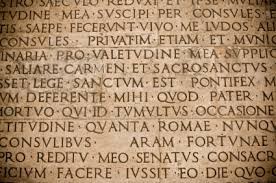
Histoire de la littérature romaine
par
Paul Albert
tome I
1870
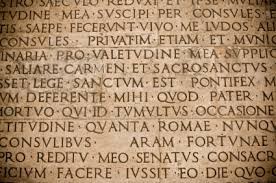
TABLE DES MATIÈRES
LIVRE PREMIER
Le peuple romain.
Niebuhr et les épopées populaires. — Les premières manifestations de la poésie latine. — Les chants de table. — Les inscriptions funéraires. — Les chants des Saliens et des Arvales. — Les vers Fescennins. — Les chants de triomphe.— La Satire. — Le vers Saturnin.— Les monuments de la prose primitive.—La loi des Douze Tables.
LE CINQUIÈME ET LE SIXIÈME SIÈCLE.
Livius Andronlcus. — Naevius. — Ennius.
LE THÉÂTRE.
Plaute. — Caecilius.— Térence
Caton (Marcus Porcius Priscus Cato Censorius).
LIVRE DEUXIÈME
LE SEPTIÈME SIÈCLE.
Tableau de la société romaine au septième siècle. — Religion, philosophie,
éducation, moeurs.
Lucilius.- Le théâtre au septième siècle. — Tragédies d'imitation. — Tragédies nationales. — Pacuvius. — Attius. — Comédie nationale. Les Atellanes.
Varron. — Lucrèce. — Catulle.
L'histoire. — Depuis les origines jusqu'à Tite-Live. — Sources de l'histoire. — Les premiers historiens. — César, Salluste.
Cicéron. — L'éloquence avant Cicéron. — Cicéron rhéteur. — Cicéron
orateur. — Plaidoyers. —Discours politiques. — La philosophie avant
Cicéron. — Cicéron philosophe. — Les lettres de Cicéron. — Les
poésies de Cicéron .
Les quelques extraits des oeuvres présentées ici ne sont pas reproduits car elles sont présentes sur ce site ainsi, il n'y a pas double emploi.
LIVRE PREMIER
LE PEUPLE ROMAIN.
Les deux peuples qui ont joué dans le monde ancien le
rôle le plus considérable, les Grecs et les Latins, ont une
origine commune. Pendant une longue période qu'il est
impossible de déterminer exactement, ils ne formaient
qu'un seul corps, parlaient la même langue, invoquaient
les mêmes divinités, menaient le même genre de vie. Les
noms des dieux les plus importants de l'Inde, de la
Grèce, de l'Italie, sont les mêmes. On retrouve encore
dans le sanscrit, le grec et le latin un grand nombre de
termes identiques pour désigner les animaux domestiques,
les plantes, les instruments de culture, les habitations,
les vêtements, les premiers éléments des sciences.
A quelle époque les diverses fractions qui forment la race indo-germanique, se séparèrent-elles pour constituer
des nationalités distinctes, et poursuivre isolément
l 'oeuvre de la civilisation ébauchée en commun ? On
est réduit encore sur ce point à des conjectures plus ou
moins plausibles. L'histoire réelle, authentique ne commence
à vrai dire pour nous que le jour où chaque peuple
nous apparaît établi dans les lieux qu'il s'est choisis,
parlant la langue qu'il s'est faite, pratiquant le culte qu'il
a imaginé, régi par les institutions civiles et politiques qu'il
s'est données à lui-même. Tout cela constitue sa personnalité
et lui assigne son véritable caractère.
Or, de tous ces peuples celui qui a exercé sur les destinées
générales du monde l'influence la plus profonde,
c'est le peuple romain. Et ce n'est pas seulement parce
qu'il est le dernier venu, parce qu'il a réuni sous sa domination
presque toutes les nations de la terre : c'est par
son esprit qu'il a été tout puissant. Il a conquis le monde,
non à la façon des hordes d'Attila ou de Gengiskan, mais
lentement, par un développement régulier de sa force.
La légende raconte qu'en creusant les fondements du Capitole,
les ouvriers découvrirent une tête humaine : les
devins consultés répondirent que là devait être la tête du
monde, ibi caput orbis futurum. Chaque Romain était
convaincu que telle était en effet la destinée de Rome, et
il se mettait résolument à l'oeuvre de la domination universelle.
Les peuples soumis partagèrent bientôt cette
croyance. La première des divinités adorées était la
déesse Rome. Dans le temps même où les barrières de
l'Empire tombent sous les coups des barbares, des poètes
comme Claudien et Rutilius célèbrent encore la Divinité
et l'Éternité de Rome. L'amour de la patrie a inspiré
aux Grecs plus d'un acte d'héroïsme, aux poëtes, aux orateurs, aux historiens des vers admirables, des pages
éloquentes ; mais c'est à Rome qu'il faut chercher le vrai
patriotisme, c'est-à-dire le dévouement absolu de tous et
de chacun à la chose publique. Le dernier des Quirites
aussi bien que le consul est prêt à sacrifier à l'État ses
biens et sa vie. C'est là une obligation stricte, une dette
contractée en naissant. Parmi la plus grande violence
des discordes civiles, l'approche de l'ennemi étouffe toutes
les haines dans un élan unanime pour la défense de la patrie.
Un sentiment aussi profond et aussi universel était
une force énorme, on le comprend, mais c'était en même
temps une force organisée. Toutes les institutions civiles,
politiques, religieuses avaient pour but de développer et
de diriger ce patriotisme.
LA FAMILLE.
La famille, composée de l'homme libre, de sa femme,
de ses fils et des fils de ses fils, est la base de l'ordre
social. Le père de famille est le chef souverain des
siens et de tout ce qui leur appartient. La femme n'est
point une esclave comme en Orient : elle n'appartient
point à la cité, il est vrai, elle est toujours dans la main
de son père ou de son mari, ou de son plus proche agnat
mâle, mais elle est maîtresse dans l'intérieur de la maison
; elle y est respectée. Le fils n'est jamais affranchi de
la tutelle paternelle, fût-il marié lui-même et père ; tout ce qu'il acquiert appartient en droit au chef de la famille.
Celui-ci peut même le vendre soit à un étranger, soit à Romain. Bien plus, affranchi, il retombe sous l'autorité
paternelle. La mort seule du père l'affranchit définitivement.
Il devient alors à son tour chef de famille et exerce le pouvoir qu'il a subi.
Mais le père de famille a des devoirs sacrés à remplir
envers ses fils. Il doit en faire des citoyens. Le but de l'éducation
en Grèce était le développement harmonieux du
corps et de l'âme, par la gymnastique et la musique. Les
poètes étaient les premiers et les plus chers instituteurs de
la jeunesse : orner et charmer l'esprit, assurer le développement
libre de toutes les facultés par des exercices
qui donnent aux membres toute leur souplesse et à l'intelligence
toute sa force, unir étroitement le beau et l'utile,
le sérieux et l'agréable, former non seulement des soldats ou des hommes d'État, ou des athlètes, ou des
artistes, mais des hommes complets posaient : voilà ce que se proposait les Grecs dans l'éducation de la jeunesse. A
Rome, l'éducation et l'instruction ne se préoccupent
point de l'individu, mais de l'État. On cherche moins à
former des hommes que des Romains. Pendant plus de
de six siècles les arts ne tiennent aucune place dans l'éducation.
La gymnastique a pour but de faire de vigoureux
soldats, non de beaux corps. Ce que l'on grave dans
la mémoire des enfants, c'est le texte de la loi des
Douze Tables, c'est là le poëme nécessaire, comme dit
Cicéron. Ainsi ils seront en état de bien servir la patrie sur les champs de bataille, et ils sauront par coeur le code national. A peine sorti des mains maternelles,
l'enfant commence son apprentissage de citoyen. Dans
l'intérieur même de la famille il retrouve Rome. Dans les
festins solennels, il chante les louanges de ses ancêtres et
des hommes illustres. Son père, qu'il accompagne partout,
l'initie aux détails de la vie publique. Il assiste du seuil
aux délibérations du sénat, aux assemblées du forum. La
gravité des moeurs qu'il a sous les yeux, la majesté de
l'État qu'il doit bientôt servir lui-même, font naître en lui
un respect sérieux et une sorte de gravité précoce. Il
associe dans un culte commun la famille et la patrie.
Toutes les qualités qu'il possède, toutes les connaissances
qu'il peut acquérir, il sait qu'il les doit à la patrie : aussi
pendant plus de six siècles, le jeune Romain resta-t-il
étranger à tous les arts qui sont le charme de la vie, mais
qui ne semblaient être d'aucune utilité pour le service
de la chose publique. Pour lui, le véritable foyer d'inspiration,
c'est le théâtre même de son action comme
citoyen ; la véritable occupation, c'est celle du forum. Après le forum, la curie, cette école supérieure
de l'homme d'État. Agir, en un mot, et agir
pour la patrie, voilà le but de la vie pour le Romain. La
vertu pour lui, virtus, c'est l'énergie virile (vir). Le Grec
au contraire se réserve en dehors des devoirs publics un
loisir qu'il consacre à la culture des arts (1).
(1) C'est le graoecum otium, pour lequel les Romains marquaient tant de mépris.
Par là,
il échappe à ce que la vie purement active a d'absorbant
et souvent d'aride. Il garde surtout son individualité,
sa liberté. Pendant les six premiers siècles de
Rome, tous les Romains se ressemblent. La même éducation,
les mêmes idées, le même but toujours présent à l'esprit, les a jetés tous dans le même moule. L'État s'agrandit,
eux ne varient point. Jamais un Grec n'eût
consenti à payer du sacrifice absolu de sa personnalité
l'unité et la force de l'État. Le Romain ne comprenait
même pas qu'il pût en être autrement. Aussi les Grecs
ont-ils été des artistes inimitables, et les Romains, les
plus grands citoyens du monde.
Mais la force est sans effet, si elle n'est organisée.
L'ordre, voilà encore une des qualités essentielles du peuple
romain. Les plus anciens souvenirs de son histoire
nous le montrent déjà en quête de cette constitution remarquable,
qui unit dans un but commun tous les éléments
de la chose publique, et les subordonne à l'utilité
générale. Rome s'élève, non point dans le territoire le
plus fertile, le plus riche en eau, où l'air soit le plus pur,
mais sur les bords du Tibre, dans des lieux souvent visités
par la peste. Seulement le Tibre est un rempart
contre les peuples du Nord et de plus c'est la route naturelle
du commerce. La fameuse constitution de Servius,
la distribution du peuple en classes et en centuries, l 'importance
et le rôle attribués à chacune de ces classes; cette
savante hiérarchie qui crée des distinctions sans élever
des barrières infranchissables, qui ne relègue en dehors de
la chose publique que les esclaves et les étrangers ; l'institution
et les priviléges de la royauté et du consulat, les
fonctions si exactement déterminées du Sénat ;la création
successive des magistratures devenues nécessaires ; cette
participation progressive et lente des plébéiens aux charges
importantes de l'État, cet art merveilleux de concilier la
stabilité et la tradition avec les progrès exigés par l'extension
de l'État et les changements survenus dans les moeurs ;
le sens pratique, en un mot, élevé à sa plus haute puissance: voilà ce qui soutient, fortifie et rend invincible la cité romaine.
Aucun des éléments qu'elle renferme n'est sacrifié,
et chacun d'eux y est mis en sa véritable place. Son organisation
militaire n'est pas moins admirable. « C'est
un dieu, dit Végèce, qui a inspiré aux Romains l'idée de
la légion. » Mais ses armées, composées exclusivement
de citoyens, n'auraient peut-être jamais conquis le monde,
si l'habile et patiente politique du Sénat, qui fut, à toutes
les époques, l'âme même de Rome, n'eut préparé de
longue main la victoire et ne l'eût rendue facile. Ce
n'est pas en effet par le génie militaire proprement dit
que les Romains sont venus à bout de tous leurs ennemis :
nous voyons, au contraire, qu'ils ont presque toujours été
battus dans leur première rencontre avec un adversaire
nouveau, les Gaulois, Pyrrhus, Xanthippe, Annibal, les
Cimbres. Ce qui a fait leur force et leur triomphe définitif,
c'est l'opiniâtreté et la discipline. Le Sénat, ce représentant
si fidèle de l'esprit romain, a déployé pour la
conquête du monde cette froide persévérance, ces efforts
obstinés et réguliers que chaque Romain mettait en oeuvre
pour conserver et accroître son patrimoine. Fermeté,
prudence, patience, économie, les qualités les plus solides
et les moins brillantes, vous les retrouverez au premier
plan à toutes les époques de l'histoire de la République,
à tous les moments de l'existence de chaque Romain.
Le fameux M. Porcius Caton en estle type le plus achevé.
LA RELIGION.
Mais l'utilité n'est pas le but unique de l'homme. En
dehors et au-dessus des nécessités de la vie, il y a des
besoins d'un ordre supérieur. C'est la religion qui doit les satisfaire. Chez tous les peuples de l'antiquité,
la
religion fut en même temps la poésie et l'art : chez les Romains
seuls elle n'eut point ce caractère. Quand nous lisons
les poëtes du siècle d'Auguste, nous nous croyons
transportés dans le monde hellénique : les divinités, les
légendes, les fables sont les mêmes. Mais tout ce monde
divin est artificiel; mais cette religion poétique n'a rien
de national. Les dieux de l'Inde et de la Grèce, personnifications
colossales ou simplement humaines, possèdent
le mouvement et la vie : ils sont nés, ils ont vécu, aimé,
souffert ; une immense famille composée de types variés
à l'infini représente sous des traits divins tous les phénomènes
de la nature, toutes les idées de l'homme, toutes
ses impressions. De là une incroyable diversité dans les
figures célestes, des couleurs éclatantes, des individualités
nobles, terribles, gracieuses, agissantes surtout : de là
les épopées gigantesques de l'Inde, vaste déroulement de
la nature personnifiée dans ses images les plus radieuses ;
delà l'Iliade, le premier et splendide affranchissement des
personnes divines qui, jusque-là emprisonnées dans la
nature, viennent s'épanouir, humaines et frémissantes de
vie parmi les hommes. Rien de tel en Italie. Les conceptions
naturalistes primitives que ce peuple a puisées à
la source commune avec les Grecs et les Indous, il ne les
traduit point en images humaines. L'idée reste chez lui
dominante, tandis qu'en Grèce elle disparaît sous l'éclatante
parure du costume. Les dieux Romains sont des
signes des êtres et des choses, non des individus. Ils ne se
marient point, ils n'engendrent point, ils ne se mêlent
point au tourbillon des passions humaines; ils n'ont pas
d'histoire. Ils sont innombrables, car ils reproduisent
tous les aspects de la nature extérieure, toutes les circonstances de la vie de l'homme : chaque homme a un
Dieu avec lui (genius) ; un dieu spécial préside à chaque
opération des travaux des champs ; il y a un dieu pour
semer, pour herser, pour sarcler, pour couper le blé, le
lier en gerbes, le rentrer, etc., etc. Mais ces divinités, on
le voit bien, ne sont que de pures abstractions. Chez les
Grecs, au contraire, tout est concret,
Tout prend un corps, une âme, un esprit, un visage.
Ici l'imagination ne joue aucun rôle ; tout est arrêté,
nu, sec; mais les croyances gagnent en profondeur et en
gravité ce qu'elles perdent en éclat et en grâce. Ainsi
conçue, la religion reçoit d'eux le nom qui lui convient
entre tous. Elle est un lien, et un lien moral. Mais comme
la famille, comme la cité, comme la légion, la religion
sera organisée. Les dieux sont divisés en grands dieux
et en petits dieux (dii majorum gentium — dii minorum
gentium), les divisions de la cité terrestre se retrouvent
dans la cité céleste. Les dieux des patriciens ne sont
point ceux des plébéiens : les priviléges religieux des premiers
sont refusés aux seconds. Pendant les sept premiers
siècles de Rome, les dieux du dehors sont aussi
sévèrement repoussés de la cité que les étrangers eux-mêmes.
Ne qui nisi romani dii, neu quo alio more
quam patrio colerentur (1).
(1) Cicer., de Leg., II, 19.
Toutes les formalités du
culte sont nettement déterminées, et il est interdit de s'en
écarter en quoi que ce soit. Une foule de prêtres, desservants
des principales divinités, interprètes de la volonté
divine, ordonnateurs des cérémonies, exercent des
fonctions distinctes, mais s'ils forment des corporations,
ils ne sont point une caste spéciale. Tout citoyen peut
être prêtre à son tour ; le sacerdoce est une fonction civile comme les autres. De plus, les augures, les aruspices,
n'exercent leur ministère d'interprètes de la divinité
que sur l'autorisation et la requête formelle du magistrat
romain. Les choses de la
religion, comme tout le reste, sont au service de la cité,
La croyance est une force; elle est dans la main du sénat
ou des patriciens. De même que pendant près de cinq
siècles ils se réservèrent spécialement la connaissance
des formules judiciaires ; ainsi tout le rituel, la fixation des
jours de fête, celle des jours fastes ou néfastes, et par
suite du calendrier tout entier, tout cela resta pendant
longtemps la propriété exclusive d'un ordre qui représentait
alors l'âme de la nation et de la politique romaines.
Si la littérature d'un peuple est l'image de l'état social,
politique et religieux de ce peuple, quel sera le caractère
de la littérature romaine? On peut assurer que
l'imagination ne sera point sa qualité dominante. Nous ne
trouverons point à son berceau quelqu'une de ces vastes
compositions poétiques, comme les Védas, l'Iliade, les Nibelungen.
Le Romain, qui a immobilisé ses dieux et emprisonné
le culte dans des formules rigoureuses, n'aura
ni épopée nationale originale, ni chants lyriques religieux.
L'invention lui fera défaut, aussi bien que l'élan. Il ne
pourra traduire en images éclatantes, en types vivants ce
monde mystérieux d'idées, de sentiments, d'impressions,
qui naissent dans l'âme à la vue des phénomènes infinis
du monde extérieur. Voué de bonne heure aux rudes travaux
de la terre, courbé sur la charrue ou réduit, pour
vivre, à aller piller les moissons de son voisin, il restera
enchaîné à ce sol ingrat qui le nourrit à peine ; et la vue
de la nature n'éveillera point en lui l'enthousiasme; elle
ne lui rappellera que la dure loi du travail et de l'épargne. Pendant plusieurs siècles, faible, toujours menacé,
toujours préoccupé d'agrandir le territoire public (ager
publicus), la guerre sera pour lui non un stimulant de
poésie,
mais un labeur plus rude que les autres. La
nécessité, le calcul, les lentes combinaisons de la politique
: voilà ce qui absorbera toutes ses facultés, et arrêtera
en lui tout essor. Il ne s'avisera point de lui-même
de chanter, ou quelques mélopées sauvages suffiront
à ses besoins d'expansion rhythmique. La poésie pénétrera
dans ses murs, mais comme une importation étrangère,
et elle y sera longtemps méprisée comme chose inutile.
Cicéron aurait deux fois plus d'années à vivre qu'il ne
trouverait pas encore le temps de lire les lyriques grecs.
Horace les traduit et s'en fait gloire ; Virgile imite Homère
et les Alexandrins : tous deux lentement, laborieusement
composent des vers admirables et d'une science profonde.
Mais ne cherchons pas dans la poésie l'originalité de ce
peuple : elle ne saurait y être. C'est à la prose qu'il faut
la demander. Cette énergie du Romain, ce sens pratique
si sûr, cette gravité dans les moeurs, ce patriotisme si
absolu, toutes ces qualités solides et rares, elles trouvent
dans la prose leur expression naturelle et tout leur relief.
Qu'il travaille pour la chose publique ou pour sa propre
chose (res publica, res privata), le Romain est avant
tout homme d'affaires, omnium utilitatum et virtutum
rapacissimus, dit Pline. De là sa prédilection pour les
arts et les sciences d'une utilité manifeste et immédiate.
Le premier ouvrage d'une certaine étendue composé en
prose est un traité d'exploitation rurale, le De re rustica,
de Caton. La première et la plus estimée des sciences,
c'est celle du droit. Le seul art pour lequel ils n'affectèrent
jamais de mépris, c'est l'éloquence : elle a ses fondements dans le droit : et c'est de tous les arts le plus utile
soit à l'homme d'État, soit au particulier. La philosophie,
au contraire, sera redoutée ou méprisée pendant plus de
six cents ans. Quoi de moins utile en effet que les spéculations
de la métaphysique ? Le jour où la philosophie obtiendra
droit de cité à Rome, elle se sera réduite volontairement
à la seule morale : de là la prédominance des
deux écoles grecques qui ont fait à cette branche de la
philosophie la part la plus large : l'épicurisme et le stoïcisme.
Les problèmes de la destinée de l'homme, du souverain
bien, des droits et des devoirs, de l'ordre et de
l'importance des vertus : voila les seuls objets véritablement
dignes de l'attention d'un Romain. Envisagée ainsi,
la philosophie touche par une foule de points à l'éloquence
; c'est à l'éloquence qu'elle empruntera sa méthode
d'exposition et son style. Plus de théories ou de
systèmes, mais des plaidoyers. L'histoire est aussi considérée
comme une province de l'éloquence. Les amis de
Cicéron le pressaient fort de s'exercer dans ce genre; et
lui-même était convaincu qu'il y eût réussi. La forme et
la couleur oratoires dominent dans Tite-Live. Enfin,
dans les derniers siècles de l'empire, lorsque depuis
longtemps toute vie publique a cessé, la littérature n'est
plus guère représentée que par les écoles des rhéteurs et
celles des jurisconsultes. L'éloquence est réduite à une
technique aride ; elle n'a plus d'aliments, plus de sujets,
plus de flamme par conséquent ; mais elle demeure le
premier des arts, comme le droit reste la première des
sciences. Ainsi se maintint, malgré toutes les révolutions
sociales, politiques et religieuses, le ferme caractère
de ce peuple qui suppléa à l'imagination par la discipline,
et préféra toujours au beau l'utile et le bon.
Niebuhr et les épopées populaires. — Les premières manifestations de la poésie latine. — Les chants de table. — Les inscriptions funéraires. — Les chants des Saliens et des Arvales. — Les vers Fescennins. — Les chants de triomphe. — La Satire. — Le vers Saturnin.— Les monuments de la prose primitive. — La loi des Douze Tables.
§ I.
Dès l'année 1738, époque de la publication du livre de
Beaufort sur l'incertitude des cinq premiers siècles de
l'histoire romaine, l'histoire traditionnelle et légendaire
de Rome fut ruinée. Dans les premières années de ce
siècle, Niebuhr essaya de la refaire. C'était en 1811, au
fort de la grande mêlée des peuples de l'Europe, dans cette
surexcitation des nationalités que la guerre avive. Romances
espagnoles, ballades écossaisses, irlandaises,
chansons des Tyroliens, des Russes, des Serbes, étaient
incessamment traduites d'une langue dans une autre.
L'Allemagne venait d'exhumer son fameux poëme des
Nibelungen ; l'audacieuse supercherie de l'Ossian de
Macpherson avait réussi : il y avait un enthousiasme universel
pour les épopées populaires, naïves, jaillissant
de l'âme des multitudes. Wolff avait donné le signal de
cette restauration des chants nationaux au profit des
peuples par ses fameux Prolégomènes, qui supprimaient
la personnalité d'Homère et remplaçaient le poëte par le
choeur immense des Hellènes. Ces conceptions un peu aventureuses de la critique
nouvelle, Niebuhr les appliqua à l'histoire des premiers
siècles de Rome. Beaufort s'était borné à la ruiner dans
sa base ; son livre était un monument élevé au scepticisme.
Niebuhr reprend ces ruines et avec elles reconstruit
l'histoire. Cette histoire n'est à ses yeux autre
chose qu'une série d'épopées, transformées plus tard
en une suite chronologique d'événements réels. Il existe
dans la même ville deux peuples, deux races bien
distinctes, les patriciens et les plébéiens. Les patriciens
sont le peuple primitif, le maitre légitime de la cité. Ils
sont divisés en gentes ou familles, dont les membres sont
unis par la loi et des sacrifices communs. Les plébéiens
sont la race vaincue, incorporée aux vainqueurs, mais
réduite au rôle de vassaux, de clients, n'ayant part ni à
la loi ni à la religion. Ces deux peuples, bien que réunis
un moment par la constitution de Servius Tullius, restent
cependant séparés. Chacun d'eux a son assemblée, ses
magistrats, ses intérêts particuliers, son caractère. Les
retraites du peuple ne sont autre chose que la séparation
de deux races unies, mais non confondues. Telle est
d'ailleurs dans le monde antique la constitution de presque
toutes les cités. Sparte a ses ilotes, Athènes ses
métèques, Carthage, ses non-citoyens tributaires. Ainsi
s'expliquent les divisions sociales, la séparation des magistratures
patriciennes et plébéiennes, les révolutions
intérieures, l'expulsion des rois, l'exil de Coriolan, etc.
L'âme de l'histoire primitive, c'est la coexistence dans
les mêmes murs de deux peuples distincts qui plus tard se
confondirent.
Quant aux fables mêlées à cette histoire et qui en sont
non la substance, mais l'ornement, c'est le peuple romain lui-même qui les a créées. La légende de Romulus
est une épopée, celle de l'enlèvement des Sabines en est
une autre. La trahison de Tarpeia en est un épisode.
Le règne de Numa est une épopée d'un autre genre,
elle est pacifique, comme celle de Romulus était guerrière.
L'élément guerrier éclate dans l'épopée de Tullus
Hostilius et les admirables épisodes des Horaces et des
Curiaces. La ruine d'Albe est une Iliade, comme la prise
de Troie. L'histoire des derniers rois de Rome n'est ni
moins poétique ni moins expressive. Sous Ancus Martius
arrive dans la cité le Lucumon étrusque, chef de
cette famille des Tarquins, odieux représentants de la
caste oppressive. C'est lui qui plonge le peuple dans les
carrières, qui construit les égouts, les aqueducs, le cirque.
Il est assassiné. Le peuple prend un roi tiré de ses
rangs, c'est l'esclave Servius Tullius. Ici les événements
revêtent une couleur toute poétique. Les deux filles de
Servius, l'une bonne, l'autre criminelle, sont unies aux
deux Tarquins, l'un honnête, l'autre scélérat. La femme
vertueuse, le mari honnête sont assassinés, et les deux
meurtriers s'unissent. Tullie fait passer son char sur le
corps de son père. Les divers épisodes de l'histoire de
l'expulsion des rois, la mort de Lucrece, la folie de
Brutus, l'emblème du bâton grossier rempli d'or, le baiser
à la terre, la conspiration des fils du vengeur du peuple,
Horatius Coclès, Scévola, Clélie, fragments d'une vaste
épopée, dont le dénoûment suprême est la victoire du
lac Régille, à laquelle prennent part Castor et Pollux
montés sur des chevaux éclatants de blancheur, et qui
viennent baigner leur corps poudreux dans la fontaine du
Juturne.
Or ces épopées sont l'oeuvre du peuple romain. En vain l'on s'obstine à le représenter comme dépourvu d'imagination et d'invention. C'est lui qui a fait son histoire,
vaste composition poétique.
Mais, quand et comment se constituèrent ces chants
nationaux ? L'incendie de Rome par les Gaulois anéantit
presque tous les documents authentiques. Il ne resta
plus des trois siècles et demi qui avaient précédé que le
souvenir vague de grands événements accomplis. Or ce
vague des souvenirs est éminemment propre à frapper les
imaginations et à les féconder. Les faits dominants survivent
seuls ; la fantaisie populaire groupe autour de ces
faits les épisodes ; elle crée le merveilleux et le confond
avec le réel. L'histoire authentique faisait défaut, le peuple
la remplaça par la légende. Ainsi avaient fait les rapsodes
du cycle thébain et du cycle troyen. Mais l'épopée
romaine eut un caractère particulier. Comme ce peuple
était divisé en deux nations, patriciens et plébéiens,
vainqueurs et vaincus, la grande épopée nationale se
forma de deux choeurs distincts : le chant patricien et
le chant plébéien. Le génie populaire créa les légendes où
revivait le souvenir des luttes et des triomphes de la
plèbe : le génie patricien créa le reste. Ainsi le cinquième
siècle de Rome est le véritable âge d'or de la littérature
latine. A cette époque seulement s'est développé
le génie profond et puissant de ce peuple. Il a
refait son histoire détruite dans ses monuments authentiques,
et il l'a refaite à la façon des légendes, par une
inspiration énergique, en suppléant, en agrandissant, en
personnifiant. Il n'a pu le faire plus tôt, car l'histoire
existait ; il n'a pu le faire plus tard, car Rome fut mise en
contact avec la Grèce et devint grecque. La poésie nationale
fut dédaignée en présence des grâces maniérées de l'hellénisme. L'élément patricien, c'est-à-dire l'élément
oppressif, domina seul, et livra Rome à l'étranger.
Les Métèllus et les Scipions sont les représentants de cette
révolution antinationale qui détruisit la première et
splendide éclosion du véritable génie romain. L'instrument,
ce fut un étranger, le Calabrais Ennius, poëte de
commande aux gages des grandes familles, qui substitua
aux éclatantes couleurs des épopées primitives les froides
contrefaçons des poëmes grecs, et créa ainsi cette école
d'imitation bâtarde qui a formé les Horace, les Virgile,
les Properce, et tout le troupeau servile de ceux qui se
trainèrent sur leurs traces.
Rien ne sourit plus à l'imagination que cette hypothèse
d'une immense épopée populaire; rien ne s'accorde
moins avec la réalité.
Et d'abord il n'en est pas resté le moindre fragment :
aucun grammairien, aucun archéologue n'en cite un seul
vers, n'en rappelle un seul mot ; aucun d'eux ne semble
en soupçonner l'existence. Et cependant presque tous
rappellent ou mentionnent les monuments les plus anciens
de la poésie primitive, tels que le chant des prêtres
Saliens et celui des frères Arvales. Mais un argument,
plus grave encore que celui du silence de tous
les auteurs, est tiré du caractère même du peuple
romain et de son existence pendant les quatre premiers
siècles de son histoire. Vainement chercherait-on en lui
quelques-uns des traits propres aux nations poétiques.
Ressemble-t-il à ces Ioniens qu'une vie facile sous un
ciel radieux, dans un pays fortuné, provoque à l'expansion
du chant? Est-ce au milieu des infécondes plaines de
Rome ou sur les coteaux arides de la Sabine, que l'on
placerait quelques-uns de ces rapsodes qui parcouraient les cités et les bourgs de la Grèce, qui trouvaient dans
chaque île, dans chaque ville, une tradition nationale,
une légende locale, à Lemnos, celle de Philoctète, à Lesbos,
celle des Argonautes, en Crète, celle de Minos, à
Salamine, celle d'Ajax et de Teucer, à Ithaque, celle
d'Ulysse, dans le Péloponnèse, celle des Atrides, à Thèbes,
celle des Labdacides, dans la Thessalie, le berceau
de tous ces personnages poétiques, Orphée, Musée, Linos,
Thamyris? Le pays est ingrat, pauvre, malsain; la
peste et la famine le désolent régulièrement. Pas de
rapsodes voyageurs faisant en tous lieux leur moisson de
belles légendes; mais des hommes opiniâtres, courbés
sur la charrue, ne quittant le hoyau que pour prendre
la lance, se défendre contre le voisin pillard, ou le
piller à leur tour. Rude et difficile est leur existence :
combats incessants, contre le sol d'abord (il faut labourer
des cailloux,dit le vieux Caton), contre les bandes
armées qui menacent le territoire, contre les oppresseurs
du dedans, les patriciens et les usuriers. Le
Romain laboure, se bat et plaide. Il réclame l'égalité
des droits civils et politiques, l'égalité des mariages,
l'abolition des dettes. Rien dans sa vie qui rappelle de
près ou de loin les nations poétiques et créatrices, les
Hellènes, les Burgondes, les Scandinaves, les Outlaws
de l'Angleterre, les compagnons de Pélage, les Bretons
d'Arthur, les Francs de Charlemagne. Interrogez la
langue : elle du moins doit avoir conservé le souvenir
de ces épopées antiques : aèdes, rapsodes, scaldes,
bardes, trouvères, peu importe le nom, tous les pays
où a fleuri la poésie ont un mot pour désigner cet être
à part, qui est l'âme chantante de la nation. Le mot
poëte, poeta, n'est que du sixième siècle, et c'est un mot grec. Il n'y a qu'un mot pour exprimer l'infinie variété
des produits de l'inspiration poétique, carmen. La loi
des Douze Tables désigne ainsi les vers injurieux.
Les prosateurs, Tite-Live et Cicéron, l'emploient dans
le sens de texte (Lex horrendi carminis erat leges
Duodecim Tabularum, carmen necessarium). Enfin,
dans ce pays où s'est développée la longue série
des épopées nationales, le poëte sera un être à part,
estimé, honoré, vénéré. Loin de là : à peine commence-
t-il à apparaître, il est méprisé et honni. Les
institutions, les moeurs, les fêtes publiques, religieuses
ou patriotiques auront du moins gardé la trace de ce
penchant poétique commun à tout un peuple. Il y
aura dans le Latium comme en Grèce des concours
de poésie. Loin de là : les jeux, les fêtes ont un caractère
exclusivement guerrier; et le peuple, à toutes
les époques de son histoire, a toujours préféré à la
représentation des tragédies et des comédies les danses
d'ours et de saltimbanques, les exhibitions du grand
triomphe, et enfin les combats de gladiateurs. Ses
plaisirs sont violents; ses spectacles favoris sont ceux
où se déploient l'adresse et la force du corps. La
guerre et le travail : voilà où s 'épuise toute son activité.
Il conquiert, recule la grosse borne de son territoire,
organise la cité, fonde le Droit, réglemente la religion.
Voilà ses arts à lui : Hoc tibi erimt artes... Comment
transformer en un choeur d'aèdes le peuple le plus essentiellement
positif et calculateur qu'il y eût jamais ?
§II
Il faut bien le reconnaître, cependant, Niebuhr invoquait
à l'appui de son opinion l'autorité de deux ou
trois textes. Le premier est tiré de Cicéron. « Que
n'existent-ils encore ces vers dont parle Caton dans
ses Origines! Ces vers qui bien des siècles avant lui
étaient chantés dans les festins par chaque convive
pour célébrer la gloire des grands hommes ! »(Brutus, 19).
Dans deux autres passages (Tuscul., IV, 2; de
Oral., III, 51), il reproduit la même idée. Horace rappelle
en poète cet usage antique. Valère Maxime (11, 1, x) fait allusion au même fait,
et Varron, cité par Nonnius (assa voce) également, avec
certaines variantes.
Ainsi le fondement de cette hypothèse d'épopées populaires
repose sur un ancien usage qui n'existait déjà
plus au temps de Caton, et suivant lequel chaque convive
chantait à son tour les exploits des hommes illustres.
Ces chanteurs étaient, d'après les témoignages différents
des auteurs, tantôt des vieillards, tantôt des jeunes
gens. Quels étaient ces chants? C'était seulement dans
des festins solennels de commémoration ou de funérailles
qu'ils retentissaient. On peut donc les considérer
comme une sorte d'adieu rhythmique envoyé au mort
par chacun des convives. En effet, suivant le texte de la
loi des Douze Tables, la coupe passait de main en main,
et chacun, en la recevant, devait sur un rhythme consacré dire quelques phrases en l'honneur du défunt. Dans les
funérailles qui précédaient le festin, se déployaient tout
le faste et l'orgueil des patriciens ; les décorations funèbres
les plus splendides rappelaient non seulement l'illustration
du mort, mais celle de la famille ; l'éloge était
prononcé sur la place publique. Le festin suivait ; et
les chants des convives n'étaient autre chose que le
résumé rapide et concis du discours prononcé devant le
peuple. C'est là un usage essentiellement romain et
surtout essentiellement patricien; seuls les patriciens
avaient un père, seuls ils avaient des ancêtres, seuls ils
pouvaient les célébrer en public et dans l'intérieur de
leur maison. La loi des Douze Tables ne laisse aucun
doute à cet égard : « honoratorum virorum laudes in
concione mernorentur. » Quant au citoyen, qui avait
vécu et était mort plébéien, ce luxe lui était interdit :
ses funérailles étaient silencieuses (tacita funera). C'est
donc singulièrement exagérer la portée de quelques
textes, qui même ne s'accordent pas, que de transformer
en épopées populaires, et par conséquent plébéiennes,
un usage ou plutôt un privilége essentiellement patricien.
Que si l'on se demande quel était le caractère de
ces chants laudatifs, les inscriptions tumulaires des
Scipions peuvent en donner une idée. Bien que d'une
époque fort postérieure aux origines proprement dites de
la littérature latine, elles expriment dans leur brièveté
hautaine le langage probable de ces premiers bégayements
de l'orgueil patricien. Il faut joindre enfin à ces monuments presque informes
de la littérature primitive le chant laudatif qui accompagnait
le cortége funèbre, et auquel s'unissaient
les accords de la flûte. On l'appelait naenia funebris.
Aucun modèle de ce genre de poésie ne nous a été
conservé : nous savons seulement qu'elle était chantée
par les parents du mort. Plus tard on chargea des pleureuses à gage de ce soin (praeficae). Après la mort
d'Auguste, le sénat ordonna que la nénie funèbre en son
honneur serait chantée par les jeunes garçons et les
jeunes filles des premières familles. Caligula se fit chanter
de son vivant sa nénie laudative. Mais ici encore,
comme pour l'éloge funèbre et le chant de table, les
patriciens seuls jouissaient de ce privilége. Il est donc
impossible de découvrir dans aucun des usages de la
Rome primitive la moindre trace d'une inspiration populaire,
créatrice de vastes épopées.
§ Ill.
Il ne faut pas la chercher non plus dans les vestiges inintelligibles qui nous ont été conservés des litanies chantées avec accompagnement de danses et de flûte par les prêtres Saliens et les frères Arvales. Comme l'a fort bien montré M. Mommsen, dans ces fêtes religieuses la danse et la musique étaient le principal, les paroles étaient l'accessoire. Il en sera de même au vie siècle. La mimique scénique passe avant le texte même du drame ; l'acteur avant le poëte. A toutes les époques, le côté sensible et matériel de l'art dominera. Autant qu'on en peut juger par les restes de cette poésie barbare, ces chants religieux n'étaient qu'une simple invocation aux dieux, où se mêlaient des commandements pour l'ordre de la cérémonie, adressés aux prêtres et à la foule. C'est ainsi du moins que les interprètent les plus récents archéologues. Nous ne possédons aucun monument des antiques prédictions des devins et parmi eux du célèbre Marcius, dont le nom était resté dans la mémoire des hommes : ces interprètes de la divinité, dont ils entendaient la voix dans les solitudes murmurantes des forêts, ces faiseurs d'incantations magiques destinées à conjurer les mauvais sorts, les vents, la pluie, à faire passer les semences d'un champ dans un autre, étaient contemporains des premiers âges du Latium. Chez tous les peuples, le spectacle des choses extérieures, la contemplation et l'effroi des phénomènes de la nature, ont provoqué les premières expansions du génie poétique mais l'élan inspiré, la couleur, la vie ont manqué aux chanteurs de l'Italie. La légende même n'a pu faire, pour eux, ce qu'elle a fait chez les Grecs pour les Orphée, les Musée, les Linus.
§IV.
C'est que tout autre est le génie de la race latine.
Le Grec anime, personnifie, divinise tout ce qu'il voit,
tout ce qu'il pense, tout ce qu'il sent ; le Latin reste
dans l'abstraction. Le Grec est prompt à l'enthousiasme ;
il revêt de belles formes les objets et les idées : le Latin
est railleur comme tous les esprits positifs. Il a le génie
de la mimique, de la farce. Aussi les plus anciens monuments
de poésie italique populaire dont il soit fait mention,
ce sont des vers satiriques. Tels étaient, on n'en
peut douter, les vers fescennins, les chants de triomphe,
les satires proprement dites, et les premiers essais de comédie,
les farces Atellanes. Ce penchant à la raillerie a
créé les vieux mots succinere, occentare, pipulus, obvagulatio ; c'est encore lui qui a donné naissance à ces innombrables
sobriquets, destinés à rappeler soit un vice
habituel, soit une difformité physique, comme Nasica,
Cornutus, Capito, Bestia, Verres, Bibulus, Dentatus, etc. Un article de la loi des Douze Tables punissait de
mort tout auteur de vers injurieux. Cette grosse gaieté
bouffonne devint plus tard, l'urbanité ; mais la satire demeura
le genre vraiment national, et Quintilien a raison
de dire : Satira tota nostra est.
Les vers Fescennins ne sont pas originaires de Fescennie,
ville d'Étrurie, pas plus que coerimonia n'est
dérivé de Coeré. C'est un des plus anciens genres de
poésie, et de poésie tout à fait nationale. Voici, d'après
Horace, quelle en est l'origine probable (1).
(1) Epist. II, i, 139.
« Les Romains d'autrefois, laboureurs, hommes énergiques, riches de peu, après avoir rentré la moisson,
accordaient dans un jour de fête quelque relâche à leur
corps et à leur âme qui supportait dans l'espoir de la fin de
rudes travaux. En compagnie de leurs aides, de leurs enfants,
de leur femme fidèle, ils apaisaient la Terre par le
sacrifice d'un porc ; Silvain, en lui offrant du lait ; en présentant
des fleurs et du vin au Génie qui préside à nos
courts instants. C'est de cet usage que naquit la licence de
la poésie fescennine, qui dans des vers alternés jetait des
sarcasmes rustiques. »
D'abord ces plaisanteries enjouées furent bien accueillies
de tous, mais les railleries devinrent envenimées, les
plus honnêtes familles furent attaquées ouvertement;
alors fut portée la loi qui interdisait de marquer qui que
ce fût d'un vers injurieux (malo carmine). Virgile parle
aussi de ces antiques laboureurs d'Ausonie, qui s'égayent
en des vers sans mesure et un rire sans frein :
Versibus incomptis ludunt risuque soluto.
Presque tous les chants primitifs ont la même origine, ils
sont nés dans la joie des fêtes, à l'occasion de la moisson
ou des vendanges. Mais en Italie ils ont ce caractère particulier
de licence satirique. Il faut y joindre l'idée superstitieuse
qui a donné leur nom aux vers fescennins. Il y avait
en Italie un Dieu Fascinus, dont la statue était placée sur
le char du triomphateur. L'esclave public, qui tenait au-dessus
de la tête de celui-ci la couronne d'or massif, lui
criait de temps en temps : « Retourne-toi, Imperator, et regarde
Fascinus, afin que ce Dieu conjure la fortune qui
se plait à châtier la gloire. » Ce dieu Fascinus était la
divinité qui conjurait les mauvais sorts. De là son importance
chez un peuple de laboureurs qui croyaient aux incantations magiques, aux sorts qui faisaient passer la semence
d'un champ dans un autre. La loi des Douze Tables
punissait de mort celui qui avait enchanté les fruits
de la terre (qui fruges excantassit) : Virgile a conservé
le souvenir de cette antique superstition, quand il parle
de ce mauvais oeil qui fascine les agneaux à la mamelle et
les fait dépérir. Quant à ces vers alternés, dont parle Horace,
c'est un usage que nous retrouvons dans toutes les
fêtes de l'ancien culte. Aux Lupercales, la troupe se divisait
en deux bandes : l'une, celle des brebis; l 'autre, celle
du loup; aux fêtes de la moisson, il y avait aussi un double
choeur : l'un chantait les louanges de Pan, de Silvain,
de Faune, de Silène ; le second répondait par des vers où
étaient rappelés en termes grossiers et licencieux le souvenir
des mésaventures amoureuses de ces dieux à demi
ridicules. Après avoir célébré et raillé les dieux, on
raillait les hommes. C'était un échange de quolibets
salés. Ovide fait allusion à ces anciens usages (1).
(1) Ovide, Fast., III, 525-695; 11,655; VI, 407.
Mais c'était surtout dans les réjouissances qui suivaient
les noces que la verve de ces improvisations licencieuses
se donnait pleine carrière. C'est là que ce malin dieu
Fascinus jouait un grand rôle, surtout quand l'âge des
époux n'était pas assorti, qu'une vieille femme épousait
un jeune homme. Peu à peu les vers fescennins ne furent
autre chose que des épithalames; mais, jusque dans les
derniers temps de Rome, ils conservèrent le privilége antique de la verve sans frein. — Claudien célèbre, en
poëte de cour, le mariage d'Honorius et de Marie, mais il
nous apprend que le choeur populaire fait entendre à la
porte du palais des chants d'un caractère bien plus libre.
Ce même caractère satirique et licencieux se retrouve
dans une des institutions les plus imposantes de Rome, la
cérémonie du triomphe. Le vainqueur, porté sur char un magnifique précédé du butin et des prisonniers, s'avançait
entre deux haies de soldats, et montait au Capitole
pour y rendre grâces aux dieux. Les soldats se divisaient
en deux choeurs qui se répondaient : les uns chantaient les louanges du vainqueur, les autres lui lançaient
au visage une foule d'invectives et de sarcasmes.
Les Cincinnatus, les Camille, les Potitius, subirent ces
explosions de la verve soldatesque (1).
(1) Tit. Liv., VII, 10, 38 ; IV, 20; X, 30; XXVIII, 9 ; XXIX, 7.
Nous retrouvons encore ici comme dans les vers fescennins ce double choeur, ces chants alternés et satiriques. Théocrite offre plusieurs exemples de ces joutes de quolibets, Virgile en a reproduit un faible spécimen dans son églogue troisième; Horace est resté plus fidèle à la tradition nationale dans sa peinture du combat d'invectives entre les deux bouffons Sarmentus et Messius (2).
Nous
ne possédons aucun spécimen des choeurs satiriques
chantés au triomphe de Cincinnatus et de Camille ; mais il
est facile de s'en faire une idée en lisant ceux qui saluèrent César. Ils sont inintelligibles, si l'on ne les divise en
un double choeur :
Gallias Caesar subegit — Nicomedes Caesarem.
— Ecce Caesar nunc triumphat qui subegit Galliam,
— Nicomedes non triumphat qui subegit Caesarem.
Ces antithèses rapides, ces rapprochements qu'un mot
fait jaillir, sont éminemment propres à l'esprit romain.
Suétone est plein de ces sarcasmes préparés par un
éloge et d'autant plus pénétrants. Les empereurs en furent
plus d'une fois atteints et percés profondément. C'est
au théâtre surtout que se conserva la vieille liberté ; nous
en retrouverons plus d'un exemple.
La Satire proprement dite appartient aussi à cette période
primitive. Aucun monument ne s'en est conservé,
mais les poëtes de l'époque immédiatement postérieure,
Naevius, Ennius et Lucilius lui-même, ont reproduit la
forme et jusqu'à un certain point le caractère de leurs
devanciers anonymes. La Satire a la même origine que les
vers Fescennins. Dans les fêtes appelées Liberalia, qui
avaient lieu au printemps, on présentait aux dieux qui
protégeaient les travaux des laboureurs un vaste bassin
rempli des prémices de toutes les productions de la terre.
Ce bassin était appelé lanx Satura, d'un mot osque qui
signifie pot-pourri. Puis commençaient les chants joyeux
et railleurs accompagnés du son des instruments et de
danses. C'étaient des contes licencieux, des plaisanteries
salées, des équivoques grossières. On y tournait surtout en
ridicule certains personnages comme les vieillards amoureux,
les vieilles femmes éhontées, les débauchés. En
même temps les assistants se faisaient des masques avec
des écorces d'arbre pour effrayer les passants. On suspendait aux arbres des mannequins de Bacchus, et
des choeurs de paysans ivres échangeaient des invectives
grossières. C'est dans des circonstances analogues que
naquirent la tragédie et la comédie chez les Grecs : mais
les deux peuples qui devaient à leur origine commune
une religion identique dans le fond et des fêtes à peu près
semblables développèrent sous d'autres cieux des qualités
différentes. Des choeurs dithyrambiques et ithyphalliques,
Eschyle et Aristophane formèrent le drame et la comédie.
Dans le Latium, les expansions de la gaieté populaire
ne produisirent aucune oeuvre d'art.
Il n'en sortit même pas une métrique quelconque, si
rudimentaire qu'elle fût. Tous ces chants populaires
avaient, pour expression uniforme, non un vers régulier,
mais un nombre, sans mesure fixe, appelé saturnin,
qu'Horace qualifie de horridus. Le saturnin variait dans
ses dimensions ; il était de trois et de sept pieds : la cadence
seule coupait les syllabes, composées en général
d'une succession redoublée de trochées unis à des ïambes,
et par là assez bien choisis pour rendre les saillies des
ripostes. C'est dans ce mètre qu'étaient composés les antiques
chants religieux, les prédictions des devins. Le Saturnin
s'appelait aussi Faunien.
Les chants de table, de funérailles, de triomphe, les inscriptions
tumulaires étaient aussi en vers saturnins.
De cette poésie primitive les débris sont rares et de
peu d'importance. Si l'on en a parlé ici, c'est qu'il était nécessaire de constater l'impuissance native de la race
latine à concevoir et à rendre sous une forme harmonieuse
et colorée les idées et les sentiments qui l'animaient.
Remarquons de plus que ces ébauches grossières
d'oeuvres poétiques ont presque toutes le même caractère
: un penchant à la raillerie. Le Romain est le citoyen
sérieux par excellence ; mais s'il cesse de l'être, s'il accorde
à son corps et à son esprit toujours tendus quelque
repos, s'il s'égaye en un mot, sa gaieté n'a rien de délicat ;
c'est une brusque détente, une explosion grossière.
Rien de plus contraire que cette disposition d'esprit à
l'essor de la grande poésie.
§V.
Sauf quelques restes de la loi des Douze Tables, il n'est rien parvenu jusqu'à nous des monuments de la prose primitive. La tradition seule s'en est conservée. Ces monuments étaient déposés dans les temples, et ils ont péri dans l'incendie de la ville par les Gaulois. Nous nous bornons à en donner un simple catalogue. Les Lois royales (Reges Regiae) remontaient aux premiers temps de Rome. Le droit Papirien (Jus Papirianum). Les livres du roi Numa (Libri Numae Pompilii) découverts seulement en 573, et fort probablement supposés, furent condamnés au feu par le Sénat. Les actes officiels des principaux magistrats religieux ou politiques, et qu'on désignait sous le noms de Libri Lintei, Libri pontificales,. Commentarii pontificum, Libri augurales, Libri prætorum, Tabulae censoriae : tous monuments d'une importance capitale pour l'histoire, mais nuls pour la littérature. Les grandes Annales (AnnalesMaximi), chronique de Rome, sèche énumération des faits les plus dignes de mémoire (1). Les traités conclus avec les Latins et les Carthaginois(2). Horace se moque des archéologues qui se piquaient de les comprendre. Les éloges funèbres et les généalogies des principales familles, documents précieux pour l'histoire, mais altérés par la vanité et le mensonge (3).
(1) Quintil., X, 2, 7; Cicer., Orat. II, 12; Tit. Liv., 11, 19.
(2) Dio Hal.,IV, 58.
Enfin un certain nombre de lois publiées pendant le
quatrième et le cinquième siècle ; mais dont nous ne
connaissons que les dispositions,le texte s'en étant perdu.
Les lois des Douze Tables, promulguées en 302 et 304.
C'est le fondement du droit civil et privé. Suivant une
tradition qui n'a plus cours aujourd'hui, ces lois auraient
été empruntées à la Grèce. Un certain Hermodore aurait
traduit pour les députés romains la constitution de Solon,
qui serait devenue le modèle de celle de Rome. C'est une
oeuvre essentiellement romaine. Nous ne les possédons
pas dans toute leur intégrité, le texte lui-même a été modifié,
dépouillé en partie de sa couleur archaïque : mais,
telles qu'elles sont, les lois des Douze Tables renferment
des renseignements précieux sur les moeurs, les idées, les
croyances, l'agriculture et les arts du quatrième siècle.
Elles furent de bonne heure commentées, interprétées par les jurisconsultes, et restèrent jusque dans les derniers
temps de l'empire la source première du droit.
La rédaction en est sentencieuse, propre à se graver facilement
dans l'esprit : une sorte d'apophthegme moral
et comminatoire. La diction en est dure, heurtée, tranchante.
Bien qu'on en apprit encore le texte par coeur
vers le milieu du septième siècle, Cicéron déclare que les
lois des Douze Tables, les livres des Pontifes, et tous ces
anciens monuments de la vieille langue n'offrent plus
guère d'intérêt qu'à l'archéologue.
LE CINQUIÈME ET LE SIXIÈME SIÈCLE.
Livius Andronicus.— Naevius. — Ennius.
§I.
C'est vers la fin du quatrième siècle que commence l'histoire
authentique de Rome ; c'est aussi vers cette époque
que Rome entre en communication avec la Grèce par les
villes de la Campanie,de l'Italie méridionale, de la Sicile,
et que des modifications importantes s'introduisent dans
la constitution, les lois, les moeurs, les usages. Quel intérêt
n aurait pas l'étude détaillée des transformations
graduelles opérées au sein de ce peuple qui doit soumettre
tous les autres peuples !
M. Mommsen a réuni presque tous les éléments de ce
travail qui, s'il était exécuté à part, jetterait la plus vive
lumière sur l'histoire littéraire : je ne puis ici qu'en signaler
l'importance.
Les premiers écrivains dont les noms et quelques
fragments nous soient parvenus appartiennent aux premières
années du sixième siècle ; et, autant que nous en
pouvons juger, la plus grande partie de leurs oeuvres
consiste dans une imitation plus ou moins libre des modèles
grecs. Ainsi ce n'est qu'après cent cinquante ans
environ de rapports avec le monde hellénique, que la littérature proprement dite apparaît. Ce fut à vrai dire la
dernière chose que les Romains eurent l'idée d'emprunter
à la Grèce : pourquoi ? C'était de toutes la plus superflue.
Aussi ne conquit-elle droit de cité à Rome, que le
jour où tout ce qui constitue le luxe eut aussi pénétré dans
la cité. Il ne faut pas se figurer les vieux Romains du
cinquième siècle comme systématiquement hostiles aux
importations étrangères ; loin de là, ils étaient tout prêts
à adopter ce qui leur semblait bon et utile ; mais les arts
proprement dits ne leur semblaient ni l'un ni l'autre.
Le Sénat avait recours aux divinités de la Grèce ; il envoyait
consulter l'Apollon de Delphes (360),il faisait élever
un temple à l'Esculape d'Épidaure (463), des statues à
Pythagore et à Alcibiade, singulier rapprochement (411) ;
il comptait même dans son sein des membres qui parlaient
grec, témoin les députés envoyés à Tarente, et
d'autres qui se paraient de surnoms grecs, Philippos,
Philon, Sophos ; on installait à Rome un calendrier solaire
apporté de Catane (491) ; enfin la civilisation hellénique
pénétrait jour par jour la société romaine, mais il
fallut une communication incessante de cent cinquante
années avant qu'une oeuvre littéraire en sortît.
Un personnage d'une puissante originalité représente
assez bien le moment indécis où le vieil esprit romain
commence à sortir du cercle étroit où il enfermait sa
vigoureuse activité, c'est le censeur Appius Claudius
Cæcus. Ce défenseur violent et obstiné des priviléges
de sa caste est en même temps le promoteur d'innovations
fort remarquables, un homme de progrès, comme on
dirait de nos jours. Politique et financier, il songe à
l'extension de la cité et de la fortune publique ; jurisconsulte
éminent, il est aussi célébré comme le premier orateur de son siècle. On lisait et on admirait encore an temps
de Cicéron la harangue qu'il prononça dans le Sénat à
l'occasion de la paix demandée par Pyrrhus vainqueur.
Ennius en a reproduit quelques traits ; on peut en voir un
résumé énergique dans Plutarque(Vie de Pyrrhus,ch. xix).
Appius s'occupa même de grammaire : c'est à lui qu'on
attribue le changement de l's en r dans les mots Furius,
Valerius, etc. Il paraît même qu'il traduisit dans son
rude langage latin les sentences morales de Pythagore.
Voilà dans quelles limites un Romain de ce temps
songeait à cultiver son esprit. Le droit national, l'éloquence,
un peu de grammaire et de morale. Ajoutons-y
certaines connaissances pratiques en agriculture : tel
est le point où l'on jugeait qu'il était bon de se tenir.
Poésie, philosophie, musique, arts plastiques, c'est cent
ans plus tard seulement que ces superfluités furent introduites
à Rome, non sans soulever d'énergiques protestations.
§II.
Au commencement du sixième siècle, l'extension de la puissance romaine et de la population de la ville, qui nécessite la création d'un préteur pour les étrangers, le grand mouvement d'expansion qui suit la fin de la seconde guerre punique, impriment un élan remarquable à la civilisation. La langue grecque est connue et parlée à Rome ; elle était indispensable au commerçant qui trafiquait avec la Sicile, à l'homme d'État qui rencontrait des Grecs partout. De nombreux esclaves originaires de la Grèce et de l'Italie du sud, introduisent la connaissance de leur langue nationale dans les classes inférieures de la société. Les comédies de Piaule sont pleines de mots grecs. Les sénateurs romains parlaient grec devant un public grec (Tibérius Gracchus à Rhodes, en 577). Les premières chroniques romaines sont écrites en grec. Flamininus répond à un compliment que des Grecs lui font en latin, par deux distiques grecs. Caton reproche à un sénateur d'avoir, dans une orgie à la grecque, chanté des paroles grecques sur un air grec. L'hellénisme pénètre partout. On met aux mains des enfants, dans les écoles, l'Iliade et l'Odyssée, avec la traduction latine. Mais le vieux préjugé romain subsiste toujours : on distingue avec soin les occupations dignes d'un homme libre, de celles qu'on abandonne à des étrangers, à des personnes de basse condition. Le Romain écrit en prose ; c'est la langue du droit, des affaires, de la politique. Ce sont les étrangers et les affranchis qui écrivent en vers.
§III.
LIVIUS ANDRONICUS.
Le premier introducteur de la littérature grecque fut
LiviusAndronicus, Grec de Tarente, amené à Rome après
la prise de cette ville en 482, par Livius Salinator, qui
l'affranchit et lui donna son nom. Il était de son métier
acteur et copiste. Il se fit maître d'école, d'abord des enfants
de son patron, puis de ceux de ses amis. Il enseignait
ensemble le latin et le grec, mettant aux mains de
ses élèves le texte de l' Odyssée et la traduction latine
qu'il en avait faite. Il semble avoir joui d'une certaine
considération si l'on en juge par l'honneur qu'il eut de
composer, sur les ordres du Sénat, le choeur chanté par
vingt-sept jeunes filles pour obtenir des dieux l'éloignement
d'Asdrubal. Ce fut lui qui fit connaître aux Romains la tragédie grecque. La première pièce traduite du grec
fut représentée en 514, à la fin de la première guerre
punique. Que pouvait être pour des Romains de ce temps
une oeuvre d'une civilisation si raffinée, écrite dans le
rude idiome national ?
Ce fut cependant ce pastiche informe qui donna le ton
à toute la littérature de cette époque. De rares essais de
tragédie nationale furent tentés, et il ne semble pas qu'ils
aient eu du succès, puisque de bonne heure cette voie fut
abandonnée. Il faut bien se souvenir, en effet, que la
poésie était, et fut encore pendant longtemps, considérée
comme une vaine et puérile occupation, et surtout que
les Romains ne pouvaient s'imaginer qu'elle dût ou pût
toucher sans profanation à des sujets nationaux ; que
ceux-ci d'ailleurs n'admettaient pas les ornements et les
fictions ; et enfin, que sur ce sol ingrat du Latium, la légende
n'avait jamais pu prendre racine. Livius Andronicus
donna donc le signal de la littérature d'imitation
qui, du moins en ce qui concerne la poésie, était à vrai
dire la seule possible. Bien que nous ne puissions en
juger par nous-mêmes, il est certain que cette lutte avec
l'idiome grec aux rhythmes si variés, dans l'épopée homérique,
dans la tragédie euripidéenne, fut favorable
à la langue latine. L'hexamètre commença à poindre ;
l'iambe et le trochée, qui se trouvaient déjà dans le vieux
Saturnin, se débrouillèrent et s'isolèrent davantage : une
certaine souplesse fut acquise, qui devait se développer de
plus en plus.
§IV.
NAEVIUS.
Cicéron compare les poëmes de Livius Andronicus à
ces statues de Dédale, immobiles, roides, les bras collés
au corps ; mais il admire fort Nsevius : « Sa guerre punique,
dit-il, nous charme encore comme une statue de
Myron ; il a écrit avec grâce (luculente) et Ennius l'a
pillé plus d'une fois sans en rien dire. » Naevius est le
favori de Niebuhr : il salue en lui le poëte national, courageux,
indépendant, qui se détourne avec mépris des
modèles de la Grèce pour se plonger aux sources vives de
l'inspiration patriotique, bien différent en cela de ce
demi-Grec Ennius, imitateur de l'étranger et flatteur de
l'aristocratie. Cette opinion, qui sourit à l'imagination, est
celle de presque tous les critiques allemands modernes,
et particulièrement de Klusmann, le dernier éditeur
des fragments du vieux poëte. Il faut avouer qu'elle est
assez vraisemblable. Mais évitons de bâtir sur des hypothèses,
si ingénieuses qu'elles soient, tout un système
de poésie nationale romaine. Naevius était campanien:
c'est Aulu-Gelle qui nous l'apprend. Klusmann en veut
faire un Romain, afin de mieux l'opposer au Calabrais
Ennius. Il était citoyen romain, cela est incontestable.
De plus, il était l'ennemi acharné et mordant du parti
des nobles ; les Métellus et les Scipions tenaient déjà alors
dans la république une place considérable : honneurs,
dignités de toute nature semblaient leur être réservés par
droit de naissance. Le courageux Naevius ne craignit pas d attaquer en face les puissantes familles. les Métellus naissent « A Rome consuls, » disait-il :
à quoi les Métellus répondirent par cette menace qui
ne fut pas: vaine. "Les Métellus sauront bien punir le poëte".
II osa même, dans une allusion transparente, rappeler
un scandale de la vie privée de Scipion l'Africain. « Cet homme, qui a accompli glorieusement de sa propre main tant de grandes choses, cet homme dont les exploits sont
encore tout vivants, qui seul attire les regards des peuples
étrangers, cet homme, son père l'a fait sortir de chez son amie, n'ayant pour tout vêtement qu'un manteau. » De là des haines violentes contre lui, et la persécution. Il
est jeté en prison ; délivré par l'intercession des tribuns,
il revient à la charge ; cette fois il est exilé, et va mourir à Utique en 550. Fut-il réellement maltraité dans sa prison? faut-il voir en lui ce poëte barbare auquel Plaute fait allusion ? (Miles gloriosus, act. If, se. Il, vers 56.)
On ne sait. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il avait de lui-même une haute opinion, si l'on en juge par l'épitaphe
qu'il se composa :
"S 'il était permis aux immortels de pleurer les mortels Les divines Camènes pleureraient Naevius le poëte.
Depuis qu'il est devenu la proie de l'Orcus,
On a oublié à Rome de parler la langue latine."
Prétendait-il opposer son oeuvre toute nationale, toute
romaine, aux imitations grecques qui allaient prévaloir?
Niebuhr et d'autres l'ont prétendu. Je ne vois dans ces vers qu'une jactance de poëte. Neevius avait écrit des
tragédies, des comédies, des satires, et un poëme héroïque
en sept livres : la Guerre punique (la première).
De tout cela à peine quelques vers, cités par les grammairiens,
nous sont parvenus. Ses tragédies étaient pour
la plupart empruntées au théâtre grec, comme celles de
Livius et d'Ennius ; cependant deux d'entre elles étaient
nationales ; l'une avait pour
titre Romulus, l'autre Clastidiurn, nom d'un bourg de
la Gaule, livré par trahison à Annibal, événement contemporain.
Ses comédies, si l'on en juge par les titres,
sont aussi des imitations du théâtre grec. Quant à son
épopée nationale, je m'étonne qu'elle ait servi de base
à l'hypothèse de Niebuhr. Les premiers livres en effet
étaient consacrés à l'histoire d'Énée, après la prise de
Troie, fable d'origine toute grecque, adoptée plus tard
par Rome, il est vrai, mais qu'un vieux et vrai poëte romain
eût ignorée alors ou repoussée avec mépris. L'argument
tiré de la métrique informe de Nævius qui en
était resté au vers saturnin, ne prouve rien, si ce n'est
que l'hexamètre lui était inconnu. Peut-être est-ce à lui
et à ses devanciers qu'Ennius faisait allusion dans ces
vers :
« C'est ainsi que chantaient jadis les Faunes et les devins, alors que
nul n'avait encore gravi les rochers des Muses (c'est-à-dire les difficultés
du mètre) et ne s'appliquait avec amour au beau langage. »
Quoi qu'il en soit de toutes ces hypothèses, voilà les
origines de la littérature romaine. Elle est absolument
imitatrice, traductrice avec Livius Andronicus ; un peu
plus indépendante avec Nævius, mais sans s'affranchir
de l'imitation hellénique, elle demeure encore informe, incertaine de la voie où elle s'engagera. Ce fut Ennius
qui lui imprima définitivement la direction qu'elle devait
suivre.
§V.
C'est sur Ennius que sont tombées toutes les colères
de Niebuhr. Ennius, c'est l'étranger, le Grec, courtisan
et vain, qui arrête brusquement l'éclosion de la
littérature nationale et fait partout dominer l'hellénisme :
ainsi que je l'ai montré, cette accusation n'a aucune
portée, car elle repose sur une hypothèse inadmissible, à
savoir, qu'il y avait eu à Rome avant Ennius une puissante
végétation de poésie nationale. Ennius n 'a rien détruit,
et son oeuvre, qui fut considérable, n'a excité parmi ses
contemporains et dans la postérité que la reconnaissance
et l'admiration.
Il est né en Calabre, à Rudies, vers 514 ou 515. Il fut
soldat pendant la première partie de sa vie, connut Scipion
l'Africain et Caton qui, après sa questure, l'amena de Sardaigne
à Rome (550). Sa vie est toute romaine ; de bonne
heure il a reçu le droit de cité, et il s'écrie avec orgueil :
« Je suis romain, moi qui fus jadis habitant de Rudies.
»
Il vit dans la société des plus nobles familles de Rome;
c'est un client, un ami qu'on se dispute. M. Fulvius
Nobilior l'emmène en Grèce avec lui, malgré les observations
de Caton le Censeur. Les Scipions font placer sa
statue parmi les monuments de la famille Cornélia. Jamais adoption ne fut pins complète. Lui-même se compose son
épitaphe et s'adresse ainsi à ses concitoyens : « Contemplez, mes concitoyens, l'image du vieil Ennius : c'est lui
qui a chanté les grands exploits de vos pères : »
Tous les auteurs postérieurs saluent en lui le Père de
la poésie latine. « C'est lui qui le premier, dit Lucrèce, a
« cueilli sur l'Hélicon une belle couronne. » Cicéron
n'en parle qu'avec une sorte de pieuse admiration ; Virgile
l'étudié, l'imite, lui emprunte des vers entiers, comme
celui qu'il consacre à Fabius Cunctator.
Horace et Sénèque semblent les seuls écrivains qui
aient essayé d'entamer cette vieille gloire nationale. La
perfection des oeuvres du siècle d'Auguste ne fait pas oublier
le grand précurseur ; l'élégant et raffiné Ovide lui
rend pleine justice : "Ennius, dit-il, génie puissant, poëte
sans art".
Dans le siècle suivant, quand des érudits comme
Fronton, Aulu-Gelle et autres se reportent aux plus anciens
monuments de la littérature latine, c'est Ennius et Caton
qu'ils invoquent comme autorités. L'empereur Hadrien
préférait Ennius à Virgile. Du temps d'Aulu-Gelle, des rapsodes prenant le nom d'Ennianistes déclament les vers
du vieux poële au théâtre. On pourrait multiplier ces témoignages,
mais à quoi bon ? Il est plus intéressant de rechercher
quel a été le caractère de la poésie d'Ennius,
en quoi il a imité les Grecs, et comment cependant il est resté romain. Qu'on ne s'y trompe pas : il s'agit ici de la
voie où va s'engager la poésie latine; il serait tout aussi
injuste de lui dénier toute originalité que de prétendre
qu'elle a tout tiré de son propre fonds.
La grande composition poétique d'Ennius, celle qui a
fait de lui un Homère latin, ce sont les Annales, en dix huit
livres. Nævius, son prédécesseur, avait raconté en
sept livres non la première guerre punique seulement, mais
l'histoire légendaire de Rome jusqu'à l'année 500 environ.
Ennius compose son poëme dans un temps où l'histoire
traditionnelle des premiers siècles de Rome est définitivement
constituée. Il raconte lui aussi la prise de Troie,
l'arrivée d'Énée en Italie, ses guerres, éléments héroïques
et nationaux de la légende : car si les Grecs en ont imaginé
une partie, depuis longtemps la légende elle-même
est devenue romaine. Le mariage d'Énée avec une fille
du Latium, Procas, Numitor, Amulius, Rhéa Sylvia,
Romulus et Rémus, tous ces événements fabuleux, mais
acceptés, forment la matière du premier livre. Le savant
éditeur d'Ennius, Vahlen, a essayé l'analyse des livres
suivants avec beaucoup de sagacité : ce n'est pas ici
le lieu de revoir son travail dans les détails. Ce qui importe,
c'est de constater l'originalité absolue de l'oeuvre
d'Ennius. Ce poëte, qui prétendait posséder l'âme d'Homère,
qui imposa, dit-on, l'hellénisme à ses contemporains,
produit cependant une oeuvre toute romaine, et
même toute barbare. D'abord il choisit un sujet national.
Ensuite, il adopte la forme imaginée par les prosateurs
de son temps et du temps qui précède, la forme des Annales.
Il ne se préoccupe point de l'unité de sujet ; il suit
les événements, mettant en lumière les plus glorieux : il
s'arrête même dans son récit, et consacre un livre tout entier à la glorification d'un ami, d'un protecteur illustre :
le XIe livre est dédié à Flamininus, le XIIe à Fabius,
le XVIe à Fulvius Nobilior. C'est là une composition rudimentaire,
qui ne doit rien à l'art, qui est donc toute
romaine. L'esprit qui anime l'oeuvre est essentiellement
romain. Les moindres vers qui nous ont été conservés
sont tout vibrants de patriotisme indompté. C'est Ennius
qui a résumé dans un seul vers le génie de la vieille
Rome :
Moribus antiquis res stat romana virisque.
C'est lui qui a tracé le portrait de cette belle et sérieuse
amitié du patricien et du plébéien, unis par les
liens religieux du patronat. Enfin l'enthousiasme guerrier
de ce contemporain d'Annibal éclate à chaque instant
dans un langage barbare, mais puissant, qui rappelle
l'ardente inspiration d'Eschyle. C'est à lui que Lucrèce
emprunte les traits les plus expressifs de ses rapides
descriptions de batailles.
Donc cette partie de son oeuvre est absolument originale
; et l'on ne saurait trop en déplorer la perte. Il
y en a une autre, et celle-là semble autoriser jusqu 'à un
certain point les regrets de Niebuhr.
Ennius s'est à peu près exercé dans tous les genres.
C'est un poëte tragique, comique, satirique, didactique,
c'est encore un philosophe. Dans toute cette partie de son
oeuvre, c'est encore un Romain, mais un Romain qui veut
initier ses contemporains aux diverses productions du génie
grec. Ses tragédies sont des imitations, presque des
traductions des poëtes grecs. Nous avons vu que Livius
Andronicus et Nævius n'avaient pas fait autre chose. Le
théâtre à Rome ne fut jamais à aucune époque purement national : la gravité romaine se fût difficilement
résignée à être exposée aux regards de la foule, et d'ailleurs
les histrions étaient ou des esclaves ou des affranchis,
toujours des êtres de vile condition : comment supporter
la vue de ces gens sous le costume d'un consul ou d'un
dictateur? C'est donc à la Grèce que l'on emprunta les
sujets des drames : on restreignit les chants du choeur,
on modifia certains détails de la fable ; on présenta certains faits sous un autre jour ; mais, en somme, la tragédie
romaine resta grecque par une foule de côtés. Le plus important
de tous, ce fut l'esprit philosophique dont elle
était animée. Le modèle auquel Ennius et ses successeurs
s'attachèrent de préférence, c'est Euripide. On sait de
quelles hardiesses philosophiques et religieuses étaient
remplies les pièces du poëte grec. Ennius semble avoir
goûté de préférence cette partie de l'oeuvre de son modèle. On entendit sur une scène romaine une Ménalippé
philosophe déclamant contre l'existence des dieux, ou attaquant dans sa base l'institution du mariage ; un Télamon
invoquant l'existence du mal pour démontrer l'impuissance
des dieux. Ajoutez à ces tirades irréligieuses
des plaisanteries fort vives sur les devins et les astrologues,
plaisanteries qui tombaient directement sur les augures.
Ennius ne s'arrêta point là. Il se fit le traducteur et
l'introducteur à Rome d'Épicharme et d'Évhémère. Il
enseigna aux Romains, d'après ses modèles, que Jupiter
est tour à tour l'air personnifié ou un ancien roi dont
la reconnaissance des mortels a fait un dieu. L'auteur
a vu son tombeau en Crète, avec cette inscription : ZANKPONOY (id est latine, Jupiter Saturni). C'est donc à
Ennius qu'il faut faire remonter le scepticisme religieux qui sera l'âme de la société romaine, cent ans plus
tard. Bien que Cicéron n'admette pas le point de vue
étroit auquel se place Évhémère, on ne voit que trop
dans ses traités de la Nature des Dieux et de la Divination,
qu'un travail sérieux de critique religieuse
s'est fait dans les esprits, et que les vieilles croyances nationales
ont été de bonne heure battues en brèche.
Ennius écrivit aussi des Satires (six livres). Il ne nous
en a été conservé que des fragments sans aucune importance.
Nous savons seulement, par Aulu-Gelle, qu'il
avait traduit en vers le bel apologue Ésopique dont la
Fontaine a fait sa fable de l'Alouette, ses Petits et le Maître
d'un champ. Il est fort probable qu'Ennius avait renoncé
à la vieille forme de la satire nationale, dont j'ai parlé
plus haut. De ce côté encore ce serait donc un novateur, il
aurait frayé la voie à Lucilius.
Enfin il traduisit du grec, d'Archestratos de Géla un
poëme gastronomique, les Friandises .
Tel est ce personnage intéressant : nous sommes réduits
à deviner pour ainsi dire le caractère de ses oeuvres ;
car nous ne possédons de lui que des fragments d'une
médiocre étendue, mais on ne peut s'y méprendre. Si Ennius
a fait à la Grèce des emprunts considérables, il a cependant
gravé sur ses productions l'empreinte de son propre
génie et du génie romain. On la retrouve jusque
dans les moindres vers cités par les grammairiens. Il n'a
aucune idée de l'atticisme, et on ignore encore à Rome
l'urbanité. D'autant plus efficace fut l'influence du vieux
poëte : il laisse de côté les grâces molles du génie grec, et
les remplace par l'énergique élan du Romain de ce
temps-là. Sa pensée se grave tout d'abord dans l'esprit
: « Salut, dit-il, ô poëte Ennius, toi qui verses aux mortels jusqu'au fond de la moelle des vers de flamme !
Écrivain rude, mais puissant, il a tiré de l'idiome latin
des ressources inattendues. Il a banni définitivement l'horrible
mètre Saturnin dont l'impuissance était bien constatée ; il a donné droit de cité à l'hexamètre, rudimentaire
encore et fruste, mais vivace et perfectible ; il a même
essayé de reproduire les formes métriques de la poésie
grecque. Enfin il a préparé les esprits de ses contemporains
à l'intelligence de cette civilisation hellénique, qui
après lui prit possession de Rome.
LE THÉÂTRE
Plaute. — Caecilius. — Térence.
§1.
Les Romains eurent de bonne heure des jeux publics,
qui duraient un certain nombre de jours. Le dernier était
consacré aux jeux du théâtre. Mais ces jeux ne furent
pendant longtemps que des danses, des jongleries, des
exercices de force et d'adresse. Il s'y mêlait bien quelques
chants dialogues, mais sans action. C'est au sixième
siècle seulement que des représentations scéniques proprement
dites s'établirent à Rome. Il n'y avait pas de
théâtre permanent ; le premier fut construit par Pompée.
Les représentations théâtrales étaient occasionnelles :
elles avaient lieu aux grands jeux (Megalensia), à la suite
d'un triomphe, et tout au plus deux ou trois fois l'an.
Un parquet, supporté par des poutres, formait la scène
où se plaçaient les acteurs. Au
fond était le décor. Les spectateurs occupaientun demi-cercle sans gradins et sans siéges. Les
femmes étaient séparées des hommes et reléguées aux
plus mauvaises places. Ce ne fut qu'en 560, que des
places particulières furent réservées aux sénateurs et
aux chevaliers. L'auteur des pièces représentées appartenait d'ordinaire
aux derniers rangs de la société ; c'était parfois esclave, un affranchi. Le chef de la troupe (dominus gregis
factionis, choragus) n'est pas d'une condition plus relevée. Directeur et acteurs sont dans la main de la police. L'édile achète au premier une pièce quelconque
et il ne la paye pas bien cher : encore le poëte ne touche-t-il son argent que si la pièce réussit. Ne cherchez pas ici de concours littéraire comme à Athènes, des récompenses
honorifiques, une multitude attentive, recueillie,
intelligente, érigée en juge des oeuvres d'art qui sont
représentées devant elle : rien de tout cela. Si les acteurs jouent mal, on les corrige à coups de fouet ; s'ils
jouent convenablement, on leur donne une outre de
vin. Voilà les stimulants pour le poëte et pour les acteurs. Ces derniers sont des esclaves, et, fussent-ils affranchis, par cela seul qu'ils sont comédiens, ils sont déclarés infâmes : quant à l'auteur, il compose des pièces
pour gagner sa vie ; il exerce un métier, et un métier
méprisé. Il écrit vite, il compose à la hâte sa comédie
qu'il traduit du grec ; il est en effet interdit de mettre en scène des personnages romains. Ainsi la comédie perd
tout son nerf en perdant toute application directe aux
personnages et aux événements contemporains.
Il ne faut point songer à Aristophane. «le poëte, dit Cicéron, « Ce n'est pas qui a le droit de noter un citoyen d'infamie, c'est le censeur. Quoi! un misérable bouffon, payé par l'édile, aurait le droit de bafouer en public un Scipion, un Caton, un Métellus. La vie d'un Romain est livrée aux enquêtes des magistrats, aux discussions légales, mais non aux fantaisies des poëtes. Nul de nous ne peut être attaqué et insulté, s'il n'a en même temps le droit de se défendre en justice (1). »
Voilà dans quelles conditions déplorables naît le théâtre romain. Nous y trouverons la licence, non la liberté. Rome apparaîtra bien derrière Athènes, mais travestie; les moeurs romaines s'y feront jour, mais timidement, par des allusions souvent inintelligibles. L'oeuvre dans ses parties essentielles n'est pas nationale. Ce qui étonne le plus, c'est qu'elle ait été si remarquable, assujettie à tant d'entraves.
§II.
LA COMÉDIE ROMAINE ET LA COMÉDIE GRECQUE.
De toutes les importations helléniques de cette période,
la comédie fut la plus populaire : la société grecque,
telle qu'elle nous apparaît dans Ménandre et ses contemporains,
ne ressemble guère, il est vrai, à la société
romaine du milieu du sixième siècle; mais les personnages
et les caractères de la tragédie étaient bien plus étrangers
à l'Italie que les personnages et les caractères dont
les originaux se rencontraient à chaque pas. De plus, les
Romains étaient par nature plus portés à l'imitation des
choses plaisantes qu'aux représentations idéalisées de la
nature humaine. Il y eut donc dans le sixième siècle
une multitude de comédies contre une quantité bien inférieure
de tragédies. Et l'on peut assurer que les premières
furent plus originales que les secondes. Les unes
et les autres étaient imitées ; et ce fut par le théâtre surtout
que l'hellénisme pénétra à Rome.
Quel était le caractère général de la comédie grecque? Les sujets sont peu variés. C'est toujours la lutte
d'un jeune homme amoureux contre son père ou contre
le leno pour obtenir la possession de celle qu'il aime.
Il est aidé dans son entreprise par un esclave rusé et
escroc. L'action se compose des péripéties qu'amène cette
poursuite de l'objet aimé. Notre comédie des Fourberies
de Scapin peut en donner une idée assez exacte.
Embarras, plaintes, désespoir des amants, scènes de
tendresse et de douleur; la passion dans toute sa véhémence
: tel était le sentiment qui était l'âme des comédies
de Ménandre. Lui-même semble avoir abandonné à
l'amour la plus grande part de sa vie. Le dénoûment
de ces comédies était toujours le même. Les deux amants
séparés par une foule d'obstacles étaient enfin réunis ; la
jeune fille était reconnue personne de condition libre, et
le mariage était célébré.
D'autres comédies avaient une action plus compliquée:
c'étaient des pièces d'intrigues. Le romanesque y dominait;
naufrages, enlèvement par des pirates, cassettes
mystérieuses, signes de reconnaissance découverts au
dénoûment, peintures de nobles sacrifices, l'ami se
dévouant pour l'ami, l'esclave pour son maitre. Mais,
à quelque genre qu'elles appartinssent, ces comédies
étaient claires, faciles à embrasser dans toutes leurs parties.
Le théâtre ayant perdu son ancienne liberté politique,
était devenu plus psychologique. Les types généraux
avaient remplacé les caricatures d'individus ; la
peinture des moeurs et des caractères était moins vive,
mais plus profonde; la composition du drame plus régulière,
le dialogue plus mesuré et plus naturel. Les bouffonneries étincelantes d'Aristophane, sa verve satirique,
ses saillies avaient disparu. Le citoyen n'existait plus ;
on avait l'homme, l'Athénien oisif, partageant les loisirs
que lui faisait la liberté absente entre le plaisir et les
arts. Cette comédie ne s'adresse plus au peuple tout entier,
à ce peuple mobile et passionné qui applaudissait et
sifflait au théâtre ses orateurs et ses généraux; mais à un
public restreint, fort civilisé et fort corrompu, fort sceptique
surtout, et qui ne veut être qu'amusé. Des peintures
fines et délicates, rien d'excessif, aucun éclat de
voix, l'ingénieux, le romanesque, les molles tendresses,
voilà ce qu'il faut à cette aristocratie blasée. C'est le
temps des grandes expéditions d'Alexandre ; la transformation
du patriotisme étroit des anciens en un cosmopolitisme
universel se prépare. Les barrières artificielles
tombent de toutes parts. La comédie, qui est l'image de la
vie privée, amène doucement les esprits à une sorte de
fusion générale. Les pères sont les camarades de leurs
fils, non leurs maîtres ; il y a même entre le maître et
l'esclave une sorte d'égalité qui commence à percer. Ce
que nous appelons aujourd'hui la vie du monde existe
déjà. Les hétaïres tiennent maison, comme Ninon et les
femmes du dix-huitième siècle. Chez elles se réunissent
les artistes, les philosophes, les princes du commerce et
de la finance. Une foule d'industries nouvelles, difficiles
à nommer, fruit de la molle corruption du temps,
commencent à se faire jour, sont acceptées; le théâtre
les met en scène. Voilà le vice élégant, gracieux, de
bonne compagnie, qui n'a rien de cynique et de révoltant.
Mais il faut dans ce tableau, baigné d'une douce lumière,
jeter les ombres. Le peintre, avec un art exquis,
mêle à ces personnages charmants des êtres ridicules, grossiers, parfois même odieux. Le cuisinier joue un
grand rôle dans cette société mondaine : il tiendra une
place importante au théâtre. Après lui, le parasite, avec
les nombreuses variétés de l'espèce, depuis le flatteur
de bon ton jusqu'au bouffon qui paye son dîner par
des facéties. Puis le sycophante, non plus le délateur
politique, mais le fourbe et le traître des rapports sociaux.
Le marchand d'esclaves (leno), tour à tour odieux ou
ridicule; le prêtre et le superstitieux, l'un dupant, l'autre
dupé. Ajoutez à cela les gros marchands étrangers,
bouffis d'insolence, qui se croient adorés et enviés de
toutes et de tous, parce qu'ils ont de l'argent, Turcarets
antiques, qu'on vole et qu'on raille; le soldat fanfaron,
mercenaire que le pillage a enrichi, et qui se plaît à raconter
des exploits impossibles, dont il est innocent.
Voilà les héros de la comédie nouvelle, voilà l'esprit général
de ces modèles charmants, essentiellement attiques,
que le rude génie de Plaute chercha à introduire à Rome.
Quel qu'ait pu être l'art de Ménandre et de ses contemporains,
l'inspiration élevée manque à leur oeuvre. Il
y a plus de licence et d'obscénités dansAristophane, mais
la lecture en était plus saine. Le patriotisme y vibre. Ici
la grâce de la forme ne peut cacher le vide du fonds.
On le sent trop, le premier intérêt de tous ces personnages,
c'est l'amour, le plaisir. Hors de là ils ne sont plus.
L'activité, l'enthousiasme, sont le partage des fripons;
eux seuls représentent l'énergie de la volonté. Ils sont
l'âme de la pièce. Les dénoûments d'une moralité fade
ou équivoque sont le triomphe de la passion. Parfois
d'étranges conciliations rapprochent sur un singulier terrain
amis et ennemis, enfants révoltés, pères barbares.
Voyez le dernier acte des Bacchis. Il y a là une naïveté de dissolution profonde qu'on ne peut mesurer
sans effroi. Voilà les modèles sur lesquels s'est formée la
comédie romaine.
Le créateur du genre est Plaute.
§ III.
Maccius Plautus est né à Sarsina, village de l'Ombrie,
dans les premières années du sixième siècle : il était
donc contemporain de Naevius et d'Ennius. D'abord
acteur ou chef de troupe, puis commerçant, il fut ruiné
par des spéculations malheureuses, et réduit à un travail
servile pour vivre : il tournait, dit-on, la meule d'un boulanger.
La misère le fit poëte. C'était un métier peu estimé,
nous le savons. Il l'était moins encore lorsqu'on
l'exerçait sans appuis, sans patrons. C'est ce qui arriva à
Plaute : Livius Andronicus, Ennius, et plus tard Térence,
jouissaient de la protection et jusqu'à un certain point
de l'estime des Livius, des Fulvius, des Scipions; le
plébéien misérable, comédien, petit commerçant, originaire
de l'Ombrie, lut inconnu et méprisé des nobles. Il
n'eut jamais de rapport qu'avec les édiles auxquels il
vendait ses pièces. Elles durent lui être de bonne heure
fort bien payées, car le peuple les adorait. Aussi de
nombreuses contrefaçons ou imitations s'en produisirent.
Il y avait au siècle suivant plus de 130 comédies
Plautiniennes. Aelius Slilo réduisit à 25 le nombre des
pièces authentiques : Varron n'en admit que 21 : nous
en possédons 20. La dernière sur la liste de Varron
( Vidularia) ne nous a pas été conservée. Elles restèrent presque toutes au théâtre avec le plus grand succès.
Une tessera trouvée il y a quelques années à Pompeï nous
apprend qu'on y jouait, l'an 79, la Casina de Plaute. Le
catalogue dressé par Varron a été suivi par tous les
éditeurs; les comédies y sont rangées par l'ordre alphabétique
des titres. Il nous est donc impossible de suivre
les développements du génie de Plaute, et les modifications
que subit sa première manière ; nous savons seulement
que le poëte avait une prédilection particulière
pour son Truculentus et son Pseudolus. Sur quoi était-elle
fondée, nous l'ignorons. Était-elle même fondée ? qui
peut le dire ? Les jugements contradictoires des critiques
ne nous apprennent à peu près rien sur le poëte.
Cicéron goûtait fort sa plaisanterie
qu'il rapproche de
l'atticisme. Horace la méprisait profondément. Varron, disait que « si les
Muses voulaient parler latin, elles emploieraient le langage
de Plaute ». Quintilien se récrie à cette étrange
assertion. Tout dépend de l'idée que chaque époque se
fait de l'esprit, de la grâce, du bon ton, choses essentiellement
sujettes à la mode.
Plaute est un homme du peuple et de la dernière
classe du peuple. C'est pour le peuple qu'il écrit, et il
a su plaire à son public. Il est hors de doute que, si le
théâtre eût été libre, s'il avait été permis à ce plébéien
à moitié esclave de mettre sur la scène romaine des
pièces tout à fait romaines, nous aurions dans le théâtre
de Plaute la production la plus forte, la plus originale de
toute la littérature latine. Je ne sais même si, malgré la
nécessité de l'imitation qui pesait sur lui, le poëte n'est
pas encore le chef des écrivains latins. Le sujet de toutes ses comédies est emprunté au théâtre
grec. Toutes avaient un prologue dans lequel l'auteur
exposait l'argument de la pièce et indiquait les sources
auxquelles il avait puisé ; mais les deux tiers d,e ces prologues
sont perdus. Plaute semble avoir mis à contribution
Diphile et Philémon, bien plus que Ménandre, « cet
astre de la comédie nouvelle ». Il y a aussi en lui des
ressouvenirs manifestes d'Aristophane et d'Épicharme,
bien autrement vifs et mordants que les poëtes du siècle
d'Alexandre. Une de ces pièces, Amphitryon, désignée
par lui sous le nom de tragi-comédie, parce que les
personnages du drame sont des dieux et des rois, doit avoir
pour modèle le sceptique et railleur Êpicharme. Mais,
quels que soient les sujets qu'il emprunte, Plaute donne à
son oeuvre une forme originale. Il prenait d'ailleurs toutes
les libertés possibles avec ses modèles, supprimait des
épisodes et des personnages, les remplaçait par d'autres.
Térence le lui reproche à mots couverts dans le prologue
des Adelphes. Voilà donc bien des éléments divers et
ennemis, à ce qu'il semble, pour composer une oeuvre
dont l'unité est la première loi. Un plébéien de Rome,
condamné à un métier servile, imitant les chefs-d'oeuvre
de l'atticisme hellénique ; les imitant avec une grande
liberté, les transformant au point de faire aimer à la populace
de Rome, gens grossiers, violents, tapageurs,
des
sujets, des personnages, des moeurs qui n'ont aucun rapport
avec le train ordinaire de la vie nationale. Les
fausses couleurs abondent, il ne peut en être autrement:
une reproduction fidèle de la société grecque au temps de Ménandre n'eût eu aucun charme pour les Romains du
sixième siècle. Il fallait leur rappeler incessamment et par
une foule de détails la patrie absente de l'oeuvre originale.
Le lieu de la scène est toujours hors de Rome, toujours en
Grèce ou en Sicile ; les Romains sont appelés barbares,
suivant l'usage grec. Tous les personnages sont grecs,
portent le pallium (comedia pallidta), mais le Romain
retrouve Rome à chaque instant. Les dieux ont des noms
romains, les cérémonies du culte sont romaines, les
termes de la langue militaire et juridique sont empruntés
à la langue nationale. Plaute conserve bien çà et là les mots
de démarques et d'agoranomes; mais le plus souvent ce
sont des édiles, des préteurs, des triumvirs, des curions.
Nous retrouvons le Vélabre et le Capitole en Étolie. Le
poëte se permet aussi en passant de décocher quelques
traits sarcastiques contre certaines villes d'Italie, comme
Atella, Préneste, Capoue ; il se répand même en invectives
générales contre les usuriers, les accapareurs, les
suborneurs de témoins, les collecteurs d'impôts et d'amendes,
les marchands d'huile. Mais il s'arrête court,
et pense au sort de Nævius. « Je suis bien sot, dit-il,
de me mêler des affaires publiques : il y a des magistrats
faits pour cela. » Tout au plus se permet-il, dans le
prologue ou à la fin de la pièce, quelques allusions aux
événements de la guerre, des voeux pour la victoire
de sa patrie. Il ne pourrait aller impunément plus loin.
La loi et la police s'y opposent. Mais il ne lui est pas interdit
de transformer à sa fantaisie le modèle grec : on
tolérera des personnages romains, s'ils ont le pallium grec,
s'ils sont transplantés en Grèce : il faut même qu'il en soit
ainsi, ou le public préférera à ces froides exhibitions de
la société hellénique les saltimbanques et les jongleurs. Mais y a-t-il à Rome des hétaïres, des leno, des soldats
fanfarons, des parasites spirituels, des esclaves fins, rusés,
des pères faciles et accommodants, qui font la
débauche avec leurs fils? Rien de tout cela n'existe
encore, à vrai dire, et n'existera guère que cent ans
plus tard. Les conversations délicates, les sentiments
raffinés, la philosophie aimable, qui donnent une couleur
particulière et un charme exquis au modèle grec, tout
cela sera-t-il, pourra-t-il être reproduit? Eu aucune façon.
Les principaux événements, la charpente du drame,
la situation des personnages : voilà ce que Plaute emprunte;
mais pour tout le reste il n'en a souci. Il
transforme tout, épaissit, grossit, charge tout. Ses parasites,
ce ne sont point des gens de bonne compagnie,
qui pratiquent avec une habileté consommée l'art de se
faire inviter à dîner; ce sont de pauvres diables qui
payent bien cher les aliments qu'on leur jette : "Pour
être parasite, il faut savoir endurer les soufflets, et les
pots qu'on vous casse sur la tête ;" on les relègue
au bas bout de la table, sur un escabeau. Ce sont
des Spartiates, car ils supportent tout, particulièrement
les coups (plagipatidae). Quand le vin a
échauffé les convives et les a mis en bonne humeur,
plats, vases, cendre, ordures, eau glacée, ils lancent à
la tête du parasite tout ce qui leur tombe sous la
main. Il quitte tout sanglant la table inhospitalière : convives
et spectateurs rient aux larmes des mésaventures
du misérable. Pour l'esclave, même transformation
du type primitif. La comédie nouvelle, contemporaine
d'Épicure et de Zénon, est pleine des plus belles
maximes sur l'égalité des hommes, et contre le préjugé
de la servitude. L'esclavage n'est qu'un mot : voilà ce que répètent tous les personnages de Ménandre. Dans
la vie ordinaire, l'esclave était en effet traité avec douceur
: les Grecs n'ont jamais eu cette dureté du Romain
propriétaire envers sa chose.
L'esclave grec fait réalité en partie de la famille, non comme le boeuf ou le chien, mais comme un homme; à Rome, c'est un meuble animé. L'esclave joue un rôle considérable dans la
comédie grecque ; il est même souvent représenté comme supérieur à son maître par l'intelligence et le dévouement.
Plaute accepte le plus souvent cette donnée de l'original;
mais l'esclave a toujours le fouet pendu sur les
épaules : une effrayante richesse d'injures sinistres, menaçantes,
est déployée pour lui ; des supplices d'une incroyable
variété sont sans cesse mis sous ses yeux ; lu-imême
plaisante sur les ingénieux raffinements imaginés
pour le torturer. Il faut qu'il rie et soit gai même sous
les coups. Le Romain, le pauvre diable qui tournait
la meule du meunier, se souvient de ce qu'il a vu et souffert.
Ce qu 'il y avait de plus difficile à transporter sur la scène romaine, c'était la vie intérieure des familles
grecques, qui semblent plutôt des associations volontaires
dont une commune tolérance adoucit le joug, que la
sévère collaboration à l'oeuvre si grave de l'éducation
des enfants. En Grèce, l'épouse jouit d'une grande liberté
: la douceur et la facilité des moeurs l'exigeaient;
de plus, la femme riche était par sa dot même affranchie.
Le mari, plus libre encore, vivait volontiers hors de
chez lui et chez les hétaïres; les filles, élevées légèrement
et surveillées plus légèrement encore, étaient souvent
exposées à de singuliers accidents. Quant aux fils, émancipés
de bonne heure, ils imitaient leurs pères; et il dut
arriver plus d'une fois que le père et le fils se trouvèrent rivaux. Quel spectacle à présenter aux Romains du milieu
du sixième siècle, que celui de cette dissolution întime et
profonde de la famille ! C'étaient des personnages grecs ;
mais de tels exemples, vinssent-ils du fond de l'Orient,
n'étaient pas bons à mettre sous les yeux des Romains.
Plaute l'a fait. Rien de plus révoltant que le sujet des Bacchis,
de l'Asinaria, de Casina, et les détails de la pièce.
Les pères font bon marché de leur autorité et de leur majesté
: ils n'ont conservé du caractère romain qu'un seul
trait; ils sont avares, ils pardonnent facilement les folies
amoureuses, mais, s'il leur en coûte quelque chose, ils
s'emportent. Quant aux fils, ils raillent volontiers leur
père, et s'entendent avec des esclaves pour le voler.
Seule la mère de famille est respectée. La matrone a protégé
la femme grecque. Plaute se borne à la représenter
comme importune, chagrine, acariâtre, soupçonneuse :
« C'est, disait le censeur Métellus au peuple, un ennui nécessaire.» Mais du moins elle est chaste, jalouse de son
honneur et de ses droits. Même dans la position équivoque
où la supercherie de Jupiter a placé Alcmène, elle
ne perd rien de sa majesté et de ses droits au respect.
Panégyris et Pinacie dans le Stichus, Palæstra, dans le Rudens, Alcmène, dans l'Amphitryon, sont de belles
images de la vertu féminine. Mais tout cela, on le voit,
forme un composé assez étrange ; dans ce mélange de grossièreté
romaine et de fine corruption hellénique, le seul
enseignement qui se fasse jour n'est pas précisément celui
de l'honneur, de la chasteté et de la vertu. Le poëte
ne se faisait pas illusion sur la portée de son oeuvre et s'en
souciait médiocrement. C'était le ton ordinaire de la comédie. Il
termine ainsi les Captifs, pièce morale et héroïque en quelques scènes : « Spectateurs, cette pièce est faite sur
le modèle des bonnes moeurs. Elle ne renferme ni scène d'amour ni mouvements déshonnêtes, ni suppostion d'enfant, ni escroquerie ; pas de jeune homme amoureux qui affranchisse sa maîtresse à l'insu de son père. Elles sont rares les comédies de ce genre, des comédies qui rendent meilleurs ceux qui y assistent. Et maintenant, si vous le voulez bien, si nous avons réussi à vous plaire, témoignez-le par ce geste : applaudissez, vous qui voulez récompenser la vertu. »
On ne peut donc en douter, le théâtre propagea la
corruption : peintures aimables du vice, mépris des
devoirs de la famille, glorification du plaisir, de l'amour,
subordination de tout sentiment sérieux et élevé;
le public romain ne put impunément être mis à un
tel régime moral. Si la police romaine, au lieu d'obéir
à un scrupule d'orgueil national peu intelligent, eût accordé aux poëtes plus de liberté, le
théâtre eût été moins licencieux. Une certaine gravité
naturelle à ce peuple eût tempéré les écarts de la
verve comique. Mais qu'importait à Plaute l'immoralité
des sujets et des personnages ? Tout cela
venait de Grèce. Comme si le poison, pour être étranger,
n'était pas du poison ! Le mauvais l'emporta donc
sur le bon; mais il y eut du bon. Si le patriotisme
romain ne trouva aucun aliment dans le théâtre étranger
importé à Rome, il ne faut pas trop s'en plaindre.
Un souffle nouveau pénétra dans l'Italie, et jusqu'au
coeur du Sénat. L'idée de l'égalité des hommes, fussent-ils séparés par les mers, les lois, la langue, les
institutions, les préjugés de toute nature, se fit jour.
La littérature grecque postérieure au siècle de Périclès
en est profondément imprégnée. L'immense empire d'Alexandre,
qui rapprochait sous une même domination
des peuples jusqu'alors ennemis et presque inconnus
les - uns aux autres, cette oeuvre grandiose de fusion
anime d'une inspiration nouvelle les productions des
artistes et les systèmes des philosophes. On ne peut
la méconnaître, cette inspiration, dans les fragments de la
comédie nouvelle. Le monde commence à apparaître
comme une grande cité dont tous les hommes sont citoyens.
De là un singulier adoucissement dans les moeurs,
l'ébranlement de bien des institutions nationales ou civiles,
des revendications éloquentes en faveur de l'esclave,
du pauvre, une sorte de cosmopolitisme en germe.
Or, par ses conquêtes, par la diffusion de sa langue, par
ses colonies, par l'influence préponderante qu'elle exerçait
dans le monde, Rome était appelée à être l'instrument
de cette grande révolution qui s'élaborait. Le
théâtre romain y prépara jusqu'à un certain point les
esprits, et contribua à ébranler les barrières que le
patriotisme s'obstinait à maintenir. Nous ne sommes
pas fort éloignés du temps où les Gracques se feront les
interprètes passionnés des réclamations et des droits
des Italiens et des dépossédés.
Plaute est un génie véritablement comique et un
grand écrivain. Il a la verve et la gaieté qui manquent
presque absolument à Térence. Tout lui est bon pour
exciter le rire : jeux de mots, mots forgés, charge, il anime
la scène d'un entrain extraordinaire. Les monologues eux-mêmes,
véritables hors-d'oeuvre pour nous, sont pétillants d'esprit. Les délicats seront parfois choqués et demanderont
grâce, mais il sait aussi prendre un ton plus noble ;
il ne le garde pas longtemps, son public ordinaire ne
l'eût pas permis. Dans cette partie de son oeuvre, il
rappelle notre Rabelais; mais il lui manque ce qui fait
accepter toutes les bouffonneries de l'autre : une idée.
Jamais la tyrannie du goût des spectateurs ne pesa plus
impérieuse sur un poëte. Mais il portait le joug facilement,
étant par son caractère et son éducation assez
semblable à ses contemporains. Il abonde en situations
d'un comique naturel, et alors sa verve est merveilleuse.
Il se saisit de tout ; l'attitude, la grimace, les gestes, les
moindres mots de ses personnages sont mis à nu, reproduits,
chargés ; on voit la mimique sous les paroles, le
poëte a été acteur, on le sent bien. Cette habile et puissante
économie de l'interêt, cet à-propos de la plaisanterie
pour soutenir la scène, cette bouffonnerie imprévue,
grâce à laquelle le poëte et l'acteur reprennent haleine
et s'élancent de nouveau en avant, cette sage économie du
dialogue qui à travers toutes les saillies se poursuit régulier
jusqu'au bout : il faut avoir pratiqué et étudié sérieusement
le théâtre pour posséder ces qualités si diverses et
si rares que la nature ne donne point. Auprès de cela,
des fautes grossières dans la composition générale et
l'agencement des scènes. Il était homme à les éviter
aisément s'il eût voulu s'en donner la peine ; mais quoi !
les Romains de ce temps-là se souciaient fort peu de
l'observation des règles ; ils voulaient être amusés à tout
prix. Horace l'a remarqué avec raison, mais il n'a pas
compris que les négligences étaient imposées au poëte,
et qu'elles n'enlèvent presque rien à la puissante et entraînante
gaieté de l'oeuvie. Les caractères de Plaute sont vivants. Il les dessine à grands traits, mais en vigoureuses
saillies. Ne cherchez point les nuances délicates,
les fines oppositions, l'art de distribuer l'ombre et la
lumière. Les Romains de cette époque n'eussent rien
compris à ces raffinements d'une pénétrante observation.
Et d'ailleurs le poëte n'a pas le temps de limer patiemment
son oeuvre. Il prend un personnage à Philémon ou à
Ménandre, le met à nu et l'habille à sa façon. C'est souvent
une caricature, mais l'ensemble est vrai, saisissant ;
la physionomie primitive est profondément altérée, ou
plutôt c'en est une autre, qui est bien réellement l'oeuvre
du poëte, et que le modèle renierait. Plaute a donc une
originalité vraie et puissante : il a l'audace et le vif sentiment de ce qu'il faut au théâtre de son temps. Ses
fautes grossières, le plus souvent, ne viennent pas d'ailleurs.
Horace lui a reproché de n'avoir pas su garder
jusqu'au bout à ses personnages le caractère qu'il leur
avait donné d'abord : c'était exagérer singulièrement
quelques écarts de détail. Et, d'ailleurs, ces modifications
brusques, surtout au dénoùment, ces revirements complets
sont aussi dans la nature. Le misanthrope a commencé
par aimer les hommes plus qu'ils ne méritaient.
Ces coups de théâtre peuvent plaire et trouvent bien souvent
un complice dans le spectateur.
La langue est la plus belle création du poëte. Singulièrement
plus souple que celle de Naevius, elle est encore
rude et heurtée, mais elle se prête à tout. Claire et vive,
elle se meut aisément, malgré le luxe encore lourd des
mots inutiles qui surchargent la phrase. Plaute manie en
maître cet instrument encore rebelle. Exact, précis, énergique,
il reste fidèle aux lois étroites de l'analogie, et il est
demeuré une autorité comme source. Quant au style, je ne sais s'il y en a de plus vif et de plus coloré. Nul écrivain
n'a osé plus heureusement; il abonde en expressions
trouvées, en alliances de mots ingénieuses et pittoresques;
il a surtout le mouvement, l'élan brusque et imprévu.
Quant à la métrique, elle semble avoir plutôt consisté
pour lui dans le nombre que dans la régularité du
rhythme. L'iambe n'y tient pas la place qui lui convient
au théâtre. Le tétramètre iambique y domine ; il fallait
aux Romains de ce temps une certaine majesté même
au théâtre. Cicéron appelle ses vers versus innumeri; il
dit même que souvent c'est à peine si on peut y reconnaître
un nombre et un vers.
Nous ne pouvons nous flatter de posséder le texte
authentique de Plaute dans toutes ses pièces. Les acteurs
ont fait subir à un grand nombre d'entre elles
de graves modifications : il a été souvent interpolé. La
liste même dressée par Varron ne contient-elle que
des pièces de Plaute ? Pendant de longs siècles on ne
connut que les huit premières ; les douze autres, qui
ont souffert davantage, ne furent connues qu'en 1430.
Les premiers manuscrits des vingt comédies ne remontent
par au delà du quinzième siècle. Enfin plusieurs
pièces, comme l'Aulularia, sont incomplètes. Quelques
éditions mettent à la suite des vingt comédies de Plaute,
Querolus, oeuvre sans esprit, sorte d'Aulularia en prose
qui ne pouvait être de lui.
Plaute mourut en 570, c'est-à-dire au moins trente ans
avant que l'hellénisme eût reçu définitivement droit de
cité à Rome. Par certains côtés il se rattache à Naevius,
qui voulut rester et resta romain ; par d'autres, il se approche de Térence, qui est déjà tout imprégné d'atticisme.
C'est ce qui explique son succès constant auprès
du peuple, que les délicatesses de la civilisation
hellénique ne touchèrent jamais, et le mépris qu'il
inspira aux poètes raffinés du siècle d'Auguste. A l'exemple
de Naevius, il avait composé lui-même son épitaphe
que voici :
Post quam est mortem aptus Plautus, comedia luget,
Scena deserta, dein Risus Ludu Jocusque
Et numeri innumeri simul omnes collacrumarunt.
Les pièces de Plaute se divisent naturellement en
deux séries : l'une comprend les huit premières, qui furent
seules connues jusqu'en 1430, et qui sont :
Amphitruo (Amphitryon), tragi-comédie. Le modèle
de Plaute est probablement Épicharme. Bocace, Molière,
Dryden, l'ont imitée.
Asinaria. Comédie empruntée à Démophile. Nous
ferons remarquer à ce propos que ces terminaisons
en aria ne veulent dire autre chose que pièce où il est
question de. Ainsi Asinaria, comédie où il est question
d'ânes. Le principal ressort de l'action est l'argent qui
provient de la vente d'un troupeau d'ânes. « Cette comédie
est très enjouée, » dit Plaute dans le prologue. Elle
l'est à un tel point que nous ne pouvons en donner une
analyse. Aulularia (ou la Marmite). C'est le premier modèle
de l' Avare de Molière. Les dernieres scènes ne sont pas
de Plaute, mais de l'érudit Urceus Codrus.
Captici (les Captifs). C'est la plus morale des pièces de
Plaute. Il n'y a ni leno ni amoureux. Elle fut représentée
en 560, dix ans avant la mort de l'auteur. Il est probable qu'elle inaugurait une manière nouvelle. Elle a été imitée
par Rotrou.
Curculio (le Charançon). C'est le nom du parasite qui
y joue le principal rôle.
Casina. Comédie imitée de Diphile. Le
sujet en est fort scabreux. C'est la rivalité d'un père et
d'un fils.
Cistellaria (ou la Corbeille). Une des premières de
Plaute. Une certaine sentimentalité vertueuse, qui n'est
pas sans charme, y contraste heureusement avec le cynisme
d'une lena.
Épidicus, ou les ruses d'un esclave qui trompe le
père de son jeune maître.
Les douze comédies découvertes seulement au quinzième
siècle sont dans un état de conservation bien inférieur
aux premières. Les mutilations, les interpolations y abondent.
Bacchides (les Bacchis). Pièce d'amour. Le prologue
est apocryphe, ainsi que la première scène.
Mostellaria ou Phasma (le Revenant). Comédie imitée
par Régnard, Addison, Destouches.
Menaechmi (les Ménechmes). Imitée aussi par Régnard.
Miles gloriosus (le Soldat fanfaron). Rappelle le Bramarbas
d'Holbein. Ce type est tout à fait étranger aux
moeurs romaines.
Mercator (le Marchand). Imitation de Philémon,
encore une comédie dont le sujet est la rivalité
d'un père et d'un fils.
Pseudolus (le Fourbe). Une des pièces de prédilection
de Plaute (avec Epidicus et Truculentus). Bons tours
joués à un leno par un esclave. Poenulus (le Carthaginois). Probablement traduit du
Carthaginois de Ménandre. Il est remarquable que
dans un tel sujet il n'y ait pas la moindre allusion politique.
Il fallait donc que tout ce qui touchait à la
vie publique des Romains fût sévèrement banni du
théâtre. C'est dans le Poenulus que se trouve ce fragment
en langue carthaginoise qui a si longtemps exercé
la sagacité des philologues (1).
(1) Acte V.
Le Poenulus fut représenté en 563 ou 564. Il appartient donc à la dernière manière de l'auteur. Aussi y remarque-t-on une observation plus exacte, une peinture plus scrupuleuse des caractères. Persa (le Perse.) C'est à peu près le même sujet que le Pseudolus. Pas de prologue. Rudens (le Câble.) Pièce romanesque et morale empruntée à Diphile. Le prologue, prononcé par l'étoile Arcturus, est d'une grande élévation religieuse et philosophique. Tout n'était pas mauvais dans l'hellénisme que Plante introduisait au théâtre. Stichus. C'est le nom d'un esclave qui célèbre à la fin de la pièce le retour de son maître. Peu de mouvement, mais une singulière pureté de sentiments. Trinummus ou le Trésor, imité de Philémon. Appartient aussi à la dernière manière de Plaute. Le sujet en est moral. Quelque analogie avec celui de l'Enfant prodigue. Truculentus (le Bourru). Tentative pour donner à un esclave une sorte de rôle moral. Plaute aimait beaucoup cette comédie.
§ IV.
CONTEMPORAINS ET SUCCESSEURS IMMÉDIATS DE PLAUTE.
Il y eut, du vivant même de Plaute et dans les dernières années du sixième siècle, un assez grand nombre de poëtes comiques, imitateurs du théâtre grec. Les fêtes publiques, les jeux, les triomphes, les funérailles d'hommes illustres rendirent naturellement plus fréquentes les représentations scéniques. Le métier de poëte commença donc à être lucratif. Il ne semble pas qu'il ait été beaucoup plus estimé. En effet, les auteurs dont l'histoire nous a conservé les noms sont ou des esclaves affranchis ou des personnages de basse extraction. Nous sommes bien éloignés encore du temps où des Romains de noble naissance ne croiront pas s'avilir en se faisant poëtes.
CAECILIUS STATIUS.
A la tête des poëtes comiques de cette période, dont nous ne possédons que des fragments recueillis et disposés par Otto Ribbekk, se place Caecihus Statius, qui fut contemporain de Plaute, et connut Térence. C'était un esclave. Il était Gaulois Insubrien de naissance. Les écrivains du septième siècle en faisaient le plus grand cas, et l'un d'eux, Volcatius Sédigitus, dans le canon qu'il a dressé des auteurs comiques, lui donne la première place, même avant Plaute. Cicéron serait volontiers du même avis, mais un scrupule semble l'arrêter : Caecilius est un mauvais écrivain, malus auctor latinitatis. Varron admire fort la sage économie de ses pièces ; Horace parle de sa gravité, peut-être ironiquement. Aulu-Gelle, dans un long chapitre qu'il lui consacre, ne le compare à Ménandre que pour le déclarer bien inférieur au poëte grec. Caecilius imita surtout Ménandre. Les noms de Luscius Lavinius, de Sextus Turpilius, de Licinius Imbrex, et de plusieurs autres qui vivaient à cette époque, ne nous apprendront rien de nouveau sur le théâtre romain au sixième siècle. A quoi bon rapporter les jugements des anciens sur leur compte, puisque nous ne pouvons les contrôler ? Venons à Térence.
§ V.
TÉRENCE.
Dans le canon des poëtes comiques, dressé au septième
siècle par Volcatius Sédigitus, Térence n'occupe
que la sixième place. Avant lui sont rangés Caecilius,
Plaute, Naevius, Licinius, Attilius. Ennius est le dernier
de tous, et peut-être n'aurait-il pas l'honneur d'y
figurer, si l'on ne devait quelques égards à la vieillesse.
Il s'en faut que de tels jugements doivent être acceptés
sans réserves par nous. Ils sont d'ailleurs démentis
par d'autres jugements portés à des époques différentes.
Rien de plus mobile, de plus sujet aux caprices de
la mode et du goût du jour que la renommée des poëtes
dramatiques. Térence en est un exemple bien curieux.
A mesure que l'hellénisme pénétra de plus en
plus la littérature romaine, sa gloire s'accrut ; au commencement
du septième siècle, le vieil esprit romain
existait encore, au théâtre surtout : c'est l'époque du
grand succès des Atellanes et de quelques comédies à
toge (comaedia togata). Térence fut relégué au sixième
rang. Cent ans plus tard, César le place in summis.
Horace l'épargne seul dans son injuste censure
des vieux poëtes. Les critiques des seizième, dix-septtième
et dix-huitième siècles ont pour lui la plus vive
admiration : pourquoi ? Il est plus poli, d'une douceur
unie, ses peintures de la nature humaine sont plus générales. De nos jours, il est moins goûté que Plaute.
Celui-ci sent plus son Romain ; il a ce goût de terroir
qui nous plaît ; la forte empreinte du cachet national
est sur son oeuvre. Térence est plus terne, ni Grec
ni Romain.
A vrai dire, il est plus Grec que Romain. Originaire
d'Afrique, d'où le surnom d'Afer, amené dès son bas
âge à Rome, il est élevé avec le plus grand soin par le
sénateur Terentius Lucanus, qui l'affranchit. Toutes
les traditions nous le représentent beau, doux, aimable,
avec une légère teinte de mélancolie qui n'est pas sans
charmes. D'une santé délicate, d'une âme plus délicate
encore, il ne peut supporter la douleur que lui cause
la perte de ses vers engloutis dans un naufrage, et il
meurt à trente-cinq ans,dans le plus pur épanouissement
de son talent. Ajoutez à cela ce voyage en Grèce,
sorte de pèlerinage pieux à la terre nourricière de
toute poésie, à la patrie de Ménandre, ce cher modèle
du poëte latin; cette langueur subite, et cette mort mystérieuse
en Arcadie,
seconde patrie des Muses et
de la vie poétique : il y a dans cette existence, si tôt dénouée,
je ne sais quoi de romanesque et de sentimental
qui entraîne l'imagination bien loin de Rome. Les
biographes, obéissant peut-être à leur insu à une loi mystérieuse
d'analogie morale, ont reproduit, à propos de
Térence, quelques-unes des plus touchantes circonstances
de la vie de Virgile, notamment ce suprême voyage
en Grèce, et cette mort dont la cause reste ignorée. Ces
deux figures s'attirent, se répondent. Elle ont des traits
communs ; toutes deux emportent la pensée loin du Latium
et font ressouvenir de l'Attique. Virgile, Térence,
plantes étrangères, charmantes et délicates, qui, transplantées, languissent, se retournent vers le lieu natal et
meurent.
Il est né vers 560 ou 562, huit ou dix ans avant la
mort de Plaute. Il débuta fort jeune au théâtre par sa
comédie de l'Andrienne. On connaît l'anecdote rapportée
à ce sujet par les biographes. Térence se présenta chez
le vieux poëte Caecilius pour lui lire sa pièce. Timide,
embarrassé, ne sachant quelle contenance garder,
on le fait asseoir sur un escabeau ; le maître de la
maison était étendu sur un lit de table et soupait. La
lecture commence : Caecilius s'étonne, il est touché, il
admire, il force Térence à quitter son escabeau, à venir
s'asseoir auprès de lui, à partager son souper. Les derniers
vers lus, il comble d'éloges le jeune poëte, et lui
fait acheter sa pièce par les édiles. Voilà l'anecdote;
elle est honorable pour Cæcilius, et on y retrouve cette
légère teinte romanesque dont je parlais. Les biographes
l'ont voulu : le charme qui était en Térence
gagne jusqu'au vieux rival et le transforme en ami,
en admirateur. Les prologues du poëte ne permettent
guère d'ajouter foi à cet aimable conte. Il s'y plaint
sans cesse des attaques malveillantes et envieuses d'un
vieil adversaire : celui-là, disciple de Plaute sans doute,
n'avait que du mépris pour les grâces efféminées de
l'affranchi du sénateur. Il semble que les spectateurs
aient été de son avis. Le poëte lui-même nous confesse,
non sans amertume, qu'à deux reprises différentes le
peuple abandonna la représentation d'une de ses comédies
pour courir aux tours de force d'un athlète, à un
funambule. Il s'en consolait en disant qu'il aimait
mieux plaire aux gens d'un goût délicat qu'à la multitude
grossière. Ici encore la tradition se plaît à représenter Térence honoré des plus hautes amitiés, admis dans la familiarité
intime des jeunes nobles comme Scipion Émilien
et Lélius ; elle va même jusqu'à attribuer une partie
de son oeuvre à des collaborateurs illustres; et il est certain
que le poëte lui-même autorisait cette conjecture
lorsqu'il disait: « Des envieux prétendent que des
hommes de haute naissance m'aident de leurs lumières
et travaillent avec moi : eh bien ! qu'y a-t-il là d'injurieux
pour le poëte? Il est fier de plaire à des hommes
qui plaisent à tous, au peuple tout entier, à des
hommes qui dans la guerre, dans la paix, dans toutes les
affaires ont rendu service à chaque citoyen sans en être
plus vains. » Certains commentateurs sont allés jusqu'à
indiquer les scènes qui appartiennent à Scipion,
et celles qui sont l'oeuvre de Lélius. Naïve et innocente
illusion de l'érudition ! Quoi qu'il en soit, tous ces traits
réunis donnent à Térence une physionomie toute particulière.
C'est un étranger, un affranchi comme la plupart
des poëtes du temps : mais il a été élevé à Rome ;
de plus, il a été admis dans la société intime de l'aristocratie
la plus délicate de son temps : dans ce monde
déjà raffiné il a puisé ces habitudes d'élégance, ce
bon ton, cette urbanité qui ne l'abandonnèrent jamais ;
et ses comédies en étaient si profondément imprégnées
que les contemporains croyaient y reconnaître la main de
ces hommes distingués et polis qui étaient les arbitres des
belles manières et du goût.
Voilà donc, on peut l'assurer d'avance, un poëte qui ne
ressemblera guère à Plaute. Avec lui, en effet, commence
une ère nouvelle ; il est le premier et un des plus parfaits représentants de cette qualité charmante et indéfinibable que les Grecs appelaient attisme, que les Romains commençaient à désigner sous le nom d'urbanitas. La première
condition de l'urbanité, c'est une culture intellectuelle
riche et variée. Pour les Romains de ce temps,
cette culture ne pouvait leur venir que de la Grèce.
D'abord méprisée par les purs représentants de l'esprit national,
elle commence à être avidement recherchée dans
les dernières années du sixième siècle. Caton lui-même
sacrifie au goût du jour. Paul-Émile, dit Plutarque, fait
élever ses fils à la romaine, mais surtout à la grecque.
Après la défaite de Persée, il fait apporter à Rome les
livres de la Grèce et fonde la première bibliothèque (587).
L'hellénisme pénètre de tous côtés : des philosophes
grecs parlent en public et passionnent la jeunesse romaine
: des Grecs illustres, et à leur tête Polybe et Panætius,
vivent dans la société intime des plus grandes familles.
On commence à rougir de la grossièreté des moeurs
nationales, à comprendre et à rechercher les élégances
de la vie. Cette révolution universelle, qui, comme toutes
les choses de ce monde, fut à la fois un bien et un mal,
ne pouvait laisser la littérature hors de son action. Le
théâtre, ce puissant véhicule de toutes les nouveautés,
fut le premier à ressentir l'effet de cette transformation
générale. Il y eut une réaction très-vive contre la comédie
telle que Plaute l'avait conçue et montrée à la génération
précédente. Térence fut le représentant de cette
réaction.
A en juger par les prologues de ses comédies, le peuple
romain, j'entends la multitude, regretta Plaute et sa
grosse bouffonnerie. Térence semble demander grâce
aux spectateurs ; il accuse d'envie le vieux poète malveillant,
et se justifie assez faiblement des innovations
qu'il hasarde. Les comédies de Plaute étaient pleines de mouvement (motoriae, comme disent les grammairiens),
il brûlait les planches, comme nous dirions aujourd'hui
; celles de Térence sont du genre calme,
presque immobiles (statariae). Il implore le silence et
l'attention ; il se doute bien en effet que la douceur unie,
les grâces délicates de son oeuvre échapperaient à un
public turbulent. Celui-ci était forcé de tenir ses yeux
et ses oreilles attachés à la scène, quand à chaque instant
un esclave s'y précipitait en fuyant, un vieillard
s'y démenait en fureur, un parasite y exposait ses bouffonnes
infortunes, un avare leno se voyait assiégé ou
battu par l'amant dont il détenait la maîtresse. Rien
de tout cela dans Térence ; il méprise ces turbulences,
il ne veut pas abaisser son art jusqu'à l'emploi de
ces grossiers moyens. Mais le succès était à ce prix.
C'est là le caractère le plus saillant de ses comédies :
elles manquent de mouvement. Charmantes à la lecture,
elles sont froides à la représentation. Des Athéniens
auraient pu s'y plaire : elles ennuyaient des Romains.
Les sujets sont empruntés au théâtre grec ; c'était
une nécessité, mais quelle variété dans les poëtes de
la comédie nouvelle ! Lequel imiter de préférence ?
Plaute a une prédilection particulière pour Philémon,
le plus gai, le moins scrupuleux de tous ; et il charge
encore les peintures du modèle. C'est à Ménandre
que Térence s'attache, au plus pur et au plus délicat
des poëtes attiques, le moins romain de tous, si on
peut parler ainsi. Les didascalies, les prologues ne
manquent pas de nous apprendre que la pièce est tout
entière grecque : cela est vrai ; elle
est grecque par le choix des sujets, par l'unité de couleur, par la scrupuleuse observation de la vérité locale.
Pas d'anachronismes, pas de transpositions de lieux, de
moeurs, d usages : dans Plaute, on voit Rome derrière
Athènes, on la sent pour ainsi dire vivante et présente
dans tous les détails de l'oeuvre ; rien de tel dans Térence.
Pas une allusion, pas une réminiscence. La
pièce est bien grecque ; c'est un calque d'un art parfait.
Mais où est la vie, où est l'intérêt pour les contemporains
?
Chose bien remarquable et qui met en pleine lumière
l'art exquis de Térence. Il avoue que plus d'une fois,
à l'imitation de ses devanciers, il a fondu deux pièces
grecques en une seule. Dans Plaute, ces agencements
sautent aux yeux ; on voit la pièce rapportée : Térence
adapte l'épisode au sujet principal avec tant d'art, que
l'ensemble de l'oeuvre n'en est pas détruit. Il est vrai
que les innombrables comédies grecques, presque
toutes semblables par le sujet, rendaient plus faciles
ces transpositions. On l'accusait cependant de se les permettre
: c'était gâter, disait-on, les sujets grecs. Sans doute ses rivaux, qui
lui adressaient ces reproches, craignaient que ces soudures
si habilement faites ne rendissent le public plus
exigeant et plus difficile pour leurs propres oeuvres : ils n'y mettaient eux pas tant de façons. Térence avait
l'amour et le respect de son art. Ses prédécesseurs
exerçaient un métier et un métier peu estimé ; Térence
est un poëte, dans l'acception la plus délicate du mot:
c'est en qualité de poëte et d'homme de bonne compagnie,
qu'il est recherché par les Scipions et les Lélius ;
il ne compromettra jamais ce double caractère. Dût le
succès faire défaut, il n'abaissera point le niveau de l'art il ne souillera point par des plaisanteries viles la fine
fleur de son beau langage. Les épisodes qu'il ajoute à
l'action principale font corps avec elle : dans Plaute,
ce sont des hors-d'oeuvre que rien ne justifie, si ce n'est
le besoin d'égayer la scène. Souvent même Plaute
introduit un personnage qui n'est d'aucune utilité dans
la pièce, un parasite par exemple : Térence se refuse
sévèrement une telle licence. Le public romain la supportait,
la réclamait même ; mais le poëte plus difficile
ne voulait pas acheter un succès à ce prix.
Non seulement il n'y a aucun personnage inutile ;
mais tous se tiennent et se complètent pour ainsi dire
l'un l'autre. Térence excelle dans ces oppositions heureuses qui mettent en lumière les différences de caractères,
source féconde de comique noble. Les Adelphes sont un modèle du genre. Notre Molière a reproduit
à un dégré bien supérieur ces contrastes ingénieux
dont il ne faut pas abuser, sous peine de faire dominer
les abstractions dans une oeuvre éminemment concrète
par sa nature.
Mais l'innovation capitale de Térence, ce sont ses
caractères. Dans Plaute, ils sont esquissés à grands traits,
et souvent voisins de la caricature : Térence peint
avec amour de fines miniatures. De là son aversion
pour les personnages bas et ignobles, qui exigeraient
des tons criards, de grosses couleurs, et forceraient
l'acteur et le poète à élever la voix. Le vil leno, si
cher à Plaute, est banni du théâtre de Térence ; vous
n'y trouverez pas non plus l'impassible et rapace courtisane,
être sans entrailles et qui ne vit que pour le
gain ; ni l'esclave ivrogne, gourmand et débauché, toujours
placé entre la fourche, les étrivières ou le cachot humide de la cave ; ni les pères imbéciles et lascifs,
qui tolèrent les vices de leurs enfants à condition qu'ils
puissent satisfaire les leurs ; ni les pudeur jeunes gens sans et sans esprit, exploités, raillés, insultés par les esclaves malins et méprisants. Toutes ces crudités
font rire le peuple, mais de quel air les gens du monde les recevraient-ils? De tout ce monde tumultueux,
grossier, cynique, à qui Plaute a donné droit de cité, Térence n'a conservé que le parasite. Mais comme il l'a transformé ! Qui reconnaîtrait dans Gnaton, gros, fleuri, gai, dispos, ce misérable Laconien, ce souffre douleur, cet homme du bas bout de la table, que les
convives en belle humeur vilipendent, inondent d'eau
sale, accablent de projectiles de toute nature, et qui quitte la table du festin tout en sang ? La vie du monde
qui commence a adouci les moeurs, poli les vices, modifié les industries. Les gens riches ont encore des parasites à leur table
,
mais ce n'est point pour les rouer de coups, distraction grossière et bonne pour les Romains d'autrefois. Le parasite moderne est un homme d'esprit qui sait flatter. Voilà pourquoi il trouve son couvert mis dans les bonnes maisons. Le passage est
curieux, je veux le transcrire. Nous prenons sur le vif un des côtés les plus intéressants de la société
nouvelle qui se fonde sur les ruines de l'ancienne, et Térence nous apparaît ce qu'il est en effet, le représentant au théâtre des moeurs et des habitudes du jour.
Le parasite Gnaton. « Quelle différence, grands dieux!
d'un homme à un autre ! Que les gens d'esprit l'emportent
sur les sots ! Voici ce qui me fait penser ainsi.
Aujourd 'hui, en arrivant, je rencontre un homme de
mon pays, de ma condition, homme très comme il faut,
qui avait dévoré tout son patrimoine. Le malheureux
était sale, malpropre, défait, couvert de haillons et vieilli
par la misère. « Quel est cet équipage, lui dis-je? J'ai
perdu tout ce que je possédais : voilà où j'en suis réduit.
Tous mes amis, toutes mes connaissances m'abandonnent.
» Je le pris en dédain : il me ressemblait si
peu ! « Quoi ! lui dis-je, ô le plus lâche des hommes,
es-tu donc au point de ne trouver plus en toi-même aucune
ressource? as-tu perdu l'esprit en perdant ton bien?
Je suis de même condition que toi : vois ce teint, cette
fraîcheur, cet embonpoint, ces habits! J'ai tout et ne
possède rien; je n'ai pas un as et rien ne me manque.
Mais j'ai un malheur, je ne sais pas faire le métier de
bouffon et endurer les coups. Eh ! crois-tu donc que ce
soit là mes moyens ! Tu te trompes du tout au tout.
Jadis, dans l'ancien temps, on gagnait ainsi sa vie; mais
nous faisons une autre chasse aujourd'hui : et c'est moi
qui en suis l'inventeur. Il y a des gens qui veulent être les
premiers en tout, et qui en sont bien loin : je m'attache à
eux, non pour les faire rire ; au contraire, c'est moi qui
ris de tout ce qu'ils disent. Je me pâme d'admiration à
leurs moindres mots, des éloges à propos de tout: quand
ils disent oui, je dis oui; quand ils disent non, je dis
non. Enfin je me suis fait une loi de leur complaire,
de les flatter en tout. C'est aujourd'hui la meilleure de
toutes les industries (1). »
(1) Eunuque, act. II, sc. iii.
On peut étendre ce parallèle à tous les caractères ;
l'étude est intéressante, et l'on voudrait pouvoir s'y arrêter.
Je me borne à indiquer celui de l'esclave, de la courtisane, du père, et enfin du soldat fanfaron. Tous
ces types, vulgaires, mais saisissants de vérité et de verve
dans Plaute, sont adoucis, urbanisés dans Térence. La
touche est plus mesurée, plus délicate ; il n'aime pas les
gens de basse compagnie et de langage grossier ; il faut
avoir fait sa toilette pour entrer dans le salon où le poëte
réunit ses personnages.
Ces délicatesses qui nous charment doucement, le
poëte comique les expie chèrement. Ses personnages n'ont pas les mouvements assez vifs, le verbe assez haut,
l'expression assez colorée. On ne supporterait pas dans le
monde un homme qui se démènerait, agiterait les bras,
frapperait du pied, parlerait haut et fort, accaparerait
pour lui seul toute l'attention de l'assemblée; au théâtre,
il faut être ainsi. Les personnages sont censés possédés
d'une passion dominante qui ne leur permet pas d'être
calmes et mesurés. Comme la tragédie, la comédie
est une crise. Il y faut de l'action et une action vive,
de l'entrain, une certaine fièvre. Cet amant obtiendra-t-il celle qu'il aime, dont il est séparé, qu'il désire,
qu'il pleure? Ce père inquiet, tourmenté des folles amours
de son fils, réussira-t-il à le guérir de sa maladie ?
Cet esclave qui sert son jeune maître aux dépens du
père de famille, sera-t-il assez malin, assez rusé, assez
menteur pour tromper le vieillard et satisfaire le jeune
homme? Térence est trop calme; il craint trop les saillies
impétueuses, les incorrections de termes et de langage
; ses personnages, même les plus infâmes, sont
trop convenables. Il n'a pas le diable au corps, l'action
se déroule doucement, uniformément, régulièrement.
Les parties en sont tien disposées, bien agencées,
l'intrigue raisonnablement embrouillée, jamais trop, le dénoûment judicieusement préparé, chaque chose est
à sa place, chaque personnage se tient religieusement
dans son rôle ; mais quoi ! le rôle manque de relief, on
est intéressé, non ému. Et ce qui est plus grave, on
ne rit jamais. Tout au plus, ce sourire des dilettanti,
qui n'applaudissent jamais, parce que cela est de mauvais
ton, et qu'ils ne sentent jamais assez vivement pour
s'oublier à ce point.
La sentimentalité remplace la gaieté. Térence est une
âme tendre ; il a fait ses personnages à sa ressemblance.
Ce n'est pas la fougue de la jeunesse, l'élan désordonné
du désir qui emporte ses jeunes gens ; ils aiment de
toute leur âme : ce sont des amants modèles dont on
souhaite de voir couronner la flamme. L'objet de leur
passion, c'est une courtisane, il est vrai : mais que de
grâces et de vertus dans cette courtisane ! L'une ne vit que
pour sa soeur, et la recommande à son lit de mort aux
nombreux amants qui recueillent ses dernières volontés (l'Andrienne); l'autre ne songe qu'à prévenir de toute
souillure, pour la rendre à sa famille, la jeune esclave
dont un amant lui a fait cadeau (l'Eunuque) ; une troisième
inspire par ses aimables qualités une si profonde
affection, que son amant marié par force lui reste fidèle
et refuse de vivre avec sa jeune femme (l'Hécyre). C'est
la courtisane qui en fait un bon mari. Quelle honnêteté
! quelle douceur ! quelle grâce dans ces créatures
! N'est-ce pas là l'idéal de la femme ? Dévouées,
généreuses, spirituelles, complaisantes, qui pourrait se
flatter de trouver toutes ces qualités réunies dans l'épouse
que donne la loi ? Aussi la conclusion naturelle
que tire le spectateur de ces belles peintures, c'est que
le célibat est le meilleur de tous les états. Les pères regrettent de s'être mariés et ne pressent pas trop leurs
fils de les imiter. Il faut que jeunesse se passe, disent-ils, et le plus agréablement possible. L'un d'eux
(Heautontimorumenos) se punit cruellement d'avoir
contrarié les amours de son fils et se réjouit du dénoûment
qu 'il avait voulu empêcher. Tout cela respire
une corruption achevée, si achevée qu'elle n'a plus
conscience d'elle-même. L'invraisemblance et l'impossible
dominent chez Plaute. On a beau faire, on ne peut
prendre au sérieux l'action qu'on voit représenter. C'est
un prétexte à scènes gaies, à saillies joyeuses et folles ; le dénoûment arrive comme il peut. On n'emporte du
théâtre que l'impression générale d'une heure de bouffonnerie.
Térence atteint les fibres secrètes du coeur;
il faut qu'on s'intéresse à ce monde qu'on a sous les
yeux. La multitude n'y prenait pas grand plaisir ; mais
quelles leçons pour ces jeunes patriciens, riches, ardents,
élevés à la grecque, et tout disposés à vivre à
la grecque !
Telle est la véritable originalité de Térence. Il donna
définitivement droit de cité à l'hellénisme ; il en importa
à Rome la grâce et la corruption douce. La hardiesse
philosophique des poëtes grecs, leurs plaidoyers
simples mais concluants en faveur de l'égalité des hommes,
des droits de la raison, trouvèrent en lui un interprète
modéré, réservé. De telles idées n'étaient pas
mûres encore, et eussent effarouché le patriciat orgueilleux
et exclusif de Rome. Cependant c'est Térence qui
a écrit (sans doute traduit) le plus beau vers peut-être
de toute la littérature latine. «Je suis homme, rien de
ce qui touche à l'humanité ne m'est étranger. »Térence est un des plus purs écrivains latins, puri sermonis amator, dit César. Varron résumait, par le mot
expressif de mediocritas, l'ensemble de ses qualités, la
mesure, la proportion exacte : voilà bien en effet le caractère
de son style. Rien de forcé, rien d'excessif,
pas de tons criards dans la peinture, pas de note imprévue
dans cette douce harmonie : mais aussi rien
de piquant, de saisissant, de dominateur. Il ne s'impose
pas, il s'insinue. Il faut, pour le comprendre et l'apprécier,
avoir le goût délicat, l'esprit cultivé, être du
monde. Il vous donne une idée assez juste de ce que
pouvait être le ton des honnêtes gens d'alors. Il a eu
dans l'antiquité même de nombreux commentateurs,
Probus, Donatus, Eugraphius ; ses oeuvres ont été reproduites
fort souvent; le manuscrit du Vatican est
du cinquième siècle. Peu représentées, elles n'ont pas
eu comme celles de Plaute à souffrir des mutilations
et des
interpolations des comédiens. Chacune de ses
pièces est accompagnée d'une didascalie qui nous
donne la date à peu près certaine de la représentation.
Suivant toute vraisemblance, le poëte, lié avec les principaux
personnages du temps, vendit fort bien ses pièces
aux édiles,
le prix qu'il voulut. La censure ne fut pas une entrave pour lui ; et
d'ailleurs l'anecdote de Ceecilius semblerait prouver que
les édiles se déchargeaient volontiers de la tâche de
choisir les comédies à représenter, sur des littérateurs
de profession. Ils n'intervenaient que pour payer. C'est
là un progrès réel, très sérieux, qui fut une conquête
pour l'art.Mais il eût fallu ne pas s'arrêter là, et
permettre sur une scène romaine la représentation de
la vie romaine.
Les six comédies de Térence portent toutes des titres grecs. Voici l'ordre dans lequel elles furent représentées.
L'Andrienne (588).
L'Heautontinortimenos (591), représentée en deux
fois. Les deux premiers actes d'abord, les trois derniers
le lendemain.
Le Phormion (592).
L'Eunuque (593).
L'Hécyre (594), deuxième représentation. La première
échoua : les speclateurs quittèrent la salle pour
courir aux exercices d'un athlète et d'un funambule.
Les Adelphes (594).
Térence mourut probablement en 595. Il laissait à
sa fille un nom illustre et une certaine fortune. Elle
épousa un chevalier romain.
Caton (Marcus Porcius Priscus Cato Censorius).
Caton vécut quatre-vingt-dix ans. Il mourut en 605; il
est donc né en 515, c'est-à-dire la même année que le
poëte Ennius, et il a survécu à Térence. Il a vu l'hellénisme
se glisser timidement à Rome, servir de modèle aux
premiers essais littéraires, puis régner au théâtre et bientôt
après dans les habitudes et dans les moeurs. Quand il
meurt, cette importante révolution est consommée. La
Grèce vaincue a réellement subjugué son farouche vainqueur.
Caton lutta toute sa vie pour empêcher ou restreindre
cet envahissement de l'étranger. C'est en cela
que consiste surtout son originalité. On peut lui donner
pour devise le beau vers d'Ennius : « C'est par ses
moeurs antiques et ses hommes que Rome se tient debout. »
Voyons donc ce que c'était au sixième siècle qu'un Romain
de moeurs antiques.
Il est né à Tusculum. Rome ne produisait déjà plus
de tels hommes. Il sortait d'une forte race de laboureurs,
de soldats et aussi de plaideurs. Déchirer et pressurer le
sol, battre l'ennemi et lui enlever son territoire, défendre
en justice son bien et celui de ses amis : voilà les trois occupations capitales du Romain de vieille souche. Pas un
moment réservé à l'étude, au loisir (otium), aux aimables
entretiens. Les ancêtres de Caton étaient hommes des
champs, adonnés à la culture et à l'élève du bétail ; de là
le surnom de Porcius (porcher). C'étaient gens rudes, sobres,
vigoureux. Tel fut Caton. Ce fut lui qui porta le
premier ce surnom « en raison de son grand sens et de sa
suffisance » (catus, avisé). Il était roux, yeux gris, robuste
; sa première jeunesse se passe aux champs ; à dix-sept
ans, il fait la guerre contre Annibal et assiste à la
défaite du lac de Trasymène. Tout le temps que lui
laissent la guerre et les travaux des champs, il le consacre
à plaider soit pour lui-même, soit pour d'autres.
« Ainsi se rendit-il bon plaideur et eut la parole à commandement.
»
A la guerre il allait à pied, portant lui-même son bagage,
ne buvait en marche que de l'eau relevée d'un peu
de vinaigre. Aux champs, il labourait avec ses esclaves,
nu comme eux, mangeant avec eux, couchant tout habillé,
jetant sur lui une mauvaise jaquette. Dans son
voisinage on voyait encore la maison du fameux Curius
Dentatus. Ce fut l'idéal que se choisit Caton. Plutarque
en voudrait faire un disciple du pythagoricien Néarque :
rien de moins vraisemblable. Il n'allait pas chercher ses modèles
si loin de Rome.
De telles moeurs étaient déjà devenues fort rares.
Quand Caton se présenta à Rome, avec la recommandation
de M. Valérîus, le. peuple reconnut un des siens et
le nomma tribun des soldats d'abord, puis questeur. Il
accompagna en cette qualité Scipion en Sicile (548).
Celui-ci trouva en son questeur un surveillant incommode
et le renvoya à Rome. Grandes clameurs de Caton contre cette noblesse hautaine, dépensière et qui affichait
le mépris des vieilles moeurs. Le peuple estime d'autant
plus Caton, et, malgré les nobles, l'élève successivement
à la préture, au consulat, à la censure. En Espagne,
il prend en trois cents jours quatre cents villes ou
villages, rapporte au trésor une somme immense. Au
moment de s'embarquer, il vend son cheval pour épargner
à l'État les frais du transport. Il obtient le triomphe, et
retourne à l'armée, simple tribun, pour combattre Antiochus.
Il sauve les légions aux Thermopyles.
Il est surtout célèbre par sa censure. Jamais fonctions
plus délicates ne furent exercées avec une plus intraitable
rigidité. Il faut voir dans Plutarque le récit de toutes
ses exécutions. Il dégrade et chasse du sénat les représentants
des plus nobles familles, un Flaminius, un
Manilius. Il fait une guerre sans pitié à toutes les importations
du luxe, établit des taxes énormes sur les
beaux meubles, les belles étoffes, les beaux esclaves,
les délicatesses de la table. Il casse les marchés onéreux
pour l'État, qui enrichissent les entrepreneurs.
Tout cela au grand applaudissement du peuple, dont
ce luxe semblait braver la misère ; mais il suscite contre
lui des haines énergiques et insatiables. Il fut accusé
jusqu'à cinquante fois; mais il n'en avait souci. Il était
toujours absous, et il réussissait presque toujours à faire
condammer ceux qu'il attaquait. A quatre-vingt-dix ans
il cite en justice Servilius Galba, et soutient lui-même
l'accusation.
Il haïssait les Grecs : il les avait vus chez eux, et les y
aimait mieux qu'à Rome. Il dit à son fils : « Je parlerai
des Grecs en temps et lieu; mon fils Marcus. Je dirai
ce que j'ai observé à Athènes. Il peut être bon d'effleurer leurs arts, mais non de les approfondir. Cette race est de
toutes la plus perverse et la plus intraitable. Ce que je
vais dire, crois-le, c'est parole d'oracle. Toutes les fois
que cette nation nous apportera ses arts, elle corrompra tout, et c'est pis encore si elle envoie ici ses médecins.
Ils ont juré entre eux d'exterminer par la médecine tous
les barbares jusqu'au dernier. Ils n'exigent le salaire de
leur métier que pour usurper la confiance et tuer plus
à l'aise. Nous aussi ils nous appellent barbares, et nous
outragent plus ignominieusement que tous les autres peuples,
en nous traitant d'Opiques. Mon fils, je t'interdis les
médecins. »
Cette haine, instinctive d'abord, puis raisonnée, politique
pour ainsi dire, étouffe, en lui tout sentiment de pitié
pour les individus. Polybe et les autres exilés grecs supplient
depuis de longues années le sénat de les rétablir
dans leur patrie. Voici l'ordre du jour que propose Caton
: « Nous avons autre chose à faire qu'à nous amuser
à discuter tout un jour pour savoir si des vieillards grecs
seront enterrés ici par les fossoyeurs de Rome ou par
ceux d'Achaïe. »
On voulait lui faire admirer Socrate : « C'est un bavard
et un séditieux, dit-il, qui attaquait les croyances, corrompait
les moeurs et aspirait à la tyrannie. »
Il entend les beaux discours des trois philosophes
grecs envoyés en ambassade, Carnéade, Diogène, Critolaüs
(599) ; il est témoin de l'enthousiasme de la jeunesse
pour ces agréables parleurs. Vite, il demande qu'on les
renvoie chez eux. « Quand les Romains s'adonneront aux
lettres grecques, disait-il, ils perdront et gâteront tout. »
Tel est l'homme politique, avec sa rigueur, ses préjugés,
son inflexibilité. Dans la vie privée, c'est le modèle du père de famille. Il voit tout et fait tout par lui-même.
Il est agriculteur, économe, intendant, médecin,
pédagogue, maître d'école. Il soigne sa femme, son fils,
ses boeufs malades, lui-même, et par quels remèdes ! Il
est bon époux, bon père, ne maltraite jamais ces êtres
faibles dont la loi l'a fait le maître. Il est juste envers
tous, même envers ses esclaves. Après dîner il distribue
aux négligents et aux paresseux le nombre exact de coups
de fouet qu'ils ont mérités. Il ne confie à nul autre qu'à
lui-même l'éducation de son fils. Il lui apprend lui-même
la lecture, puis la grammaire, les lois, voilà pour l'esprit.
L'escrime, l'équitation, le pugilat, voilà pour le corps. Il
compose lui-même et écrit de sa propre main de belles
histoires en gros caractères pour lui faciliter les débuts
de la lecture. Homme d'ordre et d'économie, il était
âpre au gain. C'était une de ses maximes favorites :
« Que celui-là était un homme divin qui par son industrie
augmentait son avoir et laissait à ses enfants en revenu
ce qu'il avait reçu en capital. » De tels principes mènent
loin. Caton en arriva sur la fin de sa vie à pratiquer
l'usure et la plus décriée de toutes, l'usure maritime.
Il faisait commerce d'esclaves ; les achetait tout petits, à
bas prix, les revendait grands et bien formés. Quand ils
devenaient vieux, il les vendait avec le vieux boeuf et la
vieille ferraille. « Le père de famille, disait-il, doit être
vendeur, non acheteur. »
Voilà l'homme. Que sera l'écrivain ?
A coup sûr ce ne sera point un poëte. C'est Caton qui
a fait cadeau à Rome d'Ennius, mais il l'a probablement
regretté plus d'une fois, car nous savons qu'il reprocha
comme une honte à M. Fulvius
Nobilior de s'être fait accompagner du poëte en Etolie. C'est lui qui disait : « La poésie n'était pas en honneur,
ceux qui s'y appliquaient et. ceux qui allaient mendier
des repas, portaient le même nom » (grassator vocabatur).
Il méprise souverainement et l'industrie et la
personne des faiseurs de vers. J'ai montré déjà que ce
préjugé tout romain avait sa raison d'être. Les poètes
du sixième siècle, étrangers, esclaves ou affranchis,
étaient peu faits pour commander le respect et l'estime.
De plus, c'étaient des traducteurs de ces Grecs que Caton
craignait et dédaignait à la fois. Caton sera donc un
prosateur. Par ses qualités et ses défauts, son bon sens
rigide, son esprit pratique, son manque complet d'imagination,
il est voué fatalement à la prose. La poésie
est un luxe, la prose est la langue des affaires. Un beau
poëme ne prouve rien, ne sert à rien ; un bon discours,
un solide traité, une histoire savante : voilà des oeuvres
éminemment utiles. Dans Caton l'écrivain disparaît derrière
le politique, l'économiste, le citoyen. Il n'écrit
pas pour écrire. Il a toujours un but pratique, positif,
nettement déterminé. Nous voilà bien loin des tragédies
et des comédies imitées du grec Livius Andronicus,
Ennius, Plaute et Térence importent à Rome comme ils
peuvent les produits de l'art attique ; Caton nous montre
les produits naturels de l'esprit romain.
C'est un savant jurisconsulte. A Tusculum il donnait
des consultations sur le droit et plaidait pour le premier
venu. C'est un avocat habile, qui possède toutes les
adresses du métier ; à Rome, il devient orateur. Les sujets
croissant en importance, l'éloquence de Caton grandit
avec eux. Il n'est pas insensible à la gloire de bien
dire, gloire utile entre toutes. L'éloquence est une arme
redoutable aux mains d'un homme résolu, ferme dans ses principes, vivant au grand jour et toujours prêt à
la lutte. Il accuse, il se défend, il défend ses amis : voilà
pour l'éloquence judiciaire ; il prend la parole au sénat, au
forum, sur les grandes questions de la paix ou de la
guerre, des lois à proposer ou à abroger. Il défend par
exemple contre le tribun Valérius et contre l'émeute
des femmes qui assiègent le forum la loi Oppia qui interdit
aux matrones de porter des vêtements de pourpre,
de se faire trainer dans des chars, loi absurde dans sa
rigueur, loi portée pendant qu'Annibal campait à Capoue
et que Rome était au plus bas, loi que des temps meilleurs
et les progrès nécessaires du bien-être et du luxe
ont abolie en fait, mais dont Caton exige le maintien.
Voilà bien l'homme opiniâtre, l'homme des anciens usages,
l'ennemi irréconciliable de toute innovation. La plupart
de ses discours ont le même caractère : âpre censure
du présent, glorification sarcastique des choses du passé.
Il se plaît à opposer aux hommes du jour l'image de sa
vie. « On m'accuse, dit-il : moi qui ai consumé toute
ma jeunesse dans l'épargne, la pauvreté rude, le travail,
moi qui ai vécu en labourant mon champ, au milieu des
rochers de la Sabine, défrichant et ensemençant des
cailloux » et ailleurs : « Dans cet outrage qui m'est
fait par ce misérable écervelé, c'est la chose publique,
oui, c'est elle que je prends en pitié. » Partout le même
ton âpre et méprisant ; partout cette hautaine identification
de sa personne avec la république. Il se sent
et se proclame le seul vrai Romain de son temps. Écoutez-le rendant compte de ses dépenses devant le peuple.
Sans doute il était accusé d'avoir dilapidé les fonds publics.
Son apologie est une censure du tour le plus vieux,
le plus insolent. Chaque détail est un coup de massue pour ses détracteurs. On accuse Caton, Caton accuse tout
le monde.
« Je fis apporter le registre où était écrit mon discours.
On produit les tablettes où se trouve l'engagement contracté
par moi avec M. Cornélius ; on lit les belles actions
de mes ancêtres, puis les services que j'ai rendus à la
république. A la suite on trouve dans le discours ces
mots : « Jamais je n'ai dilapidé dans des brigues ni mon
argent, ni celui des alliés. » Non ! non ! n'écris point
cela, dis-je, ils ne veulent entendre rien de tel. » Il continua
à lire. « Ai-je jamais imposé aux villes des alliés
des lieutenants qui ravissaient leurs biens et leurs enfants
? » Efface encore cela : ils ne veulent point l'entendre.
Continue : « Jamais je n'ai partagé entre trois ou
quatre amis ni le butin, ni ce qui avait été pris à l'ennemi,
ni les dépouilles de la guerre ; jamais je n'ai
enlevé leur conquête à ceux qui l'avaient faite. » Efface
encore cela, il n'y a rien qu'ils veuillent moins entendre,
ce n'est pas bon à dire. Continue: «Jamais je n'ai fait
cadeau de relais publics à mes amis, afin qu'ils pussent
en trafiquer, et gagner gros. » Efface, efface encore cela
avec le plus grand soin. «Jamais je n'ai distribué entre
mes appariteurs et mes amis de grosses sommes d'argent
pour le vin et la nourriture qui leur étaient dus; je ne
les ai point enrichis au détriment du trésor. » Ah ! pour
cela, efface-le jusqu'au bois. Vois, je te prie, où en
est réduite la république ! Ce que j'ai fait de bien à son
service, les actions qui étaient pour moi un titre à la
reconnaissance, je n'ose pas les rappeler aujourd'hui, de
peur de soulever la haine contre moi. Voilà où nous en
sommes ! On peut faire le mal impunément, on ne peut
faire le bien. » On possédait au temps de Cicéron plus de cent cinquante
discours de Caton. Il avait occupé les dernières
années de sa vie à revoir et à publier ces monuments
de son éloquence et de son intégrité. Il avait même composé
sous le titre de de Oratore une sorte de manuel de
l'orateur pour son fils. Cicéron faisait le plus grand cas
de ces discours : cependant ils étaient dédaignés de son
temps : la forme en était trop rude. Voici ce qu'il en dit :
« Est-il aujourd'hui un seul de nos orateurs qui lise
Caton? en est-il même un seul qui le connaisse? Et cependant
quel homme, grands dieux! Ne voyons point en
lui le citoyen, le sénateur, le général, il ne s'agit ici que
de l'orateur. Qui jamais sut louer avec plus de noblesse?
blâmer avec une plus mordante énergie ? Quelle finesse
dans les pensées, quelle ingénieuse simplicité dans l'exposition
des faits et des arguments! Les cent cinquante
discours et plus, que j'ai trouvés de lui jusqu'à ce jour et
que j'ai lus, sont remplis d'idées et d'expressions brillantes.
On peut en extraire ce qui est digne de remarque
et d'éloges ; on y trouvera toutes les beautés oratoires...»
Et plus loin : « Son style est trop vieux ; on trouve chez
lui des mots surannés ; c'est qu'alors on parlait ainsi.
Changez ce qu'il ne pouvait changer dans ce temps-là ;
ajoutez du nombre à ses périodes; mettez entre leurs
parties plus de liaison et de symétrie ; joignez et assemblez
avec plus d'art les mots eux-êmes ; alors vous ne
mettrez personne au-dessus de Caton (1). »
(1) Cicer., Brut., c. XVII.
Dans son recueil des fragments des orateurs anciens,
M: Meyer a réuni tout ce qui nous a été conservé de Caton.
Tite-Live avait peut-être sous les yeux l'original de son discours pour la loi Oppia, quand il a composé la
fameuse harangue qu'il prête au défenseur de la loi. On
sait que Salluste étudia avec le plus grand soin la langue
et le style de Caton, et imita l'un et l'autre avec plus
d'affectation que de bonheur. Sous les empereurs, les
érudits remirent à la mode le vieil orateur. Hadrien le
préférait à Cicéron. Les compilateurs le citèrent et le
commentèrent avec complaisance. C'est à eux, à Aulu-Gelle surtout, que nous devons les fragments qui nous ont
été conservés.
Si nous, en jugeons par les témoignages de l'antiquité
tout entière, il y a peu d'ouvrages dont la perte soit plus
regrettable que celle des Origines de Caton. Sous ce titre
évidemment incomplet, Caton avait construit une sorte
d'encyclopédie de toutes ses connaissances historiques.
L'ouvrage se composait de sept livres. La légende, l'histoire,
les lois, les moeurs, les événements anciens et récents,
tout y était rapporté. L'auteur s'était d'abord proposé,
comme le titre l'indique, un essai sur l'histoire de
la fondation des principales villes d'Italie. Le premier
livre était consacré à Rome : quelle tradition avait adoptée
Caton ? on l'ignore. Le deuxième et le troisième livre
renfermaient l'histoire des origines des cités les plus importantes
de l'Italie. Les quatre derniers étaient consacrés
au récit des guerres puniques en Sicile, en Italie et en
Espagne. Toute cette partie devait ressembler pour la
composition et la forme à nos mémoires. Caton exposait
avec complaisance les événements où il avait joué un
rôle. Le discours pour les Rhodiens, dont Aulu-Gelle nous
a conservé des fragments considérables, faisait partie des Origines. C'est encore dans cet ouvrage que Caton rappelait
l'héroïsme du tribun des soldats Cédicius. C'est là encore qu'il mentionnait l'antique usage romain, de
célébrer dans des chants accompagnés de la flûte les
grands hommes qui avaient illustré la patrie. Cicéron
donne à l'auteur l'épithète de gravissimus : voilà pour le
sérieux du fond. Quant à la forme, elle était plus remarquable
encore. C'est une fleur, c'est une lumière
d 'éloquence, dit Cicéron. Mais ce qui donnait à cet ouvrage
une importance capitale, c'est qu'il inaugurait la
prose latine. Tous les prédécesseurs immédiats, tous les
contemporains de Caton écrivent en grec ; tel Q. Fabius
Pictor, tel Cincius Alimentus, tel Acilius Glabrio,
soit par dédain de l'idiome national, soit pour faire admirer
leur érudition. Caton écrit pour des Romains, et il
écrit dans leur langue. Elle est rude encore, sans souplesse,
sans élégance, mais elle n'en rend que mieux la
forte et sobre pensée de l'auteur. Autre innovation. Tous
les écrivains que je viens de citer, sont des annalistes.
Ils enregistrent année par année, à l'exemple des
pontifes, les principaux événements dont ils ont été témoins.
Aucune autre composition que l'ordre chronologique.
L'ouvrage de Caton forme un tout, il est distribué
en diverses parties : la personnalité de l'auteur crée
l'ouvrage. Il expliquait lui-même d'ailleurs les raisons qui
lui avaient fait renoncer à la forme des annales. « A
quoi bon, disait-il, répéter ce qui se trouve dans les annales
des pontifes, le prix du blé, les disettes, les éclipses
de lune ou de soleil? » Ainsi sur ce point, Caton est
novateur, homme de progrès, comme nous dirions aujourd'hui, mais c'est un progrès romain qu'il veut. Qu'on
emprunte aux Grecs leur art, soit, mais qu'on écrive en
langue nationale l'histoire de la patrie.
Cicéron, dans cet aimable plaidoyer en faveur de la vieillesse, qu'il intitule Caton l'Ancien (Cato Major), se
plaît à environner d'une sorte d'auréole poétique cette
rude figure de l'inflexible censeur. C'est un Socrate mélancolique,
doux, tendre, comprenant et aimant tout ce
qui est beau, délicat, gracieux. Jamais transformation ne
fut plus complète d'un type en un autre tout différent.
Parmi les plaisirs que le Caton de Cicéron trouve dans la
vieillesse, il n'a garde d'oublier ceux que donne la vie des
champs. Quelle merveille que cet attendrissement de la
terre au printemps, ce sein tiède qui s'ouvre pour recevoir
la semence, le grain qui fermente, éclate et pousse la
frêle tige verte ; celle-ci se durcissant, s'arrondissant en
cylindre flexible, se couronnant enfin de l'épi ; la capsule
délicate et résistante qui retient chaque grain de blé, ces
longs piquants qui le garantissent comme un rempart
contre le bec des petits oiseaux ! Et la vigne dont les vrilles
rampantes s'accrochent, relèvent le sarment ! et les
bourgeons, ces diamants qui percent la rugueuse écorce
du bois qui semble mort ! et les jardins, et les belles
fleurs, et tous ces parfums, tout cet éclat, tout ce charme
de la nature se révélant heure par heure dans sa féconde
variété à l'oeil de l'homme qui admire! C'est dans son
imagination et aussi dans la lecture de Xénophon que l'orateur
latin a pris ces belles peintures de la vie des
champs. Il n'y en a pas trace dans l'ouvrage spécial que
Caton a composé sur les travaux de la campagne, De re
rustica. On y chercherait vainement un jardin, des fleurs,
le sentiment de la nature, l'admiration des merveilles
qu'elle produit : ce n'est pas un philosophe, un orateur,
un poëte, qui a écrit ce livre ; c'est un propriétaire,
et quel propriétaire ! Jamais la terre, cette généreuse
nourrice des humains, n'en a porté de plus impitoyable ; jamais ses entrailles n'ont été déchirées par des mains
plus rudes, avec un coeur plus indifférent.
Et d'abord ne demandons pas à l'ouvrage ordre, composition,
méthode ; c'est une série de préceptes et d'observations,
fruit de l'expérience, consignés au hasard,
suivant le travail du jour apparemment. Mais, tel qu'il
est, il y a peu de livres plus importants pour nous. Le
maintien de l'ancienne agriculture était intimement uni
au maintien même des moeurs et de la constitution : ce
sont les petits propriétaires, cette race opiniâtre représentée
par les Dentatus, les Cincinnatus, qui ont créé la
légion et donné une base solide à la conquête. Laboureur
et soldat, voilà le vrai Romain; l'agriculture, voilà la pépinière
des armées : Pyrrhus l'avait compris, et que les
légions recrutées ainsi étaient inépuisables et invincibles;
lesGracques le comprirent bien aussi : la race des ingénus
disparaissait, ils voulurent la refaire en refaisant la petite
propriété rurale. Horace lui-même le sentait peut-être,
quand il rappelait dans ses vers de commande, les Romains
de son temps à la vie des Dentatus et des Fabricius.
Virgile le sentait mieux encore ; et il enchâssait dans son
vers harmonieux et plein d'images la plupart des préceptes
du vieux Caton.
Or le livre de Caton est écrit au moment même où le
danger de la concentration de grands domaines en un
petit nombre de propriétaires, apparaît: Latifundia perdidere
Italiam, ce sont les grands domaines qui ont
perdu l'Italie, dit Pline. Les grands domaines, c'est-à-dire,
le remplacement des travailleurs libres par des esclaves, les bois et les prés substitués aux champs à céréales;
l'Italie ne produisant plus de quoi nourrir ses habitants. On entrevoit déjà le jour où seront inaugurées
les distributions de blé, c'est-à-dire l'encouragement
à la désertion des champs, l'appel à Rome d'une
foule oisive, démoralisée, vile, qu'il faudra nourrir et
amuser. Caton lui-même, après avoir été un Fabricius
et un Dentatus, devint dans les dernières années de sa vie
un grand propriétaire. Il préféra les bois et les prés aux
terres arables, disant avec raison, que les bois et les prés
ne demandent à l'homme aucun travail et que Jupiter se
charge de les mener à bien. Il n'en était pas encore là
quand il écrivit son Manuel d'agriculture pratique.
Quel est le but de tout homme sage? gagner, acquérir,
rem quaerere. Il y a bien des moyens, le commerce
d'abord; mais le commerce est chanceux. Il y a l'usure,
excellent moyen, mais puni par les lois. Il y a enfin l'agriculture,
moyen plus lent, mais honnête. L'agriculture
forme des hommes vigoureux, sains, des soldats excellents
; elle est estimée et considérée de tous.
Dans quelles conditions faut-il acheter un domaine ?
Avec circonspection, après mûr examen. Voir si les
voisins sont à leur aise, bon augure pour le sol. Si ceux
qui ont vendu, le regrettent.
Ce domaine acheté, les terres bien labourées et fumées,
le propriétaire ne s'endort pas. Voyons-le dans
l'exercice de ses fonctions de surveillant : vous reconnaîtrez
ici cet oeil du maître que rien ne vaut.
« Le père de famille arrive à son domaine. Il salue
les Lares domestiques, et fait le jour même le tour de sa
propriété. Il voit comment elle est tenue, ce qu'il y a
d'ouvrage fait, ce qu'il reste à faire. Le lendemain qu'il appelle le fermier. Qu'il lui demande ce qu'il y a d'ouvrage
fait, ce qu'il reste à faire. Qu'y a-t-il en vin, en
froment, en autres choses? Le compte du travail fait,
il faut faire celui des jours. S'il n'y a pas eu assez d'ouvrage
fait, le fermier assure qu'il n'a pas épargné sa
peine, mais que les esclaves ont été malades, que le
temps a été mauvais; que des esclaves ont pris la fuite,
qu'il a fallu exécuter des travaux publics. Après qu'il a
donné toutes ces excuses, ramène-le au compte des jours
et des travaux. S'il a plu, pendant combien de temps ?
Du reste il y a des ouvrages qu'on fait pendant la pluie.
On lave les tonneaux, on les goudronne, on nettoie la
maison, on transporte le blé, on met dehors le fumier,
on lui creuse une fosse, on vanne les graines à semence,
on raccommode les vieilles cordes ; les esclaves raccommodent
leurs habits. S'il y a eu des jours de fête, il fallait
les employer à curer des fossés, réparer les chemins,
élaguer les haies, piocher le jardin, sarcler le pré,
moudre la farine. Si les esclaves ont été malades, ils
n'ont pas dû manger autant. » Ce dernier trait est admirable.
Les fonctions du fermier, avec un tel maître, ne sont
pas une sinécure. Le malheureux vit dans la peur des
coups : il ne doit pas aimer la promenade, ne dîner jamais
dehors, ne pas avoir de parasite (ô ironie !), ne pas
se croire plus habile que son maître, ne prêter jamais
rien. (Caton lui permet d'emprunter aux voisins.) Qu'il
vive toujours en société des esclaves, travaille comme eux, les surveille de près. Le bon travail fait le bon sommeil.
Qu'il soit couché le dernier, levé le premier. Quant à la fermière, les recommandations sont les
mêmes. Elle ne doit pas non plus se promener ni dîner
dehors.
Les esclaves doivent travailler ou dormir, sinon des
coups. Le maître a soin de les tenir en haine les uns
contre les autres; ils se dénoncent réciproquement, il les
tient dans sa main. Pour vêtement, ils auront tous les
deux ans une tunique de trois pieds de long et des saies.
On les nourrira avec les olives tombées, ou les olives
mûres dont on ne pourrait faire de l'huile, un peu de
vin, pris sur celui qui doit être plus tard du vinaigre.
Quand l'esclave devient vieux ou infirme, on le vend. Il
faut voir les nobles et touchantes protestations de Plutarque
contre cette barbarie et cette ingratitude.
Dans le domaine de Caton les animaux, les boeufs surtout,
sont plus heureux que les hommes. On les soigne dans
leurs maladies. Le maître a quelques prétentions en médecine.
Un boeuf est indisposé, qu'on lui donne un oeuf
de poule cru. Mais que le boeuf et celui qui le lui donne
soient tous deux à jeun !
La religion a aussi sa place dans ce recueil de préceptes.
Le sacrifice du porc, les prières aux dieux avant
d'élaguer les bois, de creuser les fossés, les lustrations
des champs, les invocations à Mars pour écarter les maladies,
la truie immolée à Cérès, à Janus, à Jupiter, la
prière sacramentelle ponr rendre la santé aux boeufs,
les incantations magiques; toutes les recettes d'une religion
grossière, superstitieuse, mais purement nationale ;
les croyances les plus bizarres, les procédés les plus absurdes,
mais consacrés par la tradition : voilà ce que l'on rencontre à chaque page dans cette encyclopédie d'un
propriétaire du sixième siècle. Jamais oeuvre ne porta
plus vive empreinte du temps et du milieu où elle a
paru. On comprend, en lisant Caton, l'ardeur avec laquelle
ses contemporains se portèrent vers l'hellénisme.
Que l'on compare l'Économique de Xénophon au De re
rustica. Rien ne fera mieux comprendre l'opposition
radicale du génie grec et du génie romain : le premier
sachant concilier dans une heureuse harmonie l'utile et
l'agiéable, doux, humain, aimant la terre non seulement
pour les biens qu'elle produit, mais pour la beauté qui
est en elle, associant à ses travaux une jeune femme, des
esclaves traités avec bonté, soignés dans leurs maladies
par la maitresse de la maison ; le second exploitant avec
opiniâtreté le sol, les animaux, le fermier, l'esclave,
ennemi de toute superfluité gracieuse, n'ayant qu'un but,
augmenter son revenu.
Si l'on en croit Cicéron, Caton, dans la dernière partie
de sa vie, fut un admirateur sincère et un disciple studieux
des Grecs. Plutarque en dit autant. Mais il importe
de bien déterminer la valeur de ces témoignages.
Il est certain que Caton connaissait la littérature
grecque : ses jugements sur Socrate, sur Isocrate, Thucydide
et Démosthènes ne laissent aucun doute à ce sujet.
Ne faisons donc pas de lui un ennemi quand même de
tout ce qui venait de la Grèce; mais ne nous le représentons
pas non plus comme un vieux pécheur endurci que
la grâce vient toucher vers la fin de sa vie et qui adore
ce qu'il a brûlé. Caton ne méprisait pas toutes les
oeuvres de la littérature grecque ; il ne comprenait pas,
n'aimait pas la poésie, la philosophie spéculative et la
pure rhétorique. Quel dédain il a pour Isocrate, cet homme qui enseigna à parler pendant quatre-vingts ans,
et ne sut jamais parler lui-même ! Il redoulait pour sa
patrie un Socrate, qui après tout est un révolutionnaire.
Mais il estimait fort Thucydide et Démosthènes,
génies essentiellement pratiques et positifs. Les
poëtes ne le touchaient point : il y a des esprits ainsi
faits dans tous les temps, dans tous les pays. La poésie
lui semblait chose vaine, exercice frivole et dangereux.
A quoi servent un poëme épique, une tragédie, une
ode? De plus les représentants de la poésie à Rome
étaient ou des étrangers de basse extraction, ou des affranchis,
ou des esclaves, flatteurs pour la plupart,
parasites, vivant d'une industrie précaire et méprisée.
Longtemps encore la société romaine conservera les
préjugés du vieux Caton. Il ne faut pas que la faveur
dont jouirent Horace et Virgile nous fasse illusion. Leurs
chaînes étaient dorées, mais c'étaient des chaînes. Il
fallait célébrer le prince et les amis du prince et sa famille
et les grands. Plus tard ce fut bien pis encore :
qu'on lise les doléances et les adulations d'un Stace, d'un Martial et de tant d'autres. Caton juge les premiers
poëtes et la poésie elle-même un peu plus durement que
l'âge suivant ; mais sur ce point les Romains de tous les
temps descendent plus ou moins directement de Caton.
C'était un homme fait pour la prose. Dans la prose
seule pouvaient se développer à l'aise les qualités solides
mais sans éclat du caractère national. Caton l'avait
compris ; mais comme tous les réactionnaires ardents,
il exagéra son principe et prétendit vainement restreindre
l'horizon. La société polie de son temps se précipitait
avec enthousiasme vers les brillantes et gracieuses peintures
de la poésie grecque : Caton voulut opposer à cet engouement excessif un obstacle qui est toujours renversé, la raison froide, le bon sens pratique. C'étail justement
contre cette sécheresse que se faisait la révolution.
Il marcha dans la voie, seul, intrépide, d'autant
plus obstiné que le goût public se tournait de l'autre
côté. Tous les écrits qu 'il publia, sont en prose; tous ont
le même caractère, ce sont des livres d'utilité pratique,
des manuels à l'usage du citoyen romain. J'ai parlé
du De l'erustica, il y ajouta divers traités sur la guerre,
(De disciplina ou De re militari), sur la jurisprudence,
sur l éducation des enfants. (Praecepta ad filium ou De
pueris educandis), un recueil de préceptes. et d'apophthegmes,
des lettres, toute une encyclopédie des connaissances utiles. Par là il se flattait sans doute de créer
une littérature nationale en opposition à cette littérature
artificielle, toute d'imitation, qui régnait alors. Tentative
qui ne manque pas de grandeur : où est en effet
la véritable originalité de l'esprit romain, si ce n'est
dans l'éloquence, la jurisprudence, la morale? c'est-à-dire,
en fin de compte, dans la prose?
LIVRE DEUXIÈME
LE SEPTIÈME SIÈCLE.
Tableau de la société romaine au septième siècle. Religion, philosophie, éducation, moeurs.
Les grands événements qui s'accomplissent dans la
première moitié du septième siècle, soit à l'extérieur,
soit à Rome même, n'ont laissé qu'une faible empreinte
sur la littérature. J'ai dit qu'elle était envisagée par les
Romains comme une occupation oiseuse, un amusement
de désoeuvrés, ou un métier peu considéré. Il y eut, il
est vrai, à la fin de la période précédente, une réaction
contre le préjugé national, Tércnce en est la preuve ;
mais pendant plus de cinquante ans encore, les citoyens
mêlés au gouvernement de la chose publique et aux orages
des partis, abandonnèrent aux oisifs ou aux indifférents
la gloire d'auteur.
Les grands noms de cette époque, Scipion Émilien, les
Gracques, Marius, Sylla, n'ont rien ou presque rien écrit.
Ceux qui occupent le second rang, comme les Mucius
Scévola, les Tubéron, sont des jurisconsultes. Tous
cependant cultivèrent l'éloquence et furent de grands
orateurs. Que ne donnerait-on pas pour posséder les discours
des Gracques et ceux de leurs adversaires ? La vie publique, si orageuse à cette époque, absorbait toute l'activité
de ces hommes. Le loisir (otium) n'existait pas pour
eux ; si orné que fût leur esprit, on voit bien qu'ils ne
cultivaient pas les lettres pour elles-mêmes : tout ce
qu'ils apprenaient, tout ce qu'ils savaient était d'avance
consacré au service de la chose publique. Le littérateur
proprement dit n'existait pas encore. C'est avec Lucrèce,
Catulle et jusqu'à un certain point Salluste, qu'il commence.
Cicéron domine et remplit la seconde moitié de ce
siècle ; c'est à la fois un homme d'action et un écrivain
: il revendique hautement cette double gloire, et il
ne se dissimule pas qu'il y a un certain courage à le
faire. Le vieux préjugé romain n'était pas encore anéanti
et plus d'une fois Cicéron entendit murmurer à son
oreille l'épithète méprisante de Graeculus.
Il y eut cependant des poëtes et des prosateurs avant
Cicéron et avant Lucrèce. De leurs oeuvres il ne nous
reste que des fragments plus ou moins importants.
Voyons dans quel milieu se produisirent ces oeuvres dont
nous essayerons de reconstituer le véritable caractère.
Après la ruine de Carthage, de Corinthe et de Numance,
la domination de Rome sur le monde est accomplie.
Un des résultats les plus considérables de la
conquête, c'est la fusion universelle qu'elle amène. L'Italie,
la Grèce, et l'Orient entrent en communications
étroites et journalières. En même temps que l'esprit italien
se répand dans le monde par les colonies, les prétures,
les proconsulats, la grande cité reçoit dans son
sein les représentants de tous les pays, de toutes les civilisations.
L'esclavage, qui prend alors un développement inouï , introduit à Rome, dans l'Italie, dans la Sicile,
une immense population, composée d'éléments étrangers,
qui, se mêlant aux classes inférieures de la société
et agissant même sur ses maîtres, exerce une prodigieuse
influence sur les moeurs, les idées, les usages des vainqueurs.
(1) Le recensement de l'année 661 constata que le nombre des esclaves était plus du double de celui des hommes libres.
L'élégance, la grâce, l'esprit, étaient le privilége
de ces Grecs d'Asie, si fins, si habiles à tout, corrompus
et corrupteurs. Il se fait un échange incessant
entre les peuples : l'hellénisme, plus délicat et plus raffiné,
pénètre plus rapidement à Rome, d'abord dans les
hautes classes de la société, jalouses de se distinguer du
peuple par des manières et un ton plus relevés, puis dans
les classes inférieures. Le pontife Publius Crassus dans
sa préture d'Asie, rend ses arrêts en grec, et dans les
divers dialectes de l'idiome grec. Presque tous les Romains
de haute naissance eussent pu en faire autant.
Mais ce qui est plus digne de remarque, c'est la transformation
que subissent à leur tour tous les Grecs qui restent
en communication un peu suivie avec les principaux
Romains de ce temps. Polybe et Panselius en sont un
exemple bien curieux. Clitomaque, le Carthaginois, qui
fut disciple et successeur de Carnéade, avait un commerce
épistolaire régulier avec les principaux personnages
politiques de ce temps ; il leur dédie ses ouvrages.
On sait avec quelle animosité le vieux Caton poursuivait
les Grecs ; de son temps en effet les Grecs de Rome n'étaient
guère ou que des ambassadeurs beaux parleurs,
ou des bannis, ou des charlatans qui exploitaient l'ignorance
et les vices grossiers des Romains : on les écoutait, on se servait d'eux, on les chassait de temps en temps,
on les méprisait toujours. Il n'en est plus ainsi. Panætius
et Polybe sont estimés, recherchés ; le poëte Archias
d'Antioche est patroné par Marius et défendu plus tard
par Cicéron comme vrai citoyen Romain. Si l'on rapproche
de ces faits les grands événements de cette époque,
les réformes des Gracques, les guerres serviles, la
guerre sociale ; si surtout l'on se souvient que la classe
moyenne, la bourgeoisie, c'est-à-dire l'élément romain
par excellence, disparaissait, que les affranchis, les Italiens
et bientôt après les Gaulois, les Espagnols, tous les
peuples allaient être appelés à remplir les vides occasionnés
par les guerres, l'abandon de l'agriculture, la
ruine de la petite propriété, l'usure et la spoliation, on
reconnaît que le vieil esprit romain, exclusif et étroit,
est entamé, que les peuples, en se rapprochant, en se
pratiquant, voient s'effacer peu à peu les traits les plus
accentués du caractère national, et qu'une sorte de cosmopolitisme
se prépare. Les productions littéraires les
plus essentiellement romaines de celle époque portent
déjà l'empreinte de la révolution qui se fait.
La révolution se manifesta d'abord, ainsi que cela
arrive d'ordinaire, dans les choses de la religion. J'ai
montré comment dans la période précédente Ennius et
les traducteurs des modèles grecs avaient habitué peu à
peu les esprits à une sorte de réflexion et de scepticisme ;
mais, à vrai dire, l'evhémérisme ne porta pas une atteinte
bien sérieuse à des dieux qui n'avaient pas d'histoire.
L'importation des cultes étrangers venus d'Orient eut
une influence bien plus grave. Introduits à Rome dès le
siècle précédent, ils s'y développèrent avec une rare
énergie. En vain le sénat porta la hache sur les temples d'Isis et de Sérapis ; il fallut les relever. En vain les
mystères des Bacchanales furent interdits et punis ; ils
persistèrent. Ce qui attira le plus vivement les Romains
vers les religions orientales, ce fut cette soif de connaître
l'avenir qui est une des maladies les plus incurables de
l'esprit humain. Devins, astrologues, charlatans de la
Chaldée, mathématiciens, diseurs de bonne aventure,
tout un monde étrange, mystérieux, repoussant s'agitait
dans les bas-fonds de la ville. Les croyances superstitieuses
que ces étrangers entretenaient parmi la masse
du peuple, et dont ils vivaient, étaient partagées par les
personnages les plus considérables de la république. Une
prophétesse syrienne, nommée Martha, osa bien proposer
au sénat de lui révéler les moyens de vaincre les Cimbres.
Le sénat refusa de l'entendre et la fit chasser, mais
Marius la recueillit dans sa maison, et la mena avec lui
à l'armée. On sait combien les sortilèges, les sorcelleries
et enchantements de tout genre jouèrent un rôle considérable
dans les guerres serviles avec Eunus et Spartacus,
et en Espagne avec Sertorius. Il est bien certain que
l'incrédulité religieuse favorisa les développements inouïs
que prit la superstition à cette époque. Les Orientaux
ont toujours excellé dans l'art des prestiges ; l'Orient est
la patrie du merveilleux : là, point d'incrédules, car il
n'y a point de réflexion ; l'âme est toute tendue de désir
vers les choses surnaturelles. La plupart des astrologues,
devins, enchanteurs venus de l'Orient, exerçaient de
bonne foi une industrie lucrative, et en se faisant payer,
se faisaient croire et croyaient eux-mêmes. J'ai parlé
de Marius ; Sylla le surpassait encore en superstition ; le
sénat lui-même avait plus d'une fois recours à l'art des
devins. Le monde du surnaturel a reçu droit de cité à Rome ; les sombres et bizarres pratiques de la divination
étrusque pâlissent et s'effacent devant les imposantes révélations des sorciers d'Orient.
Par une inconséquence qui ne doit pas nous étonner,
la même époque qui vit ce débordement de superstitions
étrangères, vit aussi l'institution définitive de la religion
d'Etat. Montesquieu et les philosophes du dix-huit°
siècle pensaient que toute religion est une sage invention
des politiques pour contenir le peuple et le diriger;
opinion excessive, en ce qu'elle n'admet pas la sincérité
primitive du sentiment religieux. Les religions deviennent
un moyen de gouvernement; mais telles elles ne sont
point à leur naissance. Il y a bien des dupes en ce monde ;
il y en avait davantage autrefois. C'est vers la fin du
sixième siècle et pendant le septième que la religion romaine
se transforme en institution purement politique.
On comprend de quelle importance il était pour le sénat
de rompre les comices, de dissoudre les assemblées du
peuple, quand il prévoyait qu'une loi funeste à l'État
allait être votée, que des hommes dangereux ou incapables
allaient être nommés aux plus hautes fonctions de
la république. Les auspices qu'il avait en son pouvoir
devenaient, suivant les circonstances, favorables ou défavorables.
Dès la fin du sixième siècle, Fabius le Cunctateur,
qui était augure, disait : Ce qui est utile à la
république se fait toujours sous de bons auspices, ce qui
lui est nuisible, sous de mauvais, ou plutôt contre les
auspicesl. De là l'importance considérable de ces fonctions d'augure. Avec quel naïf orgueil Cicéron se pare de ce
titre ! Être augure, c'était être initié aux secrets de l'État.
On sait comment, dans les orages des guerres civiles,
les deux partis tiraient à eux les choses et les ministres
de la religion, afin de donner à leurs actes, à défaut de
la légalité, la sanction divine. Les nombreuses confidences
de Cicéron, tout son traité de Divinatione ne
laissent aucun doute à ce sujet. Enfin Scévola et, après
lui Varron, réduisirent en une formule l'opinion de tous
les esprits éclairés sur la religion : « Il y a trois sortes
de théologie, l'une mythique, c'est l'oeuvre des poëtes ;
l'autre naturelle, c'est l'oeuvre des philosophes; la troisième,
politique, c'est l'oeuvre de l'État.» Ne nous
étonnons donc pas de ne trouver dans les poëtes qui suivront,
j'entends les plus grands, Horace et Virgile, que
des images languissantes de la Divinité. Il n'y a chez eux
ni cet enthousiasme de la beauté, de la grandeur, de la
force, qui a fait éclore le monde divin homérique, ni la
foi naïve qui échauffa l'âme ; tout l'effort de leur génie
ne réussira qu'à nous présenter de pâles copies des dieux
de la Grèce. Les dieux romains n'ont à vrai dire jamais
eu une personnalité poétique.
Cette ruine de la religion nationale a bien des causes :
une des plus efficaces, ce fut l'introduction de la philosophie
à Rome. Je ne crois pas qu'il faille attacher une
importance bien grande à l'ambassade des trois philosophes
grecs, Diogène le Stoïcien, Critolaus le Péripatéticien,
et Carnéade l'Académicien, qui vinrent demander
au sénat la remise d'une amende de cinq cents talents à
laquelle avait été condamnée Athènes (599). Je ne sais
non plus s'il faut croire la fameuse histoire des deux discours
prononcés par Carnéade, l'un pour la justice, l'autre contre la justice. Lactance est le seul auteur qui
rapporte ce fait. Carnéade avait à ce qu'il semble trop
d'esprit, pour se hasarder à de telles pasquinades devant
un tel auditoire. Est-il vraisemblable qu'il eût employé
en présence de ces Romains si fiers, si scrupuleux,
ce raisonnement bizarre en faveur de l'injustice. « C'est
par l'injustice que vous avez conquis la plus grande partie
du monde : donc l'injustice est bonne. » L'an 599,
les Romains instruits, et ils étaient nombreux, n'avaient
pas besoin d'entendre trois ambassadeurs grecs pour
avoir une idée de la philosophie. Ils avaient des livres
grecs ; ils avaient Polybe et ses compagnons de captivité.
La plèbe n'avait peut-être jamais vu de philosophes, elle
en vit et en entendit pour la première fois : voilà à quoi
se borna l'influence immédiate des ambassadeurs.
Quoi qu'il en soit, lorsque la philosophie grecque pénétra
chez les Romains, elle était depuis longtemps déjà en
décadence. Non seulement depuis cent cinquante ans
aucun grand système n'avait apparu, mais les chefs des
anciennes écoles n'avaient pas même conservé l'intelligence
exacte et complète des doctrines qu'ils étaient
censés représenter. Les héritiers de Platon et d'Aristote
étaient écrasés par ces grands noms et incapables d'exposer
dans leur ensemble des systèmes dont ils ne pouvaient
embrasser toutes les parties. Cette faiblesse même,
loin de nuire à la philosophie grecque auprès des Romains,
lui servit de recommandation. Les spéculations
métaphysiques les eussent rebutés : la science, pour leur
plaire, devait être simple, accessible à tous, et surtout
avoir une tendance pratique. Aussi trois écoles seulement,
en dehors de l'évhémérisme, firent-elles fortune
à Rome, celle d'Épicure, celle de Zénon, celle d'Arcésilas et de Carnéade. Cette dernière n'était autre chose,
comme on sait, qu'un scepticisme de sens commun,
merveilleusement fait pour des hommes à demi cultivés
qui aiment à exercer leur esprit, sans trop en tendre
les ressorts, et se contentent de demi-vérités. L'épicurisme,
plus scientifique, plus fortement lié dans les diverses
parties qui le constituent, ruinait par sa base la
religion. Les dieux d'Épicure relégués dans les intermondes,
n'ayant point créé ni arrangé l'univers, ne s'occupant
en rien ni de sa conservation, ni du mouvement
des choses humaines, n'existent pas. Le sage, l'homme
habile et prudent qui cherche ici-bas le souverain bien,
c'est-à-dire le bonheur, imitera, autant qu'il sera en lui,
la Divinité. Il ne se mêlera point aux orages des affaires
publiques, où les meilleurs sont souvent victimes des
pires; il ne se mariera point, car le ménage, les enfants
sont des sources de tribulations incessantes ; il vivra pour
lui-même, vertueux, je le veux bien, à la condition de réduire la vertu aux sages calculs d'un égoïsme raffiné.
Pendant la première moitié du septième siècle, cette philosophie
si contraire au caractère essentiel du Romain,
ne fit que peu de prosélytes. Les grandes catastrophes
des guerres civiles, les proscriptions, les spoliations,
l'incertitude où l'on vivait, le droit de la force tendant à
prévaloir chaque jour davantage sur la légalité, la lassitude,
le dégoût, l'abaissement des âmes, suites ordinaires
des calamités publiques, propagèrent parmi les Romains
cette triste doctrine. Nous la retrouverons plus tard, non
plus à ses débuts, mais triomphante.
Le stoïcisme avait un tout autre caractère. D'abord il
ne détruisait pas la croyance aux dieux nationaux; au
contraire, il s'y adaptait assez exactement. Les dieux romains, j'ai déjà eu occasion de le montrer, étaient de
pures allégories, non des êtres vivants, ayant une histoire, une physionomie distincte. Or, le stoïcisme admet tous les dieux, avec leurs noms et leurs attributions distinctes. Il les considérait comme des modifications
de la substance universelle, ou, si l'on veut, comme des
émanations du dieu premier. « Ce dieu, dit Sénèque
a autant de noms, qu'il prodigue de bienfait. C'est
Bacchus, Hercule, Mercure. » Une telle doctrine ruinait dans sa base le polythéisme hellénique, dont l'anthropomorphisme est le principe, mais elle n'avait rien hostile à la religion abstraite des Romains. Ajoutons
que la morale du stoïcisme primitif, que cette tension
du ressort de l'activité humaine, celle rigidité inflexible
tout cela était fait pour plaire à des hommes qui ne comprenaient pas encore qu'on pût donner pour but à la vie
le repos, et pour nourriture à l'âme, l'indifférence.
Enfin les subtilités mêmes de la casuistique stoïcienne ne
déplaisaient pas à ces jurisconsultes émincnts. Les Tubéron,
les Scévola, appelés chaque jour à débattre les plus
délicates questions du droit.
Mais ce qui contribua puissamment à accréditer la philosophie stoïcienne à Rome, ce fut le caractère même de son introducteur. Panaetius vécut longtemps à Rome et se concilia, par l'élévation de ses sentiments, la bienveillance et l'estime des personnages les plus considérables
de ce temps. Scipion l'Africain l'avait recueilli dans
sa maison, et l'emmenait avec lui dans ses expéditions
guerrières. Panaetius est le prince des stoïciens, dit Cicéron
: tel il n'eût point paru aux yeux des Grecs le milieu dans lequel il vécut le transforma; il devint à
demi Romain. Les Grecs sont toujours enclins à accorder davantage à la philosophie contemplative. Panaetius
se sépara sur ce point de ses compatriotes : de là la
faveur dont il jouit parmi les Romains, peu faits pour
la spéculation pure, et toujours tendus vers l'action.
Cicéron le loue fort d'avoir peu goûté les subtilités épineuses
de la dialectique (spinae disserendi) et l'inflexible
rigidité des opinions (acerbitas sententiarum) ; par là
encore, il est Romain. Il alla même jusqu'à ne pas accepter
le fameux aphorisme : « La douleur n'est pas
un mal. » Il s'abstint du moins de le développer dans
la consolation qu'il adressa à Tubéron. C'est le grand
instructeur des Romains de ce temps. Pour eux il écrit
une histoire critique des principaux systèmes philosophiques. Enfin il condense la substance d'un
stoïcisme pratique, c'est-à-dire tout romain, dans son
traité du Devoir que traduisit plus tard
Cicéron. Ainsi s'opérait cette fusion d'idées et d'opinions
qui est un des traits les plus remarquables de
cette époque. On a généralement pris trop au pied de la
lettre le vers d'Horace : Graecia capta ferum victorem cepit. Les deux peuples exercèrent l'un sur l'autre une
influence salutaire : les Grecs se relâchèrent quelque
peu de leur exclusivisme littéraire et philosophique; les
Romains renoncèrent à leurs sots préjugés contre les
lettres, les sciences et les arts ; mais ils ne voulurent
point y voir un simple amusement de l'esprit : l'idée
toujours présente de la patrie et des devoirs qu'elle impose,
ce besoin invincible de rapporter toutes choses à
une fin déterminée, modifièrent singulièrement le fond
même des oeuvres grecques. C'est justement dans cette
transformation que réside l'originalité du génie romain.
On ne peut nier, je crois, que Panaetius n'ait subi l'influence de ces idées si étrangères à la Grèce d'alors.
On en peut dire autant de Polybe, qui n'est ni un conteur ni un philosophe, mais un pragmatique, comme on disait alors, un esprit positif, comme nous dirions aujourd'hui. Jusqu'où alla cette influence de l'esprit romain sur l'esprit grec, il est difficile de le déterminer,
mais elle existe. Les Grecs éprouvèrent une véritable
admiration pour l'édifice imposant de la grandeur romaine
; plusieurs d'entre eux s'attachèrent étroitement
aux personnages les plus considérables de cette époque et cet attachement allait jusqu'au ; fanatisme. Tel fut Blossius
de Cume, philosophe stoïcien, ami et conseiller de
Tibérius Gracchus. Interrogé par les consuls, après la
mort de son ami, il répondit « qu'il avait exécuté tout
ce que Tibérius lui avait commandé. » «Eh quoi ! dit
Scipion Nasica, s 'il t'avait commandé de mettre le feu
au Capitole ? » « Je l'eusse fait, » répondit-il.
La même fusion s'opère dans l'instruction de la jeunesse.
Nous ne sommes plus au temps où le sénat, sur la proposition de Caton, expulse les philosophes et les
rhéteur s étrangers, coupables d'enseigner des choses nouvelles, contraires à la coutume et aux usages des ancêtres. On ne peut bannir par un décret
public les hommes qu'on admet dans son intimité. La
vieille encyclopédie de Caton, cet arsenal de toute la
science jugée nécessaire à un Romain, ne suffit plus à la
génération nouvelle; elle n'a que du dédain pour ces manuels grossiers. Le cercle des connaissances indispensables
à tout honnête homme s'est singulièrement étendu : des maîtres romains commencent l'éducation
du jeune citoyen : le litterator lui apprend à lire, à
écrire, à compter; le grammairien lui enseigne les principes
de la langue nationale ; il étudie le droit à l'école
des jurisconsultes les plus éminents, et en assistant lui-même
aux consultations des parties, aux procès, aux
plaidoiries; en même temps il se forme à la connaissance
des affaires publiques, de l'art militaire, de l'administration
: voilà l'enseignement purement national. Combien
il est différent de cette partie de l'éducation que les
Grecs appelaient Mouoixii, et qui comprenait l'étude de
tous les arts, y compris la danse, le chant et la musique.
Saltare in vitiis ponitur, dit Cornélius Népos. Le Romain
ne consentit jamais à s'abaisser jusqu'à cultiver
des arts exercés par des baladins et des jongleurs. Un
Néron seul put concevoir une si étrange fantaisie. Quant
à la gymnastique, elle durait toute la vie. Marius, âgé de
plus de soixante ans, s'exerçait encore à la course, au
saut, au jet du disque en plein champ de Mars. Mais ces
exercices avaient pour but de maintenir le corps sain
et dispos, non de donner de la grâce à la personne. On
y formait de vigoureux soldats, on eût rougi de songer à
la gloire des athlètes. L'éducation nationale est complétée
par l'éducation à la grecque. Le grammairien enseigne
à ses élèves les deux langues à la fois : vers la tin du
sixième siècle, l'étranger Cratès de Malles fait un cours
public de critique littéraire sur l'Iliade et l'Odyssée.
Son exemple enhardit les Romains; on essaye de commenter
devant un auditoire les anciens poëtes de Rome,
Naevius et Ennius, plus tard Lucilius. L'érudition commence
; son premier représentant sera Elius Lanuvinus
Stilo, prédécesseur du docte Varron. Mais combien cet enseignement timide, hésitant, sans base assurée,
pâlit auprès de celui des rhéteurs, des grammairiens, des
philosophes de la Grèce ! La bibliothèque apportée par
Paul Émile livre aux Romains avides tous les trésors de
la science, de l'esprit, de l'éloquence des Grecs. Des
maîtres, comme Panaetius, des amis comme Polybe, sont
là pour diriger et faciliter les lectures de ces jeunes gens
si curieux de s'instruire. La langue grecque leur devient
aussi familière que l'idiome national ; ils se plaisent
à écrire en grec, ils déclament en grec ; ils sèment de
mots grecs et leur prose et leurs vers. Auprès des enfants
de Paul Emile « on voit non-seulement des maîtres
de grammaire, de rhétorique et de dialectique,
mais
aussi des peintres, des imagiers, des piqueurs et dompteurs
de chevaux et des veneurs grecs. » Le vieux Paul
Émile lui-même assiste aux leçons de ses fils. Dans son
voyage à travers la Grèce, il avait admiré en connaisseur
les chefs-d'oeuvre qu'il avait sous les yeux, et déclaré
que le Jupiter Olympien de Phidias était réellement le
Zeus homérique. Mais ne nous imaginons pas trouver à
Rome de fins appréciateurs des oeuvres du pinceau ou du
ciseau des grands artistes grecs. Il ne faut pas sur ce point juger les Romains d'après leurs paroles, ni même
d'après leurs actes ; à les entendre, ils n'avaient que du
mépris pour ces fragiles merveilles qui avaient demandé
tant de travail et de génie. Cicéron lui-même n'affecte-t-il
pas plus d'ignorance sur ce sujet qu'il n'en avait réellement?
Ne soyons pas dupes de ces petites hypocrisies.
Les Romains aimaient les beaux tableaux, les belles statues,
les bronzes précieux ; mais ils étaient incapables de
les bien goûter. Ils en faisaient la décoration des temples,
des basiliques, des villas; c'étaient des meubles comme d'autres, qui ornaient agréablement. Ils n'aimaient point
les statues d'une nudité parfaite ; ils faisaient adapter aux
membres éclatants d'un Apollon une cuirasse ou une saie.
Il n'y avait pour eux rien de plus beau qu'un guerrier.
Le mot naïf de Mummius les peint tout entiers. Il menace
les ouvriers chargés de transporter les splendides oeuvres
d'art de Corinthe à Rome, de les faire réparer à leurs frais,
s'ils ont la maladresse d'en briser quelqu'une. N'est-ce
pas lui qui ordonnait aux musiciens grecs de jouer tous à
la fois et chacun un air différent? Cent ans plus tard Agrippa
propose de vendre tous les tableaux, toutes les statues qui
ornent la ville; proposition digne du plus grand des
citoyens, dit niaisement Pline. Ainsi, à l'époque où nous
sommes parvenus, l'esprit grec et l'esprit romain, mis en
présence depuis près d'un siècle, se pénètrent l'un l'autre.
Les Grecs sont les instructeurs ; mais l'élève n'apprendra
que ce qu'il veut, et comme il veut. Il fait au
superflu sa part ; mais il n'entend pas lui sacrifier le sérieux
et l'utile. Il n'y fut guère de plus grand et de meilleur
citoyen que ce Scipion Émilien, élevé trop curieusement
à la grecque, dit Plutarque : il sut concilier le loisir et les
affaires (otium, negotium), cultiver et charmer son esprit
sans l'amollir, se faire grec, sans cesser de demeurer romain.
C'est par là sans doute qu'il resta aux yeux de Cicéron
comme le type achevé sur lequel chacun devait
essayer de se régler. N'est-ce pas, en effet, comprendre
excellemment la vie que de ne sacrifier ni le positif à l'idéal,
ni l'idéal au positil? Voilà ce qui frappait d'admiration
des Grecs de ce temps-là. N'ayant plus de patrie et se consolant
aisément de n'être plus citoyens en restant artistes,
ils éprouvaient un respect involontaire à la vue de ces
hommes qui avaient cessé d'être des barbares, sans cesser d'être Romains, qui recherchaient et aimaient les
choses de l'esprit sans s'y absorber exclusivement, et qui
savaient concilier les douceurs du loisir et les sérieux devoirs de
la vie publique. Caton leur avait déjà présenté cette
image de l'homme complet. Un jour qu'il leur fit «une soudaine
et briève haranguer, ils s'écrièrent, : «Que le parler
ne sortait aux Grecs que des lèvres,et aux Romains du coeur.»
Il n'est pas de mon sujet de présenter ici un tableau
complet d'es moeurs de la première moitié du septième siècle;
je me borne à une esquisse générale et fort rapide. Les Romains ont effrayé le monde du spectacle de leurs vices
grandioses. Au moment où le christianisme parut, Rome
était devenue l'immense foyer où s'était concentrée la
corruption de tout le monde antique. L'Italie, la Grece,
l'Orient, apportaient chaque jour leur contingent de turpitudes
au centre universel. La corruption y était profonde,
intense, infiniment variée, se renouvelant et s'étendant
sans cesse avec ce mouvement incessant qui faisait affluer
au coeur de l'empire les religions, les usages, les moeurs,
la langue, les dissolutions et les misères du monde entier.
Au commencement du septième siècle., cette centralisation
commence. Plus de peuples à subjuguer, si ce n'est
les Gaulois à l'Occident, les Parthes à l'Orient. La race
des ingénus est détruite aux trois quarts. Ce sont les étrangers
et les affranchis qui vont recruter les légions romaines.
Une immense population, pauvre, affamée, se précipite
sur Rome pour y vivre des distributions de blé, pour y
exercer une foule d'industries équivoques qui accélèrent
les progrès de la corruption. La vieille noblesse romaine,
jalouse conservatrice des droits et des traditions de la cité,
voit s'élever à ses côtés, et la menacer dans son influence,
une aristocratie toute nouvelle,
l'aristocratie d 'argent, les chevaliers. Ce sont les chevaliers qui exploitent le monde
conquis, ils représentent l'État dans ses contrats avec les
provinces et les peuples alliés ; ils perçoivent les impôts,
les tributs, les redevances. La ruine des derniers petits
propriétaires de l'Italie est bientôt suivie de la spoliation
effrénée des peuples. Des réclamations s'élèvent. Les
provinces ont des patrons au sénat, parmi ces nobles de
vieille souche, qui sauront les défendre. Ils ne le peuvent.
Les chevaliers prévaricateurs sont les juges des procès en
prévarication. Ils s'acquittent eux-mêmes. Plus tard on
leur enlève les jugements ; ils achètent les juges. Un million
ou deux, qu'est-ce que cela pour des hommes qui
savent en tirer dix ou douze par an d'une seule province?
Voilà le principe et la source féconde de la corruption, mot
vague, et qu'il faut préciser. La conquête et l'exploitation
de la conquête : voilà ce qui ruina les vieilles moeurs. Il
était à peu près impossible qu'il en fût autrement. Les
Romains des premières années du septième siècle sont
des parvenus. Les voilà tout à coup riches, puissants,
environnés de flatteurs, exposés à toutes les tentations,
en état de satisfaire tous les caprices, d'épuiser les plaisirs
de toutes les civilisations, la grecque, l'asiatique,
l'orientale. Quoi d'étonnant qu'ils n'aient pu résister?
L'austérité des anciennes moeurs avait pour fondement
et pour gardienne la pauvreté : peut-on continuer à
vivre en Fabricius, lorsqu'on est plus riche qu'un roi?
Toutes les conséquences de cette grande révolution ne se
développèrent pas immédiatement; mais elles commencent
à se manifester. Dès l'année 60; L.Calpurnius Pison porte sa
fameuse loi contre les prévarications des gouverneurs de
province. C'est au nom de cette loi
que, quatre-vingts ans plus tard, Cicéron attaqua Verrès. L'insolence et la cruauté des magistrats romains s'étaient
exercées d'abord en Italie, dans les villes des alliés,
comme Préneste, Ferentum, Teanum. Ils faisaient saisir
et battre de verges les magistrats des cités, tantôt parce
qu ils étaient mécontents des vivres qui leur avaient été
apportés, tantôt parce qu'ils n'avaient pas trouvé les bains
publics assez propres. Ici, la femme d'un consul exige
qu'on lui livre les bains ; elle ne les trouve pas convenab, le questeur de Teanum est attaché à un poteau et battu de verges. Ailleurs, un jeune Romain porté dans
une litière est rencontré par un bouvier de Venusium.
« Est-ce que vous portez un mort?» dit le rustre. Les
porteurs détachent les bâtons de la litière et le frappent
jusqu'à ce qu'il expire. Un Q. Flamininus, pour faire
plaisir à un jeune garçon qu'il aimait, et qui n'avait jamais
vu mourir, fait trancher la tête à un Gaulois en
sa présence : voilà les moeurs publiques.
A l'intérieur, les antiques rapports de client à patron
sont tout à fait modifiés. Le patron exploite ses clients. La
loi Cincia défend de recevoir des présents mais le peuple est déjà devenu le tributaire des nobles (vectigalis et stipendiaria plebes esse coeperat). Il est vrai que les nobles à leur tour payent le peuple : ils lui achètent ses suffrages ; c'est la principale ressource de la plèbe. Les
innombrables lois sur la brigue (de ambitu) se succèdent,
et, toujours impuissantes, ne servent qu'à constater le mal
et ses progrès. Tel est l'esprit public à Rome. Si l'on interroge
la vie privée, on voit déjà éclos les germes de cette
effrayante corruption dont les Verrines, les Catilinaires et
quelques autres plaidoyers de Cicéron nous traceront de
si éloquentes peintures. La famille, c'est-à-dire, d'après la
constitution primitive de Rome, l'État lui-même formé de la réunion de ces associations légales d'où sortait l'ingénu,
le citoyen est attaqué dans sa base par le développement
menaçant du célibat. Les moeurs grecques et orientales,
les esclaves des deux sexes, charmants, corrompus,
dociles, suppriment la vie de famille. Un censeur invite
les citoyens à se marier, voici en quels termes : « Si nous
pouvions vivre sans épouse, Romains, nous nous affranchirions
tous de cet ennui : mais puisque la nature l'a
voulu, puisque, si l'on ne peut vivre agréablement avec
les femmes, sans elles on ne peut vivre du tout, pensons
plutôt au salut de l'État qu'à un plaisir de peu de
durée.» Ainsi contractées, les unions étaient bientôt
rompues. La répudiation et le divorce, à peu près inconnus
au siècle précédent (1), se multiplient et deviennent l'issue
ordinaire de presque tous les mariages.
(1) Le premier divorce est de 533.
La femme
que sa dot affranchit n'est réellement plus dans la main
de son mari, comme le voulait l'ancienne législation.
Émancipée, toujours sûre de trouver un autre époux,
tant qu'elle sera riche, elle s'abandonne à toutes les
fantaisies de ces unions passagères qui sont la ruine de
la famille. Cent ans plus tard, Auguste, par ses lois, par
l'attrait des honneurs et des récompenses publiques, par
les sermons en vers qu'il commande aux poëtes célibataires
en l'honneur du mariage et des anciennes moeurs, essayera
en vain de reconstituer la noble et féconde association
des époux. On ne se mariera plus, suivant la forte
expression de Plutarque, pour avoir des héritiers, mais
pour avoir des héritages. Cependant la pureté des anciennes
moeurs se conservait encore dans les villes du Latium,
dans la province, et parmi quelques grandes familles qui
avaient bien voulu emprunter à la Grèce sa civilisation et ses arts, mais non ses vices. Tels étaient Scipion et ses
amis, à Rome même ; et nous verrons bientôt naître hors
de Rome presque tous les hommes qui dans la politique,
la guerre, les lettres seront la gloire de leur temps.
Parlerai-je des progrès du luxe à cette époque ? Un
grand nombre de lois somptuaires essayent en vain d'en
arrêter les débordements ; la rigoureuse censure de Caton
avait été impuissante, les loi?qui interdisaient de consacrer
à un festin plus de telle ou telle somme, d'avoir plus
de tant de livres d'argenterie, sont violées et abrogées par
le mépris qu'on en fait chaque jour. Le luxe, chose utile,
nécessaire dans nos sociétés modernes où l'industrie et le
commerce ont une place si considérable, était un véritable
fléau, une source permanente de corruption chez un peuple
qui ne s'enrichissait que par la conquête, la spoliation,
les exactions de tout genre. Ces beaux meubles, ces beaux
esclaves qui coûtaient jusqu'à 400,000 sesterces, ces
bronzes, ces statues, on les payait avec l'argent extorqué
aux provinces. Les jeux splendides donnés au peuple pour
obtenir ses suffrages et par suite une préture, un proconsulat,
c'étaient les provinces qui en faisaient les frais. Ainsi
tout s'enchaîne. Les basses classes de la société sont dépravées
par l'oisiveté; il n'y a plus de petits propriétaires,
partant plus de travail : il faut nourrir cette multitude, la
fàire voter, l'amuser. De là les distributions de blé, les
jeux, les brigues. De là la nécessité de dépenses énormes
pour les hommes qui veulent jouer un rôle dans l'État.
C'est la conquête et l'administration des provinces qui
fourniront l'argent nécessaire.
Lucilius. Le théâtre au septième siècle. — Tragédies d'imitation. Tragédies nationales. — Pacuvius. — Attius.— Comédie nationale. Les Atellanes.
§ I.
Voilà le milieu dans lequel vécut et se forma un poëte
que les Romains de tous les temps ont célébré et admiré.
Quelques-uns même n'hésitaient pas à le préférer à tous
les autres. Horace, si impitoyable pour les écrivains
du sixième siècle, si dédaigneux envers Naevius, Ennius
et Plaute, n'ose qu'avec réserve attaquer cette gloire incontestée.
Des protestations s'élèvent contre le premier
jugement qu'il en porte. On trouve fort mauvais qu'Horace
blâme le style parfois bourbeux, les longueurs, les
négligences de Lucilius; Horace est forcé d'expliquer ce
qu'il a voulu dire, de faire à l'éloge une part plus grande,
de déclarer « qu'il n'oserait jamais enlever au front du
vieux poëte la couronne que tant de gloire y avait attachée.
» Tout l'art, toute la douceur, tout le génie des
écrivains du siècle d'Auguste, ne réussirent jamais à faire
descendre de son piédestal la statue de Lucilius : de lui
volontiers tout Romain eût dit : « Il est des hommes à qui
l'on succède, mais qu'on ne remplace jamais.»
Les titres de cette grande renommée sont à peu près
perdus pour nous. Des trente livres de satires qu'avait composés Lucilius, il ne nous reste que quelques fragments
cités par les érudits et les grammairiens. L'ensemble de l'oeuvre nous échappe complètement, malgré
les conjectures plus ou moins ingénieuses des éditeurs
pour en distribuer et en relier les unes aux autres les diverses
parties : nous ne pouvons apprécier le mouvement, la verve, l'élan du poëte, c'est-à-dire les premières qualités que l'on cherche dans la satire. De plus les personnages sur qui Lucilius se précipitait « le glaive
à la main » (c'est ainsi que parle Juvénal) nous sont inconnus,
et deux vers de Lucilius ne peuvent être acceptés comme une peinture suffisante. Nous devons
croire, puisque Quinlilien l'a dit, qu'il régnait dans ses satires une grande liberté, beaucoup de mordant et de sel mais nous ne comprenons guère pourquoi Quintilien le loue particulièrement de sa merveilleuse érudition. Ce
n'est guère le premier mérite que l'on admire dans un poëte satirique. Essayons cependant de reconstituer dans
ses parties essentielles l'oeuvre mutilée.
Voyons d'abord quel fut le personnage. Ce n'est pas un Romain de Rome. Il est né dans la colonie latine de Suessa, en 606, un an après la mort de Caton. Il appartient donc à cette génération qui succède aux âpres et opiniâtres lutteurs de la seconde guerre punique. Il n'a
pas vu les désastres de la patrie victorieuse, il trouve Rome partout dominatrice déjà, ou n'ayant qu'à étendre le
bras pour renverser les derniers ennemis qui restent debout, Numance, Corinthe, Carthage. Au dedans, l'intolérance de Caton contre les arts et les sciences de la Grèce n'est plus qu'un souvenir presque ridicule. On reconnaît enfin qu'un homme peut être un bon et utile
citoyen, bien qu'il sache le grec et qu'il étudie les poëtes et les philosophes. Lucilius est bien l'homme de ce
temps; il est profondément pénétré de l'esprit nouveau,
de plus il vit dans le milieu même d'où cet esprit se répand
comme d'un foyer dans toutes les classes éclairées de
la société romaine. Il est admis dans la familiarité de Scipion,
de Lélius, de L.Furius Philus, qui fut consul en 618,
de Spurius Mummius, frère du vainqueur de Corinthe.
Avec ces personnages illustres il assista au siége de Numance;
sans doute il entendit lire à Mummius ces épîtres
en vers qu'il adressait du camp à ses amis de Rome, vif
et élégant badinage qui cent ans après conservait encore
tout son charme. Il connut aussi et pratiqua le jurisconsulte
Rutilius Rufus, homme éminent par sa science et sa
probité, stoïcien, disciple de Panaetius. Mais ces personnages
distingués n'étaient pas, il importe de le rappeler,
des admirateurs fanatiques et exclusifs de la civilisation
grecque ; ils n'affectaient et n'avaient aucun dédain pour
les moeurs nationales : citoyens dévoués, actifs, intelligents,
ils savaient concilier les devoirs que la patrie leur
imposait, avec la culture de l'esprit et les charmes du
loisir : voilà le juste tempérament qui les distingue.
Ils aiment les arts que Caton affectait de dédaigner ou
de redouter, mais ils n'en font pas l'unique occupation de
leur vie. Ils ne croient pas non plus qu'un Romain doive
rompre avec la vieille tradition nationale ; l'antique discipline,
qui était l'âme même de Rome, adoucie, non supprimée,
par une culture intellectuelle plus large : voilà
le milieu dans lequel avec un rare bon sens ils savent se
fixer et se plaire. On ne comprendrait point Lucilius,
si on ne le replaçait par la pensée dans la société de ces
hommes de goût et démesure, qui surent conserver au milieu
des entraînements irréfléchis de la mode et des séductions de la civilisation hellénique, l'attitude, le caractère
et les moeurs de Rome.
Lucilius appartenait à une noble famille, il était chevalier
et fort riche. Quelques historiens font de lui un
publicain, sans doute pour expliquer sa fortune, qui était
considérable ; mais Lucilius déclare en propres termes
qu'il ne veut pas cesser d'être Lucilius pour se faire publicain
d'Asie. Il était d'ailleurs d'une santé fort
délicate, et incapable de résister aux fatigues de la vie publique.
Il traversa donc les terribles orages de cette époque,
la révolution tentée par les Gracques, les commotions
de la guerre sociale, sans se mêler aux affaires, sans
même s'attacher à aucun parti. Il resta l'ami des citoyens
les plus considérables, sans épouser leurs intérêts et
leurs passions. M. Mommsen voit en Lucilius un Béranger
romain, comparaison plus humoristique que solide
: car Béranger était d'un parti. Il faut beaucoup
d'esprit, de véritable indépendance et de droiture pour
prendre et conserver une position aussi délicate. Dans
des temps de luttes, les combattants ne sont guère disposés
à la sympathie pour ceux qui, neutres la veille,
peuvent être demain des ennemis déclarés. Il paraît que
Lucilius sut faire accepter sa neutralité, disons mieux,
son indépendance. Car rien ne serait plus faux que de
voir en lui un indifférent, un épicurien à la façon de Lucrèce.
S'il ne partage pas les ardentes passions de ses
contemporains, s'il ne lutte pas pour le triomphe de tel
ou tel parti, c'est qu'il veut conserver la franchise et le
pur dévouement du citoyen. Lui aussi a une cause à
défendre, mais ce n'est ni celle du Sénat, ni celle des alliés, ni celle des plébéiens, c'est la cause des moeurs
publiques. Ame honnête, sincère, ardente, excitée encore
par les souffrances du corps, il ressent des indignations
généreuses, des dédains, des afflictions profondes
à la vue des désordres sans nombre et de tout genre qui
s'étalent à la face du ciel. Ses relations étendues, la
finesse de son esprit, lui permettent de tout voir, de tout
comprendre, de tout exprimer; de plus, avantage énorme,
il ne fait pas un métier comme Ennius, Plante et Térence
; il n'écrit point pour vivre, car il est riche. Il est
le premier des Romains qui ose mépriser le préjugé qui
interdit à un homme libre la profession de littérateur.
C'est par là encore qu'il conserva sur Horace aux yeux
des Romains une certaine supériorité. Tel est l'homme,
voyons l'oeuvre.
Lucilius est le créateur de la satire littéraire, poëme
didactique et moral, que tous les peuples modernes ont
emprunté aux Romains, et que les Grecs ne connaissaient
pas. Horace salue dans Lucilius un inventeur, l'auteur
d'un poëme ignoré des Grecs. Avant Lucilius, la satire était
dramatique et bouffonne; Ennius ne réussit point à lui
donner une forme définitive ; après Lucilius le genre est
constitué. Une seule modification sera apportée à son
oeuvre. Par ressouvenir de la satire primitive, sorte de
pot-pourri facétieux et licencieux, Lucilills ne s'astreignit
pas à l'uniformité du mètre, il passait sans transition de
l'hexamètre à l'iambe trimètre, et à d'autres rhythmes.
Peut-être la variété des sujets exigeait-elle ces changements?
peut-être faut-il regretter que la satire se soit
condamnée à l'hexamètre, plus souple il est vrai, chez
les Latins et les Grecs que chez les Français, mais cependant difficile à manier, et trop majestueux. Mais
laissons l'extérieur de l'oeuvre de Lucilius : voyons-en
l'âme.
C'était un Romain, honnête homme, indépendant, d'un
esprit cultivé, sans affectation de rigorisme,
n'ayant
rien d'un Caton morose, ou d'un déclamateur de profession.
Si la comédie aristophanesque eût été tolérée à
Rome, il semble qu'il eût été capable de la faire applaudir
de ses contemporains. Il n'hésite pas à mettre les
noms au bas des portraits ; il déchire, raille et loue des
personnages vivants. Lui-même se met en scène, et
ne s'épargne pas. On sait que sur ce point Horace l'imita.
Quels étaient les vices, les turpitudes, les ridicules alors
à la mode? Lucilius semble en avoir recueilli une
ample moisson. Le premier livre de ses satires est d'une
haute et fière conception, tout épique. Il rassemble les
dieux dans un conseil solennel : ils se sont émus du triste
spectacle que présente alors la ville qu'ils ont élevée si
haut, et, pour arrêter le débordement du mal, ils décident
de faire un exemple dans la personne de Lupus.
Voilà le frontispice de l'oeuvre. Les livres suivants seront
une galerie de portraits : les imitateurs, les amis
de Lupus y figureront. On peut juger de l'intérêt de
cette vaste composition pour les contemporains. Mais
nous sommes réduits à de vagues indications sur l'ensemble
et les détails. Prenons donc au hasard les vers
les plus significatifs.
Voici le peuple romain au Forum.
« Mais aujourd'hui, du matin à la nuit, jour de
fête et jour ouvrier, tous les jours et tout le jour, peuple
et sénateurs s'agitent au Forum et n'en sortent point.
Tous se livrent à une seule et même étude, à un seul art, celui de tromper par d'adroites paroles, de combattre
par la ruse, de faire assaut de flatteries, de se
donner des airs d'honnête homme, de se tendre des piéges,
comme si tous à tous étaient des ennemis. » Peinture
générale, un peu vague, de la vie publique ; mais supposez,
après cette sorte d'entrée en matière, des portraits
en pied des principaux types du temps, le relief au lieu de
l'esquisse, la forte saillie bien accusée ; voilà dans les
deux parties l'oeuvre du poëte : le général menant tout
droit au particulier. Malheureusement fort peu de fragments
nous aident à compléter cette ébauche de la
vie publique des Romains. Je ne fais pas difficulté de
croire que Lucilius avait été fort réservé sur ce point.
Il voyait et flétrissait les vices des particuliers ; mais la
patrie était respectée : c'était avant tout un bon citoyen.
Il a dit : « Lucilius présente au peuple ses salutations
et ses vers faits de son mieux, et tout cela avec
affection et sincérité. » Il a résumé aussi en ces deux
vers toute l'histoire militaire de sa patrie : « Le peuple
romain a été plus d'une fois vaincu par la force et surpassé
en de nombreux combats, mais dans une guerre,
jamais ; et tout est là. »
Peu d'allusions aux grands événements du temps ; cependant une critique amère contre la lenteur de la
guerre d'Espagne, et un hémistiche terrible. «Les
légions servent pour de l'argent. » Ajoutez un mot
obscur sur la loi de Calpurnius Pison, contre les concussionnaires, c'est à peu près les seuls renseignements
que nous offrent les fragments de Lucilius sur la vie
publique des Romains. Il y a là, si je ne me trompe, un
scrupule honorable, un respect de la patrie, qui est
grande après tout aux yeux du monde. Quant aux individus,
il n'est tenu à rien envers eux, et il le prouve.
Lucilius vit de ses yeux les premières folies du luxe,
les raffinements encore grossiers de la table, du mobilier,
des vêlements, les premiers scandales de la débauche,
l'acclimatation à Rome des vices empruntés à la
Grèce et à l'Orient. J'ai dit comment tout cela s'était
concentré à Rome, qui devenait le grand refuge de tous
les étrangers, de toutes les industries équivoques, de
toutes les vilenies du monde. La province était infiniment
moins corrompue. Le respect des vieilles moeurs
s'y conserve encore, avec un certain mépris pour le dévergondage
de la capitale. Il ne faut pas oublier que
Lucilius est un provincial ; il y a chez lui une certaine
satisfaction à opposer aux vices de Rome, l'innocence
des villes où se recrutaient alors les meilleurs et les plus
distingués serviteurs de la patrie.
Je ne chercherai pas à présenter un tableau complet
des moeurs de cette époque. Les satires de Lucilius,
telles que nous les possédons, ne pourraient m'en fournir
tous les traits, et les citations sont délicates. Les vices
que Lucilius semble avoir flétris de préférence sont
la débauche sous toutes ses formes, et elles étaient déjà
alors singulièrement nombreuses et variées, et l'intempérance
de la table. « Ce n'est pas vivre, dit-il quelque
part, que de n'avoir pas d'appétit. » Tel gourmand
d'alors reconnaît au goût la patrie des huîtres
qu'on lui sert. Le type qu'il semble avoir reproduit avec le plus de complaisance, c'est celui de l'affranchi
parvenu qui inonde de parfums sa tête hérissée,
tranche du grand seigneur, mène grand train, étale le
luxe de ses esclaves, de ses maîtresses, de ses festins.
C'étaient ces parvenus qui dans le Forum se permettaient
d'assaillir de leurs clameurs Scipion Émilien.
« Silence, leur crie-t-il, bâtards de l'Italie. Vous aurez
beau faire, ceux que j'ai amenés garrottés à Rome ne
me feront pas peur, tout déliés qu'ils sont maintenant. »
C'étaient les ancêtres de Trimalcion.
Autant qu'il est permis d'en juger, les peintures de
Lucilius étaient d'une singulière énergie, surtout celles
des amours de ce temps-là. Lui-même se met plus
d'une fois en scène, et il est aisé de voir que, s'il condamnait
les excès inouïs de ses contemporains, il n'était pas
lui-même un modèle de continence et de retenue. C'est
ce qui donnait à ses satires un charme particulier : on
y retrouvait non un censeur chagrin, mais un homme
qui avait ses faiblesses, ses misères morales et les confessait
ingénument. Liberté, franchise et sincérité : voilà
ce qui semble avoir caractérisé l'oeuvre du satirique et
l'avoir fait accepter.
Je signalerai un point qui n'a pas été assez remarqué
jusqu'ici. Les contemporains de Lucilius copiaient avec
fureur et parfois avec une gauche affectation les modes,
les moeurs, les goûts de la Grèce : ils écrivaient
volontiers en grec, émaillaient la conversation de mots
grecs. On en trouvera un grand nombre intercalés
dans les vers de Lucilius, soit qu'il ait lui aussi sacrifié
au goût du jour, soit qu'il veuille railler les sottes affectations des grécomanes. L'intention des vers qui suivent
n'est pas douteuse :
« Au lieu de rester romain, sabin, concitoyen de
Pontius, de Trétannus, de ces centurions, de ces hommes
illustres, les premiers de tous, et nos porte-étendards,
tu as mieux aimé le faire appeler grec. En grec
donc, puisque tu le préfères, je te salue, moi préteur
à Athènes, Titus. Et mes lecteurs, et ma suite,
et ma cohorte te disent : Titus. Voilà pourquoi
Titus Albutius est mon ennemi public, mon ennemi
privé. » C'est encore contre le même Albutius que sont
décochés ces deux vers : « Que ces mots sont
agréablement agencés ! On dirait les petits casiers d'une
mosaïque, un assemblage de marqueterie. »
Et ailleurs. Ne rhètorise pas trop avec moi.
Ainsi Lucilius tournait en ridicule l'abus de l'hellénisme
: il voulait que la langue nationale, le parler national,
gardassent leur propre couleur ; il va même jusqu'à
railler doucement certains élégants qui raffinent sur
la langue. Voici deux vers à l'adresse de son ami Scipion
Émilien : «Pour paraître plus agréable et plus savant que
les autres, tu ne dis pas pertaesus, mais pertisus. »
Ce qui n'empêchait pas Lucilius de faire à l'occasion le
pédant, et d'étaler avec complaisance tout son savoir.
Le livre IXe tout entier était consacré à l'orthographe
et à la grammaire. Les fragments conservés sont plus
longs que ceux des autres livres. On voit bien que
ce sont les grammairiens qui les ont recueillis. Le caractère
et la valeur des lettres, des étymologies, des
définitions, par exemple la différence qu'il y a entre poesis et poema, fervere et fervere, etc., c'est un savant
de la veille qui fait montre de ses connaissances.
Il est donc bien l'homme que j'ai dit, grec et romain à la
fois, ennemi de tout excès, ni Caton, ni ce fol Albutius,
tout grec.
Terminons cette étude par la traduction du fragment
le plus considérable de Lucilius. C'est Lactance qui
nous l'a conservé pour le réfuter, cela va sans dire.
On ne peut dire qu'il y ait réussi. Le poëte essaye une
définition de la vertu. Je ferai remarquer que sa définition
est toute stoïcienne ; c'est comme le sommaire du
traité de Cicéron sur les Devoirs. Nous retrouvons ici directe
et vivante l'influence de Panaetius.
« La vertu, Albinus, c'est de savoir apprécier les
soins et les affaires de la vie ; la vertu, pour l'homme,
c'est de savoir ce que chaque chose renferme en soi :
la vertu, pour l'homme, c'est de savoir ce qui est droit,
utile, honnête, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est
dangereux, honteux, malhonnête. La vertu, c'est de
savoir un terme et une fin au désir d'amasser ; la vertu,
c'est de savoir apprécier ce que valent les richesses; la
vertu, c'est d'honorer ce qui mérite en effet de l'honneur ;
c'est d'être l'ennemi public et privé des hommes mauvais,
des moeurs mauvaises; c'est d'être le défenseur des
hommes de bien, des bonnes moeurs ; de les glorifier, de
leur vouloir du bien,
de vivre leur ami ; c'est de
placer au premier rang les intérêts de la patrie, au second
ceux de nos parents, au troisième et au dernier les
nôtres. »
Il manquerait quelque, chose à cette exposition si solide de la morale stoïcienne, si le poëte n'avait
ailleurs décoché son épigramme contre ce fameux sage
qui seul est beau, riche, libre, roi ; Horace ajoute, bien
portant... quand il n'a pas la pituite. Tel est le bon
sens romain : il saisit avec ardeur et reproduit avec
respect et conviction ce qui est, grand, utile dans la
doctrine stoïcienne, et, pour agrandir le cercle, dans
l'hellénisme tout entier : quant à l'exagération, aux
puérilités prétentieuses, aux vains jeux d'esprit, il s'en
raille. Le disciple veut bien s'instruire, mais il n'apprendra
et n'admirera que ce qui lui paraîtra bon et vrai.
Lucilius est le premier en date de ces esprits cultivés et
modérés, pleins de tact et de goût, qui s'arrêtent juste
au point où le ridicule va commencer.
Parlerai-je de son style? Il est çà et là d'une fière
venue, étincelant d'heureuses rencontres. «Quand je fais
jaillir un vers de mes entrailles, » dit-il. Le plus souvent, c'est de la
prose, forte, saine, un peu lourde. Il faisait deux cents
vers avant dîner, deux cents vers après, ce qui révolte fort le laborieux Horace. Ses vers coulaient
c'est-à-dire qu'un mouvement rapide de l'âme les emportait. Voilà ce que l'on admirait encore du temps
d'Horace ; voilà ce qu'on chercherait vainement dans les
satires plus jolies, plus élégantes, plus froides, de son
successeur.
§II.
LA TRAGÉDIE ET LA COMÉDIE AU SEPTIÈME SIÈCLE.
Nous ne possédons pas une seule des nombreuses tragédies
écrites par Livius Andronicus, Nævius, Ennius,
Pacuvius, Attius et plusieurs autres; nous n'en possédons
pas même une seule scène : quelques définitions philosophiques
sur le principe des choses, sur la Fortune, le
récit d'un songe, une ou deux lamentations : voilà les
faibles indice ssur lesquels nous devons essayer de fonder
un jugement. Chose difficile,impossible même : pourrions-nous
nous flatter de connaître Corneille et Racine s'il
n'avait survécu de leurs oeuvres que le récit de la mort
d'Hippolyte ou celui du songe de Pauline ? Ces morceaux
brillants permettent d'apprécier les qualités épiques ou
descriptives du poète, non son génie dramatique. Il nous
reste, il est vrai, les jugements portés par les anciens sur
des oeuvres qu'ils connaissaient en entier, qu'ils avaient
vu représenter. Mais, outre que nous ne pouvons contrôler
ces jugements, il faut bien avouer qu'ils ne nous
apprennent rien ou presque rien. Cicéron célèbre avec
enthousiasme la Médée d'Ennius, l'Antiope de Pacuvius :
«Il faudrait, dit-il, être ennemi du nom romain pour ne
pas admirer de tels-ouvrages. » Nous voulons bien le
croire : mais en quoi sont-ils admirables, voilà ce qu'il
serait pour nous utile de savoir. Horace traite les vieux
poëtes tragiques avec plus de respect que les comiques :
mais un vers lui suffit pour caractériser Pacuvius et Attius
: l'un brille par sa science, l'autre par son élévation. Enfin Quintilien admire en eux l'élévation des pensées,
la gravité du style, la majesté des personnages ; du reste
leurs écrits manquent d'élégance et de poli ; Cicéron
va plus loin : il dit que Cécilius et Pacuvius écrivaient
mal.
Cependant, si l'on en croit Cicéron, ces poètes jouirent
de la plus grande faveur de leur vivant et jusqu'à la fin
de la république. C'était même, parmi la foule grossière
et ignorante, un enthousiasme qui se manifestait par des
cris confus. Mais étaient-ce les tragédies elles-mêmes qui
ravissaient la multitude ou le jeu consommé des acteurs,
ou, ce qui est encore plus probable, les allusions aux événements
et aux personnages contemporains? Cicéron lui-même
nous apprend que les acteurs ne se faisaient pas
faute de commenter ainsi le texte et même d'intercaler
des vers de circonstance. Ainsi l'acteur Diphilus a bien
soin de désigner clairement Pompée à la multitude, en
prononçant ces vers : "C'est par notre misère que tu es
grand" (Pompée s'appelait Magnus). Le comédien Esopus,
si l'on en croit Cicéron, rappela éloquemment au souvenir
du peuple Cicéron exilé, et lui appliqua ce vers du
Brutus d'Attius :
« Tullius, qui libertatem civibus stabiliverat.
De même après la mort de César le peuple saisit avidement
toutes les allusions à Brutus alors absent ; et en
cela il fit preuve de grande perspicacité ; car la pièce représentée
était Térée,et il y avait réellement fort peu d'analogie
entre ce roi de Thrace et le dictateur Jules César. Mais
qui ne sait combien l'esprit préoccupé d'une seule idée
y rapporte facilement tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend?
Le meurtre de César, la fuite de Brutus et de ses amis, les funérailles du dictateur, cette scène si dramatique
du cadavre étalé sur la tribune aux Harangues, ces
plaies encore fraîches montrées à la multitude en même
temps qu'Antoine lisait le testament plein de legs pour le
peuple : comment, au sortir de ces drames d'une si puissante
réalité, ne pas découvrir même dans la tragédie de
Térée des rapprochements quelconques avec tel ou tel de
ces événements ? Et d'ailleurs les acteurs aidaient les
spectateurs à en découvrir; ils en créaient au besoin. Ce
que l'on admirait donc, ce qui excitait les transports de la
multitude, ce n'était pas le génie du poëte tragique, ni
l'oeuvre représentée, mais ce que l'imagination des spectateurs
y ajoutait ou croyait y trouver. De tels applaudissements,
loin de témoigner en faveur de la tragédie romaine,
la condamnent. Elle était l'occasion, le prétexte
de grandes émotions populaires. Elle n'en était pas la
source. Ce que l'on saluait en elle avec transport, c'était
ce qu'on y mettait, non ce qu'elle renfermait. Or le propre
d'une oeuvre réellement forte et vraie est de désintéresser
du présent l'âme du spectateur, de l'entraîner dans le
monde imaginaire où le poëte a placé l'action du drame, et
de ne laisser en lui aucune autre pensée, aucune autre
émotion. II ne fut que trop évident trente ans plus tard que
la tragédie latine n'avait pas en elle-même sa vitalité et
son charme. Quand Auguste eut pacifié le théâtre comme
l'éloquence et tout le reste, quand les allusions devinrent
impossibles dans cette espèce de léthargie et d'indifférence
à la chose publique devenue la chose d'un seul, la tragédie
romaine tomba à plat. Réduite à n'être plus qu'une oeuvre
d'art, les spectateurs s'en détournèrent avec dégoût. Ils
retournèrent à leur véritable inclination, les jeux du
cirque et les combats de l'arène. Tels ils étaient déjà d'ailleurs au temps même de Térence. Et c'est là à vrai
dire une des causes principales de la faiblesse du théâtre
tragique chez les Romains. Qu'était-ce que les souffrances
imaginaires d'un Oreste ou d'un Télèphe auprès des sensations
violentes d'un combat de bêtes ou de gladiateurs?
Les critiques se sont ingéniés à rechercher les causes de
l'infériorité des Romains en ce genre, et ils en ont découvert
un grand nombre : celle que je viens d'indiquer me
semble capitale. Le génie d'un peuple se manifeste dans
les divertissements qu'il préfère. Jamais les sanglantes
scènes du cirque ne purent s'introduire à Athènes, chez
un peuple qui comprenait et ressentait les pures jouissances
des arts : les Romains n'en goûtèrent jamais d'autres.
Tout spectacle qui n'était pas fait pour les yeux,
qui s'adressait à l'intelligence et à la sensibilité dans ce
qu'elle a de plus délicat, les ennuyait : ils préféraient un
saltimbanque à Térence. Même avant la fin de la république,
les mimes et les pantomimes remplacèrent en
partie la comédie et la tragédie. Dès le début même des
représentations dramatiques, dans la première chaleur de
la nouveauté, ils manifestèrent leur prédilection pour la
partie qui s'adressait plus directement aux sens. Livius Andronicus,
qui jouait lui-même ses tragédies, s'étant brisé
la voix, se fit remplacer dans cette partie de son rôle par
un jeune esclave, et se borna à faire les gestes. Le public
y attachait plus d'importance qu'aux paroles. Nous verrons
cette prédilection se développer de plus en pius.
Sous les empereurs les représentations dramatiques ne
furent plus que des gesticulations et des danses.
Reconnaissons-le donc sans hésiter. Les Romains
étaient incapables de goûter la tragédie : c'était un
plaisir trop noble et trop délicat pour leurs fibres grossières. Qu'on se reporte à la naissance du poëme dramatique
en Grèce. Il apparaît au moment où la source des
épopées naïves tarit, où la réflexion s'éveille, et, se détachant
du monde extérieur, commence à sonder les
profondeurs de la nature humaine. Tous les éléments,
toutes les formes poétiques des âges antérieurs entrent
dans la composition du poëme dramatique ; il est à la fois
épique et lyrique; de plus il touche à l'éloquence qui commence
à naître, et s'inspire déjà de la philosophie qui
s'essaye : c'est comme la synthèse harmonieuse et vivante
de toutes les facultés, de toutes les richesses de la
race hellénique. Par-dessus tout il est éminemment et
exclusivement national. Or de toutes les parties qui le
composent, quelles sont celles que le poëte romain trouvait
autour de lui? L'épopée et la poésie lyrique n'existent
pas à Rome, ou du moins n'y ont aucune originalité
ni aucun élan. Les légendes héroïques sont de création
récente, et de plus c'est un dépôt sacré auquel cet être
méprisé qu'on appelle un poëte ne saurait toucher sans
sacrilège : l'orgueil national ne tolérerait pas une telle
profanation. Un historien, un vil esclave jouant sur la scène
le rôle d'un Romulus ou d'un Drutus! Enfin la philosophie
est inconnue aux Romains. L'éloquence seule,
ce genre vraiment national, jette son premier éclat.
Voilà les éléments qui s'offrent au poëte. Jamais peut-être
oeuvre d'art ne fut conçue et exécutée dans des conditions
plus délavurables. Ne nous faisons donc pas d'illusion
sur les éloges décernés par un Cicéron à ces
poëtes tragiques du septième siècle: Cicéron n'est pas un
juge bien compétent en fait de poésie. Pacuvius et Attius
avaient été parfois des hommes éloquents, il n'en
fallait pas davantage pour ravir le grand orateur. Il ne semble pas en effet qu'ils aient été autre chosc.
Chacun d'eux a une physionomie distincte ; mais, dans
ses parties essentielles, leur oeuvre est la même.
Pacuvius, neveu et compatriote d'Ennius, né à Brindes
en 533, vécut quatre-vingt-dix ans. Il fut d'abord
peintre. Il vécut à Rome dans la société de Scipion et de
ses amis, et retourna, déjà fort avancé en âge, mourir dans
sa ville natale. C'était un homme fort instruit pour ce
temps-là, ce qui veut dire sans doute qu'il aimait à faire
étalage de ses connaissances. Il y a en effet dans les
fragments de Pacuvius une certaine pédanterie : l'auteur
de la rhétorique à Hérennius en avait été frappé. J'y
trouve aussi un certain abus des formes syllogistiques.
Lucilius se moque quelquefois de ses exordes embrouillés, ce qui prouve que la forme
oratoire avec tout son appareil didactique lui était
chère : autre marque de pédanterie. Enfin les grammairiens
ont recueilli dans Pacuvius un certain nombre de
mots forgés par lui avec plus d'affectation que de bonheur,
comme geminitudo, prolixitudo, vastitudo, grandaevitas,
concorditas, repandirostrum, incurvicervicum
pecus, rudentisibilus, etc., ce qui fait penser à notre
Ronsard, quand il croit ne devoir plus être français pour
paraître plus docte.
Attius était de cinquante ans plus jeune que Pacuvius;
il naquit en 584, et vécut jusqu'en 670. Il put
connaître à la fois Scipion et Cicéron. Il débuta dans la
carrière dramatique sous les auspices de Pacuvius, auquel
il alla lire un jour sa tragédie d'Atrée. Pacuvius
en trouva les vers grands et sonores, mais un peu durs et
âpres. Attius s'en consola; car les bons fruits naissent
durs et deviennent doux, tandis que ceux qui sont doux en naissant, pourrissent. Il y avait une certaine fierté,
comme on le vit, dans le caractère d'Attius : ce que marque
assez bien l'altus d'Horace. Si c'est bien d'Attius
qu'il est question dans un passage de Valère Maxime,
(lib. III, cap. vii), il eût porté dans les relations ordinaires
de la vie une indépendance quelque peu ombrageuse.
Il fut, dit-on, l'ami particulier du consul Décimus Brutus;
et c'est peut-être ce qui le détermina à composer sa
tragédie nationale Brutus. Tous les critiques de l'antiquité
s'accordent à admirer dans Attius l'énergie et
l'élévation : par là il agissait puissamment sur les
âmes. Cicéron se plaît à le citer sans cesse. C'est un
autre personnage que le docte Pacuvius ; et il semble
qu'on puisse lui appliquer l'hémistiche d'Horace : « Il y a en lui un certain souffle tragique.
» Attius est en effet le seul poëte qui ait eu la
fibre dramatique, autant qu'un Romain pouvait l'avoir.
Pacuvius composa douze tragédies : nous avons du
moins conservé les titres et quelques fragments de
douze tragédies différentes dont il était l'auteur.
Attius en composa un bien plus grand nombre. J'en
trouve mentionnées jusqu'à quarante-six. Ce qui frappe c'est
l'incroyable disproportion qui existe entre le nombre des
tragédies ayant des titres grecs, et celles qui ont des titres
latins. Paulus, Decius, Brutus, trois tragédies en tout sur près de soixante, voilà la place que l'histoire nationale
tenait sur le théâtre romain. Était-ce impuissance des
poëtes à composer sans être soutenus par
un modèle grec, une oeuvre originale? Était-ce par un respect excessif de tout ce qui touchait à la patrie ? Était-ce
par crainte de ne pas intéresser le public en lui présentant
sur la scène des faits et des personnages qu'il
connaissait déjà ? Toutes ces raisons peuvent être vraies : ce sont à peu près les mêmes qui ont donné à notre
théâtre du dix-septième siècle sa forme et son esprit. Il
ne vint pas une seule fois à la pensée de Corneille et de
Racine de prendre dans l'histoire de leur pays le sujet
d'une tragédie. Nous touchons ici le point délicat, la profonde et incurable infériorité des littératures d'imitation.
Elles peuvent produire des oeuvres d'un art merveilleux la vie intérieure leur manque. Elle leur manque, parce qu'il y a un divorce absolu entre la littérature et le milieu
social. Chez de tels peuples, il faut être savant pour être
poëte : au dix-septième siècle il fallait connaître à fond
Aristote et les auteurs grecs et latins à qui l'on empruntait le sujet d'une tragédie. Il est vrai que ce sujet antique,
on le traitait à la moderne, qu'on dénaturait la physionomie des événements, le caractère et les moeurs des personnages,
que l'élément national banni de la scène y
rentrait à la dérobée, et s'imposait à une oeuvre qui lui
était absolument étrangère, qu'on avait des héros antiques taillés sur le patron des brillants cavaliers du jour ; mais
personne n'était choqué de ces fausses couleurs ; et des
oeuvres admirables d'éloquence, de passion, de vérité
morale sortaient de ce bizarre amalgame de deux mondes
et de deux sociétés. Les poëtes romains du septième siècle
ne firent pas autre chose. La littérature et la vie réelle
étaient deux mondes séparés : de même qu'on demandait
à l'Afrique ses figues, au Pont-Euxin ses huîtres et ses
sardines, à Tyr sa pourpre, c'est la Grèce qui avait la
spécialité d'approvisionner le théâtre romain. Avec quel
naïf orgueil Térence répète dans tous ses prologues :
« C'est une pièce entièrement grecque : Est tota fabula
graeca ! » Ce qui veut dire : vous pouvez l'admirer de
confiance ; elle vient du pays où l'on n'en fait que de bonnes.
Ce point bien établi, cette loi fatale de l'imitation bien
constatée, voyons quels étaient les caractères de l'imitation
; nous essayerons ensuite de déterminer ce que pouvait
être une tragédie nationale (1).
(1) Voir sur ce sujet les chapitres IV et V de la thèse de M. Buissier : Le poëte Attius.
Pacuvius et Attius
connaissaient, outre les trente-deux tragédies d'Eschyle,
de Sophocle et d'Euripide que nous possédons, toutes
celles qui avaient été écrites par ces poëtes et dont le
nombre était considérable, plus celles de leurs contemporains et de leurs successeurs, c'est-à-dire la plus riche
et la plus abondante matière qui pût jamais être offerte
à l'imitation. Le nombre des tragédies latines ne s'élève
pas au-dessus de trois cents. Celui des tragédies grecques dépasse mille. Mais nous ne pouvons en douter, les poëtes
grecs ne se faisaient aucun scrupule de traiter un sujet
traité déjà par leurs prédécesseurs ou leurs contemporains
; ils ne cherchaient point la nouveauté de la matière;
il n'y en avait pas, à vrai dire, qui fût inconnue au
public. Une seule tragédie, la Fleur d'Agathon,est de pure
invention. Que firent les poëtes latins ? Ils firent ce qu'avaient
fait les comiques : ils empruntèrent à Eschyle le
sujet, à Sophocle tel personnage nouveau, à Euripide
telle tirade pathétique ; ils firent un mélange plus ou moins
heureux des traits les plus frappants choisis avec plus ou
moins de discernement dans les poëtes grecs. C'est là
l'heureuse audace que leur attribue Horace (feliciter audet).
Par ces ingénieuses combinaisons ils évitaient l'extrême
simplicité de l'art grec, qui n'eût pu se faire agréer
des Romains ; ils introduisaient dans leur oeuvre une
agréable variété, donnaient plus de mouvement à l'action,
plus d'imprévu aux situations, et produisaient en somme
une tragédie originale. Au point de vue de l'art, il ne se
peut rien imaginer de plus grossier qu'un tel procédé ; mais la première condition imposée au poète dramatique,
c'est de plaire au public. Un calque fidèle de la tragédie
grecque eût été inintelligible et inacceptable à des Romains
du septième siècle. Plaute arrangeait pour eux Ménandre,
Philémon et Diphile : le scrupuleux Térence lui-même
réunissait en une deux comédies grecques. Il fallait
avant tout intéresser et retenir un spectateur toujours
disposé à quitter le théâtre pour les tréteaux des baladins
et les combats de bêtes ou d'hommes.
Pacuvius et Attius suivirent tout naturellement la loi
de leur caractère dans l'assemblage des parties hétérogènes
qui composaient leurs tragédies. Le docte Pacuvius imita de préférence Euripide. Il y a dans Euripide quelque
pédanterie ; on voit qu'il a connu et admiré les
princes de la sophistique, alors dans tout l'éclat de leur
gloire. Il vit au sein de la plus orageuse des démocraties,
parmi des hommes qu'il faut persuader et charmer pour
les conduire. De là ces longs plaidoyers et ces discussions
subtiles qui refroidissent l'action, mais ravissaient les
Grecs qui y retrouvaient l'écho des belles luttes oratoires
de l'Agora. Disciple d'Anaxagore, et aussi de Socrate,
il est le premier interprète d'une philosophie nouvelle,
moins ambitieuse, mais plus humaine, et plus morale.
Voilà ce qui séduisit surtout Pacuvius, et ce qu'il essaya
de reproduire. On lit parmi les fragments de ses pièces
deux passages, l'un sur le perpétuel mouvement des choses
; l'autre sur la fortune, cette aveugle dispensatrice
des biens et des maux, qui sont évidemment empruntés à
Euripide. Attius, moins philosophe, moins savant, ou
moins désireux de le paraître, âme plus haute, caractère
plus énergique, imita surtout Eschyle. Mais l'extrême
simplicité des tragédies d'Eschyle, si dénuées d'incidents,
de péripéties, d'imprévu, ne pouvait satisfaire un public
romain. Attius combina donc dans son oeuvre l'inspiration
forte et mâle du vieux poëte, sa couleur pour ainsi
dire avec le mouvement plus rapide de ses successeurs.
Il est même fort probable, ainsi que l'a supposé ingénieusement M. Boissier, qu'Attius réunissait parfois dans
une seule tragédie tous les événements relatifs à quelqu'une
de ces antiques familles légendaires, comme les
Pélopides, les Labdacides. Ainsi de la trilogie d'Eschyle Agamemnon, les Choéphores, les Euménides, il faisait une
seule tragédie. Il s'efforçait d'ailleurs de mettre le plus
souvent possible sous les yeux du spectateur les événements que le poëte grec se bornait à exposer dans un
récit : ainsi, dans Sophocle, le gardien du cadavre de
Polynice vient raconter la pieuse désobéissance d'Antigone
qui pendant la nuit est venue recouvrir d'un peu de terre
le corps de son frère : Attius montrait Antigone surprise
par le gardien. Il fallait de ces scènes vives et saisissantes
pour des spectateurs déjà blasés sur ces histoires tragiques,
et avides d'émotions nouvelles. Pacuvius lui-même,
beaucoup plus froid, avait cependant représenté devant
Thoas lui-même le généreux combat entre Oreste et
Pylade qui s'écrient tous deux : Je suis Oreste ! tandis que
Euripide s'était borné à une longue discussion entre les
deux amis. C'est par ces qualités, à savoir, une remarquable
énergie d'expressions, une fierté soutenue dans
les caractères, et un mouvement plus rapide de l'action
qu'Attius, le dernier venu des poëtes tragiques romains,
fut le plus admiré.
Le choeur, cette partie si importante de la tragédie
grecque, et qui fut dans le principe toute la tragédie, tenait
fort peu de place dans la tragédie latine. Les Romains
n'ont pas le génie lyrique; Cicéron, qui n'aurait pas
trouvé le temps de lire les poëtes lyriques grecs, quand
même le nombre de ses années eût été doublé, n'eût
point admiré Attius, si celui-ci eût donné une importance
considérable à cette superfluité, le choeur. Il n'y avait
pas de place réservée pour le choeur sur la scène romaine:
l'orchestre était occupé par les sièges des sénateurs.
Les poëtes en usaient fort librement avec cette partie de
l'oeuvre de leurs modèles. Ennius, dans son Iphigénie,
remplace un choeur de jeunes filles par un choeur de soldats,
maugréant sur les ennuis du service militaire. Ce
qui tenait lieu de choeur aux Romains, c'était ce qu'ils appelaient cantica. Les cantica étaient des monologues
d'un mètre plus rapide, que déclamaient, avec l'accompagnement
de la flûte, les personnages principaux du
drame. Étroitement unis à l'action, avantage que n'avait
pas le choeur, ils résumaient sous une forme plus vive les
traits de la situation présente et préparaient l'avenir.
C'était un mélange de poésie et d'éloquence, et c'est par
là qu'il réussissait auprès des Romains. L'éloquence faisait
passer la poésie. C. Gracchus avait lui aussi un
joueur de flûte placé derrière lui aux rostres. Le passage
de l'Eurysacès d'Attius, que le comédien Esopus sut appliquer
si heureusement à l'exil de Cicéron, était un canticum : c'est une éloquente péroraison. Attius était un
orateur énergique. Aussi l'on s'étonnait, qu'il ne fût que
poëte, lui qui semblait si bien fait pour les luttes de la
parole (1).
(1) Quintil., V, 13.
La tragédie latine était donc, selon toute vraisemblance,
une oeuvre oratoire ; et c'est ce qui explique l'enthousiasme
de Cicéron pour Pacuvius et Attius. Éloquence,
philosophie, peinture de l'énergie morale : voilà à peu
près tout ce que les Romains demandaient au théâtre.
Les modèles grecs leur offraient tout cela, non dans un
seul auteur, mais, je l'ai déjà dit, ils mettaient sans
scrupule à contribution Eschyle, Sophocle et Euripide à
la fois pour composer une seule tragédie. L'influence
d'Euripide fut certainement la plus considérable ; et c'est
par là que la tragédie latine compta de si ardents admirateurs
au septième siècle. Quelque opinion que l'on
ait du drame d'Euripide, on ne peut méconnaître qu'il
fut, pour toute l'anquité grecque et latine, le modèle par
excellence, le grand initiateur. C'est un incrédule et un moraliste: voilà ce qui explique les fausses couleurs
dont son oeuvre abonde ; il a rompu avec la vieille tradition
héroïque et religieuse, et il a entrevu l'esprit nouveau
qui va bientôt animer le monde hellénique. Il est
placé entre ce qui n'est plus et ce qui sera; forcé d'emprunter
au passé la matière de ses poëmes, il en altère
profondément le sens et la portée, et revendique pour la
raison une part considérable dans des oeuvres de imagination pure et de naïve poésie. Le premier de tous les
poëtes antiques, il substitue le libre arbitre humain à la
fantaisie du destin ou des dieux; ce n'est pas Vénus qui
cause les égarements de l'amour, c'est l'abandon volontaire
de l 'âme à sa passion. Vénus est jetée au-devant de
la tragédie dans le prologue, hommage dérisoire à la
croyance populaire, mais le drame se développe dans le
coeur humain lui-même. Ces railleries contre des dieux
cruels, injustes, impudiques, cette hardie protestation au
nom du bon sens et de la morale, ces analyses subtiles,
et ces dissertations ingénieuses et déplacées; ce mélange
de pathétique brûlant et de raisonnements oratoires ; et
par-dessus tout cette glorification de la liberté humaine
qui s'affirme, même quand elle abdique devant la passion
: voilà ce qui frappa le plus les Romains dans le
théâtre grec ; voilà ce qui fit leur éducation philosophique ; voilà ce que les poëtes latins s'appliquèrent de préférence
à reproduire. C'est par là que la tragédie latine, si
faible qu'elle ait été au point de vue poétique, mérite
cependant d'attirer l'attention. Elle est un fait social important. Térence d'un côté, Pacuvius et Attius de
l'autre, ce n'est pas autre chose que Ménandre et Euripide,
les deux grands novateurs, qui reçoivent le droit de
cité à Rome. Il est facile après cela de comprendre l'espèce d'indifférence
qui accueillit les rares essais de tragédies nationales
(fabula praetexta ou praetextata). En supposant
que le public romain pût s'intéresser à un drame
dont le sujet était connu et fixé par l'histoire, et où le merveilleux
ne pouvait naturellement qu'être froid et déplacé,
comment le poëte eût-il pu introduire dans une
oeuvre de ce genre les opinions, le langage, l'esprit de la
tragédie euripidéenne? y eut-il jamais dans aucune
famille romaine rien qui ressemble à l'horrible légende
des Atrides, des Labdacides, des Alcrnwonides? Si le drame
est un combat, soit entre des individus, soit entre des
intérêts et des passions, s'il est la peinture des incertitudes,
des défaillances, des élans subits, des emportements,
où trouver matière à tout cela dans l'histoire de
Rome? Le poëte osera-t-il introduire dans son oeuvre
ces éléments qui lui sont étrangers. La gravité romaine,
l'orgueil romain, ne sauraient s'accommoder de
cette métamorphose. On veut bien devoir à la Grèce un
divertissement ; mais on ne veut pas affubler de costumes
grecs des personnages romains. L'histoire de Rome
n'offrait qu'un seul sujet qui pût se passer à la rigueur
de ces couleurs étrangères, sujet héroïque entre tous
et que de bonne heure la légende avait embelli et poétisé,
le drame de l'expulsion des Tarquins ; Lucrèce,
Brutus, les deux Tarquins, tout ce que la vie privée avait
de plus pur, indignement souillé par un tyran, tout ce que
la vie publique avait de plus grand, l'amour de la liberté,
l'horreur du crime et de la royauté : il était impossible
que de tels souvenirs présentés sur la scène aux yeux des républicains du septième siècle, ne fissent pas éclater
un véritable enthousiasme populaire. Aussi c'est la seule
des tragédies nationales (il n'y en eut jamais que six tout) en qui ait eu un véritable succès. Attius en est l'auteur,
elle a pour titre Brutus. Quant au Romulus de
Naevius, au Paulus de Pacuvius, on ne sait absolument
ce que c 'était. Le dévouement de Décius inspira à Attius
une autre tragédie : Aeneadae sive Decius. Quelle pouvait être l'action d'un drame de ce genre ? Des prodiges
annonçaient le courroux des dieux : voilà du moins un effort pour donner place à la religion nationale dans
une oeuvre toute nationale, puis le récit de la bataille,
le dévouement de Décius, et probablement ses funérailles.
La tragédie de Brutus renfermait un songe. Tarquin
se voyait pendant son sommeil jeté à terre par un bélier. Les devins consultés voyaient dans ce bélier le
stupide Brutus. Quelle place tenait dans le drame l'épisode
de Lucrèce, on ne sait. Peut être Tite-Live, en refaisant
en orateur l'antique légende, s'est-il inspiré d'Attius.
§ III.
COMÉDIE NATIONALE.
Les essais de comédie nationale furent plus nombreux
et plus heureux. S'il était difficile aux Romains de trouver
dans leur histoire ou dans leur imagination des sujets
de tragédies et les ressorts d'une action tragique, le génie
comique ne leur manquait pas: les antiques satires, les
vers fescennins et saturnins, les chants de triomphe en
sont la preuve. Rien de plus franc que ce comique sorti
du sol même de l'Italie. Un peuple plus artiste eût fait jaillir de ces disposions naturelles toute une moisson de
chefs-d'oeuvre nationaux ; mais l'intelligence et l'amour
des beautés de la forme manquèrent toujours aux Romains.
Ils purent dessiner à grands traits de vives et
piquantes ébauches ; ils ne surent point composer un
tableau achevé dans toutes ses parties. Il importe cependant
de signaler l'existence et la popularité de la comédie
nationale qui ne céda point la place, comme on se
l'imagine à tort, il la comédie grecque de Plaute et de
Térence. Les noms d'Afranius, d'Atta, de Dossenus, de
Naevius et de Pomponius étaient et restèrent fort célèbres
; mais leurs oeuvres ne nous sont pas plus connues
que celles de Pacuvius et d'Attius. Essayons de
retrouver, d'après les fragments et les indications des
auteurs, la physionomie véritable de la comédie nationale.
Elle offre d'abord une certaine variété. Si l'on s'en
rapporte aux grammairiens, gens volontiers enclins aux
divisions et aux classifications, la comédie nationale
(fabula togata) comprenait la comédie trabeata, la
comédie tabernaria, la comédie atellana, la comédie planipedia ou planipedaria. Ajoutons-y, si l'on veut, la
tragi-comédie, appelée rhintonica, bien que le sujet en fût emprunté à la Grèce, et la comédie satyrica, qui
a le même caractère. Dans la trabeata les personnages
principaux appartenaient à l'ordre équestre : la trabée
était le costume ordinaire de cet ordre ; c'étaient des comédies
nobles. La tabernaria, de taberna, taverne, cabaret,
représentait des personnages et des moeurs de basse
condition. Les plus célèbres de ces comédies furent celles que l' on nomme fables Atellanes. Voici quelle en fut l'origine.
Dès que Livius Andronicus et Naevius eurent introduit
à Rome la tragédie et la comédie grecques, il se produisit
une protestation de l'esprit italique contre cette importation
étrangère. La jeunesse romaine, pleine de mépris
pour les pièces helléniques et pour les acteurs de condition
servile qui les représentaient, opposa tréteaux à tréteaux.
Elle emprunta aux Osques, peuple célèbre par son rude langage, ses moeurs grossières et sa bouffonnerie,
un divertissement scénique analogue à l'antique satire.
Les Osques en étaient les inventeurs, ils en furent bientôt
les victimes. Ce furent en effet des personnages osques qui d'abord figurèrent seuls dans les fables Atellanes
(d 'Atella, capitale des Osques), véritables farces satiriques
qui furent reçues avec le plus vif applaudissement
et ne disparurent jamais du théâtre. Ces personnages devinrent de bonne heure des types, c'est-à-dire des
portraits d'une vérité générale, qui pouvaient recevoir les
modifications les plus diverses, sans perdre leur caractère originel. C'est la plus remarquable création du génie
comique et bouffon de l'Italie; aussi est-ce la seule qui
ait survécu à la littérature romaine. On la retrouve encore
aujourd'hui en Italie sous le nom de comedia
dell'arte. Ses personnages fondamentaux étaient Maccus,
bossu, chauve, grand nez recourbé, oreilles hautes et
pointues, démarche vacillante, chutes fréquentes.
Maccus est gourmand, poltron, sot. C'est l'Arlechino des
Italiens modernes. Maccus est tantôt soldat, laboureur,
marchand, et dans tous ces états il reste fidèle au caractère primitif. Il avait une grande analogie avec les
faunes et les satyres, dieux italiques. Après lui venait
Bacco (grosses joues), type du parasite vorace, flatteur,
affectant la niaiserie. C'est à la fois Brighella et Polichinelle.
Pappus, bonhomme avare, ambitieux, superstitieux,
créé pour être dupe. C'est lui qui est le père des
Cassandre, des Bartholo, des Pantalon. Il est célèbre
surtout par ses infortunes conjugales. La vieille farce
Atellane en faisait aussi un candidat aux honneurs publics
d'Albe. Dossenuss ou Dorsenus, ainsi nommé à cause de
l'excessive proéminence d'une de ses épaules, charlatan
fourbe, prédit l'avenir, dupe les paysans, leur donne au besoin des consultations de droit et de médecine. C'est le
docteur de Bologne et notre Pathelin ; Bridoison en a
conservé quelques traits. Ces personnages étaient les
acteurs obligés de toute Atellane. Les comédiens imaginaient
un scenario quelconque, les situations et les événements
qu'il leur plaisait : dans ce cadre de convention,
mobile et accidentel, se retrouvaient toujours ces quatre
types de la sottise humaine. D'autres personnages se
mêlaient à l'action ; ceux-là avaient une origine et un
caractère religieux : c'étaient des êtres surnaturels tirés
de la grossière mythologie des pâtres et des laboureurs
du Latium, Manducus, rictus ouvert démesurément,
dents horribles et claquantes, espèce d'ogre et de croquemitaine
dont on effrayait les petits enfants. Lamia,
Mania, fées ogresses, avaient le même caractère. Horace
parle d'enfants qu'on leur retirait du ventre. Quant à la
composition des pièces, elle était abandonnée à l'imagination
des acteurs. Ils la divisaient entre eux par scènes,
et ces scènes, ils les remplissaient au caprice de l'improvisation
et de la verve. Quel était le caractère général des Alellanes? Nous
avons vu qu'elles étaient une sorte de protestation de
l'esprit national contre le théâtre grec importé à Rome.
Les acteurs des Atellanes étaient de jeunes Romains, de
condition libre. Le divertissement populaire qu'ils avaient
imaginé suivait immédiatement la représentation de la
pièce imitée du grec : de là le mot d'exodium pour le désigner.
Les acteurs portaient des masques, et ces masques
représentaient souvent les traits de personnages vivants
tournés en ridicule sur la scène. On laissait à ces acteurs
de farces populaires la plus grande liberté ; eux-mêmes
étaient fort jaloux de leurs priviléges, et n'eussent jamais
permis à un histrion de profession de jouer en leur
compagnie. La loi qui
déclarait les comédiens infâmes ne les atteignait pas:
ils gardaient leur rang dans la curie et à l'armée : de
plus ils n'étaient pas forcés d'ôter leurs masques sur la
scène. Sous les empereurs, les farces Atellanes furent le
refuge de la liberté bannie de tous lieux; et plus d'une
allusion sanglante partie de ces tréteaux populaires vint
frapper les Césars au milieu des rires de tout le peuple.
Pendant près de deux cents ans (de 450 à 650), les
fables Atellanes ne furent pas autre chose que des farces
improvisées avec des personnages et des caractères fixes
(statae personæ) : elles étaient alors l'amusement de la
populace ; les élégants épris de la grâce attique les méprisaient
fort. Au septième siècle seulement, elles subirent
une transformation devenue nécessaire. Deux écrivains
fort estimés des contemporains et de l'antiquité, Novius
et Pomponius, donnèrent une forme plus régulière à
l'Atellane, agrandirent le cadre du scenario primitif,
ajoutèrent aux personnages convenus d'autres personnages, et écrivirent leurs comédies. L'Atellane. devint un
genre littéraire.On s'accorde généralement à regarder
Pomponius comme l'auteur de cette innovation. On ne
sait que fort peu de chose sur ce personnage : il florissait
vers l'an 650, et il sut se faire applaudir. Si l'on en juge
d'après les titres de ses pièces, il présentait aux spectateurs
les personnages de l'Atellane primitive dans les
conditions les plus diverses, en leur conservant leur caractère
traditionnel. C'est ainsi que chez nous on voyait
Pierrot tour à tour soldat, épicier, ministre, etc. Pomponius
montrait Bucco adopté, Bucco
vendu, Maccus, soldat, chevalier,
jeune fille. On imagine les obscénités d'une telle transformation.
Pomponius n'avait pas non plus sacrifié le
merveilleux de l'antique Atellane : une de ses pièces
porte le titre de Pytho gorgonius, sorte de croquemitaine
originaire du Latium. Enfin un grand nombre de
comédies représentaient au vif les moeurs, les habitudes,
les ridicules des provinces, de certaines industries et de
certanis métiers. On ne peut trop en regretter la perte.
Ce que nous possédons de Novius offre les mêmes caractères.
Il était contemporain de Pomponius. Il représentait
dans ses Atellanes Maccus en exil, Maccus cabaretier,
l'ogresse Mania, exerçant la médecine. Sylla, qui aimait
beaucoup les farces Atellanes, en écrivit, dit-on, quelques unes.
Le Mime fit mépriser l'Atellane vers la fin de la république.
La comédie nationale disparut du théâtre pendant
près d'un siècle ; elle revint à la lumière sous
Tibère.
Afranius est un des poëtes les plus célèbres de cette
période. Les critiques postérieurs le mettent sur la même ligne que Plaute et Térence ; il parait même, si l'on en
croit Horace, que des enthousiastes voyaient en lui un
Ménandre. Tous sont d'accord sur un point, le seul important
pour nous, c'est que Afranius fut un poëte comique
national (togatarum auctor); quelques-uns même
lui attribuent une Atellane. Il n'emprunte donc pas le
sujet de ses pièces à la Grèce. Le titre de Thaïs que porte
une de ses comédies ne prouve rien, sinon qu'il y avait à
Rome plus d'une courtisane de ce nom très vulgaire dans
l'antiquité. De plus les comédies d'Afranius n'étaient ni
des prætextatæ, ni des trabeatae, mais des tabernariae,
c'est-à-dire que le poète s'était appliqué à peindre les
moeurs des gens de basse condition, et il semble y avoir
excellé. Cicéron le qualifie de disertus, faible éloge à nos
yeux pour un poëte comique, mais le plus grand sans
doute aux yeux de Cicéron. Velleius Parterculus déclare
que Afranius soutient fort bien la comparaison avec les
Grecs. Est-ce ironiquement que Horace le rapproche de
Ménandre? Il ajoute cependant que le public romain se
presse au théâtre pour applaudir ces vieux poëtes. Afranius
était encore fort goûté du temps de Néron : Apulée
le cite avec éloge. Ausone l'appelle facundus. On ne peut
donc en douter, cet auteur de comédies populaires fut
estimé de l'antiquité tout entière. Mais nous devons ajouter
que la plupart des critiques lui reprochent l'extrême
liberté de ses peintures. Ce ne fut pas son seul emprunt à
la Grèce. Des détracteurs lui reprochaient d'avoir imité
trop souvent Ménandre. Il en convient le tout premier.
«Oui, j'ai emprunté à Ménandre plus d'un passage; et non à lui seulement. J'ai pris partout ce qui me convenait, quand je n'espérais pas pouvoir faire mieux. J'ai même emprunté aux Latins. » Il serait au moins téméraire de supposer avec certaines critiques que les pièces
d'Afranius, bien que latines par les sujets et les personnages,
étaient tontes grecques. Pourquoi le poëte se
serait-il imposé la peine de trouver des sujets nationaux
pour les afflubler à la grecque ?
Il reste les titres de plus de quarante pièces d'Afranius.
Il était contemporain de Pomponius et d'Attius. Avant
lui, Titinius s'était exercé dans le même genre, ainsi que
Quinctius Atta, dont Horace fait mention. Le pédant
Vulcatius Sédigitus ne parle pas de ces poëtes, parce
qu'ils n'ont pas emprunté aux Grecs les sujets de leurs
pièces : il ne cataloguait que les auteurs de comédies pallatiae. Il était utile de rappeler que dans ce siècle, où
la civilisation hellénique transformait les moeurs et les
idées romaines, l'esprit national se maintint encore au
théâtre.
VARRON. — LUCRÈCE. — CATULLE.
§ I.
VARRON.
Si l'on jugeait Varron d'après les témoignages de l'antiquité
et du moyen âge, il faudrait lui donner dans l'histoire
des lettres latines une place aussi grande, plus
grande même que celle de Cicéron. Lactance le déclare
supérieur aux Grecs en science, saint Augustin le loue
avec effusion, Pétrarque le place entre Cicéron et Virgile,
et salue en lui «la troisième grande lumière de Rome».
Cet enthousiasme s'explique tout naturellement. Varron
représentait à lui seul toute l'érudition romaine, ses écrits, dont le nombre nous semble prodigieux, étaient le
vaste arsenal où chacun, suivant son goût, pouvait aller
puiser les faits qu'il était désireux de connaître. De tels
hommes sont précieux aux époques où la barbarie commence
et aux époques où elle va cesser. Ce dont on est
affamé alors, ce n'est pas de beau langage, ni de pure fleur de poésie, mais de connaissances exactes et variées.
Varron savait tout et avait écrit sur tout. On disait plus tard de Longin qu'il était une bibliothèque vivante et un
musée ambulant : on l'eût dit de Varron avec bien plus
de raison. Et Varron avait sur Longin cet avantage qu'il
n'avait pas gardé pour lui sa science. La bibliothèque
qu'il portait dans son cerveau, il l'avait publiée, mise en
circulation dans une foule d'ouvrages; enfin il avait essayé
jusqu'à un certain point de sacrifier aux grâces et
de rendre agréable l'érudition.
C'est un Romain de vieille souche. Il y a en lui quelque
chose de Caton le Censeur. Il est Sabin d'origine, né
à Réale, au coeur même de ce rude pays où s'était concentrée
l'énergie patiente de la vieille Italie. Il est né dix
ans avant Cicéron, auquel il survécut de dix-sept ans
(638-727); corps de fer, âme vaillante, à quatre-vingt-dix
ans il écrit encore. Il traverse les crises les plus orageuses
sans défaillir un seul instant : il voit passer tour à tour
Sylla, Pompée, César, Antoine, Octave, et meurt sous
Auguste, entouré de ses livres et de quelques amis épargnés
comme lui par la guerre civile.
D'abord lieutenant de Pompée, pour lequel il compose
des manuels sur la marine et le consulat, il fait avec son
chef la guerre aux pirates, et obtient l'insigne honneur
d'une couronne rostrale. Républicain sincère et sans faiblesse,
il se sépare de Pompée le jour où celui-ci entre
dans le premier triumvirat, et décoche contre les Triumvirs
son pamphlet intitulé : Le Monstre à trois têtes.
Mais il reconnaît bientôt que ce serait folie et peine
perdue de lutter contre la force des choses ; il ne songe
plus qu'à sauver son honneur et sa vie. Envoyé en Espagne
par Pompée, il ne peut lutter contre César. Celui-ci par
sa douceur politique a gagné les coeurs de tous. Varron,
vieux Romain fidèle aux traditions de mépris et de dureté
envers les provinces, se trouve tout à coup abandonné et
forcé de faire sa soumission à César. Il n'assiste pas à la
bataille de Pharsale : Pompée l'avait mal reçu à son retour
d'Espagne. Sous la dictature de César, il se tient à l'écart
: mais le dictateur, ce fin connaisseur d'hommes, rallie
Varron en le priant de fonder d'immenses bibliothèques
publiques. Auguste lui continuera le même emploi. C'était
l'enlever à l'opposition sans lui faire sentir le joug. Après
la mort de César, à laquelle il semble avoir été tout à fait
étranger, Antoine le met sur la liste des proscrits, s'empare
de sa maison, la souille de ses orgies et la met au
pillage. Mais Varron échappe. On se disputa, dit Appien,
le droit de le sauver. Ce fut le dernier orage. Auguste
respecta le vieillard inoffensif, et Varron put mourir en
écrivant. «L'homme n'est qu'une bulle d'air, disait-il,
dans ses derniers jours, et encore plus le vieillard; aussi
faut-il que je me presse, et songe à plier bagage avant de
quitter la vie. »
Varron disait dix ans avant de mourir : « J'ai écrit
quatre cent quatre-vingt-dix livres, » et il continua
d'écrire jusqu'à sa dernière heure. Il portait dans l'érudition
cette opiniâtre ténacité des hommes de sa race
tour à tour laboureurs défrichant les cailloux sur les coteaux
de la Sabine, soldats battus, taillés en pièces par
Annibal, et ne perdant jamais coeur, puis pillards grandioses,
épuisant dans des jeux et des orgies inouïes le
loisir, l'or et les forces dont ils ne savaient que faire.
Varron, lui, fut un engloutisseur de livres.
Tout lui était bon : antiquités humaines et divines,
grammaire, poésie, théâtre, éloquence, histoire, jurisprudence,
astronomie, économie rurale, satires, philosophie :
il avait tant lu et si fidèlement retenu qu'il était en état de dicter sur un sujet quelconque un traité complet.
Presque tout cela a péri pour nous ; nous ne possédons
pas même tous les titres de ses ouvrages. Des fragments
de satires, de philosophie, de grammaire, d'histoire ou
plutôt d'archéologie, et d'économie rurale : voilà tout ce
que le temps a épargné, pas un seul traité complet. Les
deux qui ont le moins souffert du temps sont le de Lingua
latina et le de Re rustica.
Le plus original de ces ouvrages était évidemment les
Satires, intitulées Ménippées. Varron les écrivit dans la
première partie de sa vie, avant d'avoir perdu dans les
fouilles de l'érudition le nerf et l'élan de la pensée. Avait-il
réellement l'intention que lui prête Cicéron (Académiques,
1, 3) de faire accepter aux Romains les enseignements
de la philosophie en les revêtant d'une forme piquante
et chère au génie national ? Cela est douteux.
Varron n'était pas étranger à la philosophie ; mais, en
sa qualité de Romain de vieille souche, il avait un sincère
mépris pour les professeurs de subtilités si à la mode et
si recherchés de son temps. Il y a en lui, comme je l'ai
dit, beaucoup du vieux Caton. Il emprunta aux Grecs ce
personnage de Ménippe, parce que c'était de tous les
vieux cyniques, dit Lucien, celui qui aboyait le plus et
mordait le mieux, surtout ses confrères en philosophie.
Quant à la forme qu'il donna à son oeuvre, elle rappelle
la satire nationale antique, qui était un véritable pot-pourri.
Ennius avait mêlé tous les mètres, Varron mêla
la prose et les vers. Il connaissait à fond et aimait de tout
coeur les antiquités nationales, comme il était le partisan
des anciennes moeurs et le défenseur de la vieille
liberté. Il emprunte aux temps les plus reculés quelques-uns
de ses titres : c'est Tanaquil, Serranus, les Aborigènes : il met en scène le fameux Pappus, ce héros de
l'Atellane
: souvent même des dictons populaires lui servent
de titres : Sardines à vendre. Ne mêlez pas les parfums
aux fèves. La marmite a trouvé son couvercle, ou
du mariage. Grâce au théâtre, le public romain était
familiarisé avec les noms et la personne des héros des
légendes grecques ; Varron les mettait en tête de ses
Satires : il annonçait un Oedipothyeste, un faux Énée,
un Ulysse et demi, les Colonnes d'Hercule ; puis c'était
tout un monde habillé à la cynique, l'orateur, le chevalier,
et une foule d'autres. Tous les personnages lui
sont bons, tous les cadres lui agréent. Il envoie un Romain
de son temps, homme de luxe et de plaisir, chez
les barbares qui lui enseignent la frugalité et la tempérance.
Et, par contre, il ramène à la vie un Romain
contemporain des Gracques, et qui ne reconnaît plus sa
Rome d'autrefois. Il se bâtit à lui-même une autre cité que
celle qu'il a sous les yeux et l'appelle Marcopolis. Là, il
ne rencontre plus les prêtres eunuques de Cybèle, se livrant
aux transports orgiastiques de leurs danses sauvages,
ni les astrologues chaldeéns, ni les thaumaturges
d'Égypte, ni les marchands de philosophie ayant chacun
leur recette et leurs solutions. « Jamais, disait-il, un malade
n'a fait de rêve si absurde qu'un philosophe n'en
ait fait son système. » Puis, à travers ces caricatures de la
vie romaine de son temps, un accent sérieux d honnête
homme, et aussi des réflexions pédantes d'érudit. Il
aime le dilemme, et il en abuse. Voit-il un homme déchirer
ses habits en signe de deuil, il lui dit avec beaucoup
de sens : « Si tu as besoin de tes habits, pourquoi
les déchires-tu ? Si tu n'en as pas besoin, pourquoi les
portes tu ? » Sur le mariage : « Il faut ou détruire ou supporter les défauts de sa femme : celui qui les détruit
rend sa femme plus agréable ; celui qui les supporte
se rend meilleur lui-même. »
Sous le titre général de Logistorici, Varron avait composé
jusqu'à soixante-dix ouvrages différents sur des
matières philosophiques. Il traitait d'après les Grecs et
au point de vue romain toutes les questions imaginables,
passant d'un livre sur la fortune à un livre sur la santé,
sur les nombres, sur la folie, sur le culte des dieux, sur
la paix, sur l'origine du théâtre. Comme il avait imité
Ménippe dans la satire, il intitait Héraclide d'Héraclée
(vers 450) dans les Logistorici. Le philosophe grec
avait adopte la forme du dialogue, mais en même temps
il avait revêtu des ornements de la mythologie les enseignements
de la sagesse ; c'était un attrait
de plus pour ce public grec si amoureux de belles
fables et de subtiles recherches. Varron, plus sévère,
avait remplacé les héros mythologiques des dialogues
d'Héraclide par des personnages empruntés à l'histoire
même de Rome. Ainsi le traité sur l'éducation des enfants
avait pour titre : Cato, de liberis educandis. C'était
évidemment la glorification des anciennes moeurs
opposée à la corruption de son temps : d'autres portaient
les noms de personnages plus récents, comme
Marius, Messala, Tubéron, Atticus, Métellus Pius,
Scaurus, Sisenna, Calenus, etc. Les traités de Cicéron
sur la Vieillesse et l'Amitié, qui portent les noms de
Caton et de Lelius, sont probablement imités de Varron.
Les Romains considéraient comme ouvrages philosophiques
ces dissertations plus ou moins savantes, plus ou
moins ingénieuses sur de petites questions qui seraient
pour nous sans intérêt. J'en excepte, bien entendu, le raité sur l'éducation des enfants. Les fragments conservés
de cet ouvrage nous autorisent à en regretter la perte.
Quant à la philosophie proprement dite, Varron n'avait
eu garde de la négliger. Il y avait consacré au moins
deux ouvrages spéciaux (de Forma philosophiae — de
Philosophia). A quelle doctrine s'était-il attaché? Cicéron
nous dit qu'il tenait pour l'ancienne Académie, représentée
par Antiochus d'Ascalon. Rien n'empêche de l'admettre :
mais n'oublions pas que tous les Romains de ce temps,
sauf peut-être Caton, étaient plus ou moins académiciens,
c'est-à-dire sceptiques et éclectiques à la fois. Ils prenaient
dans tous les systèmes ce qui leur convenait, et
ne se piquaient guère de concilier ces éléments hétérogènes.
Varron, plus érudit que ses contemporains, devait
pratiquer une synthèse plus large. M. Mommsen, qui
n'aime pas les républicains, représente Varron exécutant
pendant toute sa vie la danse des oeufs entre le portique,
le diogénisme (ou cynisme, à cause de ses satires Ménippées)
et le pythagorisme. Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'il recommanda en mourant qu'on l'ensevelît à la façon
des Pythagoriciens, dans un cercueil de briques, avec
des feuilles de myrte, d'olivier et de peuplier noir. Il fut
érudit même par delà la mort ! Quant à la valeur du
traité sur la Philosophie, elle se réduit à peu de chose :
c'était un inventaire de toutes les opinions des anciens
philosophes sur le souverain bien. Les Romains bornaient
volontiers tout le travail de la raison humaine à cette
recherche. Varron avait trouvé et rappelé jusqu'à deux
cent quatre-vingt-huit solutions différentes données au
grand problème !
Je ne parle point des sentences qui portent le nom de
Varron : c'est une compilation apocryphe où tous les uteurs, tous les temps, toutes les idées, tous les styles,
sont confondus.
Le grammairien en lui est beaucoup plus original.
C'était une science qui avant lui n'existait pas. Son maître
Elius Stilon était plutôt un commentateur des anciens
poëtes et des premiers monuments de la langue (le chant
des Saliens, par exemple) qu'un grammairien proprement
dit. Varron étudia la grammaire dans les auteurs grecs,
notamment dans les philosophes stoïciens, passés maîtres
en ce genre. Selon toute probabilité, il avait uni à l'étude
abstraite des lois du langage les recherches particulières
les plus minutieuses sur la langue nationale. Les titres
conservés de ses ouvrages ne laissent aucun doute à ce
sujet. Les lettres, l'orthographe, la synonymie des termes,
l'origine de la langue latine, étaient par lui étudiées à
part dans des ouvrages spéciaux. Un grand traité en vingt cinq
livres, le de Lingua latina, résumait toutes ces observations
de détail. L'auteur, après avoir envisagé les mots
dans leur origine même, les étudiait dans leurs flexions,
ou, comme il disait, dans leurs déclinaisons ; puis dans
leur réunion qui constitue la phrase. Les divers éléments
qui la composent étaient distingués et examinés avec soin.
L'étymologie tenait une grande place dans cette étude :
c'était la passion des Romains d'alors : ils y déployaient
beaucoup plus de subtilité et d'esprit que de véritable
science. Après l'étymologie, venait l'analogie, sujet traité
aussi par César ; et enfin douze livres étaient consacrés
aux lois de la syntaxe. C'était donc un ouvrage d'une
grande étendue, et de plus remarquable par la disposition
de ses parties. Ce que le temps nous a conservé est
malheureusement d'un intérêt médiocre. Il faut bien le
reconnaître d'ailleurs, auprès des grands travaux modernes de philologie comparée, de cette filiation universelle
de tous les idiomes qui tous les jours devient de plus
en plus évidente et ouvre à la science des perspectives
splendides, les travaux les plus estimables de l'érudition
ancienne renfermée en elle-même, étrangère à la connaissance
des langues orientales, méritent à peine d'attirer
l'attention.
Varron n'est pas un historien, c'est un archéologue.
C'est à lui sans aucun doute que nous devons une bonne
partie des inepties dont Denys d'Halicarnasse a farci ses
Antiquités romaines. Varron a recueilli, conservé, rappelé
et même célébré toutes les traditions primitives de
Rome. Il sait les moindres détails du siége de Troie, l'autorisation
donnée par les Grecs à Énée d'emporter ce qu'il
lui plaira de la ville en flammes, l'enlèvement d'Anchise,
puis des Pénates. Il accepte les généalogies héroïques
que les grandes familles se faisaient fabriquer par des
poëtes ou des Grecs affamés ; il croit que les Cluentius
descendent de Cloanthe, compagnon d'Énée. Tout ce
qui peut rehausser la gloire de Rome et de ses premiers
fondateurs, il n'hésite pas à le rappeler : c'est un érudit,
qui ne veut pas laisser perdre les découvertes qu'il a
faites, même dans le pays des chimères. C'est aussi un
patriote, un vieux Romain à qui l'admiration ferme les
yeux au lieu de les ouvrir.
Ses travaux sur les antiquités nationales se divisent en
deux groupes : l'un comprend les antiquités humaines,
l'autre les antiquités divines. Les Antiquités humaines,
qui avaient quarante et un livres, traitaient successivement
des hommes, des lieux, des temps et des choses.
Les voyages d'Énée, les premiers rois de Rome, la géographie
complète de l'Italie ancienne, faite par un homme qui connaissait et aimait de coeur son pays ; des tentatives
ingénieuses pour fixer la chronologie de ces temps reculés,
question qui attirait alors l'attention des Romains ; et
enfin une étude détaillée des institutions et des usages de
la Rome primitive : voilà à peu près quelle était la matière
des Antiquités humaines. Voici les éloges que Cicéron
adresse à Varron au sujet de ce grand ouvrage :
« Nous étions comme des voyageurs errants, des étrangers
dans notre propre patrie ; c'est toi qui nous as ramenés
dans nos demeures : tes livres nous ont fait savoir
ce que nous sommes et en quels lieux nous vivons ; tu as
fixé l'âge de Rome et la date des événements ; tu nous as
enseigné les règles des cérémonies sacrées et des divers
sacerdoces, les usages de la paix et ceux de la guerre, la
situation des contrées et des villes, enfin toutes les choses
divines et humaines, avec leurs noms, leurs caractères,
les devoirs qu'elles imposent et les motifs qui leur ont
donné naissance (1) .»
(1) Cicer. ,Academ., 1, 3.
Les Antiquités divines avaient seize livres et étaient
composées sur le même plan que les Antiquités humaines :
les personnes, les lieux, les temps, les choses, et enfin les
dieux. C'était l'ouvragele plus complet qui eut été écrit sur
la matière. Non-seulement il fut la source où les poètes de
l'âge suivant allèrent puiser leur enthousiasme de commande
pour les dieux nationaux ; mais de plus les Pères
de l'Église ne crurent avoir ruiné le polythéisme dans sa
base que le jour où ils eurent battu en brèche et renversé
ce formidable monument. C'est que Varron ne s'était
pas borné cette fois à compiler et à exposer sur les choses
de la religion tous les documents et toute la science des époques antérieures. Les Antiquités divines étaient une
oeuvre de foi. Je m'explique : Varron ne croyait pas aux
fables débitées par les poètes sur les dieux, leurs amours,
leurs unions ; il ne croyait pas non plus que les statues
et les temples qu'on leur élevait fussent l'hommage qui
leur était dû : mais il croyait à l'influence salutaire et moralisatrice
des institutions religieuses. Émanées de l'État,
réglées par l'État, placées pour ainsi dire par lui comme
la préface nécessaire à tous les actes de la vie civile et
politique, ces institutions ont fait la grandeur de Rome,
et tout bon citoyen doit en souhaiter la conservation.
Voilà le but de l'auteur. Nous retrouvons donc encore ici
en lui un défenseur zélé des anciennes moeurs. Mais
était-ce plaider avec succès la cause de l'antique religion
que de l'exposer dans le plus minutieux détail ?
Varron ne se doutait pas que son livre devait être un
jour une arme terrible entre les mains des chrétiens. Sa
fameuse division empruntée à Mucius Scévola ruinait
dans sa base l'édifice qu'elle croyait soutenir. « Il y a
trois théologies, disait-il : l'une mythique, c'est celle
qu'ont imaginée les poëtes ; elle est propre au théâtre ; la seconde est naturelle, c'est celle des philosophes,
elle est propre au monde; la troisième est civile, elle est
propre à la cité. » Il méprise souverainement la première,
pratique la seconde, et veut que la troisième soit conservée
scrupuleusement. Elle est en effet une partie et
une partie considérable de l'État, un moyen de gouvernement
précieux, un frein salutaire. On voit quel parti
les adversaires du polythéisme purent tirer d'un tel aveu.
Varron représente bien le patriotisme étroit de l'aristocratie
romaine, qui ne voulait que pour elle-même la liberté,
la science et la vérité; dure pour les étrangers, les vaincus, les alliés, pleine de méfiance envers le
peuple, elle l'enfermait au coeur de la cité comme dans
une tour inexpugnable. Le jour vint où un homme appela
au partage des droits politiques tous ceux qui en étaient
exclus, et avec eux renversa la vieille constitution. Il ne
resta debout que la religion. Mais pendant qu'Auguste
et ses successeurs essayaient de rendre la vie à ce moribond,
et prétendaient maintenir chez le peuple des
croyances qu'ils tournaient eux-mêmes en ridicule, le
christianisme appela à lui tous les hommes grands et
petits, et les dieux de l'empire n'eurent plus pour défenseurs
que l'aristocratie qui n'y avait jamais cru.
Le traité de Varron sur l'agriculture (de Re rustica)
porte le même titre que celui de Caton ; mais il en diffère
complétement par la forme comme par le fond. Caton
écrivit un manuel, sans souci d'imaginer et de suivre un
plan quelconque, ni même d'enchaîner les uns aux
autres les préceptes qu'il donne à son fils : le but de
l'ouvrage est d'enseigner à celui-ci à tirer de l'exploitation
d'un domaine le plus de revenus possible: Varron,
a l'exemple de Xénophon et de Cicéron, employa la forme
du dialogue. Il crut par là donner plus d'intérêt à son sujet.
Il le divisa en trois livres : le premier traite des travaux
des champs en général; de la construction de la ferme,
des instruments de labourage, des diverses cultures. Le
deuxième est consacré à l'élève du bétail : le troisième à
la basse-cour, à la garenne, au vivier. L'archéologue et le
partisan des anciennes moeurs se retrouvent encore ici.
Varron évoque le souvenir de ces porchers italiens,
« dont les paroles, dit-il, sentaient l'ail et l'oignon, mais
qui étaient gens de coeur. » Comme Caton, il voudrait
voir ses contemporains revenir aux rudes travaux et aux mâles vertus des Serranus, des Curius Dentatus, souhait
sincère, mais singulièrement naïf. Lui-même n'est-il pas
une preuve des modifications considérables survenues
dans les idées et les habitudes des Romains? Il est plus
savant que Caton, il n'a plus les préjugés ou les niaises
superstitions de son devancier. Il ne borne pas la médecine
à un recueil de recettes et d'incantations magiques.
Enfin il a le coeur plus humain envers l'esclave, que Caton
mettait sur la même ligne que le boeuf. La décadence
dont se plaint Varron avait donc du bon, puisque, grâce
à elle, les esprits s'étaient éclairés, et les moeurs s'étaient
adoucies. Mais les Romains de son temps ne s'occupaient
plus guère des travaux de la campagne. Ils avaient de
belles villas, ornées de statues, de bibliothèques, de
portiques même ; ils allaient s'y reposer des fatigues de
la vie publique : mais ils abandonnaient au fermier et
au colon toute l'agriculture. C'est à cette époque que les
grands domaines se convertissent en bois ou en pâturages : la culture des céréales est abandonnée. C'est du dehors
que l'Italie tire sa subsistance. Varron raille ces moeurs
nouvelles et l'abandon de l'antique tradition : mais
jusqu'à quel point était-il sincère? Que faisait-il lui-même
dans son domaine de Tusculum qui fut souillé et
pillé par Antoine? Il y compilait ses traités laborieux:
on ne voit point qu'il y travaillât aux champs, nu, avec les
esclaves, mangeant et buvant comme eux, ainsi que faisait
le vieux Caton. Il y avait une volière et un vivier : le
vieux Caton eût banni ces superfluités de citadin oisif.
Ces contrastes, je dirai presque ces contradictions, sont
un signe du temps. L'originalité de Varron, s'il en a une,
c'est d'appartenir malgré lui, pour ainsi dire, à une génération
qui a rompu sur tous les points avec les vieilles traditions, et de tenir encore à celles-ci par une sympathie
secrète. Il veut les honorer, les glorifier, les pratiquer
encore; et il le fait jusqu'à un certain point;
mais à chaque instant il s'en sépare forcément. Caton
lui-même n'avait-il pas dû subir l'influence des idées
nouvelles?
§ II.
LUCRÈCE.
Titus Lucretius Carus.
Ce n'est pas la vie de Lucrèce qui nous aidera à comprendre
son oeuvre. Nous ne savons au juste ni la date
de sa naissance ni celle de sa mort. Suivant une tradition
romanesque, il écrivit son poëme dans les intervalles
lucides que lui laissait la folie; et cette folie fut occasionnée
par un philtre amoureux que lui donna sa maîtresse.
On le représente aussi étudiant la philosophie
épicurienne à Athènes, sous Zénon, uniquement sans
doute parce que Zénon vivait à celte époque. Laissons là
toutes les conjectures plus ou moins ingénieuses, mais
qui importent peu. Si l'homme nous échappe, nous
avons le poëte; de plus nous avons le temps où il a
vécu.
Il est contemporain de tous les grands hommes de la
fin de la république : né vers 655, mort vers 699, il a
connu Cicéron, Varron, César, Pompée, Salluste, Catulle.
Appartenant à une famille distinguée, il a reçu l'instruction
riche et variée que recevaient ses contemporains. De
bonne heure il connut tous les systèmes philosophiques
de la Grèce, représentés alors à Rome par une foule de maîtres illustres ; il fit un choix et s'attacha à l'épicurisme.
Son poëme de la Nature des choses (de Rerum natura)
est le fruit de ces études et de cette préférence.
L'ouvrage est dédié à Memmius (C. Memmius Gemellus),
descendant d'une famille illustre, un des personnages
les plus remuants de cette époque singulièrement
orageuse. Il était le neveu de ce fameux C. Memmius, à
qui Salluste prête les disconrs les plus violents contre la
faction des nobles. Il semble lui-même avoir été un fougueux
adversaire de Lucullus, dont il voulut empêcher
le triomphe. Préteur en Bithynie, puis tribun du peuple,
il échoua dans la poursuite du consulat, fut accusé
de brigue et condamné à l'exil. C'est à Athènes qu'il alla
passer les dernières années de sa vie. Il voulut s'y construire
une maison sur une partie du terrain où se trouvaient
encore les jardins d'Épicure. C'était un orateur
distingué, âpre et mordant. Très versé dans la connaissance
de la littérature grecque, il n'avait guère que du
dédain pour les écrivains et les ouvrages de son pays.
A quel moment de sa vie reçut-il la dédicace du poëme
de Lucrèce? Sans doute avant son exil; car le poëte, dans
une allusion rapide aux troubles de la république, se
refuse à croire que l'illustre descendant des Memmius
puisse abandonner en de tels périls la cause de la patrie.
Il l'abandonna bientôt, ayant succombé dans la lutte; et
peut-être le fit-il sans regrets, car c'était un véritable
épicurien, j'entends un épicurien pratique, un homme
de plaisirs, peu capable sans doute d'apprécier et de partager
l'ardent enthousiasme de son ami.
Le poëme est divisé en six livres ; malgré quelques lacunes
dans le premier et dans le sixième, il est fort probable
que nous possédons l'oeuvre entière de Lucrèce, telle du moins qu'il l'a laissée à sa mort. On ne peut méconnaître
l'ordre et l'enchaînement des parties.
Le premier livre est consacré aux atomes, corpuscules
invisibles, qui sont le principe de tout ce qui existe, car
rien ne peut naître de rien. Il réfute à ce propos les
hypothèses méprisables des philosophes qui voient dans
les quatres éléments le principe et l'origine des choses. Le
monde est infini, les atomes sont innombrables, le vide
n'a pas de bornes. Mais comment les atomes ont-ils
formé les êtres ? En se combinant dans le vide, en vertu
de certaines lois qui président à leur rencontre et résultent
de leur forme et de leur nature. Parmi les principales
créations des atomes se trouve l'âme, dont Lucrèce
démontre la matérialité, et qu'il identifie parfois
avec le souffle (anima-animus). Elle n'est pas localisée
ici ou la ; elle est répandue par tout le corps. Elle doit
donc périr avec lui. C'est une loi naturelle; les insensés
seuls peuvent s'en affliger et la redouter. Ici se placent
les éloquentes invectives du poëte contre la lâcheté
humaine, contre les terreurs d'une autre vie qui est impossible.
Le quatrième livre est consacré à l'explication des
opérations des sens; c'est par les sens que toutes les
idées s'acquièrent. De la surface des corps se détachent
sans cesse des particules invisibles, des simulacres, qui en frappant les sens, donnent la connaissance des
objets dont ils sont comme une émanation. C'est ainsi
qu'il explique encore les rêves et les passions, surtout
l'amour. L'objet aimé envoie un perpétuel rayonnement
dont on est pénétré et comme enchaîné. Servitude
cruelle le plus souvent, et qu'il faut briser ! Mais
comment le faire? En combattant le mal par le mal. Comme Buffon, comme Rousseau (Discours sur l'origine
de l'inégalité parmi les hommes), Lucrèce veut réduire
l'amour à une fonction physique : mais quelle tristesse
poignante dans la peinture des désordres qu'il occasionne !
Est-ce le physicien qui parle, ou un coeur blessé qui ternit?
Il expose ensuite ses idées sur la formation du
monde, qui a eu un commencement et qui aura une fin.
Il détermine la place et les fonctions de la terre, de l'air,
de l'éther, du soleil, de la lune, des astres, dans le système
général des choses, et essaye de démontrer que les
corps célestes n'ont pas un volume supérieur aux proportions
que nos yeux leur assignent. C'est la partie la plus faible
(avec la négation des antipodes) de la physique épicurienne.
L'originalité réelle de ce cinquième livre est
l'histoire des productions de la terre, dont la fécondité
naissante donne la vie aux plantes, aux fleurs, aux arbres,
aux animaux et enfin à l'homme lui-même. Il apparaît,
ce roi de la nature, au moment où la terre encore humide,
tout enveloppée de chaudes vapeurs, lance à sa surface
des myriades d'êtres. Le poëte montre ces premiers-nés de
la Mère commune, corps gigantesques, dont la solide charpente
est mue par des muscles d'une force merveilleuse :
les voilà comme perdus au sein de l'immensité, rencontrant
à chaque pas un obstacle ou un ennemi. Ils dévorent les
glands des chênes, les fruits de l'arbousier ; quand la nuit
les surprend au sein des vastes forêts, ils étendent leurs
membres sur le sol et ramènent sur eux les feuilles tombées.
Le lion, le tigre, le sanglier, tous les monstres des
bois rôdent autour d'eux, les saisissent dans leur sommeil,
les emportent criant et se lamentant. Puis ils se
rapprochent, ils s'unissent ; la femme donne naissance à
l'enfant, la famille est constituée par l'amour d'abord, puis par la pitié. Ces sauvages, ne sachant encore parler,
se montrent les uns aux autres leurs petits et conviennent
d'épargner les êtres sans défense. Ne poussons
pas plus loin cette analyse ; ce que nous avons dit suffit
pour faire apprécier la force et la beauté de cette conception.
Nous voilà bien loin du joli et fade roman de
l'âge d'or, lieu commun des poëtes antérieurs. Lucrèce
a retrouvé, on peut le dire, l'histoire des premiers humains,
et il l'a décrité avec une vigueur qui fait pâlir
les tableaux puérils des Ovide et de tant d'autres. Rousseau
lui-même, si âpre et si énergique, languit auprès de
cette poésie sombre et profonde.
Le sixième livre est consacré aux météores, sujet fort
important, puisqu'il donne au poëte l'occasion d'expliquer
les causes des phénomènes célestes, source éternelle
d'épouvante pour les hommes. Les nuages, la pluie,
la foudre, l'arc-en-ciel, les tremblements de terre, tout
est rapporté à des causes naturelles. Le merveilleux, l'intervention
et le courroux des dieux sont bannis du
monde. La paix rentre dans le coeur des mortels. C'est en
expliquant la cause des exhalaisons fétides qu'il est conduit
à décrire, d'après Thucydide, la fameuse peste
d'Athènes.
Sous quelque aspect que l'on envisage ce poëme, unique
dans la littérature romaine, il est impossible de ne
pas être frappé d'abord de la passion profonde qui l'inspire
et le soutient. Ceci est une oeuvre de foi. Les contemporains
de Lucrèce étudiaient en amateurs les systèmes
de la Grèce, et concluaient pour la plupart à un scepticisme
superficiel ou à un éclectisme facile qui n'engageait
en rien la conscience. Lucrèce a l'enthousiasme
et l'esprit de propagande : comme il possède la vérité, cette lumière de l'intelligence, et avec elle la vraie vertu,
cette santé de l'âme, il veut communiquer aux autres ces
biens inestimables, les arracher aux erreurs, aux préjugés,
aux infirmités morales, pour les associer à la
félicité pure qu'assure sa doctrine, et les entraîner à sa
suite dans ces temples lumineux et sereins où résident
les sages. Vous reconnaissez ici le Romain, homme pratique,
même dans les spéculations sur le monde et la
nature, comme Cicéron, comme Varron, comme tous les
Romains de ce temps. Lucrèce, lui aussi, a retourné en
tous sens le problème du souverain bien ; et de toutes les
solutions données par les écoles, il a préféré celle d'Épicure.
La conviction est en lui : seul sur le rivage, sans
crainte de la tempête, il voit le reste des hommes ballottés
par les flots, et il leur tend la main et les appelle à lui.
Jamais voix plus pressante ne s'éleva dans un moment
plus solennel. Sous les dehors brillants de la société d'alors couvaient
de grandes misères. De la vieille constitution
républicaine, le squelette seul est debout; le règne de
l'aristocratie conservatrice touche à sa fin, Caton et
Cicéron le sentent bien; la domination de César apparaît
dans un lointain que les fautes et l'opiniâtreté de ses
adversaires rapprochent tous les jours. Les esprits inquiets
pressentent l'explosion de la guerre civile. Le
souffle de la grande révolution a passé sur les âmes; Lucrèce
entend déjà les sourds grondements qui annoncent
la catastrophe. Les uns s'enveloppent fièrement de leur
vertu, certains de tomber, mais plus certains encore de
tomber noblement; d'autres calculent et se préparent à
tous les événements. Quelques-uns cherchent dans les
voluptés l'oubli des préoccupations pénibles. C'est à cette
société menacée et malade que s'adresse Lucrèce : il veut la sauver et la guérir en la convertissant à la sagesse.
Triste sagesse ! Quelques-unsla partageaient déjà, et, pour
se soustraire au grand naufrage, refusaient de monter
sur le vaisseau. Si Lucrèce avait persuadé ses contemporains,
tous eussent fait ainsi, et la tâche de César eût
été plus facile. Mais cette lâche sagesse qui préfère le repos
à la liberté, elle ne triompha qu'avec l'empire, quand
il n'y eut plus d'espoir dans les choses, ni de ressort dans
les hommes. L'épicurisme était le fruit naturel d'une telle
époque. En politique abdication, en religion athéisme
peu courageux, en morale égoïsme perfectionné : voilà ce
dont Caton ne voulait pas, voilà ce qui suffit aux sujets
d'Auguste et de ses successeurs. Mais laissons de côté les
conséquences, et voyons la doctrine.
Elle est empruntée à la Grèce dans ses principes essentiels.
Lucrèce a pour maîtres Empédocle et Épicure; mais
ce qui est bien à lui, c'est la manière dont il l'expose et la
passion qui l'anime. La philosophie pour lui n'est pas une
occupation d'oisif, il a un but. Le plus grand ennemi du
bonheur des hommes, c'est l'idée fausse qu'ils se font de
la divinité, et les terreurs qui en sont la conséquence.
Lucrèce veut dégager l'âme de ces terreurs. Il prouvera
donc que la puissance attribuée aux dieux est imaginaire ;
que la nature obéit à ses lois et non aux caprices de ces
prétendus maîtres que l'erreur lui impose. Ce n'est pas
Jupiter qui lance le tonnerre, qui est l'auteur des phénomènes
célestes : des lois immuables régissent ces manifestations.
Si Jupiter lançait la foudre, pourquoi tomberait-elle souvent sur les temples mêmes du Dieu ou
dans les plaines arides, ou sur un arbre innocent? Non.
Les dieux sont étrangers à ces grands faits de l'ordre
naturel. Les dieux n'ont pas fait le monde : s'ils l'eussent fait, y rencontrerait-on toutes les imperfections dont il
est plein? Ce ne sont pas eux qui le conservent, ce ne sont
pas eux qui le feront tomber en poussière ; ce ne sont pas
eux non plus qui dirigent le cours des choses humaines :
trop d'iniquités y abondent. Laissons donc les dieux dans
cette sphère inaccessible où ils jouissent d'une béatitude
inaltérable, indifférents à tout, sauf à leur propre félicité.
Ne leur adressons plus ni voeux ni hommages ; ils ne peuvent
exaucer les uns, et n'ont nul besoin des autres. Si
l'homme est bien persuadé de ces vérités, aussitôt les
vaines terreurs qui désolent son âme s'évanouissent ; les
éclairs, la foudre, tous ces prétendus signes de la colère
céleste n'excitent plus en lui la moindre inquiétude ; il ne va
point, tremblant et la tête voilée, se prosterner devant une
pierre insensible, égorger des animaux, consulter leurs
entrailles, pâlir de peur à l'aspect des indices du courroux
céleste. La vraie piété, c'est la raison, c'est la ferme assurance
du sage. La religion, fille de l'ignorance et de la
peur, a causé toutes les misères de l'humanité. N'est-ce
pas elle qui a poussé les chefs de la Grèce à égorger aux
pieds des autels la jeune Iphigénie?
Il faut donc enseigner aux hommes la formation du
monde, la loi des phénomènes, leur expliquer l'universalité
des choses. Quand ils posséderont la vérité, ils seront
guéris de leurs vaines terreurs, ils seront heureux. Le
poëte se met courageusement à l'oeuvre, et il expose en
longs développements les doctrines d'Empédocle et d'Épicure
sur le monde. Malgré quelques inexactitudes de
détail, des explications peu plausibles, des infidélités assez
graves à ce système dont il s'est fait l'interprète, cette partie technique, pour ainsi dire de l'oeuvre, est fort belle,
et tout à fait nouvelle, chez les Romains. Je n'y insisterai
pas. Mais je ne puis passer sous silence un des principaux
résultats obtenus par le philosophe : c'est sa démonstration,
de la matérialité et de la mortalité de l'âme.
Cette conquête du néant le ravit. Comme toutes les choses
créées, l'âme est composée d'un agrégat de molécules qui
se dissoudront, et retourneront dans le grand mouvement
qui emporte les atomes. Si donc l'âme n'est pas autre
chose qu'une partie de nous-mêmes, comme le pied et
la main;
si elle doit périr comme le dernier de nos membres, que
signifient ces vaines terreurs d'une autre existence dont
l'homme insensé est assailli ? Quoi ! craindre les dieux
pendant sa vie, et, après sa mort, l'Achéron, le Styx, le
Tartare, les Furies et les supplices réservés aux impies,
ce serait là le triste lot de l'humanité ! Non : tout meurt
avec le corps. La mort est le repos éternel. Pourquoi la
redouter? Était-on malheureux de n'être pas encore?
Pourra-t-on être malheureux en n'étant plus? La cessation
de l'existence est une loi naturelle. Tout meurt dans
la nature : quel orgueil, quelle folie d'opposer à cette nécessité
universelle ses plaintes et son désespoir ! Épicure
lui-même est mort, et toi, chétive créature, tu te révolterais
contre ta destinée !
Comment donc devra vivre l'homme débarrassé de la
crainte des dieux et des terreurs de l'enfer ? Il vivra conformément
à la nature. Elle réclame peu de chose ; les
besoins du corps sont satisfaits à peu de frais ; plus doux
cent fois est le sommeil sur l'herbe aux bords d'un frais ruisseau que sous les lambris dorés. Les grands ennemis
de l'homme, ce sont les passions, les désirs insatiables, la
poursuite effrénée des faux biens, tout ce qui trouble
l'âme, et l'empêche de goûter cette bienheureuse quiétude,
fruit de la raison et de la sagesse. La volupté, c'est l'art
de jouir de tous les biens que comporte la nature humaine,
sans excès et sans trouble. La vertu n'est pas autre chose
non plus que cette sage volupté : vertu, sagesse, félicité,
les trois choses se confondent, et le souverain
bien est trouvé!
Tel est le philosophe. Venons au poëte.
Il ne paraît pas que les anciens l'aient estimé autant
qu'il le mérite. Cicéron qui, suivant saint Jérôme, serait
l'éditeur du poème de la Nature des choses, y trouvait
beaucoup d'art, mais peu d'éclat : Quintilien se borne à
l'épithète difficilis, qui n'est pas un éloge : mais les jugements
de Quintilien sur les poëtes ne sont pas d'un
grand poids. Ovide promet l'immortalité à Lucrèce qu'il
appelle sublime. Stace seul semble l'avoir senti. « Il a, dit-il, la science, l'enthousiasme et l'élévation : » Comme la Pauline de Corneille,
il semble toujours prêt à s'écrier :
Je vois, je sais, je crois, je suis désabusé.
Il n'a que du mépris pour les machines poétiques en
honneur de son temps. Le convenu et l'artificiel lui répugnent.
Il ne chantera pas des dieux qu'il relègue dans les
intermondes, il ne s'épuisera pas à refaire d'après les Grecs
leur légende héroïque et amoureuse. Il est grave, solennel, ému. Il vit en contemplation de la vaste nature, sa
seule divinité ; il en perçoit la majesté et l'infinie puissance.
S'il est disciple des Grecs, c'est aux maîtres les
plus sérieux qu'il s'attache, Empédocle et Thucydide.
Les agréables badinages des fables, la grâce molle et pédante
des Alexandrins, il laisse à d'autres tout cela. Et, en
réalité, il y a cent fois plus de grandeur dans la conception
cosmogonique d'Empédocle que dans l'anthropomorphisme
puéril où s'attardaient les poëtes du temps. Ce
n'est point parmi eux, c'est dans le sixième siècle qu'il
faut lui chercher des pairs. Lucrèce se rattache directement
à Ennius. C'est de tous les poëtes latins le seul
qu'il cite : une parcelle de l'héroïsme du vieux poëte a
passé en lui, héroïsme scientifique, cette fois : « Notre
Ennius, dit-il, le premier qui sur le vert Hélicon ait cueilli la couronne d'éternel feuillage. » Lui aussi, il
sera le premier propagateur de la vérité. « Il parcourt les lieux inaccessibles où nul pied humain n'a laissé sa trace ; il aime à aller puiser aux fontaines vierges, à
cueillir des fleurs inconnues pour s'en faire une couronne dont nul poëte n'ait encore entouré ses tempes. »
Dur et pénible labeur que le sien : il annonce des choses
nouvelles, obscures, et il n'a à son service qu'un idiome
rebelle et pauvre :
Propter egestatem linguae et rerum novitatem.
Il empruntera des termes à la Grèce, puisqu'il le faut ;
mais l'empreinte du génie national sera sur son oeuvre.
Il sera soutenu par la beauté du but d'abord, puis par
l'espérance de la gloire " qui d'un thyrse aigu a frappé
son coeur, et jeté dans son âme le doux amour des muses". Tel est l'enthousiasme d'Ennius, le grand novateur. Il vit par la pensée dans cet héroïque sixième siècle : il
en a l'orgueil démesuré et le fier accent. S'il peint en
quelques vers une bataille, son esprit se reporte aux
grands combats avec les Carthaginois ; il revoit les horribles
mêlées d'alors ; « les légions bouillonnant dans les plaines, entonnant le cri de guerre, appuyées sur les
« fortes troupes alliées et les éléphants, en parure de
combat, puissantes, animées à l'envi. » Il a l'inspiration
haute et forte. Il peint vivement et à grands traits,
n'ayant nul souci de l'élégance qui amollit la pensée.
Absorbé par l'ingrat labeur d'une exposition technique,
il sent et voit si directement les objets, qu'il les projette
en relief splendide. Aussi bien il a son Dieu qui l'inspire ;
lui aussi est anthropomorphiste à sa façon : c'est la nature
qui remplace Jupiter, Neptune, Apollon. Il la voit, la sent,
l'aspire et la personnifie sans le vouloir. Son effrayante
fécondité qui crée sans cesse et tire de son sein inépuisable
les animaux, les plantes; tout ce fourmillement de
vie qui s'épand à l'infini, il l'oppose au rude labeur de
l'homme qui veut conquérir la terre : qu'il cesse pendant
une année de déchirer et de retourner le sol, la nature
va le couvrir de ronces et le reprendre pour elle.
Son style a quelque chose de cette végétation puissante
et désordonnée. Ce sont des jets vigoureux et sauvages.
Pas la moindre concession au rhythme et à l'harmonie
; partout et toujours le mot propre. De là un
incroyable sans-façon dans la manière dont il traite le
vers : il le termine par des spondées, des monosyllabes,
peu lui importe. Il a des élisions impossibles et des coupes
d'une audace sans pareille : à côté de cela, des vers d'une douceur et d'un charme infinis, des expressions d'un éclat
et d'une vérité dont rien n'approche. C'est un flot d'or
épais hérissé de scories. Virgile l'étudiera, le pillera, sans
l'appauvrir et sans le faire oublier.
§ III
CATULLE.
Catulle (Quintus Valerius Catullus) est né en 667, à
Vérone ; il est mort en 700. Il appartenait à une de ces
familles nobles de province, fort estimées dans leurs pays et même à Rome. Son père était l'hôte de Jules
César. Conduit de bonne heure à Rome par Manlius,
Catulle connut particulièrement Cicéron auquel il adressa
un remerciement en vers, sans doute à l'occasion d'un
procès où l'orateur plaida pour le poète, Cornélius Népos,
César, Hortensius, et tous les citoyens les plus illustres
de ce temps. Il n'exerça aucune fonction publique. Cependant
il fit à la suite du prêteur Memmius, celui-là
même à qui Lucrèce dédie son poëme, un voyage en
Bithynie, sur lequel il comptait pour rétablir sa fortune.
Son espérance fut déçue, il en revint aussi pauvre qu'avant
« la bourse pleine d'araignées », comme il dit lui-même.
De plus, il eut la douleur d'y perdre son frère
qu'il aimait tendremént et dont la mort lui a inspiré ses
plus belles élégies. Il mourut vers l'âge de 33 an dans
le plein épanouissement du plus aimable génie.
Ses poésies en un seul livre, adressées à Cornélius Népos,
se composent de cent seize pièces, placées sans ordre
à la suite les unes des autres. On y trouve des épigrammes,
des odes, des élégies, des fragments d'épopée, une grande
variété de mètres et de sujets. Il est fort probable que ce
recueil est incomplet. Pline parle d'un poëme sur les
incantations (de incantamentis), qui ne nous est pas parvenu; quelques auteurs ont attribué à Catulle les deux
poëmes de Ciris et du Pervigilium veneris, mais à tort.
Voilà tout ce que peut nous apprendre sur Catulle
l'histoire littéraire. Ajoutons cependant que ses contemporains
et toute l'antiquité en faisaient le plus grand
cas. Ovide, Tibulle, Martial, lui décernent l'épithète
d'homme savant, éloge qui paraîtrait bizarre, si
nous n'en faisions comprendre la signification. Un poëte
savant, aux yeux des Latins, était un poète qui avait su, à force d'art et de travail, faire passer dans l'idiome national
les beautés des modèles grecs. Catulle a évidemment
ce mérite, mais ce serait singulièrement le méconnaître
que de borner là sa gloire.
Replaçons-le dans le milieu où il a vécu, milieu social
d'abord, milieu littéraire ensuite.
Ce que nous appelons aujourd'hui le monde commençait
à exister à Rome. La vie du monde commence le
jour où les femmes ne sont plus condamnées à garder la
maison, en compagnie de leurs esclaves, vouées aux
soins du ménage. Dès le milieu du septième siècle, la
matrone est émancipée : elle l'est par la libre possession
de sa fortune et par le relâchement de l'ancienne discipline.
Elle reçoit et rend des visites. Elle assiste aux
spectacles, aux festins qui se prolongent fort avant dans
la nuit. L'été venu, elle va aux bains de mer, à Baïes,
escortée de ses amis : ce sont des promenades sur l'eau,
des fêtes continuelles. Le gros mot d'adultère est abandonné
aux juristes ou aux opiniâtres représentants des
vieilles moeurs. On peut déjà dire de la société de ce
temps-là ce que dira plus tard Tacite : « Corrompre et
être corrompu,c'est vivre selon le siècle. » La ville offre
aux jeunes gens des amours plus faciles encore : s'ils veulent
sortir du monde, ils en trouvent un autre : de
belles et brillantes courtisanes tiennent une véritable
cour, puis il y a les affranchies, et ce qui vient immédiatement
après elles. On peut voir dans le plaidoyer de
Cicéron pour Caelius jusqu'où pouvait aller la licence
permise à la jeunesse. Catulle appartient à la fois à
l'un et à l'autre monde. Il est l'ami et le compagnon
de tous ces jeunes Romains qui, en attendant l'âge de
briguer les honneurs publics, consument leur temps dans les plaisirs. Réunions joyeuses, festins, parties de débauche,
confidences réciproques sur les amours, lectures
de vers badins, ou d'épigrammes aiguisées contre un
rival ; un mari incommode: voilà les passe-temps de cette
société élégante et dissolue. Les uns disaient adieu à ces
folies et se jetaient dans le tourbillon de la vie publique ;
les autres y restaient attachés jusqu'à la mort, qui venait
plus vite pour eux que pour leurs anciens compagnons.
Catulle fut de ces derniers. Il n'a vécu que pour le plaisir
et les vers. Il a chanté ses amours en véritable amant
et en véritable poëte : sa Lesbie, qui n'était autre que
Clodia, la soeur du turbulent Clodius, est immortelle.
« Je hais et j'aime, » disait Catulle, victime de plus d'une
infidélité qu'il lui fallait bientôt oublier et pardonner.
Lesbie avait tant de grâce et d'esprit ! Voyez ce petit tableau
d'intérieur : la femme, le mari, l'amant. « Lesbie, en présence de son mari, me dit une foule de choses
désobligeantes: le sot en ressent la joie la plus vive. 0 mulet, tu ne comprends donc rien ! si elle m'avait oublié, si elle se taisait, elle serait guérie de notre amour ; mais la voilà qui cause,qui bavarde : c'est qu'elle se souvient ; mieux encore, elle est irritée : donc elle brûle. » Il célèbre aussi en bon ami les maîtresses de
ses amis. Celle de Varus, qu'il ne nomme pas, indiscrète
personne qui demanda un jour au poëte revenant de
Bithynie des porteurs pour sa litière, celle de Calvus,
Quintilia, celle de Septimius, Acmè, celles de Caelius et
de Quintius. Il a aussi des vers charmants pour chanter
les douceurs de l'amitié, et la joie du retour au foyer
paternel, après les longues et cruelles déceptions du
voyage en Bithynie. Mais ses vers les plus touchants sont
ceux que lui inspire la mort de son frère. Le poëte léger et insouciant a été atteint d'un deuil sérieux, sa blessure
est profonde. Un sentiment nouveau, la douleur, et la
douleur sans espoir fait vibrer en son âme une corde inconnue
à lui-même. Mais nous ne possédons pas encore
l'homme tout entier. Il ne s'est point mêlé aux agitations
de la vie publique ; mais il n'est point indifférent. C'est
un provincial qui ne pardonne point aux grands de Rome
leur insolence et leur dureté envers les étrangers. Il
rappelle par ce côté Lucilius. S'il n'a pas le souffle puissant
du poëte indigné, s'il ne peut composer et soutenir
tout un poëme satirique, il sait du moins décocher le
trait acéré de l'épigramme. La vie privée de César, le
spoliateur de la Gaule, de l'Espagne et de la Bretagne,
l'élévation aux dignités de la république des viles créatures
du grand homme, Catulle a flagellé tous ces désordres
en vers rapides mais saisissants. Il n'a pas épargné
non plus les ridicules plus innocents de ses ennemis ou de
ses rivaux en amour. Sa plaisanterie est sanglante, le
plus souvent obscène et intraduisible. Voilà l'homme, et
voilà un des côtés du poëte. Ses vers sont une image vivante,
ou plutôt une miniature achevée de la société
d'alors, c'est la partie la plus originale de son oeuvre :
ces vers de circonstance nés au jour le jour, expansion
des sentiments à mesure qu'ils naissent, ont une saveur
particulière. Tout l'art d'Horace ne nous rendra
pas cette franche poésie : il lui manque l'élévation et
la force créatrice, mais elle a la vérité, la couleur, la
vie.
Je suis moins touché, je l'avoue, de l'autre partie de son
oeuvre, la partie savante, disons mieux la partie artificielle.
Les contemporains et l'âge suivant admiraient
surtout le docte Catulle, imitateur achevé des Grecs; j'aime mieux le Catulle latin. J'ai parlé du milieu moral,
voyons le milieu littéraire.
Dans la seconde moitié du septième siècle, Rome posséda
un nombre considérable de poëtes aujourd'hui perdus
et peu regrettables probablement. Tout Romain instruit
faisait des vers, et les faisait bien. Cicéron, Varron,
César, l'orateur Hortensius, l'orateur Calvus, pour ne
parler que des plus connus, en faisaient, c'était une mode.
Catulle comptait parmi ses amis un grand nombre de
poètes: Hortensius, Calvus, Furius Bibaculus, Valerius
Caton, Lævius, Helvius Cinna. Il est le chef et le roi de
cette pléiade : il a seul survécu, parce que seul il a joint
à la pureté de la forme et à l'élégance de l'expression la
passion vraie, qui fait le poëte. C'est par là qu'il s'est
élevé au-dessus des versificateurs de salon avec lesquels
il vivait. Tous procèdent de l'Alexandrinisme. Imitateurs,
comme tout vrai Romain doit l'être, ils ne vont pas chercher
leur modèle dans la pure antiquité grecque ; ils le
prennent tout près d'eux parmi les poëtes contemporains
ou de l'âge précédent, qui ont vécu en Égypte. Les poëtes
alexandrins, sorte de regain du genre grec, avaient compris
que les genres sérieux leur étaient interdits : ils n'abordèrent
en conséquence ni l'épopée, ni le drame, ni la
haute poésie lyrique ; ils se bornèrent aux oeuvres de
courte baleine ; ils aimaient surtout les compositions
mélangées de chant et de récit, la petite épopée ltéroico-érotique, et l'élégie amoureuse : celle-ci était leur
triomphe. La nature du sujet leur permettait des rapprochements
ingénieux avec les antiques légendes, et ils
étaient fort érudits. Dépourvus d'inspiration élevée, ils
excellaient dans les pièces de circonstance, notamment
l'épigramme. Ils savaient jeter en passant une allusion spirituelle, un trait plaisant ; ils trouvaient des expressions
délicates, rares surtout et inintelligibles pour le
commun des lecteurs. C'était une poésie d'érudits et de
courtisans. Voilà les modèles qui s'imposèrent aux Romains.
Il n'était pas fort difficile de les imiter. Les élégies
amoureuses d'Euphorion, qui furent répandues à profusion
à Rome vers la fin du septième siècle, firent naître
une foule de contrefaçons en latin : toute la société
polie raffola de ces petits poëmes, et s'exerça à en composer
de pareils ; on tourna en vers un compliment, un
bonjour, une invitation à dîner. Il se forma des cercles
littéraires ; on se réunit pour se communiquer une épigramme,
une élégie ; on s'adressa des compliments en
vers ; on fit des vers sur une pièce de vers qui avait réussi.
Il y eut à Rome à peu près l'équivalent de notre hôtel
de Rambouillet. Le joli, le gracieux, le piquant y étaient
les qualités requises de tout poëte.
Il faut bien le reconnaître cependant : de même que
nos précieuses épurèrent la langue, il se fit dans les cercles
littéraires de ce temps un travail sérieux sur
l'idiome national. La langue des vers manquait absolument
de souplesse et de grâce : Lucrèce lui-même, ce
puissant génie, en est le plus souvent dépourvu. Catulle
et ses contemporains adoucirent les aspérités du vieux
langage ; ils créèrent la versification qui, à vrai dire,
n'existait pas; ils eurent un sentiment juste et délicat de
l'harmonie et du rhythme. Sans idées, sans inspiration
originale, ils mirent leur gloire à lutter contre les grâces
infinies et la perfection de forme de leurs modèles grecs.
Ce furent d'habiles artistes. Catulle resta leur maître
même en ce genre, et il eut de plus sur eux la supériorité
du sentiment vrai. Catulle relève donc des poëtes Alexandrins. Ses pièces
les plus longues et les plus admirées des faiseurs d'extraits
sont des traductions. Tel le poëme en quatre cent neuf
vers, intitulé Epithalame de Pélée et de Thétis, composition
héroico-épique, où le poëte a entassé tous les souvenirs
de mythologie qu'il put évoquer : l'expédition des
Argonautes, la légende des amours de Thésée et d'Ariane,
un chant d'hymen, une prédiction de la naissance d'Achille.
Telle encore l'élégie héroïque sur la chevelure de
Bérénice, imitation presque littérale de Callimaque
l'Alexandrin : tel enfin le poëme en vers galliambiques,
intitulé Alys, peinture assez éloquente et dramatique du
deuil de la déesse qui a perdu son amant et du culte
orgiastique que lui rendent ses ministres. L'épithalame
de Manlius et d'Aurunculeia est à la fois une imitation
et une oeuvre originale : c'est un remarquable morceau
de poésie lyrique ; et le chant nuptial qui suit, en vers
hexamètres, est d'une belle venue. Les gracieuses et libres
images de l'amour sont tempérées par le sérieux de
l'union conjugale : le grec et le romain se sont unis dans
cette oeuvre. Ce n'est pas assez de dire comme Barthius,
« qu'elle est écrite par la main de Vénus et des grâces, »
il faut ajouter qu'elle est profondément chaste.
L'histoire. — Depuis les origines jusqu'à Tite-Live. — Sources de l'histoire. — Les premiers historiens. — César, Salluste.
§ I.
César et Salluste sont les premiers historiens dont les
ouvrages nous soient parvenus, et ces ouvrages ont été
composés dans les premières années du huitième siècle.
Tout ce qui précède a péri, ou il n'en reste que des
fragments de peu d'étendue, ou de simples indications.
Je ne crois pas utile de dresser, d'après Krause, un catalogue
de ces historiens perdus, travail facile et fastidieux.
Je me borne à indiquer les sources où puisèrent
les écrivains de l'école classique. Ce sera indiquer du
même coup les plus anciens monuments de l'histoire,
et les moyens employés par les Romains des premiers âges
pour conserver le souvenir des événements.
Tite-Live avoue que l'authenticité des faits qui constituent
l'histoire des premiers siècles de Rome ne repose
guère que sur des traditions où la fable se mêle à la
vérité, et l'on sait que la critique moderne rejette
presque toutes ces légendes. Cependant il existait encore
du temps de Tite-Live quelques documents authentiques
qu'il a pu consulter. Les voici suivant l'ordre chronologique. Dès les temps les plus anciens, on conservait dans les
temples ou dans les maisons des plus illustres citoyens,
des tables de plomb, d 'arain, de bois, de pierre, ou des
peaux sur lesquelles étaient inscrits les traités, les lois,
les décrets du Sénat, et autres monuments. Il existait
encore à ce qu'il paraît de ces tables commémoratives
sous Vespasien. Tels étaient les traités conclus avec les
Carthaginois, Porsenna, les Gabiens, les Ardéates, et les
monuments fort incertains appelés Commentarii regum,
Leges regiae. Les plus importants de ces documents
étaient les grandes Annales, Annales maximi. Elles
se composaient de quatre-vingts livres, et allaient jusqu'au
Pontificat de P. Mucius Scévola (a. U. 624). C'étaient des
tables sur lesquelles le grand Pontife inscrivait les noms des principaux magistrats et les événements les plus
mémorables. On croit en découvrir quelques traces dans
Tite-Live.
Les Commentarii pontificum renfermaient les détails
du culte, les rites et surtout le calendrier politique qui
en était l'appendice naturel. Ces livres rédigés par les
seuls patriciens étaient aussi conservés par eux seuls.
Les Livres de lin, Libri lintei, semblent avoir eu un caractère analogue.
Des ouvrages plus spéciaux, espèce de formulaires, de
rituels, de catalogues, conservaient le souvenir et les
règles des cérémonies religieuses, la succession des magistrats : tels étaient Libri rnagistratuum, Commentarii
consulares.
Il faut y joindre aussi les généalogies de familles
nobles et les éloges funèbres (Laudationes). Suivant Denys d'Halicarnasse, Valerius Publicola prononça en
public l'éloge funèbre de Junius Brutus, et cet hommage
rendu au fondateur de la liberté devint bientôt un usage
général parmi les patriciens. A partir de l'an 365, les
matrones elles-mêmes furent louées en public. Jules César
prononça l'éloge de sa tante Julia. Aucun monument de
ce genre ne nous a été conservé, et, si l'on en croit Cicéron
et Tite-Live, nous ne devons pas trop le regretter : faux
triomphes, faux consulats, fausses généalogies, voilà ce
qui remplissait trop souvent ces oeuvres où les morts n'étaient
célébrés que pour glorifier les vivants. Tels étaient
sans doute aussi ces vers chantés dans les festins par les
convives en l'honneur des grands hommes. L'usage n'en
existait déjà plus au temps de Caton le Censeur ; cependant
Varron, Valère Maxime, Cicéron et Horace y font
allusion. C'est sur cette base fragile que Niebhur a établi
son hypothèse d'une épopée populaire, dont les fragments
auraient formé l'histoire fabuleuse des premiers siècles
de Rome. Ces monuments primitifs disparurent presque
tous dans l'incendie de Rome par les Gaulois (364). Et le
premier historien n'écrivit que deux cents ans plus tard.
Cet historien, c'est Quintus Fabius Pictor, antiquissimus
scriptor, dit Tite-Live. Il vivait au milieu du sixième
siècle. Il fut envoyé à Delphes consulter l'oracle après
la bataille de Cannes : il devait donc savoir le grec, il
paraît que son ouvrage était écrit en grec. Cet ouvrage,
ainsi que tous ceux qui suivirent pendant une période de
plus de cent années, était moins une composition historique
qu'un registre des événements mémorables année
par année. Cette forme des Annales fut adoptée par tous
les écrivains du sixième siècle, et s'imposa pour ainsi dire
jusque vers le milieu du septième. Tels furent L. Cincius Alitnenlus, C. Acilius Glabrio, Aldus Posthumius Albinus,
contemporains de Fabius Pictor, ou appartenant à
la génération suivante. Au commencement du septième
siècle, des personnages considérables par leurs dignités
et leur science adoptent encore la forme employée par
leurs devanciers. Servilius Fabius Pictor, que Cicéron
célèbre comme très versé dans la connaissance du droit,
des lettres et de l'antiquité ; L. Calpurnius Piso Frugi,
qui porta la première loi sur la concussion (de repetundis
a. u. 605); Scribonius Libo, L. Cassius Hemina,
Q. Fabius Maximus Servilianus furent aussi des annalistes.
Cicéron ne cache pas le peu d'estime qu'il a pour ces
vieux écrivains. "Rien de plus maigre, dit-il, que Fabius
Caton,Pison, Fannius, Vennonius; ils racontent les faits,
ils ne savent pas les embellir." Cicéron se faisait de
l'histoire une idée toute différente ; il la regardait comme
une province de l'éloquence, point de vue étroit et faux.
On ne saurait trop regretter la perte de ces anciens
Annalistes et de ceux qui les suivirent. Ces écrivains en
effet appartenaient aux plus illustres familles de Rome,
presque tous ils obtinrent les premières dignités de la république,
hommes politiques et pratiques ils rapportaient
simplement les faits considérables auxquels ils avaient
pris part. L'autorité, la gravité, l'exactitude, ne sont pas
des qualités méprisables chez un historien, et doivent
passer avant l'art d'embellir ou de dénaturer les faits.
On ne cite dans toute cette longue période qu'un seul auteur
étranger a la conduite des affaires, qui ait osé en
retracer le récit. C'est L. Octacilius Pilitus, esclave et
portier du père de Pompée, plus tard affranchi, rhéteur,
chargé de l'instruction de Pompée. Il écrivit l'histoire du père et du fils. Les nobles seuls s'étaient jusqu'alors
réservé cet honneur. La tentative de Pilitus fut considérée
comme une sorte d'empiètement. Cette susceptibilité
ombrageuse est peut-être plus excusable que la
revendication de l'histoire par l'éloquence, ainsi que le
voulait Cicéron.
Les écrivains du septième siècle abandonnèrent la forme
des annales. Le vieux Caton leur en donna l'exemple dans
son livre des Origines. «A quoi bon, disait-il, rappeler
ce qui se trouve dans les Annales des Pontifes, le prix du
blé, les disettes, les éclipses de lune ou de soleil?»
L'histoire commença dès lors à devenir ce qu'elle doit
être, un art et une science. A la tête des auteurs de cette
période se place L. Caelius Antipater, contemporain des
Gracques. Il écrivit une histoire de la seconde guerre
punique en sept livres, et " donna à l'histoire un ton plus
élevée, dit Cicéron". Il est souvent mentionné par Tite-Live. L'empereur Hadrien, archéologue d'un goût douteux,
le préférait à Salluste. Après lui se place P. Sempronius
Asellio, qui assista au siége de Numance en qualité de
tribun militaire, et écrivit l'histoire complète de la guerre.
Aulu-Gelle cite de cet auteur un préambule assez remarquable
(1).
(1) N. Att., V, 18.
Le plus célèbre de ces historiens est C. Clandius Quadrigarius, qui avait composé une vaste histoire s'étendant de la guerre des Gaulois à la mort de Sylla. Tite-Live combat fréquemment l'autorité de Quadrigarius, qui semble avoir conçu l'histoire à la façon de Cicéron. Nous possédons de lui la narration du combat de Manlius Torquatus contre un Gaulois (1).
Q. Valerius Antias, son contemporain, qui revint à la forme des Annales, ne jouissait pas non plus d'une grande autorité. Enfin,
mentionnons encore Sisenna (L. Cornélius) qui fut prêteur
en 676, ami et partisan de Verrès, vir bene latine loquens,
dit Cicéron. Sisenna avait écrit l'histoire de la guerre Marsique et celle de la guerre entre Marius et Sylla.
Salluste en faisait le plus grand cas.
J'aurai terminé cette énumération d'ouvrages perdus
mais qui étaient des sources importantes pour les historiens
qui suivirent, quand j'aurai indiqué une autre sorte
de documents aussi considérables : ce sont les mémoires.
Plusieurs grands personnages, qui avaient été mêlés aux événements importants de leur époque, laissèrent en mourant ou publièrent de leur vivant le récit des faits où
ils avaient joué un rôle. Tel fut M. Aemilius Scaurus, consul, prince du sénat, censeur, homo gravissimus, civis
egregius, fortissimus senator, dit Cicéron ; mais Salluste
le juge tout autrement. Il joue un singulier rôle dans la
guerre de Jugurtha. Scaurus écrivit trois livres de mémoires
sur sa vie (de Vita sua). Q. Lutatius Catulus
composa un ouvrage sur son consulat (de Consulatu et rebus gestis suis). Les plus intéressants de ces mémoires
étaient ceux du dictateur L. Cornelius Sylla, en vingt deux
livres, dédiés à Lucullus. Tous ces ouvrages, comme je l'ai dit, ont péri. Mais ils
ont servi à la fois de modèles et de documents aux écrivains
postérieurs.
§Il.
Le premier des historiens latins qui nous ait été conservé est César (C. Julius Cesar— 655-710 - 99, 44 av. J. -C.). Sa biographie se trouve partout, et n'appartient
que très indirectement à mon sujet. Dans la première
période, César joue plusieurs rôles, tour à tour ami ou
adversaire des personnages les plus considérables; il a
dans ses allures je ne sais quoi d'équivoque qui inquiète
ou exaspère les honnêtes gens comme Caton. Quand la
guerre civile éclate, et malgré toute l'habileté de son
plaidoyer (voir les premiers chapitres du de Bello civili),
éclate par sa faute, les citoyens les plus probes ne vont
pas se ranger sous ses drapeaux. Ce n'est pas qu'ils préfèrent
Pompée; mais Pompée représente en ce moment
la cause du droit et des lois. Enfin, quand César est frappé
dans le sénat, et que les lambeaux de son pouvoir usurpé
passent aux mains d'Antoine et d'Octave, c'est encore
dans le parti contraire que se trouvent les plus honnêtes
citoyens. Il faut donc le reconnaître, à aucune époque de
sa vie César n'a échappé au jugement sévère de la conscience
publique. Son génie n'a jamais été mis en doute, même
par ses contemporains; mais ils n'ont pu s'incliner devant
l'usage qu'il en a fait : il restera toujours des ombres autour
de cette grande figure. Ce qu'il y a en lui de plus
saisissant, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il se
proposait de faire. Que pour asservir ses concitoyens, il
ait pris son point d'appui aussi bien hors de Rome qu'à
Rome même ; qu'il ait attiré les peuples à sa cause en
leur faisant entrevoir la liberté, les priviléges jusqu'alors
réservés aux seuls Romains : c'est là un moyen, rien ne
prouve que cela ait été un but. Ces Gaulois, ces Espagnols
qui envahissent le sénat romain et dont on se moque
dans les rues, ce ne sont pas des émancipés, mais des
instruments qu'on récompense. Je suis frappé cependant
du deuil universel qui saisit les nations étrangères à la nouvelle de sa mort. Les Juifs surtout ne pouvaient s'arracher
d'auprès de son bûcher. Si l'on en croit Suétone, ce grand esprit se disposait à changer la face du monde.
Corinthe et Carthage étaient relevées, les Parthes supprimés
ou transportés ; l'Euphrate et le Taurus à l'orient, à
l'occident le Rhin et l'Océan devenaient les barrières de
l'empire. À l'intérieur, la multitude des lois souvent contradictoires
était réduite à un code unique, qui devait
être celui du monde entier; d'immenses bibliothèques devaient
réunir tous les monuments du génie humain. Il
s'opérait ainsi une sorte de fusion universelle entre tous
les peuples, rêve gigantesque, chimère. Mais là est l'originalité
du génie de César : ce n'est pas un Romain, ce
a'est pas un citoyen de la cité antique. Parmi ses successeurs,
il n'eut pas un continuateur. Auguste ne lui ressemble
en rien; quant à ceux qui suivirent, s'il avait pu
les prévoir, il eût peut-être regretté de n'être pas mort à
Pharsale.
Écrivain, il a sa place parmi les premiers : Summus
auctorum, dit Tacite. Son esprit d'une incroyable activité
s'était porté dans toutes les directions. Pendant la
guerre des Gaules, il consacre ses loisirs à la composition
d'un traité de grammaire en deux livres, sur l'Analogie,
question capitale surtout en ce moment, où la langue latine
ayant acquis la souplesse et l'harmonie, pouvait être
tentée de s'enrichir en s'affranchissant des lois que lui
imposait son génie. Cet ouvrage était dédié à Cicéron en
qui César saluait un des bienfaiteurs de la langue nationale
: « Tu as bien mérité, lui écrivait-il, du nom et de la dignité du peuple romain. » Il avait un respect scrupuleux
de la pureté du langage; c'est le principal éloge
qu'il adresse à Térence ; et il répétait souvent : «Fuyons tout mot nouveau ou inusité, comme on fuirait un écueil. » Dans sa jeunesse, il cultiva la poésie, composa
une tragédie d'OEdipe et un poëme en l'honneur d'Hercule
(Laudes Herculis). Sous le titre de Dicta collectanea, il avait formé un recueil de sentences et de bons mots
dont Auguste empêcha la publication. L'astronomie, qui
tenait une grande place dans la religion politique des
Romains, avait aussi attiré son attention. Grand Pontife,
il composa des ouvrages spéciaux sur les auspices et les
augures , et travailla à la
réforme du calendrier. Orateur éminent, le seul, dit
Quintilien, qui pût disputer la palme à Cicéron, son éloquence
était sobre et pleine de charme. Il fut même
pamphlétaire. En réponse à un éloge de Caton, composé
par Cicéron, il écrivit un libelle intitulé Anticato, auquel
l'honnête Plutarque fait une allusion fort méprisante. il
n'est pas permis à des hommes comme César d'insulter
dans leur tombe des hommes comme Caton.
De tout cela nous ne possédons que ses mémoires sur
la guerre des Gaules et sur la guerre civile. (De Bello
gallico commentariorum libri VII ; De Bello civili
libri VII.) Le premier de ces ouvrages renferme, suivant
l'ordre chronologique, l'histoire des campagnes de César
en Gaule, en Bretagne, en Germanie ; le second comprend
la guerre contre Pompée et son parti. Ces commentaires
ne sont pas une histoire proprement dite,
mais de véritables mémoires écrits vraisemblablement
au jour le jour, sans composition méthodique. Comme
source, ils sont d'une importance capitale, les premiers
surtout. César est le plus ancien et le plus sûr écrivain
qui nous fasse connaître la Gaule, ses habitants, leurs
moeurs, leurs coutumes, leur religion, d'une manière incomplète, il est vrai, mais bien rarement inexacte. Au
point de vue géographique et stratégique, leur utilité été proclamée a par les juges les plus compétents. Cependant Asinius Pollion reprochait à César beaucoup
d'inexactitudes et de mensonges. Il y a au moins de singulières
atténuations dans le récit de plus d'une bataille ; il est et souvent assez difficile de restituer les faits, l'enchaînement des faits et même la topographie exacte, témoin le long débat de nos jours sur Alésia.
Comme historien, César se rattache évidemment à
1'école de Thucydide. Cicéron eût écrit l'histoire d'une façon toute différente ; il en eût fait une série de plaidoyers.
César ne plaide jamais, même dans la guerre civile : tout au plus se borne-t-il à donner aux événements
qui précèdent les hostilités un tour favorable à ses prétentions. Mais il saisit les faits d'une vue nette et les fixe dans le récit. Il ne s'attarde pas aux longues explications,
aux tableaux à effet : il n'a pas d'imagination aux dépens
de la réalité; mais il la réfléchit dans son oeuvre avec une clarté souveraine. C'est le propre des esprits
puissants; ils ne sont jamais entraînés par les faits, ils
les dominent toujours, et les mesurent : ils ne leur prêtent
rien de ce que leur imagination frappée serait tentée
d'y ajouter. Tite-Live n'a jamais évité entièrement cet écueil : c'est que Tite-Live n'est ni un général ni un politique, mais un littérateur qui subit l'influence des événements.
Il ne faut pas non plus chercher dans César
l'histoire morale. Il ne se propose point de donner des
leçons de vertu à ses contemporains ou à la postérité :
l'enseignement se trouve si l'on veut au fond de ces récits de campagnes, mais il faut l'en dégager. L'auteur
ne se croit pas tenu à l'expliquer. Cette espèce d'indifférence superbe étonne et choque même nos habitudes d'esprit
: nous aimons à nous passionner pour les gens qu'on
nous montre ; un peu de déclamation nous mettrait plus
à l'aise. La personnalité de l'auteur nous semble trop
voilée. Nous nous souvenons par exemple de cet éloquent
passage où Lucain nous introduit sous la tente de César,
dans cette nuit redoutable où il songe à franchir le
Rubicon : nous nous imaginons sans peine avec le poëte
que l'image de la patrie dut se dresser dans l'ombre de
la nuit devant les yeux épouvantés du parricide préparant
son crime. Le récit de César est d'une impassibilité
absolue. Le nom même du Rubicon, ce rempart visible
de la légalité, n'y figure pas. C'est pendant que les pourparlers
s'échangent, que César va de Ravenne à Ariminium,
c'est-à-dire viole la loi de son pays et donne le
signal de la guerre civile. Du reste le plus souvent il ne
donne par les motifs de sa conduite : ce sont des motifs
à lui connus, dit-il, ou bien, il serait trop long de les
rapporter.
Et néanmoins pas un fait important n'est omis : si l'auteur
ne cherche point à passionner, il veut éclairer.
Avec un art d'une sobriété exquise, il réunit et groupe les
détails pour produire un ensemble qui satisfait et ne
trouble jamais. Cicéron avait raison de dire que César
avait réuni des matériaux pour l'histoire, mais que des
sots pourraient seuls avoir l'idée de refaire après lui
ce qui n'était plus à faire. César était à la fois la source,
l'auteur et le narrateur des faits. C'est encore ce qui
explique l'absence de composition scientifique. Il intercale
dans le récit de ses campagnes en Gaule un tableau des
moeurs, de la religion, des coutumes des Gaulois, qu'un
historien de profession eût jeté dans les premières pages. Mais César dit ce qu'il sait, quand il le sait, et il n'a connu les Gaulois que vers la quatrième année de la guerre. Le style est d'une simplicité hardie, lumineux, pittoresque sans recherche. La phrase rapide, sans être heurtée, ne cherche point l'harmonie, mais la porte elle-même par le choix et l'agencement
des mots. Si elle se développe en longue période (dans
les discours indirects, par exemple), chaque proposition apparaît, se détache de l'ensemble, et s'y confond dans
une synthèse parfaite. La
langue est d'une pureté et d'une
élégance souveraine. César inclinerait plutôt versl'archaïsme
que vers le néologisme. Il simplifie volontiers la composition de la phrase, les verbes de la phrase, répète rarement les prépositios après les verbes composés,
cherche en tout la brièveté et le relief. Peut-être
cette simplicité parfois excessive entraîne un peu desécheresse et de monotonie, mais la vie intérieure soutien et anime tout. Pour bien apprécier
César, il faut avoir beaucoup pratiqué Cicéron.
Il est difficile de se figurer comment certains écrivains ont
pu nier l'authenticité des commentaires et les attribuer
à un certain Julius Celsus, qui vivait à ce qu'il paraît au septième siècle après Jésus-Christ. Cet auteur avait
donné une édition des commentaires, on les lui attribua.
Il va sans dire que plus d'un critique les déclara indignes de César et y reconnut la langue du septième
siècle. Cette opinion est aujourd'hui complètement abandonnée. Ce Celsus est aussi dépossédé aujourd'hui d'une
Vie de César, qui lui avait été attribuée, et qui est de Pétrarque. Suivant Servius (Æneid., XI, 743), César,
outre ses commentaires, aurait écrit un journal (Ephemeris)
de la guerre des Gaules, conjecture peu probable.
Dans presque toutes les éditions de César, à la suite des sept livres sur la Guerre des Gaules et des trois livres
sur la Guerre civile, on trouve un huitième livre sur la
Guerre des Gaules, et deux livres intitulés, l'un de Bello
alexandrino, l'autre de Bello africano. On les attribue
généralement à Aulus Hirtius, lieutenant de César, qui périt
un an après lui à la bataille de Modène. Quant au livre
sur la guerre d'Espagne (de Bello hispaniensi), il a aussi
probablement pour auteur ce même Hirtius, qui dit formellement
avoir continué le récit des campagnes de César
jusqu'à sa mort; mais l'ouvrage a dû subir des modifications
et des interpolations considérables. D'autres l'attribuent
à C. Oppius. Il existe une traduction grecque
des Commentaires sur la guerre des Gaules, attribuée
au moine Planude, qui vivait vers le milieu du quatorzième
siècle. Ellé ne manque pas d'importance pour contrôler
les manuscrits.
§III.
SALLUSTE (C. Sallustius Crispus).
« Que n'a-t-il vécu comme il parlait ! » dit Lactance.
Rien de plus pur, de plus austère même que la morale de
Salluste, et, si l'on en croit ses contemporains, sa vie en
fut le plus audacieux démenti. Né en Sabine, à Armiternum,
en 668, d'une famille plébéienne, lié avec les
personnages les plus considérables de son temps, notamment
avec César, l'ambition le jeta dans le parti populaire.
Questeur, puis tribun du peuple, en position d'obtenir
les plus hautes dignités de la république, il fut chassé du
sénat par les censeurs Appius Claudius Pulcher et L. Calpurnius
Pison. Suivant Varron, cité par Aulu-Gelle, il eût
été surpris en adultère par Annius Milon. Déshonoré, il alla trouver César dans les Gaules, le servit activement
dans la guerre civile, fut rétabli par lui sur la liste des
sénateurs, et nommé préteur de Numidie : suivant Dion
Cassius, il fut pour cette province un autre Verrès, et ne
dut qu'à la haute protection de César d'être acquitté de
l'accusation de concussion. Ce fut le dernier acte de sa vie
politique. Retiré dans son domaine de Tibur, ou dans les
splendides jardins qu'il possédait dans l'intérieur même
de Rome, il partagea son temps entre l'étude et les plaisirs.
Il mourut en 719. Il est malheureux pour la réputation
de Salluste, qu'il ait eu dans l'antiquité tant de
détracteurs, et pas un apologiste. Les passions politiques
ne suffisent pas à expliquer un tel déchaînement. Le
libelle de l'affranchi de Pompée, Lenaeus, fut, dit-on, la
source de toutes ces calomnies : l'invective contre Salluste,
mise sous le nom de Cicéron, n'a aucun caractère
authentique ; elle est l'oeuvre d'un rhéteur quelconque,
aussi bien que la déclamation de Salluste contre Cicéron,
dont parle cependant Quintilien; mais le témoignage de
Varron, celui de Dion Cassius, l'expulsion du Sénat prononcée
par des censeurs intègres, cette fortune énorme
acquise pendant sa préture, cette accusation de concussion,
cette retraite, le jour où César ne peut plus couvrir
de sa protection un ami compromis trop souvent : ce
sont là de fortes présomptions contre Salluste. L'argument
tiré en sa faveur de ses belles dissertations morales
pourrait-aisément se retourner contre lui. Il a eu parmi
les modernes des apologistes ardents et ingénieux, Wieland,
Roos, Malte-Brun, 0. Müller, et aussi des adversaires décidés, Loebel et l'un de ses plus savants éditeurs
Gerlach. Si la biographie de Salluste par Asconius nous
eût été conservée, nous serions plus à l'aise pour trancher une question qui restera probablement toujours obscure.
L'homme n'a pas nui à l'écrivain. Il y en a peu qui aient
joui et qui jouissent encore d'une telle réputation. Il la
mérite par le choix des sujets, la composition, le style.
Son ouvrage le plus considérable ne nous est point parvenu.
C'étaient cinq livres d'histoires (Historiarum libri
quinque) adressés à Lucullus, et qui embrassaient une
période de douze années, de 675 à 687. Ils étaient précédés
d'une introduction sur les moeurs et la constitution
romaine, et d'un rapide exposé de la guerre civile entre
Marius et Sylla. Quels étaient le plan et la composition
de cet ouvrage dont nous ne possédons que quelques
fragments dans le genre oratoire, c'est ce qu'il est difficile
de déterminer. Le président de Brosses a essayé de
le reconstituer, mais son travail, quoique fort remarquable,
est le plus souvent conjectural. On sait seulement
que Salluste traitait successivement de la guerre de Sertorius
en Espagne, de l'expédition de Lucullus contre
Mithridate, de la guerre de Spartacus, et de celle des
pirates. Suivant toute probabilité, ces cinq livres ne
comprenaient pas toute l'histoire de Rome pendant une
période de douze années. Salluste nous apprend en effet
qu'il s'est proposé de raconter les événements carptim,
et en choisissant ceux qui lui semblaient mériter une
attention particulière. Il aimait à circonscrire son sujet
pour mieux l'étudier dans toutes les parties : c'est un
esprit qui a plus de profondeur que d'étendue.
Son premier ouvrage semble avoir été l'histoire de la
conjuration de Catilina (Catilina ou Bellum catilinarium).
Il l'écrivit vraisemblablement après sa préture,
vers l'an 708. "En ce moment, dit-il, mon âme commençait à se reposer de bien des misères et de bien des dangers: je n'avais plus ni espérance ni crainte; entre tous les partis j'étais indépendant. » Il le croyait
peut-être, mais il n'en est rien. On chercherait en vain
dans l'histoire de cette crise intérieure le rôle si considérable
qu'y a joué Cicéron, consul, armé par le sénat
de pleins pouvoirs, salué père de la patrie. Salluste ne
mentionne même pas le discours qu'il prononça dans la
fameuse délibération sur le châtiment à infliger aux conjurés
(IVe Catilinaire). S'il dissimule les services éminents
de Cicéron en cette occasion, il ne dit pas un mot
du rôle équivoque joué par César, qui était évidemment
favorable à la conjuration. Il a donc manqué au premier
devoir de l'historien, l'impartialité.
L'étude minutieuse qu'il a faite de Thucydide ne lui a
pas communiqué cet ardent amour de la vérité qui
anime toutes les pages de son modèle. Sa première
préoccupation semble être de bien écrire. Esprit peu
philosophique, politique médiocre, il ne semble pas avoir
compris le caractère de cette conjuration de Catilina,
qu'on pourrait appeler un des signes du temps. Il restreint
encore un sujet déjà restreint. Il faut accepter cette histoire
comme un épisode absolument détaché, et alors les
remarquables qualités de l'écrivain apparaissent en pleine
lumière. La composition est simple, forte cependant.
Salluste replace Catilina dans le milieu où il est né et où
il s'est dépravé; il montre comment par ses qualités, ses
vices et ce charme de séduction qui agit sur Cicéron
lui-même, il put réunir et attacher à sa fortune tant d'amis.
Les causes générales que l'on retrouve quinze ans
plus tard, et sur lesquelles César fonda la révolution,
Salluste ne les indique que de la manière la plus vague :
il eût craint de ne pas laisser en pleine lumière le héros de son épisode. La même sobriété, parfois un peu sèche,
se retrouve dans le récit: nulle déclamation, aucune digression,
si ce n'est peut-être un parallèle fort artificiel
et peu sérieux entre César et Caton. Les discours sont
d'un art heureux. Ceux qu'il prête à Catilina, plus vagues,
composés tout entiers par l'auteur, sont un peu vides.
Les deux harangues de César et de Caton, prononcées dans
le sénat, sont d'une venue plus heureuse, celui de Caton
surtout. J'y retrouve le disciple de Thucydide : les personnages gardent la physionomie qui leur est propre ; la
question en délibération
est traitée avec soin, et cependant
l'auteur n'est pas absent de son oeuvre.
Le second ouvrage de Salluste est intitulé Jugurtha ou
Bellum jugurthinum. Il est bien supérieur au premier.
Les événements étaient plus anciens, et par conséquent
il était plus facile à l'auteur d'être impartial. De plus le
sujet se détachait plus aisément de l'histoire générale de
Rome, enfin les événements changeaient souvent de
théâtre, l'auteur passait tour à tour de Numidie à Rome,
du siége d'une ville au récit d'une séance du sénat.
Ajoutez à cela l'avantage inappréciable de connaître parfaitement
les lieux où se passaient les faits. Aujourd'hui
encore les peintures de Salluste sont vraies: ce peuple
dont il a peint les moeurs et le caractère, on le retrouve
encore. Mais l'art de l'écrivain n'apparaît nulle part plus
achevé que dans le récit même des événements. Après
avoir montré la famille du vieux Micipsa, le roi mourant,
l'héritage laissé indivis, les sottes impertinences des fils
légitimes, il met en scène Jugurtha le bâtard : on voit
ce Numide dissimulé, féroce et violent, se débarrassant
d'abord d'un des deux princes, manquant l'autre qui va
demander protection aux Romains. C'est le premier acte du drame. La scène change; nous voici à Rome, Adherbal
lâche et pleurant aux pieds du sénat ; des émissaires
de Jugurtha semant par derrière l'or et les promesses ; l'impunité du crime se préparant. Je n'achève point cette
analyse, tout le monde peut la faire. Il y a peu de récits
aussi habilement composés, aussi sobrement écrits et
d'un aussi énergique relief. Les combats, les siéges,
sont décrits avec une fidélité et une netteté admirables.
Quant aux portraits, ils abondent et sont d'une vérité
frappante. Celui de Marius, le rude plébéien qui flagelle
la noblesse et enlève le consulat « comme une dépouille
», est une belle étude.
A la suite de ces deux ouvrages, figurent dans les éditions
de Salluste deux lettres ou discours à César sur l'organisation
de la république (de ordinanda republica), et
une déclamation contre Cicéron. Ce dernier ouvrage est
évidemment apocryphe : il a été fabriqué par quelqu'un
de ces tristes rhéteurs du second siècle, qui s'adonnaient
au pastiche, dans l'impuissance où ils étaient de rien
produire par eux-mêmes. Plusieurs critiques ont admis
l'authenticité des discours à César (Vossius, Douza). Le
fonds de cette composition est évidemment plus sérieux ;
c'est une sorte de programme de la révolution que tenta
César et qu'il accomplit en partie: abaissement de la noblesse,
extension du droit de cité, unité de l'empire sous
un maître. Rien n'autorise à supposer que Salluste ait pu
concevoir un tel plan. Cent cinquante ans plus tard, il
était très facile de l'imaginer. Nous savons de plus que
Salluste fut le modèle le plus étudié, imité, copié, dans
la période qui s'étend d'Hadrien à Commode. Ses procédés
de style se laissent surprendre ; et on s'appliquait alors
avec passion à se modeler sur lui. Ce style a un grand charme. Il est net, vif, riche en
rencontres heureuses ; un certain tour archaïque lui
donne une parure originale. La concision et la brièveté
en sont les caractères les plus saillants. Ce sont des qualités
de travailleur patient et délicat, il l'était. Aulu-Gelle, qui le pratiquait beaucoup, bien qu'il lui préférât
le vieux Caton, le qualifie assez heureusement en l'appelant
suhtilissimus brevitatis artifex. C'est un artiste
consommé. Il a étudié Thucydide dans les plus intimes
détails de sa diction ; il le surpasse en clarté, non en
force. La phrase, admirablement construite et dégagée
finit toujours heureusement, et par une surprise agréable
pour l'esprit ; la pensée n'est pas toujours aussi heureuse
ou aussi originale. Ce trait brille, mais n'entre pas. Cet
effort vers la concision nuit à l'effet des narrations. Elles
n'ont rien d'ample : ce n'est pas ce mouvement lent et
régulier de la riche diction de Tite-Live; on n'est pas
entraîné, mais plutôt arrêté par la recherche des détails.
C'est un écrivain raffiné. Mais il appartient à cette belle
époque, où la langue latine, dégagée et libre d'allures, se
plie sans efforts à l'abondance cicéronienne, aussi bien
qu'à la rapidité élégante de César. Salluste s'est, lui aussi,
créé son style; il s'est maintenu en étroite relation avec
les écrivains du siècle précédent,vrais Romains de moeurs
et de langage, et il s'est approprié le tour distingué de
l'atticisme sévère de Thucydide.
Cicéron. - L'éloquence avant Cicéron - Cicéron rhéteur. - Cicéron orateur.- Plaidoyers. - Discours politiques.-La philosophie avant Cicéron.- Cicéron philosophe.- Les lettres de Cicéron.- Les poésies de Cicéron.
§I.
Il n'y a pas dans l'histoire de la littérature romaine de plus grand nom que celui de Cicéron. Les contemporains, les générations qui suivirent, le moyen âge, la renaissance et les derniers siècles reconnurent et proclamèrent hautement sa gloire. La critique moderne lui est moins favorable.M. Mommsen en particulier le traite avec une dureté et un mépris aussi injustes que peu convenables. A qui espère-t-on persuader que Cicéron n'est pas un écrivain, mais un pur styliste? que c'est un journaliste sans idées, un feuilletoniste épuisé? qu'il n'avait ni conviction ni passion, et que par conséquent il ne pouvait être un orateur ; qu'il ne fut qu'un avocat, et un mauvais avocat (1)?
(1) Mommsen, Romische Geschichte, t. III, p. 602 et suiv.
De tels jugements se réfutent par leur violence même. Le grand crime de Cicéron aux yeux de certains critiques modernes, c'est d'être resté fidèle au parti de la liberté. Peut- être a-t-il compris aussi bien qu'un autre la révolution qui
se préparait ; on pourrait en citer plus d'un témoignage tiré de ses écrits ; mais il n'a pu s'y résigner, et en cela, il était du sentiment de Caton, de Brutus, des plus honnêtes
gens qu'il y eût alors. C'étaient, dira-t-on, des esprits
étroits, exclusifs, bornés. L'empire était utile, nécessaire.
On oublie sans doute les épouvantables calamités qui précédèrent
l'établissement du pouvoir d'un seul, et qui le firent
accepter par épuisement (cuncta discordiis civilibus
fessa accepit) ; on oublie surtout ce que furent les successeurs
d'Auguste, pour ne voir et n'admirer que le bien-être
relatif des provinces, l'égalité des droits civils et politiques
se répandant de plus en plus dans le monde. Mais
peut-on exiger des hommes qui vécurent cinquante ans
avant ces événements, qui naquirent et moururent pour
la liberté telle qu'ils l'entendaient, telle que l'avaient entendue
leurs pères, une intelligence, disons mieux, une
divination claire des conséquences possibles d'une révolution
qui détruisait la vieille Rome, divination que n'avaient
peut-être pas ceux-là mêmes qui en furent les auteurs
? Il faut replacer les hommes dans le milieu où ils
ont vécu,et ne leur pas demander des idées qui ne vinrent
au monde qu'après eux. Il faut surtout respecter la fidélité
aux convictions, et l'honorabilité du caractère. Cicéron
commit plus d'une faute, tomba dans plus d'une inconséquence
; mais je ne sache pas qu'on lui ait fait jamais
l'injure de le comparer à un César, à un Antoine, à un
Octave.
Aussi vainement lui chercherait-on un égal en gloire
littéraire. Il est au premier rang par le nombre, la variété,
l'importance et la perfection des ouvrages. La langue latine
n'a pas de représentant plus autorisé. On peut critiquer
l'abondance parfois stérile de son style ; il faudrait
être bien téméraire pour critiquer sa diction. Si ce n'est
pas un génie créateur (et je ne sais si Rome en a produit un seul), c'est le plus riche, le plus éloquent, le plus clair
des vulgarisateurs.Il n'a rien inventé en philosophie; mais
il a résumé pour ses contemporains et avec une critique
suffisante, les travaux les plus importants de la philosophie
grecque : il doit être regardé comme l'introducteur
de ces études, fort négligées et méprisées avant lui. Orateur
et rhéteur, il a donné des préceptes excellents dans
un excellent langage, et des modèles admirables. Épistolographe,
il représente presque seul pour nous un genre
littéraire d'une importance considérable pour l'histoire.
Il se proposait d'écrire l'histoire, et il l'eût écrite comme
l'aimaient les Romains, en orateur et en moraliste. Il a
même été poëte, et non sans gloire au jugement de ses
contemporains. Enfin la rhétorique, l'éloquence, la philosophie
morale chez les Romains, se réduiraient pour
nous à fort peu de chose, si Cicéron n'eût pas existé. A défaut
d'autre originalité, c'en est une qui vaut la peine qu'on
la signale. Il est à vrai dire le centre où aboutit forcément
tout le mouvement littéraire de son temps. De plus,
il est depuis Caton, mort quarante-trois ans avant sa
naissance, le seul prosateur qui nous permette de juger
des progrès de la langue. Que l'on compare le De re rustica aux premiers plaidoyers de Cicéron, et l'on verra
quelle transformation avait subie l'idiome national en si
peu de temps.
§II.
ÉLOQUENCE.
Parlons d'abord de l'éloquence avant Cicéron.
L'éloquence est le genre national par excellence, c'est
celui de tous qui exige le moins d'invention et le plus de force. L'orateur en effet n'est point obligé de créer la
matière de ses discours : ce sont les faits qui la lui donnent.
Eloquentia veluti ftamma materia alitur. L'art ne
vient qu'après ; c'est la mise en oeuvre des matériaux.
Sans eux, il n'est rien qu'un vain exercice de déclamation;
et son plus beau triomphe, c'est de dissimuler sous
les misérables splendeurs de la forme la pauvreté du
fond.
L'histoire de l'éloquence se divise donc naturellement
en trois périodes. Dans la première, l'éloquence possède
déjà tous les éléments nécessaires ; mais la langue est
encore informe, et l'art est inconnu. Dans la seconde, la
matière la plus riche et la plus variée est offerte à l'éloquence,
et de plus tous les préceptes, toutes les ressources
de l'art sont connus et possédés par les orateurs. Dans la
troisième, l'art seul subsiste ; les faits, source première
de l'éloquence, ont disparu. Elle est pacifiée, c 'est-à-dire
éteinte. La première période comprend les premiers
siècles de Rome jusqu'à la dictature de Sylla. C'est en
effet vers cette époque que la rhétorique commence à être
enseignée sérieusement à Rome. La seconde s étend de
la dictature de Sylla au principal d 'Auguste. La troisième
va de l'établissement de l'empire au cinquième
siècle après Jésus-Christ.
La première période offrait à l'éloquence les sujets les
plus beaux et les plus variés. Laissons de côté l'époque à
demi fabuleuse des rois. L'établissement de la république,
qui appelait tous les citoyens à prendre part aux affaires
de l'État, dut provoquer chez un grand nombre d'entre
eux l'éclosion des premiers germes de l'éloquence. Brutus
ne prononça pas devant le peuple les harangues incendiaires
et savantes que lui prête Tite-Live ; il parla cependant, il sut faire parler le cadavre de Lucrèce, il souleva
les passions de la multitude, et fonda la liberté (1).
(1) Voir Cicéron, Brutus, de Claris oratoribus, c 14.
Si l'on en croit Tite-Live, son collègue Valérius Publicola prononça devant le peuple assemblé l'éloge funèbre de ce grand homme, usage qui se continua sans interruption jusque dans les dernières années de l'Empire. A peine le peuple est-il délivré de la tyrannie de Tarquin, la grande lutte entre les patriciens et les plébéiens commence. Ceux-ci doivent conquérir lentement et l'un après l'autre tous les droits que s'est réservés la classe privilégiée. Il n'est pas une seule de ces conquêtes qui n'occasionne des troubles et des orages dans l'État. La tradition a conservé le souvenir de l'ingénieuse éloquence de Ménénius Agrippa. Qu'il ait ou non développé devant le peuple étonné le fameux apologue des membres et de l 'estomac, il n'importe. Il parla, persuada, rétablit la concorde entre les deux ordres. L'établissement du tribunat créa des orateurs populaires. Inquiets, soupçonneux, toujours sur la brèche pour combattre les prétentions de la noblesse, réclamer l'égalité, poursuivre devant les tribunaux les chefs du patriciat, proposer et défendre des lois nouvelles, les tribuns étaient orateurs et sans doute éloquents. Quelle flamme dans les discours que leur prête Tite-Live ! Avec moins d'emportement, mais plus de majesté, les sénateurs délibéraient dans la curie sur les grands intérêts de la République. Le vieil Appius Claudius aveugle se faisait conduire parmi eux pour combattre le projet d'une paix ignominieuse avec Pyrrhus. Son discours prononcé l'an 474 existait encore du temps de Cicéron. Plutarque en a probablement reproduit les principaux arguments (1).
(1) Plutarch , Vita Pyrrhi, c. 19.
Importance des intérêts en
jeu, élévation des sentiments, sincérité, enthousiasme,
passion, les hommes qui jetaient alors les bases de la
puissance romaine, possédaient toutes les conditions nécessaires
à la véritable éloquence ; mais la langue leur
faisait défaut, l'art leur était inconnu.
Le premier auquel Cicéron décerne, sur la foi d'Ennius,
le titre d'éloquent, est M. Cornélius Céthégus, qui
fut consul en 550 : Suaviloquentiore, suadaeque medulla,
dit le vieux poëte. Il eut pour questeur l'homme le plus
remarquable de cette époque, le fameux M. Porcius
Caton. Nous en avons déjà parlé.
Caton meurt en 605. La civilisation grecque, qu'il
avait fini par accepter, pénètre la société romaine. On
écrit l'histoire, on prononce des plaidoyers en grec; le
Cilicien Cratès, de Malles, enseigne la grammaire ; des
philosophes et des rhéteurs ouvrent des écoles; la langue
commence à acquérir de la souplesse : elle avait déjà
l'énergie et le relief. Quant aux événements, cette matière
première de l'éloquence, aucune époque n'en vit
jamais de plus importants. La première moitié du septième
siècle vit la ruine de Carthage, de Corinthe et de
Numance, la soumission de la Macédoine, la réduction
de la Grèce, de l'Asie et de l'Afrique en provinces romaines.
A l'intérieur, les misères du peuple et de l'Italie,
la spoliation des petits propriétaires, l'extension menaçante
des domaines de quelques particuliers, provoquent
les lois agraires des Gracques. Les déprédations des gouverneurs
de provinces donnent naissance à la loi Calpurnia
de repetundis. Les religions étrangères, celles de l'Orient surtout, se glissent à Rome, et, bien que proscrites, s'y
maintiennent. Enfin la sanglante rivalité de Marius et
de Sylla, c'est-à-dire la lutte entre la noblesse et le peuple,
va éclater. Ces conquêtes, ces orages intérieurs,
ces luttes ardentes suscitent un nombre considérable
d'hommes remarquables, presque tous éloquents. Ils
sont les prédécesseurs de Cicéron, et l'on peut voir dans
le Brutus le portrait qu'il a tracé de chacun d 'eux. C'est
à peine si quelques fragments sans importance de leurs
discours nous ont été conservés. Je ne ferai pas, d'après
Cicéron, l'énumération de leurs noms et de leurs qualités
que nous ne pouvons apprécier; mais je ne puis cependant passer sous silence les deux fils de Sempronius Gracchus
et de Cornélie. Ils consacrèrent à une révolution
impossible un courage et une éloquence admirables. Tibérius,
l'aîtié, avait, dit Plutarque,plus de douceur et de séduction
; il excellait à remuer les coeurs par la pitié. Sa
diction était pure et travaillée avec le plus grand soin.
Son frère Caius était plus violent et pathétique : son éloquence
emportait. Un joueur de flûte placé derrière lui en modérait les éclats (1) .
(1) Plutarch. Vita Tib. Gracch., c. 2.
L'historien grec traduit sans doute du discours original le fragment qui suit d'une harangue de Tibérius. «Les bêtes sauvages qui habitent l'Italie ont leurs tanières et leurs repaires où elles peuvent se retirer et dormir; et ceux qui combattent et versent leur sang pour l'Italie n 'y ont à eux que l'air et la lumière. Sans maison, sans asile, ils errent de tous côtés avec leurs femmes et leùrs enfants. Ils mentent, les généraux qui sur le champ de bataille les exhortent à combattra pour défendre leurs tombeaux et leurs temples. En est-il un seul dans un si grand nombre qui ait un autel domestique et un tombeau où reposent ses ancêtres ? C'est pour entretenir le luxe et l'opulence d'autrui qu'ils se battent et meurent. On les appelle les maîtres du monde ; et ils n'ont pas en propriété une motte de terre ! » Cicéron admire surtout Caius Gracchus : « Voici enfin, dit il, un homme doué du plus beau génie, passionné pour l'étude, et formé dès l'enfance par de savantes leçons; c'est Caius Gracchus. Personne n'a jamais eu une éloquence plus riche et plus abondante. Peut-être, s'il eût vécu, n'eût-il jamais trouvé personne qui l'égalât. Ses expressions sont nobles, ses pensées solides, l'ensemble de sa composition imposant. Il n'a pu mettre la dernière main à ses ouvrages. Plusieurs sont d'admirables ébauches, qui seraient devenues des chefs-d'oeuvre. Oui, si un orateur mérite d'être lu par la jeunesse, c'est Caius Gracchus (1). »
(1) Brut., 33.
Son rapide passage à cette tribune où montèrent, où périrent tant de grands orateurs, laissa dans l'imagination des Romains une impression ineffaçable. Trois cents ans plus tard, on lisait et commentait encore dans les écoles des rhéteurs les brûlantes harangues du jeune tribun. Aulu-Gelle nous en aconservé quelques fragments d'une rare énergie, et d'un bon sens aiguisé et sarcastique qui emporte la pièce (1).
(1) Aul. Gell. XV, 12 ; XI, 10; X, 3.
Voici un épisode
du discours de legibus a se promulgatis. Il est intéressant
pour l'histoire des moeurs de cette époque. « Le consul
vint dernièrement à Teanurn Sidicinum : sa femme lui
dit qu'elle désirait se baigner dans les bains des hommes.
On donne l'ordre au de questeur Sidicinum, M. Marius, de faire sortir des bains tous ceux qui s'y lavent. L'épouse
du consul se plaint à son mari de ce que les bains ne lui
ont pas été livrés sur-le-champ, de ce qu'ils n'étaient pas
propres. En conséquence un poteau est planté dans le
forum, et là on amène M. Marius, le personnage le plus
noble de la cité. On lui enlève ses vêtements, on le frappe
de verges. Les habitants de Calès, apprenant cela, ordonnent
par un édit que nul ne se présentât pour se baigner
quand un magistrat romain serait dans la ville. À
Férentum, notre préteur fit saisir pour le même motif les
deux questeurs ; l'un se jeta la tête la première du haut
d'un mur ; l'autre fut arrêté et frappé de verges. Je vais
vous montrer par un seul exemple jusqu'où vont l'insolence
et les cruels caprices de ces jeunes gens. Il y a
quelques années, on envoya en Asie un tout jeune
homme comme lieutenant. Il était porté en litière. Un
bouvier de Vénusium le rencontre, et ne sachant qui se
faisait porter ainsi, demande en plaisantant : Est-ce un
mort que vous portez là? Il l'entendit, fit arrêter la litière,
et avec les bâtons qui la supportaient fit frapper le
bouvier jusqu'à ce qu'il rendît l'âme. » Les derniers
accents de cette éloquence passionnée retentissent encore
jusqu'à nous. C'est peu de jours avant sa mort peut-être
que Caius s'écriait : « Malheureux, où irai-je? où porterai-je mes pas ? Est-ce au Capitole? Mais il est inondé
du sang de mon frère ! Est-ce dans ma maison? Mais j'y
trouverai ma mère abattue et se lamentant ! » Tous les contemporains des Gracques étaient orateurs.
Jamais un aussi grand nombre d'hommes remarquables
ne prirent une part plus directe aux affaires publiques. Il
n'y avait pas encore à cette époque d'Épicuriens oisifs
ou indifférents. Le sénat, le forum, les tribunaux étaient
des champs de bataille toujours ouverts, où l'on se disputait
les honneurs, l'influence, le crédit. Il fallait à chaque
instant monter à la tribune pour rendre compte de
sa conduite, accuser un ennemi, défendre un ami. L'éloquence
était une arme, et dans cette orageuse mêlée des
passions et des intérêts, quiconque était désarmé, était
anéanti. Mais l'étude et l'exercice n'avaient pas encore
fourni aux orateurs toutes les ressources de l'art de bien
dire. Vifs, énergiques et pressants, ils manquaient de
souplesse, d'abondance et d'harmonie. Horridi et impoliti,
et rudes, et informes, comme dit Tacite (1).
(1) Dialog., c. 18.
Parmi les prédécesseurs immédiats de Cicéron, trois ou quatre seulement possédaient d'une manière encore bien incomplète quelques-unes des qualités qu'il devait porter à un si haut degré. Tels étaient Lépidus et Crassus ; le premier remarquable par « une douceur toute grecque, l'harmonie de ses périodes, et les habiles combinaisons de son style ; le second, par une rare pureté de langage. Enfin Crassus et Antoine, que Cicéron appelle " nos plus grands orateurs," et "les véritables rivaux des Grecs. "Le premier mourut en 661, Cicéron avait quatorze ans ; le second en 666, Cicéron avait dix-neuf ans. Antoine n'écrivit jamais un seul de ses discours, afin, disait-il, que si on lui jetait jamais à la face un mot compromettant, il pût nier l'avoir prononcé (1).
(1) Cicér., Pro Cluent., 50.
De cet orateur il ne reste donc rien
que le témoignage de l'admiration juvénile ou intéressée
de Cicéron. Habileté de composition, choix et arrangement
des preuves, diction brillante et figurée, action
riche, variée et vive, il avait presque tous les mérites.
Cependant sa voix manquait de sonorité, et son
langage, sans être incorrect, n'était pas un modèle d'élégance.
Crassus au contraire s'exprimait avec une rare
pureté : il avait une gravité noble tempérée par une plaisanterie
fine et ingénieuse, un remarquable talent pour
définir et développer les principes du droit naturel. On
disait de lui : qu'il était le plus habile jurisconsulte
d'entre les orateurs, et Scévola le plus grand orateur
d'entre les jurisconsultes.
Cicéron et ses contemporains.
Cicéron plaida sa première cause sous la dictature de
Sylla, il prononça ou composa sa dernière Philippique sous le triumvirat d'Octave, Antoine et Lépide. Cette période
de quarante années est la plus orageuse de l'histoire
de Rome. Les conspirations contre la liberté sont à l'ordre
du jour. Ce ne sont plus seulement les deux grands
partis du peuple et des nobles qui se disputent le pouvoir des citoyens rêvent pour eux-mêmes la domination
absolue. Pompée n'ose s'en emparer, Catilina l'essaye et
succombe, César y réussit. Les horribles guerres qui suivent,
les pactes monstrueux qui se concluent, se dénouent enfin par le triomphe définitif du plus habile ; la
forme du gouvernement est changée. Mais de telles révolutions,
suivies d'une tranquillité morne qui n'est au
fond que de l'épuisement, sont le stimulant le plus énergique
de l'éloquence. Les passions politiques violemment
surexcitées donnent aux moindres événements une couleur
particulière. Il y a des conspirateurs dans le sénat,
il y en a au forum, aux comices, devant les tribunaux, à
la tête des armées. Ce n'est plus la culpabilité ou l'innocence
que les avocats et les juges examinent ; c'est la
position politique de l'accusé. Parmi les nombreux plaidoyers
de Cicéron, trois ou quatre à peine sont exclusivement
judiciaires. Il accuse ou défend suivant l'intérêt
du parti auquel il appartient dans le moment. Ajoutez à
cela les émeutes de la place publique, soulevées souvent
par des hommes qui aiment le désordre pour lui-même,
comme Clodius; les tentatives de révolution sociale
d'un Rullus, les dramatiques et rapides péripéties
d'une guerre civile qui détruit l'un après l'autre et ceux
qui la font et la liberté ; et vous n'aurez qu'une idée encore
bien imparfaite de l'agitation féconde de cette époque.
Que de fois Cicéron déplore les calamités dont il est
témoin, ce silence momentané du forum et du sénat et
des tribunaux ! Mais s'il lui avait été donné de voir le
principat du sanguinaire Octave, les délibérations paisibles
du sénat, la bonne tenue des comices, et l'édifiante
sagesse des tribunaux ; s'il avait vu enfin cette pacification
de l'éloquence qui était la mort même de toute vie
publique, il eût redemandé pour sa patrie des Catilina,
des Clodius et même des Antoine.
De telles époques sont donc éminemment favorables à
l'éloquence. Le désordre, les rivalités ardentes, l'anarchie elle-même, lui sont des stimulants. Que sera-ce, si la
langue, enfin assouplie, rapide et sonore, se trouve toute
prête pour le combat? L'étude patiente des modèles
grecs, des exercices continuels dans l'un et l'autre idiome,
la fréquentation des écoles d'Athènes et de Rhodes ; l'usage
assidu de la déclamation, celui des traductions,
cette lutte si fortifiante avec un modèle, et par-dessus
tout l'ambition, l'amour de la gloire, la certitude de
réussir ; tous les éléments les plus favorables à l'éclosion
des grands talents et au perfectionnement des ressources
naturelles se trouvent ici réunis. Il faut lire dans le Brutus le détail des études de Cicéron. Quel orateur de
nos jours serait capable d'une application aussi obstinée ?
Qu'on se reporte ensuite à ce portrait de l'orateur achevé,
qu'on analyse tous les dons naturels, toutes les connaissances
acquises que Cicéron exigeait de l'homme appelé
à parler en public, et l'on comprendra peut-être ce que
pouvait être l'éloquence chez des hommes qui s'en faisaient
une si haute idée, et qui la cultivaient avec une
telle passion.
Presque tous les hommes politiques de cette époque furent
des orateurs remarquables : Hortensius, Cicéron,
Licinius Calvus, Marcus Brutus, Marcus Caelius, Pompée,
Sulpicius Rufus, César, Caton, Clodius, et d'autres
encore parurent avec éclat aux tribunaux, au forum, dans
le sénat. Mais plusieurs d'entre eux ne songèrent point à
revoir et à publier des discours souvent improvisés au
hasard du moment et de l'inspiration : les autres prirent
ce soin, mais le temps a dévoré leurs oeuvres. Qu'importait
aux contemporains d un Dioclétien l'éloquence d'un
Hortensius ou d'un Caton? Cicéron seul a survécu: il écrivait et publiait tous ses discours, même ceux qu'il
n'avait pas prononcés, comme les Verrines. C'est donc
lui qui résume pour nous toute cette période, et même
toute l'éloquence romaine. Disons un mot cependant de
quelques-uns de ses contemporains.
A leur tête se place Q. Hortensius Ortalus, rival et ami
de Cicéron : de sept ans plus âgé que lui (né en 640),
mort six ans avant lui (704), on l'appelait le roi du barreau. Il obtint l'une après l'autre toutes
les dignités de la République. Il ne parait pas avoir eu un
caractère parfaitement honorable : avocat, il recevait des
présents, et Cicéron lui reprocha en face d'avoir acheté
des juges. Souvent opposés l'un à l'autre, comme dans le
procès de Verrès, souvent aussi unis pour plaider la même
cause ; tous deux membres du collége des augures, et
dans les dernières années de leur vie, très étroitement
attachés l'un à l'autre, ils étaient reconnus de tous comme
les deux premiers orateurs de leur temps. Cicéron semble
avoir jugé Hortensius avec une entière sincérité. Il ne dissimule
aucun de ses mérites, et sans trop y insister signale
ses défauts. Hortensius était doué d'une mémoire prodigieuse
; il n'écrivait jamais ses discours, ne prenait jamais
de notes sur les discours de ses adversaires, et n'en oubliait
pas un mot. Il avait un remarquable talent d'exposition
et savait surtout résumer d'une façon lumineuse ses
arguments et ceux de la partie adverse. Sa diction était
noble et élégante, souvent un peu diffuse : c'était ce
qu'on appelait alors un Asiatique. Son action était surtout
admirable. Aussi plaisait-il plus quand on l'écoutait qu'à
la lecture. C'est ce qui explique la perte de ses ouvrages.(1)
(1) Voir les derniers et admirables chapitres du Brutus.
Si l'on en croit Quintilien, Hortensius avait composé un traité oratoire sous le titre de Loci communes.
Sa fille Hortensia prononça en public un plaidoyer
fort remarquable contre un tribut imposé aux matrones
par les triumvirs. Elle obtint gain de cause.
Après Hortensius, on cite C. Licinius Calvus, qui disputa
à Cicéron le premier rang et mourut à trente ans;
Servius Sulpicius Rufus, jurisconsulte et orateur fort
remarquable ; Pompée, orateur plein de gravité, mais
froid ; C. Curio, dont Lucain a dit : Audax venali comitatur
Curio lingua; Caton d'Utique, que Salluste place
sur la même ligne que César; M. Junius Brutus, le meurtrier
du dictateur, et enfin César lui-même, dont Cicéron
disait : "J'estime que de tous les orateurs, c'est lui qui
s'exprime avec le plus d'élégance." Suivant Quintilien,
lui seul était capable de disputer à Cicéron le premier
rang. Mais son âme voulait une autre gloire.
Cicéron fut avant tout un orateur. « Oui, je l'avoue,
dit-il, je suis entièrement adonné à de telles études. Que
d'autres en rougissent, s'il leur plait ; mais pourquoi en
rougirais-je, moi qui depuis tant d'années n'ai refusé à
personne le secours de mon éloquence, moi que ni le repos,
ni le plaisir, ni le sommeil même n'ont détourné ou arrêté
dans cette carrière ? » Et ailleurs : « Tous les services
que j'ai rendus à la République, si je lui en ai rendu,
c'est à ces maîtres, c'est à ces études que je le dois : ce
sont eux qui m'ont formé, préparé, armé pour la patrie. »
Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit a la couleur oratoire,
c'est à l'éloquence qu'il dut tous ses succès et tous ses
revers, celui son éloquence qui le tua.
Je glisserai rapidement sur les événements qui composent sa vie politique. L'homme d'Etat en lui était médiocre.
D'abord favori, puis dupe et enfin victime des
grands ambitieux de son temps, il ne sut rien deviner,
ni rien empêcher.
§III.
CICÉRON.
Cicéron (M. Tullius Cicero) est né à Arpinum, ville municipale
du Latium et patrie de Marius, le 3 janvier 648
(an 106 avant Jésus-Christ). Sa famille, qui appartenait à
l'ordre équestre, était obscure. II fut élevé à Rome avec
son frère Quintus, et reçut les leçons du poëte Archias.
Enfant, et tout jeune homme, il fit des vers; mais sa
véritable vocation le porta de bonne heure vers l'éloquence.
Les grands orateurs d'alors étaient Licinius
Crassus, Marcus Antonius, Aemilius Scaurus ; les plus
célèbres jurisconsultes étaient les deux Scévola, l'un
augure, l'autre grand pontife. Cicéron s'attacha à ces
hommes illustres, les prit pour patrons et pour guides,
les accompagnant au forum, se formant sous leur discipline
à la connaissance du droit, à l'art de bien dire, à
la pratique du barreau. Comme tous les jeunes Romains
de son temps, il porta les armes et servit dans la guerre
sociale sous le père de Pompée. II débuta au barreau à
vingt-huit ans, sous la dictature de Sylla. Trois ans après,
il entrait dans la vie publique, et était nommé questeur
à Lilybée (677). Les excellents souvenirs qu'il laissa dans
ce pays, décidèrent les Siciliens à s'adresser à lui pour
accuser le préteur Verrès. Il le fit avec une grande véhémence.
Il était alors l'adversaire fougueux de la noblesse, contre laquelle d'ailleurs commençait la réaction
provoquée par Sylla. « Je ne suis pas, dit-il, dans sa péroraison, un de ces hommes que les faveurs du peuple
romain viennent trouver pendant leur sommeil. » Il
sera du parti de Caton, l'ennemi acharné de la noblesse,
du parti de Fimbria et de Marius, ces grands révolutionnaires.
Il faut en finir avec la domination des nobles. Le chef de cette réaction était Pompée. C'est
par lui que Cicéron obtint successivement l'édilité et
la préture. Il paya sa dette en appuyant la loi Manilia qui déférait à Pompée des pouvoirs extraordinaires.
Une fusion s'opéra bientôt entre les diverses fractions
qui composaient le parti aristocratique. Cicéron fut agréé
par les chefs de la noblesse, et porté au consulat. Le démocrate disparaît. Il combat et fait échouer la loi
agraire que propose le tribun Rullus; mais il a de flatteuses paroles pour cette plèbe qu'il retient à Rome et
qu'il eût mieux valu envoyer dans des colonies. Il fait
l'éloge des Gracques, qu'il représente ailleurs comme
des citoyens criminels, justement massacrés. Consul,
il sauve Rome menacée par Catiliria, il est salué du titre
glorieux de Père de la patrie. Il eût dû mourir alors. Bientôt après se forme la première ligue entre Pompée,
César et Crassus ; Cicéron est tenu à l'écart, abandonné
par Pompée, sacrifié au tribun Clodius, exilé. Son âme
perd toute énergie. Il ne peut comprendre ce brusque
revirement, la perte de toute influence et de tout crédit.
Rappelé 1'année suivante, il courtise à la fois César et Pompée, qui déjà s'observent avec défiance. Il demande
en faveur du premier la prolongation du gouvernement des Gaules; pour complaire au second, il défend en justice
des hommes méprisés et coupables, Vatinius, Gabinius,
etc. On se débarrasse de lui en l'envoyant comme
proconsul en Cilicie. Quand il revient à Rome, César
envahit 1'Italie, et passe le Rubicon ; Cicéron se range
du parti de Pompée, mais sans espérance et sans illusion.
Le triomphe de César le relègue de plus en plus dans
l'ombre. La conspiration se forme contre le dictateur;
Cicéron en est exclu. Le meurtre commis, il l'approuve :
il espère ressaisir la direction des affaires; mais Brutus
et Cassius ne tiennent aucun compte de ses conseils;
il voit Antoine régner sur le peuple et faire confirmer
par le Sénat les actes de César. Il se jette du côté d'Octave,
croyant trouver chez ce jeune homme docilité et
reconnaissance. Il ne trouve qu'hypocrisie et lâcheté.
Son ami Brutus lui reproche ses complaisances pour
l'héritier de César ; celui-ci se rapproche d'Antoine, défait
avec lui les meurtriers de César, et livre Cicéron
à la vengeance du triumvir. Sa tête et ses mains furent
coupées et attachées à la tribune aux harangues (710). Il
avait soixante-trois ans. Ce n'était pas une mort prématurée,
dit Tite-Live, que je trouve un peu sec envers un si
grand homme. L'historien ne craint pas d'ajouter ces
mots qui sont une calomnie ou une lâche flatterie à
l'adresse d'Auguste. De tous les malheurs qui fondirent
sur lui, il ne supporta en homme que la mort.
Et à bien estimer les choses, cette mort paraîtra moins
injuste; car le vainqueur ne le traita pas autrement
qu'il ne l'eût traité lui-même s'il avait vaincu. Toute
la vie de Cicéron proteste contre cette supposition. Il
était ennemi de toute violence. Bien qu'armé de pouvoirs
illimités, il ne put se décider à ordonner le supplice des complices de Catilina dont le crime était manifeste.
Ce fut le sénat qui les condamna par la voix de
Calon. Tite-Live termine ainsi : « Il faudrait pour célébrer
en détail ses mérites être un autre Cicéron. »
Allusion cruelle à cet amour de la gloire qui chez ce
grand homme dégénérait souvent en vanité.
Ajoutons à cette rapide biographie quelques détails
sur sa vie privée. Il fut marié deux fois. De sa première
femme Térentia il eut un fils, Marcus, et une fille, la
fameuse Tullia, qu'il a tant pleurée. Il ne vécut pas
longtemps avec sa seconde femme Publilia, qu'il avait
épousée parce qu'elle était riche, et qu'il répudia parce
qu'elle s'était réjouie de la mort de Tullia. Tous les
historiens ont loué la noblesse de son caractère, la
douceur et la sûreté de son commerce, sa fidélité dans
l'amitié. D'un esprit mordant et caustique, qui saisissait
et perçait à jour les ridicules et les vices, il était cependant
dépourvu de toute méchanceté. Il possédait une
fortune assez considérable, de nombreuses maisons de
campagne dans lesquelles il avait réuni des livres, des
statues, des objets d'art. C'est là qu'il se consolait par
l'étude ou avec quelques amis, de son éloignement des
affaires. C'est là qu'il composa la plupart de ses traités
philosophiques. On ne peut lire sans être ému des nobles
et touchantes préfaces de ces ouvrages, fruit d'une solitude
forcée et d'un repos auquel il ne pouvait se résigner.
Octave, devenu empereur, surprit un jour un de
ses petits-fils lisant un livre de Cicéron : le jeune homme
embarrassé voulut le cacher sous sa toge ; mais César
le prit, l'examina et le rendit en disant : « C'était un
homme éloquent, mon fils, et qui aimait bien sa patrie. »
Mot profond et qui résume toute cette vie : éloquence et patriotisme. Les fautes, les faiblesses, les défaillances
s'expliquent par cette imagination et cette sensibilité si
vives chez l'orateur. Il se trompa souvent, hésita, flotta
irrésolu ; mais ce ne furent jamais les suggestions de l'intérêt
personnel qui le portèrent ici ou là. Il crut toujours
servir la cause de la liberté et des lois. Il n'était pas toujours
facile de la distinguer parmi ces brusques et soudains
revirements des hommes et des choses. Son ami Pomponius
Atticus resta prudemment en dehors de ces luttes
des partis, et réussit à plaire à tout le monde. Une aussi
égoïste indilférence ne pouvait convenir à l'âme généreuse
de Cicéron.
Sa vie littéraire.
Lorsque Cicéron parut au forum, les Romains n'avaient pas encore un seul maître qui enseignât en latin les règles de l'art de bien dire. A la fin du sixième siècle le sénat avait expulsé de Rome les philosophes et les rhéteurs grecs ; l'an 662 (Cicéron avait alors quatorze ans) il interdit à des rhéteurs latins qui avaient ouvert des écoles, de donner des leçons à la jeunesse (1).
(1) Aul. Gel., XV, II ; Sueton., de Clar. Rhet, I.
Cependant, quatre ans plus tard, (666)Plotius Gallus enseignait
à Rome la rhétorique, et Mlius Stilo Praeconinus, de Lanuvium, compta Cicéron parmi ses élèves. Octacilius
Pilitus, l'affranchi de Pompée, ouvrit aussi une
école d'éloquence, ainsi que Epidius, qui fut le maître
du triumvir Antoine. Mais c'est surtout dans les écoles
de la Grèce que Cicéron alla chercher le véritable enseignement
de l'éloquence. Il comprit en même temps que
l'art de bien dire n'était rien, si l'on n'y joignait une instruction solide et étendue, si surtout on ne donnait
pour base à l'éloquence la philosophie. Ainsi en
même temps qu'il étudiait la jurisprudence sous les
deux Scévola, la rhétorique dans les écoles et au forum,
il suivait les leçons de deux philosophes grecs que les malheurs
de leur patrie avaient forcés de se réfugier à Rome.
C'étaient l'épicurien Phèdre et l'académicien Philon ; ce
fut ensuite le stoïcien Diodote qui vécut pendant de longues
années et mourut dans sa maison. En Grèce, il suivit
les leçons d'Antiochus d'Ascalon ; en Asie, celles de
Xénoclès, de Dionysius, d'Apollonius Molon et de Posidonius.
De plus, afin de féconder la théorie par la pratique,
il ne passait pas un seul jour sans déclamer soit en latin
soit en grec. Ce ne fut qu'après cette longue et laborieuse
préparation qu'il parut enfin à la tribune et y remporta,
dans l'affaire de Sextus Roscius, son premier triomphe.
Mais jamais il n'interrompit les exercices auxquels il se
livrait pour nourrir et développer son éloquence. Agé de
quarante ans, il assistait aux leçons du rhéteur Gniphon,
et étudiait sous les grands comédiens Aesopus et Roscius
le geste et la déclamation. Pour donner à son style plus
de souplesse et de force, il s'exerçait à traduire les Oeconomiques de Xénophon, plusieurs dialogues de Platon, les
deux harangues d'Æschine et de Démosthènes sur la Couronne. Enfin il ne passait pas un seul jour sans plaider.
La nature l'avait fait éloquent, l'art et le travail firent de
lui le premier des orateurs.
§ IV.
OUVRAGES DE RHÉTORIQUE
Il est aussi le premier des rhéteurs latins.
Gardons-nous de le comparer à Platon, et surtout à Aristote.
Bien que dans certaines parties de ses traités sur l'art
oratoire, il imite visiblement ces deux grands modèles,
il leur est inférieur. A vrai dire, il semble relever plutôt
des rhéteurs grecs qu suivirent, et composèrent dans un
temps où la grande éloquence avait disparu, des recueils
de préceptes et de recettes sur les moyens de persuader.
Mais Cicéron est un Romain qui parle à des Romains de
l'art qu'ils préféraient à tous les autres : il mêle aux souvenirs
de ses études les observations personnelles qu'il
doit à son expérience ; moins philosophe que Platon et
Aristote, il se propose surtout d'être utile. Par là il se
rattache à l'école du vieux Caton, qui avait composé un
manuel sur l'art oratoire, à l'usage de son fils et de ses
contemporains. C'est l'orateur romain que Cicéron s'applique
à former ; ce n'est pas l'art oratoire qu'il étudie
dans ses principes, sa nature, son but. Un seul de ses
traités, l'Orateur, a un caractère général, et rappelle la
fameuse théorie platonicienne des idées ; mais l'énumération
des procédés techniques y tient encore trop de place ;
et l'on voit trop que c'est toujours l'éloquence à Rome et
non l'éloquence en général que l'auteur a en vue. Voilà
ce qu'il ne faut jamais oublier quand on étudie un auteur
latin quel qu'il soit, et Cicéron en particulier.
Son premier ouvrage est intitulé, Rhetorica, sive de
Inventione rhetorica libri duo. Il fut composé vers
l'an 666; Cicéron était âgé de vingt ans. Des quatre livres qu'il comprenait ou devait comprendre, deux seulement
nous sont parvenus. C'est sans doute à ce premier essai
qu'il fait allusion lorsqu'il dit : « Quae pueris aut adolescentulis
nobis ex commentariolis nostris inchoata ac
rudia exciderunt (1).»
(1) De Orat., 1, 2.
On dirait les rédactions d'un bon
élève après la leçon du maître.
Certains passages ont une analogie frappante avec un
autre traité de rhétorique qui figure dans toutes les éditions
de Cicéron et qui n'est pas de lui. C'est l'ouvrage
intitulé Libri quatuor rhetoricorum ad C. Herennium et connu sous le nom de Rhétorique à Hérennius. Il
n'y fait jamais la moindre allusion ; et peut-être n'a-t-on
songé à le lui attribuer qu'à cause de certaines ressemblances
de détail avec les deux livres de l'Invention. Les
commentateurs et les critiques ont attribué à bien des
auteurs la Rhétorique à Hérennius.Les uns ont nommé
Q. Cornificius, un des correspondants de Cicéron, dont
Quintilien fait mention ; les deux Manuce, Muret, Sigonius,
Turnèbe sont de cet avis. Vossius veut que ce soit
Cornificius le fils, et non le père ; d'autres nomment Laurea
Tullius, Tiron, l'affranchi de Cicéron, Marcus, son fils ;
ou bien le rhéteur Gallion, ou encore Virginius Rufus.
Quelques-uns avouent franchement qu'ils ne savent à
quoi s'en tenir sur cette question. Une dernière hypothèse,
peut-être plus vraisemblable que les autres, attribue cet ouvrage au rhéteur M. Antonius Gnipho, dont Cicéron
fut le disciple, et qui était de huit années plus âgé que
lui. Ainsi s'expliqueraient les analogies de détail entre
les deux traités. Cicéron, tout jeune homme, eût emprunté au premier, au seul traité de rhétorique écrit en latin quelques développements ou la matière de ses développements.
Mais il resterait toujours un passage bien
difficile à expliquer, si Cicéron n'est pas l'auteur de cette
rhétorique et s'il ne l'a pas composée étant déjà l'époux
de Térentia (1).
(1) Rhet. ad Heren ,I, 20.
M. Leclerc, dans sa savante dissertation
sur cet ouvrage, se prononce pour l'authenticité.
Ces deux premiers ouvrages ne sont guère que des
manuels. Les trois livres sur l'orateur (De oratore libri
tres), dédiés à son frère Quintus, ont un tout autre caractère.
Ils furent composés l'an 699 de Rome. Cicéron avait
alors cinquante ou cinquante et un ans. Il était dans toute
la force de son talent et dans tout l'éclat de sa gloire. Nul à
Rome n'avait plus d'autorité que lui pour donner les préceptes
d'un art dans lequel il était passé maître. C'est donc
en son propre nom qu'il parle; il ne répète plus une leçon
apprise. Bien plus, il affiche le plus profond et le moins généreux
mépris pour ces misérables rhéteurs grecs qui
chantent aux oreilles de vieux préceptes rebattus, et prétendent
enseigner un art qu'ils n'ont jamais exercé. Passage
curieux, car il nous indique bien le caractère de l'ouvrage.
C'est un livre pratique. Qu'eût répondu Cicéron, si on lui
eût fait observer que Platon et Aristote n'avaient point été
orateurs? Leur eût-il refusé toute autorité, comme à ces
pauvres docteurs grecs qui enseignaient ce qu'ils avaient
appris dans les livres ? Il faut donc avoir soi-même pratiqué
l'art de parler en public pour en donner des leçons :
ajoutons, afin de donner à l'ouvrage son vrai caractère :
il faut avoir été orateur distingué à Rome pour parler de
l éloquence à des Romains. C'est en effet à ses concitoyens
et à ses contemporains que s'adresse Cicéron. Il veut que son ouvrage leur soit utile, et l'orateur qu'il veut former,
c'est l'orateur romain.
Il y avait encore deux écoles en présence au moment
où Cicéron débuta au barreau : l'une qui prétendait renfermer
l'orateur dans son art, afin qu'il y fût plus habile, et
par un exercice continuel, acquît toutes les qualités indispensables
; c'était la vieille école, celle de Caton, l'ennemi
de toute étude surperflue. L'autre exigeait de l'orateur les
connaissances les plus étendues et les plus variées : c'était
celle de la génération nouvelle, formée sur le modèle de
Scipion, de Lélius et de leurs amis : elle devait triompher
avec les progrès incessants de l'hellénisme. Cicéron en
fut le plus complet représentant. Dans le premier livre de
l'Orateur, il met en présence les deux systèmes ; l'un est
exposé par l'orateur Antonius, l'autre par Crassus. Il est
visible que Cicéron donne gain de cause au dernier. L'orateur,
dit Crassus, doit non seulement étudier la rhétorique,
mais la philosophie, la politique, l'histoire, la jurisprudence
et d'autres sciences. La philosophie surtout lui
est indispensable. Telles sont les études préparatoires
que Cicéron exige de l'orateur. Dans le second livre, il
traite un sujet plus spécial : l'invention et la disposition ;
dans le troisième, de l'élocution et de l'aetion.
L'Orateur est écrit sous la forme du dialogue : les interlocuteurs
sont Q. Mucius Scévola, augure, Crassus, son
gendre, Antonius, c'est-à-dire le plus illustre jurisconsulte
et les deux plus célèbres orateurs de leur temps. Le lieu
de la scène est à Tusculum en 662. Dans le second
livre, Scévola est remplacé par Catulus et C. Julius
Caesar Strabo. « J'ai écrit à la façon d'Aristote, mais
comme il m'a plu, dit Cicéron, trois livres de dissertation et de dialogues sur l'orateur. Cela ne ressemble
en rien aux préceptes vulgaires : c'est un résumé
de toute la méthode oratoire des anciens, et particulièrement d'Aristote et d'Isocrate. » C'était un des ouvrages
qu'il aimait le mieux ; mais y en avait-il qu'il aimât
peu ?
Huit ans plus tard (en 707), il écrivit Brutus ou des
Orateurs illustres.
C'est une histoire critique de l'éloquence chez les Romains,
précédée d'une introduction sur l'éloquence chez
les Grecs. Cicéron composa cet ouvrage environ un an
après la bataille de Pharsale, dans les loisirs forcés que
la ruine de la liberté lui créa. Les premières pages et
les dernières sont empreintes d'un profond sentiment de
tristesse et de découragement. Hortensius venait de mourir,
et Cicéron ne peut le plaindre : qu'eût-il vu en effet
s'il avait vécu ? Le silence du forum, l'oppression et la
violence. Brutus, au contraire, se voit brusquement arrêté
dans sa carrière par les misères du temps. Enfin
Cicéron lui-même ne peut trouver pour son éloquence
blanchissante d'autre asile que le travail solitaire. Voilà
sous quelles impressions il composa le Brutus. C'est un
retour mélancolique vers les temps heureux où l'éloquence
libre et toute puissante régnait au forum, au sénat,
dans les tribunaux. Bien qu'il ne puisse guère y avoir
d'unité dans un tel ouvrage, le sentiment qui domine Cicéron
imprime cependant à cette énumération des orateurs
romains une couleur particulière. Il montre les premiers
bégaiements de l'éloquence, ses progrès, son riche épanouissement
vers le milieu du septième siècle. Elle est
enfin parvenue à un point où, toutes les ressources de l'art
étant connues les plus beaux sujets offerts à l'orateur, Rome pouvait, devait espérer enlever aux Grecs en ce genre la
gloire de la supériorité. Toutes ces espérances sont brutalement
détruites par le triomphe de la violence et de l'illégalité.
Cet ouvrage est pour nous d'un prix inestimable.
Sans lui que saurions-nous des prédécesseurs de Cicéron?
L'Orateur, adressé à Brutus, suivit de près le
traité des Orateurs illustres : il fut composé vraisemblablement
dans cette même année 707. Cicéron lui donne
parfois un second titre, de optimo genere dicendi. C'est
le plus philosophique de ses ouvrages sur l'art oratoire.
Bien qu'il se propose toujours un but pratique, bien qu'il
enseigne et dogmatise, il est préoccupé surtout de dessiner
la figure de l'orateur idéal : de là, l'étendue et la
variété des connaissances qu'il exige de lui. L'orateur
parfait ne doit rien ignorer, il doit surtout être profondément
versé dans la philosophie, qui est le plus sûr fondement
de l'éloquence. Il doit pouvoir prendre, suivant
les sujets, tous les tons et tous les styles ; être tour à
tour simple, tempéré, sublime, posséder au plus haut
degré le talent de l'invention, celui de la disposition, de
l'élocution et de l'action. Cicéron accorde à l'élocution la
place la plus importante; il va même jusqu'à renfermer
en elle toute l'éloquence : c'est une théorie qui lui est paticulière, et qui ne fut pas admise généralement par ses
contemporains et par la postérité. Mais on comprend que Cicéron ait été amené à penser ainsi : il était le créateur
et le plus parfait modèle de la langue oratoire ; il avait
donné à la prose l'harmonie, le nombre, l'abondance ; souvent même la forme chez lui prévaut sur le fond. C'est
un artiste admirable qui étale avec complaisance l'habileté
dont il est doué. Il y a donc un certain excès sur ce point. Ses deux derniers ouvrages de rhétorique sont beaucoup
moins importants. Ce sont les Topiques (Topica) et
lesPartitions oratoires (De partitioneoratoria dialogus).
Le premier est adressé au jurisconsulte Trébatius, qui
le lui avait demandé. Cicéron le composa en quelques
jours, pendant une traversée de Vélia à Rhégium, sans
aucun secours de livres. C'est un résumé des Topiques d'Aristote. Les anciens entendaient par Topique l'art de
trouver des arguments sur toutes sortes de questions. Cicéron écrivit les
Topiques en 709, un an avant sa mort.
Le dialogue sur les Partitions oratoires, fut écrit pour
son fils, on en ignore la date. C'est un manuel de rhétorique
élémentaire. Quelques critiques l'ont jugé indigne de
Cicéron ; mais le témoignage de Quintilien qui en fait
plusieurs fois mention ne permet pas de le déclarer apocryphe.
Il faut ajouter à ces ouvrages une sorte de préface à la
traduction des deux discours de Démosthène et d'Eschine
sur la couronne, et qui porte le titre : du meilleur genre
d'éloquence (de optimo genere oratorum). C'est un manifeste
sur l'atticisme ; nous y reviendrons.
§V.
CICÉRON ORATEUR.
Les anciens possédaient plus de cent vingt discours de
Cicéron, il ne nous en reste que cinquante-six. Sous ce
nom général de discours il faut comprendre les discours
prononcés devant le peuple, les discours prononcés devant
le sénat, et enfin les plaidoyers prononcés devant
les tribunaux: c'est la vieille et excellente division introduite par Aristote des trois genres délibératif, démonstratif,
judiciaire.
Comment ces discours nous ont-ils été conservés? Cicéron
les écrivait, non pas avant de les prononcer, mais
peu de temps après. De plus il y avait des sténographes
qui recueillaient la parole de l'orateur. Il revoyait
lui-même le texte de la harangue improvisée, le modifiait
en certains points, sans trop s'éloigner de la réduction
primitive, et après cette révision le publiait. On
connaît l'histoire du plaidoyer pour Milon. Cicéron, intimidé
par l'aspect inusité du forum et du tribunal entouré
d'hommes armés, perdit une partie de son assurance, et
Milon fut condamné. L'orateur prit sa revanche dans le
silence du cabinet et écrivit le beau discours qu'il eût
voulu prononcer devant les juges. Au temps de Quintilien
les deux plaidoyers existaient encore. Des critiques modernes,
et en particulier M. Mommsen, ont reproché à
Cicéron la publication de ses oeuvres oratoires. Le plaidoyer,
le discours public sont faits pour ceux qui
l'écoutent, et non pour les absents et la postérité. On ne
parle point comme on écrit; le discours publié ne sera
jamais la reproduction exacte du discours prononcé, ou
celui-ci n'est qu'un discours appris par coeur, ce qui
est détestable. Les grands orateurs de l'âge précédent,
Antonius entre autres et Galba, ne publiaient point leurs
discours. Il est certain cependant que Caton et Caius
Gracchus revirent et publièrent les monuments de leur
éloquence; et l'on ne voit pas pourquoi ce travail utile
entre tous serait interdit à l'orateur. Il ne faut pas oublier non plus que presque tous les discours prononcés soit
devant le peuple, soit au sénat, soit même devant les
tribunaux, avaient un caractère politique, et pouvaient
jusqu'à un certain point être considérés comme des manifestes
: l'orateur appartenait au parti de la noblesse ou
à celui du peuple ; il accusait des adversaires, défendait
des amis politiques; il ne laissait pas échapper la moindre
occasion de faire éclater ses sentiments; il se mettait
souvent en scène, prenait le peuple pour juge de ses
actes et de ses idées, faisait appel à ses passions, se désignait
lui-même à ses suffrages. Ne voyons-nous pas encore
aujourd'hui nos orateurs politiques publier les
discours dont ils sont satisfaits? N'est-ce pas dans le but
de s'adresser à un public moins restreint, et pour agir
sur l'opinion? Mais ce qui est vraiment fort remarquable,
c'est que les discours revus et publiés par Cicéron s'éloignaient
fort peu du texte primitif. Quel orateur de nos
jours serait capable d'une telle correction de langage,
d'une telle élégance, et si soutenue? Que d'études préparatoires
pour atteindre à une telle facilité ! On reconnaît
ici l'homme qui ne passait pas un jour sans parler en
public ou sans écrire, qui ne négligeait aucune des parties
de l'art, augmentait chaque jour ses ressources, soit
pour l'invention, soit pour l'élocution, si bien qu'aucun
sujet ne pouvait le surprendre, qu'il trouvait sans peine et
les idées et les mots et l'arrangement des mots déterminé
par les lois du nombre et de l'harmonie. Que cette constante
préoccupation de la forme donne parfois à l'éloquence
de Cicéron quelque chose d'apprêté ; qu'on
souhaite plus de vivacité et d'imprévu, on ne peut le
nier. Mais il faut accepter Cicéron tel qu'il est, comme
le plus parfait modèle de ce que peuvent l'art, le travail et un heureux naturel. D'autres ont eu des inspirations
plus hautes, plus de feu ; mais ils ont manqué de et de proportion mesure ; leur langage est incorrect ou inexact.
L'éloquence de Cicéron est toujours égale; aucune qualité ne lui manque, c'est un ensemble harmonieux. Il représente excellemment cette époque unique dans
l'histoite d'un peuple où toutes les ressources des sujets
de l'art, de la langue, sont offertes à l'orateur. Avant lui,
de beaux génies, mais peu d'art ; après lui, l'art seul
subsiste, et l'éloquence, n'ayant plus de sujets dignes
d elle, devient artificielle et déclamatoire.
Plaidoyers de Cicéron.
Il y avait à Rome deux voies pour acquérir la faveur
du peuple et parvenir aux plus hautes dignités de la république, la gloire militaire et l'éloquence. C'est à l'éloquence
que Cicéron dut tous ses succès; et il put même
s'écrier un moment dans un transport naïf de vanité Cedant arma togae, : que les armes cèdent à la toge ! Il
ne reconnut que trop à la fin de sa vie que la violence était
le plus sûr moyen d'être le maître de l'État; mais pendant plus de trente ans il lutta, et non sans gloire, contre cette triste révolution qui se préparait. Il représenta dans
la République la cause du droit, de la légalité, de la justice
qui allait être anéantie. Le politique était médiocre en
lui, avons-nous dit ; mais l'orateur, ou, pour mieux rendre notre pensée, l'avocat était éminent.
Il n 'y avait pas à proprement parler d'avocats à Rome,
le mot advocatus désigne toute autre chose; tout citoyen
pouvait accuser ou défendre devant les tribunaux le premier venu. Un succès attirait naturellement l'attention publique sur l'orateur; on venait implorer le secours
de son éloquence; il était bientôt consul et célèbre.
Aussi à peine avait-il atteint l'âge fixé par les lois, il briguait
l'une après l'autre toutes les dignités de la république.
Il lui était facile de faire connaître ses sentiments
sur les affaires de l'État, d'arborer son drapeau, comme
nous disons aujourd'hui. Le procès le plus insignifiant
touchait toujours par quelque point à la politique. Cicéron
débuta au barreau à 25 ans (672); c'était sous la
dictature de Sylla. Comme tous les débutants, il se plaça
nettement dans l'opposition. Il ne craignit pas d'attaquer
en face une créature du dictateur, un certain Névius,
protégé et défendu par un orateur comme Hortensius,
un personnage consulaire, Philippe. Il gagna sa cause.
L'année suivante, il défendit contre un affranchi du
dictateur, Chrysogonus, Roscius d'Amérie, que Chrysogonus
avait dépouillé de ses biens, et qu'il accusait
en outre de parricide, afin d'en jouir en toute sécurité.
Certains traits hardis ou trop spirituels, d'éloquentes
protestations contre les misères du temps, la
lâcheté et la terreur universelles, furent avidement
accueillis par le public. Peut-être Cicéron crut-il prudent
de se dérober aux dangers de son triomphe. En
tout cas, peu de temps après, il fit un voyage en Grèce.
Quand il revint à Rome, la faveur populaire le récompensa
de son courage : il fut nommé questeur à l'unanimité.
Il exerça sa charge en Sicile à Lilybée. Cinq ans
plus tard (683), il est désigné édile; et les Siciliens le
chargent d'accuser Verrès, leur préteur, coupable des
plus horribles vexations et du brigandage le plus effréné.
Il accepte. C'était, quoi qu'on en ait dit, un acte
de courage. Verrès appartenait à l'aristocratie romaine alors toute-puissante : il devait être défendu par le consul
désigné qui n'était autre que le fameux Hortensius ;
il avait pour lui les représentants des plus hautes familles
de Rome, les Métellus et les Scipions, l'immeuse majorité
du Sénat, intéressée à protéger un de ses membres,
qui n'était peut-être pas plus coupable que tel ou tel
préteur de province : de plus c'étaient les sénateurs eux-mêmes,
c'est-à-dire les amis, et jusqu'à un certain
point les complices de Verrès, qui devaient le juger ; et
l'accusé était assez riche pour acheter ses juges, si cela
était nécessaire. Il avait même eu l'impudence de l'annoncer
en partant pour son gouvernement.
Une analyse détaillée des six discours de Cicéron contre
Verrès, n'est malheureusement pas possible ici, et je
le regrette. Rien de plus instructif, rien de plus intéressant que
le tableau de l'étatmoral de Rome à cette époque ;
la violence, la fraude siégeant avec les juges, une conjuration
universelle de tous les intérêts et de toutes les cupidités,
le cynisme de l'iniquité. Cicéron ne put même obtenir
sans une lutte énergique le droit de plaider pour les
Siciliens. Un certain Cécilius, qui avait été questeur de
Verrès, et qui était Sicilien d'origine, prétendit lui enlever
l'honneur de porter la parole pour ses compatriotes; il
n'avait d'autre but que de les trahir. Ce fut contre lui que
Cicéron prononça son premier discours, afin de ne pas
se laisser déposséder de la cause que les Siciliens avaient
confiée à son honnêteté et à son talent. Ce premier plaidoyer
porte le titre de Divinatio : les juges, après avoir
entendu les deux compétiteurs, devaient deviner pour
ainsi dire celui des deux qui était le plus capable de bien remplir ses fonctions d'accusateur. Cécilius écarté, Cicéron
aborda résolûment l'affaire. Les amis de Verrès voulaient
la traîner en longueur jusqu'à la fin de l'année,
époque où son défenseur Hortensius, consul désigné, entrerait
en fonctions; pendant cet intervalle on subornerait
des témoins, on achèterait des juges, on rendrait le
procès à peu près impossible. Cicéron déjoua ces manoeuvres.
Il partit pour la Sicile,
recueillit en cinquante
jours une foule de témoignages écrasants, revint à Rome
armé de toutes pièces, força Hortensius d'interroger les
témoins, se borna lui-même à ajouter quelques mots à
leurs dépositions, accabla le coupable, son défenseur,
ses amis, ses juges sous l'évidence des crimes, et coupa
court aux intrigues qui se préparaient. La démonstration
fut si complète, que Verrès ne voulut pas attendre l'issue
du procès, et se condamna lui-même à l'exil. Ainsi le
plaidoyer contre Cécilius et la première action contre
Verrès, voilà réellement les deux seuls discours prononcés
dans le procès. Les cinq autres furent écrits par Cicéron
après la fuite de Verrès, et publiés. A quoi bon,
se demandera-t on, puisque le procès était gasné? Je n'oserais
affirmer que le désir de faire connaître les crimes
de Verres, ait déterminé Cicéron à composer à loisir dans
le cabinet des plaidoyers qui ne devaient pas être prononcés.
Avocat, écrivain plein de ressources, il ne put
consentir à perdre une si belle occasion de montrer son
esprit, son éloquence, et surtout ses sympathies pour
l'ordre des chevaliers qui allait bientôt hériter des jugements
enlevés aux sénateurs. Voilà les mobiles auxquels
il a obéi. L'artiste et le politique ambitieux ont
voulu se satisfaire. Tous deux ont réussi pleinement. Peu
de temps après ce procès scandaleux, les chevaliers succédèrent aux sénateurs (Lex Aurelia judiciaria, 684), Cicéron
fut nommé édile, et devint l'ami de Pompée, alors
déjà tout puissant. Quant à l'avocat, il eut un succès qui
dépassa toutes ses espérances. Jamais la vie privée et publique d'un homme ne fut interrogée,
analysée, étalée
flétrie avec plus d'habileté, de hardiesse et de feu. Dans
le premier discours de la seconde action, l'orateur
rappelle les antécédents de Verres, sa questure
, sa lieutenance
et sa préture à Rome : il montre Verrès questeur
du consul Carbon, volant la caisse militaire et passant
dans le parti de Sylla; trahissant ensuite Dolabella ; enlevant
et outrageant une jeune fille libre, préludant déjà
au pillage de la Sicile par des extorsions de tout genre, et
notamment la spoliation d'un pupille. Quant à la préture,
c'est-à-dire, la manière dont Verrès rendait la justice à
Rome, les détails fournis par Cicéron nous donnent
une singulière idée de ce qu'étaient alors les tribunaux.
Après cette introduction,
Cicéron passe à l'énumération
des crimes commis par Verres dans sa préture de
Sicile. Il les divise en quatre classes : 1° ses prévarications
dans l'administration de la justice; 2° ses vols
et ses concussions dans la perception des dimes de
blé; 3° ses vols commis contre les particuliers et
contre les temples, notamment des vols de statues et
d'objets d'art; 4° enfin les exécutions iniques et
cruelles qu'il a commandées. Je ne puis entrer dans
le détail de tous les méfaits de Verres; et s'il fallait choisir, auquel donner la préférence ? Tout en admettant que
Cicéron ait un peu chargé l'accusé, surtout l'accusé absent,
qui ne devait ni ne pouvait se défendre, la part faite
à l'hyperbole oratoire, Verrès n'en sera pas moins un scélérat.
Ce qui importe, c'est de bien comprendre comment
un homme pouvait être amené à commettre naturellement,
pour ainsi dire, et presque sans en avoir conscience,
tant d'actes violents, despotiques, illégaux. Il y
avait plus d'un Verrès dans l'empire romain : la loi Calpurnia
sur la concussion était violée tous les jours et impunément.
Un préteur réunissait dans ses mains le pouvoir
militaire, l'imperium, le pouvoir judiciaire, les finances,
et enfin le pouvoir exécutif. Les provinces étaient
livrées à sa merci ; elles n'avaient d'autre recours que
de l'accuser devant les tribunaux romains, lorsqu'il était
sorti de charge, si elles réussissaient à trouver un accusateur.
Le préteur trouvait dans ses juges des gens qui
avaient fait ou qui comptaient bien faire comme lui, et qui
ne voulaient pas être inquiétés. Il fallait de plus réunir des
témoins assez hardis pour déposer contre un magistrat
romain et se désigner ainsi eux-mêmes à la haine de son
successeur. Chose inouïe ! l'accusé trouvait plus aisément
dans cette province qu'il avait saccagée, des hommes et
des villes entières pour lui élever des statues, pour lui
offrir des félicitations, des certificats publics de bonne et
honnête gestion, que l'accusateur ne trouvait des malheureux
assez osés pour lui faire connaître les iniquités dont
ils avaient été victimes. Évidemment, une réforme dans
l'administration des provinces était nécessaire : la justice,
l'intérêt même de Rome l'exigeaient. Je dois avouer
que Cicéron ne sut point envisager la question à ce point
de vue : il fut exclusivement avocat, et jamais homme
politique. Il se borna à souhaiter plus de douceur et d'humanité
chez les préteurs en général; il opposa aux exactions
de Verrès la modération relative de tel ou tel gouverneur
de province; il se livra à d'éloquents développements
sur la majesté du peuple romain, sur les vertus
des ancêtres, sur cette belle loi Calpurnia, sur les souffrances
des Siciliens : il ne songea pas un seul instant à
revendiquer pour eux et leurs frères en servitude quelques
garanties plus sérieuses qu'une loi destinée à punir
et non à empêcher les déprédations, et qui d'ailleurs
était si rarement appliquée. A vrai dire, la question
capitale du procès, à ses yeux, ce fut la composition
des tribunaux romains, le droit de juger rendu au moins
en partie aux chevaliers, le sénat abaissé. Il était encore
à ce moment l'adversaire du parti aristocratique, de ces
hommes « que les bienfaits du peuple romain vont trouver
pendant leur sommeil, et qui se croient d'une autre
nature que les autres. » Quant à la Sicile, elle fut pour
lui une occasion d'être hardi, habile, éloquent, d'attirer
l'attention de Pompée, des chevaliers et du peuple; il ne
sut pas agrandir son horizon, il se renferma dans Rome,
et laissa prendre à d'autres le beau rôle de défenseurs
sérieux des provinces. César ne se bornait pas à plaider
pour elles; il leur faisait entrevoir l'affranchissement et
le droit de cité, et il le leur donna à la fin. Aussi c'est
par elles qu'il a vaincu Rome et le parti de Cicéron.
Quant à la composition des Verrines, on sent un peu trop
peut-être que c'est une oeuvre de cabinet. L'énumération
des crimes de Verrès ne comportait guère cette distribution
didactique de chaque discours, ces longs exordes
et ces péroraisons avec des apostrophes. La mise en
oeuvre manque de sobriété; les simples dépositions des témoins durent produire bien plus d'effet que les anecdotes
triées avec soin par l'orateur, précédées d'un petit
préambule pour attirer l'attention et suivies d'une récapitulation
animée qui en reproduisait les principaux détails.
L'esprit ne manque pas. Le goût de Verrès pour les
objets d'art est agréablement dépeint. On voudrait plus
de nerf et de concision ; l'effet serait plus saisissant. Mais
Cicéron est naturellement abondant (copiosus); il aime
l'amplification, parce qu'il a à son service une grande
richesse de mots; il n'a pas cet art achevé qui consiste à
ne point paraître. Fénelon a bien raison de dire qu'il ne
s'oublie jamais.
Par une inconséquence qui ne doit pas nous étonner, Cicéron
défendit l'année suivante un préteur probablement
aussi coupable que Verrès, Fontéius, qui avait gouverné
pendant trois ans la Gaule Transalpine et le fit acquitter. Bien que le discours nous soit parvenu incomplet,
on peut voir comment Cicéron traitait les Gaulois assez
hardis pour accuser en justice leur spoliateur. M. Leclerc
ne pardonne pas à l'orateur ses invectives et ses railleries
contre nos aïeux, et il a cent fois raison. Je me
borne à mentionner les plaidoyers pour Cécina, pour
Cluentius, bien intéressants pourtant, comme peinture
des moeurs du temps, et qui furent prononcés par Cicéron
pendant sa préture ; le plaidoyer pour Rabirius, qui nous
montre Cicéron dans le camp du parti aristocratique ; il
venait d'être élevé au consulat. Ce n'est plus le jeune et hardi avocat des premières années. Il a moins de feu
moins d'éclat, plus d'habileté ; il en fallait et beaucoup
pour défendre contre Sulpicius Rufus et Caton, un Muréna
accusé de brigue; il fallait plus que de l'habileté tourner pour en ridicule Caton, le plus honnête homme de ce temps, pour railler la noble science du droit dont Rufus était un des plus illustres représentants. Tristes et re grettables concessions aux intérêts de l'ambition et de la vanité. Il met alors en pratique, non plus la belle
maxime de Caton sur l'orateur sait parler « Un homme de bien qui sait parler» ( Vir bonus dicendi peritus), mais une théorie nouvelle qu'il exposa lui-même devant les juges
dans le procès de Cluentius. « Tous nos discours, dit-il,
sont le langage de la cause et de la circonstance, non celui de homme et de l'orateur; car si la cause pouvait parler elle-même, on n'emprunterait pas le secours de la
voix. » N insistons pas sur un tel aveu. Cicéron ne l'a
que trop justifié par ses actes. Ne relevons pas les nombreuses contradictions qui lui échappèrent; expliquons les.
Il y avait au fond de tous ces procès une question
politique: Cicéron n'était d'aucun parti; non qu'il fût
indifférent, mais il était facile à tromper, et il se trompait aisément lui-même : l'exercice prolongé et triomphant de
la profession d'avocat produit souvent chez des
âmes honnêtes mais sans énergie cette sorte d'indifférence morale;
le ressort de la conscience est comme émoussé, a force d'avoir été tendu inutilement et dans tous les sens.
La claire et nette appréciation du fait
échappe; on ne voit plus que la cause : la pure lumière
de la vérité pâlit devant des yeux qui cherchent partout des arguments. Ajoutez l'enivrement
d'orgueil que l'on éprouve, quand à force d'adresse et d'éloquence on a réussi à faire absoudre un scélérat !
nul plus que Cicéron ne fut dupe de cette espèce d'illusion
qui cache les faits pour ne laisser voir que les sophismes
de la défense ; une fois à l'oeuvre, on est soutenu
par une sorte d'enthousiasme d'auteur ; on sent qu'on
crée un autre homme que celui de l'accusation,
qu'on
crée d'autres faits, ou d'autres explications des faits;
plus l'oeuvre est difficile, plus on s'y acharne ; c'est une
lutte entre la force brutale de la réalité et le génie de
l'avocat. Quel encouragement à recommencer, si l'on a
réussi une fois! Voilà le secret des nombreuses contradictions
de Cicéron; il était convaincu que l'éloquence
peut triompher de tout, et la sienne en particulier. De
telles dispositions d'esprit, développées par la pratique,
produisent un avocat d'une force incomparable ; la sévère
morale ne saurait accepter et justifier ces tours de force,
et l'homme qui se plaît à les exécuter, ne sera jamais un
grand politique. Il lui manquera la première condition
de toute action sérieuse sur les hommes et sur les événements,
l'autorité.
Discours politiques.
Ses discours politiques sont encore des plaidoyers. Ici
les défauts ordinaires de Cicéron sont plus choquants.
Un avocat peut et doit même s'enfermer dans la cause.
Q'uest-ce qu'un homme d'État qui ne voit que le fait en
question, et ne sait pas le rattacher au passé ou découvrir
l'importance qu'il doit avoir dans l'avenir? La prévision,
voilà ce qui manque le plus à Cicéron. Il est l'homme du
moment. Toujours prêt sur toute question à prendre la
parole, à faire admirer sa prodigieuse facilité, à présenter des observations justes, habiles, éloquentes, il n'a
pas cette vue nette des conséquences renfermées dans
l'événement qui se présente. Il n'apporte rien de nouveau
dans une discussion importante : il en développe supérieurement
l'objet actuel ; il la peint pour ainsi dire
avec de riches couleurs; mais il ne montre pas d'où elle
vient et où elle va. En un mot, il a toujours été en
toute chose beaucoup plus frappé du côté extérieur,
l'imagination dominait en lui ; il était prompt à l'enthousiasme,
à l'admiration, à la colère. On dirait que
Salluste, son ennemi, pensait à lui quand il prêtait à César
ce grave et noble exorde sur les conjurés de Catilina:
« Les hommes, qui délibèrent en temps de crise sur les
affaires publiques, doivent être exempts de haine, de
colère et d'amitié : l'esprit discerne avec peine la vérité
quand ces passions le possèdent. »
Ses principaux discours sont des panégyriques ou des
invectives; ce sont des modèles du genre démonstratif,
non du genre délibératif. Cela vient, comme je l'ai dit,
de son impuissance à rattacher un fait à sa cause et à en
prévoir les conséquences.
Les plus célèbres sont : le Discours pour la loi Manilia, qui proposait de décerner à Pompée des pouvoirs
extraordinaires pour faire la guerre à Mithridate. L'orateur
rencontrait en Catullus et en Hortensius des adversaires
déclarés; ils comprenaient combien il était dangereux
dans une république de déclarer hautement,
qu 'un seul homme pouvait soutenir la gloire du peuple, et
de l'investir d'une autorité qui le mettait au-dessus des
lois. Cicéron réfuta cette opinion sage et patriotique par des arguments d'une faiblesse déplorable: il ne vit pas
que créer dans l'État un tel précédent, c'était justifier
d'avance tout ambitieux qui aurait réussi à se rendre
indispensable. Ce qui eût dû l'éclairer cependant, c'est
l'empressement de César à appuyer la proposition de
Manilius. Pompée lui frayait les voies à la domination;
il lui en montrait même les moyens, l'intervention des
tribuns. On sait quel usage il en fit plus tard. Il y eut
donc une grande imprévoyance de la part de Cicéron. Cette
critique fondamentale établie, il faut admirer la brillante
et complète exposition qu'il a faite de l'état de l'Asie à
cette époque, des intérêts de tout genre, qui exigeaient
que la guerre fût promptement terminée. Le panégyrique
de Pompée, qui tient une trop grande place dans
le discours, cette énumération complaisante de toutes
ses qualités intellectuelles, guerrières et morales, prouvent
plus d'habileté oratoire que de discernement. Le
style est d'un coloris un peu forcé, mais d'une riche
venue. Cicéron débutait aux rostres; il était en grande
toilette.
De graves difficultés se présentèrent sous son consulat:
il sauva Rome de Catilina, et il empêcha l'adoption de la
loi agraire proposée par le tribun Rullus. Parlons
d'abord de la loi agraire.
C'était un principe du droit romain qu'il n'y avait pas
de prescription contre l'État. Le territoire public pouvait être cédé suivant certaines conditions
à des particuliers, mais il ne pouvait jamais être aliéné.
Les lois agraires étaient donc justes en principe, puisqu'elles
se fondaient sur l'inaliénabilité du domaine public, pour en réclamer le retour à l'État, et par suite la
cession, suivant telle ou telle condition, à des particuliers.
Il y avait donc deux questions à examiner: la
première était le maintien des droits de l'État: celle-là
ne pouvait être douteuse, puisque, contre l'État, il n'y
avait pas de prescription ; la seconde était l'opportunilé
de la reprise réclamée au nom de l'État, et les moyens
proposés pour disposer en faveur des particuliers du
domaine public. Cette distinction est capitale. Si on
l'oublie, on ne comprend rien aux lois agraires en général
et à celle de Rullus en particulier.
Rullus proposa sa loi quelques jours avant que Cicéron
entrât en fonctions comme consul. Le peuple de Rome
était alors fort misérable ; la forte race des petits propriétaires
qui avaient conquis le monde, avait disparu: on
n'avait plus à sa place qu'une plèbe mendiante, oisive,
turbulente, qui vivait de viles industries, de distributions
de blé et de la vente de ses suffrages. Le domaine public,
qui était immense, eût amplement suffi à la nourriture
de cette tourbe indigente et dangereuse. On eût créé des
colonies et expédié au loin ces prétendus citoyens qui
vivaient de l'émeute et ne songeaient qu'à se vendre au
plus offrant et au plus audacieux. La proposition de
Rullus était donc sage, politique, utile à l'État, de plus elle
était fondée en droit. Mais, comment reprendre à ceux
qui en étaient détenteurs les terres publiques? Comment
en opérer la distribution? Ici se présentaient de graves
difficultés ; Rullus et ses amis ne surent pas les conjurer.
Ils proposèrent l'établissement d'un décemvirat avec
pouvoir absolu pendant cinq ans sur tous les domaines de
la république; ces décemvirs les distribueraient à leur
gré, vendraient, achèteraient, indemniseraient à leur gré, établiraient des colonies, en un mot disposeraient en
maîtres de toute la richesse publique.
Ce fut cette partie de la loi que Cicéron attaqua.
C'était chose facile. Rullus et ses parents se mettaient
au nombre des décemvirs ; étaient-ils tout à fait désintéressés?
Quel pouvoir énorme ils réclamaient ! Ne seraient-ils pas de véritables rois? Le peuple romain souffrirait-il une telle usurpation? On voit d'ici les développements
oratoires sur ce thème banal.La loi organique
était mauvaise, soit, impraticable, soit ; mais le
principe de la loi était excellent; je dirai plus, la loi était
opportune. Cicéron est bien forcé de le reconnaître
dans la première partie de son discours. « Je suis un consul
ami du peuple, » se plaît-il à répéter sans cesse. Il
chante les louanges des Gracques, «. ces excellents citoyens, si dévoués au peuple, si sages, si avisés, et qui ont réglé si bien plusieurs parties de l'administration. » Mais après cette belle profession de foi, il
bat en brèche l'un après l'autre tous les articles de la
loi et n'en laisse subsister aucun. Son argumentation
est spécieuse, habile, spirituelle, souvent mordante: elle
a un air patriotique fait pour abuser ; la démonstration
s'annonce, se développe, se poursuit avec une force toujours
croissante. La proposition de Rullus est détruite
de fond en comble. L'avocat a gagné son procès. Mais
le principe de la loi, qu'est-il devenu? Il a disparu avec
la loi elle-même. Il a été escamoté. Que d'esprit et
d'éloquence pour ne pas voir et ne pas laisser voir la vérité!
Cicéron, chose incroyable, soutint deux ans plus
tard une loi analogue à celle de Rullus ; mais elle était
proposée par une créature de Pompée, Flavius. Il la
soutint, parce qu'elle avait l'avantage de débarrasser Rome de cette tourbe dangereuse d'affamés, qu'il appelle
la sentine de la ville (sentinam urbis exhauriri). La
loi de Rullus ne produisait-elle pas le même effet? C'est
pitié que d'entendre Cicéron dire à cette populace: «Ne vous laissez pas déporter dans les colonies ; conservez précieusement le pouvoir, la liberté, les suffrages, la majesté, la ville même, le forum, les jeux, les jours de fête et tous vos autres avantages. » Ceux qu'il
voulut garder à Rome, il les retrouva bientôt autour
de Catilina, puis autour de Clodius, de César et d'Antoine.
Les Catilinaires sont plus connues; j'y insisterai peu.
M. Mommsen ne veut pas admettre que Cicéron ait
sauvé la république: les contemporains furent cependant
unanimes à le reconnaître, et ils devaient être assez bons
juges de la question. Salluste lui-même, si peu favorable
à Cicéron, ne peut nier cependant que l'État ne lui doive
son salut. M. Mommsen reproche au consul des hésitations
sans fin: il n'hésita que sur un point, le supplice
sans jugement des conjurés. Même après le discours de
Silanus et celui de Caton, qui emportèrent la majorité, il
eut encore quelques scrupules sur la légalité de l'exécution
: il s'y décida enfin, comme à un acte indispensable,
mais qu'il regrettait. On sait que plus tard ce fut le prétexte
dont se servit Clodius pour le faire exiler. Mais ce point excepté, il se montra courageux, résolu, prévoyant et
grand citoyen. J'ajoute même que sa conduite fut supérieure
à son langage. Des quatre Catilinaires, la première
et la quatrième furent prononcées devant le sénat, la seconde et la troisième devant le peuple. Certains critiques
allemands contestent l'authenticité de la seconde
et même de la quatrième; il est difficile de se rendre à leurs raisons. La première Catilinaire, si célèbre par
l'exorde, est une magnifique explosion d'indignation et de
mépris. Oeuvre oratoire admirable, on n'en voit pas bien
le but au point de vue politique. A quoi bon dire à un
conspirateur qu'il a tort de conspirer, qu'on le surveille,
qu'on sait ce qu'il a fait, ce qu'il compte faire. Mais
Cicéron, homme d'imagination et de vive sensibilité, ne
put contenir en lui les colères allumées par tant d'audace.
Il fallait qu'il s'épanchât. Envisagée ainsi, cette première
Catilinaire est un chef-d'oeuvre. La seconde est
plus mêlée. Cicéron rend compte au peuple du départ de
Catilina et de l'état de la conjuration qui subsiste, à
Rome même. Elle renferme une fort remarquable peinture
des diverses classes de conjurés; c'est un exposé
historique intéressant de l'état moral de Rome à cette
époque. La troisième est le récit de la découverte des
intelligences que les conjurés avaient pratiquées avec les
Allobroges. La quatrième, la plus remarquable de
toutes, est la discussion animée des opinions émises dans
le sénat par Silanus et par César, relativement aux conjurés
jetés en prison. Une grande mesure et une fermeté
réelle, voilà le caractère de ce discours. Peut-être
n'eût-il pas forcé les suffrages; peut-être les paroles prononcées
ensuite par Caton, produisirent-elles plus effet
;
mais Cicéron avait ouvert la voie, et Caton n'eut qu'à
accentuer un peu plus énergiquement les arguments de
l'orateur qui l'avait précédé. On voudrait retrancher
des Catilinaires ces longs et fatigants éloges que Cicéron
se décerne à lui-même. Ils y tiennent beaucoup trop
de place.
Je ne parlerai point des discours politiques relatifs à I exil de Cicéron et à son retour : ce sont à vrai dire des plaidoyers pour lui-même. Le discours relatif provinces consulaires aux (de Provinciis consularibus, 698)
est un triste monument de l'inconséquence de Cicéron.
Il est divisé en deux parties : dans la première, il invective
de la manière la plus violente Gabinius et Pison et demande qu'ils soient rappelés de leurs provinces (la Macédoine et la Syrie) ; dans la seconde, il combat les orateurs qui s'opposent à ce que César soit maintenu dans
son commandement des Gaules. Il fait un magnifique
éloge de César, et prouve une fois de plus combien le
sens politique lui faisait défaut. Il y a dans sa manière
d'envisager ces graves questions une naïveté honnête qui confond. Pourquoi rappeler Gabinius et Pison? Parce
que ce ne sont pas des gens de bien. Pourquoi proroger les pouvoirs de César ? Parce que c'est un grand homme.
Il comprit plus tard, trop tard, son erreur et chercha
à l'expliquer, sans y parvenir.
Cicéron donna lui-même le nom de Philippiques à quatorze discours prononcés devant le sénat et devant le peuple contre Antoine, pendant les années 709 et
710, dernier monument de l'éloquence de Cicéron.
Ces Philippiques ne ressemblent à celles de Démosthène que par le titre. L'ennemi que combat Cicéron n'estpas un barbare, un étranger qui médite la conquête de la patrie ;
c'est le lieutenant et l'instrument de
César,un homme d action sans scrupules, que les désordres et l'anarchie de la république encouragent peu à
peu à se promettre la succession de son maître. Dans
cette période de confusion qui s'étendit de la mort de
César au triumvirat, Cicéron fut l'âme du sénat. Toutes
les résolutions qui furent prises, tous les décrets qui furent
portés, c'est lui qui les inspira et les dirigea. C'est
dire assez qu'il n'y eut ni unité ni suite dans la direction
des affaires. Le sénat semblait avoir toute l autorité
comme autrefois ; mais la véritable force était dans les armées
qui étaient nombreuses et obéissaient à différents
chefs. Antoine en avait une, le jeune César en avait une
autre. Décimus Brutus, Marcus Brutus et Cassius, les consuls
Hirtius et Pansa commandaient aussi à des légions.
Qu'importaient les décrets du Sénat, s'il n'avait pas la
force de les faire exécuter? A quoi bon déclarer Antoine
ennemi de la république, si ses soldats lui restent fidèles
et lui conservent une position redoutable ? Cicéron ne sut
pas dominer cette situation ; et je ne sais s'il était possible
de le faire.
La cause de la liberté et de la légalité était évidemment
perdue : ses derniers défenseurs au dehors, Brutus et Cassius,
étaient hésitants et n'avaient que des forces insuffisantes
; au dedans, les habiles se préparaient une défection
lucrative. Ce sera l'honneur de Cicéron d'être resté
fidèle à l'État, que tous s'apprêtaient à trahir. On sait d'ailleurs
qu'il expia par la mort sa courageuse résistance aux
envahissements d'un Antoine, le plus méprisable des
hommes. Mais quelle lecture affligeante que celle des
Philippiques ! C'est bien en cette circonstance que Cicéron
se paye de mots. Le sol se dérobe sous lui!; les déceptions
se succèdent; quelques succès sans importance
sont bientôt suivis des symptômes les plus alarmants ; l'orateur passe de la confiance au découragement; il
loue les morts ; il essaye de stimuler les vivants : les faits
les plus ordinaires acquièrent tout à coup une importance
capitale à ses yeux : comme dans une tempête les passagers
interrogent avec angoisse les plus légères variations
dans le temps. Des illusions naïves sur les événements
et sur les hommes; une confiance absolue et bien mal
récompensée en ce jeune César qui sut tromper tout le
monde ; et par-dessus tout une haine et un mépris
inexprimables contre Antoine : voilà les sentiments et les
idées qui remplissent ces discours. Ce sont les expansions
éloquentes des dernières craintes et des dernières espérances
de Cicéron ; c'est aussi le dernier monument de la
liberté de la parole à Rome. La seconde Philippique, que
Juvénal appelle divine, est le plus curieux modèle que
nous ait laissé l'antiquité de l'invective personnelle.
Je crois avoir suffisamment indiqué les caractères généraux
de l'éloquence de Cicéron. Elle nous semble aujourd'hui,
il faut bien le reconnaître, un peu verbeuse.
Et j'ose dire que nous avons tort. Un orateur moderne
qui imiterait les procédés de Cicéron, fatiguerait et serait
invité à hâter le pas : cela prouve seulement que nous
sommes devenus plus économes de notre temps et insensibles
aux belles constructions d'un art savant. Tels n'étaient
point les anciens. Ils suivaient sans effort et avec
un plaisir infini les développements magnifiques des
idées les plus simples, présentées dans tout leur jour,
avec la plus riche abondance de preuves, dans des termes
choisis, élégants et harmonieux. Jamais préteur n'eût dit
à un avocat comme les présidents de nos jours : au fait!
Le fait, c'était la cause tout entière, telle que la comprenait
et voulait l'exposer l'orateur. Et que l'on ne s'imagine pas pour cela, que ces longs plaidoyers, où le lieu
commun tenait souvent un grande place, fussent sans action
sur les âmes. Jamais l'éloquence ne remporta de plus
beaux triomphes qu'à cette époque. A la suite de ces lentes
et savantes périodes, de ces amplifications splendides, et à
notre sens,oiseuses, il y avait des larmes, des acclamations,
des enivrements populaires. C'est que l'orateur ne jetait
pas dans son discours cinq ou six traits brillants, ou quelque
mouvement imprévu destiné à un succès de surprise :
dès les premiers mots il s'emparait doucement de l'esprit
de l'auditeur, le menait sans crise violente, de déductions
en déductions, l'échauffait insensiblement en lui présentant
sans cesse et sous toutes ses faces une vérité qu'il
voulait faire accepter, jusqu'à ce que de tous ces détails,
de tous ces raisonnements, enchaînés les uns aux autres et
se faisant mutuellement valoir, la conviction éclatât enfin
irrésistible. Nul n'a possédé cet art à un plus haut degré
que Cicéron; on peut même dire qu'il en a parfois abusé.
Toutes les circonstances ne demandent pas cette abondance
de langage et ce luxe d'arguments ; mais il ne
pouvait se résigner à laisser perdre pour ainsi dire l'opulence
qu'il se sentait. Il parle souvent de ce fleuve du discours qui doit couler des lèvres de
l'orateur; c'est bien l'image qui rend le mieux le caractère
de son éloquence. Elle coule aisée, harmonieuse,
riche, d'un mouvement uniforme, mais puissant par sa
continuité. Cette lenteur méthodique n'avait rien de choquant
alors : il arrivait souvent que la même cause était
plaidée par deux, trois, quatre et jusqu'à six orateurs
différents ; et tous étaient écoutés avec le même intérêt.
Parfois ils se partageaient entre eux les diverses parties du
plaidoyer: l'un prenait l'exorde, l'autre la narration, un troisième la confirmation, ou la péroraison. C'est cette
partie dont Cicéron était ordinairement chargé. Il excellait
à résumer les arguments, à les présenter condensés
et sous une forme animée et dramatique.
Cependant, il y eut, même parmi ses contemporains,
des critiques assez délicats pour lui reprocher ce qui leur
semblait le plus grand des défauts, un manque d'atticisme.
Tacite semble être de cet avis, mais Quintilien
n'admet pas ce reproche. Cicéron y fut fort sensible, et
il s'en défendit avec une grande chaleur. Lui, le disciple
des Grecs, l'admirateur et le traducteur passionné de Démosthène,
il ne serait pas un Attique ! L'atticisme serait
donc la sécheresse, et pour tout dire, une sorte d'impuissance
à produire une impression profonde sur la multitude!
Les Attiques représentés par M. Brutus, Licinius
Calvus et Asinius Pollion, avaient raison : Cicéron n'est
pas un Attique; il avait tort de prétendre à ce titre. L'atticisme,
ce charme indéfinissable qui émane de la sobriété
sans sécheresse, d'un éclat tempéré qui n'éblouit point
les yeux, d'une harmonie sans affectation, d'une mesure
exacte et exquise en tout, il ne le possédait point. Il n'était
pas non plus un Asiatique, c'est-à-dire, un parleur
vulgaire et d'une abondance plate ou ampoulée. Son
éloquence tient le milieu entre ces deux formes, et par là
elle est éminemment romaine et originale. Cicéron est le
premier des écrivains du siècle d'Auguste. Il les annonce;
Virgile et Horace se frayeront une route entre Pindare et
Homère d'une part, c'est-à-dire, les purs génies grecs et
les Alexandrins de l'autre. Cicéron placé entre l'atticisme, que nul Romain ne put jamais atteindre, et l'asiaticisme,
qui était un défaut, représente excellemment ce tempérament
sage qui est le caractère du génie romain.
§ VI.
PHILOSOPHIE DE CICÉRON.
La philosophie romaine avant Cicéron.
Cicéron est le premier des auteurs romains qui ait composé dans la langue nationale des ouvrages de philosophie. Il en est fier, mais il faut bien le reconnaître, il semble en même temps s'excuser d'avoir consacré à de telles occupations une partie de ses loisirs. Parmi ses contemporains, les uns ne pouvaient admettre en aucune façon qu'on s'adonnât à la philosophie; d'autres voulaient qu'on ne le fit qu'avec une certaine mesure, et sans y consacrer trop de temps et d'étude. D'autres enfin, méprisant les lettres latines, préféraient lire les ouvrages des Grecs sur ces matières ; je ne parle pas de ceux qui trouvaient indigne d'un consulaire une étude aussi futile (1).
(1) Cicer.,de Finibus, 1,1.
1
« Aussi jusqu'à nos jours, dit Cicéron, la philosophie a
été négligée, et n'a reçu des lettres latines aucune illustration.
» Quant à lui, il est convaincu que si les Romains
avaient.voulu s'adonner à la philosophie, ils y auraient
réussi aussi bien que les Grecs : n'ont-ils pas rivalisé heureusement
avec ceux-ci dans la poésie et dans l'éloquence?
C'est une illusion du patriotisme. Le goût des spéculations
philosophiques, ou, pour mieux dire, l'amour de la philosophie
pour elle-même était absolument étranger aux Romains. C'étaient avant tout des hommes d'action et des
esprits positifs. Tels ils restèrent pendant les six premiers
siècles, incapables, je ne dis pas de résoudre, mais d'imaginer
même un seul des problèmes qui sont l'objet de la
philosophie. Ils n'eurent l'idée de cette science que le
jour où des Grecs leur en parlèrent. Quand ils en connurent
le but, quand ils virent ces étrangers, dont toute la
vie se consumait dans une étude qui n'avait pas empêché
la ruine de leur patrie, et ne leur rapportait rien à eux-mêmes
qu'un maigre salaire payé à des oisifs par
d'autres oisifs, ils méprisèrent ce qu'on leur fit connaître,
et ceux qui le leur firent connaître. Voilà les
vrais sentimens des contemporains de Caton le Censeur.
Le Sénat, qui représente fidèlement alors l'opinion publique,
chasse de Rome, en 593, les trois philosophes députés
par Athènes, Carnéade, Diogène et Critolaus. Au milieu
du siècle suivant, il renouvelle la même expulsion. Nous
verrons Domitien retourner sur ce point aux anciennes
traditions de Rome républicaine. Il y eut donc à presque
toutes les époques une sorte d'antipathie nationale contre
la philosophie, et surtout contre les philosophes de
profession : ceux-ci, pour la plupart exilés, pauvres, vivant
de leur enseignement, n'étaient pas faits pour donner
aux Romains une haute idée de la science qu'ils professaient.
Mais il y eut toujours, chez les Romains, une
certaine hypocrisie politique. Les sénateurs ne voulaient
point que le peuple et la jeunesse s'adonnassent à des
études qui absorbent toute l'activité intellectuelle, font
aimer et rechercher le loisir, et produisent une certaine
indifférence pour les choses de la vie réelle ; mais ils comprirent
bientôt aussi qu'il était interdit à un homme vraiment
digne de ce nom, de rester absolument étranger à une science si importante. Ils votaient donc au Sénat avec
Caton le renvoi des philosophes grecs; mais, rentrés
chez eux, ils se mettaient à lire Aristote, Platon, Épicure,
Zénon. Ils interdisaient aux philosophes grecs l'enseignement
public de la philosophie; mais ils les appelaient
chez eux, se faisaient instruire par eux, les emmenaient
avec eux dans leurs expéditions. Caton lui-même, cet implacable
ennemi des Grecs, étudiait leur langue et leur
philosophie. Quant à des hommes comme P. Scipion l'Africain,
Lélius, Furius, des jurisconsultes comme Q. Elius
Tubéron et Mucius Scévola, ils s'avouaient hautement les
disciples des stoïciens Panétius et Diogène de Babylone.
J'ai montré dans le poële Lucilius, leur contemporain, des
souvenirs manifestes de la doctrine du Portique. Ce fut
en effet le stoïcisme qui pénétra d'abord à Rome, et qui
à toutes les époques exerça sur les Romains la plus profonde
influence. Mais les autres doctrines ne tardèrent pas
à s'introduire aussi à Rome, et y eurent des disciples.
Après la prise d'Athènes par Sylla (667), les écrits d'Aristote
furent apportés à Rome; Lucullus réunit une vaste
bibliothèque, où étaient déposés les monuments de la
philosophie grecque. En même temps, les Romains virent
arriver dans leur ville les représentants des principales
écoles de la Grèce. Il ne fut plus permis à un Romain
lettré d'ignorer une science que tant de maîtres et d'ouvrages
mettaient à la portée de tous. Aussi voyons-nous
que parmi les contemporains de Cicéron, pas un seul ne
resta étranger aux études philosophiques. Chacun d'eux
s'attacha, suivant les tendances de son caractère, à telle
ou telle secte; Lucullus à la nouvelle académie, ainsi que
M. Junius, Brutus et Varron. Lucrèce, Atticus, Cassius,
Velléius, Torquatus, furent épicuriens. Les jurisconsultes Q. Mucius Scévola, Servius Sulpicius Rufus, Tubéron,
Caton, furent stoïciens. Il y eut même une sorte de pythagoricien,
Nigidius Figulus, et un péripatéticien, M. Pupius
Pison.
Mais on se tromperait singulièrement, si l'on voyait
dans ces personnages distingués des philosophes proprement
dits. Pour eux, la philosophie était la marque d'une
haute culture intellectuelle, une sorte de distinction ou
de luxe qu'ils voulaient posséder, mais dont ils ne voulaient
pas être les esclaves. C'était pour eux un magnifique
domaine, qu'on est heureux de posséder, mais
qu'on ne laboure pas. De telles études leur plaisaient,
mais à condition d'être une distraction, non un labeur.
Ils les envisageaient surtout comme un utile auxiliaire
pour l'éloquence, une source abondante de beaux développements;
aussi réduisaient-ils volontiers toute la philosophie
à la morale; et en cela ils suivaient l'exemple
que leur donnaient leurs maîtres, les derniers héritiers des
écoles de Platon,
de Zénon et d'Epicure; ils exagéraient
même cette tendance, en faisant prédominer dans l'étude
même de la morale le côté pratique, les applications immédiates,
en la bornant presque à n'être plus qu'un manuel
à l'usage du citoyen et de l'homme. Même restreinte
ainsi, la philosophie n'était jamais pour eux qu'un passetemps.
Ils s'y adonnaient particulièrement, quand l'exercice
des devoirs de la vie publique leur était interdit;
c'était alors la consolation et le refuge. Comment une
science réduite à tenir si peu de place dans la vie et dans
l'estime des Romains, aurait-elle inspiré des oeuvres sérieuses.
et originales? Parmi les contemporains de Cicéron,
un certain Amafinius, parfaitement inconnu d'ailleurs,
composa un ouvrage sur l'Epicurisme, dont Cicéron ne parle qu'avec mépris. M. Brutus écrivit un traité sur
la vertu, qui n'était qu'une amplification oratoire comme
le traité Sur la gloire, de Cicéron. Le docte Varron résuma
les opinions des philosophes anciens sur le souverain
bien. Aucun de ces ouvrages n'avait un caractère
vraiment scientifique ; ils sont perdus pour nous.
Cicéron parut, et ne fit pas autrement que ses contemporains;
seulement il le fit avec plus d'éclat, dans un
meilleur style; et il toucha à un plus grand nombre de
sujets. Dans sa jeunesse, il étudia la philosophie, parce
qu'elle lui parut une puissante auxiliaire de l'éloquence ;
mais il ne se résolut à composer des ouvrages philosophiques
que dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire
daus des circonstances où il ne pouvait trouver un
autre emploi de ses loisirs. Il vit dans ce travail un passe-temps
et une consolation; il composa sur des matières
philosophiques une suite de discours ou plaidoyers qu'il
eût mieux aimé débiter au Forum, au Sénat, ou devant
les tribunaux. Toutes ses préfaces sont pleines des plaintes
les plus éloquentes à ce sujet. Les misères du temps
qu'un homme comme lui devait sentir plus vivement
qu'aucun autre, les préoccupations douloureuses qui en
étaient la suite, la nécessité de préparer son âme aux plus
extrêmes périls : voilà la première origine des ouvrages
philosophiques de Cicéron. Ce sont entre tous des ouvrages
de circonstance. Inquiet, abattu, malade d'esprit, il
va demander à la sagesse antique les remèdes de l'âme
et la force dont il a besoin.
Dans sa jeunesse, il étudia d'abord l'épicurisme : tout
Romain dépendait des premiers maîtres qui s'offraient
à lui ; et il est certain que cette doctrine avait alors de
fort nombreux représentants, puisque les premiers écrits philosophiques des Romains, ceux d'Amafinius, de Catius,
et le poëme de Lucrèce, sont des expositions de l'épicurisme.
Cicéron fut l'élève de Phèdre et de Zenon,
tous deux épicuriens. Plus tard Philon l'académicien,
Antiochus d'Ascalon, et les stoïciens Diodote et Posidonius
furent tour à tour ou simultanément ses instituteurs.
A l'exemple de ses compatriotes, il ne s'attacha exclusivement
à aucune secte, il fut éclectique. Cependant ses
préférences furent pour la nouvelle Académie. La doctrine
du probabilisme et du vraisemblable convenait
parfaitement à un avocat. D'un autre côté, le stoïcisme,
par son élévation morale, devait avoir prise sur une
âme profondément honnête. De ce mélange de doctrines
se compose ce qu'on est convenu d'appeler la philosophie
de Cicéron. D'une originalité médiocre, elle
avait cependant un grand prix aux yeux de ses contemporains
: elle les instruisait en les forçant à réfléchir et
à comparer les diverses solutions données, par les écoles
anciennes, aux problèmes les plus importants de la destinée
humaine, elle les charmait par les agréments et
l'éloquence du style, et enfin elle les consolait, et entretenait
dans leurs âmes les nobles sentiments et le courage
qui fait mépriser les maux extérieurs. Combien d'oeuvres
plus savantes et plus profondes n'ont jamais eu et
n'auront jamais cette salutaire influence ! Voici la liste
de ses ouvrages.
Le premier en date est de l'année 700. C'est le traité
sur la République ou sur le gouvernement, en six livres, adressé à Atticus. C'est un dialogue dont les interlocuteurs
sont le jeune Seipion, Lélius, Manilius Philus, Tubéron, Mucius Scévola, C. Fannius, conversant
ensemble vers l'année 625 sur la constitution et le
gouvernement de la République, quelques années avant
la grande révolution essayée par les Gracques. Jusqu'en
1814, on ne connaissait de cet important ouvrage que
la conclusion conservée par Macrobe sous le titre de
Songe de Scipion, et quelques passages fort courts cités
par saint Augustin, Lactance et des grammairiens. Le
savant Angelo Mai découvrit sur un manuscrit palimpseste
des commentaires de saint Augustin sur les
psaumes, une partie du texte effacé du traité de la République.
Malgré ces restitutions, l'ouvrage est encore
bien défectueux : des livres entiers sont si mutilés que
c'est à peine si l'on peut reconnaître le plan complet de
l'ouvrage. Les contemporains, l'antiquité tout entière,
les Pères de l'Église eux-mêmes en faisaient le plus
grand cas ; Cicéron n'en parle qu'avec une prédilection
marquée ; il n'est pas loin de croire avec ses amis et
ses flatteurs qu'il a enfin réussi à surpasser les Grecs,
et que sa République est bien supérieure à celle de
Platon et au traité d'Aristote sur la politique. C'est là
une illusion naïve.
Ce qui faisait aux yeux des contemporains
de Cicéron et de Cicéron lui-même le mérite
supérieur de cet ouvrage est justement ce qui en fait la
faiblesse. On s'imaginait qu'un Romain devait écrire
beaucoup mieux sur un tel sujet qu'un Grec, parce que
Rome était plus puissante que n'avait jamais été Athènes.
Cieéron en particulier, Cicéron qui avait été consul, ne
devait-il pas avoir des lumières particulières, fruit de
l'expérience qui manqua absolument à Platon et à Aristote? Enfin on se disait : La république de Platon
est une utopie ; le sens du réel manque absolument
à ces rêveurs de la Grèce ; la politique d'Aristote est
une sèche analyse des diverses formes de gouvernement.
Combien ces deux ouvrages pâlissent auprès de la République de Cicéron, qui est à la fois philosophique et
didactique, qui unit dans une sage proportion l'idéal
qui existe seul chez Platon, et le réel qui existe seul chezAristote ! On retrouve en effet dans Cicéron la fameuse
théorie platonicienne de la justice, sur laquelle est fondé
tout le traité de la république ; mais le philosophe latin
a réduit le principe fécond à un développement oratoire.
Chez lui, aussi, on retrouve le songe d'Herr l'Arménien,
cette vision éclatante des merveilles de l'autre vie ; mais
combien l'horizon s'est rétréci ! Le songe de Scipion, un
des morceaux les plus parfaits qu'ait écrits Cicéron, est
un hors-d'oeuvre imité du grec et habillé à la romaine.
Quant à Aristote, il n'est pas difficile non plus de signaler
les nombreux emprunts que Cicéron lui a faits. La
description des trois formes de constitutions pures, la
démocratie, l'aristocratie, la royauté ; l'analyse des
constitutions mélangées, les principes propres a chacune
des formes de gouvernement, et enfin la théorie
de l'esclavage, ne lui appartiennent pas en propre.
Ainsi et la partie dogmatique et la partie technique
sont des imitations de la Grèce. Mais ce qui faisait aux
yeux des contemporains l'originalité et la supériorité
de l'ouvrage, c'est la place considérable qu'y tenait
Rome. Cicéron en effet avait pris comme idéal de tout
gouvernement la constitution romaine, non point telle
qu'elle existait de son temps, déjà altérée dans son
principe, et penchant visiblement vers une monarchie militaire, mais telle que l'avaient établie les Catons, les
Scipions, les Fabius : elle lui apparaissait comme un
heureux mélange des trois formes de gouvernement, l'aristocratique,
le démocratique, le monarchique. Les consuls
représentaient la monarchie, tempérée par la courte
durée des fonctions; le sénat représentait l'aristocratie,
et le peuple représentait la démocratie. Les pouvoirs et les
attributions des trois ordres étaient si sagement définis ; il
y avait un équilibre si heureux entre ces forces différentes
et non contraires, que Cicéron s'abstenait de chercher la
république idéale qu'avait imaginée Platon, et il avait sur
Aristote cette supériorité qu'il pouvait conclure en disant :"
J'ai trouvé la forme de gouvernement la plus parfaite, ce
que le Stagyrite n'eût jamais osé faire. Voilà ce qui
constitue l'originalité de ce traité. C'est une oeuvre essentiellement
romaine ; et il n'est pas étonnant qu'elle
ait excité une telle admiration. La légitimité des conquêtes
de Rome démontrée à des Romains, l'éloge des
institutions nationales, la glorification des traditions de
la patrie, tout cela était bien fait pour plaire à des contemporains.
Peut-être ne serait-il pas difficile de montrer
que, même conçu ainsi, cet ouvrage se rapproche singulièrement
de celui de Polybe, esprit philosophique
et pratique à la fois, et qui, lui aussi, a pris pour point
de départ de son histoire universelle la constitution romaine.
Le traité sur les Lois, qui parut vraisemblablement
en 702, au moment où Cicéron venait d'être nommé augure,
peut être considéré comme le complément du traité
sur la République. Il présente les mêmes qualités et les
mêmes défauts que ce dernier. Ce n'est ni un ouvrage purement
philosophique, ni un ouvrage de pure jurisprudence, mais une sorte de compromis entre la spéculation et la pratique.
Dans le premier livre, visiblement inspiré de Platon,
et probablement aussi du traité spécial de Chrysippe sur
la Loi, Cicéron démontre avec une grande élévation
de pensée et de style l'existence d'une loi universelle,
éternelle, immuable, conforme à la raison divine et
se confondant avec elle. C'est elle qui constitue le droit
naturel, antérieur et supérieur au droit positif; elle existait
avant qu'aucune loi eût été écrite, avant qu'aucune cité eût
été fondée. Après cette belle entrée en matière, Cicéron
abandonne la métaphysique du droit, et passe à l'examen
des lois positives; le publiciste succède au philosophe.
Mais il s'en faut qu'il recherche dans l'étude des lois
les applications aux diverses formes de gouvernement,
comme l'a fait Montesquieu. De même qu'il n'y avait à
ses yeux d'autre république que la république romaine,
il semble qu'il n'y ait d'autres lois que les lois de Rome.
Du premier coup il a rencontré la législation la plus parfaite ; il ne se donne même pas la peine de démontrer l'excellence
de ces lois par leur rapport étroit avec la
loi universelle : il se borne à une sèche énumération
des textes, qui n'a pas même le mérite d'offrir un ordre
méthodique et rationnel. Les lois qui attirent surtout
son attention sont celles qui règlent les détails et l'ordonnance
du culte. Comment a-t-il pu voir, dans ces règlements
de police inspirés par un formalisme étroit et
une politique menteuse, une émanation directe de la loi
universelle ? De telles chutes ne sont pas rares chez Cicéron
: celle-ci en particulier s'explique tout naturellement
par sa promotion à l'augurat. Il a voulu paraître
aux yeux de ses contemporains profondément versé dans
la connaissance des choses de la religion, et bien digne du dépôt sacré qui lui était confié. Tout le second livre
est consacré à cet inventaire aride. Le troisième livre,
défiguré par quelques lacunes, est consacré à la politique.
Cicéron y examine la nature et l'organisation du
pouvoir, le caractère des diverses fonctions de l'État,
l'antagonisme salutaire, qui doit exister entre les forces
qui le constituent. Ces questions d'un intérêt général
si vif, puisqu'elles touchent directement au problème
de la liberté politique, avaient une importance considérable
et une sorte d'actualité pour les contemporains
de Cicéron. Quelle devait être la part de l'aristocratie
ou du sénat, et celle du peuple dans le gouvernement
de la république ? Le temps n'était pas éloigné où César
devait trancher la question. Tous les esprits avisés prévoyaient
une catastrophe ; on s'efforçait de consolider
l'autorité du sénat et des lois pour opposer au flot démocratique
une barrière plus forte. Quintus, le frère de
Cicéron, représente, dans la discussion relative à cette
grave question, l'obstination et la morgue patriciennes.
Il va même jusqu'à combattre l'institution du tribunat
qu'il déclare impolitique et dangereuse. Cicéron, sans
accepter entièrement les opinions de son frère, reconnaît
cependant les périls qu'une telle magistrature peut offrir
pour le maintien de la paix et de la liberté ; mais il
montre aussi qu'il n'est pas fort difficile de tromper le
peuple, et de briser ainsi entre les mains des tribuns
une arme redoutable. Il conseille de le taire; il croit la
chose juste et utile. Que dut-il penser plus tard, quand il
vit César mettre en pratique, pour détruire la constitution
de l'État, une théorie qu'il croyait faite pour le sauver?
Nous ne possédons que les trois premiers livres du
traité des Lois : il y en avait probablement six. Le quatrième était consacré à l'examen du droit politique, le
cinquième au droit criminel, le sixième au droit civil. Ces
livres sont perdus. On doit d'autant plus le regretter
qu'aucun autre ouvrage de Cicéron sur des matières analogues
ne peut les remplacer pour nous.
N'oublions pas que les traités de la République et des
Lois furent écrits à une époque où la constitution romaine
était encore debout, avant la guerre civile et la ruine de
l'antique liberté. Cette circonstance explique le caractère
des deux ouvrages : ils sont à la fois théoriques et
pratiques, je dirai même techniques. Quand la révolution
sera consommée, l'élément spéculatif dominera dans
la philosophie de Cicéron, on devine bien pourquoi. La
réalité de la vie publique lui échappant, il se réfugie
dans la contemplation.
Le premier en date de ces ouvrages philosophiques de
la seconde période de sa vie est celui qu'on désigne sous
le titre des Académiques (Academica). On peut le
considérer comme l'introduction naturelle aux ouvrages
qui suivent. En effet, la philosophie de Cicéron,
n'ayant rien d'original, devait emprunter aux principaux
systèmes des Grecs les éléments souvent contradictoires
qui la constituent. Cicéron n'est ni un péripatéticien
ni un académicien ; il appartient plutôt il la nouvelle
Académie. C'était la plus récente des doctrines philosophiques,
mais non la plus considérable, il s'en faut de
tout. Cependant c'était celle qui du temps de Cicéron
jouissait, parmi les Romains, de la plus haute considération.
Le scepticisme modéré qui la caractérisait, cette
théorie du vraisemblable érigée en critérium absolu ; cette tendance des nouveaux académiciens à exposer et
à réfuter les unes par les autres les opinions des diverses
écoles; les ressources qu'un tel système offrait à l'art oratoire
: voilà ce qui détermina les préférences de Cicéron.
Il est en effet bien plus intéressant comme historien
de la philosophie que comme philosophe, et en cela
il ressemble fort à ses maîtres de la nouvelle Académie.
L'ouvrage que nous possédons sous le titre de Academica se compose de deux livres : il y en eut deux éditions,
l'une en deux livres, l'autre en quatre; nous avons conservé
le premier livre de la seconde édition, et le second
de la première. C'est un résumé de l'histoire de la
philosophie grecque depuis Socrate jusqu'aux représentants
de l'ancienne Académie, résumé présenté par le
docte Varron. Cicéron prend ensuite la parole et expose la
doctrine de la nouvelle Académie; enfin Lucullus établit
les différences qui séparent la nouvelle Académie de
l'ancienne. C'est dans cet ouvrage que Cicéron se déclare
en philosophie ce qu'il sera toujours, un homme qui ne dit
jamais : "Je suis certain, mais je crois (opinator)". Il ne
porta que trop souvent la même indécision dans les actes
de sa vie politique.
L'année même qui suivit la mort de Caton à Utique,
Cicéron écrivit et adressa à Brutus, neveu de Caton, le
traité qui a pour titre : Des vrais biens et des vrais maux.
Il traduisit, par le mot De Finibus, le titre grec de l'ouvrage
de Chrysippe sur le même sujet. Ce problème
du souverain bien, retourné en tous sens par les
écoles de l'antiquité, était la pierre de touche de chacune
d'elles. En quoi l'homme doit-il faire consister le vrai bien? Est-ce dans la volupté? dans l'absence de la douleur,
dans la jouissance de la vie sous le gouvernement
de la vertu, dans la vertu seule? Toutes ces solutions
avaient été données et d'autres encore qui, moins radicales,
essayaient d'accorder ensemble la volupté et la
vertu. Suivant que l'on adoptait telle ou telle doctrine, on
était dans la conduite de la vie l'homme du plaisir,
l'homme du devoir austère et rigoureux, ou l'homme des
tempéraments, qui s'accommode aux circonstances, ne
rompt en visière avec personne, et, sans cesser d'être
honnête, peut s'entendre jusqu'à un certain point avec
ceux qui ne le sont pas. Il y avait alors à Rome des représentants
de chacune de ces opinions, et la plupart
d'entre eux se montrèrent dans la pratique fidèles à leurs
théories. Le Traité de Cicéron, qui est l'exposition complète
et la discussion des doctrines d'Épicure, de Zénon,
des péripatéticiens et de l'ancienne Académie, devait donc
être d'un intérêt bien vif pour ses contemporains. Les
personnages mêmes qu'il met en scène, Manlius Torquatus,
Caton, Atticus, Papius Piso, et qui exposent le système
de philosophie adopté par chacun d'eux, donnaient
la vie pour ainsi dire à ces doctrines. Dans le premier
livre, Manlius Torquatus développe les principes de l'épicurisme, c'est-à-dire la théorie de la volupté considérée
comme le souverain bien. C'est un plaidoyer ingénieux,
mais fort incomplet et sans profondeur. Il est
réfuté dans le second livre par un autre plaidoyer de Cicéron.
L'épicurisme est la seule doctrine que Cicéron
n'ait jamais voulu admettre dans son éclectisme universel
; et cependant il fut l'ami du plus remarquable épicurien
de ce temps-là, Atticus. Au troisième livre, c'est
Caton qui expose la doctrine stoïcienne. Ce livre est le plus beau et le plus solide de tout l'ouvrage. Cicéron eut
toujours pour le stoïcisme une sympathie secrète dont il ne
put se défendre. II railla plus d'une fois les excès de l'orgueilleuse
doctrine ; mais il comprenait bien que seule elle faisait
les grands citoyens et les gens véritablement honnêtes.
Il la réfute dans le quatrième livre, mais faiblement, en
lui contestant l'originalité de ses principes, qu'il prétend
empruntés aux socratiques. Le cinquième livre est consacré
à l'exposition de la doctrine de l'ancienne Académie.
Les Tusculanes sont de l'année 709. César est maître
de la république, Caton vient de se donner la mort; il
n'y a plus de liberté. Le dictateur est humain, clément
envers ses ennemis; mais il sait leur faire comprendre
que, lui vivant, ils ne seront rien dans l'Élat que ce qu'il
lui plaira. Cicéron vient de composer l'Éloge de Caton,
ouvrage perdu pour nous; César y a répondu par un
Anti-Caton, pamphlet méprisant envers un mort illustre,
sorte de leçon donnée à ses adversaires qui voudraient
exalter aux dépens du dictateur celui qui n'a pu s'opposer
à ses desseins. Cicéron, dégoûté du spectacle qu'offre
Rome, où César ne rencontre plus un seul opposant,
s'est retiré dans sa maison de campagne de Tusculum, et
il essaye d'oublier que la vie publique lui est interdite, en
s'adonnant à l'étude de la philosophie. Les sujets de ses
méditations sont en rapport avec l'état de son âme.
Qu'est-ce que la mort? qu'est-ce que la douleur? Y a-t-il
un moyen d'alléger les afflictions de l'esprit? Qu'est-ce
que les passions? Et comment le sage doit-il se conduire
avec ces ennemis de son repos? Enfin qu'est-ce que la
vertu? Et suffit-elle pour vivre heureux? Voilà les questions qu'il traite dans les Tusculanes. Il le fait abondance avec son et son éloquence ordinaires; mais il y a bien
peu d'originalité dans l'exposition et dans les arguments.
On sent d'ailleurs la réelle impuissance du citoyen à se contenter de ces entretiens avec soi-même. Évidemment
son esprit est à Rome; et toute la philosophie qu'il étale
n'est pour lui qu'un pis-aller. Cependant il sent bien que le moment est venu de se préparer à supporter en homme
les épreuves qui semblent réservées aux derniers amis
de la liberté. Aussi c'est au stoïcisme qu'il va demander
ses virils enseignements.
Le traité de la Nature des Dieux (1),bien que plus dogmatique,
offre le même caractère.
(1) De natura Deorum libri tres.
Il fut écrit en 710,
fort peu de temps avant la mort de César, et adressé à
M. Brutus. Cicéron met successivement en scène un épicurien,
Velleius; un stoïcien, Balbus; et un académicien,
Cotta, qui exposent et discutent les opinions des anciens
philosophes sur les dieux et sur la Providence. L'athéisme
déguisé d'Épicure est réfuté assez vivement par Cotla, qui semble ici servir de prête-nom à Cicéron. C'est
aussi Cotta qui bat en brèche les arguments des stoïciens
sur la Providence ; malheureusement une partie de sa dissertation
est perdue pour nous. On s'étonnera peut-être
que Cicéron n'ait point pris la parole dans le débat. S'il
repousse avec Cotta la doctrine d'Épicure, faut-il croire
qu'il repousse aussi l'opinion stoïcienne si profondément
religieuse? Sur cette grave question, s'est-il, comme les
académiciens, arrêté à un probabilisme vague? Ses admirateurs
déclarés ne le croient point, et prétendent que sur ce point il était fort éloigné du scepticisme. C'est là en effet une opinion assez probable, dirons-nous à notre
tour. Mais, ce qui importe, c'est de constater l'extrême
discrétion de son attitude, qui correspond si bien avec
l'incertitude et le vague de ses convictions. Cicéron est
persuadé que la croyance à l'existence des dieux et à leur
action sur le monde doit exercer une profonde influence
sur la vie ; qu'elle est d'une importance fondamentale
pour le gouvernement de la cité. Donc il faut la maintenir
parmi le peuple. C'est le politique et l'augure qui parlent.
Il ne trouve pas les arguments des stoïciens bien concluants,
et il les réfute par Cotta. C'est l'académicien qui
parle. Enfin, il incline fort à croire que les dieux existent,
et qu'ils gouvernent le monde ; il le croit, parce
que c'est là une opinion commune à tous les peuples; et
que cet accord universel équivaut pour lui à une loi de
la nature (consensus omnium populorum lex naturae putanda
est). Quant à la pluralité des dieux, bien qu'il ne
s'exprime pas catégoriquement sur ce point, il est évident
qu'il n'y croit pas, ou du moins qu'il réduit comme
les stoïciens les dieux à n'être pour ainsi dire que des
émanations du Dieu unique. Celui-ci, il le conçoit comme
un esprit libre et sans mélange d'élément mortel, percevant
et mouvant tout, et doué lui-même d'un éternel
mouvement.
Il n'épargne pas les fables grossières du polythéisme
gréco-romain; il raille et condamne les légendes immorales
communes à tous les peuples. C'est celte partie du
livre de Cicéron (livre III) qui charmait surtout les philosophes
du dix-huitième siècle. Il n'était pas difficile de
tourner en ridicule la religion populaire ; on peut même
dire qu'au temps de Cicéron cela était devenu un lieu
commun philosophique. Les uns, en repoussant avec mépris ces fables grossières, repoussaient aussi toute
croyance; les autres adoptaient la doctrine stoïcienne.
Cicéron ne la trouve point inattaquable; mais l'existence
des dieux est nécessaire; tous les peuples y
croient ; il y croira donc aussi. Il raisonne à peu près
de la même manière sur l'immortalité de l'âme, et
dirait volontiers avec Platon auquel il emprute la plupart
de ses arguments : « C'est un beau risque à courir
et une belle espérance. Il faut s'en enchanter soi-même.
»
Il est beaucoup plus explicite sur la foi que mérite la
divination. L'ouvrage qui porte ce titre est le plus
original qu'il ait écrit. Bien qu'il y discute les opinions
des stoïciens, on sent qu'il est ici sur son terrain, qu'il
a vu fonctionner sous ses yeux la religion romaine, qu'il
a été augure, et qu'il sait ce qu'il faut croire des révélations
divines. Cet ouvrage, ainsi que le troisième
livre de de la Nature des Dieux, ont été le grand arsenal
où les chrétiens puisaient des arguments contre le polythéisme.
Il est à peu près impossible de déterminer le caractère
et la portée de l'ouvrage incomplet que nous possédons
sous le titre de : Sur le Destin (de Fato). Les petits traités
sur la Vieillesse et sur l'Amitiéadressés à Atticus, sont
pleins de grâce et de douceur. Le choix des sujets convenait
parfaitement à la portée philosophique de l'esprit
de Cicéron : ce sont deux plaidoyers, dont le premier est
fort ingénieux et le second plein d'agrément et même
d'éloquence. Les Paradoxes des stoïciens sont un exercice de casuistique oratoire, d'une médiocre valeur.
Le dernier en date de ces écrits philosophiques est le
Traité des devoirs, qui parut en 710, après la mort de
César. Il est adressé par Cicéron à son fils Marcus, qui
étudiait alors la philosophie à Athènes sous la direction
de Cratippe. Le premier livre traite de l'honnête, le second
de l'utile, le troisième de la comparaison entre
l'honnête et l'utile. Le fond de l'ouvrage et les divisions
sont empruntés à Panétius le stoïcien, auteur d'un Traité
sur le devoir. Il ne faut pas demander
à Cicéron, même dans les questions de morale où il
est le plus affirmatif, des recherches profondes sur les
premiers principes et une rigueur scientifique. Cicéron
est un esprit pratique ; son livre est un recueil de précopies
excellents, adressés à son fils. Il veut en faire un
bon citoyen romain, le préparer à l'accomplissement des
devoirs qui constituent cette vertu de l'homme du monde
qui n'a rien d'excessif et d'absolu. De là, les tempéraments
nécessaires entre l'inflexibilité stoïcienne et le
péripatétisme beaucoup plus conciliant. Un critique allemand,
Garve, a fort bien résumé les principaux caractères
de cette philosophie morale. Je lui emprunte le passage
suivant cité par Schoell :
« Lorsque l'auteur n'examine pas la nature morale de
l'homme en général, mais qu'il explique seulement les
devoirs que lui impose la société, on s'aperçoit qu'il a
parfaitement compris la philosophie de son maître; il
l'expose avec la plus grande clarté, et, nous n'en doutons
pas, il l'a enrichie de ses propres découvertes. Mais, dans
les recherches purement théoriques, dans le développement des notions abstraites, lorsqu'il est question de découvrir
les parties simples de certaines qualités morales
ou de résoudre certaines difficultés qui se présentent,
Cicéron ne réussit pas à être clair lorsqu'il copie; et,
quand il vole de ses propres ailes, ses idées ne pénètrent
pas bien avant, mais restent attachées à la superficie.
Parle-t-il de la nature de la bienfaisance, dit décorum,
et des règles du bon ton, de la société et de la manière
de s'y conduire, des moyens de se faire aimer et respecter ? II est instructif par sa clarté et sa précision, il est
intéressant par la vérité de ce qu'il dit, et même par les
idées nouvelles qu'on croit y apercevoir. Mais les doctrines
de la vertu parfaite et imparfaite, du double
décorum et du bon ordre, la démonstration de la
proposition qui dit que la vertu sociale est la première de
toutes les vertus, démonstration fondée sur l'idée de la
sagesse, et surtout la théorie des collisions, qui remplit tout le troisième livre, ne sont ni clairement exprimées
ni bien développées. La situation politique dans
laquelle Cicéron se trouvait, et qui, jusqu'à un certain
point, ressemblait à celle où avaient été placés les plus
anciens philosophes de la Grèce, donne un caractère
particulier à sa morale. Les individus qu'elle a en vue
sont presque toujours les hommes de la haute classe, destinés
à prendre part à l'administration de l'État. Sa morale descend-elle à une autre classe? c'est tout au plus
celle des hommes qui s'occupent de l'instruction et des
sciences. Les autres classes de la société y trouvent, il est vrai, les préceptes généraux de la vertu qui sont communs
à tous les hommes, parce qu'ils ont tous la même
nature; mais elles y chercheraient en vain l'application
de ces règles aux circonstances où elles sont placées; en
revanche, elles y liront beaucoup de préceptes dont elles
n'auront jamais occasion de faire usage.
« Chose singulière ! tandis que les constitutions des
anciennes républiques abaissaient l'orgueil politique, en
faisant dépendre la grandeur de la faveur populaire, les
préjugés du monde ancien nourrissaient l'orgueil philosophique
en n'accordant le privilége de l'instruction
qu'aux hommes que leur naissance ou leur fortune destinaient
à gouverner leurs semblables. C'est par une suite
de cette manière de voir que les préceptes moraux de
Cicéron dégénèrent si souvent en maximes de politique.
Ainsi, lorsqu'il prescrit des bornes à la curiosité, c'est
afin qu'elle n'empêche pas de se livrer aux affaires politiques;
ainsi il recommande avant tout cette espèce de
justice qu'exercent les administrateurs par leur impartialité
et leur désintéressement; et il blâme surtout les
injustices qui sont commises par ceux qui se trouvent à
la tête des armées et des gouvernements. C'est pour la
même raison qu'il s'étend si longuement sur les moyens
de se rendre agréable au peuple, sur l'éloquence, comme
frayant le chemin des honneurs, sur les droits de la
guerre; c'est pour cela que l'amour du peuple et l'honneur
lui paraissent des choses de la plus haute utilité,
c'est pour cela que ses exemples sont tous tirés de l'histoire
politique. Enfin cette manière de voir est la cause de la grande
inégalité qui se trouve dans le développement que Cicéron
donne aux différentes espèces de devoirs. Ceux par lesquels l'homme perfectionne sa nature morale ou son
état extérieur ne sont que brièvement indiqués. La vie
domestique n'est prise en considération qu'autant qu'elle
forme le passage à la vie civile et qu'elle sert de base à
la vie sociale. Les devoirs de la religion sont entièrement
passés sous silence. Les rapports seuls que présente la
société civile sont regardés comme importants : quelques-uns sont traités avec un détail qui appartient plutôt
à la science politique. »
Les autres ouvrages philosophiques de Cicéron ne
nous sont point parvenus. Nous ne possédons qu'un
fragment du Timée, imitation
de Platon. Les traités de la Gloire, l'Oeconomique, traduction de Xénophon,
le Protagoras, traduction de Platon, l'Éloge de Caton, composé après la mort de celui-ci à Utique
en 708; un autre éloge de Porcia, fille de Caton; un
livre sur la Philosophie,
une Consolation que Cicéron s'adressa à lui-même après
la mort de sa fille Tullia, ont péri pour nous. Probablement
d'autres encore ont subi le même sort, dont nous
ne connaissons pas même les titres.
Bien que je n'aie pu m'étendre longuement sur cette
partie des oeuvres de Cicéron, je crois en avoir assez dit
pour bien en déterminer le caractère. Cicéron n'est pas
un philosophe ; c'est un Romain qui, d'après les philosophes
grecs, compose sur certaines questions des écrits
clairs, élégants et même éloquents. Il s'adonne à cette
étude dans les loisirs forcés que lui créent les misères du
temps; il y trouve une distraction à ses tristes pensées et
une consolation. Il se flatte aussi de disputer aux Grecs la victoire en ce genre, comme il l'avait fait pour l'éloquence,
et de donner à sa patrie une littérature philosophique
qui lui manquait. Nous avons vu combien l'originalité
lui fait défaut, et, ce qui est plus grave, combien
il s'en souciait peu. On ne peut guère douter qu'il ne se
crût supérieur à la plupart des Grecs qu'il imitait, si l'on
en excepte Platon. Et il esi fort probable qu'il leur était
en effet supérieur sous le rapport du style, de l'élégance
et de l'abondance. Peut-être même a-t-il été convaincu
que le bon sens pratique, dont il était doué au plus haut
point, faisait de lui un philosophe bien plus remarquable
et plus utile à ses contemporains que les Zénon
et les Épicure. Il semble avouer cette prétention dans le
traité des Devoirs, son dernier ouvrage. Et il ne serait pas
étonnant que les contemporains pour lesquels il écrivait
eussent partagé cette illusion. La philosophie de Cicéron
devait en effet être à leurs yeux la vraie philosophie, celle
qui seule convenait à des Romains. Nous savons tout ce
qu'il y a d'étroit et de borné dans ce point de vue. Mais
il est un mérite qu'on ne peut refuser à Cicéron : il est
pour nous une des sources les plus précieuses pour l'histoire
de la philosophie, grâce à la rareté extrême des
ouvrages conservés. Ajoutons aussi qu'il a porté dans
la composition de ses écrits les admirables qualités de
son esprit et de son style. Il n'a point la grâce souveraine
de Platon, il ne peut lui être comparé dans la
forme du dialogue ; car Cicéron ne peut converser, il
faut qu'il plaide : mais chez qui trouverait-on plus de
clarté, d'élégance, d'éclat et de mouvement?
§ VII.
LES LETTRES DE CICÉRON.
La correspondance de Cicéron est une des sources les
plus précieuses pour l'histoire si intéressante des derniers
temps de la république. Nous ne possédons en effet, sur
cette période, que des documents fort incomplets et souvent
inexacts. Nous avons perdu Tite-Live, Salluste,
Asinius Pollion, les Mémoires d'Auguste, et bien d'autres
écrits rédigés par des hommes qui furent témoins ou acteurs
dans les événements qu'ils rapportaient. Perte regrettable
assurément, mais si la correspondance de Cicéron
nous était parvenue entière, elle remplacerait les
documents qui nous manquent. Nous n'en possédons que
le quart, environ mille lettres écrites par Cicéron lui-même
ou par ses correspondants. Ceux-ci, personnages
politiques mêlés aux événements, ou les suivant avec intérêt
et perspicacité, comme Atticus, seraient pour nous
des témoins d'une autorité bien plus sûre que Tite-Live
lui-même, et à plus forte raison Auguste. Telle qu'elle
est cependant, cette correspondance jette la plus vive lumière
sur cette époque si agitée. Il ne nous appartient
pas d'en présenter le tableau : nous nous bornerons à
indiquer le caractère général des lettres qui s'y rapportent.
Le recueil des Lettres de Cicéron est le plus ancien qui
nous soit parvenu, mais ce n'est pas le premier qui ait
été publié. Caton le Censeur avait publié les lettres qu'il
adressait à son fils. Mummius en avail écrit du siége de
Corinthe à ses amis ; c'étaient des lettres enjouées, spirituelles, qu'on se communiquait et qui étaient encore
lues cent ans plus tard. Enfin C. Gracchus et sa mère, la
fameuse Cornélie, avaient aussi publié des recueils de
lettres. Il n'est donc pas étonnant que celles de Cicéron
aient été réunies. Elles ne parurent qu'après sa mort, il
est vrai, mais nous ne pouvons douter que de son vivant
il n'eût songé lui-même à les livrer au public. Il dit à
Atticus : « Il n'y a point de recueil de mes lettres, mais
Tiron en a à peu près soixante et dix, et l'on en prendra
quelques-unes chez vous. Il faut ensuite que je les revoie,
que je les corrige, et l'on pourra alors les publier (1). »
(1) Voir Boissier, "Recherches sur la manière dont furent recueillies et publiées les lettres de Cicéron."
Ce petit nombre de soixante-dix nous autorise à penser que Cicéron faisait un choix parmi les lettres qu'il voulait livrer à la publicité, et qu'il en retranchait celles qui avaient un caractère intime et tout à fait confidentiel. Il importe de se faire une idée exacte de ce qu'était alors le commerce épistolaire. Les Romains de ce temps avaient comme nous des intérêts, des affections, des préoccupations de la vie domestique ; les lettres dans lesquelles ils traitaient des questions de ce genre n'étaient évidemment pas destinées à la publicité. Atticus, qui fut le principal éditeur des oeuvres de Cicéron, publia même les lettres qui avaient ce caractère (1) ; et il est permis de supposer qu'il supprima plus d'une lettre politique qui l'eût compromis aux yeux de ceux qui avaient fait ou laissé périr Cicéron.
(1) Ces lettres dont Cicéron disait : " Elles sont si pleines de mystère que je ne les confierais pas même à la main d'un secrétaire."
Quant aux lettres qui traitaient
des affaires publiques, bien qu'adressées à un seul homme, elles étaient le plus souvent écrites pour être communiquées à d'autres ; on en tirait des copies; le nombre de ces copies s'augmentant, on pouvait tes sidérer comme ayant été publiées, lors même que l'auteur
n'en eût point eu l'intention formelle. Qu'on songe aux intrigues si compliquées qui se tramaient alors au Sénat, au Forum, devant les tribunaux, dans les provinces,
a ce duel qui se prépara si longuement entre Pompée
et César, puis entre les républicains et Antoine, enfin entre Antoine et Octave : quel citoyen pouvait rester indifférent dans cette mêlée de passions, d'intérêts, où le sort de la république et des particuliers était chaque jour
mis en question? Une démarche de Pompée, un pas en avant fait par César, le long débat dans le Sénat sur la prolongation des pouvoirs des deux adversaires, les émeutes
du Forum excitées par les tribuns favorables ou hostiles
à César, les procès politiques suscités de part et autre : tous ces événements, qui se présentaient chaque joui, donnaient une occasion toute naturelle aux hommes politiques d exprimer, dans une lettre qui était lue et commentée par tout le monde, leurs opinions et leurs sentiments sur les personnes et sur les choses. Ces lettres étaient de véritables manifestes politiques. J'en ferais
volontiers une classe à part. Enfin il y en avait d'autres
qui étaient à la fois intimes et politiques : ce sont celles
que les absents de Rome écrivaient à leurs amis, et celles
qu ils en recevaient. La plus grande partie de la correspondance de Cicéron se compose des lettres qu'il écrit pendant son exil et son proconsulat en Cilicie, autre exil
« de celles qu'il se fait écrire pour se tenir au courant
des événements de chaque jour.
Voici comment les éditeurs anciens ont rangé les lettres de Cicéron et de ses amis. Un premier recueil comprend les lettres à Atticus. Il
se compose de seize livres. A part neuf lettres antérieures
au consulat de Cicéron, elles sont toutes postérieures à
l'année 693, et vont jusqu'à l'année 710. C'est Atticus
lui-même qui les publia, ou plutôt qui en prépara la publication,
laquelle selon toute probabilité n'eut lieu qu'après
sa mort en 721. C'est sans doute le même esprit de
prudence qui décida cet habile personnage à ne pas insérer
une seule de ses lettres dans le recueil. Cicéron loue
souvent son ami de la noblesse et de la fierté de ses sentiments
patriotiques : Atticus aima mieux que la postérité
crût Cicéron sur parole que de laisser subsister un témoignage
écrit de ses opinions politiques. Du reste,
épicurien, éloigné par principe des orages de la vie publique,
homme d'étude et de plaisir, collectionneur de
curiosités, il eut l'art d'être et de rester jusqu'au bout
l'ami des personnages les plus considérables de tous les
partis. Grâce à ces habiles ménagements, il mourut fort
âgé, et il eut l'honneur d'être le beau-père d'Agrippa.
Voilà l'homme auquel Cicéron confia pendant dix-sept ans
ses plus secrètes pensées, ses joies, ses tristesses, ses espérances,
ses craintes. Rien n'égale l'abandon et la sincérité
de cette correspondance. Elle montre Cicéron en
déshabillé, vivant au jour le jour, politique irrésolu,
âme faible, mais parfaitement droite et pure. Evidemment
la plupart de ces lettres n'étaient point destinées
par lui à la publicité. Elles n'en ont que plus d'intérêt
pour nous.
Le second recueil comprend les lettres dites familières
ou à divers peronnages, en seize livres. Nous en devons la conservation à Pétrarque qui en découvrit et
copia de sa main le manuscrit en 1345. C'est vraisemblablement
l'affranchi Tiron qui composa et publia le recueil,
soit à l'aide des papiers de Cicéron qui gardait
copie de ses lettres les plus importantes, soit en ayant
recours à Atticus et aux correspondants même de Cicéron.
Quoi qu'il en soit, la disposition du recueil est fort confuse ;
de plus nous ne pouvons douter qu'il n'y ait des lacunes
énormes. Des livres entiers consacrés à un seul correspondant
sont entièrement perdus. Du reste aucun ordre
chronologique ni de matières : mais c'est la partie la plus
intéressante de la correspondance de Cicéron ; car c'en
est la plus variée. Non-seulement nous le retrouvons en
scène, mais avec lui tous les personnages les plus considérables
du temps. Tantôt c'est Cicéron qui les tient au
courant des affaires de Rome dont ils sont éloignes ; tantôt
au contraire c'est à lui qu'on mande les nouvelles.
Ainsi ce commerce épistolaire nous fait connaître les
événements d'abord, les idées et les sentiments de Cicéron
ensuite, et enfin le caractère des correspondants. Il
est regrettable qu'il se soit conservé si peu de lettres de
Marc-Antoine, de César, de Pompée, d'Octave, de Cassius,
de Brutus et de Caton ; peut-être la correspondance
de Cicéron avec ces personnages illustres faisait-elle l'objet
d'un recueil particulier que nous avons perdu. Voici
les noms des principaux correspondants dont nous avons
conservé quelques lettres : Marc-Antoine, L. Cornélius
Balbus, Décimus Junius Brutus, Marcus Junius Brutus,
Cassius, César, Caton, M. Coelius Rufus, Dolabella, gendre
de Cicéron, Servius Sulpicius Galba, aïeul de l'empereur
Galba, P. Lentulus Spinther, M. Emilius Lépidus, un des triumvirs, Luccéius, l'historien, Pompée, M. Claudius Marcellus, pour qui plaida Cicéron, Cn. Matius, l'ami
particulier de César, Munatius Plancus, l'homme de tous
les partis, le traitre de toutes les causes, Asinius Pollion,
le détracteur de toutes les gloires, Servius Sulpicius Rufus,
le célèbre jurisconsulte et le grand citoyen, Trébonius,
un des meurtriers de César, et Vatinius, contre
qui Cicéron a prononcé une si violente harangue. On
pourrait ajouter à cette liste les noms des hommes politiques
à qui Cicéron a écrit, mais dont nous n'avons aucune
lettre, comme Curion, Appius Pulcher, Q. Thermus,
Caninius Sallustius, Nigidius Figulus, Cn. Plancius,
les Métellus, Sextius, Torquatus, Trébatius, Varron,
Memmius, Cluvius, Acilius, Titius Rufus, Philippus,
Alliénus, et enfin Terentia, la femme de Cicéron, Tullia,
sa fille, et Tiron, son affranchi.
Ces documents historiques, rédigés au jour le jour, offrent
le plus grand intérêt; il serait facile de tirer de
cette correspondance une galerie de portraits fort curieuse.
Cicéron figurerait en tête, nous le retrouverions
avec ses hésitations, ses abattements, ses fausses démarches, ses élans de confiance suivis de désespoirs profonds,
sa vanité naïve et expansive. Un grand nombre
de ces lettres étaient évidemment destinées à la publicité ;
elles sont écrites avec un soin extrême; et l'on y retrouve
l'orateur. Atticus, qui était à l'affût de tout ce qui sortait
de la plume de son ami, lui réclame plus d'une fois telle
ou telle lettre qu'il vient d'adresser à un personnage important
sur un événement grave; et Cicéron lui répond
qu'elle n'est pas perdue (salvum est), ce qui prouve
qu'il en gardait copie. Quant aux lettres plus familières, elles ont une grâce et un charme tout particuliers. Cicéron
était passé maître dans l'art délicat des coquetteries
du style; il a des caresses délicieuses d'expression, une
remarquable souplesse et un abandon parfait. Ces qualités,
que l'on voudrait trouver plus souvent chez l'orateur,
contrastent heureusement avec le ton un peu guindé,
l'aspérité un peu sèche de quelques-uns de ses correspondants.
J'en excepterais l'honnête Matius, dont la lettre
sur le meurtre de César est fort touchante.
Un des plus intéressants personnages de ce groupe
d'amis est Caelius Rufus, dont les lettres à Cicéron forment
tout le huitième livre. On peut voir quelques-unes
des réponses de Cicéron au lIe livre des Lettres familières.
Caelius fut un des correspondants les plus actifs de
Cicéron pendant son proconsulat de Cilicie. L'orateur
avait sauvé Caelius d'une accusation de meurtre, et le
plaidoyer que nous possédons encore est un des plus
instructifs pour la connaissance des moeurs de ce temps.
Caelius fut successivement tribun du peuple, édile et préteur.
C'est pendant son édilité, qu'il tient Cicéron au courant des nouvelles de Rome. Caractère léger, esprit facile
et brillant, Caelius, dont la jeunesse avait été fort turbulente,
jugeait finement et peignait en traits heureux les
hommes et les choses. Il y a de lui de singuliers aveux sur
les tribunaux d'alors. « Nous acquittons tout le monde,»
dit-il à Cicéron. Rien ne l'émeut, il se moque de tout; il
regrette à chaque instant que Cicéron ne soit pas là pour
rire avec lui de tel ou tel. Une seule préoccupation sérieuse
le tient en éveil; il craint que Cicéron oublie de
lui envoyer de Cilicie les panthères qu'il lui a promises
et qui feront si bel effet dans le cirque !
Un recueil particulier contient les lettres de Cicéron à son frère Quintus (l) ; elles forment trois livres.
(1) Episiolarum ad Q. fratrcm libri tres.
Quintus Cicéron, de quelques années plus jeune que son frère, suivit
comme lui la carrière des honneurs. Il était préteur
en 691, et ce fut probablement devant lui que Cicéron
plaida pour Archias. Il fut ensuite lieutenant de Pompée
en Sardaigne et de César dans les Gaules. Il combattit à
Pharsale dans l'armée de Pompée, et fit sa soumission
aussitôt après. A la mort du dictateur, il se déclara contre
Antoine et contre le triumvirat, et périt peu de temps
après son frère. Le petit Traité sur la manière de briguer
le consulat (De Petitione consulatus) est peut-être de lui.
Il avait de plus composé des annales, ou des commentaires
sur l'expédition des Gaules, qui sont perdus. Il
faisait des tragédies. Les lettres que Cicéron adresse à
Quintus sont ou des lettres de conseil, ou des lettres de
nouvelles. L'une d'elles expose longuement les idées de
Cicéron sur l'administration des provinces et particulièrement
de l'Asie, où Quintus était propréteur. C'est un
fort beau Traité sur les devoirs d'un gouverneur romain.
Celles du second et du troisième livre sont toutes politiques.
Quintus était alors en Sardaigne ou en Gaule, et
Cicéron le tenait au courant de la situation des partis à
Rome.
Le dernier recueil se compose d'un seul livre et comprend
les lettres de Cicéron à Marcus Brutus et de Brutus à Cicéron
et à Atticus. C'est un faible fragment de la correspondance
de ces deux grands hommes; nous savons en
effet qu'elle comprenait au moins neuf livres, et commençait
aux premiers temps de la liaison de Brutus avec
Cicéron pour ne finir qu'à la mort du premier : il ne nous en reste que vingt-cinq lettres. Nul recueil n'était plus
célèbre dans l'antiquité. Ce personnage de Brutus exerçait
et exerce encore une sorte de fascination sur l'esprit
des hommes. Sous le règne des empereurs, les historiens,
les rhéteurs, les grammairiens évoquent sans cesse le souvenir de ce personnage ; c'était, disaient les républicains
du temps de Tibère, le dernier des Romains. Jamais
deux caractères ne furent plus dissemblables que celui
de Cicéron et celui de Brutus. Autant Cicéron était doux,
bienveillant, mesuré dans la forme, autant Brutus était
âpre et tranchant."(Même quand il m'écrit pour me demander
quelque chose, dit Cicéron, il est aigre, arrogant,
insociable." Les misères du temps auraient dû rapprocher ces deux hommes de bien ; et ils se rapprochèrent
en effet; mais de graves dissentiments éclatèrent entre
eux. Pour Cicéron, le véritable ennemi de la république
et de la liberté, c'était Antoine, Antoine qui osait rêver
de recueillir l'héritage de César, Antoine qui était adoré
des soldats du dictateur, et comptait bien les lancer
contre le sénat et l'opposition républicaine. Cicéron
songeait à opposer à Antoine le jeune Octave dont les
feintes caresses et les hypocrites flatteries l'avaient
séduit. Il se portait garant des intentions pures de ce jeune homme. Il chantait sans cesse ses louanges devant
le sénat (Ille et IVe Philippique). Brutus, au contraire, redoutait peu Antoine, à qui il supposait des sentiments généreux; mais il n'avait que du mépris et de la
défiance pour le jeune César dont il devinait la duplicité
et l'ambition. Tous deux se trompaient, l'un sur Octave,
l'autre sur Antoine. De plus, Cicéron voulait que Brutus,
après le siège de Modène, quittât la Macédoine où il s'obstinait
à poursuivre Dolabella, pour venir en Italie même au secours de la République menacée. On sait comment
ces hésitations fatales perdirent et la liberté et ses derniers
défenseurs. Dans cette correspondance,
Brutus est
âpre, violent, parfois injuste, mais en somme il a le plus
beau rôle. Cicéron n'avait pas rougi de recommander à la
bienveillance d'Octave un homme tel que Brutus. Celui-ci
s'en indigna, et il répondit à Cicéron la lettre la plus
fière et la plus dure qu'on puisse imaginer. Elle est un
chef-d'oeuvre.
Certains critiques anglais et allemands, Tunstalt, Markland
et Wolff, ont nié l'authenticité de cette correspondance.
Les raisons historiques et grammaticales qu'ils ont
données à l'appui de leurs assertions sont loin d'être convaincantes.
§ VIII.
Les nombreux ouvrages dont j'ai donné une rapide
analyse ne sont pas les seuls qu'ait composés Cicéron. Il
s'en est perdu peut-être autant qu'il en a été conservé.
Le recueil de ses Lettres est évidemment incomplet; il
s'en faut que nous possédions tous ses discours. Le grand
ouvrage sur la République est mutilé. D'autres sont complètement
perdus, comme le traité de la Gloire, l'Éloge de
Caton, les livres sur la Philosophie, adressés à Hortensius,
une Consolation, etc. On trouve à la suite de toutes
les éditions de Cicéron l'indication des ouvrages perdus.
Je ne puis qu'y renvoyer le lecteur.
Je dois dire un mot cependant de ses poëmes. Nous
n'en possédous que des fragments, dont un seul est de
quelque étendue. La plupart sont des oeuvres de sa jeunesse, sauf cependant celui dans lequel il a célébré la
gloire de son consulat. C'est dans ce dernier que se trouve
le vers célèbre
0 fortunatam natam me consule Romam !
dont Juvénal s'est moqué, et dont on se moque encore. Le
caractère général de ces diverses productions semble être
le manque absolu d'invention. Partout et toujours des
imitations ou des traductions du grec. Il y en a d'assez
bien réussies, comme les lamentations d'Hercule, empruntées à Sophocle (Trachiniennes), et celles de Prométhée.
Quant aux fragments imités d'Aratus, ce sont des descriptions peut-être exactes des phénomènes célestes
et des pronostics, mais elles n'exigeaient pas des facultés
poétiques bien rares. C'est au point de vue de la
langue et de la versification que ces diverses tentatives
offrent quelque intérêt. Cicéron se rattache directement à
Eunius et à Attius (on sait qu'il faisait le plus grand cas de ces deux poëtes); mais il ne rencontre jamais les fortes
expressions du premier, ces audaces heureuses d'une
inspiration franche et vive. Par contre, sa phrase est d une allure plus dégagée, moins chargée de mots; mais
elle n'a pas le mouvement poétique. D'autre part, la concision
vigoureuse d'Attius semble avoir été goûtée et recherchée par Cicéron ; mais, excellente dans une tragédie,
elle était déplacée dans un poërne descriptif. Quant à la
versification, elle est sans originalité aucune : si on la
rapproche de celle de Lucrèce, son contemporain, elle
paraît généralement plus châtiée, plus régulière, mais
d'une banale uniformité. Il manque à tous ces essais le je
ne sais quoi qui trahit un vrai poëte.
FIN DE L'OUVRAGE
![]()