
Des Lois
de
Cicéron
Traduction par M. Ch. de Rémusat
Nisard
1869

livre 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
livre 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20.
I. ATTICUS. Voilà, sans doute, le bois, et voici le chêne d'Arpinum (1)
(1) Arpinum, ville municipale de la terre des Volsques, fut la patrie de Cicéron, qui toujours y conserva une maison de campagne; c'est là que se passe la scène -livre ii, chap. 1. C. Marius était du même pays. Cette circonstance fut apparemment une des causes de l'admiration que Cicéron professa constamment pour un homme dont les crimes surpassèrent les exploits, et qui, pendant toute sa vie, conduisit le parti politique que Cicéron combattit toute sa vie. Très jeune encore, il avait pris des engagements envers la gloire de Marius, en le choisissant pour le héros d'un poème. Dans le petit nombre de vers qui nous en restent, se trouve le passage auquel. Atticus l'ait allusion. Marius banni, avant de gagner la mer, veut revoir Arpinnus; là, à l'aspect d'un aigle qui, prenant son essor d'un arbre voisin, enlève un serpent dans ses serres, le déchire à coups de bec, le rejette tout sanglant sur la terre, et s'envole vers l'orient au bruit d'un coup de tonnerre à gauche, l'illustre exilé sent ses espérances renaître et son cœur se raffermir (de Div., i, 47). Ce passage contient les plus beaux vers qui nous soient restés de Cicéron; ils ont été souvent imités par Voltaire, Delille, Ducis, etc.
; je les reconnais, tels que je les ai lus souvent dans le Marius. Si le chêne vit encore, ce ne peut être que celui-ci; car il est bien vieux. QUINTUS. S'il vit encore, cher Atticus! il vivra toujours; car c'est le génie qui l'a planté, et jamais plant aussi durable n'a pu être semé par le travail du cultivateur que par le vers du poëte. ---ATT. Comment cela, Quintus ? et qu'est-ce donc que plantent les poëtes ? Vous m'avez l'air, en louant votre frère, de vous donner votre voix. — QUINT.Soit; mais tant que les lettres parleront notre langue, on ne manquera pas de trouver ici un chêne qui s'appellele chêne de Marius ; et ce chêne, comme l'a dit Scévola (1) du Marius même de mon frère, Vieillira des siècles sans nombre.
(1) On ne sait si Quintus veut parler de Scévola l'augure, qui fut consul l'an de Rome 636, et mourut l'an 665, ou de Scévola le pontife, consul en l'année 658 avec L. Crassus, et massacré treize ans plus tard devant la statue de Vesta. Cicéron avait beaucoup fréquenté l'un et l'autre (de Amicit., c. i), et il sera encore parlé de tous deux dans le cours de l'ouvrage (i, 4, 5; ii, 20). Cependant, comme Cicéron a coutume d'ajouter quelque désignation au nom du dernier, M. Wagner croit qu'il s'agit ici de l'augure. En tous cas, celui dont il est question avait apparemment composé en l'honneur du poème de Marius quelque pièce d'où ce vers est extrait. Sa prédiction ne s'est point accomplie.
Est-ce que par hasard votre Athènes aurait pu conserver dans sa citadelle un éternel olivier ? ou montrerait-on encore aujourd'hui à Délos ce même palmier que l'Ulysse d'Homère y vit si grand et si flexible, et bien d'autres choses qui, en bien des lieux, vivent plus longtemps dans la tradition qu'elles n'ont pu subsister dans la nature? Ainsi, que ce chêne chargé de glands, d'où s'envola jadis L'orgueilleux messager du monarque des cieux, soit celui-ci, j'y consens; mais, croyez-moi, quand les saisons et l'âge l'auront détruit, il y aura encore dans ce lieu le chêne de Marins. — ATT. Je n'en doute pas assurément ; mais je demanderai maintenant, Quintus, non plus à vous, mais au poëte lui-même, si ses vers seuls ont planté le chêne, ou si ce qu'il a raconté de Marius est vrai. — MARCUS. Je vous répondrai, Atticus ; mais vous, d'abord, répondez-moi: N'est-cepas non loin de votre maison qu'après son départ de la terre, Romulusse promenait, lorsqu'il dit à Julius Proculus qu'il était dieu, qu'il s'appelait Quirinus, et qu'il ordonna qu'un temple lui fût dédié dans ce lieu même ? et à Athènes, n'est-ce pas aussi non loin de votre antique demeure qu'Orithyie fut enlevée par Borée ? car telle est la tradition. — ATT. Que voulez-vous dire ? et pourquoices questions ? _ MARC. Rien, sinon qu'il ne faut pas trop diligemment vous enquérir des récits de ce genre.—ATT.Toutefois il y en a beaucoup dans le Marius, dont on demande s'ils sont faux ou vrais ; et certaines gens exigent presque de la rigueur dans un poëme sur un sujet si récent, et dans un poëte du pays d'Arpinum. — MARC. Eh mais! assurément, je désire ne point passer pour menteur. Cependant ceux dont vous parlez, Titus, l'entendent mal de vouloir dans cet essai la vérité, non pas d'un poëte, mais d'un témoin. Je ne doute pas que les mêmes gens ne soient convaincus que Numa s'entretenait avec Égérie, et qu'un aigle mit un bonnet pointu sur la tête de Tarquin. —QUINT. Je vous comprends, mon frère ; autres sont à votre avis les lois de l'histoire, autres celles de la poésie. —MARC. Oui, puisque tout dans l'une se rapporte à la vérité, et presque tout dans l'autre à l'amusement. Ce n'est pas que dans Hérodote, le père de l'histoire, et dans Théopompe, il n'y ait d'innombrables fables.
II. ATT. Je trouve enfin une occasion que je désirais,et je ne la négligerai pas MARC. Laquelle donc, Titus ?—ATT. Depuis longtemps on vous demande,et on vous demande avec instance une histoire : on pense en effet que si vous traitiez ce genre, la Grèce n'aurait plus rien à nous disputer. Et pour vous en dire mon avis, il me semble que c'est un présent que vous devez non seulement aux désirs de ceux qui aiment les lettres, mais encore à votre patrie, qui serait illustrée ainsi par celui qui l'a sauvée. L'histoire manque en effet à notre littérature ; je le trouve moi-même, et je vous l'entends dire souvent. Or, vous pouvez assurément satisfaire à ce besoin, puisque, de votre propre aveu, c'est un genre d'écrit éminemment oratoire. Commencez donc,je vous prie, et prenez du temps pour un travail jusqu'à présent ignoré ou négligé de nos auteurs; car après les annales des grands pontifes, composition, sans contredit, des plus agréables, si nous passons à Fabius (1), ou à celui dont vous avez sans cesse le nom à la bouche, à votre Caton, ou bien encore à Pison, à Fannins, à Vennonius, en admettant que parmi eux l'un soit plus fort que l'autre,quoi de plus mince cependant que le tout ensemble?
(1) La plupart des historiens ici nommés sont peu connus: à peine avons-nous quelques citations de quelques-uns d'entre eux. Je ne dirai qu'un mot de chacun. - Fabius Pictor, le plus ancien de tous, est loué par Tite Live, qui le fait contemporain de la seconde guerre Punique (i, 44; xxii, 7). Caton le censeur, ou l'ancien, plus célèbre comme personnage politique, est l'objet de la continuelle admiration de Cicéron; nous avons sous son nom le livre de Re rustica, et quelques fragments. L. Calpurnius Pison Frugi fut consul avec P. Mucius, l'an de Rome 620. Il écrivit des Annales que Cicéron trouve mesquines, exiliter scriptos. (Brut., 27). C. Fannius, gendre de Lélius le sage, fut historien et orateur (Brut. 26; de Amicit. I, et passim). Vennonius est inconnu: Cicéron seul nous a conservé son nom (ad Att., xii,3). L. Célius Antipater avait écrit l'histoire de la seconde guerre Punique (Orat. 69). Cicéron porte ailleurs de lui le jugement qu'il met ici dans la bouche d'Atticus, de Orat. ii, 12 et 13. Sext. et Cn. Gellius, comme historiens, avaient peu de réputation (de Divinat. I, 26; Den. d'Halicarn. i, 7). Clodius Licinius, dont Tite Live fait l'éloge (xxix, 22), fut à peu près contemporain d'Asellion, qui, selon Aulu-Gelle, N. A., ii, 13, fut tribun des soldats sous P. Scipion l'Africain au siège de Numance, et composa l'histoire des événements auxquels il avait pris part. C. Licinius Macer est peu connu, quoique souvent cité par Tite Live: il vivait du temps de Sisenna. Lucius Sisenna fut préteur, et mourut dans l'Ile de Crète, où il commandait une armée. Il avait écrit particulièrement l'histoire de la guerre Sociale et de celle de Sylla. (Vell. Pat., ii, 9). Il fut au barreau le contemporain et le rival d'Hortensias et de Sulpicius; mais jamais, au témoignage de Cicéron, il ne put surpasser ni l'un ni l'autre (Brut. 64). Clitarque, fils de Dinon, accompagna Alexandre le Grand en Asie, et écrivit le récit de cette expédition (Plin., vi, 31). Comme historien, il passait pour plus ingénieux que fidèle (Quintil., x, i). Longin dit que c'est un auteur «qui n'a que du vent et de l'écorce», et le compare à un homme qui ouvre une grande bouche pour souffler dans une petite flûte.» (Du Subl., 2.)
Le contemporain
de Fannius, Célius Antipater éleva
bien un peu le ton ; il montra une certaine vigueur
rude et inculte, sans éclat, sans art, et du moins
pouvait-il avertir les autres d'écrire avec plus de
soin ; mais voilà qu'il eut pour successeurs des Gellius, un Clodius, un Asellion, qui se réglèrent
moins sur son exemple que sur la platitude
et l'ignorance des anciens. Compterai-je Macer,
dont le bavardage a bien quelques pensées, mais
de celles qu'on trouve, non dans les savants
trésors des Grecs, mais dans nos chétifs recueils
latins? Dans ses discours, une prolixité, une inconvenance qui va jusqu'à l'extrême impertinence.
Sisenna, son ami, a sans doute surpassé tous
nos historiens, ceux du moins qui ont publié
leurs écrits ; car nous ne pouvons juger des autres.
Jamais cependant, comme orateur, on ne
l'a compté parmi vous ; et dans l'histoire, il
laisse bien voir, à sa petite manière, qu'il n'a pas
lu d'autre Grec que Clitarque, et que c'est lui
seul qu'il veut imiter ; et toutefois, l'eût-il égalé,
il serait encore loin d'être parfait. Vous le
voyez, Cicéron, c'est votre affaire; on l'attend
de vous : Quintus penserait-il autrement?
III. QUINT. Moi? point du tout, et nous en avons parlé souvent ensemble ; mais il y a entre nous un petit débat. — ATT. Qu'est-ce donc? -QUINT.De quelle époque doit-il d'abord s'occuper ? Selon moi, des temps les plus reculés; car les histoires que nous en avons sont telles, qu'on ne les lit seulement pas : mais lui, il se déclare pour une histoire contemporaine, qui puisse embrasser tous les faits auxquels il a pris part.—ATT. Pour moi, je serais plutôt de cet avis ; car il y a de grandes choses dans les fastes de notre temps. Il y pourra d'ailleurs célébrer un homme qui nous est bien cher, Cn. Pompée; il y rencontrera aussi son année, sa mémorable année; et j'aime mieux qu'il nous raconte de telles choses, que tous les dit-on de Rémus et Romulus. — MARC. Je sens bien que c'est là depuis longtemps le travail qu'on me demande, Atticus,et je ne m'y refuserais pas, s'il m'était accordé quelque temps de loisir et de liberté; car ce n'est point par un esprit surchargé de travail, préoccupé de soins, qu'un si grand ouvrage peut être entrepris. Il y faut deux choses, point de soucis et point d'affaires.— AIT, Mais vous avez écrit plus qu'aucun Romain, et pour tant d'ouvrages, quand donc vous a-t-il été donné plus de loisir ?—MARC. On peut dérober quelques instants, et je les saisis. Par exemple, si je puis gagner quelques jours pour aller à la campagne, je mesure sur leur nombre ce que je veux écrire. Mais l'histoire ne peut s'entreprendre sans loisir assuré, ni s'achever en peu de temps ; ajoutez que mon esprit est sujet à se déconcerter, lorsqu'ayant une fois commencé une chose, il en est détourné pour une autre ; et il ne m'est pas aussi facile de reprendre ce que j'ai interrompu, que de terminer ce quej'ai entrepris. —ATT. C'est-à-dire qu'une telle composition ne demande rien moins qu'une légation, ou quelque autre temps de retraite libre et oisive.— MARC. Non, je comptais plutôt sur le privilége de vétérance, d'autant que je ne me refusais point à imiter un jour l'usage de nos pères, à répondre, assis sur mon siège, à qui viendrait me consulter, tâche honorable et douce d'une vieillesse qui ne se relâche point. Voilà comme il me serait permis de donner tout le soin qu'il me plairait, et à l'oeuvre que vous désirez, et à beaucoup d'autres encore plus grandes et plus étendues.
IV. ATT. Je crains fort que personne n'entende cette raison, et que vous ne soyez destiné à toujours parler en public, surtout depuis que vous vous êtes changé vous-même, et que vous avez pris une autre manière. A l'exemple de Roscius que vous aimiez, et qui dans sa vieillesse, ayant baissé la cadence et le ton de sa voix, faisait ralentir l'accompagnement des flûtes, vous rabattez tous les jours quelque chose de ces efforis extrêmes auxquels vous étiez accoutumé. Déjà même votre discours ne diffère pas beaucoup de la douceur du langage philosophique ; et comme la vieillesse la plus avancée peut soutenir ce ton, je ne vois pas qu'il puisse y avoir vacances au barreau pour vous. — QUINT. Et moi je pensais que le peuple ne vous désapprouverait pas, si vous vous livriez entièrement aux fonctions de consultant. Je vous engage donc à l'éprouver, dès que vous en aurez envie. — MARC. Oui, Quintus, s'il n'y avait dans cette épreuve aucun dauger ; mais j'ai peur d'augmenter mon travail, en le voulant diminuer, et d'ajouter encore à l'étude des causes, dont je n'entreprends jamais la plaidoirie sans réflexion ni préparation, toute cette interprétation du droit, moins fâcheuse encore par la peine qu'elle me donnerait, que parce qu'elle ôterait à mes discours cette méditation sans laquelle je n'ai jamais osé entreprendre aucune cause importante. —ATT. Eh bien ! que ne faites-vous aujourd'hui ces recherches dans ces moments libres dont vous parliez, et que n'écrivez-vous sur le droit un peu plus spirituellement qu'on ne l'a fait ? car depuis vos premières années je me souviens que vous étudiez le droit, dans le temps que je venais souvent aussi chez Scévola ; et je ne vous ai jamais vu vous dévouer à la parole, au point de négliger la jurisprudence.— MARC. Vous m'engagez, Atticus, dans une longue discussion, que j'accepte cependant (à moins que Quintus n'aime mieux que nous fassions autre chose) ; et puisque nous sommes de loisir, je parlerai.—QUINT. J'ecouterai volontiers. Que ferais-je de préférence ? et à quoi pourrais-jemieux employer ce jour? — MARC. Rendons-ous donc à nos promenades et à nos siéges accoutumés. Là, quand nous aurons assez marché, nous pourrons nous reposer ; et je vous prometsque l'intérêt ne nous manquera pas ; les questions vont naître les unes des autres. - ATT. Allons ; prenons, croyez-moi, par le bord de l'eau, et marchons à l'ombre. Mais commencez dès à présent, je vous prie, et dites-nous ce que vous pensez du droit.— MARC. Moi? je pense qu'il y a eu, parmi nos citoyens, des hommes supérieurs qui ont fait profession d'expliquer le droit au public, et de répondre aux consultations; mais que ces hommes, après avoir promis de grandes choses, se sont employés à de très petites. Quoi de si grand, en effet, que le droit dans un état ? et quoi de si mince que la fonction de consultant, toute nécessaire qu'elle est au public? non que je pense que tous les chefs de cette profession fussent absolument étrangers au droit universel; mais ils n'ont professé ce qu'ils appelaient le droit civil, qu'autant qu'ils pouvaient ainsi être utiles au peuple.Or, l'autre droit, plus inconnu, est, dans la pratique, moins nécessaire. Où m'engagez-vous donc, et que me conseillez-vous ? de faire de petits livres sur le droit des gouttières ou des murailles, ou bien de composer des formules de stipulation ou d'arrêt? toutes choses qui d'abord ont été soigneusement traitées par beaucoup d'autres, et qui d'ailleurs sont au-dessous, j'imagine, de ce que vous attendez de moi.
V. ATT. Mais si vous le demandez, voici ce que j'attends : vous avez écrit sur la meilleure forme de république ; il me semble que c'est une conséquence que vous en écriviez autant sur les lois ; et je vois que c'est ainsi qu'a fait Platon, votre Platon, que vous admirez, que vous mettez avant tous les autres, que vous aimez de prédilection. — MARC. Voulez-vous alors que, comme lui, lorsque, avec Clinias de Crète et le Lacédémonien Mégillus, un jour d'été, ainsi qu'il le raconte, tantôt marchant, tantôt se reposant dans ces allées champêtres qu'ombragent les cyprès de Gnosse, il disserte sur les institutions des républiques et les meilleures lois ; nous, entre ces hauts peupliers, sur cette rive pleine de verdure et de fraîcheur, maîtres à notre gré de nous promener ou de nous asseoir, nous recherchions ensemble sur ce sujet quelque chose d'un peu plus profond que ne le demandent les besoins du barreau ? — ATT. Pour moi, je suis impatient de vous entendre. — MARC. Que dit Quintus? —QUINT.Rien ne me plaira davantage.—MARC. Et vous avez raison ; car soyez sûrs qu'aucune questionne découvre avec plus d'éclat ce qui a été donné par la nature à l'homme, quelle infinité d'excellentes choses renferme l'âme humaine, pour quelle mission et pour quelle oeuvre nous sommes nés et venus à la lumière, quelle est la liaison des hommes et quelle société naturelle est entre eux : c'est là, en effet, ce qu'il faut expliquer pour trouver la source des lois et du droit. — ATT. Ce n'est donc pas dans l'édit du préteur, comme tout le monde aujourd'hui, ni dans les douze Tables, comme nos anciens, mais au sein même de la philosophie,que vous allez puiser la science du droit ? — MARC. Non, nous ne rechercherons pas ici, Pomponius, les moyens de nous défendre en droit, ni les réponses d'un consultant sur toutes les espèces qui lui sont soumises. Que ce soit chose importante, j'en conviens, que cet office, qui, rempli autrefois par tant d'illustres personnages, l'est aujourd'hui par un seul, avec une science et une autorité si grandes. Mais notre discussion, à nous, doit embrasser tout le droit dans son universalité ; de sorte que ce droit particulier que nous appelons civil ne soit lui-même qu'une partie d'un tout, et ne tienne qu'une petite place du droit de la nature ; car c'est la nature même du droit qu'il nous faut expliquer, et c'est dans la nature de l'homme que nous devons l'aller prendre; nous avons ensuite à considérer quelles lois doivent régir les cités ; puis à traiter de ces règles écrites et composées, ou des droits et des décrets des peuples, qui forment les divers droits civils ; et c'est ici que nos Romains ne seront pas oubliés.
VI. QUINT.C'est vraiment remonter à la source, et, comme il convient, prendre la question à son sommet; et ceux qui enseignent autrement le droit, enseignent moins les voies de la justice que celles de la chicane. —MARC. Non pas, Quintus, c'est plutôt l'ignorance que la science du droit qui fait la chicane ; mais ceci viendra plus tard. Voyons maintenant les principes du droit. Il a plu à de très-savants hommes de partir de la loi. Je ne sais s'ils n'ont pas bien fait, surtout si, comme ils la définissent, la loi est la raison suprême communiquée à notre nature, et qui ordonne ou qui défend. Cette raison, une fois qu'elle s'est affermie et développée dans l'esprit de l'homme, est la loi. En conséquence, ils estiment que la prudence est une loi dont la vertu est de nous ordonner de bien faire, et de nous défendre de faire mal. Suivant eux, c'est de l'expression grecque qui revient â celle de départir à chacun ce qui lui appartient, que la loi a pris son nom dans cette langue. Moi, je crois que notre mot vient de celui qui signifie choisir. Ainsi, pour eux le caractère de la loi serait l'équité, et pour nous le choix ; et dans le fait, l'un et l'autre caractère appartiennent à la loi. Si tout cela est vrai, comme j'en suis assez d'avis, c'est à la loi que le droit commence; elle est la force de la nature, l'esprit et la raison du sage, la règle du juste et de l'injuste. Mais comme notre discours roule sur un sujet d'un intérêt populaire, nous serons obligés de temps en temps de parler comme le peuple, et d'appeler loi celle qui fixe par écrit sa volonté, soit qu'elle ordonne, soit qu'elle défende. Quant au droit fondamental, dérivons-le d'abord de cette loi suprême, née pour tous les siècles, avant qu'aucune loi eût été écrite, avant qu'aucune cité eût été fondée.— QUINT. L'ordre que vous proposez me semble plus méthodique et plus sage. -MARC. Eh bien ! voulez-vous que je reprenne l'origine du droit à sa source ? une fois qu'elle sera trouvée, plus de doute, nous saurons où rapporter ce que nous cherchons.—QUINT.Oui, je crois que c'est ainsi qu'il faut procéder. — ATT. J'y donne aussi ma voix.—MARC.Puis donc que nous devons tenir et garder cette forme de République dont Scipion, dans les six Livres qui portent ce titre,nous a enseigné l'excellence, et que toutes les lois doivent être appropriées à ce genre de cité ; qu'il faut jeter les semences des moeurs, et que tout ne peut pas se régler par écrit : je chercherai les sources du droit dans la nature; il faut la prendre pour guide dans l'examen de toute cette question. — ATT. Fort bien ; avec ce guide, aucune erreur n'est possible.
VII. MARC. M'accordez-vous, Pomponius, car je connais le sentiment de Quintus, que la force des dieux immortels, leur nature, leur raison, leur puissance, leur esprit, leur divinité, ou quoi que ce soit qui rende plus clairement ma pensée, régit toute la nature ? car si vous ne l'admettez pas, il faudra commencer par là. — ATT. Allons, je l'accorde, si vous le demandez ; car, grâce à ces oiseaux qui chantent, et au murmure de ces ruisseaux, je n'ai pas peur que quelqu'un de mes condisciples m'entende. — MARC. Eh mais ! prenez-y garde : car, avec leur bonté, ils sont sujets à se mettre fort en colère, et ils ne vous entendraient point patiemment trahir le premier chapitre de l'excellent livre (1) où le maître a écrit « que Dieu ne se soucie de rien, ni pour soi, ni pour autrui. »
(1) L'excellent livre est un ouvrage d'Épicure, intitulé Principes fondamentaux. Il paraît que c'était un recueil d'aphorismes dont celui-ci est à coup sur le plus célèbre.Notre auteur n'en donne que le sens ; Diogèue Laërce en a conservé letexte, que Cicéron ailleurs a traduit ainsi pour le réfuter : « Ce qui est heureux et immortel n'a et ne témoigne d'intérêt pour rien. » Nat. des Dieux, I, 30 ; Diog. Laërce, x, 139.
— ATT. Poursuivez, je vous prie, je désire savoir où tend la concession que je vous ai faite. — MARC. Je ne tarderai pas plus longtemps ; le voici. Cet animal si prévoyant, si pénétrant, si composé, doué de sagacité, de mémoire, de raison, de conseil, et que l'on appelle l'homme, a été engendré par le Dieu suprême avec une noble destinée : seul de tant d'espèces et dénaturés d'animaux, il est participant de la raison et de la pensée, tandis que les autres en sont tous dépourvus. Or, qu'y a-t-il,je ne dis pas dans l'homme, mais dans tout le ciel et la terre, de plus divin que la raison ? la raison, qui, lorsqu'elle a pris sa croissance et son perfectionnement, se nomme proprement la sagesse. Il y a donc, puisque rien n'est meilleur que la raison, et que la raison est dans Dieu et dans l'homme, il y a une première société de raison de l'homme avec Dieu. Or, là où la raison est commune, la droite raison l'est aussi ; et comme celle-ci est la loi, nous devons, par la loi, nous regarder, nous autres hommes, comme en société avec les dieux. Certainement, là où il y a communauté de loi, il y a communauté de droit, et ceux que lie une telle communauté doivent être regardés comme de la même cité ; bien plus encore, s'ils obéissent aux mêmes volontés et aux mêmes puissances. Or, ils obéissent à cette céleste ordonnance, au divin esprit, au Dieu tout-puissant; de sorte que tout cet univers doit être considéré comme une société commune aux dieux et aux hommes : et tandis que dans nos cités, pour une raison dont il sera parlé en son lieu, il y a des distinctions d'état entre les familles d'une même race, dans la nature un ordre plus relevé et plus beau lie les hommes aux dieux et par la race et par la famille.
VIII. Lorsqu'on s'occupe de la nature universelle, on a coutume d'établir, et on établit en effet avec vérité, qu'après de perpétuelles révolutions et une suite de conversions célestes, ce fut enfin le vrai moment, la saison de semer le genre humain, qui, répandu sur la terre, y germa bientôt, fut enrichi du divin présent de l'âme ; et tandis que les hommes ont pris de leur mortelle origine tout le fragile et le périssable auquel ils demeurent attachés, l'âme leur a été donnée de Dieu, et c'est pour cela qu'on peut nous appeler la famille, la race, ou la lignée des êtres célestes. Aussi de tant d'espèces, Il n'est aucun animal, hormis l'homme, qui ait quelque connaissance de Dieu ; et parmi les hommes mêmes, il n'est point de nation si féroce et si sauvage qui, si elle ignore quel Dieu il faut avoir, ne sache du moins qu'il en faut avoir un. D'où il résulte que, pour l'homme, reconnaître Dieu, c'est reconnaître et se rappeler, en quelque sorte, d'où il est venu. La vertu est la même dans l'homme et dans Dieu, et elle n'est dans aucun autre esprit. Or, la vertu n'est pas autre chose que la nature perfectionnée en elle-même, et conduite à son dernier terme. Il y a donc une ressemblance de l'homme avec Dieu ; et s'il en est ainsi, quelle parenté plus étroite et plus certaine ? Voilà pourquoi la nature a répandu une si grande abondance de choses à l'usage et à la commodité des hommes, que toutes les productions paraissent nous avoir été données à dessein plutôt qu'être nées par hasard, et non seulement celles que livre le sein de la terre en végétaux ou en fruits, mais encore les animaux, créés évidemment pour fournir à l'homme et leur service, et leur dépouille, et des aliments. Puis, des arts innombrables ont été trouvés à la voix de la nature ; et la raison, en l'imitant, a obtenu par industrie les choses nécessaires à l'existence.
IX. Quant à l'homme lui-même, non seulement la nature l'a doué de l'activité de l'âme, mais encore elle lui a attribué des sens,gardes et messagers fidèles, et elle a placé en lui les intelligences nécessaires d'une foule de choses obscures, et qui semblent les fondements de la science ; ensuite, elle lui a donné un corps d'une forme commode et convenableà l'esprit qui l'anime : car tandis qu'elle avait courbé les autres animaux vers leur pâture, elle a mis l'homme seul debout ; elle l'a comme excité à regarder le ciel, sa première famille et son ancien domicile : enfin, elle a disposé les traits de sa face pour représenter les sentiments cachés au fond du coeur. En effet, quelque affection que nous éprouvions, nos yeux trop expressifsla disent; et ce qu'on appelle le visage, et qui ne peut se trouver dans aucun autre animal que l'homme, décèle nos moeurs : c'est une propriété que lui ont bien reconnue les Grecs, quoiqu'ils ne lui aient point trouvé de nom. J'omets toutes les qualités, toutes les dispositions adroites du reste du corps, cette souplesse de la voix, cette force de la parole, de cet organe,médiateur principal de la société humaine ; car tout ne doit pas entrer dans notre discussion d'aujourd'hui, et c'est, je crois, un point sur lequel Scipion en a dit assez dans ces Livres que vous avez lus. Maintenant, puisque Dieu a engendré et orné l'homme dont il a voulu faire le principe de tout le reste, posons comme évident, et pour ne pas tout démontrer, que la nature est par elle-même progressive, et que sans autre maître qu'elle même, en partant de ces connaissances générales qu'elle doit à une intelligence primitive et commencée, elle fortifie et accomplit la raison.
X.-ATT. Dieux immortels, que vous reprenez de loin les principes du droit ! Ce n'est pas cependant que je sois pressé de ce que je vous demandais touchant le droit civil. Je vous laisserais très facilement employer ce jour, et ce jour tout entier, à de semblables discours. Ce que vous venez de traiter par occasion est peut-être au-dessus du sujet même auquel est destiné ce préambule. MARC. Sans doute ce sont de grandes questions que je touche ici en passant ; mais de toutes celles qui sont livrées à la discussion des sages, il n'en est assurément aucune de supérieure à cette vérité bien comprise, que nous sommes nés pour la justice, et que le droit n'a point été établi par l'opinion, mais par la nature. Cette vérité paraîtra à découvert, si vous considérez la société et la liaison des hommes entre eux. Rien en effet n'est si réciproquement semblable, rien n'est si pareil que nous le sommes tous les uns aux autres. Si la dépravation des coutumes, la diversité des opinions, ne fléchissait pas, ne tournait pas la faiblesse de nos esprits au gré d'un premier mouvement, personne ne serait aussi semblable à lui-même que tous le sont à tous. Aussi, quelque définition qu'on donne de l'homme, elle vaut pour tous les hommes : ce qui prouve assez qu'il n'y a point de dissemblance dans l'espèce ; car s'il y en avait, la même définition ne renfermerait pas tous les individus. La raison en effet, par qui seule nous l'emportons sur les bêtes, la raison par qui nous savons induire, argumenter, réfuter, établir, prouver, conclure, est assurément commune à tous, différente en tant que science, pareille comme faculté d'apprendre. De plus, nous saisissons tous les mêmes choses par les sens, et de ce qui frappe les sens de l'un les sens de tous les autres sont frappés; ces intelligences ébauchées dont j'ai parlé, et qui sont imprimées dans les âmes, le sont également dans toutes ; la parole est pour l'esprit un interprète qui, s'il diffère dans les mots, s'accorde dans les pensées : enfin, il n'y a point d'homme d'une nation quelconque qui, ayant une fois pris la nature pour guide, ne puisse parvenir à la vertu.
XI. Et non seulement dans les penchants droits, mais dans les mauvais penchants, l'air de famille de l'espèce humaine est remarquable. Tous, par exemple, sont sensibles au plaisir, qui, bien qu'il soit l'attrait du vice, contient cependant quelque chose de semblable à un bien naturel : comme il plaît par sa douceur et son charme,il ne gagne notre âme qu'en la trompant, qu'en se montrant comme quelque chose de salutaire. Que d'erreurs semblables! on fuit la mort comme la dissolution de la nature; on aime la vie, parce qu'elle nous maintient dans l'état où nous sommes nés ; on met la douleur au rang des plus grands maux, parce que, sans compter ce qu'elle a de pénible, la destruction de la nature paraît la suivre ; enfin, c'est la ressemblance de la gloire et de l'honnêteté qui fait paraître heureux ceux qui sont honorés, et malheureuxceux qui n'ont pas de gloire. Les chagrins, les joies, les désirs, les craintes, parcourent également tous les coeurs ; et bien que les opinions varient des uns aux autres, le même sentiment superstitieux n'en afflige pas moins et ceux qui adorent le chat ou le chien comme des dieux, et le reste des nations. Quel peuple enfin ne chérit point la douceur, la bonté, le dévouement, le souvenir des bienfaits? quel peuple est sans haine ou sans mépris pour les superbes, les méchants, les cruels, les ingrats ? Si donc l'on comprend que ces idées primitives forment la société des hommes entre eux, la conséquence dernière en est que la raison, appliquée à la conduite de la vie, rend les hommes meilleurs. Si vous l'accordez,je passerai au reste ; mais si vous avez quelque question à proposer, éclaircissons-la d'abord. — ATT. Nous ? aucune, si du moins je puis répondre pour tous deux.
XII.-MARC.Il suit donc que c'est pour le partage et l'association commune que la nature nous a faits justes ( et c'est dans ce sens que je veux être entendu toutes les fois que dans cette discussion je nommerai la nature (1)) ; mais telle est la corruption des mauvaises habitudes, qu'elle étouffe ces étincelles données par la nature, et qu'elle développe et fortifie en nous les vices opposés.
(1) Il importe d'insister sur ce passage. C'est ici cette opinion tant reprochée aux Stoïciens, que la nature est bonne par elle-même; opinion qui ne va a rien moins qu'à la négation du mal. « Remarquant quelques traces de la première grandeur de l'homme, dit Pascal, et ignorant sa corruption, ils ont traité la nature comme saine et sans besoin de réparateur; ce qui les mène au comble de l'orgueil. » (Pensées, XI, 3.) Ce n'est pas le lieu de discuter cette opinion; mais il est nécessaire de l'admettre, ou au moins de la comprendre pleinement, pour bien saisir toute l'argumentation de Cicéron. La voici : La société existe ; elle existe sur le fondementd'un échange de secours communs. Le fait de la société prouve qu'elle est dans les vues de la nature (ch. 15). D'ailleurs les facultés de l'homme nécessitent la société comme leur but, et la société nécessite ces facultés comme ses moyens. Or, d'une part, la communauté de droit ou la justice est la base de la société ; de l'autre, la justice est dans l'homme. La justice est donc dans la nature comme la société. La justice ou le juste, ou, selon l'expression de Cicéron, le droit, est donc dans la nature, ou plutôt c'est la nature même. On peut voir comment ces deux principes du stoïcisme, « la nature nous a créés pour la société par la justice, » et « le juste n'est pas distinct de la nature, » sont exposés l'un au traitéde Finibus,III, 17 et suiv.; l'autre, de Offic., III, 2 et 3. Il est évident qu'il faut, dans tout ceci, considérer la nature comme étant bonne par elle-même; au point qu'Épictète va jusqu'à dire que la nature du mal n'existe pas dans l'univers (ch. 27) : mais comme la vertu n'est que la nature développée, les hommes peuvent, au lieu de la développer, la contrarier, l'étouffer ; et les préjugés et les mauvais exemples la corrompent en effet trop souvent. C'est ce dont Cicéron convient en passant, et ce qu'il expose ailleurs plus en détail (Tusc., III, I, et suiv,). Resterait à savoir comment la nature, étant bonne, est corruptible; il y a là une contradiction que les Stoïciens ont bien aperçue, quoi qu'on en ait dit ; mais l'examen de la solution qu'ils en ont donnée mènerait trop loin. Au reste, ce qui jette quelque obscurité dans la traduction, c'est le retour fréquent du mot droit, employé dans des acceptions diverses, et que l'on a quelque peine à distinguer. Jus est en latin le radical de justus; et quand Cicéron dit que la nature nous a faits justes (justos, capables de droit), on comprend aisément que c'est presque la même chose que s'il disait que le droit (jus) est la nature ( naturam esse)
Que si, conformant leurs jugements à la nature même, les hommes pensaient, comme dit un poëte, que rien d'humain ne leur est étranger, le droit serait également respecté par tous; car à tous ceux à qui la nature a donné la raison, la droite raison a été donnée, et par conséquent la loi, qui n'est que la droite raison, en tant qu'elle commande ou qu'elle interdit, et si la loi, le droit : or, tous ont la raison ; donc le droit a été donné à tous. Et c'est à juste titre que Socrate maudissait le premier qui avait séparé l'utilité de la nature : il déplorait cette séparation comme la source de tous les désordres. De là aussi cette parole de Pythagore, qu'entre amis tout est commun, et qu'amitié est égalité. Ces mots fontvoir que lorsque le sage a rassemblé sur un homme doué d'une égale vertu cette vaste bienveillance éparse et répandue çà et là, il arrive ce qui, pour paraître incroyable à quelques-uns, n'en est pas moins nécessaire, qu'il ne s'aime en rien plus que son ami; car où serait la différence, quand toutes choses sont égales entre eux? s'il en existait la moindre,jusqu'au nom de l'amitié disparaîtrait ; car telle est la vertu de l'amitié, que du moment où l'un des deux a mieux aimé une chose pour soi que pour l'autre, elle s'anéantit. Tout ceci n'est que pour vous préparer à la suite de notre discussion, et pour vous faire plus aisément comprendre que le droit est dans la nature. J'en dirai quelques mots, et j'arriverai ensuite au droit civil, d'où est venue toute cette dissertation.
XIII. -QUINT. Quelques mots tout au plus ; car d'après ce que vous avez déjà dit, Atticus voit bien, je vois du moins que le droit est issu de la nature. — ATT. Comment pourrai-je m'en défendre, maintenant que vous avez établi d'abord que nous sommes, en quelque sorte, munis et parés des présents des dieux; en second lieu, qu'il y a entre les hommes une règle de vie pareille et commune ; enfin, que tous sont unis entre eux, tant par un lien d'indulgence et de bienveillance naturelle, que par la société du droit ? Après vous avoir accordé avec raison, selon moi, que tout cela est vrai, comment serions- nous libres de séparer les lois et le droit de la nature ? — MARC. Oui, sans doute ; mais selon l'usage des philosophes, non pas de nos anciens, mais de ceux qui, pour ainsi dire, ont ouvert des ateliers de sagesse, tout ce qu'on discutait autrefois en masse et librement, se dit aujourd'hui distinctement et par article. Ainsi ils ne croient pas avoir assez fait pour la question que nous tenons en ce moment, s'ils n'ont établi séparément que le droit existe dans la nature. — ATT. Avez-vous donc perdu votre liberté de discussion, ou êtes-vous homme à ne point suivre, en dissertant, votre jugement, et à vous soumettre à l'autorité des autres ? — MARC. Pas toujours, Titus ; mais vous voyez quelle est la marche de ce discours : c'est à consolider les républiques, à raffermir leurs forces, à guérir les peuples, que tend tout ce développement; je n'ai donc garde de poser des principes qui n'aient été ni bien prémédités, ni soigneusement examinés : non que je prétende qu'ils touchent tout le monde (car c'est chose impossible) ; je m'adresse à ceux qui pensent que toutes les choses justes et honnêtes sont désirables pour elles-mêmes et que rien ne doit être compté parmi les biens que ce qui est essentiellement louable, ou du moins, qu'il n'est de grand bien que ce qui mérite d'être loué par sa propre nature. Ceux-là, qu'ils soient restés dans l'ancienne académie avec Speusippe, Xénocrate, Polémon, ou qu'en s'accordant avec eux sur le fond, mais en différant un peu sur la forme de la démonstration, ils aient suivi Aristote et Théophraste ; soit que, comme l'a voulu Zénon, sans rien changer aux choses, ils aient changé les expressions ; soit même qu'ils aient embrassé la secte d'Ariston, et cette doctrine ardue et difficile, mais déjà dissipée et vaincue, que les vertus et les vices exceptés, tout le reste est parfaitement égal ; ceux-là, dis-je, reconnaissent tout ce que j'ai dit. Quant à ces flatteurs d'eux-mêmes, à ces esclaves de leurs sens, qui pèsent au poids du plaisir ou de la douleur ce qu'ils doivent chercher ou fuir dans cette vie ; quand même ils diraient vrai, je ne veux point ici chicaner avec eux ; renvoyons-les disserter dans leurs élégants jardins ; qu'ils renoncent à toute intervention dans la chose publique, dont ils ne connaissent, dont ils n'ont voulu jamais connaître la moindre partie, et qu'ils restent un moment à l'écart. Pour cette nouvelle académie d'Arcésilas et de Carnéade, perturbatrice de toute cette philosophie, prions-la de garder le silence. Si elle faisait irruption sur notre terrain, où tout nous semble construit et arrangé avec assez d'art, elle y ferait trop de ravages. Je n'aspire qu'à la fléchir; mais la repousser, je n'ose.....
Lacune...
XIV. On peut expier de telles fautes sans avoir recours à ses sacrifices ; mais pour les attentats sur les hommes et pour les impiétés, il n'y a point d'expiation. Ces crimes sont punis, moins par les jugements (puisque autrefois il n'y en avait nulle part ; qu'en beaucoup de circonstances il n'y en a point aujourd'hui; et lorsqu'il y en a, bien souvent ils sont faux), que par les furies qui les poursuivent et les obsèdent,armées, non de torches ardentes comme dans la fable, mais des angoisses de la conscience et des tourments du crime. Que si c'était la peine, et non la nature, qui dût éloigner les hommes de l'injustice, quelle inquiétude, lorsqu'ils n'auraient pas de supplices à craindre, agiterait donc les coupables? Et cependant jamais il ne s'en est trouvé d'assez effronté pour ne pas nier qu'il eût commis le crime, ou pour ne pas feindre quelque excuse, comme un légitime ressentiment, et ne pas chercher quelque justification de son forfait dans le droit naturel. Quand les impies osent s'en réclamer, quel doit être l'empressement des bons à s'y attacher! Si la peine, la crainte du châtiment, et non la laideur du vice, détourne d'une vie injuste et criminelle, personne n'est injuste ; seulement les méchants calculent mal. Et nous, alors, nous que pousse à la vertu, non l'honnêteté même, mais quelque utilité, mais je ne sais quel profit, nous sommes avisés et non pas bons. Que fera-t-il dans les ténèbres, cet homme qui ne craint rien que le témoin et le juge ? que ferat-il, s'il rencontre dans un lieu désert un homme à qui il puisse prendre beaucoup d'or, s'il le trouve faible et seul ? Notre honnête homme à nous, juste par nature, s'entretiendra avec lui, le secourra, le remettra dans son chemin ; mais celui qui ne fait rien pour l'amour d'autrui, et qui mesure tout sur ses intérêts, vous voyez, je pense, comme il va se conduire. S'il prétend qu'il ne lui ôtera ni la vie, ni son or, jamais il n'en donnera pour motif l'opinion que cette action est naturellement déshonnête, mais la crainte que la chose ne se répande, c'est-à-dire qu'il n'en soit puni. Raisonnement qui devrait faire rougir le dernier des hommes : que dirai-je donc d'un philosophe ?
XV. Encore une autre absurdité et la plusforte, c'est de tenir pour juste tout ce qui est réglé par les institutions ou les lois des peuples. Quoi! même les lois des tyrans ? Si les trente tyrans d'Athènes eussent voulu lui imposer des lois, si même tous les Athéniens aimaient ces lois tyranniques, seraient-elles des lois justes ? Pas plus, je pense, que la loi rendue par notre interroi : « Que le dictateur pourrait tuer impunément le citoyen qu'il lui plairait, sans lui faire son procès. » (1)
(1) Valérius Flaccus, nommé interroi par le sénat pour tenir les comices, après la seconde entrée de Sylla dans Rome et la mort des deux consuls, fit nommer Sylla dictateur, et passer une loi qui ratifiait tout ce que le dictateur pourrait avoir fait. Cicéron appelle ailleurs la loi Valéria la plus injuste de toutes les lois, la moins semblable à une loi (de Leg. Agrar.,III, 2 ; pro S. Rosc., 43.)
Non, il n'existe,qu'un seul droit, dont la société humaine fut enchaînée, et qu'une loi unique institua : cette loi est la droite raison, en tant qu'elle prohibe ou qu'elle commande ; et cette loi, écrite ou non, quiconque l'ignore est injuste. Si la justice est l'observation des lois écrites et des institutions nationales, et si, comme les mêmes gens le soutiennent, tout doit se mesurer sur l'utilité ; il négligera les lois, il les brisera, s'il le peut, celui qui croira que la chose lui sera profitable. La justice est donc absolument nulle si elle n'est pas dans la nature : fondée sur un intérêt, un autre intérêt la détruit. Bien plus, si la nature ne doit pas confirmer le droit, c'est fait de toutes les vertus. Que deviennent la libéralité, l'amour de la patrie, la piété, le noble désir de servir autrui ou de reconnaître un bienfait ? car toutes ces vertus naissent de notre penchant naturel à aimer les hommes,lequel est le fondement du droit. Et non seulement les obligation senvers les hommes disparaissent, mais avec elles les cérémonies du culte des dieux, et les religions,qui doivent être conservées,à mon avis, non par la crainte, mais à cause de ce lien qui unit l'homme avec Dieu.
--- Ce chapitre contient la grande objection contre l'infaillibilité du consentemen tgénéral ; c'est celle dont l'auteur de l'Essai sur l'indifférence en matière de religion n'a tenu aucun compte. M. de Bonald, au contraire, s'est appuyé plusieurs fois des idées de Cicéron, et il a même donné cette phrase, Nos legem bonam a mala, etc., pour épigraphe au chapitre iv de son Essai analytique sur les lois naturelles. On doit seulement s'étonner qu'il en ait déduit la doctrine du pouvoir absolu.
Que si les volontés des peuples, les décrets des chefs de l'État, les sentences des juges fondaient le droit, le vol serait de droit ; l'adultère, les faux testaments seraient de droit, dès qu'on aurait l'appui des suffrages ou des votes de la multitude. S'il y a dans les jugements et les volontés des ignorants une telle autorité que leurs suffrages subvertissent la nature des choses, pourquoi ne décrètent-ils pas que ce qui est mauvais et pernicieux soit à l'avenir tenu pour bon et salutaire ? et pourquoi la loi qui de l'injuste peut faire le juste, d'un mal ne pourrait-elle pas faire un bien ? C'est que nous avons, pour distinguer une bonne loi d'une mauvaise, une règle, une seule règle, la nature. Et non seulement le droit se distingue d'après la nature, mais encore l'honnête et le honteux en général ; car c'est une notion que le sens commun nous donne, et dont il a ébauché les éléments dans nos esprits, que celle qui place l'honnêteté dans la vertu, et la honte dans les vices. Or, cette notion, la faire dépendre de l'opinion, au lieu de la placer dans la nature, c'est une démence. La bonté même d'un arbre ou d'un cheval, comme nous le disons par abus de mot, ne réside point dans l'opinion, mais dans la nature : s'il en est ainsi, la distinction de ce qui est honnête et de ce qui ne l'est pas est aussi naturelle. Si la vertu, en général, s'appuyait sur l'opinion, il en serait de même des vertus particulières. Qui donc jugera qu'un homme est prudent, avisé, non pas sur sa conduite même, mais sur quelque apparence étrangère? La vertu n'est que la raison perfectionnée, et la raison est certainement dans la nature : l'honnêteté, en général, s'y trouve donc aussi.
XVII. De même que le vrai et le faux, la conséquence et la contradiction se jugent sur ce qu'elles sont, et non sur une preuve extérieure ; ainsi la constance de la raison dans la direction de toute la vie, ce qui est la vertu, et l'inconstance opposée, ce qui est le vice, ont leur fondement dans leur nature même. Ne jugeons-nous pas ainsi le caractère des jeunes gens ? et quand nous le jugeons d'après la nature, suivrons-nous une autre règle pour les vertus et les vices qui naissent du caractère ? ou si nous gardons ici la même, en changerons-nous pour l'honnête et le honteux ? Ce qui est louable est bien, et a nécessairement en soi ce qui le fait louer ; car le bien lui-même n'est pas dans l'opinion, mais dans la nature : autrement l'opinion ferait aussi le bonheur; et que peut-on dire de plus absurde ? Si donc la distinction du bien et du mal est naturelle, si ce sont des principes de la nature, certainement l'honnête et le honteux doivent être distingués de même, et rapportés à la nature. Mais la diversité des opinions, les dissentiments des hommes nous déconcertent; et parce que les sens ne sont pas sujets aux mêmes contradictions, nous regardons les sens comme naturellement certains; les notions, au contraire, qui varient selon les personnes, et qui pour la même personne ne restent pas toujours les mêmes, nous les traitons de fictions. Il en est tout autrement; car si nos sens ne sont pas dépravés par des parents, une nourrice, un maître, un poëte, des spectacles, s'ils ne sont pas détournés du vrai par le consentement de la multitude, tous les pièges sont tendus à nos esprits, soit par ceux dont je viens de parler, qui, les saisissant encore bruts et flexibles, les dirigent et les plient à leur gré ; soit par la volupté, qui, habile à imiter le bien lorsqu'elle est la mère de tout mal, s'insinue dans tous nos sens, et s'empare de nous-mêmes : corrompus par ses flatteries, nous ne savons plus reconnaître les biens véritables, parce qu'ils n'ont pas sa douceur et son fard trompeur.
XVIII. Il suit, pour clore enfin toute cette argumentation, ce qui doit être visible après tout ce que j'ai dit, que le juste et en général l'honnête sont désirables par eux-mêmes. C'est l'équité, le droit lui-même que chérissent tous les gens de bien et l'erreur apparemment n'est point le partage de la vertu ; elle n'aimerait pas ce qui ne serait pointréellement aimable. Le droit est donc pour lui-même digne de recherche et de culte ; ce qui est vrai du juste, l'est de la justice; et par suite, toutes les autres vertus qui sont en elle doivent être cultivées pour elles-mêmes. La libéralité, par exemple, est-elle gratuite ou mercenaire ? Si elle rend service sans récompense, elle est gratuite ; si elle attend un salaire, elle se vend. Nul doute que l'homme digne des noms de libéral et de bienfaisant ne suive le devoir, et non le profit. Ainsi, la justice ne recherche aucun prix, aucun salaire; elle est donc recherchée pour elle-même. Telles sont toutes les vertus. Et d'ailleurs, si la vertu est recherchée pour ses avantages et non par suite de sa propre nature, ce qui restera de la vertu ne sera vraiment que méchanceté. On est d'autant moins homme de bien que l'on rapporte davantage ses actions à l'intérêt : la vertu n'est donc que malice pour qui pèse le prix de la vertu. Où trouver le bienfaisant, si personne ne rend service pour l'amour d'autrui ? Qu'est-ce que le reconnaissant, si la reconnaissance ne considère plus celui à qui elle adresse ses actions de grâces ? Que devient enfin cette sainte amitié, si nous n'aimons plus notre ami pour lui-même de tout notre coeur, comme on dit ? il faudra donc l'abandonner, le rejeter, lorsqu'on n'en espérera plus ni fruit ni avantage : que peut-on dire de plus monstrueux? Mais si l'amitié mérite par elle-même d'être cultivée, la société des hommes, l'égalité, la justice sont aussi essentiellement désirables. Que si le contraire est vrai, la justice n'est rien ; car c'est l'extrême injustice que d'attendre un prix de la justice.
XIX. Que dire de la modération, de la tempérance,
du désintéressement, de la modestie,
de la pudeur, de la chasteté ? Est-ce par crainte
de l'infamie que l'on n'est point déréglé, ou bien
des lois et des tribunaux ? Quoi ! l'on n'est pur
et réservé que pour avoir bonne réputation? et c'est afin de recueillir l'approbation générale,
qu'un homme pudique rougit même de parler de
la pudeur ? Et moi je rougis de ces philosophes
qui veulent n'éviter aucun vice, s'il n'est
flétri par le juge. Car enfin pouvons-nous appeler
pudiques ceux qui s'abstiennent de l'adultère
par crainte de l'infamie, lorsque l'infamie
elle-même n'est qu'une suite de la turpitude essentielle
de l'action ? Si vous niez la nature de
ce qui est louable et blâmable, que pouvez-vous
blâmer ou louer à bon droit ? Quoi! les défauts
corporels, s'ils sont très marquants,auront quelque
chose qui nous blesse, et nous ne serons point
blessés de la difformité de l'âme, elle dont la
laideur se montre si visiblement dans les vices Est-il rien de plus hideux que l'avarice, de plus
horrible que la convoitise, de plus bas que la
lâcheté, de plus ignoble que la stupidité et la déraison?
Quoi donc ! ceux qui se distinguent par
un ou plusieurs de ces vices, serait-ce à cause
des inconvénients, des dommages, ou de quelque
peine qui les accompagne, que nous les appelons
malheureux ? et n'est-ce pas à cause de
l'essence et de la turpitude même de ces vices ?
On en peut dire autant de la louange opposée
qu'obtient la vertu.
Enfin, si la vertu est recherchée par des raisons
qui ne sont pas elle, il faut qu'il y ait quelque
chose de meilleur que la vertu. Est-ce donc
l'argent? est-ce la beauté, les honneurs, la santé ?
toutes choses qui, lorsqu'on les possède, paraissent
bien petites, et dont la durée est si incertaine.
Est-ce enfin, j'ai honte de le dire, la volupté
? mais c'est à la mépriser, à la rejeter que
se reconnaît la vertu.
Voyez-vous la suite des choses et des pensées, et comme l'une se rattache à l'autre ? J'étais entraîné
bien plus loin, si je ne m'étais retenu.
XX. -QUINT. Où donc ? Volontiers, mon frère, Je m'y laisserais entraîner avec vous. — MARC. Où ? à la fin de la vertu, à l'objet auquel se rapportent et vers lequel doivent tendre toutes nos actions : question fort débattue, et féconde en contestations parmi les plus doctes, mais qu'il faudra bien juger quelque jour. — ATT. Eh ! comment? L. Gellius est mort.—QUINT. Qu'importe à la question ? — ATT. C'est que je me souviens d'avoir entendu dire à mon ami Phédrus, étant à Athènes, que lorsque Gellius, votre ami, vint en Grèce au sortir de sa préture, en qualité de proconsul, il convoqua tous les philosophes qui se trouvaient alors dans Athènes, et leur donna gravement le conseil de prendre jour pour mettre un terme à leurs controverses, disant que s'ils n'étaient pas d'humeur à disputer jusqu'à la mort, la chose pourrait s'arranger ; et il ajouta qu'il leur promettait son entremise, au cas qu'ils voulussent faire la paix. (1)
(1) Phédrus, philosophe athénien de la secte d'Épicure, fut un des premiers maîtres de Cicéron, son ami et celui d'Atticus, qui resta son disciple. L. Gellius Poplicola avait été consul l'année de Rome 681, et censeur deux ans après avec Cn. Cornélius Lentulus.
— MARC. Le fait est plaisant, Pomponins, et l'on s'en est souvent amusé. Mais sérieusement je voudrais être élu pour arbitre entre l'ancienne académie et Zénon. — ATT. Comment cela ? — MARC. C'est qu'ils ne diffèrent qu'en un point, et qu'ils s'accordent singulièrement sur le reste—ATT. Que dites-vous! la division n'est que sur un point ? —MARC. Oui, sur un seul vraiment essentiel : nos anciens ont décidé que tout ce dont il était naturel que nous jouissions dans cette vie était bien ; Zénon n'a voulu reconnaître d'autre bien que l'honnête.— ATT. Petite question, en effet mais dont la solution ne trancherait pas tout. — MARC. Sans doute, s'ils différaient sur le fond, et non pas seulement sur les termes.
XXI.- ATT. Vous pensez donc comme Antiochus mon ami, je n'oserais dire mon maître, avec qui j'ai vécu pendant un temps, et qui m'a presque entraîné hors de nos jardins pour me faire entrer de quelques pas dans l'Académie? — MARC. Homme plein de sens et de sagacité, accompli dans son genre, et mon ami comme le vôtre, vous le savez ; mais avec lequel cependant nous verrons une fois si nous nous accordons en tout. Ce que je dis, c'est qu'une paix générale est possible. —ATT. Comment? —MARC.Si Zénon, comme l'a dit Ariston de Chio, avait dit que l'unique bien est l'honnête, l'unique mal le déshonnête ; que toutes les autres choses sont parfaitement égales, et que la présence ou l'absence en est absolument indifférente, il s'écarterait alors beaucoup de Xénocrate et d'Aristote, et de tous ces philosophes de la famille de Platon ; le débat roulerait entre eux sur un point capital, et duquel dépend toute la conduite de la vie. Mais comme c'est le beau, appelé par les anciens souverain bien, que Zénon appelle le bien unique, et que le contraire du beau, qui pour les premiers est le souverain mal, est selon lui le mal unique ; en sorte qu'il appelle les richesses, la santé, les agréments extérieurs, des choses utiles, et non pas des choses bonnes : et la pauvreté, l'infirmité, la douleur, des choses incommodes, et non pas des choses mauvaises; il pense évidemment comme Aristote et Xénocrate, quoiqu'il parle autrement. De cette dispute de mots, et non de faits, est née la discussion sur les fins, dans laquelle, forts de la loi des XII Tables (1) , qui a donné cinq pieds de terrain imprescriptible, nous ne permettrons pas à ce rusé philosophe d'usurper le vieux domaine de l'Académie ; et pour tracer les limites, nous serons trois arbitres, selon les XII Tables, et non pas deux, selon la loi Mamilia.
(1) La discussion sur les limites, ou sur les fins, est celle de la distinction des biens et des maux traitée dans le de Finibus. Pour bien comprendre l'allusion qui suit, il faut savoir plusieurs choses. Ce terrain imprescriptible était un espace de cinq pieds, environ quatre pieds et demi de France, que les douze Tables ordonnaient de laisser en friche entre chaque propriété, et sur lequel les deux propriétaires voisins pouvaient aller, venir, tourner la charrue pour reprendre un nouveau sillon ; mais qui n'appartenait à aucun des deux, et que l'un ne pouvait prescrire (usu capere) sur l'autre ; toute contestation à ce sujet était,d'après les douze Tables, jugée par trois arbitres. L'an de Rome 642, pendant la guerre de Jugurtha, le tribun C. Mamilius fit passer une loi de limitibus sive de regundis finibus, laquelle lui fit donner le surnom de Limitanus. Cette loi fixait entre cinq et six pieds la largeur du terrain qui devait rester libre et neutre entre les propriétés, et remettait à deux arbitres choisis par chacune des parties la décision de toute contestation sur les limites; c'est à cette double législation que Cicéron fait allusion. Profitant du double emploi du mot fines, il veut, dans la question des limites ou des fins, maintenir entre le champ des Académiciens et celui du stoïcisme un espace libre, qui échappe à la prescription, et qu'Antiochus ne puisse s'approprier pour venir ensuite envahir la propriété de l'Académie. Quant à la contestation des deux propriétaires voisins, c'est-à-dire des deux sectes limitrophes, il prétend la faire vider par trois arbitres, conformément à la loi des douze Tables. En effet, dans le Traité de Finibus, où il tient cette promesse, il introduit trois personnages, du moins dans le premier Livre, savoir : lui-même, L. Torquatus, et C. Triarius.
— QUINT. Quelle sera donc notre sentence ? —MARC. Ordonnons de rechercher les bornes que Socrate avait plantées, et de s'y tenir.- QUINT. A merveille, mon frère; vous commencez à parler le langage des lois et de la jurisprudence, sur lesquelles j'attends toujours vos idées ; car pour cette autre question, je tiens de vous que c'est une grande affaire à décider. De quoi s'agit-il en effet ? de savoir si le souverain bien est de vivre selon la nature, c'est-à-dire de jouir d'une existence modeste et d'une vertu réglée, ou bien de suivre la nature, et de vivre en la prenant pour loi ; c'est-à-dire de ne lui rien refuser de ce qu'elle demande,à condition que la vertu le permette, la vertu, la vraie loi de la vie. Je ne sais si cela sera jamais décidé, mais sûrement ce ne peut être dans cet entretien, du moins si nous voulons nous ressouvenirde notre première question.
XXII. -ATT. Pour moi, je m'en laissais détourner sans regret. —QUINT. Nous pourrons reprendre l'autre ; mais aujourd'hui revenons à la première, qui n'a pas besoin, d'ailleurs, de cette discussion sur le mal et sur le bien.— MARC. Vous parlez très sagement, Quintus ; car ce que j'ai dit jusqu'ici.... -QUINT. Et je ne demande ni les lois de Lycurgue, ni celles de Solon, de Charondas, ou de Zaleucus, non plus que nos xii Tables, ou nos plébiscites. Je pense seulement que, dans l'entretien d'aujourd'hui, vous donnerez une loi de conduite, un règlement de vie, tant aux peuples qu'aux individus. — MARC. Telle est, en effet, la portée de cette discussion, Quintus ; et je voudrais que ce fût celle de mes forces. Mais enfin la vérité est que, puisqu'il faut qu'il existe une loi pour corriger les vices et diriger les vertus, c'est d'elle que doit dériver toute la science de vivre. De là résulte la sagesse, mère de tout ce qui est bon, et dont l'amour a produit chez les Grecs le nom de la philosophie, présent le plus riche, le plus éclatant, le meilleur enfin que les dieux immortels aient fait à la vie humaine. Seule en effet, elle nous a enseigné, sans compter tout le reste, ce qu'il y a de plus difficile au monde, à nous connaître : précepte dont la puissance et la profondeur est telle, qu'on n'osait l'attribuer à un homme, mais au dieu qu'on adore à Delphes. Celui qui se connaîtra lui-même, sentira d'abord qu'il possède quelque chose de divin ; cet esprit qui est en lui et qui est à lui, il le regardera comme une image sacrée, comme le dieu du temple; toutes ses actions, toutes ses pensées seront dignes d'un si grand présent des dieux ; et lorsqu'il se sera examiné, et pour ainsi dire essayé tout entier, il comprendra comment il est venu à la vie, paré des mains de la nature, et comme prédestiné par elle à obtenir et à conserver la sagesse ; lui qui, dès l'origine, a reçu dans son âme, dans son entendement, les premiers linéaments de toutes choses, afin qu'à leur lumière il pût distinguer que c'est en prenant la sagesse pour guide qu il trouvera la vertu, et par la vertu le bonheur.
--- Cicéron, en établissant l'existence
d'une loi, a posé le fondement de toutes les sciences
morales et de la philosophie, qui les domine et les contient
toutes ; et il montre dans cette éloquente péroraison toute
la portée du principe. De ce principe en effet, et de ce
principe seulement, il résulte que la sagesse existe. La
sagesse n'est pas ici une simple qualité morale, mais une
science tout entière, ainsi que les Grecs l'entendaient
quand ils formèrent le mot de philosophie. Or, toute
science suppose une vérité qui lui sert de fondement ; et
toute vérité, étant immuable,est une loi. La sagesse n'est
donc une science que parce qu'elle porte sur un fait immuable,
c'est-à-dire sur une loi. Cette science est celle de
l'application de la loi à l'humanité. L'étude de cette science
comprend, selon Cicéron, la connaissance de soi-même,
celle de la nature, l'art du raisonnement et l'éloquence.
Delphico deo tribueretur. On sait que cette parole
de Chilon de Lacédémone était, ainsi que plusieurs autres
maximes attribuées aux sept sages, gravée en lettres d'or
sur un des murs du vestibule du fameux temple d'Apollon
Pythien, à Delphes, dans la Phocide. Cette circonstance,
ou la beauté du précepte, lui avait fait attribuer une origine
céleste.
XXIII. En effet, lorsque l'âme, après avoir connu et compris les vertus, se sera dégagée de toute complaisance envers le corps, et qu'elle aura étouffé la volupté comme la souillure du beau, qu'elle se sera affranchie de toute crainte de la mort et de la douleur, qu'elle se sera associée à ses semblables par le lien de la charité, qu'elle aura regardé les hommes comme ses alliés naturels ; lorsque enfin, ayant embrassé le culte des dieux et une religion pure, elle aura exercé cette vue de l'esprit, qui se forme, ainsi que celle des yeux, à discerner ce qui est beau et à repousser ce qui ne l'est pas, vertu qui a pris le nom des prudence, du mot prévoir : alors, je le demande, peut-on connaître, peut-on imaginer un sort plus heureux que le sien ? La même âme, lorsqu'elle aura bien observé le ciel, la terre, l'océan, toute la nature ; lorsqu'elle aura vu d'où toutes les choses ont été engendrées, où elles retournent, quand, comment elles se détruiront, ce qu'il y a en elles de mortel et de périssable, ce qu'il y a de divin et d'éternel; lorsqu'elle aura saisi, peu s'en faut, celui qui les modère et les régit ; lorsqu'elle reconnaîtra qu'elle n'est point un habitant d'une enceinte fermée par des murailles, mais un citoyen du monde, de la cité unique ; alors, au magnifique spectacle de l'univers, à cette révélation de la nature, grands dieux ! comme elle se connaîtra elle-même, selon le précepte d'Apollon Pythien! comme elle méprisera, comme elle dédaignera, comme elle traitera à l'égal du néant toutes ces choses que le vulgaire appelle grandes! Et toutes ces notions, elle les munira, comme d'un rempart, du talent de la discussion, de la science de discerner le vrai du faux, enfin de cet art de saisir les conséquences et les contradictions. Puis, comme elle se sera sentie née pour la société civile, elle jugera bien qu'elle ne doit pas se borner à des débats de pure subtilité, mais parler un langage qui s'étende plus loin et se soutienne plus longtemps, qui gouverne les peuples, consolide les lois, châtie les méchants, protègeles gens de bien, honore les grands hommes, et dont la voix persuasive, propageant parmi les citoyens des maximes de salut et de gloire, sache exhorter à l'honneur, rappeler du sein du vice, consoler les vaincus, enfin publier en d'immortels monuments, avec l'ignominie des pervers, les actions et les desseins des forts et des sages. Tant et de si grandes choses, qui se découvrent dans la nature humaine à qui veut se connaître soi-même, naissent de la sagesse, et sont enseignées par elle. -ATT. L'éloge est grave, sans doute, et mérité ; mais enfin où cela nous mène-t-il ? — MARC. D'abord, Pomponius, aux questions que nous allons traiter à présent, et dont je veux vous montrer toute la grandeur ; ce qui ne serait pas, si celles dont elles découlent n'étaient immenses; ensuite, c'est avec plaisir, et je crois avec raison, que je n'ai point oublié ici une étude qui me charme et qui m'a fait ce que je suis.— ATT. Oui, vous surtout, vous pouviez en parler ; et, comme vous le dites, la question vous en faisait un devoir.

I. ATTICUS. Mais comme nous nous sommes assez promenés, et que d'ailleurs vous allez commencer quelque chose de nouveau, voulez-vous que nous changions de place, et que dans l'île qui est sur le Fibrène (1), car c'est, je pense, le nom de cette autre rivière, nous allions nous asseoir pour nous occuper du reste de la discussion?
(1) Le Fibrène est une petite rivière qui se jette dans le Liris; sur leurs bords était Arpinum.
— MARCUS.Volontiers: c'est un lieu où je me plais, quand je veux méditer, lire ou écrire quelque, chose. — ATT. Moi, qui viens ici pour la première fois, je ne puis me rassasier : j'y prends en mépris ces magnifiques maisons de campagne, et leurs pavés de marbre, et leurs riches lambris. Qui ne rirait pas de ces filets d'eau qu'ils appellent des Nils et des Euripes, en voyant ce que je vois ? Tout à l'heure, dissertant sur le droit et la loi, vous rapportiez tout à la nature ; eh bien ! jusque dans les choses qui sont faites pour le repos et le divertissement de l'esprit, la nature domine encore. Je m'étonnais auparavant (car dans ces lieux je n'imaginais que rochers et montagnes, trompé par vos discours et par vos vers), je m'étonnais que ce séjour vous plût si fort : mais à présent je m'étonne que lorsque vous vous éloignez de Rome, vous puissiez être ailleurs de préférence.— MARC.C'est lorsque j'ai la liberté de m'absenter plusieurs jours, surtout dans cette saison de l'année, que je viens chercher l'air pur et les charmes de ce lieu : il est vrai que je le puis rarement. Mais j'ai encore une autre raison de m'y plaire, qui ne vous touche point comme moi. — ATT. Et quelle est-elle ? — MARC. C'est qu'à proprement parler, c'est ici ma vraie patrie, et celle de mon frère Quintus. C'est ici que nous sommes nés d'une très ancienne famille; ici sont nos sacrifices, nos parents, de nombreux monuments de nos aïeuls. Que vous dirais-je? vous voyer cette maison et ce qu'elle est aujourd'hui; elle a été ainsi agrandie par les soins de notre père. Il était d'une santé faible et c'est là qu'il a passé dans l'étude des lettres presque toute sa vie. Enfin sachez que c'est en ce même lieu mais du vivant de mon aïeul du temps que, selon les anciennes moeurs, la maison était petite comme celle de Curius (1), dans le pays des Sabins, oui c'est en ce lieu que je suis né.
(1) Manius Curius Dentatus, trois
fois consul, avait triomphé des Samnites, des Sabins et
de Pyrrhus. On connaît sa gloire et sa frugalité. La maison
ou plutôt la chaumière où il refusa les présents des Samnites
n'était pas éloignée de la maison de Caton l'ancien.
Aussi je ne sais quel charme s'y trouve qui touche mon coeur et mes sens et me rend ce séjour encore plus agréable. Et ne dit-on pas que le plus sage des hommes, pour revoir son Ithaque, refusa l'immortalité ?
II. -ATT. C'est, je le sens, une bonne raison pour vous de venir ici plus volontiers, et d'avoir une prédilection pour ce lieu. Moi-même, je dis vrai, depuis un moment j'aime encore davantage cette maison et toute cette campagne qui vous a vu naître. Je ne sais comment, mais nous sommes émus de l'aspect des lieux où se voient les traces de ceux que nous aimons ou que nous admirons. Tenez, pour moi, Athènes, ma chère Athènes me plaît moins par ses magnifiques monuments et ses antiques chefs-d'oeuvre des arts, que par le souvenir des grands hommes; le lieu que chacun d'eux habitait, la place où il s'asseyait, celle où il aimait à discourir, je contemple tout avec intérêt, tout, jusqu'à leurs tombeaux. Aussi, croyez-moi, ce lieu où vous êtes me sera désormais plus cher. — MARC.Alors je suis bien aise de vous l'avoir montré; c'est presque mon berceau. —ATT. Et moi plus aise encore de l'avoir vu. Mais qu'avez-vous donc dit tout à l'heure, que ce lieu dont vous m'avez appris que le nom est Arpinum, est à tous deux votre vraie patrie ? Est-ce donc que vous avez deux patries ? en avez vous une autre que la patrie commune? ou peut-être que celle de Caton le sage n'a pas été Rome, mais Tusculum. —MARC. Certainement; pour lui comme pour tous les citoyens des villes municipales, je reconnais deux patries, celle de la nature et celle de la cité. Ainsi Caton, qui était né à Tusculum, fut agrégé citoyen de Rome ; et Tusculan par l'origine, Romain par la cité, il eut une patrie de fait et une patrie de droit. De même chez vos Athéniens : lorsque Thésée leur eut fait quitter les champs pour les réunir dans la ville, dans l'Astu (1), comme on l'appelle, ceux qui étaientde Sunium (2) étaient aussi d'Athènes. Ainsi nous, nous nommons patrie celle où nous sommes nés et celle qui nous adopta; mais il faut donner le premier rang dans notre amour à celle dont le nom, devenu celui de la république, renferme tous les citoyens. C'est pour elle que nous devons mourir, à elle que nous devons nous dévouer tout entiers, en elle que nous devons placer et consacrer, pour ainsi dire, tout ce qui est à nous. Il n'en est pas moins vrai que nous aimons presque autant la patrie qui nous fit naître ; et voilà pourquoi je ne renierai jamais ma patrie d'Arpinum, quoique l'autre soit plus grande et la contienne dans son sein.
--- « Sous Cécrops et les premiers rois, l'Attique fut toujours habitée par bourgades, qui avaient leurs prytanées et leurs archontes. Dans le temps où ils vivaient sans crainte, ils n'allaient pas s'assembler en conseil pour délibérer avec le roi ; les habitants de chaque bourgade délibéraient et prenaient conseil entre eux.... Mais, sous le règne deThésée, entre diverses institutions tendantes à l'avantage d'Athènes, ce prince, qui joignait la sagesse à la puissance, abolit les conseils et les premières magistratures des bourgades, rassembla tous les citoyens dans ce qui est à présent la ville, et y institua un seul conseil et un seul prytanée ; les Athéniens continuèrent d'habiter et de cultiver leurs champs; mais il les força de n'avoir qu'une ville. » (Thucydide,II, 15. trad. de M. Gail.)
(1)— Astu est un mot grec qui signifie ville, et, pris isolément, la ville par excellence ou Athènes, comme en latin Urbs veut dire Rome.
(2)— On sait que Sunium était un bourg placé sur un promontoire du même nom qui s'avance dans la mer Égée, à l'extrémité sud-est de l'Attique. Du reste, on n'est d'accord ni sur le texte ni sur le sens précis de cette phrase.
III. -ATT. C'est donc avec raison que notre grand Pompée, lorsque je l'entendis plaider avec vous pour Balbus (1), soutint que la république pouvait rendre de très justes actions de grâces à ce municipe, puisque ses deux sauveurs en étaient sortis ; et je crois maintenant sans peine que le lieu de votre origine est aussi votre patrie.
(1) Pompée défendit Balbus avec Cicéron, pro Balb. : c'est pour cela qu'on a substitué le nom de Balbus à ceux d'Avidius ou d'Ambius que portent les premières éditions, et qui sont également inconnus. Il est certain d'ailleurs que Pompée plaida plusieurs fois conjointement avec Cicéron. C'est Marius qui partage ici avec le dernier l'honneur d'être appelé le sauveur de Rome.
— QUINT. Mais nous voici dans l'île. Peut-on trouver un plus beau lieu ? Comme cette pointe partage le Fibrène, dont les eaux, également divisées, arrosent ses deux bords, et qui dans son cours rapide, pressé de revenir en un seul lit, n'embrasse qu'un espace suffisant pour une petite palestre ! Ensuite, comme s'il n'avait eu d'autre soin que de nous faire une arène propreà la dispute, il se précipite aussitôt dans le Liris. Là, tel qu'un plébéien entré dans une famille noble, il perd son nom plus obscur, et communique au Liris sa fraîcheur ; car moi, qui ai visité bien des rivières, jamais je n'en ai touché de plus froide ; et je pourrais à peine essayer d'y mettre le pied, comme fait Socrate dans le Phédrus de Platon. — MARC. Oui, ce lieu doit nous plaire ; mais si j'en crois, Titus, les récits de mon frère, votre Thyamis en Épire ne lui cède en rien. — QUINT. Non, sans doute ; et n'allez pas croire qu'il y ait rien de plus beau que l'Amalthée de notre Atticus et ses superbes platanes. Mais, s'il vous plaît, asseyons-nous ici à l'ombre, et revenons à notre discussion. — MARC. Vous êtes exigeant, Quintus. Moi qui croyais avoir échappé : on ne peut rien vous devoir. —QUINT. Commencez donc ; car nous vous consacrons toute cette journée. -MARC. C'est par toi, Jupiter, que ma muse commence, comme au début de mon poëme d'Aratus. — QUINT. Pourquoi ce début ? —MARC. C'est que, cette fois encore, nous ne saurions mieux commencer que par Jupiter et les autres Dieux immortels.— QUINT.Très bien, mon frère! c'est un devoir.
--- Ceux qui entraient par adoption dans les familles en prenaient le nom, surtout s'ils passaient d'une famille obscure dans une maison noble. Atticus, qui peut-être parle ici, était dans ce cas, puisque, ayant été adopté par son oncle Cécilius, il allongea son nom de cet autre, et se fit appeler Titus Cécilius Pomponinus Atticus ; mais commeCécilius n'était pas d'une qualité à relever celle d'Atticus, on revint à son nom ordinaire,même du vivant de Q. Cécilius.
IV. -MARC. Voyons donc encore une fois, avant d'arriver aux lois particulières, quelle est la nature et la force de la loi ; car, devant y rapporter toutes choses, il ne faut pas tomber dans quelque méprise de langage, ni ignorer la force du terme, sans lequel on ne peut définir aucun droit.—QUINT. Sans doute et c'est une excellente méthode. — MARC. Je vois donc que le sentiment des plus sages a été que la loi n'est point une imagination de l'esprit humain, ni une volonté des peuples, mais quelque chose d'éternel, qui doit régir le monde entier par la sagesse des commandements et des défenses. C'est ce qui leur a fait dire que cette première et dernière loi était l'esprit du Dieu dont la raison souveraine oblige et interdit; et de là le divin caractère de cette loi donnée par les Dieux à l'espèce humaine ; car elle n'est aussi que l'esprit et la raison du sage, capable de conduire ou de détourner. — QUINT. Déjà quelquefois vous avez touché ce point ; mais avant d'en venir aux lois du peuple, développez, s'il vous plaît, toute la force de cette loi divine, de crainte que le torrent de la coutume ne nous surmonte, et ne nous entraîne à parler comme le vulgaire. — MARC. En effet, Quintus, qu'avons-nous appris, dès notre enfance, à nommer loi ?— « Doit comparaître quiconque est cité en justice, » et d'autres formules de ce genre. Mais il ne faut pas croire que ces formules, et en général toutes les défenses ou prescriptions des peuples aient le pouvoir d'appeler aux bonnes actions ou de détourner des mauvaises. Cette puissanee-là compte plus d'années que la vie des peuples et des cités ; elle est de l'âge de ce Dieu qui conserve et régit le ciel et la terre. Le divin esprit ne peut pas plus exister sans la raison, que la raison divine sans être la règle et la sanction du bien et du mal. Parce qu'il n'était écrit nulle part qu'un seul homme sur un pont dût résister à une armée ennemie, et faire couper le pont derrière lui, en penserons-nous moins que ce fut la loi du courage qui commandait à notre Horatius Coclès un si grand exploit ; et s'il n'y avait à Rome,sous le règne de Tarquin, aucune loi écrite contre l'adultère, s'ensuit-il que Sextus Tarquin n'ait point fait violence à Lucrèce, fille de Tricipitinus, au mépris de l'éternelle loi ? Non, il existait déjà une raison, émanée de la nature des choses, qui pousse au bien, qui détourne du crime : celle-là ne commence point à être loi du jour seulement qu'elle est écrite, mais du jour qu'elle est née; or, elle est contemporaine de l'intelligence divine. Ainsi, la loi véritable et primitive ayant caractère pour ordonner et pour défendre, est la droite raison du Jupiter suprême.
V. -QUINT. Je reconnais, mon frère, que le juste est en même temps le vrai, et ne saurait commencer ni périr avec les lettres qui servent à rédiger les décrets. —MARC.Si donc la raison, dans la divinité, est la suprême loi, chez l'homme elle est parfaite dans l'esprit du sage. Quant aux règles écrites pour les peuples, diverses et temporaires, elles tiennent le nom de lois de la faveur plusque de la réalité. Car toute loi, pour mériter ce titre, doit être louable : on le prouve par de certains raisonnements que voici. Il est convenu que c'est pour le salut des citoyens, la conservation des cités, le repos et le bonheur de tous, que les lois ont été inventées; que les premiers législateurs avaient fait entendre aux peuples qu'ils écriraient et proposeraient des choses dont l'adoption et l'établissement leur assurerait une vie heureuse et honnête, et que ces actes, ces décrets, furent appelés par eux du nom de lois : d'où il est simple de conclure que ceux qui prescrivirent aux peuples des commandements pernicieux et injustes, ayant agi contre leur déclaration et leur promesse, ont fait tout autre chose que des lois. Maintenant on peut voir clairementque le mot de loi, bien entendu, renferme la pensée et la nécessité de légaliser le juste et le droit. Je vous interrogerai donc, Quintus, à la manière de nos philosophes : ce dont l'absence dans une société suffit pour que cette société doive être regardée comme nulle, doit-on le compter au nombre des biens ? — QUINT. Et même des plus grands biens. — MARC. Or, une cité où il y a absence de loi n'est-elle pas par cela même réduite à rien ? — QUINT. On ne peut dire le contraire.— MARC. C'est donc une nécessité que la loi soit mise au rang des premiers biens. -QUINT. Certes, je le crois. -MARC. Et pourtant, chez les nations, que de décrets pernicieux, empoisonnés, qui ne méritent pas plus le titre de lois que les conventions d'une assemblée de brigands! Si l'on ne doit point nommer ordonnances de médecin les recettes mortelles que des ignorants sans expérience auront données pour salutaires, ce n'est pas une loi pour un peuple que ce qui est pernicieux pour lui, quelle qu'en soit la forme, et lui-même l'eût-il accepté. La loi est donc la distinction du juste et de l'injuste, modelée sur la nature, principe immémorial de toutes choses, et règle des lois humaines, qui infligent une peine aux méchants et garantissent la sûreté des gens de bien.
VI. -QUINT. J'entends à merveille; et je vois maintenant qu'aucune autre loi ne doit être regardée comme telle, ni même être appelée de ce nom. — MARC. Ainsi, vous regardez comme nulles les lois Titia et Apuléia ? (1)
(1) Les lois du tribun Sext. Titius sont peu connues; mais l'histoire parle beaucoup de L. Apuléius Saturninus, célèbre tribun du peuple, ami de Marius qui l'abandonna, imitateur des Gracques dont il éprouva le destin, l'an de Rome 653.Toutes ses lois étaient factieusement populaires, et par conséquent très-odieuses au sénat et à Cicéron. Il porta, entre autres, une loi de majesté, de Orat., II, 25, 49 ; une loi agraire et sur les colonies, pro Balb., 21 ; une loi sur les subsistances, ad Herenn., I, 12; enfin, une loi sur le serment des sénateurs, celle qui contribua le plus à sa perte, pro Sext., 16 ; pro Dom.,31 ; pro Cluent., 35. Sext.Titius, tribun ami de Saturninus, après avoir participé à toutes , ses mesures, renouvela, l'année qui suivit sa mort, la fameuse loi agraire des Gracques. Le consul Marcus Antonius l'orateur lui résista, et le fit peu après condamner au banissement
— QUINT. Et même les lois Livia.— MARC. Vous avez raison ; car le sénat, par une seule ligne, les abolit en un moment; tandis que cette loi, dont je vous ai expliqué la force, ne peut s'abolir ni s'abroger. — QUINT. Si bien donc que vous ne proposerez que des lois que l'on n'abroge jamais.— MARC. Du moins si vous les acceptez tous deux. Mais comme l'a fait Platon, le plus docte, le plus imposant de tous les philosophes, et qui le premier a écrit sur la république et traité séparément de ses lois, je crois qu'avant de réciter la loi elle-même, je dois faire l'éloge de la loi. Je vois que Zaleucus et Charondas l'avaient fait avant lui, lorsqu'ils rédigèrent des lois qui n'étaient point une simple étude, un plaisir de l'esprit ; mais un service rendu à leurs concitoyens. Et si Platon les imita, c'est qu'il crut aussi qu'il convenait à la loi de persuader quelquefois, et de ne pas tout emporter par la force et la menace.— QUINT. Et Timée, qui nie que ce Zaleucus ait jamais existé ? — MARC. Oui ; mais Théophraste n'est pas une autorité inférieure, à mon avis ; beaucoup même la trouvent plus respectable ; et les citoyens de Zaleucus, mes clients, les Locriens, conservent sa mémoire. Et puis, qu'il ait existé ou non, peu importe ici : nous suivons la tradition.
VII. — Ainsi donc, que les citoyens aient avant tout la conviction que les dieux sont les maîtres et les régulateurs de toutes choses ; que tout ce qui se fait se fait par leur puissance, leur volonté, leur providence ; qu'ils méritent bien du genre humain; qu'ils voient ce que nous sommes, nos actions, nos coeurs; dans quel esprit, avec quelle dévotion chacun accomplit les pratiques religieuses ; et qu'ils tiennent le compte de l'homme pieux et de l'impie. Une fois pénétrés de ces idées, les esprits ne seront pas éloignés de la croyance utile et vraie ; car en est-il une plus vraie que celle que personne ne doit être assez follement orgueilleux pour penser qu'il y ait en lui une intelligence et une raison, et que dans le ciel et le monde il n'y en ait pas ; que ce qu'il ne peut comprendre, sans le plus grand effort de la raison et de l'esprit, ne soit mu par aucune raison ? Celui que le cours des astres, que la succession des jours et des nuits, que l'ordre des saisons, que les productions destinées à nos jouissances ne forcent pas à la reconnaissance, est-il permis de le compter comme un homme ? Et puisque tout ce qui est raisonnable l'emporte sur tout ce qui est dépourvu de sens, et qu'il y aurait presque de l'impiété à dire que rien soit au-dessus de la nature universelle, il faut confesser que la raison est en elle. Quant à l'utilité de telles opinions, comment la nier, si l'on considère combien de choses s'appuient sur la religion du serment; combien les cérémonies qui consacrent les traités sont salutaires; combien d'hommes la crainte des châtiments divins a détournés du crime ; combien enfin est sainte la société des citoyens entre eux, dès que les Dieux y interviennent comme juges, ou comme témoins. — Voilà le préambule de la loi ; ainsi l'appelle Platon. -QUINT. Oui, mon frère, et ce qui m'en plaît le plus, c'est que vous ne prenez pas les mêmes choses ni les mêmes pensées que lui ; car rien n'en diffère plusque tout ce que vous avez dit d'abord, et que cet exorde de vos lois. Je ne vois qu'une chose que vous imitiez, le style.— MARC. Je le voudrais; mais qui peut, et qui jamais a pu l'imiter ? Pour les pensées, il serait bien facile de les traduire, et je le ferais, si je ne voulais être absolument moi-même; car où serait l'embarras de rendre les mêmes choses presque dans les mêmes mots ? — QUINT. Je le crois bien. Mais, comme vous venez de le dire, j'aime mieux que vous soyez vous-même. Maintenant proclamez, s'il vous plaît, les lois de la religion. -MARC. Oui, je les proclamerai autant que je le puis; et comme le lieu et l'entretien admettent la familiarité, je vais vous dire les lois des lois. — QUINT.Qu'entendez-vous par là ? — MARC. Il y a, Quintus, de certains termes consacrés pour les lois, et qui, sans être aussi vieux que ceux des douze Tables et des lois sacrées (1), sont cependant un peu plus anciens que notre langage actuel, et en ont plus d'autorité
(1) On appela principalement lois sacrées celles qui avaient été rendues sur le mont Sacré, l'an 260, et qui créaient le tribunat, parce que le transgresseur en était dévoué aux dieux, sacer diis ; ce qni était une espèce de malédiction. Depuis, d'autres lois qui étaient armées de la même menace furent aussi décorées du même nom. Telles étaient la loi sur l'appel au peuple, De provocatione, Tite Live, II, 8, et la loi sacrée militaire, qui défendait de rayer du tableau le nom d'un soldat sans son consentement. Id., vii, 41
Je prendrai donc, si je puis, leur forme avec leur brièveté. Seulement je ne donnerai pas une législation complète, car ce serait infini ; mais les choses principales et le fond des pensées. — QUINT. C'est bien ce qu'il faut : écoutons les paroles de la loi.
VIII. -MARC. Que l'on s'approche des Dieux avec chasteté ; qu'on y apporte une âme pieuse, et qu'on écarte les richesses. Si quelqu'un fait autrement, Dieu lui-même sera le vengeur. Que nul n'ait des Dieux à part ; que nul n'adore en particulier des Dieux nouveaux ou étrangers, s'ils ne sont admis par l'Etat. Que dans les villes soient les temples bâtis par les anciens; dans les campagnes, les bois sacrés et la demeure des Lares. Que l'on conserve les rites de sa famille et de ses pères. Que l'on adore les Dieux, et ceux qui ont toujours été regardés comme habitants du ciel, et ceux que leurs mérites y ont appelés, Hercule, Bacchus, Esculape, Castor, Pollux, Quirinus, et ces vertus qui donnent aux hommes l'entrée du ciel, la Raison, la Force, la Piété, la Foi; que toutes aient des temples, et qu'aucun sacrifice solennel ne se célèbre en l'honneur des vices. Que les contestations cessent les jours fériés, et qu'ils soient communs aux esclaves quand les travaux sont achevés. Que l'année soit donc réglée de manière qu'ils tombent exactementaux retours annuels. Que les prêtres emploient aux libations publiques de certains fruits de la terre et des arbres, et cela dans des sacrifices et à des jours déterminés. Pour les autres jours, que l'on conserve une provision de lait et de jeunes victimes. Et de peur qu'il n'y ait quelque manquement, que les prêtres règlent en conséquence de cet ordre la période annuelle, et qu'ils se pourvoient des victimes les plus belles et les plus agréables pour chaque divinité. Qu'il y ait des prêtres pour chaque Dieu, des pontifes pour tous en général, pour quelques-uns des flamines (1).
(1) On pourrait discuter sur cette phrase. Le plus sûr est de suivre, le texte sans l'altérer par aucune conjecture. Il y avait en effet des prêtres particuliers pour chaque divinité, tels que les Luperci pour le dieu Pan, les Galli pour Cybèle, les Potitii pour Hercule, etc. Les pontifes formaient un collège qui avait juridiction sur tout ce qui concernait la religion et ses ministres, et dont les membres ne rendaient compte de leur conduite ni au sénat ni au peuple. Quant aux flamines, c'est d'eux que vient toute la difficulté du passage. On prouve en effet que tous les prêtres des divinités particulières ont souvent été appelés flamines. Mais il n'en est pas moins vrai que ce nom s'appliquait plus particulièrementà ceux de certains dieux, savoir : Jupiter, Mars et Romulus; Flamen Dialis, Martialis, Quirinalis.Ces trois prêtres, longtemps pris parmi les patriciens,étaient à part,et jamais on n'eût confondu le Flamen Martialis avec les Salii, qui étaient aussi des prêtres de Mars.
Que les vierges Vestales conservent dans la ville le feu éternel du foyer public. Que ceux qui ignorent l'ordre et la forme des célébrations, tant publiques que particulières, l'apprennent des prêtres publics. Que ceux-ci d'ailleurs forment deux classes : l'une qui préside aux cérémonies et aux autres sacrifices, l'autre qui interprète les réponses des devins et des prophètes, que le sénat et le peuple auront approuvés. Que les interprètes de Jupiter très bon et très grand, augures publics, consultent ensuite les signes et les auspices ; qu'ils observent les règles. Que les prêtres prennent les augures pour les vignobles, pour les nouveaux plants, pour le salut du peuple ; qu'ils fassent d'avance connaître l'auspice à ceux qui traitent des affaires de la guerre ou du peuple, et que l'on s'y conforme; qu'ils présagent le courroux des Dieux, et qu'on y obéisse; qu'ils partagent le ciel en régions déterminées, pour y observer les éclairs ; et la ville, et les champs, et les temples, que tout soit ouvert à leurs regards et soumis à leurs paroles. Et que les choses que l'augure aura déclarées irrégulières, néfastes, vicieuses, funestes, soient nulles et non avenues, et que la désobéissance soit crime capital.
IX. Pour les traités, la paix, la guerre, les trêves, que deux féciaux soient orateurs et juges : qu'ils discutent la guerre. Que les prodiges, les événements extraordinaires soient, si le sénat l'ordonne déférés aux Étrusques et aux aruspices ; que les premiers Étrusques enseignent les règles ; qu'ils apaisent les Dieux qu'ils auront reconnus; qu'ils expient et les coups de la foudre et les lieux où elle est tombée. Que les femmes ne célèbrent point de sacrifices nocturnes, hors ceux qui se font régulièrement pour le peuple ; et qu'il n'y ait aucune initiation, si ce n'est dans la forme des mystères grecs de Cérès. Tout sacrilége qui ne pourra être expié est un acte impie ; que celui qui pourra être expié, le soit par les prêtres publics. Aux jeux publics, autres que les courses et les combats, que l'on tempère l'allégresse populaire par les accords du chant, de la flûte et de la lyre, et qu'on la rapporte au culte des Dieux. Des rites paternels, que l'on conserve les meilleurs. Excepté les desservants de la mère des Dieux, et même encore aux jours légitimes, que personne ne fasse la quête. Que celui qui aura dérobé ou ravi de force une chose sacrée, ou déposée dans un lieu sacré, soit parricide (1).
(1) Le mot "parricide", dans la langue
des lois romaines, s'applique au simple homicide, et par extension
à tout crime capital, comme dans cette expression
consacrée, questeur du parricide ; c'est le questeur criminel.
L'inceste désigne surtout l'outrage fait aux vestales,
et entraîne toujours une idée de profanation
Contre le parjure, la peine des Dieux est la mort, celle des hommes l'infamie. Que les pontifes décernent contre l'inceste le dernier supplice. Que l'impie n'ait point l'audace d'apaiser par des dons la colère divine. Que l'on contracte des voeux avec prudence ; qu'il y ait une peine contre toute violation. Qu'ainsi personne ne consacre un champ ; que l'on consacre avec mesure, l'or, l'argent, l'ivoire. Que les sacrifices domestiques soient à perpétuité. Que les droits des Dieux mânes soient saints; que ceux que la mort possède soient tenus pour divins ; que l'on diminue pour eux la dépense et le deuil.
X. -ATT. Certes, vous avez renfermé une loi si considérable en aussi peu de mots que possible. Mais cette constitution du culte ne diffère pas beaucoup, du moins ce me semble, des lois de Numa et de nos coutumes.—MARC.Scipion, dans les Livres sur la République, paraît avoir prouvé que de toutes les républiques, la nôtre, la vieille Rome est la meilleure : n'est-ce donc point, à votre avis, une nécessité de donner des lois qui s'accordent avec la meilleure des républiques ? — ATT. Oui, je pense comme vous.—MARC. Alors donc attendez-vous à des lois qui puissent maintenir cet excellent gouvernement; et si quelques unes de celles que je proposerai aujourd'hui ne font pas ou n'ont point fait partie de notre constitution, du moins ont-elles été presque toutes dans l'usage de nos ancêtres, lequel alors avait force de loi. — ATT. Développez donc en forme, s'il vous plaît, la loi que vous venez de réciter, afin qu eje puisse donner mon vote pour la proposition. — MARC. Quoi ? est-ce que vous ne voterez pas sans cela?—ATT. Pour toute loi importante, non ; pour les autres, je vous dispenserai de ce soin.— QUINT. Et tel est aussi mon avis. — MARC. Mais prenez garde que cela ne devienne un peu long. — ATT. Tant mieux : qu'avons-nous de mieux à faire ? -MARC. La loi ordonne d'approcher des Dieux avec chasteté : chasteté d'âme, cela s'entend ; ce qui comprend tout, et n'exclut pas la chasteté du corps ; seulement il faut concevoir que l'âme étant fort au-dessus du corps, si l'on observe de garder la chasteté extérieure, on doit à bien plus forte raison garder celle de l'esprit. La souillure du corps en effet, une aspersion d'eau, un délai de quelques jours la détruit. La tache de l'âme ne peut disparaître avec le temps; tous les fleuves du monde ne la sauraient laver. Le commandement d'apporter une âme pieuse, et d'écarter les richesses, veut dire que c'est la pureté de l'âme qui est agréable à Dieu, et non le luxe, qui doit être éloigné. Pourquoi, en effet, nous qui voulons que dans le commerce des hommes la pauvreté soit l'égale de la richesse, en introduisant la dépense dans le culte, fermerions nous à la pauvreté l'accès des Dieux, surtout quand rien ne doit être moins agréable à un Dieu que de voir que la porte n'est pas ouverte à tous pour l'apaiser et l'adorer ? Ensuite, un Dieu vengeur tient ici la place d'un juge, pour que la religion trouve une garantie dans la crainte d'une peine présente. Si chacun adorait des Dieux à lui, soit nouveaux, soit étrangers, il y aurait confusion des religions, il y aurait des cérémonies inconnues, et non réglées par les prêtres ; car, du reste, le culte des Dieux que l'on a reçus de ses pères est permis, s'ils se sont eux-mêmes conformés à la présente loi. —Je veux que les temples restent dans les villes, où les avaient placés nos aïeux ; et je n'imite point les mages de Perse, sur le conseil desquels on dit que Xerxès brûla les temples de la Grèce, parce qu'on y renfermait dans des murs les Dieux, à qui tout doit être ouvert et libre, et dont tout cet univers est le temple et la demeure. (1)
(1) C'était en effet une opinion des mages, prêtres, philosophes et magistrats chez les Perses ; ils n'élevaient ni temples ni autels, mais ils célébraient des sacrifices sur le sommet des montagnes. Toutefois, dans l'expédition contre la Grèce, la guerre que fit Xerxès, selon l'expression de Cicéron, aux dieux comme aux hommes, fut plutôt dirigée par la vengeance que par la religion
XI. Les Grecs et nos pères ont mieux fait : pour augmenter la piété envers les Dieux, ils ont voulu qu'ilsfussent habitants des mêmes villes que nous. Cette opinion introduit en effet dans la cité même la religion qui lui est si utile, selon le sens du moins de cette parole du savant Pythagore (1), que jamais la piété et la religion ne remplissent plus les âmes que lorsque nous sommes occupés du service divin ;
(1) Pythagore disait que les hommes deviennent meilleurs lorsqu'ils s'approchent des dieux (Plut., de Superst., et de Orac. defect.) ; ou, selon la version de Sénèque, qu'ils changent d'esprit en entrant dans un temple, en voyant de près l'image des dieux, en écoutant un oracle( Epist. 94). Suivant Thalès, le monde était animé et plein des dieux (Diog. Laert., I, 27 ). L'interprétation que Cicéron donne de leur pensée n'est pas incontestable; elleest entachée d'idolâtrie.(Wagner.)
et de cette autre de Thalès, le plus sage des sept sages, qu'il faut que les hommes pensent que tout ce qui frappe les regards est rempli des Dieux, et qu'alors ils deviendront plus chastes, comme s'ils étaient toujours dans le plus sacré des temples ; car, suivant une certaine croyance, les Dieux n'apparaissent pas seulement à l'esprit, ils ont une présence. Les mêmes raisons nous font placer aux champs les bois sacrés ; et ce culte, transmis par nos aïeux, tant aux maîtres qu'aux serviteurs, qui se célèbre en vue du champ et de la maison, ce culte des Lares ne doit pas être oublié. Garder les rites de sa famille et de ses pères, c'est garder une religion pour ainsi dire de tradition divine ; car l'antiquité se rapproche des Dieux. Quand la loi prescrit le culte de ceux d'entre les hommes qui ont été sanctifiés, comme Hercule et les autres, elle indique que si les âmes de tous sont immortelles, celles des bons et des forts sont divines. Il est bien que la raison, la piété, la force, la foi, soient consacrées par l'homme : ainsi Rome leur a dédié des temples, afin que ceux qui les possèdent (et tout homme de bien les possède) croient que leur âme est habitée par des Dieux. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on fit à Athènes, lorsque après l'expiation du crime de Cylon, sur le conseil d'Épiménide de Crète, on éleva un temple à l'Affront et à l'Impudence; ce sont les vertus et non les vices qu'il faut consacrer. Un autel antique est dressé, sur le mont Palatin, à la Fièvre ; un autre, sur l'Esquilin, à la Fortune mauvaise et maudite : tous les monuments pareils doivent être proscrits. S'il faut inventer des surnoms, il faut plutôt en choisir qui expriment la victoire et la conquête, comme Vicepota; l'immutabilité, comme Stata ; ou des surnoms tels que ceux de Jupiter Stateur et Invaincu ; ou bien que ce soient les noms de choses désirables, comme le salut, l'honneur, le secours, la victoire. Ainsi, comme l'attente des biens relève les courages, Calatinus a eu raison d'élever un temple à l'Espérance. La fortune aussi peut en avoir, soit la Fortune (de ce jour) car ce titre peut se rapporter à tous les jours ; soit la Fortune Respiciens, c'est-à-dire secourable ; soit celle du hasard, qui regarde plutôt les événements incertains; soit la Fortune Primigènie, qui préside à la naissance ; soit la Fortune compagne, ou...
Lacune.
XII. La règle des féries et des jours de fêtes affranchit les hommes libres de procès et de contestations; les esclaves, de soins et de travaux. C'est à l'ordonnateur de l'année de les distribuer sans nuire à l'agriculture. Et pour que le temps permette de tenir en réserve les offrandes et les victimes dont il est parlé dans la loi, il faut soigneusement observer la méthode de l'intercalation : c'est une sage institution de Numa, détruite par la négligence des pontifes qui l'ont suivi. Il ne faut rien changer d'ailleurs aux règlements des pontifes et des aruspicessur la nature, l'âge, l'état, le sexe des victimes qu'il faut immoler à chaque Dieu. Un plus grand nombre de prêtres pour tous les Dieux en général, et des prêtres différents pour chaque culte, facilitent les consultations sur le droit de leur compétence, et les religions sont mieux professées. Vesta, suivant le nom que les Grecs lui ont donné, et que nous avons à peu près conservé, est comme le foyer mystérieux de Rome : que des vierges desservent son culte, afin que la veille soit plus facile pour la garde du feu sacré, et que les femmes apprennent à supporter toute la chasteté dont leur nature est capable. Ce qui suit intéresse non seulement la religion, mais la constitutionde l'État : c'est la défense à qui que ce soit de célébrer, sans l'intervention des ministres publics,un culte particulier. Le peuple, en effet, doit toujours avoir besoin du conseil et de l'autorisation des chefs de l'État. D'ailleurs, la distribution des prêtres est telle, que toute espèce de religion légitime a ses ministres.Il y en a d'établis pour apaiser les Dieux, et ceux-là président aux saintes solennités. Il y en a pour interpréter les prédictions des devins, qui ne doivent pas être nombreux; car cela ne finirait pas, et les grands desseins publics pourraient ainsi être connus hors du collége. Rien dans la république de plus grand ni de plus beau que le droit des augures ; il fait partie du gouvernement. Je pense ainsi, non parce que je suis moi-même augure, mais parce qu'il y a pour moi nécessité de le reconnaître. Quoi de plus grand en effet, si nous regardons au droit, que de pouvoir dissoudre ou annuler les comices, ou les conseils convoqués ou tenus par les premières autorités et les premières magistratures! Quelle puissance que cette faculté de tout interrompre par cette seule parole augurale : A un autre jour ! Quel droit magnifique que celui d'ordonner que les consuls abdiquent ! Quel pouvoir plus saint que celui d'accorder ou de refuser la permission de traiter soit avec la nation, soit avec le peuple; que celui d'abolir la loi si elle n'a pas été régulièrement proposée, comme fut abolie la loiTitia par un décret du collége ; les lois Livia par le conseil de Philippus,augure et consul ! si bien que, dans l'intérieur ou au dehors, nul des actes du magistrat ne peut être approuvé sans leur autorisation.
XIII. ATT. Soit ; je vois et je conviens que ce sont là de grandes choses. Mais il y a dans votre collége, entre Marcellus et Appius, deux excellents augures, une grande contestation ; car leurs livres me sont tombés dans les mains (1).
(1) C. Marcellus et Appius Claudius, collègues de Cicéron dans le collège des augures, avaient écrit tous deux sur la divination, comme lui-même l'a fait depuis (Tuscul., 1, 16). Il parait que l'opinion du premier était assez répandue parmi ses collegues; car ils se moquaient des superstitions du second en le nommant un Pisidien (Divin., I, 47). Cicéron, qui expose en détail, dans son Traité, tous les arguments qu'il rappelle ici en faveur de la réalité de la science augurale, n'élude point comme ici la question, et s'y montre plus indépendant que dans ce livre, où il s'attache étroitement aux croyances ainsi qu'aux coutumes anciennes. Il ne nie point la science augurale, il nie divination; il déclare qu'il penche plutôt pour l'avis de Marcellus; il croit que si la science de la divinationa étédans le principe établie de bonne foi, reçue par le préjugé, elle a été conservée par la politique ; et il ajoute ce qu'il n'eût point osé dire dans le Traité des Lois.
L'un veut que vos auspices aient été inventés pour l'utilité de l'État ; l'autre, que votre science puisse effectivement deviner. Sur ce point, je vous prie, que pensez-vous ? — MARC. Moi? je pense qu'il y a une divination, une mantique, comme disent les Grecs, et que c'est réellement une partie de cette science que l'art d'observer les oiseaux, et tous nos autres signes. Si nous accordons que les Dieux suprêmes existent, que leur esprit régit le monde, que leur bonté veille sur le genre humain, qu'elle peut nous manifester les signes de l'avenir, je ne vois pas pourquoi je nierais la divination. Or, tout ce que j'ai supposé existe : la conséquence est nécessaire. De plus, notre république, et tous les royaumes, et tous les peuples,et tous les pays, abondent en exemples de choses incroyables et vraies, arrivées selon les prédictions des augures. Et Polyide, Mélampe, Mopsus, Amphiaraüs, Calchas, Hélénus, n'auraient point une si grande renommée; tant de nations, les Arabes, les Phrygiens, les Lycaoniens, les Ciliciens, surtout les Pisidiens, n'auraient pas jusques aujourd'hui conservé des auspices, si le temps n'en eût enseigné la certitude. Que dis-je? notre Romulus n'eut point pris les auspices pour fonder Rome ; le nom d'Attius Navius ne vivrait pas depuis si longtemps dans la mémoire, s'ils n'eussent fait tant de prédictions d'une admirable vérité. Mais il n'y a nul doute que cette science, que l'art des augures, ne se soient évanouis par vétusté et par négligence. Je ne m'accorde donc ni avec Marcellus,qui nie qu'uue telle science ait jamais existé dans notre collège, ni avec Appius, qui croit qu'elle existe encore. Mais elle a existé chez nos ancêtres, doublement utile à la république, quelquefois comme raison d'état, plus souvent comme sage conseillère. — ATT. Je crois bien que c'est là le vrai, et je pense comme vous; mais continuez.
XIV. MARC. Oui, et si je puis, en peu de mots. Vient ensuite le droit de la guerre. L'entreprendre, la faire, l'abandonner, tout cela est soumis au droit, ainsi qu'à la foi, et c'est une science à laquelle notre loi assigne des interprètes publics. Quant aux fonctions religieuses des aruspices, aux expiations et aux purifications,je crois que la loi même en parle autant et plus qu'il ne faut. — ATT. Oui, et tout ce détail ne touche que la religion. — MARC. Mais sur ce qui suit qu'allez- vous dire, et que dirai-je, Titus ? — ATT. Qu'est-ce enfin ? — MARC. Les sacrifices nocturnes célébrés par les femmes. — ATT. Moi, je consens à tout, puisque la loi excepte elle-même le sacrifice solennel et public.— MARC. Que vont donc devenir Iacchuset nos Eumolpides (1), et tous ces augustes mystères, si nous supprimons les sacrifices nocturnes ?
(1) lacchus est le nom que l'on donnait à
Bacchus dans les hymnes des mystères qui se célébraient
en son nom, et les Eumolpides étaientles prêtres de Cérès
Éleusine, du poëte Eumolpus, fils de Musée et disciple
d'Orphée, qui avait été pontife de cette déesse, et dans
la famille duquel ce ministère s'était perpétué : aussi désignait-on les mystères de Cérès sous le nom de Sacrifices
des Eumolpides.
car ce n'est pas au peuple romain seul, c'est à tous les peuples qui ont de la vertu et du courage, que nous donnons des lois. — ATT. Vous exceptez, je pense, les mystères auxquels nous sommes initiés.—MARC. Oui, je les excepterais volontiers ; car entre tant de belles et divines choses dont votre Athènesa fait présent à la société, rien ne me paraît meilleur que ces mystères qui nous ont fait passer, d'une existence agreste et sauvage, à l'état d'homme, à des moeurs douces et cultivées : ils portent le nom d'initiations; et en effet, nous avons été par eux initiés à la vie. Ils nous ont appris tout à la fois et à vivre heureux, et à mourir avec une meilleure espérance. Mais ce qui me déplaît dans les célébrations nocturnes, les poëtes comiques l'indiquent assez. Si une telle licence eût été donnée à Rome, que n'eût pas fait celui qui apporta la préméditation de l'adultère dans un sacrifice où l'imprudence même d'un regard est profane ? — ATT. Soit ; mais proposez votre loi pour Rome, et ne nous ôtez pas les nôtres.
XV. -MARC. Je reviens donc à nous. Nous devons rigoureusement prescrire que l'éclat du jour protége aux yeux de tous l'honneur des femmes, et qu'elles soient initiées aux mystères de Cérès dans les formes où elles le sont à Rome. La sévérité de nos aïeux en ce genre est attestée par l'ancien décret du sénat sur les Bacchanales (1), et les poursuites, et les répressions exercées à main armée dans cette occasion par les consuls.
(1) Sous le prétexte du culte de Bacchus, une secte s'était formée, qui dans l'obscurité des forêts et de la nuit célébrait d'horribles mystères, où l'humanité et la pudeur étaient également outragées. Le sénat, instruit de ces désordres, ordonna aux consuls Sp. Postumus et Q. Marcius Philippus de faire une information, et de punir les coupables. On en découvrit près de sept mille, tant dans les campagnes de l'Italie qu'à Rome même : ils furent poursuivis et punis de mort, ou forcés à la fuite, l'an de Rome 567 (Tite Live, xxxix, 14).
Et
qu'on se garde de nous trouver trop durs ; car,
en pleine Grèce, le Thébain Diagondas abolit
par une loi perpétuelle toutes les fêtes nocturnes.
Les Dieux nouveaux et les veillées consacrées
à leur culte sont sans cesse attaqués par
le plus plaisant des poëtes de l'ancienne comédie,
par Aristophane ; au point que chez lui Sabazius
et quelques autres Dieux sont jugés comme
étrangers et bannis de la cité Le prêtre public délivrera de toute crainte l'imprudence
sagement expiée; il condamnera et déclarera
impie l'audace qui introduira d'infâmes
cérémonies.
Quant aux jeux publies, ils sont divisés en jeux
du théâtre et en jeux du cirque. Au cirque, le
concours est ouvert entre les exercices du corps,
la course, la lutte, le pugilat, les courses de chevaux,
jusqu'à la proclamation de la victoire ; au
théâtre, c'est la musique, le chant, les instruments
à cordes et à vent, toujours réglés par une
certaine modération que prescrit la loi ; car je
pense, avec Platon, que rien ne pénètre si aisément
dans les âmes tendres et sensibles que les
sons variés de la musique : on ne saurait dire
combien la puissance en est grande pour le mal
comme pour le bien. Elle anime ceux qui languissent,
fait tomber en langueur les plus exaltés,
et tantôt relâche les esprits, tantôt les raffermit.
Il eût été important pour beaucoup de cités
de la Grèce de conserver leur ancienne méthode
musicale; leurs moeurs,entraînées vers la mollesse,
changèrent avec leur musique,soit, comme
quelques-uns le pensent, que la douceur corruptrice
de cette musique même les ait dépravées ;
soit que leur sévérité ayant cédé à d'autres vices,
leurs sens et leurs esprits, déjà changés, eussent
amené cette révolution. C'est pour cela que le
plus sage et le plus savant des Grecs redoute fort
ce germe de corruption, et va jusqu'à dire qu'on
ne peut changer les lois musicales sans changer
les lois publiques (1).
(1) Platon est plus sévère que Cicéron ; c'est que la musique avait plus de danger chez lesGrecs, si dociles à la puissance des arts, que chez les Romains. (Plat., Lois, IV ; Montesquieu, Esp. des Lois, iv, 8.)
A mes yeux, c'est une chose qu'il ne faut ni craindre tant, ni tout à fait dédaigner. Voyez ces chants pleins d'une grâce sévère, sur le mode de Livius et de Névius : pour les faire réussir aujourd'hui, on tourne la tête et les yeux au gré des inflexionset des accords. La Grèce antique défendait sérieusement ces abus, prévoyant de loin que la corruption, s'introduisant peu à peu dans les esprits des citoyens, finirait par renverser des cités entières, victimes de ces changements funestes; témoin cette austère Lacédémone, qui ordonna de retrancher toutes les cordes que Timothée ajouta aux sept cordes de la lyre.
XVI. Il a ensuite dans la loi que, des rites
paternels, les meilleurs doivent être respectés.
Les Athéniens ayant consulté Apollon Pythien
pour savoir quelles formes religieuses ils garderaient
de préférence, l'oracle se prononça pour
celles qui étaient usitées chez leurs aïeux. Ils revinrent
une seconde fois, disant que la coutume
de leurs pères avait souvent changé, et ils demandèrent
laquelle entre tant de variations ils
devaient choisir. Le Dieu répondit : La meilleure.
Et, certes, les plus anciennes institutions religieuses sont
aussi les meilleures, puisqu'elles sont
les plus proches de Dieu.
Nous avons aboli les quêtes, excepté celle de
Cybèle, qui revient rarement ; car elles jettent
une superstition de plus dans les esprits, et ruinent
les familles.
Il y a une peine contre le sacrilége, eût-il ravi
non-seulement une chose sacrée, mais même
une chose confiée à un lieu sacré, comme cela
se fait encore dans bien des temples. On dit
qu'Alexandre déposa ainsi une somme d'argent
dans le sanctuaire, à Soles en Cilicie ; et le célèbre Athénien
Clisthène,craignant pour sa fortune,
commit à la Junon de Samos la dot de ses filles. Rien de plus sur les parjures et les incestes.
Que les impies n'aient point l'audace d'offrir aux
Dieux des présents.Qu'ils écoutent Platon : Quelle
sera, leur dit-il, la volonté des Dieux? en pouvez-
vous douter, lorsqu'il n'est pas un homme
de bien qui voulût des présents d'un méchant ?
La loi en dit assez sur l'exactitude dans l'accomplissement des
voeux et de toute promesse
faite à une divinité.La peine pour toute violation
de la religion est une peine inévitable. Pourquoi
citer les exemples des grands criminels dont nos
tragédies sont pleines ? Parlons plutôt de ce qui
est devant nos yeux. Quoiqu'un tel récit, je le
crains, ne semble au-dessus de la fortune d'un
mortel ; cependant, puisque c'est à vous que je
parle, je ne veux rien taire, et je souhaite que
ce que je dirai soit plutôt agréable qu'offensant
pour les Dieux.
XVII. Oui, à mon départ de Rome, par le
crime de quelques citoyens pervers, tous les
droits des religions furent souillés; nos Dieux
domestiques furent persécutés ; au lieu même de
leur autel, on éleva un temple à la licence ; et
celui qui avait sauvé tous les temples en fut
chassé. Jetez un regard rapide autour de vous,
et voyez (car il est inutile de nommer personne)
quel événement s'en est suivi. Moi qui, dans mon
désastre, n'avais point souffert que la déesse tutélaire
de notre ville fût outragée, et qui de ma
maison l'avais transportée dans celle de son auguste
père, j'ai obtenu du jugement du sénat,
de l'Italie, de toutes les nations, le nom de conservateur
de la patrie : est-il pour un mortel de
plus belle gloire ? Et parmi ceux-là dont le crime avait profané et renversé la religion, les uns languissent, dispersés et fugitifs; les autres, chefs
et promoteurs de ces attentats, les plusi mpies de
tous envers tout ce qui est saint, après avoir
passé leur vie dans les tourments et l'opprobre,
ont été privés de funérailles et de tombeau.
QUINT. Oui sans doute, mon frère, et j'en
rends grâce aux Dieux ; mais trop souvent nous
voyons qu'il en arrive autrement.— MARC. C'est
que nous ne jugeons pas bien, Quintus, de la
justice divine : une fois emportés dans l'erreur
par les opinions du vulgaire, nons ne voyons
plus la vérité. La mort, la douleur corporelle, les
chagrins, l'affront d'une condamnation, voilà
ce que nous appelons les misères de l'homme, et
j'avoue qu'elles sont de la destinée humaine;
les gens de bien l'ont souvent éprouvé : mais la
peine du sacrilège, sans compter toutes ces circonstances qui
ne font que la suivre, est triste
et sévère par elle-même. Nous avons vu ces
hommes, qui, s'ils n'eussent haï la patrie, n'auraient
point été mes ennemis, consumés de passion,
d'effroi, de remords, tantôt tremblants et
irrésolus, tantôt foulant aux pieds la religion :
ils avaient enfreint tous les jugements, ils avaient
corrompu ceux des hommes : mais ceux des
Dieux? Je m'arrête ; je ne les poursuivrai pas
plus loin ; et d'ailleurs je suis plus vengé que je
ne l'ai demandé. Il me suffit d'établir que la
peine divine est double, puisqu'elle se compose
et des tourments de l'âme des méchants pendant
la vie, et du sort qui leur est annoncé après la
mort; juste punition faite pour instruire et consoler
ceux qui survivent.
... Ce que l'auteur dit ici du
sort de ses ennemis est un peu amplifié. Ceux dont il
parle d'abord sont apparemmentl es partisans de Gabinius
et de Clodius, frappés la plupart de condamnations et dispersés
par l'exil ; ce qu'il dit des plus impies ne paraît convenir
qu'à Clodius, dont la mort fut sanglanteet les funérailles
tumultueuses (Pro Mil., 32). Elles ne furent
point justes, c'est-à-dire,régulières, dans les formes prescrites: c'est ainsi que le mot justa seul a fini par signifier
obsèques.
XVIII. Les champs ne seront point consacrés ; je suis entièrement de l'avis de Platon qui s'exprime à peu près en ces termes, que j'essaierai de traduire : « La terre, comme le foyer de l'univers, est consacrée à tous les Dieux. Que personne donc ne la consacre une seconde fois. L'or et l'argent, dans les maisons et dans les temples, excitent l'envie. L'ivoire, extrait d'un corps inanimé, n'est pas une offrande assez pure. L'airain et le fer meublent les camps mieux que les temples.Tout objet, en bois ou en pierre, que l'on voudra dédier dans les temples publics, sera entièrement de même matière. Les tissus ne doivent point avoir coûté un travail au-dessus de l'ouvrage d'une femme en un mois. La couleur blanche en général, surtout dans les tissus, est la plus convenable anx Dieux. Point d'étoffes teintes, excepté dans les enseignes guerrières. Les offrandes les plus dignes des Dieux sont les oiseaux et les images achevées en un seul jour par un seul peintre. Telles doivent être les autres offrandes. » Voilà ce que veut Platon. Pour moi, je ne suis pas si rigoureux ; j'accorde quelque chose, soit aux vices de l'humanité, soit à la richesse de mon siècle. Je soupçonne que la culture de la terre serait moins active, si quelque superstition se mêlait au soin de l'entretenir et de la cultiver. ATT. Je comprends.Maintenant il reste à parler de la perpétuité des sacrifices et du droit des Dieux mânes. — MARC. Quelle mémoire que la vôtre, Pomponius ! cela m'avait échappé. — ATT. Je le crois bien ; mais si je me rappelle, si j'attends ces questions avec plus d'intérêt, c'est qu'elles touchent au droit pontifical et au droit civil (1).
(1) L'obligation de célébrer les sacrifices établis dans une famille étant une des charges de la succession, les questions qui y étaient relatives regardaient les jurisconsultes; d'un autre côté, comme il s'agissait de sacrifices, par conséquent d'engagements religieux, les pontifes possédaient ou s'étaient arrogé le droit d'en connaître. Le droit pontifical se composait de simples questions de droit, qui, par la nature des objets auxquels elles s'appliquaient, paraissaient intéresser la religion
— MARC. En effet, et il y a sur ces matières beaucoup de décisions et d'écrits à la portée de tous. Quant à moi, dans tout cet entretien, à quelque genre de loi que la discussion me conduise, j'exposerai, autant que je le pourrai, notre droit civil sur la question, mais de façon que l'on connaisse bien le point auquel se rattache chaque partie du droit, et qu'il soit facile à quiconque a un peu d'activité dans l'esprit,quelque cause ou quelque consultation qui lui soit présentée, d'en saisir le droit et les premiers principes.
XIX. Mais les jurisconsultes, soit pour nous faire illusion, et donner à leur science un appareil plus imposant; soit, ce qui est probable, par ignorance de l'enseignement (car il existe un art d'enseigner comme un art de savoir), divisent souvent à l'infini, lorsqu'ils pourraient simplifier. Ici, par exemple, quelle exagération dans les Scévola, tous deux pontifes, et très habiles dans le droit ! «souvent, dit le fils de Publius (1), j'ai ouï dire à mon père qu'on ne peut être bon pontife si l'on ne sait le droit civil. »
(1) C'est Quintus Scévola, le pontife par excellence, fils de Publius Scévola.
Quoi! tout entier? et pourquoi? Que fait au pontife le droit des murs, des eaux, ou tout autre ? C'est donc seulement la partie du droit qui se lie à la religion ; mais combien c'est peu de chose! les sacrifices, je crois, les voeux, les fériés, les sépultures, et autres objets pareils. D'où vient l'importance qu'on y donne, quand tout le reste en a si peu ? Sur les sacrifices, qui sont la partie la plus étendue, il ne faut qu'une règle : c'est qu'ils se conservent toujours, et se transmettent dans les familles, ou, comme je l'ai mis dans la loi, qu'ils soientà perpétuité. De ce principe posé, l'autorité des pontifes a déduit comme règle de droit que, dans le cas où la mort du père de famille pourrait interrompre la tradition des sacrifices, ils fussent dévolus à ceux auxquels reviendrait alors la fortune. De ce même principe, qui suffit pour la connaissance de la science, naissent d'innombrables questions qui remplissent les livres des jurisconsultes. On demande en effet qui est astreint aux sacrifices. Rien de plus juste que d'en charger les héritiers, nul ne représentant mieux la personne du mort. Après eux vient celui qui, par le fait de la mort ou du testament, prend dans la succession autant que tous les héritiers, et cela en proportion du legs ; car c'est une conséquence naturelle. En troisième lieu, s'il n'y a point d'héritier, celui qui possédait par usucapion la plus forte portion des biens du défunt, au jour du décès. Quatrièmement, s'il ne se trouve aucun acquéreur de ce genre, celui des créanciers qui a le plus retiré de la succession. Enfin, le dernier qui doive hériter des sacrifices est le débiteur du défunt, qui, n'ayant payé à personne, sera réputé avoir acquis par prescription la somme qu'il n'aura point payée.
XX.Voilà ce que nous avons appris de Scévola, et ce n'est point la doctrine des anciens. Ceux-ci enseignaient qu'on peut être obligé aux sacrifices de trois manières : si l'on est héritier ; si l'on est légataire de la plus grande portion de la fortune, ou si, cette portion ayant été léguée, on est co-partageant du legs. Mais suivons le pontife. Vous voyez que tout porte sur ce point, que les pontifes veulent que les sacrifices suivent les biens; et ils y joignent encore les fêtes et les cérémonies. Que dis-je ? les Scévola donnent aussi cette règle de partage : que les légataires, s'il n'y a point de déduction écrite dans le testament, et qu'ils aient pris dans la succession moins que ce qui est laissé à tous les héritiers, ne soient point tenus des sacrifices. Or, dans les donations, ils interprètent le même point différemment: ce que le père de famille a approuvé dans la donation faite à quiconque est en sa puissance, est valable; ce qui a été fait à son insu, s'il ne l'approuve pas, n'est point valable. De ces propositions naissent une foule de petites questions que celui qui les connaît le moins pénétrera facilement, s'il les rapporte au principe. Par exemple, supposé qu'un légataire, de crainte d'être obligé aux sacrifices, ait pris moins que son legs, et que dans la suite un de ses héritiers réclame en proportion de sa part ce qui a été abandonné par celui dont il hérite ; si la somme, jointe à la portion antérieurement exigée, n'est pas moindre que la totalité du partage de tous les héritiers, celui qui aura fait la revendication, seul et sans le concours de ses cohéritiers, sera tenu des sacrifices. Ils décident même que celui dont le legs est plus fort qu'il ne peut être sans obliger au devoir religieux, peut s'acquitter en payant au poids et à la balance l'héritier testamentaire, attendu qu'ayant ainsi fait la soute de l'hérédité, les choses sont au même état que s'il n'y avait point eu de legs.
XXI. Sur ce point et sur beaucoup d'autres, je dis aux Scévola, ces grands pontifes d'un esprit des plus subtils : Pourquoi tenter d'unir ainsi le droit civil au droit pontifical? Par la science de l'un, vous supprimez en quelque manièrec elle de l'autre.En effet, c'est votre autorité, ce n'est point la loi qui a mis les sacrifices du côté de l'argent. Si donc vous n'étiez que pontifes, la décision pontificale subsisterait; mais comme vous êtes en même temps très habiles dans le droit civil, vous éludez l'une des deux sciences par l'autre. Les grands pontifes P. Scévola, Coruncanius (1) et les autres, veulent que ceux dont le legs égale la totalité des héritages soient obligés aux sacrifices : c'est là le droit pontifical.
(1) Cicéron fait plusieurs fois l'éloge de Coruncanius. Il y eut plusieurs pontifes de ce nom, entre autres le premier plébéien, élu grand pontife (Brut., 14 ; Tit. Liv., Epit. XVIII).
Qu'est-ce que le droit civil y a donc ajouté? La clause du partage, stipulée par précaution pour la déduction des cent sesterces : moyen inventé pour affranchirle legs de la charge des sacrifices. Que si le testateur n'a point voulu prendre cette précaution, aussitôt ce même Mucius, jurisconsulte et pontife à la fois, avertit le légataire de prendre moins que ce qui reste à tous les héritiers. Ainsi, plus haut, ils disaient que ceux qui prenaientplus dans la succession étaient tenus des sacrifices : maintenant on les en décharge. Ce n'est pas non plus du droit pontifical, c'est du pur droit civil que ce payement au poids et à la balance à l'héritier testamentaire, et qui met les choses en même situation que si l'argent légué ne l'avait point été, dès que le légataire stipule la somme même qui lui est léguée ; en sorte que le montant de son legs lui est dû par stipulation, sans être grevé du sacrifice. J'arrive aux droits des mânes, que nos aïeux ont très sagement institués et très religieusement observés. Ils ont réglé qu'au mois de février, qui était pour eux le dernier de l'année, on célébrerait des fêtes en l'honneur des morts (1). Toutefois D. Brutus (2) était dans l'usage de le faire en décembre, ainsi que l'a écrit Sisenna.
(1) Les fêtes des morts, feralia, se célébraient tous les ans, selon Festus, le 21, et selon Ovide, le 17 de février (Fast., II, 567).
(2) Décimus Brutus, consul l'année 616 de la fondation de Rome, triompha des Galléciens et des Lusitaniens, et reçut le nom de Gallécus ; il fut le protecteur et l'ami de L. Attius , poëte et historien, dont il fit graver les vers sur les murs des temples et sur les monuments dont il fut le fondateur. (Brut., 18, 22 et 28 ; pro Arch., 11).
Je m'en suis demandé le motif, et j'ai trouvé pourquoi Brutus s'écartait en cela de l'usage de nos aïeux ; car je vois que Sisenna l'ignore. Que Brutus eût négligé sans raison un établissement de nos pères, cela ne me paraissait pas vraisemblable dans un homme sage, et dont Attius fut l'intime ami ; mais c'est, je crois, qu'il prenait le mois de décembre pour le dernier mois de l'année, et les anciens celui de février. C'est lui, du reste,qui regardait comme un devoir de piété d'immoler aux fêtes funèbres une grande victime.
XXII. Telle est la religion des tombeaux,
qu'on dit qu'il n'est point permis de les transporter
hors du lieu des sacrifices et de la demeure
de la famille : ainsi, du temps de nos pères,
A.
Torquatus l'a jugé pour la famille Popilia. Et
sans doute les dénicales, appelées ainsi de l'un
des noms de la mort; parce qu'elles sont chômées
en l'honneur des morts, ne seraient point
appelées fêtes comme les jours de repos en l'honneur
des autres habitants du ciel, si nos aïeux
n'avaient voulu que ceux qui étaient sortis de
cette vie fussent au nombre des Dieux. La loi
est de les placer à des jours où il n'y ait ni fêtes
personnelles ni fêtes publiques; et toute la disposition
de cette partie du droit pontifical annonce
qu'il s'agit d'une religion importante et d'une
grande cérémonie.
Il ne nous est pas nécessaire de développer
comment cesse l'état d'une famille qui a perdu
un de ses membres, quelle sorte de sacrifice se
fait avec des béliers au dieu Lare, comment on
ensevelit l'os qu'on a réservé à la terre, quelles
règles obligent au sacrifice de la truie, enfin à
quel moment la sépulture devient tombeau et est
consacrée par la religion.
Seulement le genre de sépulture le plus ancien
me pâraît être celui que Cyrus choisit dans Xénophon
: le corps est rendu à la terre, et là, doucement déposé, il semble couvert du voile d'une mère.
Et c'est suivant le même rit que notre roi Numa
fut, dit-on, enseveli dans le tombeau voisin des
autels d'Égérie; c'est aussi la sépulture qui fut
en usage dans la famille Cornélia jusqu'à nos
jours. Mais les restes de Marius, déposés au bord
de l'Anio, furent dispersés par l'ordre de Sylla
victorieux, animé d'une haine cruelle, et plus
violent que sage. Alors, craignant peut-être que
ses restes n'éprouvassent le même outrage, il
voulut, le premier des Cornélius patriciens, être
brûlé après sa mort, en effet, Ennius nous dit,
en parlant de Scipion l'Africain: Il repose en ce lieu, celui.... Il repose ne peut se dire que de ceux qui sont
ensevelis. Cependant il n'y a point de tombeau
pour eux, avant que les derniers devoirs n'aient
été rendus et le corps déposé. Et bien qu'aujourd'hui
l'on emploie indistinctement pour toutes
les sépultures le mot d'inhumation, il ne se disait
autrefois que pour ceux que couvrait un peu
de terre jetée, et le droit pontifical confirme cet
usage; car avant que la terre n'ait été jetée en monceau
sur l'os réservé, le lieu où le corpsa été brûlé
n'a aucune sainteté ; la terre une fois jetée, le mort
est inhumé, le lieu prend le nom de tombeau,
et dès lors seulement il a plusieurs droits religieux.
Ainsi, dans le cas où un homme tué sur
un vaisseau est jeté à la mer, P. Mucius a prononcé
que sa famille était pure, parce qu'il ne
restait pas sur la terre un seul de ses os ; que
dans le cas contraire, l'héritier était obligé à
l'offrande de la truie, aux trois jours de fête,
et que la truie était sacrifiée en expiation. Si l'homme est mort dans la mer, il ordonne les
mêmes pratiques, hors les fêtes et le sacrifice
expiatoire.
XXIII. ATT. Je vois ce qu'il y a dans le droit pontifical ; mais qu'y a-t-il dans les lois ? — MARC. Peu de chose, Titus, et rien, je crois, que vous ne sachiez tous deux. D'ailleurs, elles s'occupent moins de la religion que du droit des tombeaux : « Qu'un homme mort, dit la loi des douze Tables, ne soit ni enseveli, ni brûlé dans la ville. » Soit, ne fût-ce que pour le danger du feu. Cette addition ni brûlé indique que l'on est enseveli lorsqu'on est inhumé, et non quand on est brûlé. — ATT. Mais ces hommes illustres qui, depuis les douze Tables, ont été ensevelis dans la ville ? — MARC. Je crois, Titus, que c'étaient des hommesà qui leur mérite avait fait accorder avant la loi, comme à Publicola, comme à Tubertus, un honneur que leurs descendants ont conservé de droit ; ou s'il en est quelques-uns qui l'aient obtenu depuis, comme C. Fabricius, qu'ils ont été de même affranchis des lois pour leur vertu. La loi n'en défend pas moins d'ensevelir dans la ville. Ainsi le collège des pontifes a décrété qu'il n'était point de droit de placer un tombeau dans un lieu public. Vous connaissez, hors de la porte Colline (1), le temple de l'Honneur : c'est une tradition que dans ce lieu il y avait autrefois un autel.
(1) La porte Colline était près des monts Viminal et Quirinal, dont elle tirait son nom (a collibus). L'anecdote que rapporte Cicéron n'est connue que par lui ; dans les temps modernes et dans les idées chevaleresques, ces mots de maîtresse de l'honneur, écrits sur une lame d'épée,se comprendraient facilement; mais dans l'antiquité, il faut convenir qu'ils n'offrent aucun sens. On propose diverses conjectures.
Auprès de cet autel on trouva une lame sur laquelle était écrit Domina Honoris, et ce fut la cause de l'érection de ce temple. Mais comme il y avait dans le même lieu beaucoup de sépultures, on y passa la charrue; car le collège prononça qu'un lieu public ne pouvait être lié par des consécrations particulières. Ce qu'il y a de plus dans les douze Tables sur la diminution des dépenses et des lamentations funéraires, est à peu près traduit des lois de Solon : « Qu'on ne fasse rien de plus que cela, disent-elles ; qu'on ne polisse point avec le fer le bois du bûcher. » Vous savez ce qui suit ; car dans notre enfance, on regardait comme une nécessité de nous faire apprendre les douze Tables, que presque personne n'apprend aujourd'hui. Après avoir réduit le luxe à trois robes de deuil (1), autant de bandes de pourpre et dix joueurs de flûte, elles suppriment aussi les lamentations : « Que les femmes ne se déchirent point les joues ; qu'elles s'interdisent le lessus des funérailles. »
(1) Ces robes de deuil, ricinia, étaient ornées de liens ou de noeuds de pourpre d'une forme particulière ; les femmes les jetaient avec leurs ornements sur le bûcher de leurs parents. Il paraît qu'on se rendait aux funérailles avec plusieurs de ces robes,afin d'en jeter un plus grand nombre et la loi défendait d'en porter plus de trois ; tel paraît être du moins le sens de celle de Solon ; peut-être aussi la loi réduit-elle tout simplement à trois en tout le nombre de celles que l'on peut brûler sur le bûcher. Cette cérémonie,ainsi que toutes celles des funérailles, se faisait au son de la flûte.
Les anciens interprètes, Sext. Élius et L. Acillius, ont dit qu'ils n'entendaient pas bien cet endroit, mais qu'ils soupçonnaient que le lessus était quelque espèce de vêtement funèbre. L. Élius prend lessus pour un gémissement lugubre, comme le mot lui-même semble l'indiquer : explication que je crois d'autant plus vraie, que c'est précisément ce que défend la loi de Solon. Ces règles sont louables, et à peu près égales pour les riches et pour le peuple ; et, sans doute, il est bien naturel que la différence de condition s'efface à la mort.
XXIV. Toutes les autres cérémonies funèbres qui ajoutent au deuil, les douze Tables les ont aussi retranchées : « Qu'on ne recueille point, disent-elles, les os d'un mort, afin de célébrer plus tard les funérailles. » Elles n'exceptent que la mort à la guerre ou dans l'étranger. Il y a aussi des dispositions sur la coutume d'oindre les corps ; cette opération que faisaient les esclaves (1) est interdite, ainsi que le banquet funèbre : choses qui sont abolies avec raison, et l'abolition prouve qu'elles existaient.
(1) Le corps, avan td'être enseveli, était
lavé avec de l'eau chaude, et oint de parfums et d'essences
par des esclavesa ppelés pollinctores. C'est apparemment ce luxe que Cicéron interdit ; la
défense est rigoureuse, et moins motivée que celle qui proscrit
le banquet funèbre, qu'il ne faut pas, je crois, confondre
avec le silicercium.
Passons sur la prohibition des somptueuses aspersions, des grandes couronnes, des cassolettes. Mais la pensée de la loi n'est-elle pas que les morts ont droit aux insignes de la gloire, lorsqu'elle porte que la couronne décernée à la vertu peut, au jour des funérailles, être placée sur le front de celui qui l'aura remportée, et sur le front de son père. Je vois encore qu'il était arrivé souvent de célébrer plusieurs fois des obsèques, et d'étendre plusieurs lits en l'honneur d'une seule personne, puisque dans la loi il est défendu de le faire. Une loi défendait l'or dans les sépultures ; une autre loi a l'attention d'ajouter aussitôt : « Celui dont les dents seront attachées avec de l'or peut être enseveli ou brûlé avec cet or. » Et voyez en même temps qu'on a regardé comme une chose différente d'ensevelir ou de brûler. Il ya en outre deux lois sur les sépultures, dont l'une protége les édifices particuliers, l'autre les sépultures mêmes. Celle qui défend d'élever un bûcher ou un sépulcre nouveau, à moins de soixante pieds de la maison d'autrui, contre le gré du maître, a pour but de prévenir le malheur d'un incendie ; et celle qui prohibe l'acquisition par prescription du forum ou vestibule du sépulcre, et de la place même où le mort a été brûlé ou inhumé, maintient le droit des sépultures. Voilà ce que nous avons dans les douze Tables, en cela très conformes à la nature, cette règle de la loi. Tout le reste est coutumier, comme l'usage d'annoncer les funérailles en indiquant s'il y a des jeux, et si le maître des funérailles aura un appariteur et des licteurs. « Que les vertus des personnages distingués soient célébrées en assemblée publique, et que cet éloge soit accompagné de chants et de flûtes. » C'est ce qu'on appelle nenia, lamentations, d'un mot qui, chez les Grecs, désigne aussi les chants lugubres.
XXV. -QUINT. Je suis content que nos lois s'accordent avec la nature,et j'aime beaucoup la sagesse de nos pères. — MARC. Je crois aussi surtout, Quintus, que le luxe des tombeaux, comme tous les autres luxes, demande à être modéré : car le tombeau de C. Figulus vous fait voir jusqu'où ce genre de faste est porté. Il me semble d'ailleurs qu'on n'avait pas autrefois cette passion ; autrement nos ancêtres en auraient laissé de nombreux monuments. Aussi les interprètes de notre loi, au chapitre où il est ordonné d'écarter du culte des Dieux mânes la dépense d'un deuil fastueux, entendent qu'une des premières choses que la loi veut restreindre, est la magnificence des sépulcres ; et ce soin n'a pas été négligé des plus sages législateurs. C'est, disent-ils, une coutume à Athènes, et une loi qui remonte à Cécrops, que de couvrir les morts de terre. Les plus proches parents jetaient la terre eux-mêmes, et lorsque la fosse était comblée, on semait des graines sur cette terre, dont le sein, comme le giron d'une mère, s'ouvrait pour le mort, et dont le sol purifié par cette semence était rendu aux vivants. Venaient ensuite des festins, où présidaient les parents couronnés de fleurs. Là se faisait l'éloge du défunt, quand il y avait quelque chose de vrai à dire ; car le mensonge était tenu pour sacrilège. Ainsi s'accomplissaient les funérailles. Lorsqu'ensuite, comme l'écrit Démétrius de Phalère, la somptuosité et les lamentations eurent commencé,la loi de Solon les abolit. C'est cette loi que nos décemvirs ont insérée presque en proprestermes dans la dixième Table : car les trois robes de deuil et presque tout le reste est de Solon ; et l'article qui défend aux femmes de se déchirer le visage et de se lamenter est littéralement traduit.
XXVI. Il n'y a rien de plus dans Solon, sur
les sépulcres, que la défense de les détruire, ou
d'y déposer le corps d'un autre ; et une peine
contre celui qui aura outragé, renversé ou brisé
un tombeau (car c'est là, je crois, ce que le mot
grec signifie),un monument, ou une colonne funéraire.
Mais peu après, l'immensité de ces mausolées
que nous voyons dans le Céramique avait
fait défendre, par la loi, d'élever de tombeau qui
exigeât un travail au-delà de celui de dix hommes
pendant trois jours. Il n'était plus permis de
les orner de stuc, d'y placer ce qu'ils appellent
des Hermès, de prononcer l'éloge du mort, si ce
n'est dans les obsèques publiques, et par la bouche
de l'orateur nommé par l'État. Toute réunion
nombreuse d'hommes et de femmes était également
supprimée, afin de diminuer les lamentations
: car ces grands concours augmentent le
deuil. Aussi Pittacus défend-il absolument à qui
que ce soit d'aller aux funérailles d'un étranger.
Mais le même Démétrius ajoute que la magnificence
des funérailles et des sépultures reprit de
nouveau, telle à peu près que nous la trouvons
maintenant à Rome. Il combattit lui-même cette
mode par une loi. Car, vous le savez, si c'était
un très savant homme, c'était aussi un bon citoyen
et un homme d'État très habile. Non content
d'une peine, il restreignit la profusion en
changeant l'heure, et il ordonna que les obsèques
se fissent avant le jour. Il mit également ordre aux nouvelles sépultures; il ne laissa point
placer autre chose sur le monceau de terre qu'une
petite colonne haute de trois coudées au plus, une
table de pierre, ou un bassin ; et il nomma un
magistrat spécial pour y veiller.
XXVII. Voilà pour vos Athéniens. Passons à Platon, qui renvoie le règlement des funérailles aux interprètes des choses religieuses, forme que nous observons. Quant aux sépulcres, voici ce qu'il dit. Il défend qu'aucune partie d'un champ cultivé, ou qui peut l'être, soit prise pour une sépulture ; il veut que le champ dont la nature est telle qu'il ne peut que servir d'asile aux restes des morts, sans préjudice pour les vivants, soit employé de préférence : mais que la terre qui peut porter des fruits et fournir aux hommes la nourriture, comme une mère à ses enfants, ne reçoive aucun dommage ni des vivants ni des morts. Il interdit les tombeaux dont la hauteur dépasserait le travail que cinq hommes accomplissent en cinq jours, et les masses de pierres plus grandes que l'espace nécessaire pour graver la louange du mort en quatre vers héroïques, ou de ceux qu'Ennius appelle grands vers. Nous avons donc aussi, pour les sépultures, l'autorité de ce beau génie ; mais il a de plus déterminé les frais des funérailles selon le cens, depuis une mine jusqu'à cinq. Du reste, il répète tout ce que nous savons de l'immortalité de l'âme, du repos qui attend les bons après la mort, et des peines des impies.Vous avez maintenant, ce me semble, tout ce qui regarde la religion. — QUINT. Oui, sans doute, mon frère, et même avec détail. Mais passez au reste.—MARC. Volontiers ; et puisque vous avez eu la fantaisie de m'engager dans cette discussion, je la terminerai dans l'entretien de ce jour, surtout un jour comme celui-ci. Je vois que Platon en a fait autant, et qu'il a terminé tout son entretien sur les lois en un jour d'été.Je l'imiterai, et je vais traiter des magistratures. C'est assurément, la religion une fois constituée, ce qui intéresse le plus la république. — ATT. Parlez donc, parlez, et suivez l'ordre que vous vous êtes prescrit.
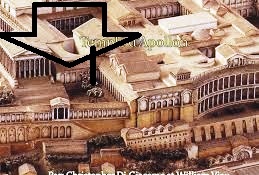
I. -MARCUS. Je suivrai donc, comme je l'ai annoncé, cet homme divin, que, dans mon admiration, je loue plus souvent peut-être qu'il n'est nécessaire.— ATTICUS. Vous parlez de Platon, sans doute. —MARC. De lui-même, Atticus.— ATT. Non, jamais vous ne le louerez trop, ni ne le louerez trop souvent ; car mes confrères eux-mêmes, eux qui veulent qu'on ne loue personne que leur philosophe, m'accordent d'aimer Platon tant que je voudrai. — MARC. Ils font bien, assurément. Quoi de plus digne, en effet, de la politesse d'un homme dont la vie et le langage me semblent offrir l'alliance la plus difficile, celle de la gravité et de l'élégance ? — ATT. Allons, je suis bien aise de vous avoir interrompu, puisque j'y ai gagné une si belle déclaration de votre opinion sur moi. Mais continuez, je vous prie. — MARC. Louons d'abord la loi elle-même ; mais que nos louanges soient vraies et appropriées à sa nature. —ATT. Oui, comme vous avez fait pour la loi religieuse. -MARC. Vous voyez donc le caractère du magistrat : il préside, il prescrit ce qui est juste, utile, conforme aux lois. Comme les lois sont au-dessus des magistrats, les magistrats sont au-dessus du peuple; et l'on peut dire avec vérité que le magistrat est la loi parlante ; la loi, le magistra tmuet. Rien sans doute n'est plus naturel, plus légitime, dans le sens que nous avons donnéà ce mot, que le pouvoir : sans le pouvoir, maison, cité, nation, tout le genre humain ne saurait subsister, non plus que la nature entière, non plus que l'univers lui-même. Car il obéit à Dieu ; la terre et la mer lui sont soumises, et la vie des hommes reconnaît les commandements d'une loi suprême.
II. En effet, pour venir à des faits plus rapprochés
de nous, et qui nous sont plus connus,
toutes les nations anciennes ont obéi à des rois.
Ce genre de pouvoir était déféré d'abord aux plus
justes et aux plus sages ; et cette règle prévalut
dans notre république, tant qu'elle fut sous l'autorité
royale. Depuis, cette autorité s'est transmise
aux descendants; ce qui subsiste encore chez les
rois d'aujourd'hui. Mais ceux à qui la toute puissance
royale déplut firent voeu non pas de
n'obéir à personne, mais de ne pas toujours obéir
à un seul. Nous donc, puisque nos lois sont pour
les peuples libres, et que nous avons déjà exprimé en
six livres nos sentiments sur la meilleure
république, nous conformerons aujourd'hui nos
lois au gouvernement que nous avons préféré.
Il faut des magistrats: sans leur prudence et
leur zèle, la cité ne peut exister ; et dans la détermination
de leurs fonctions réside toute l'économie
de la république. Prescrivons, non-seulement aux magistrats comment il faut commander,
mais aux citoyens comment il faut obéir. Car celui
qui commande bien a nécessairement obéi
quelque temps, et celui qui a la sagesse de l'obéissance
paraît digne de commander un jour. Il
est donc à propos que celui qui obéit espère de
commander quelque jour, et que celui qui commande se
rappelle que bientôt il devra obéir. Mais
c'est peu de se soumettre et d'obéir aux magistrats,
nous prescrivons encore de les respecter
et de les aimer, à l'exemple de Charondas dans
ses lois ; et notre Platon prononce que celui-là
est de la race des Titans qui s'oppose aux magistrats,
comme les Titans aux maîtres des cieux.
Arrivons maintenant aux lois elles-mêmes, si
vous l'approuvez.— ATT. Pour moi, j'approuve
tout, et les principes et la méthode.
III. -MARC. « Que le pouvoir soit juste, et que les citoyens y obéissent docilement et sans débat. — Que le magistrat réprime le citoyen rebelle et coupable par l'amende, les fers, les verges (1), si un pouvoir égal ou supérieur, ou le peuple, n'y met opposition : qu'il y ait droit d'appel devant eux.
(1). L'établissement de la peine des verges est un retour à l'ancien régime de la république. Cette peine portée par les douze Tables avait été abolie en 556, par une loi du tribun M. Porcius Lecca.
—
Lorsque le magistrat aura jugé et condamné, que la contestation sur la peine et sur l'amende regarde le peuple. — A la guerre, que celui qui commande commande sans appel ; que le commandement de celui qui fait la guerre ait force de loi. —Que les magistrats inférieurs, dont l'autorité n'est pas universelle, soient en nombre compétent. A l'armée, qu'ils commandent à ceux qui leur sont subordonnés ; qu'ils soient leurs tribuns. Au dedans,qu'ils gardent le trésor public ; qu'ils veillent sur les prisons ; qu'ils punissent les crimes capitaux; qu'ils marquent du seing public l'airain, l'or, l'argent ; qu'ils jugent les procès engagés qu'ils exécuten tout décret du sénat.— Qu'il y ait des édiles qui prennent soin de la ville, des subsistances, des jeux solennels ; et que ce soit le premier degré pour monter à de plus grands honneurs. — Que des censeurs recensent le peuple, selon l'âge, le nombre d'enfants, le nombre d'esclaves, et le revenu ; qu'ils surveillent les temples de la ville, les chemins, les eaux, le trésor, les impôts ; qu'ils partagent les diverses portions du peuple en tribus ; qu'ils les répartissent par fortunes, par âges et par ordres ; qu'ils enregistrent les enfants des chevaliers et des hommes de pied ; empêchent le célibat ; dirigent les moeurs du peuple ; ne souffrent point l'infamie dans le sénat. Qu'ils soient deux ; que leur magistrature soit quinquennale, tandis que les autres magistratures seront annuelles; mais que cette autorité ne soit jamais abrogée.— Que le préteur, arbitre du droit, juge ou fasse juger les affaires
privées; qu'il soit gardien du droit civil ; qu'il ait autant d'égaux en autorité que l'aura décrété le sénat et ordonné le peuple. —Qu'il y ait deux magistrats avec un pouvoir royal, et que selon qu'ils président, jugent ou consultent, ils soient appelés préteurs, juges, consuls. — En guerre, qu'ils aient un droit souverain et n'obéissent à personne. Que pour eux le salut du peuple soit la suprême loi. — Que nul ne reprenne cette même magistrature qu'après un intervalle de dix ans.— Que l'on observe l'âge réglé par la loi Annale. — Mais en cas de guerre redoutable,ou de discorde civile, qu'un seul, si le sénat le décrète, ait le même droit que les deux consuls, mais pas plus de six mois ; et que, nommé sous un auspice favorable, il soit le maître du peuple. Qu'il ait sous lui un commandant de la cavalerie, avec une juridiction égale à celle du préteur. Mais quand ce maître du peuple existe, qu'il supplée à tous les autres magistrats.
— Que les auspices appartiennent au sénat, et qu'il tire de son sein ceux qui surveilleront dans les comices la création des consuls. Que les chefs d'armées, les gouverneurs de provinces, les lieutenants, quand le sénat le décrète et le peuple l'ordonne, sortent de la ville ; qu'ils fassent justement des guerres justes, ménagent les alliés, se contiennent eux et leurs agents, augmentent la gloire de leur nation, et reviennent dans leur patrie avec honneur.—Que nul ne soit délégué pour ses affaires. — Que le peuple ait les dix tribuns qu'il s'est créés pour le secourir contre la force ; que leur veto, que leurs propositions au peuple fassent loi ; qu'ils soient inviolables, et qu'on ne laisse jamais le peuple dépourvu de tribuns. —
Que tous les magistrats aient leurs auspices et leur juridiction ; qu'ils forment le sénat ; que les décrets du sénat fassent loi. Et si une puissance égale ou supérieure ne l'empêche, que les sénatus-consultes soient enregistrés; que cet ordre soit sans tache ; qu'il soit le modèle des autres.—
Que pour l'élection des magistrats, les jugements, les ordres ou défenses du peuple, lorsqu'on ira aux voix, les suffrages soient connus des grands, libres pour le peuple.
IV. S'il survient quelque chose qui soit hors de la compétence des magistrats, que le peuple en crée un pour décider, et lui donne le droit de le faire. —Que le droit d'agir avec le peuple et les sénateurs appartienne au consul, au préteur, au maître du peuple, à celui de la cavalerie, et au magistrat que le sénat délègue pour la nomination des consuls ; que les tribuns que le peuple s'est donnés aient le droit d'agir avec le sénat; et que les mêmes portent au peuple ce qu'il sera nécessaire de lui apprendre. — Que la modération règne toujours dans les discours tenus devant le peuple et au sénat. — Qu'il y ait, pour le sénateur absent, motif ou délit. Que le sénateur parle en son rang et avec mesure; qu'il prenne en main les causes du peuple. Point de violence dans le peuple ; qu'une autorité égale ou supérieure l'emporte. Mais si une proposition cause du trouble, que la faute en soit à l'auteur. Si une proposition est funeste, que l'opposant soit regardé comme un bon citoyen.—Que ceux qui parleront observent les auspices ; qu'ils obéissent à l'augure ; qu'ils ne fassent leurs propositions qu'après les avoir promulguées, exposées, publiées dans le trésor ; qu'ils ne fassent pas délibérer de plus d'une chose à la fois ; qu'ils expliquent leurs intentions au peuple ; qu'ils souffrent que les magistrats et les particuliers lui en parlent à leur tour.— Qu'on ne rende point de priviléges (1);
(1) Qu'on ne rende point de priviléges. Il faut entendre par là : Qu'on ne rende point de lois spéciales sur un individu.
qu'on ne prononce point sur l'existence d'un citoyen, si ce n'est dans les grands comices, formés de ceux que les censeurs auront admis dans les classes du peuple. — Qu'on ne prenne ni ne donne de présents, soit dans la poursuite du pouvoir, soit pendant, soit après la gestion. Que pour quiconque se sera écarté de toutes ces choses, la peine soit pareille au délit. — Que les censeurs tiennent les lois sous leur garde ; que le magistrat rentré dans la vie privée leur rende compte de ses actes, sans être pour cela exempté de l'action légale. »
V. La loi est récitée (1). Retirez-vous, et je vous ferai donner les bulletins.
(1) Discedite. C'est le mot par lequel le magistrat qui présidait les comices invitait les citoyens à se retirer chacun dans leur tribu ou centurie pour aller aux voix (Tite Live, XXXI, 7). Là, ou plutôt en s'y rendant, ils recevaient individuellement une petite tablette sur laquelle chacun écrivait son vote. Il n'y a point de doute sur cette allusion ; mais discedite est une correction heureuse de Davies ; les manuscrits portent dicere ou discere.
-QUINT. Vous avez en bien peu de mots, mon
frère, mis sous nos yeux toutes les magistratures.
Mais c'est là notre république, ou peu s'en
faut. —MARC. Votre remarque est juste, Quintus
; c'est en effet la constitution publique dont
Scipion fait l'éloge dans nos livres, et qu'il approuve
de préférence: elle ne pourrait se réaliser
sans cette composition des magistratures. Vous
devez savoir que des magistratures dépend la
forme de l'État, et que c'est à leur ordonnance
que l'on reconnaît de quelle espèce est un gouvernement.
Or, comme c'est une chose qui a été
constituée par nos ancêtres avec infiniment de
sagesse et de proportion, je n'ai rien ou presque
rien changé dans leurs lois. — ATT. Vous
voudrez bien, comme vous l'avez fai tpour la loi de
la religion, sur mon observation et à ma prière,
nous exposer aussi, relativement aux magistratures,
les raisons qui vous font préférer cette organisation.
— MARC. Je ferai ce que vous désirez,
Atticus ; j'éclaircirai toute cette matière, comme
l'ont approfondie et discutée les plus savants des
Grecs; puis, ainsi que je me le suis proposé,j'arriverai
à nos lois particulières.— ATT. J'attends
surtout ce point de la discussion.—MARC. Presque
tout, au reste, a été dit et devait l'être, dans
ces livres où nous recherchions la meilleure
république. Mais il y a, sur ce sujet des magistratures,
des questions spéciales, qui ont été examinées
de plus près, d'abord par Théophraste,
ensuite par Dion le stoïcien.
VI. ATT. Que dites-vous? les Stoïciens ont encore traité de cela ? — MARC. Non, si ce n'est celui que je viens de nommer, et après fut un grand homme, un des premiers pour la science, Panétius ; car les anciens de la secte s'occupaient bien de la république,et même ingénieusement, mais jamais d'une manière usuelle et civile. C'est plutôt la famille de Socrate qui ouvrit la source où nous puisons; Platon commença; puis Aristote éclaira, par ses recherches, toute la politique, ainsi qu'Héraclide de Pont, qui avait eu Platon pour maître. Pour Théophraste, instruit par Aristote, il s'étendit, vous le savez, sur ces matières ; et un autre élève du même maître, Dicéarque, ne négligea point non plus cette partie de la science. Enfin, à la suite de Théophraste, ce Démétrius de Phalère, dont j'ai parlé plus haut, sut admirablement faire sortir la science des écoles de la philosophie et du sein du repos, pour la conduire non seulement au soleil et dans l'arène, mais au milieu des hasards du gouvernement; car nous pouvons citer beaucoup de grands hommes d'État, médiocrement philosophes, et de grands philosophes qui n'étaient pas trop versés dans les affaires publiques. Mais l'homme qui excellerait sous les deux rapports, qui serait le premier dans l'étude de la doctrine et dans le gouvernement de l'État, après Démétrius, pourrait-on le trouver aisément?
VII. -ATT. Oui, je crois qu'on le peut, et même
quelqu'un de nous trois. Mais continuez.
MARC. Ils ont donc cherché s'il convenait qu'il
y eût dans la cité un magistrat auquel tous les
autres obéissent, chose qui convint, je le vois,
à nos ancêtres mêmes, après le bannissement des
rois. Mais comme le gouvernement royal, d'abord approuvé, a été rejeté depuis, moins pour les
vices de la royauté que pour ceux du roi, le nom
seul de monarque sera proscrit, et la monarchie
subsistera, si un seul magistrat commande à tous
les autres. Voilà pourquoi les éphores, à Lacédémone,
n'ont pas été sans cause opposés aux rois
par Théopompe, ni parmi nous les tribuns aux
consuls. Le consul, en effet, a toute la puissance
légale, et les autres magistrats lui sont subordonnés,
à l'exception du tribun, qui fut créé
plus tard, de peur que ce qui avait été ne revînt.
Ce fut une première diminution du droit
consulaire, que l'existence d'un magistrat qui n'en
dépendait point ; la seconde fut le secours qu'il
prêta non-seulement aux autres magistrats, mais
aux citoyens qui n'obéissaient point au consul.
— QUINT. Vous parlez là d'un grand mal ; car
une fois que cette magistrature fut née, l'autorité
des grands tomba, et le pouvoir de la multitude
prit des forces. -
-MARC. Non, non, Quintus
; l'autorité consulaire devait nécessairement
paraître un jour trop superbe au peuple, et même
trop violente ; au lieu qu'avec ce sage tempérament,
la loi fut égale pour tous...
Ici manque tout le commentaire de la loi, depuis le premier article jusqu'à la fin du treizième.
VIII. « Qu'ils reviennent avec gloire dans leur patrie. Les hommes vertueux et purs ne doivent en effet rien rapporter des pays alliés ou ennemis, que la gloire.— Peut-on douter ensuite que rien ne soit plus honteux qu'une légation qui n'est point dans l'intérêt public ? Je me tais sur la conduite passée et présente de ceux qui vont en légation recueillir un héritage, ou l'acquittement de leurs créances. C'est peut-être la faute des personnes; mais, je le demande, qu'y a-t-il en effet de plus indigne qu'un sénateur délégué sans commission, sans mandat, sans la moindre fonction publique? C'est cette espèce de légation que, dans mon consulat, j'aurais abolie de l'aveu des sénateurs, quoiqu'elle paraisse être dans leurs intérêts, sans l'opposition inconsidérée d'un tribun du peuple. Toutefois j'en diminuai la durée, et réduisis à une année ce qui n'avait point de terme. Mais, à la durée près, la honte de l'abus subsiste. Maintenant, s'il vous plait, quittons les provinces, et revenons à la ville. — ATT. Je le veux bien, mais ceux qui sont dans les provinces ne le veulent pas. —MARC. Mais aussi, Titus, s'ils obéissaient à nos lois, rien ne serait pour eux plus doux que la ville et que leur maison ; rien ne leur paraitrait plus fâcheux ni plus triste que la province. La loi qui suit consacre la puissance des tribuns du peuple telle qu'elle existe dans notre république : aucune discussion là-dessus n'est nécessaire.— QUINT. Et moi, je vous demanderai cependant, mon frère, ce que vous pensez de cette puissance-là; car elle me parait pernicieuse, comme née dans la sédition et pour la sédition. Si nous nous rappelons sa première origine, nous la voyons s'élever, au bruit de la guerre civile, pendant l'occupation et le siége des hauteurs de Rome. Puis, promptement rejeté comme un de ces monstres d'une naissance prématurée, que proscrivent les douze Tables, le tribunat fut reproduit peu de temps après, et naquit plus horrible encore et plus hideux.
---- L'an de Rome 260, les plébéiens, révoltés contre le sénat et la noblesse, se retirèrent, conduits par Sicinius, sur le mont Sacré. Le sénat, pour faire cesser la révolte, accorda un adoucissement des lois sur les dettes, et l'établissement des tribuns du peuple (Tite Live, II, 23, 32, 33). Quarante ans après, les décemvirs, chargés de refaire la législation, ne recréèrent point le tribunat. Mais une nouvelle sédition et une nouvelle retraite sur le mont Sacré, l'an 304 de Rome, en amenèrent le rétablissement (Ibid, III, 49 et suiv.) De là cette comparaison que fait Quintus de la naissance du tribunat avec celle de ces enfants faibles et monstrueux que la barbarie des douze Tables ordonnait de noyer (Denys d'Halic., II ; Sénèque, de Ira, I, 13). Montesquieu n'est pas de l'avis de Quintus sur l'origine du tribunal. (Esprit des Lois, L. XII, ch. 21 ; Grandeur et décadence,ch. 8).
IX. Que ne fit-il pas alors ? Il commença (digne coup d'essai d'un impie, par ravir aux pères de l'État tous leurs honneurs; il confondit, troubla, bouleversa toutes choses, et après avoir foulé aux pieds la majesté de la noblesse, ne se reposa pas. Pour ne rien dire ni de C. Flaminius (1), ni des premiers temps de notre histoire, quelle ombre de droit le tribunate Tib. Gracchus laissa-t-il aux gens debien ?
(1) C. Flaminius, celui qui, étant consul, perdit la bataille deTrasimène, avait, durant son tribunat, porté la quatrième loi agraire au sujet du Picenum, abandonné par les Gaulois (Brut., 14 ; de Senet. 4). L'an de Rome 615 , les tribuns voulurent s'arroger le droit d'exempter du service militaire dix citoyens, chacun à leur choix. L'un d'eux, C, Curiatius, fit emprisonner les deux consuls P. Corn. Scipion Nasica et D. Junius Brutus,qui s'opposaient à leur prétention (Tite Live, Epit. lib. LV). L'histoire des Gracques et celle de Saturninus sont connues.
Cinq ans auparavant,les consuls D. Brutus et P. Scipion (quels noms et quels hommes! ), par l'ordre du plus vil et du plus méprisable des factieux, C. Curiatius, tribun du peuple, avaient été traînés en prison : chose inouïe jusqu'à leur consulat. Avons-nous oublié C. Gracchus qui faillit renverser Rome, et qui disait lui-même que du haut de la tribune il jetait aux Romains des glaives et des poignards? Que dirai-je du supplice de Saturninus, et de tant d'autres dont la république n'a pu se délivrer qu'en s'armant elle-même? Pourquoi d'ailleurs rapporterais-je des faits anciens ou étrangers, plutôt que des faits récents et personnels ? Qui jamais eût été assez audacieux, assez notre ennemi pour nous attaquer dans notre position, s'il n'avait pu aiguiser contre nous le poignard de quelque tribun? Et comme ces hommes perdus de crimes ne trouvaient d'auxiliaire dans aucune maison, ni même dans aucune famille, ils se sont décidés, au milieu des ténèbres de la république, à bouleverser les familles mêmes. Chose remarquable et glorieuse pour notre mémoire, qu'il n'ait pu se trouver à aucun prix de tribun contre nous, qu'un homme à qui il n'était pas même permis d'être tribun. Mais aussi quels ravages il a faits ? tous les ravages que, sans lumières, sans la moindre bonne espérance, a pu produire la fureur d'une bête féroce enflammée par les fureurs des autres. Permettez-moi donc d'approuver une fois Sylla (1), qui par sa loi enleva aux tribuns du peuple le pouvoir d'être dangereux, et ne leur laissa que celui d'être utiles : et quant à notre Pompée, dans tout le reste de sa carrière politique je ne cesse de lui donner des louanges infinies ; sur l'article de la puissance tribunitienne je me tais, car je ne veux pas le blâmer ; et le louer, je ne le puis.
(1) Sylla, dictateur, ne laissa aux tribuns que le droit d'intercession, et leur ôta la proposition des lois, ainsi que plusieurs autres priviléges que Pompée leur rendit plus tard. Une des fonctions des tribuns était en effet de porter secours ; ceux qui les imploraient disaient : A vobis, tribuni, postulo, ut mihi auxilio sitis. Les tribuns répondaient : Auxilio erimus, vel non erimus (Tite Live, iv, 26 ; xxviii, 45).
X. -MARC. Oui, vous découvrez parfaitement, Quintus, tous les vices du tribunat. Mais il est injuste, quand on attaque une chose, d'en omettre les avantages pour en compter les inconvénients et n'en choisir que les défauts. Par cette méthode on pourra blâmer même le consulat, pour peu qu'on veuille recueillir toutes les fautes de tels consuls que je ne nommerai pas. Sans doute j'avoue aussi qu'il y a quelque mal dans cette puissance des tribuns; mais le bien que l'on y a cherché, sans le mal, nous ne l'aurions pas. La puissance des tribuns du peuple est trop grande ! Qui en doute ? Mais la force populaire est bien plus violente et plus redoutable : avec un chef, il sera toujours plus aisé de la calmer que si elle était libre et sans frein. Un chef se souvient que chaque pas qu'il fait peut lui être funeste; la foule qui se précipite ne songe jamais à ses dangers. Mais un tribun l'irrite quelquefois ! Combien de fois aussi ne l'a-t-il pas calmée ? Quel est, en effet, le collége de tribuns si désespéré que sur dix il ne s'en trouve pas un qui soit raisonnable? Tib. Gracchus, lui-même, n'est-ce pas un tribun opposant, interdit, que dis-je ? supprimé par lui, qui le brisa ? Quel autre soup le renversa en effet, sinon le tort qu'il eut d'enlever à son collègue le droit d'intercession? Et vous, voyez en ceci la sagesse de nos pères, cette magistrature une fois accordée au peuple par le sénat, les armes tombèrent, la sédition fut éteinte ; un tempérament fut trouvé par lequel les plus petits crurent devenir les égaux des plus grands et ce fut le salut de l'État. Mais les deux Gracques enfin ? Joignez-y tous ceux que vous voudrez, et quoiqu'on en nomme dix tous les ans, parmi quelques hommes turbulents et légers, vous n'en trouverez pas un qui ait été vraiment funeste à sa patrie. Par eux, le premier ordre est à l'abri de l'envie ; le peuple n'élève plus de dangereuses querelles sur ses droits. Enfin, il ne fallait point bannir les rois, ou il fallait donner au peuple la liberté de fait et non de parole ; et encore elle lui a été donnée de telle sorte, qu'elle pût se confier souvent aux plus illustres citoyens et céder à l'autorité des grands.
---- Le tribun Octavius s'étant opposé à la loi agraire de Tib. Gracchus, celui-ci, sans tenir compte de son intercession, le fit déposer par le peuple. Ce traitd'audace poussa les patriciens à l'extrême, et quelques jeunes nobles, sous la conduite de Nasica, mirent à mort Tibérius. Ce fait explique la phrase de notre auteur, dont le sens n'est pas douteux, quoique les termes en soient défigurés. Le texte qu'on a suivi se rapproche d'une correctionde Bentley.
XI. Quant à ce qui nous regarde, mon cher et excellent frère, il est vrai que les tribuns étaient puissants quand nous fûmes malheureux ; mais je ne les accuse pas. Ce n'est point le peuple soulevé qui a voulu renverser ma fortune ; mais les prisons furent ouvertes, les esclaves excités contre moi ; une terreur militaire se joignit à ces menaces ; nous eûmes alors à combattre moins contre notre funeste ennemi que contre les temps les plus orageux de la république. Si je n'eusse cédé, la patrie n'eût pas recueilli longtemps les fruits de mon consulat. Et l'événement l'a montré : quel est l'homme libre, quel est même l'esclave digne de la liberté, à qui mon salut n'ait point été cher ? Que si tel eût été le tour des affaires que tout ce que j'ai fait pour la conservation de la république n'eût pas obtenu la reconnaissance de tout le monde ; si j'eusse été banni par la multitude irritée ; si quelque tribun eût excité le peuple contre moi, comme fit Gracchus contre Lénas (1), Saturninus contre Métellus, nous le supporterions, ô mon frère !
(1) P. Popillius Lénas, consul
l'année qui suivit la mort de Tibérius, avait fait bannir
tous sesamis. Pour se venger, Caïus fit passer, dix ans après,
une loi qui traduisait devant le peuple tout magistrat qui
aurait banni un citoyen sans jugement; et Lénas fut exilé. La loi agraire de Saturninus,en 644, portait
que tous les sénateurs en jureraient l'observation, sous
peine d'exil. Q. Métellus Numidicus refusa seul, et fut
forcé de quitter Rome.
ô Quintus ! et nos consolateurs seraient moins ces philosophes d'Athènes, dont c'est pourtant le devoir, que les grands hommes qui, bannis de cette ville, aimèrent mieux se passer d'une ingrate patrie, que demeurer dans une patrie criminelle. J'en viens à Pompée : vous l'approuvez moins ici que sur tout le reste ; mais il me semble que vous ne remarquez pas assez qu'il dut considérer non seulement le meilleur, mais en même temps le nécessaire. Il sentit que l'autorité des tribuns ne pouvait manquer plus longtempsà la république. Et comment un peuple qui l'avait si fort demandée avant de la connaître y eût-il renoncé après l'avoir connue ? Il était donc d'un citoyen sage de ne point abandonner une mesure qui, sans être pernicieuse, était si populaire, qu'il était impossible de résister au premier flatteur du peuple qui s'en serait emparé. Vous savez, mon frère, que, dans un entretien du genre du nôtre, on dit oui à celui qui parle, afin qu'il puisse passer à autre chose.
XII. -ATT. Pour moi, je suis de votre avis. —
QUINT. Moi, je n'en suis pas encore ; mais ne
laissez pas de continuer. — MARC. Vous persistez
donc dans votre première opinion ?
—
QUINT.
A présent, oui. — ATT. Je suis d'un autre sentiment
que notre cher Quintus ; mais écoutons le
reste.
-MARC. Nous donnons ensuite auspices et juridiction
à tous les magistrats : juridiction, à la condition que la puissance du peuple subsistera
pour recevoir l'appel; auspices, afin que des délais
plausibles empêchent beaucoup de comices
dangereux : car souvent les Dieux immortel sont
arrêté par des auspices l'injuste précipitation du
peuple. Composer le sénat de ceux qui ont exercé
les magistratures est populaire : personne ainsi
ne peut arriver au rang suprême que par le peuple,
et l'élection censoriale se trouve supprimée.
Mais il y a un correctif dans l'article suivant, qui
fortifie l'autorité du sénat : « Que ses décrets fassent
loi. » Il est constant que si le sénat était
maître du conseil publie, que tous prissent la défense
de ce qu'il décrète, et que les autres ordres
voulussent que la république fût gouvernée par
la sagesse de l'ordre suprême, il se pourrait qu'au
moyen d'une combinaison qui placerait la puissance
dans le peuple, et l'autorité dans le sénat,
on obtînt cette constitution tant cherchée d'un
gouvernement pacifique et tempéré, surtout si
l'on observe la loi suivante : « Que cet ordre soit
sans tache, qu'il soit le modèle des autres. »
-QUINT. Elle est belle, mon frère, cette loi, et
elle porte très loin. Et voulant que l'ordre soit
sans tache, elle exige un censeur pour interprète (1).
(1) Quintus, encore plus attaché que son frère aux vieilles institutions, surtout lorsqu'elles sont conformes aux intérêts patriciens, réclame l'intégrité des privilèges de la censure, et son droit d'épuration sur le sénat. Atticus réplique par un sarcasme très vif contre le sénat, qui, à la vérité, était plus corrompu que jamais, depuis que Sylla avait introduit dans cette assemblée la foule de ses créatures.
— ATT. Mais quoique le sénat soit à vous tout entier, et qu'il conserve un souvenir reconnaissant de votre consulat, permettez-moi de dire qu'il désespérerait et tous les censeurs et tous les juges.
---- Cicéron veut populariser, d'une part, la composition du sénat, en ôtant aux censeurs le droit de le former à peu près arbitrairement ; et de l'autre, augmenter son autorité, en donnant force de loi à ses décrets. C'est une application de ce système qui séduit tous les caractères doux et tous les esprits timides, de ce système de la fusion des contraires et du rapprochement des extrêmes. Cicéron, dans sa conduite comme dans ses doctrines politiques, prétendit toujours à maintenir cette balance si vainement cherchée entre l'élément démocratique et l'élément aristocratique, dont se composai tà ses yeux le gouvernement de Rome : car, de son temps, on croyait aussi à la balance des pouvoirs.
XIII. -MARC. Cessez, Atticus : il n'est question ici ni du sénat, ni des hommes d'aujourd'hui, mais des hommes à venir, s'il y en a jamais qui veuillent obéir à ces lois. La loi voulant que l'ordre entier soit sans tache, quiconque ne sera point pur ne paraîtra même pas dans l'ordre. A la vérité, cela est difficile à obtenir sans une certaine éducation et une certaine discipline, dont nous dirons quelque chose peut-être, si nous en trouvons la place et le temps. — ATT. Pour la place, elle ne peut vous manquer, puisque vous tenez le fil de toutes vos lois ; et la longueur du jour vous donne le temps convenable. Au reste, si vous l'oubliez, je vous redemanderai l'article de l'éducation. — MARC. Oui, et avec celui-là tous ceux, Atticus, qui pourront m'échapper. Que le sénat soit le modèle des autres ordres. S'il l'est, nous tenons tout. Comme les passions et les vices des premiers de l'État infectent toute la cité, ainsi leur régularité l'épure et la corrige. Un grand-homme, et notre ami à tous, L. Lucullus, fut très vanté pour avoir répondu, disait-on, fort à propos, quand on lui reprochait la magnificence de sa maison de campagne de Tusculum, qu'il avait deux voisins, l'un plus haut que lui, chevalier romain, l'autre plus bas, simple affranchi; que leurs maisons étaient magnifiques, et qu'il fallait bien lui accorder ce qu'on permettait à des hommes d'un rang inférieur au sien.—Et vous ne voyez pas, Lucullus, que c'est de vous que viennent leurs prétentions, et que vous seul vous leur servez d'excuse ? Souffrirait-on, sans vous, leurs maisons de campagne remplies de statues et de tableaux, dépouilles des lieux publics, et même des lieux sacrés et religieux ? Ne réprimerait-on pas leurs excès, si ceux même qui les devraient réprimer n'étaient possédés de la même passion pour le luxe ?
XIV. En effet, quoique les fautes des premiers
de l'État soient déjà par elles-mêmes un grand mal, leur plus grand mal est qu'elles ont de nombreux
imitateurs. Vous pouvez voir, si vous voulez
interroger le passé, que tels ont été les principaux
de la cité, telle a été la cité même; et que
toute altération qui s'est opérée dans les moeurs
des premiers citoyens a été suivie d'une altération
pareille dans celles du peuple. Et ceci est
en peu plus vrai que cette idée de notre Platon,
qui veut qu'un changement dans la musique
change la situation des États. Je pense, moi, que
ces révolutions dans les moeurs publiques viennent
surtout du changement dans les habitudes des
nobles. Aussi les grands qui ont des vices sont
d'autant plus funestes à la république, que non-seulement
eux-mêmes ont contracté ces vices,
mais qu'ils les répandent dans la cité. Non-seulement
ils nuisent parce qu'ils sont corrompus,
mais parce qu'ils corrompent; et leur exemple
fait plus de mal que leur faute. Cette règle, étendue
à tout un ordre, peut encore être restreinte.
Un petit, un très petit nombre de citoyens, environnés
d'honneurs et de gloire, suffisent en effet
et pour corrompre,et pour corriger les moeurs
d'un Etat.
Mais en voilà assez sur un point que j'ai
traité plus soigneusement dans les livres de la
République. Passons donc au reste. L'article
suivant est sur les suffrages ; je veux qu'ils soient
« connus des grands, libres pour le peuple. » —
ATT. J'y ai fait attention, je vous jure, et je n'ai
pas bien compris ce que veut dire cette loi, ou
du moins ces paroles.
XV. -MARC. Le voici, Titus ; il s'agit d'une question difficile et souvent examinée, savoir, s'il vaut mieux que dans l'élection d'un magistrat, dans le jugement d'un accusé, dans le vote d'une loi ou d'une proposition, les suffrages soient secrets ou publics. — ATT. Est-ce une question ? — QUINT. J'ai peur de différer encore avee vous de sentiment. — MARC. Non, non, Quintus ; car je suis d'un avis que je tiens pour avoir toujours été le vôtre, que le mieux serait que les suffrages se donnassent à haute voix, reste avoir si l'on peut l'obtenir. —QUINT. Je le dirai, mon frère, avec votre permission ; voilà ce qui trompe le plus les ignorants, et nuit trop souvent à l'État. Une chose est reconnue pour bonne et pour juste, et l'on dit qu'on ne peut l'obtenir, parce que ce serait choquer le peuple. D'abord, on lui résiste bien, quand on sait agir avec fermeté; puis, il vaut mieux succomber sous la force dans la bonne cause, que céder à la mauvaise. Or, qui ne sent pas que la loi sur les scrutins a ravi toute autorité aux grands ? Libre, le peuple ne l'avait jamais désirée; opprimé par la domination et la puissance des grands, il l'a sollicitée. Aussi voyait-on bien plus de citoyens puissants condamnés de vive voix, qu'il n'y en a par le scrutin secret. Il fallait donc réprimer chez les puissants cette excessive passion d'entraîner les suffrages dans les mauvaises causes, au lieu de donner au peuple un voile à l'abri duquel il peut, tandis que les honnêtes gens ignorent la pensée de chacun, cacher sur une tablette un coupable suffrage.
XVI. Qu'on ne s'étonne donc pas que cette
méthode n'ait jamais trouvé un homme de bien
pour la décréter ou la conseiller. Il y a quatre
lois tabulaires. La première est pour l'élection
des magistrats; c'est la loi Gabinia, portée par
un homme obscur et vil. Deux ans après, vint
la loi Cassia, sur les jugements populaires; celle-là fut portée par un homme de nom, L. Cassius ;
mais, je puis le dire sans offenser sa famille, par
un homme opposé aux honnêtes gens, et qui
captait par tous les moyens les moindres applaudissements
du peuple. La troisième, sur l'adoption
ou le rejet des lois, est de Carbon, séditieux
et mauvais citoyen, que son retour même aux
honnêtes gens ne put faire sauver par eux. Le
suffrage de vive voix avait été laissé dans un seul
cas, que Cassius lui-même avait excepté, celui
de haute trahison. Célius introduisit le scrutin
jusque dans ce jugement, et gémit, tant qu'il
vécut, d'avoir, pour opprimer C. Popillius, nui
à la république même. Et notre aïeul, homme
d'un rare mérite dans ce même municipe, résista
toute sa vie à M. Gratidius, dont il avait épousé
la soeur, notre aïeule, et qui proposait aussi une
loi de scrutin. Il est vrai qu'ici Gratidius soulevait,
comme on dit, les flots dans un vase, avant
que son fils Marius les soulevât dans la mer Egée.
Aussi le consul Scaurus dit-il à notre aïeul, quand
la chose lui fut rapportée : « Avec cet esprit et ce
mérite, M. Cicéron (1), que n'avez-vous mieux aimé
jouer un rôle avec nous dans la république
suprême que dans une république municipale ? »
(1) Ce Marcus Cicéron, aïeul des deux frères, ne quitta point Arpinum. Cicéron le cite ailleurs ( de Or., II, 66).Il dit ici que Gratidius soulevait les flots dans un vase c'est-à-dire qu'il excitait des troubles dans un petit endroit comme Arpinum; tandis que son fils devait exciter des tempêtes dans la mer Égée ou dans Rome. Ce fils est apparemment M. Marius Gratidianus, fils adoptif de Marius, citoyen turbulent. Il prit part aux troubles de la république, et fut tué par ordre de Sylla (de Off.? III, 20 ; Brut., 62 ; de Petit. cons., 3 ; Flor., III, 21 ). Quelques-uns croient qu'il s'agit du grand Marius lui-même,qui proposa aussi une loi sur les suffrages.
Puisqu'il s'agit donc, non de reconnaître les lois actuelles du peuple romain, mais de redemander celles qui lui furent enlevées, ou d'en composer de nouvelles, je pense que vous devez nous dire, non pas ce qu'on peut obtenir avec un tel peuple, mais ce qui vaut le mieux. Votre Scipion porte encore le reproche de la loi Cassia, qui passe pour avoir été rendue sur son conseil. Vous, si vous rendez une loi de scrutin, vous serez le coupable; car enfin je n'en veux point, non plus qu'Atticus, autant que j'en juge par son air.
XVII. -ATT. Pour moi, jamais rien de populaire ne m'a plu, et je regarde comme la meilleure république celle que votre frère avait établie pendant son consulat, le gouvernement des meilleurs.— MARC. Ainsi, à ce que je vois, vous rejetez la loi sans scrutin. Mais moi, quoique Scipion, dans mes livres, en ait dit assez pour se défendre, si j'accorde au peuple la liberté du scrutin, c'est de manière que les honnêtes gens possèdent et exercent l'autorité. Voici, en effet, la loi des suffrages telle que je l'ai récitée : — « Qu'ils soient connus des grands, libres pour le peuple. » — Loi qui renferme la pensée d'abolir toutes les lois postérieurement rendues, pour cacher le suffrage par tous les moyens, comme de défendre de regarder le bulletin d'autrui, de solliciter, d'appeler. La loi Maria rétrécit même les ponts. Si ces mesures sont dirigées contre la brigue, comme elles le sont presque toutes, je ne les blâme point ; mais si les lois sont assez fortes pour qu'il n'y ait plus de brigue, que le peuple garde son bulletin, comme le garant de la liberté, pourvu qu'il le montre et l'offre volontairement à tout homme de bien et d'autorité, d'autant que la liberté n'est pas autre chose que le droit donné au peuple de témoigner honorablement sa confiance aux honnêtes gens. C'est même là ce qui produit ce que vous disiez tout à l'heure, Quintus, que le scrutin prononce moins de condamnations que ne le faisait le suffrage public : c'est qu'il suffit au peuple de pouvoir. Dès qu'il conserve le droit, il donne la décision du reste à l'autorité ou à la faveur. Si donc (et pour omettre les suffrages corrompus par largesses), si la brigue vient jamais à tomber, est-ce que vous ne voyez pas les suffrages se régler sur l'opinion des meilleurs citoyens ? Ainsi, notre loi donne les formes de la liberté, maintient l'autorité des gens de bien, supprime toute cause de dissension.
XVIII. Vient ensuite la question de savoir qui
aura le droit d'agir, soit avec le peuple, soit avec
le sénat. La loi, je crois, est sage et belle : « Que
la modération règne toujours dans les discours
tenus devant le peuple et le sénat. » La modération,
c'est-à-dire la règle et le calme. Celui qui
parle, en effet, modère et façonne en quelque
sorte, non seulement l'esprit et les volontés, mais
presque l'expression du visage de ceux à qui il s'adresse.
La chose n'est pas difficile pour le sénat;
car un sénateur doit moins chercher des paroles
agréables pour l'auditeur qu'honorables pour lui-même.
Trois choses lui sont ordonnées : d'être
présent, car le nombre augmente l'autorité; de
parler à son rang, c'est-à-dire quand son avis lui
est demandé ; et avec mesure, de peur qu'il ne
parle sans fin ; car la brièveté, non seulement
dans le sénateur, mais dans l'orateur en général,
est un grand mérite pour une opinion. Et jamais
il ne faut faire de longs discours, si ce n'est lorsque
le sénat s'égare, ce qui vient très souvent de
l'ambition ; alors, si aucun magistrat ne s'entremet,
il est utile de remplir toute la séance ; ou
bien, lorsque l'affaire est si grande que toutes les
ressources de l'orateur deviennent nécessaires
pour convaincre ou pour instruire. Dans ces deux
genres, notre Caton excelle.
Ce qui suit : « Qu'il prenne en main les causes
du peuple, » impose au sénateur le devoir de connaître
la république ; et cela s'étend loin : le nombre des soldats, les ressources du trésor, les
alliés, les amis, les tributaires, la loi, la condition,
le traité de chacun; savoir l'usage des délibérations,
connaître les exemples du passé.Vous
voyez que tout cela exige de l'instruction, de la
diligence, de la mémoire; sans quoi un sénateur
n'est jamais prêt.
Je trouve ensuite les rapports avec le peuple ;
tout est dans ce mot : « Point de violence. » Rien
n'est si funeste aux Etats, rien n'est si contraire
au droit et aux lois, rien n'est moins digne du
citoyen et de l'homme, que la décision par la violence dans une république
ordonnée et constituée.
La loi prescrit de céder à l'intercession, et cela
est excellent; car il vaut mieux qu'une bonne
chose soit empêchée qu'une mauvaise accordée.
XIX. Si je veux que la faute retombe sur l'auteur de la proposition, tout ce que j'en ai dit est l'avis de Crassus, homme d'une grande sagesse; et le sénat pensa comme lui, lorsqu'il décréta, sur le rapport du consul C. Claudius, touchant la sédition de C. Carbon (1), qu'il ne pouvait y avoir de sédition sans l'aveu de celui qui parlait devant le peuple, attendu qu'il a pleine licence de dissoudre l'assemblée, aussitôt qu'il y a eu intercession et que le trouble a commencé.
(1) Ce passage a des difficultés. Cicéron parle plusieurs fois de l'orateur L. Licinius Crassus, qui, très jeune encore, intenta une accusation célèbre contre C. Papirius Carbon (de Orat., Il avait vingt-un ans alors. C'était l'an de Rome 634, et en effet il était né l'an 613. Mais est-ce de ce Crassus et de cet événement qu'il s'agit ? Morabin n'en doute pas, et il ajoute que le fait se passa sous le consulat de C. Claudius Pulcher et de M. Perpenna, et que Carbon était un tribun séditieux qui voulait rendre les tribuns indéfiniment rééligibles. Or, il faut savoir que le consulat de Claudius et de Perpenna, dont parle Morabin, est de l'an 661 de la fondation de Rome ; qu'à cette époque Crassus avait quarante-huit ans, et même qu'il était censeur ; enfin que Carbon fit la proposition sur la réélection des tribuns environ trente-deux ans auparavant. M. Wagner, qui n'a point commis cette méprise, trouve un autre consul du nom de Claudius Pulcher en 623. C'est l'année qui suivit le tribunal de Carbon et sa loi sur la réélection; mais il est prouvé qu'alors Crassus n'avait que dix ans. M.Wagner conclut que l'accusation, commencée apparemment dès cette année par son père, ne fut renouvelée par lui que dix ans après, et que c'est du père qu'il s'agit. Mais ne peut-on pas supposer aussi que lorsque, en 634, Carbon, qui sortait d'un consulat, se vit accuser par le jeune Crassus, il y eut sur cette affaire un rapport de Claudius, que Cicéron appelle consul, soit par inadvertance, soit parce qu'il n'était rapporteur de l'affaire au sénat qu'en qualité de consul de l'année qui avait suivi le tribunat de Carbon, et dans laquelle l'affaire avait été commencée ?
Celui qui continue lorsque la délibération n'est plus possible, veut la violence ; notre loi lui ôte l'impunité. Suit cet article : « Si une proposition est funeste, que l'opposant soit regardé comme un bon citoyen. » Qui maintenant ne s'empressera point de venir au secours de la république, assuré d'un aussi beau titre par la déclaration de la loi ? J'ai placé ensuite ce que nous avons déjà dans les lois et institutions publiques:« Que l'on observe les auspices, que l'on obéisse à l'augure. » Un augure qui sait son devoir n'oublie jamais qu'il doit être tout prêt dans les grandes circonstances de la république,qu'il a été donné pour interprète et pour ministre à Jupiter très bon et très grand, comme le sont pour lui ceux qu'il charge d'observer les auspices; et qu'enfin l'inspection de certaines parties du ciel lui a été confiée, pour qu'il en rapportât le salut. Il s'agit, dans le même article, de la promulgation, de la présentation séparée des affaires, de l'audition des particuliers et des magistrats. Viennent deux lois admirables, tirées des douze Tables, dont l'une supprime les priviléges, dont l'autre défend de poursuivre une accusation capitale contre un citoyen, si ce n'est dans les grands comices (1).
(1) Il y a évidemment ici deux dispositions : la première abolit les privilèges; c'était un privilège de la loi par laquelle Clodius fit prononcer l'exil de Cicéron. Ce dernier avait éprouvé et compris le vice de ces jugements rendus en forme de loi, qui tout à la fois créent le délit et la peine, et condamnent l'accusé. C'est là proprement le privilége, toujours odieux, même lorsqu'il est favorable (pro Dom., 17 ; pro Sext., 30). La seconde disposition défend de prononcer un jugement capital, si ce n'est dans les grands comices. Les comices par tribus étaient beaucoup plus démocratiques. Le crime de haute trahison, celui de royauté, crimen regni, ne devaient être jugés que dans les comices par centuries (Tite Liv, VI, 20), Ceux-ci ne procédaient pas alors comme pouvoir législatif, mais comme pouvoir judiciaire. Ainsi les deux dispositions, l'une contre les priviléges, l'autre pour la compétence des grands comices, n'ont rien de contradictoire. D'ailleurs cette confusion de fonctions avait de grands inconvénients politiques.
Chose étonnanteque dans un temps où les séditions des tribuns n'avaient point commencé, qu'on n'y pensait pas même encore, nos aïeux aient vu si loin dans l'avenir! Ils n'ont pas voulu qu'on fit des lois sur les individus ; car c'est là le privilége, la dernière des injustices, puisque la propriété de la loi est que ce qu'elle statue soit ordonné pour tous. Ils n'ont pas voulu que l'on prononçât sur un citoyen hors des comices par centuries; car le peuple distribué, selon le cens, l'ordre, l'âge, apporte dans la délibération plus de conseil que lorsqu'il est confusément convoqué par tribus. De là toute la vérité de ce que disait, à mon sujet, un homme d'un grand esprit et d'une extrême sagesse, L. Cotta, qu'il n'y avait rien de fait contre moi ; qu'en effet, outre que ces comices avaient été tenus par des esclaves en armes, dans les comices par tribus, une décision capitale n'était point valable, et que dans aucun un privilége ne pouvait l'être ; qu'en conséquence il n'y avait nul besoin d'une loi pour moi, rien ne s'étant fait légalement contre moi. Mais nous jugeâmes, nous et quelques-uns de nos premiers citoyens, qu'il valait mieux que celui contre lequel des esclaves et des brigands prétendaient avoir rendu je ne sais quel décret, reçût le témoignage des sentiments de toute l'Italie.
XX. Suivent des lois sur les présents et la brigue.
Comme tout cela doit être sanctionné par
des jugements plus que par des discours, j'y ai
ajouté : « Que la peine soit pareille au délit, » afin
que chacun soit frappé dans son vice ; que la violence
encoure une peine capitale ; l'avarice, une
amende ; l'ambition, l'infamie.
Les dernières lois ne sont point usitées parmi
nous ; elles sont nécessaires à la république. Nous
n'avons point de dépôt pour la garde de nos lois :
aussi sont-elles ce que nos appariteurs veulent
qu'elles soient. Nous les demandons à des copistes
; nous n'avons point de tradition publique
consignée dans des registres publics. Chez les
Grecs, en cela plus soigneux, on crée des gardiens
des lois qui veillent non-seulement sur le
texte des lois (car cela existait aussi chez nos
aïeux),mais encore sur la conduite des personnes,
et qui les rappellent aux lois. Donnons ce soin aux
censeurs, puisque nous avons décrété la perpétuité
de la censure dans notre république. Les
magistrats, en sortant de charge, exposeront leur
gestion devant les censeurs, qui en porteront un
premier jugement. Cela se pratique en Grèce, où
des accusateurs publics sont constitués. Mais les
accusateurs ne peuvent avoir d'autorité s'ils ne
sont volontaires. En conséquence, il vaut mieux
que le compte soit rendu et les raisons exposées
devant les censeurs, et que la loi cependant réserve
dans leur intégrité les droits de l'accusateur
et du jugement. Mais c'en est assez sur les magistrats, si vous n'avez rien à demander de plus.
-ATT. Nous nous tairions, que vos derniers mots
vous avertiraient de ce qui vous reste à dire. —
MARC. Sur les jugements sans doute, Pomponius;
car cela touche aux magistratures.—ATT. Eh
quoi ! sur le droit civil du peuple romain, comme
vous l'aviez annoncé, vous croyez qu'il n'y a rien
à dire ? — MARC. Mais que demandez-vous? —
ATT. Ce que je demande? ce qu'on ne peut, je
crois, ignorer sans honte, quand on se mêle d'affaires
publiques. Car, vous l'avez dit tout à
l'heure, je ne lis nos lois que grâce aux copistes ;
et je remarque que la plupart des magistrats, dans
leur ignorance du droit qui les concerne, n'en savent qu'autant qu'il
plaît aux appariteurs. Si donc vous avez cru devoir parler de l'aliénation des
sacrifices, après avoir proposé les lois sur la religion,
vous êtes obligé, après avoir établi les
magistrats, de traiter de la puissance et du droit
de chacun.
-MARC. Je le ferai en peu de mots, si je puis y
réussir : car M. Junius, ami de votre père, dans
un livre qu'il lui adresse, a traité plus au long la
question, avec beaucoup de soin et d'habileté.
Nous devons, à mon avis du moins, sur le droit
de la nature, penser et dire d'après nous-mêmes;
et sur le droit du peuple romain, penser et dire
ce qui est conforme à la tradition du passé. —
ATT. Sans doute, et c'est précisément là ce que
j'attends.
FIN DE L'OUVRAGE
![]()