Velleius Paterculus
HISTOIRE ROMAINE
Traduction de Despres
refondue avec le plus grand soin par M. Gréard, (professeur au lycée Bonaparte).
1864
 |
 |
 |
|---|
HISTOIRE ROMAINE
A M. VINICIUS, CONSUL
I. [Epeu S ], séparé par la tempête de Nestor son chef, bâtit Métaponte. Teucer, repoussé par Télamon son père, pour avoir lâchement laissé sans vengeance l'injustice faite à son frère Ajax, alla fonder dans l'î le de Chypre une autre Salamine. Pyrrhus fils d'Achille, s'établit en Epire, Phidippus à Ephyre, dans la Thesprotie. Agamemnon , le roi des rois, jeté par la tempête dans l'île de Crète, y construisit trois villes, qu'il appela, les deux premières, Mycènes et Tégée, du nom de deux villes de sa patrie, la troisième Pergame en souvenir de sa victoire sur [Troie]. Peu de temps aprte, il périt, livré par sa criminelle épouse au poignard d'Egisthe, son cousin, instrument de la haine héréditaire [de Thyeste] contre les Atrides. Egisthe demeure maître du trône pendant sept ans. Il est immolé avec Clytemnestre par Oreste, secondé dans tous ses desseins par Electre, femme au cœur viril. Les dieux ap prouvèrent l'action d'Oreste :la longueur de sa vie et la prospérité de son règne en témoignèrent clairement. Il régna soixante et dix ans, et en vécut quatre-vingt-dix. Il se vengea aussi de sa main, de Pyrrhus, fils d'Achille. Pyrrhus avait ravi Hermione, fille de Mènélas et d'Hélène, avec laquelle il était fiancé : il le tua dans le temple de Delphes.
En ce même temps, deux frères, Lydus et Tyrrhenus, gouvernaient la Lydie : une disette les contraignit de tirer au sort qui des deux aurait à s'expatrier, avec une partie de la population. Le sort tomba sur Tyrrhenus. Arrivé en Italie, il donna à la contrée, au peuple, à la mer, son nom devenu illustre, et qui leur resta. Après la mort d'Oreste, Penthilus et Tisamène, ses fils, régnèrent trois ans.
II Quatre-vingts ans environ après la ruine de Troie, cent vingt ans depuis qu'Hercule était allé s'asseoir au rang des Dieux, la race de Pélops, qui avait conservé, pendant tout ce temps, l'empire du Péloponnèse, dont elle avait chassé les Héraclides, en est chassée à son tour par la race des Héraclides. Témène, Cresphonte, Aristodème, arrière-petits-fils d'Hercule, furent les chefs de la révolution qui leur rendit l'empire.
Vers ce même temps, à peu près, Athènes cessa d'être gouvernée par des rois. Son dernier roi fut Codrus, fils de Mélanthe, héros digne de mémoire. Les habitants de l'Attique, en guerre avec les Lacédémoniens, étaient vivement pressés ; l'oracle d'Apollon consulté avait répondu que le peuple dont le chef serait tué par l'ennemi resterait vainqueur. Codrus, dépouillant les insignes de la royauté, revêt l'habit d'un pâtre, pénètre dans le camp ennemi, se fait une querelle, et est tué sans être reconnu. L'immortalité pour Codrus, la victoire pour les Athéniens, tel fut le résultat de ce dévouement. Et qui n'admirerait un homme qui pour chercher la mort, use des moyens qu'un lâche emploie pour l'éviter? Médon, fils de Codrus, fut le premier archonte d'Athènes, ses descendants furent, de son nom, appelés Médontides : eux et les archontes qui suivirent, jusqu'à Charops, jouirent de cet honneur. En sortant de l'Attique, ceux du Péloponnèse bâtirent Mégare, à égale distance de Corinthe et d'Athènes. — Ce fut à cette époque aussi qu'une flotte de Tyriens, nation puissante sur la mer, fonda aux extrémités de l'Espagne et du monde la ville de Cadix, dans une île de l'Océan, séparée de la terre ferme par un tout petit détroit. Peu d'années après, ils bâtirent Utique, en Afrique. Dépossédés par les Héraclides, les enfants d'Oreste, après avoir été pendant quinze ans le jouet des événements et de la fureur des flots, se fixèrent dans le voisinage de l'île de Lesbos.
III. De grands mouvements d'émigration bouleversèrent alors la Grèce. Les Achéens, chassés de la Laconie , s'emparèrent de la contrée qu'ils occupent encore aujourd'hui. Les Pélasges passèrent dans l'Attique. Un jeune et ardent guerrier, Thesprotien d'origine, et appelé Thessalus, s'établit de force, à la tête d'une troupe considérable de ses concitoyens, dans le pays qu'on appelait l'État des Myrmidons, et qui, de son nom, s'appelle maintenant la Thessalie. C'est une chose assez étrange, que les historiens de la guerre de Troie désignent ce pays sous ce nom de Thessalie. C'est une faute d'ailleurs commune, mais particulièrement chez les auteurs tragiques, et en cela ils sont d'autant moins excusables que, dans leurs compositions, ce n'est pas le poète qui parle, ce sont les personnages qui vivaient à l'époque où se passe l'action. Dira-t-on que les Thessaliens reçurent leur nom de Thessalus, fils d'Hercule? Alors on demandera pourquoi la Thessalie ne fut pas connue sous ce nom avant l'invasion du second Thessalus Quelque temps auparavant, Alétès, fils d'Hippotès, et le sixième des Héraclides, bâtit dans l'isthme la ville de Corinthe, autrefois Éphyre, clef du Péloponnèse. Ne nous étonnons pas qu'Homère l'appelle Corinthe, c'est le poète qui parle lui-même, et il donne à cette ville et à quelques colonies ioniennes le nom qu'elles portaient de son temps, quoiqu'elles eussent été fondées près d'un siècle après la prise de Troie.
IV. Des colonies athéniennes s'emparèrent de Chalcis et d'Érétrie, dans l'Eubée, une colonie lacédémonienne occupa Magnésie, dans l'Asie Mineure. A quelque temps de là, les Chalcidiens, originaires de l'Attique, ainsi que je l'ai dit, allèrent fonder Cumes, en Italie, sous la conduite d'Hippoclès et de Mégasthène ; leur flotte était guidée, selon les uns, par le vol d'une colombe qui la précédait ; selon d'autres, par les sons d'un instrument d'airain, pareils à ceux qui retentissent la nuit aux fêtes de Cérès. Longtemps après, une portion détachée de cette colonie bâtit la ville de Naples. Les deux villes, par leur rare et inaltérable dévouement aux Romains, se sont rendues bien dignes du renom dont elles jouissent, et des agréments de leur site. Naples est demeurée plus fidèles aux mœurs nationales de ses fondateurs, le voisinage des Osques n'a pas été sans influence sur Cumes. La vaste enceinte des murailles de ces villes témoigne hautement, aujourd'hui encore, de leur ancienne force.
Dans la période suivante, une colonie grecque, jeune et nombreuse, qu'un excès de population forçait de chercher un asile, se répandit en Asie. Les Ioniens, partis d'Athènes sous la conduite d'Ion, envahirent la plus belle partie de la région maritime qui porte aujourd'hui encore le nom d'Ionie, y fondèrent Ephèse, Milet, Colophon, Priène, Lébède, Myunte, Erythra, Clazoméne et Phocée et occupèrent plusieurs îles dans la mer d'Icare et dans la mer Egée, Samos, Chio, Andros, Ténos, Paros, Délos, et quelques autres moins connues. Bientôt les Éoliens, partis aussi de la Grèce, après avoir erré longtemps, se fixèrent sur des rivages non moins illustres, et fondèrent les villes célèbres de Smyrne, de Cymes, de Larisse, de Myrine, de Mityléne, et quelques autres dans l'île de Lesbos.
V . Ensuite brilla le beau génie d'Homère, Homère éminemment grand, sans comparaison, seul digne du titre de poète, par l'étendue de son œuvre et l'éclat de ses vers. Ce qu'il y a de plus grand en lui, c'est qu'il n'eut point de modèle et qu'il n'a point eu d'imitateur. Archiloque et lui sont les seuls qui créèrent leur genre et qui le portèrent à la perfection ; on n'en citerait pas d'autres. Homère vivait à une époque beaucoup plus éloignée qu'on ne le pense de la guerre de Troie, qu'il a chantée car il florissait il y a environ neuf cent cinquante ans, et il n'y en a pas plus de mille qu'il est né. Ne soyons donc pas surpris de l'entendre dire et répéter: Les hommes, tels qu'ils sont aujourd'hui, il veut indiquer par là la différence des siècles et des hommes. Quant à l'opinion qu'Homère était aveugle de naissance, il faut être dépourvu de sens pour y croire.
VI. Dans la période suivante, l'empire d'Asie, que les Assyriens possédaient depuis mille soixante-dix ans, passa aux Mèdes. Il était alors gouverné par Sardanapale, prince énervé par les délices, et que perdit l'excès de son bonheur : le Mède Arbacès lui ravit à la fois le sceptre et la vie. Il y a de cela à peu près huit cent soixante-dix ans. Issu de Ninus et de Sémiramis, fondateur de Babylone, Sardanapale était, par une succession non interrompue, de père en fils, le trente-troisième héritier de leur couronne.
Lycurgue, de Lacédémone, un des personnages les plus illustres de la Grèce , signala cette époque. Né du sang royal, il dota sa patrie d'une législation sévère et juste, et d'un système d'éducation admirablement propre à former des hommes, tant que Sparte y demeura fidèle, rien n'égala sa gloire et sa prospérité. C'est dans cette période, et soixante-cinq ans avant la naissance de Rome, qu'Elissa de Tyr, qui, selon quelques-uns, est la même que Didon, jeta les fondements de la ville de Carthage. Vers ce même temps, à peu près, Caranus, d'origine royale, et le seizième du sang des Héraclides, partit d'Argos, et s'empara de la Macédoine. C'est par ce Caranus qu'Alexandre le Grand, son dix-septième successeur, se glorifiait de descendre d'Hercule par son père, comme par sa mère, il descendait d'Achille.
Aemilius Sura dit, dans ses Annales romaines : « Ce sont les Assyriens qui ont eu les premiers l'empire du monde puis les Mêdes, après eux, les Perses, après les Perses, les Macédoniens. Enfin, à la suite de la défaite d'Antiochus et de Philippe, princes originaires de Macédoine, défaite qui suivit d'assez près la ruine de Carthage, la domination souveraine échut au peuple romain. Entre cette époque et le commencement du règne de Ninus, il y a un intervalle de dix-neuf cent quatre-vingt-quinze ans. »
VII .Hésiode appartient à cette période. Séparé d'environ cent vingt ans du siècle d'Homère, homme d'un génie merveilleusement orné, remarquable par la douceur enchanteresse de ses vers, ami des loisirs et du repos de la paix, il se rapproche de ce grand homme par l'importance de son œuvre comme par le temps où il vécut. Il a pris le soin, qu'Homère négligea, de nous faire connaître ses parents et sa patrie. Mais il n'a fait que flétrir sa patrie qui l'avaitfrappé.
Tout en m'amusant à l'histoire des autres peuples, j'arrive à un fait relatif à la nôtre, sur lequel les opinions des auteurs sont fort erronées et très différentes les unes des autres. Il s'agit de Nole et de Capoue : quelques-uns disent que ces deux villes furent fondées par les Toscans, à cette époque, c'est-à-dire il y a huit cent trente ans et pour mon compte, je serais disposé à me ranger à leur avis. Mais combien Marcus Caton s'en éloigne ! Il ne nie pas que les Toscans aient fondé Capoue, et ensuite Nole mais il prétend que Capoue n'existait que depuis deux cent soixante ans environ, lorsque les Romains s'en emparèrent. S'il en est ainsi, la fondation de Capoue ne remonterait pas au delà de cinq cents ans, puisqu'il n'y a que deux cent quarante ans que les Romains l'ont prise. Quant à moi, qu'il me soit permis de le dire sans manquer de respect pour l'autorité de Caton, j'ai peine à croire qu'une aussi grande ville ait pu, en aussi peu de temps, s'accroître, tomber et se relever.
VIII . On vit ensuite se renouveler ces célèbres luttes Olympiques, si propres à développer les qualités du corps et de l'âme, sous les auspices d'Iphitus, roi d'Élide, huit cent quatre ans, Marras Vinidus, avant voire consulat. Atrée, dit-on, les avait instituées dans ce même lieu, lorsqu'il fit célébrer des jeux funèbres en l'honneur de Pélops, son père, il y a douze cent cinquante ans, et ce fut Hercule qui y demeura vainqueur dans tous les genres de combats.
A Athènes, vers le même temps, l'autorité des archontes cessa d'être perpétuelle. Après Alcméon, on limita l'exercice de ce pouvoir à dix années, et cette disposition fut maintenue pendant soixante et dix ans, ensuite l'administration de la république fut commise à des magistrats annuels. Le premier de ceux qui gouvernèrent dix ans fut Charops, et le dernier, Euryxias. Créon fut le premier des magistrats annuels.
Dans le cours de la sixième olympiade, vingt-deux ans après le rétablissement des jeux Olympiques, quatre cent trente-sept ans après la prise de Troie, sept cent quatre-vingt-deux ans avant que vous fussiez consuls, Romulus fils de Mars, après avoir vengé son aïeul, bâtit Rome sur le mont Palatin, dans les jours consacrés aux fêtes de Pales. Je crois aisément, avec quelques historiens, que les soldats de Numitor contribuèrent au succès de cette entreprise. Comment Romulus, avec une poignée de pâtres timides, eût-il pu fortifier une ville naissante, dans le voisinage des Sabins, des Véiens et des autres peuples de l'Étrurie? Toutefois, l'asile qu'il avait ouvert entre deux bois sacrés dut accroître ses forces. Cent hommes, qu'il choisit et qu'il appella pères , formèrent le conseil public : telle est l'origine du nom de patriciens. L'enlèvement des Sabines……………………
IX ..... [L'ennemi était plus à craindre qu'on ne l'avait cru.] Pendant deux ans [Persée] soutint la lutte contre les consuls avec des succès divers, toutefois le plus souvent l'avantage lui resta, ce qui entraîna une grande partie de la Grèce dans son alliance. Les Rhodiens eux-mêmes, d'une fidélité jusque-là si constante, observant sa fortune, chancelèrent dans leur foi, et semblèrent pencher pour le monarque. Le roi [de Pergame] Eumène demeura neutre dans cette guerre, et démentit à la fois les engagements de son frère Attale, et ses propres habitudes d'amitié. Alors le sénat et le peuple romain nommèrent consul Lucius Aemilius Paullus, dont la préture et le premier consulat avaient été marqués par deux triomphes ; homme digne de tous les éloges dus à la vertu la plus parfaite. Il était fils de ce Paullus Aemilius qui mourut si bravement à cette fatale bataille de Cannes qu'il avait engagée avec tant de répugnance. Le consul défit complètement Persée, près de Pydna, en Macédoine. Battu, mis en déroute, chassé de son camp, et privé par la destruction de son armée de toute espérance, le roi fut contraint de s'enfuir de la Macédoine. Il se sauva dans l'île de Samothrace, et s'y réfugia dans un temple, confiant ses jours à l'inviolabilité de cet asile. Cn. Octavius, qui commandait la flotte, parvint jusqu'à lui. Il le détermina, plutôt qu'il ne le contraignit, à se livrer à la foi des Romains et c'est ainsi que Paullus Aemilius mena en triomphe un roi puissant et illustre.
Cette année fut signalée par deux autres triomphes, le triomphe naval du préteur Octavius, et celui d'Anicius, qui fit marcher devant son char Gentius, roi d'Illyrie. Compagne inséparable d'une haute fortune, l'envie s'attache à tout ce qui s'élève : on en trouverait ici la preuve. Les triomphes d'Octavius et d'Anicius n'éprouvèrent aucune opposition, tandis qu'on s'efforça de traverser celui d'Aemilius, néanmoins, par la grandeur du roi Persée, par la pompe des images, par le chiffre de la somme qui fut versée dans le trésor public (deux cents millions de sesterces), il effaça, sans comparaison, tous les triomphes passés.
X. Vers le même temps, Antiochus Épiphane, roi de Syrie, celui qui éleva dans Athènes un temple à Jupiter Olympien, assiégeait le jeune Ptolémée dans Alexandrie. Les Romains envoyèrent Marcuss Popilius Lenas pour lui intimer l'ordre de renoncer à son entreprise. Popilius exposa l'objet de sa mission: Antiochus répondit qu'il en délibérerait. L'ambassadeur, traçant sur le sable avec le bout d'une baguette un cercle autour d'Antiochus, lui défendit de le franchir avant d'avoir rendu sa réponse. C'est ainsi que la fermeté romaine coupa court aux réflexions du roi, et Rome fut obéie.
Le héros de la grande victoire, Lucius Paullus, avait quatre fils : les deux aînés avaient été adoptés, le premier par Fabius Maximus, le second par Publius Scipion, fils de l'Africain, qui ne rappelait de son père, que son grand nom et sa mâle éloquence. Les derniers portaient encore la prétexte à l'époque de sa victoire. La veille de son triomphe, dans le discours où, selon l'antique usage, il rendait compte de sa conduite au peuple assemblé hors des murs, il adressa cette prière aux Dieux: « Si, parmi les immortels, il en est un qui soit blessé de mes exploits et de ma fortune, que sa colère retombe sur moi et épargne la république.» Parole pour ainsi dire prophétique, qui le priva d'une grande partie de sa famille. Des deux fils qu'il avait conservés, l'un mourut quatre jours avant son triomphe, l'autre, trois jours après. Fulvius Flaccus et Posthumius Albinus exercèrent, en ce temps, la censure avec une telle sévérité, que Cn. Fulvius, frère du premier, et qui vivait sous le même toit que lui, fut exclu du sénat par leur ordre.
XI. Après la défaite et la prise de Persée, qui mourut, à Albe, au bout de quatre années d'une captivité sans rigueur, un aventurier à qui son imposture valut le nom de Pseudo-Philippus, et qui se donnait pour un rejeton de la tige royale, quoiqu'il fût de la plus basse extraction, envahit la Macédoine à main armée, prit le nom de Philippe et les marques de la royauté. Son audace ne fut pas longtemps impunie. Le préteur Quintus Metellus, à qui la valeur qu'il déploya dans cette guerre mérita le surnom de Macédonique, remporta sur lui et sur les Macédoniens une victoire signalée. Dans une bataille non moins sanglante, il défît les Achéens, qui commençaient à secouer le joug de l'obéissance.
Metellus le Macédonique est celui qui construisit des portiques autour de ces deux temples sans inscriptions qu'enferment aujourd'hui les portiques d'Octavie. Ce fut lui qui fit transporter de Macédoine cet escadron de statues équestres placées en face des deux temples, et qui en font aujourd'hui le plus bel ornement. Voici, suivant la tradition, l'origine de cet escadron. Alexandre le Grand chargea le célèbre sculpteur Lysîppe de reproduire exactement sous leurs traits ceux de ses cavaliers qui avaient été tués au passage du Granique, et de le représenter lui-même au milieu d'eux. Le premier de tous, Metellus introduisit à Rome la magnificence, ou le luxe, en élevant un temple de marbre dans l'enceinte même de ces monuments. Dans quel pays, dans quel siècle, dans quel rang trouver un homme dont le bonheur puisse se comparer à celui de Metellus ? Sans parler de ses triomphes éclatants, des honneurs considérables dont il fut comblé, de son rang éminent dans l'État, de sa vie prolongée jusqu'à l'extrême vieillesse, des vives et nobles luttes qu'il soutint contre ses ennemis, pour la défense de la république, il eut quatre fils, qu'il vit tous parvenir à l'âge viril, et qu'il laissa vivants et chargés de dignités. Lorsque ces quatre fils portèrent le lit funèbre de leur père devant la tribune aux harangues, le premier avait été consul et censeur, le second était consulaire, le troisième était consul, et le dernier, tout près de l'être. Finir ainsi, ce n'est pas mourir, c'est sortir heureusement de la vie.
XII . L'Achaïe tout entière reprit une attitude hostile, ainsi que je l'ai dit, quoiqu'elle eût été fort affaiblie par la campagne de Metellus le Macédonique. C'était surtout à l'instigation des Corinthiens, qui allèrent jusqu'à insulter les ambassadeurs romains. On confia la conduite de la guerre au consul Mummius.
Vers le même temps, les Romains prirent la résolution de détruire Carthage, animés contre elle, bien moins par des rapports croyables, que par des bruits qu'ils aimaient à croire. On éleva donc au consulat (quoiqu'il ne briguât que l'édilité) Publius Scipion Emilien, né de Paullus Emilius, et qu'avait adopté Scipion, fils de l'Africain. Héritier des vertus de son aïeul et de son père, Scipion Émilien possédait à la fois les talents militaires et civils, et surpassait tous ceux de son temps par les dons de l'esprit et l'étendue des connaissances, homme dont les discours, les actions et les sentiments n'offrirent jamais rien que de louable dans tout le cours de sa vie. Ses exploits lui avaient déjà mérité la couronne obsidionale, en Afrique, et la couronne murale, en Espagne. Ce fut en Espagne aussi, que, provoqué à un combat singulier, il tua un adversaire d'une taille gigantesque, bien qu'il ne fût lui-même que d'une force ordinaire. Scipion poussa le siège de Carthage avec plus de vigueur que les consuls qui l'avaient commencé deux ans auparavant. Et cette ville en qui Rome haïssait une puissance dont elle était jalouse, mais qui, dans ces derniers temps, ne l'avait point offensée, devint, par sa ruine, un monument de la valeur de Scipion, comme elle l'avait été de la clémence de son aïeul. Carthage fut détruite, il y a cent soixante et dix-sept ans, la six cent soixante-septième année de sa fondation, sous les consuls Cn. Cornélius Lentulus et Lucius Mummius. Telle fut la fin de la rivale de Rome. La lutte avait commencé avec nos ancêtres, sous le consulat de Claudius et de Fulvius, deux cent quatre-vingt-seize ans avant le vôtre, Marcus Vinicius. Pendant l'espace de cent quinze ans, il n'y eut entre les deux peuples qu'hostilités déclarées, préparatifs de guerre, ou paix infidèles. Jamais Rome, même lorsqu'elle eut vaincu le monde entier, n'espéra de repos aussi longtemps que Carthage serait debout, et que son nom subsisterait. Tant il est vrai que l'animosité née de longues querelles survit à l'inquiétude, et résiste même à la victoire ! Ce qu'on a détesté ne cesse d'être odieux qu'en cessant d être.
XIII. Marcus Caton, qui n'avait cessé de réclamer la destruction de Carthage, mourut trois ans avant que cette destruction eût été accomplie, sous le consulatde Marcus Manlius et d e LuciusCensorinus.
L'année même de la chute de Carthage, Mummius renversa de fond en comble Corinthe, qui comptait neuf cent cinquante-deux années d'existence, depuis sa fondation par Alétès, fils d'Ilippotès. On honora les deux vainqueurs du nom de la nation dont ils avaient triomphé. Scipion fut surnommé l'Africain, et Mummius, l'Achaïque. C'était le premier homme nouveau qui recevait un surnom acquis par sa valeur.
Ces deux généraux différaient absolument de caractère et dégoûts. Scipion avait le goût et la passion des arts libéraux et de tous les genres de connaissances : à Rome, à l'armée, il avait toujours auprès de lui deux hommes d'un génie supérieur, Panetius et Polybe. Jamais personne n'occupa plus noblement ses moments de loisir. Sachant passer tour à tour des exercices de la guerre aux arts de la paix, et des combats à l'étude, il fortifiait son corps au milieu des périls, et son esprit au sein de la philosophie. L'ignorance de Mummius était si grossière, que lorsqu'il voulut, après la prise de Corinthe, envoyer à Rome les chefs-d'œuvre des plus célèbres artistes de la Grèce , il avertit ceux qui s'en étaient chargés qu'ils auraient à remplaeer les statues et les tableaux qu 'auraient perdus dans levoyage. Nul doute toutefois, n'est-il pas vrai, Vinicius, qu'il eût mieux valu pour la république être toujours insensible au prix des arts de Corinthe, que d'avoir appris à sentir autant leur mérite. Cette ignorance convenait mieux à Rome et faisait plus d'honneur à l'État que ce raffinement de connaissance.
XIV. Comme les faits rapprochés les uns des autres et groupés ensemble s'impriment plus aisément dans l'esprit en frappant les yeux, que lorsqu'ils sont épars et isolés, je me propose de placer, entre la première et la seconde partie de mon ouvrage, exposition qui ne sera point inutile, le tableau sommaire de nos colonies fondées depuis l'invasion des Gaulois, avec l'indication de l'époque où chacune d'elles fut établie par ordre du sénat. Les noms des colonies militaires, les motifs de leur établissement et les noms de ceux qui les fondèrent sont assez connusse n'en parlerai point. Mais il ne sera pas hors de propos, je crois, de donner un état des cités fondées pendant cette période, véritables rejetons de Rome, qui participant aux droits de la métropole, propagèrent le nom romain.
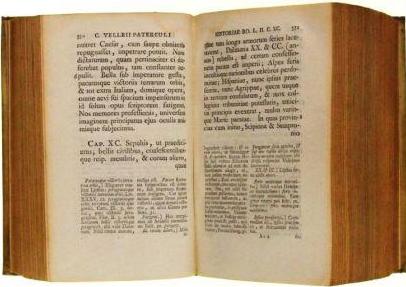 |
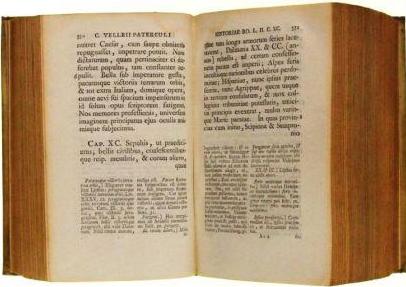 |
|---|
Sept ans après la prise de Rome par des Gaulois, une colonie fut conduite à Sutrium ; une autre colonie fut envoyée, l'année d'après, à Setina et neuf ans après, une autre à Népé. Trente-deux ans après, il y a trois cent cinquante ans, le droit de citoyen romain fut accordé à ceux d'Aricie. Les Campaniens l'obtinrent de même, ainsi qu'une partie des Samnites, mais sans droit de suffrage, sous le consulat de Sp.Posthumius et de Veturius Calvinus. La même année, une colonie fut conduite à Calès. Trois ans après, l'année même de la fondation d'Alexandrie, ceux de Formies et de Fondi furent admis au nombre des citoyens. L'année suivante, sous la censure de Sp. Posthumius et de Philon Publilius, le droit de cité fut accordé aux habitants d'Acerra. Une colonie fut conduite, trois ans après, à Terracine ; quatre ans après, une autre, à Lucérie, trois ans après, une autre, à Suesse, dans le pays des Aurunques, une autre, deux ans après, à Saticule et à Intéramne. Puis ce mouvement fut suspendu pendant dix années. A la reprise, Sora, Albe, et deux ans après, Carséoles, reçurent des colonies. Sinuesse et Minturnes en reçurent également pendant le cinquième consulat de Quintus Fabius, et le quatrième de Decius Mus, l'année de l'avènement de Pyrrhus. Quatre ans après, ce fut le tour de Venuse. Deux ans après, sous le consulat de M. Curius et de Cornélius Rufînus, les Sabins furent admis au droit de citoyens romains, sans suffrage. Cela remonte à trois cent vingt ans. Sous le consulat de Fabius Dorsôn et de Claudius Canina, il y a environ trois cents ans, des colonies furent envoyées à Pœstum, et à Cosa. Cinq ans après, sous le consulat de Sempronius Sophus et d'Appius, fils de l'Aveugle, Ariminum et Bénévent reçurent des colons, et les Sabins acquirent le droit de suffrage. Au commencement de la première guerre punique, on s'assura de Firmum et de Castrum par des colonies. Ce fut le tour, un an après, d'Esernia; vingt-deux ans après, d'Esulum et d'Alsium, de Ficelles, deux ans après, de Blindes, l'année suivante, sous le consulat de Torqualus et de Sempronius et de Spolète, trois ans après, l'année où furent institués les jeux Floraux. Deux ans après, une colonie fut conduite à Valence. Celles de Crémone et de Placentia datent de l'arrivée d'Annibal en Italie.
XV . L'envoi d'aucune colonie romaine ne fut possible, ni pendant le séjour d'Annibal en Italie, ni dans les années qui suivirent sa retraite. Tant que dura la guerre, on pensa plutôt à rassembler des soldats qu'à les congédier et, après la guerre, il fallut songer à concentrer les forces de la république, plutôt qu'à les disperser.
Mais sous le consulat de Cn. Manlius Volson et de Fulvius Nobilior (il y a deux cent dix-sept ans), on conduisit une colonie à Rologne; quatre ans après, à Pisaure et à Potentia ; trois ans après, à Aquilée, et à Gravisca, quatre ans après à Luca, et, dans le même temps, ce que quelques historiens n'admettent pas comme certain, à Putéoles, à Salerne et à Buxentum. La colonie d'Auxime, dans le Picenum, est fondée depuis cent quatre vingt-sept ans. C'est trois ans auparavant, que le censeur Cassius avait entrepris de faire construire un théâtre qui devait s'étendre du Lupercal au mont Palatin mais l'austérité des mœurs s'opposa, par l'organe du consul Scipion à l'achèvement de cet ouvrage et c'est une des preuves les plus éclatantes, à mon sens, que le peuple ait données de l'esprit qui l'animait. — Fabrateria s'accrut d'une colonie, il y a cent cinquante-sept ans, sous le consulat de Longinus et de Sextius Calvinus qui vainquit les Saliens près des eaux appelées depuis eaux Sextiennes, du nom de ce consul. Un an après, des colonies furent envoyées à Scylacium, à Minervium, à Tarente, à Neptunia, et à Carthage, en Afrique, ce fut la première colonie romaine hors de l'Italie. Quant à Dertone, on n'est pas d'accord sur l'époque à laquelle elle fut fondée. Narbonne, en Gaule, date du consulat de Porcius et de Marcius, il y a cent cinquante-trois ans. Vingt-trois ans après, pendant le sixième consulat de Marius, collègue de Valerius Flaccus, une colonie fut conduite à Eporedia, chez les Bagiennes. Il me serait difficile de citer à partir de cette époque, d'autres colonies que les colonies militaires.
XVI . Mais cette partie de mon ouvrage sort déjà de mon plan. Je sens qu'entraîné par un mouvement aussi rapide que celui d'un char qui vole, ou d'un torrent qui se précipite, je dois plutôt omettre des détails nécessaires qu'en embrasser de superflus. Cependant je ne puis m'empêcher d'insister ici sur une question que j'ai souvent agitée dans mon esprit, sans être jamais arrivé à la tirer au clair. Peut-on s'étonner assez de ce que les plus beaux génies, dans tous les genres, se rencontrent toujours dans l'étroit espace et comme dans le cadre d'un même âge? Comme l'on voit des animaux d'espèces différentes, renfermés dans une même enceinte, s'éloigner de l'espèce à laquelle ils n'appartiennent point, pour se réunir à la leur, de même, les esprits capables de produire des ouvrages sublimes se sont-ils séparés des autres, pour s'élever, dans un même temps, au même degré de perfection? Une seule époque, et bien restreinte, a vu la tragédie illustrée par l'inspiration d'un Eschyle, d'un Sophocle et d'un Euripide. Une seule époque a vu naître et briller de tout son éclat la vieille comédie, sous Cratinus, Aristophane et Eupolis. En moins de quelques années, Ménandre, et ses contemporains, plutôt que ses rivaux, Philémon et Diphile, créèrent la comédie nouvelle, et la laissèrent inimitable. Ces philosophes, dont la doctrine s'inspire de celle de Socrate, combien de temps parurent-ils après Aristote et Platon? Avant Isocrate, après ses disciples et leurs élèves, trouvez-vous quelque chose de distingué parmi les orateurs? Ils se pressent dans un si court espace de temps, que parmi ceux qui sont dignes de mémoire, il n'en est pas deux qui n'aientpu se voir.
XVII. Telle fut la marche des choses dans la Grèce , et telle nous allons la retrouver chez les Romains car, à moins de compter ces rudes et grossiers essais que recommande le seul mérite de l'invention, c'est Accius et, ses contemporains qui représentent toute la tragédie, et c'est aussi dans une même période que les grâces exquises de la comédie latine brillèrent sous la plume de Caecilius, d'Afranius, et de Térence. Quant aux historiens, en rangeant Tite Live au nombre des anciens, il est certain qu'à l'exception de Caton, de quelques autres plus éloignés de nous et peu connus, l'espace qui les renferme ne comprend pas quatre-vingts ans. La période qui vit fleurir la poésie ne remonte pas plus haut et ne descend pas plus bas. Pour ce qui regarde l'éloquence et la perfection de l'art oratoire, Caton toujours mis à part, j'en demande pardon à P. Crassus, à Scipion, à Laelius, aux Gracchus, à Fannius et à Sergius Galba, tel est l'essor que Cicéron, le roi de son art, a donné à tous les genres d'éloquence qu'il ne nous est possible de goûter qu'un très petit nombre de ses devanciers, et d'admirer que ceux qu'il a pu voir et ceux qui l'ont vu. De même pour les grammairiens, les peintres, les graveurs et les autres artistes. Plus on observera les dates, plus on reconnaîtra que les chefs-d'œuvre de tous les arts ont été produits dans les limites d'une période fort restreinte.
Lors donc que je cherche les causes de cette réunion des génies, se rassemblant tous comme de concert dans un même siècle, et disputant d'efforts et de succès, j'avoue que je n'en découvre pas qui me satisfasse, mais peut-être en ai-je trouvé de vraisemblables, et particulièrement celles-ci. L'émulation nourrit le talent, l'admiration et l'envie l'enflamment tour à tour, et en toute chose, on arrive vite, par l'effort, au sommet. Mais il est un point de perfection où il est difficile de se maintenir et, par un effet naturel, ce qui n'avance plus, recule. D'abord, on s'excite pour atteindre ceux qu'on reconnaît les premiers mais, dès qu'on ne se flatte plus de pouvoir les surpasser, ou même les égaler, le zèle se ralentit avec l'espérance. On cesse de poursuivre ce qu'on désespère d'approcher et, laissant, comme envahie par d'autres, la matière où l'on ne peut plus exceller, on en cherche une autre à sa portée et c'est cette perpétuelle mobilité d'esprit qui est le plus grand obstacle à la perfection.
XVIII. Voilà pour les temps : la considération des lieux nous offrira le même sujet d'admiration. L'éloquence et les œuvres de l'esprit ont jeté plus d'éclat dans la seule ville d'Athènes que dans la Grèce entière. On dirait que les esprits de la nation étaient tous rassemblés dans les murs d'Athènes, et que les corps étaient seuls répartis dans les autres villes. Je n'en suis pas plus étonné, que de ne pas voir dans Sparte, dans Thèbes, ou dans Argos, un seul orateur dont le talent ait honoré la vie ou la mémoire. Ces villes, et les autres étaient pour les arts un champ stérile : excepté Thèbes, qu'illustra le génie de Pindare. Pour Alcman, c'est à tort que Sparte revendique l'honneur de l'avoir vu naître.
. Le premier Scipion avait frayé aux Romains la voie de la puissance, le second leur ouvrit celle de la corruption. Affranchie de la crainte que lui inspirait Carthage, souveraine sans rivale, ce ne fut point par degrés, mais d'une course rapide que Rome, quittant le sentier de la vertu, se précipita dans tous les vices. Les mœurs antiques furent abandonnées pour faire place à d'autres. On passa des veilles à la paresse, des armes aux voluptés, des travauxà la mollesse oisive.
Ce fut alors que furent élevés, au Capilole, les portiques de Scipion Nasica, nous avons déjà parlé de ceux de Metellus, et, au Cirque, celui e Cn. Octavius, qui l'emportait de beaucoup, en agrément, sur les autres et le luxe des particuliers marcha sur les traces du luxe de l'État.
Survint ensuite une guerre funeste et honteuse en Espagne, la guerre contre un chef de brigands, contre Viriathe, les succès furent partagés ; cependant le sort fut plus souvent contraire aux Romains. Viriathe mort, victime de la perfidie, non du courage de Cépion, la guerre de Numance, plus fatale encore, s'alluma. Cette ville ne put jamais armer plus de dix mille jeunes gens, pris dans son sein mais soit intrépidité de la défense, soit inhabileté de nos généraux, soit faveur de la fortune, plusieurs de nos chefs, et Pompée entre autres, homme d'une grande réputation et le premier consul de ce nom, après Pompée, le consul Mancinus Hostilius, furent réduits à signer des traités éshonorants et odieux. Pompee fut sauvé par son crédit, Mancinus par son repentir. Il alla jusqu'à consentira ce que les féciaux le livrassent à l'ennemi, nu, les mains liées derrière le dos. Mais les Numantins refusèrent de le recevoir, en disant que le sang d'un seul homme ne suffisait pas pour expier la violation de la foi publique. Les Samnites, après la défaite de Caudium, avaient tenu le même langage.
II L'extradition de Mancinus excita dans Rome un trouble effroyable, Tiberius Gracchus, fils de Tiberius Gracchus, illustre et éminent citoyen, était questeur de l'armée de Mancinus, et petit-fils par sa mère de Scipion l'Africain et le traité de Numance avait été son ouvrage. Affligé devoir un de ses actes désavoués, peut-être aussi craignait-il d'être enveloppé dans la même accusation et soumis au même châtiment,à peine fut-il élu tribun du peuple (c'était d'ailleurs un homme d'une vie irréprochable, d'un esprit distingué, d'intentions pures, et doué de toutes les qualités que comporte la condition humaine favorisée par la nature et perfectionnée par l'éducation), que rompant avec le parti des gens de bien, c était sous le consulat de P. Mucius Scasvola, et de L. Galpurnius, il y a de cela cent soixante ans, — il promit à toute l'Italie le droit de cité, promulgua les lois agraires, pour flatter la multitude qui aspirait à une situation moins précaire, brouilla tout, bouleversa tout, et amena la république au bord du précipice. Octavius, son collègue, défendait contre lui la cause du bien public, il le déposa, puis il se commit lui-même, avec le consulaire Appius, son beau-père, et Caïus Gracchus, son frère, tout jeune encore, au soin de régler la répartition des terres et l'envoi des hommes destinés à les cultiver.
III . Un homme sacrifia, dans cette occasion, les intérêts du sang à ceux de la patrie : ce fut P. Scipion Nasica, petit-fils de ce Scipion que le sénat avait déclaré le plus vertueux des Romains, fils du censeur qui construisit les portiques du Capitole, arrière-petit-fils du célèbre Cn. Scipion, c'est-à-dire de l'oncle paternel de Scipion l'Africain, et cousin de Tib. Gracchus. Regardant comme contraire à ses intérêts tout ce qui n'était pas utile au bien public (telle était l'idée qu'on avait de sa vertu, que, par une distinction qu'on n'avait encore accordée à nul autre, on l'éleva à la dignité de grand-pontife, en son absence), Nasica, simplement vêtu de la toge du citoyen, alla se placer sur le plus haut degré du Capitole, relevant un pan de sa robe autour de son bras gauche, il engagea à le suivre tous ceux qui voulaient le salut de la république. Aussitôt, les grands, les sénateurs, la plus forte et la plus saine partie des chevaliers, et la portion du peuple que cette dangereuse politique n'avait pas encore égarée, se précipitent sur Gracchus, qui se tenait au milieu de la place publique, à la tête de sa troupe, et appelant à la révolte la population de l'Italie entière. Réduit à fuir, le tribun fut frappé d'un tronçon de banc sur la pente du mont Capitolin qu'il descendait encourant, et termina, par une mort prématurée, une vie qu'il eût pu rendre glorieuse.
Tel fut, dans Rome, le commencement des guerres où les glaives furent tirés, où le sang des citoyens coula impunément. Bientôt la violence étouffa les lois : le pouvoir appartint au plus fort. Les dissentiments, que des transactions avaient jusque-là pacifiquement terminés, furent jugés par le fer. Les guerres n'eurent plus d'autres causes que l'intérêt. Faut-il s'en étonner? L'exemple ne s'arrête point à sa source ; ouvrez-lui le plus étroit sentier, vous le verrez élargir sa route et s'étendre. Dès qu'on a quitté la droite voie, on est entraîné vers l'abîme. On croit pouvoir faire sans honte ce que d'autres ont fait avec profit.
IV Tels étaient les événements qui se passaient en Italie. Cependant Aristonicus, à la mort d'Attale, roi de Pergame, dont il prétendait être le fils, s'était emparé de l'Asie, quoique ce prince eût légué son royaume aux Romains, comme Nicomède leur légua depuis la Bitbynie. Vaincu par M. Perpenna, traîné devant le char de triomphe de M. Aquilius, il fut mis à mort, comme meurtrier du célèbre jurisconsulte Crassus Mucianus, qu'il avait fait égorger au commencement de la guerre, au moment où il quittait le proconsulat d'Asie. D'un autre côté, P. Scipion Émilien, qui portait le surnom d'Africain depuis qu'il avait détruit Carthage, créé consul pour la seconde fois, fut envoyé contre Numance, si souvent fatale à nos armes. L'Afrique avait éprouvé sa valeur et sa fortune, l'Espagne reconnut l'une et l'autre. En moins de quinze mois, Numance, investie, fut rasée. Avant Scipion, jamais homme, chez aucun peuple, n'immortalisa son nom par un plus glorieux exploit que la destruction de ces deux villes. La chute de Carthage mit fin à nos craintes ; celle de Numance vengea nos affronts.
Le même Scipion, interrogé par le tribun Carbon sur ce qu'il pensait du meurtre de Tib. Gracchus, répondit que s'il avait eu le dessein d'asservir la république, sa mort était juste. Et comme cette réponse avait soulevé les cris de l'assemblée : « Eh ! Pensez-vous, reprit Scipion, que celui qui tant de fois a bravé les clameurs d'un ennemi en armes, se laisse émouvoir par les vôtres, à vous qui n'êtes pas même des enfants de l'Italie ? » Peu de temps après son retour d'Espagne, ce grand homme, honoré d'un double consulat et d'un double triomphe, destructeur de deux villes qui étaient la terreur de la république, fut trouvé mort, le matin, dans son lit, portant au cou quelques marques de strangulation. — C'était sous le consulat de M. Aquilius et de Cn. Sempronius, il y a cent cinquante ans. On ne fit point d'enquête sur sa mort et, le jour de ses funérailles, il fut porté, la tête couverte d'un voile, lui, par qui Rome avait élevé la sienne au-dessus de toutes les villes de l'univers! Mais que cette fin ait été naturelle, comme c'est le sentiment du plus grand nombre ou que, suivant l'opinion de quelques autres, un crime en ait avancé l'instant, l'éclat de sa carrière effaça toutes les autres renommées, hors la gloire de son aïeul. Il mourut dans sa cinquante-sixième année, ce qui ne peut être révoqué en doute, puisqu'à l'époque de son consulat, il était âgé de trente-six ans.
V. Avant la destruction de Numance, D. Brutus fit une campagne brillante en Espagne. II pénétra chez tous les peuples de cette contrée, prit un grand nombre d'hommes et de villes, s'avança jusqd'en des contrées qu'on connaissait à peine de nom, et mérita le surnom de Galicien.
Peu d'années auparavant, Quintus le Macédonique avait exercé, dans ce pays, l'autorité la plus sévère. A l'attaque de Contrebia, cinq cohortes légionnaires ayant été chassées d'une position escarpée, Quintus leur ordonna d'aller la reprendre aussitôt. Tous les soldats, en retroussant leur tunique, faisaient leur testament comme s'ils marchaient à une mort certaine, le consul ne se laissa pas émouvoir et, grâce à cette fermeté, des troupes qui se croyaient envoyées à la mort lui revinrent victorieuses.
Heureux effet d'un sentiment d'honneur mêlé de crainte, et de cette espérance qui naît du désespoir! Quintus le Macédonique et Fabius Aemilianus acquirent l'un et l'autre une grande réputation en Espagne, le premier, par sa valeur et sa rigidité, l'autre, en soumettant ses troupes à la discipline que Paul Emile avait établie.
VI. Le même délire s'empara de Caïus Gracchus, dix ans après la mort de son frère. Caïus avait les vertus comme les idées de son aîné, avec plus de génie et d'éloquence. Il n'aurait eu qu'à se tenir en repos pour devenir le premier citoyen de la république mais soit pour se frayer une route à l'autorité suprême, soit pour venger la mort de son frère, il entra, comme lui, dans la carrière du tribunat et poussant plus loin et plus vivement ses réclamations, il accorda à tous les habitants de l'Italie le droit de cité romaine, l'étendit presque jusqu'aux Alpes, partagea les terres, renouvela l'ancienne loi Licinia, qui défendait de posséder plus de cinq cents arpents ; établit de nouveaux péages, remplit les provinces de nouvelles colonies, transféra, des sénateurs aux chevaliers, le pouvoir judiciaire, proposa de faire des distributions de blé à la multitude enfin, changeant tout, remuant tout, ne laissant rien à sa place, il alla jusqu'à se faire continuer dans l'exercice de sa magistrature.
Le consul L. Opimius, qui, pendant sa préture, avait détruit la ville de Frégelles, le poursuivit, les armes à la main, ainsi que le complice de ses desseins, Fulvius Flaccus, homme consulaire, honoré d'un triomphe, nommé triumvir par C. Gracchus, à la place de Tiberius, et que le tribun avait associé à sa puissance royale. La conduite d'Opimius fut coupable en cela seulement qu'il mit à prix la tête, je ne dis pas de Gracchus, mais d'un citoyen romain, et qu'il offrit de la payer au poids de l'or. Flaccus animait les siens au combat sur le mont Aventin, lorsqu'il fut égorgé : l'aîné de ses fils eut le même sort. Gracchus fuyait mais, tout près d'être atteint par ceux qu'Opimius avait envoyés à sa poursuite, il tendit la gorge à son esclave Euporus, qui se montra aussi courageux en lui prêtant ce fatal secours, qu'en refusant de lui survivre. Pomponius, chevalier romain, donna le même jour à Gracchus la preuve d'un rare dévouement. Après avoir soutenu sur un pont l'effort des ennemis, comme Horatius Coclés, il se perça de son épée. Le corps de Tiberius avait été jeté dans le Tibre, les vainqueurs traitèrent les restes de Caïus avec la même inhumanité inouïe.
Tel fut le sort des fils de Tiberius Sempronius Gracchus : le mauvais usage de leur talent les perdit. Cornélie, fille de Scipion l'Africain, et leur mère, les vit périr tous les deux. La république leur eût offert d'elle-même tous les honneurs qu'ils ambitionnaient, s'ils les eussent brigués en citoyens, au lieu de vouloir les emporter en factieux.
VII. Cette rigueur fut suivie d'un, crime sans exemple. Opimius fit assassiner le fils de Fulvius Flaccus, jeune homme d'une beauté remarquable, à peine âgé de dix-huit ans, et que son père, aux fautes duquel il n'avait aucune part, avait envoyé proposer les conditions d'un accommodement. Un aruspice toscan, son ami, surprit des larmes dans ses yeux, pendant qu'on le traînait en prison : « Eh! Que ne fais-tu plutôt comme moi? » lui dit-il et, dans le même moment, il se brisa la tête contre le mur, à l'entrée de la prison ; le coup fit jaillir la cervelle, et il expira aussitôt. Bientôt les amis et les clients de Gracchus furent en butte aux poursuites les plus rigoureuses. Mais, plus tard, Opimius, homme d'ailleurs d'une vie pure et respectable, fut condamné par jugement public et le souvenir de sa cruauté, fit que son malheur n'intéressa personne. La haine publique applaudit également avec justice à la condamnation de Rutilius et de Popilius, qui, durant leur consulat, avaient sévi sans ménagement contre les amis des deux frères. Mêlons à ces grandes choses le souvenir d'un fait assez insignifiant. C'est du consulat de cet Opimius, que le célèbre vin opimien a reçu son nom ; il n'existe plus aujourd'hui, ce qui n'a rien d'étonnant : un laps de cent cinquante et un ans, M. Vinicius, sépare ce consulat du vôtre.
La conduite d'Opimius eut peu d'approbateurs, parce qu'elle parut passionnée. On y vit un homme qui satisfaisait une animosité personnelle, plutôt qu'un citoyen qui vengeait la république.
VIII. Vers le même temps, on établit à Narbonne une colonie sous le consulat de Porcius et de Marcius. Je ne dois pas omettre un fait qui dépose de la sévérité des jugements. C. Caton, homme consulaire, petit-fils de M. Caton, et neveu, par sa mère, de Scipion l'Africain, accusé de concussion dans son gouvernement de Macédoine, fut condamné, quoique la somme qu'il avait exigée ne s'élevât point au delà de quatre mille sesterces : tant il est vrai que ces premiers Romains considéraient moins la faute en elle-même que l'intention, et regardaient à la nature, non à la gravité du délit !
Rome vit en ce même temps deux frères, M. et C. Metellus, triompher le même jour. Un spectacle non moins éclatant, et même unique jusqu'alors, avait été donné par les fils de ce Fulvius Flaccus qui s'était illustré par la prise de Capoue. Ils furent collègues dans le consulat mais l'un d'eux avait passé par adoption dans la famille d'Acidinus Manlius. Deux Metellus avaient été censeurs en même temps, mais ils étaient cousins, et non pas frères. L'honneur d'un double consulat ne fut décerné qu'aux deux Scipion. Les Cimbres et les Teutons passèrent le Rhin, et se rendirent bientôt célèbres par les défaites qu'ils nous firent essuyer et qu'ils essuyèrent. A la même époque eut lieu le glorieux triomphe sur les Scordisqucs de ce Minucius, à qui l'on doit ces portiques admirés encore de nos jours.
IX. Dans la même période, brillèrent de grands orateurs, Scipion Émilien, Laelius, Serg. Galba, les deux Gracchus, C. Fannius, Carbon Papirius. Citons aussi Metellus le Numidique, Scaurus, et, par-dessus tous, L. Crassus et M. Antonius, qui, peu de temps après, eurent pour héritiers de leur talent C. César Strabon et P. Sulpicius. Quant à Mucius, il fut moins célèbre par son éloquence, que par sa science du droit.
D'autres génies illustrèrent cette époque ; Afranius, dans la comédie, Pacuvius et Accius, dans la tragédie, Accius digne d'entrer en comparaison avec les tragiques Grecs et d'occuper parmi eux un rang honorable. Chez les Grecs, il y a plus d'art, chez le Romain, plus de vie. Lucilius rendit aussi son nom célèbre : pendant la guerre de Numance, il avait servi dans la cavalerie sous P. Scipion l'Africain. C'était le temps où Marius et Jugurtha, jeune encore, faisant leurs premières armes sous ce même Scipion, apprenaient dans le même camp ce qu'ils devaient un jour pratiquer l'un contre l'autre. Sisenna écrivait déjà l'histoire mais il était jeune alors, et ce ne fut que dans sa vieillesse qu'il fit paraître le récit de la guerre civile et des guerres de Sylla. Caelius était plus ancien que Sisenna, qui fut contemporain de Rutilius, de Claudius Quadrigarius et de Valerius Antias. Rappelons qu'en ce même temps vivait Pomponius, écrivain rude, mais fort de choses, et recommandable par l'invention d'un genre de compositions
X. Nous citerons encore un trait de la rigidité des censeurs Cassius Longinus et Cépion. Ils appelèrent à comparaître devant eux (il y a cent cinquante-sept ans) l'augure Aemilius Lepidus, parce qu'il avait un loyer de six mille sesterces. De nos jours, on aurait peine à reconnaître pour sénateur un homme dont l'habitation serait si modeste : tant la pente est rapide du bien au mal, du mal à de plus grands excès, et de là bientôt aux derniers dérèglements !
Dans le même temps, deux victoires éclatantes furent remportées ; la première sur les peuples d'Auvergne par Domitius, la seconde par Fabius sur les Allobroges. Fabius reçut le surnom d'Allobrogique : il était petit-fils de Paul Emile. C'est une chose à remarquer que la destinée des Domitius ; destinée glorieuse, mais concentrée sur un petit nombre de têtes. Un de nos contemporains, ce jeune Domitius dont nous aimons la noble simplicité, compte parmi ses ancêtres plusieurs fils uniques, qui tous furent élevés au consulat, au sacerdoce, et presque tous, aux honneurs du triomphe.
XI. Vint ensuite la guerre contre Jugurtha, conduite par Quintus Metellus, le plus grand général de son siècle. Marius, que j'ai déjà nommé, était son lieutenant, Marius, homme d'une naissance obscure, d'un naturel dur et farouche, de mœurs austères, aussi bon capitaine que mauvais citoyen, affamé de gloire, insatiable d'honneurs, incapable de modération et de repos. Marius se servit des publicains et d'autres gens qui faisaient des affaires en Afrique, pour calomnier les sages lenteurs de Metellus. A les entendre, Metellus ne prolongeait la guerre, depuis trois années, que par l'orgueilleuse prétention, naturelle aux nobles, de se perpétuer dans les commandements. Ces manœuvres le menèrent à son but. Il eut la permission de se rendre à Rome, obtint le consulat, et fut chargé de la conduite de la guerre qu'avait presque achevée Metellus, deux fois vainqueur de Jugurtha. Rome n'en reconnut pas moins les services de Metellus. Son triomphe eut un grand éclat, et sa valeur lui fit décerner le surnom de Numidique.
J'ai fait remarquer l'illustration des Domitius, rappelons aussi celle de Caecilius Metellus. Au temps dont nous parlons, plus de douze Metellus parvinrent, en moins de douze années, aux honneurs du consulat, de la censure ou du triomphe. Il en est des familles comme des villes et des empires : on les voit fleurir, vieillir et s'éteindre.
XII . C Marius prit L. Sylla pour questeur, comme si la prévoyance des destins eû-t voulu lier ces deux hommes. Marius (il y a environ cent trente-huit ans) envoya Sylla vers le roi Bocchus, qui lui livra Jugurtha. Désigné consul pour la seconde fois, et de retour à Rome, il y triompha du prince Numide, aux calendes de janvier, et dans les premiers jours de ce second consulat.
Lorsque dans l'immense débordement des peuples germaniques dont j'ai déjà parlé, les Cimbres et les Teutons eurent écrasé et mis en déroute, dans les Gaules, Cépion, le consul Manlius, Carbon, Silanus, anéanti leur armée, égorgé le consul Aurelius Scaurus, et plusieurs autres personnages illustres, Marius parut le seul homme capable de repousser des ennemis si formidables, et les consulats lui furent prodigués. Le troisième fut employé en préparatifs de guerre. Ce fut dans le cours de cette année que le tribun Cn. Domitius fit passer une loi par laquelle il attribuait au peuple le droit de nommer au sacerdoce, droit qui jusqu'alors avait été réservé au collège des prêtres. Le quatrième fut signalépar la défaite entière des Teutons, près des Eaux de Sextius (Aix), au delà des Alpes. La bataille dura deux jours. Plus de cent cinquante mille Teutons y périrent : la nation fut exterminée. Pendant son cinquième consulat, Marius, aidé du proconsul Q. Lutatius Catulus, attaqua les Cimbres, dans les plaines appelées Raudiennnes, en deçà des Alpes. Les armes romaines ne furent pas moins heureuses. Plus de cent mille hommes furent tués ou pris. Victoire par laquelle Marius mérita que la république se consolât de sa naissance, et qui parut une compensation aux maux qu'il lui préparait. Son sixième consulat fut le prix de ses services. Mais il lui valut une gloire qu'on ne peut pas lui dérober. Rome était déchirée par les fureurs des deux tribuns, Servilius Glaucias et Saturninus Apuleius, qui s'étaient maintenus violemment dans leur magistrature, et qui, les armes à la main, ensanglantaient et dispersaient les comices. Le consul marcha contre eux, et mit fin à ces désordres. Ces forcenés furent punis de mort, dans la curie Hostilia.
XIII. Ce fut peu d'années après, que M. Livius Drusus arriva au tribunat. Il était aussi distingué par la naissance que par l'éloquence et la vertu mais il fut plus sage dans ses vues et dans ses projets, qu'heureux dans leur exécution. Il voulait rétablir la dignité du sénat, et lui rendre le droit des jugements : droit que les chevaliers exerçaient, d'après une loi de Gracchus, et dont ils abusaient. C'était peu d'avoir injustement sévi contre les citoyens les plus illustres et les plus honnêtes, ils en étaient venus jusqu'à condamner, au désespoir de toute la ville, comme coupable de concussions, Publius Rutilius, l'homme le plus vertueux, non-seulement de son siècle, mais de tous les temps. Ce que Drusus entreprenait en faveur du sénat trouva de l'opposition dans le sénat même. Le sénat ne sentit point que le tribun, par l'attrait de quelques propositions favorables à la multitude, cherchait à la gagner, et lui faisaitde petites concessions pour obtenir de grands avantages. Enfin, tel fut le malheur de Drusus, que les sénateurs aimèrent mieux approuver les actes coupables de ses collègues, que de rendre justice à la droiture de ses intentions; tandis qu'ils se laissaient outrager par les tribuns, ils refusèrent l'honneur que Drusus leur offrait, et supportèrent plus aisément des hommes d'un médiocre mérite, que celui dont la gloire les blessait.
XIV. Le mauvais succès de ses louables desseins lui fit prendre la résolution de donner le droit de citoyen romain aux peuples d'Italie, Cette idée l'occupait, lorsqu'un jour, revenant du forum, au milieu de la foule en désordre qui l'accompagnait toujours, il fut frappé d'un coup de poignard, à l'entrée de sa maison. L'arme resta dans la plaie. Peu d'heures après, il expira. Près de rendre le dernier soupir, Drusus, tournant les yeux sûr ceux qui l'entouraient, et dont la douleur était profonde, leur adressa ces paroles, qui peignent ses sentiments : « O mes parents, ô mes amis, la république retrouvera-t-elle jamais un citoyen qui me ressemble?» Ainsi mourut cet illustre jeune homme. — Je n'oublierai pas un trait qui témoigne de la pureté de son caractère. Il faisait bâtir une maison sur le mont Palatin, au lieu même où l'on voit encore celle qui fut occupée par Cicéron, puis par Censorinus, et qui l'est aujourd'hui par Statilius Sisenna. Comme l'architecte lui proposait de la construire de façon qu'il fût à l'abri des regards curieux, et que personne n'y pût plonger: « Au contraire, répondit Drusus, appliquez votre talent à disposer ma maison de telle sorte que tout le monde puisse voir tout ce que je ferai. »
XV . Une des plus pernicieuses lois de Caïus Gracchus, à mon sens, fut celle qu'il porta pour établir des colonies hors de l'Italie. La politique de nos pères était bien plus sage. Ils voyaient Carthage, Marseille, Syracuse, Byzance et Cyzique, devenues plus puissantes que Tyr, Phocée, Corinthe et Milet, leurs métropoles. Cette leçon ne fut pas perdue pour eux. Ils ne manquèrent pas de rappeler en Italie, par l'obligation de se soumettre au cens, tous les Romains qui se trouvaient épars dans les provinces. Carthage fut la première ville étrangère qui reçut une colonie romaine.
Le feu de la guerre Italique couvait depuis longtemps, la mort de Drusus ralluma. Elle commença par les habitants d'Asculum, qui avaient massacré le préteur Servius et le lieutenant Fonteius. La rébellion gagna les Marses, et de là, s'étendit aux autres contrées, de sorte que les Romains, sous les consuls L. César et P. Rutilius (il y a cent vingt ans), eurent pour ennemis les peuples ligués de toute l'Italie. Mais le sort des alliés fut aussi malheureux que leur cause était juste. Car enfin, que demandaient-ils ? Le droit de cité dans la capitale d'un empire dont ils étaient les défenseurs. A chaque guerre, disaient-ils, et tous les ans, ils fournissaient un double contingent de troupes, soit à pied, soit à cheval et Rome refusait d'admettre au nombre de ses citoyens des hommes par lesquels elle avait acquis cette grandeur dont elle abusait pour mépriser des peuples du même sang et d'une même origine! Cette guerre fit perdre à l'Italie plus de trois cent mille hommes, la fleur de sa jeunesse.
XVI . Les généraux qui s'y distinguèrent furent, parmi les Romains, Cn. Pompée, père du grand Cn. Pompée, C. Marius, dont j'ai déjà parlé, L. Sylla, qui sortait de la préture, Q. Metellus Pius, fils du Numidique. Il mérita ce surnom de Pius, lorsque sa tendresse filiale, aidée de l'autorité du sénat et de l'assentiment unanime de la république, ménagea le retour de son père, exilé par L. Saturninus pour s'être refusé seul au serment d'observer les lois que ce tribun avait publiées. La cause de l'exil de Metellus, son exil même et son retour ne furent pas moins glorieux pour lui que ses dignités et ses triomphes. Les principaux chefs des alliés étaient Popedius Silon, Herius Asinius, Insteius Caton, C. Pontidius, Telesinus Pontius, Marius Egnatius, Papius Mutilius. Et pourquoi déroberais-je quelque chose à la gloire de mon sang par une modestie mal placée, quand je n'ai rien à dire qui ne soit conforme à la vérité? Minatius Magius, d'Asculum, mon troisième aïeul, est digne ici d'un honorable souvenir. Petit-fils d'un des principaux habitants de Capoue, de Decius Magius, dont Rome éprouva la fidélité illustre, Minatius ne fut pas moins fidèle. A la tête d'une légion qu'il avait levée lui-même dans le pays des Hirpins, il prit Herculanum avec T. Didius, se joignit à L. Sylla pour assiéger Pompéi, et se rendit maître de Cosa. Bien des historiens ont célébré ses mérites mais nul ne leur a rendu un plus complet et plus éclatant hommage que Q. Hortensius dans ses Annales. Le peuple romain récompensa dignement son zèle : il lui accorda le droit de cité romaine, par privilège spécial et ses deux fils furent nommés préteurs, à une époque où ces magistrats n'étaient encore qu'au nombre de six. La guerre Italique fut sanglante et mêlée de revers ; en l'espace de deux années consécutives, deux consuls, Rutilius et Porcius Caton furent tués, les armées romaines battues en plusieurs rencontres ; il fallut prendre le sagum et pendant longtemps le garder. Les peuples ligués avaient déjà choisi Corfmium pour être la capitale de leur empire, et lui donnaient le nom d'Italicum. Mais peu à peu Rome, en accordant le droit de cité aux peuples qui n'avaient point pris les armes ou qui les avaient déposées à temps, rétablit sa fortune, ce furent Sylla, Marius et Pompée qui relevèrent l'Etat penchant et glissant vers sa ruine.
XVII .On touchait à la fin de la guerre. La seule ville de Nole se maintenait encore en état d'hostilité. Les Romains, affaiblis eux-mêmes, accordèrent aux Italiens, vaincus et humiliés, le droit de cité qu'ils leur avaient refusé, avant que la lutte les eût épuisés les uns et les autres. Q. Pompée fut alors nommé consul. Il eut pour collègue L. Cornélius Sylla, cet homme en qui l'on ne peut ni assez louer le guerrier qui sut vaincre, ni délester assez l'abus de la victoire. Il était issu d'une noble famille, et le sixième descendant de Cornélius Rufinus, un des généraux les plus connus parmi ceux que Rome avait opposés à Pyrrhus mais la splendeur de sa maison ne s'était pas soutenue, et la conduite que tint longtemps Sylla n'annonçait point qu'il eût la pensée d'aspirer au consulat. Cependant, après sa préture, il s'illustra dans la guerre Italique, et même avant cette époque, employé comme lieutenant de Marius dans les Gaules, il avait battu les plus fameux capitaines. Ces succès l'enhardirent ; il brigua le consulat, et l'obtint à la presque unanimité des suffrages. Il est vrai qu'il avait déjà quarante-neuf ans.
XVIII . Vers ce temps parut. Mithridate, roi de Pont, prince dont il est impossible de se taire et difficile de parler, ardent à la guerre et d'une bravoure héroïque, quelquefois grand par sa fortune, toujours grand par son courage, général au conseil, soldat dans l'action, et un second Annibal par sa haine contre les Romains. Après avoir envahi l'Asie, Mithridate adressa aux gouverneurs des différentes villes des lettres portant, avec de magnifiques promesses, l'ordre de faire égorger, le même jour, à la même heure, tous les citoyens romains qui s'y trouvaient. Aucun peuple, en cette occasion, ne montra plus d'énergie contre Mithridate et de fidélité aux Romains que les Rhodiens. La perfidie de Mitylène fit encore mieux ressortir le zèle de Rhodes. Les habitants de Mitylène livrèrent à Mithridate M. Aquilius et plusieurs autres Romains chargés de fers. Pompée, dans la suite, ne leur pardonna qu'en considération du seul Théophane. Mithridate, s'étant ainsi rendu formidable, paraissait menacer l'Italie même, lorsque le gouvernement des provinces asiatiques échut à Sylla.
Sylla, ayant quitté Rome, était arrêté sous les murs de Nole car cette ville, qui nous avait montré, dans le cours de la guerre Punique, un attachement inviolable, semblait désavouer sa conduite en s'obstinant à ne point poser les armes devant, l'armée romaine qui l'assiégeait. Cependant, un tribun du peuple, P. Sulpitius, homme d'une élocution facile, actif, célèbre par sa fortune, son crédit, ses liaisons, l'énergie de son esprit et de son courage, et qui, jusque-là avait honnêtement cherché l'estime populaire tout à coup, comme s'il se fût repenti de ses vertus, comme s'il eût cru la sagesse contraire au succès de ses desseins, se montra pervers et audacieux. Partisan de C. Marius, qui, plus que septuagénaire, aspirait encore à tous les emplois, à tous les gouvernements, il fit porter une loi, dans l'assemblée du peuple, pour lui confier, au préjudice de Sylla, la guerre entreprise contre Mithridate. Il porta plusieurs autres lois pernicieuses, funestes, intolérables pour un peuple libre. Bien plus, il fit assassiner, par des émissaires de sa faction, le fils du consul Q. Pompée, lequel était gendre de Sylla.
XIX. Alors Sylla rassemble une armée, retourne à Rome, s'en rend maître, chasse les douze principaux auteurs des nouveautés et des désordres, parmi eux Marius, son fils, et le tribun P. Sulpitius, et porte une loi qui les exile. Sulpitius, atteint par des cavaliers envoyés à sa poursuite, fut égorgé dans les marais de Laurente, et sa tête fut exposée sur la tribune aux harangues, présage des proscriptions prochaines. Marius après six consulats, Marius septuagénaire, forcé, pour se dérober aux émissaires de Sylla, de se plonger, près de Marica, dans la vase d'un marécage (ses yeux et son nez seulement étaient à découvert), en fut arraché nu, conduit à Minturnes, couvert de fange, la corde au cou, et jeté dans une prison par l'ordre du duumvir. On envoya pour le tuer un esclave armé d'une épée. Cet homme, Germain de nation, avait été, dans la guerre des Cimbres, un de ses prisonniers, il reconnut Marius. A la vue de la disgrâce de ce grand homme, il pousse un cri d'indignation, jette son glaive et s'enfuit.
Les habitants, auxquels un Barbare apprenait à plaindre l'infortuné qui naguère était à la tête de la république, fournirent à
Marius des vêtements, des secours en argent, un vaisseau. Il rejoignit son fils près d'Enaria, puis se dirigea vers l'Afrique, et
vécut misérablement sous l'abri d'une pauvre cabane bâtie au milieu des ruines de Carthage. Là, se contemplant l'un l'autre, Carthage et Marius se consolaient mutuellement de leurs destinées.
XX. Cette année vit le soldat tremper pour la première fois ses mains dans le sang d'un consul romain. Q. Pompée, collègue de Sylla, périt au milieu d'une sédition excitée contre lui dans l'armée du proconsul Cn. Pompée. Il est vrai que le proconsul était lui-même l'auteur du complot. Cinna n'était point un homme plus modéré que Sulpitius ni Marius. En conférant aux peuples d'Italie le droit de cité romaine, on les avait répartis en huit tribus, afin que le nombre et l'influence de ces nouveaux citoyens ne portassent aucune atteinte à la dignité des anciens, et que des hommes admis à une telle faveur ne devinssent pas plus puissants que ceux qui la leur avaient accordée. Mais Cinna annonça qu'il les distribuerait dans toutes les tribus et, sur cette promesse, ils accoururent en foule de toute l'Italie. Dans ce même moment, Cinna fut chassé, de Rome par son collègue, auquel s'unirent les chefs de la noblesse et comme il prenait la roule de Campanie, le sénat le déclara déchu du consulat, et lui donna pour successeur L Cornélius Merula, prêtre de Jupiter. Cinna avait mérité cette injure mais l'exemple était dangereux. Il se rendit au camp de Nole, gagna les centurions et les tribuns. Les soldats furent séduits à leur tour par l'espoir de ses largesses. Il reçut le serment de toute l'armée, retint les ornements consulaires, et marcha contre sa patrie. Il comptait sur cette grande multitude de nouveaux Romains qui lui avaient fourni plus de trois cents cohortes, dont il avait composé trente légions. Mais son parti avait besoin de crédit et d'autorité, pour lui donner cette force, il rappela les deux Marius et les autres exilés.
XXI. Tandis que Cinna marchait contre sa patrie, Cn. Pompée, père du grand Pompée, qui avait rendu d'éminents services à l'Etat pendant la guerre Sociale, particulièrement dans le Picenum, comme nous l'avons dit plus haut, et qui avait pris Asculum après une balaille où, malgré la dispersion des forces romaines sur plusieurs points, soixante-quinze mille citoyens romains avaient combattu le même jour contre plus de soixante mille Italiens, Pompée, dis-je, frustré de l'espérance d'un second consulat, se ménageait entre les deux partis, sans en embrasser aucun, subordonnant toutes ses actions à son intérêt, épiant les occasions et prêt à passer avec son armée du côté qui promettrait le plus à son ambition. Cependant il finit par en venir aux mains avec Cinna. Des deux parts, l'acharnement fut atroce. Il serait malaisé de dire combien ce combat, engagé et consommé au pied des murs de Rome, sous les yeux des habitants, fut affreux pour les acteurs et pour les témoins et, comme si le fer n'eût pas suffi pour anéantir l'une et l'autre armée, la peste les décima, et Cn. Pompée mourut. La joie que causa sa mort fut une trop faible compensation à la perte de tant de citoyens, moissonnés par le fer ou la contagion. Le peuple assouvit sur son cadavre la haine qu'il lui avait vouée vivant. On a compté deux ou trois familles de Pompées, il est constant que le premier consul de ce nom fut Q. Pompée, collègue de Cn. Servilius, il y a environ cent soixante-sept ans. Après de sanglants combats, Marius et Cinna se rendirent maîtres de la ville. Cinna y entra le premier, et fit une loi pour autoriser le retour de Marius.
XXII. Bientôt C. Marius entra dans Rome, et son retour fut un fléau pour les gens de bien. Jamais victoire n'eût été plus cruelle que la sienne, si celle de Sylla ne l'eût suivie de près. Ce ne fut pas sur des têtes vulgaires que s'exerça sa fureur : les premiers citoyens de la première cité du monde furent livrés à tous les genres de supplices. Le consul Oclavius, homme de l'esprit le plus doux, périt par l'ordre de Cinna. Merula, qui n'avait pas abdiqué le consulat, se fit ouvrir les veines, arrosa les autels de son sang, et, près de finir des jours utiles à son pays, appela contre Cinna, contre sa faction toute entière, la malédiction de ces mêmes Dieux qu'en qualité de prêtre de Jupiter, il avait tant de fois invoqués pour le salut de la république. Marius et Cinna proscrivirent Marc Antoine, le premier des citoyens et des orateurs. Il tomba sous le glaive des soldats, dont son éloquence avait suspendu les coups. Q. Catulus, qui partageait avec Marius la gloire d'avoir vaincu les Cimbres, et que d'autres vertus recommandaient encore, sachant qu'on était à sa poursuite, et prévoyant son sort, s'enferma dans un lieu fraîchement enduit de chaux et de sable, y porta du feu pour donner plus d'action à la vapeur qui s'en exhalait, respira cet air méphitique, et bientôt, étouffé, mourut selon le désir, mais non au gré de ses ennemis. La république marchait aux abîmes, et néanmoins personne n'osait encore donner ni demander la dépouille d'un citoyen romain. Dans la suite, la cupidité s'enhardit jusqu'à la cruauté. Les crimes furent proportionnés aux biens. Tout riche devint coupable. L'or du proscrit paya son assassin. On ne vit plus de honte là où l'on voyait du profit.
XXIII. Cinna, consul pour la seconde fois, entrait en fonctions, et Marius commençait un septième consulat, pour le déshonneur des autres, lorsqu'une maladie termina ses jours. Cet homme, impatient du repos, n'avait pas été moins funeste à ses concitoyens pendant la paix, qu'à l'ennemi pendant la guerre. On lui donna pour successeur Valerius Flaccus, auteur d'une honteuse loi par laquelle les débiteurs se libéraient en payant un quart de leur dette, avant la fin de l'année qui suivit cette faute, Valerius en porta la peine méritée. La domination de Cinna, dans l'Italie, détermina la plus grande partie de la noblesse à se réfugier auprès de Sylla, d'abord en Achaïe, bientôt après, en Asie. Cependant Sylla, vainqueur des généraux de Mithridate, en Attique, en Béotie, en Macédoine, reprit Athènes, détruisit, non sans peine, les immenses fortifications du Pirée, tua plus de deux cent mille hommes et fit autant de prisonniers. De croire qu'en assiégeant et en prenant cette ville, Sylla punissait des rebelles, ce serait ignorer l'histoire et la vérité. Les Athéniens s'étaient toujours conduits à l'égard des Romains avec une telle fidélité, qu'à Rome il était passé en proverbe, de dire, en quelque chose que ce fût, qu'agir de bonne loi, c'était agir à l' Athénienne . Au reste, la situation des Athéniens était affreuse. Accablés par les armes de Mithridate, ils voyaient les ennemis occuper leur ville, et leurs amis l'assiéger. La nécessité les retenait dans leurs murs, tandis que leurs cœurs étaient au milieu des Romains. De là, Sylla, passant en Asie, trouva Mithridate suppliant et soumis. Il lui demanda une forte somme, une partie de sa flotte, l'évacuation de l'Asie et de ses autres conquêtes, se fit rendre les prisonniers, châtia les transfuges et les coupables, et l'obligea à se renfermer dans l'héritage de ses ancêtres, c'est-à-dire dans les limites du royaume de Pont.
XXIV. Avant l'arrivée de Sylla, C. Flavius Fimbria, qui commandait, en Asie, la cavalerie romaine, s'était défait du consulaire Valerius Flaccus, pour s'emparer, après sa mort, du commandement des troupes et, salué du nom d' imperator , il avait eu le bonheur de mettre en fuite Mithridate. A l'approche de Sylla, il se tua de sa propre main, il était tout jeune encore et il avait montré de l'énergie dans l'exécution d'un criminel dessein. Cette même année, P. Lénas, tribun du peuple, fit précipiter de la roche Tarpéienne le tribun de l'année précédente, Sextus Lucilius et ses collègues, cités par lui, s'étant réfugiés auprès de Sylla, il leur fit interdire l'eau et le feu. Cependant Sylla avait tout pacifié au delà des mers. Des ambassadeurs vinrent lui rendre hommage au nom du roi des Parthes; c'était la première fois qu'un Romain recevait cet honneur. Parmi ces envoyés se trouvaient des mages, qui, d'après quelques signes observés dans ses traits, lui prédirent que le souvenir de sa vie serait immortel. De retour en Italie, Sylla prit terre à Brindes, et n'y débarqua que trente mille hommes, quoiqu'il en eût deux cent mille à combattre. Une chose me frappe entre toutes chez Sylla ; c'est la conduite qu'il tint pendant que la faction de Marius et de Cinna opprima l'Italie. Sans dissimuler la résolution de les combattre, sans interrompre la guerre qui l'occupait, il regarda comme un devoir plus pressant d'écraser les ennemis de la patrie, que d'aller punir des concitoyens, il voulut affranchir Rome des sujets de terreur qu'elle avait au dehors, avant de triompher des ennemis qu'elle avait dans son sein. Il n'était pas encore arrivé, quand Cinna fut tué dans une sédition militaire. Il eût dû périr condamné par le jugement des vainqueurs, plutôt qu'immolé par la colère des soldats. On peut dire de lui qu'il osa ce que jamais un homme de bien n'eût osé, mais qu'il fallait toute son énergie pour venir à bout de ce qu'il entreprit : factieux aussi téméraire dans ses projets qu'intrépide dans l'exécution. Carbon resta seul consul pendant toute l'année. Cinna n'ayant pas été remplacé.
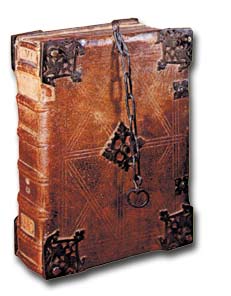 |
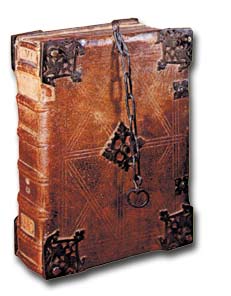 |
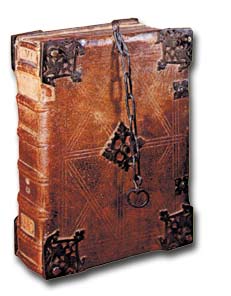 |
|---|
Carbon fut nommé consul pour la troisième fois, avec Caïus Marius, dont le père avait obtenu sept fois cet honneur. Caïus était âgé de vingt-six ans. On retrouvait en lui l'ame forte du vieux Marius mais sa carrière fut moins longue. Tout ce qu'il entreprit honora son courage et répondit à sa dignité. Mis en fuite par Sylla, près de Sacriport, il alla s'enfermer avec son armée dans Préneste, ville que sa situation défendait, indépendamment d'une garnison qu'il avait eu soin d'y placer.
Pour que rien ne manquât aux malheurs publics, l'émulation du crime succéda dans Rome à l'émulation des vertus. Le plus méchant se crovait le meilleur. Tandis qu'on se battait à Sacriport, le préteur Damasippe faisait égorger dans la curie Hostilia, comme favorables au parti de Sylla, Domitius, le grand pontife Scévola, célèbre auteur d'un traité sur le droit divin et les lois humaines, le prétorien C. Carbon, frère du consul, et l'ancien édile Antistius.
Honneur à Calpurnie, fille de Bestia, femme d'Antistius, qui se perça le sein pour ne pas survivre à son époux! Quelle renommée, quelle gloire elle s'est acquise ! Sa vertu brille d'un vif éclat, à côté du nom de son père justement oublié.
Carbon et le jeune Marius étaient consuls, lorsque Pontius Telesinus, chef de Samnites, implacable ennemi du nom romain, cœur intrépide et vaillant bras, avançant à la tête de quarante mille hommes, jeunes, intrépides et déterminés à ne point quitter les armes, en vint aux mains avec Sylla, vers la porte Colline, le premier jour de novembre, il y a cent onze ans et peu s'en fallut que cette journée ne fût aussi fatale au général romain qu'à la république. Rome courut un moindre péril, lorsqu'Annibal campait à trois milles de ses murailles, qu'au moment où Telesinus, volant de rang en rang, déclarait à son armée « que le dernier jour des Romains était arrivé ; qu'il fallait détruire et raser leur ville; que ces loups, ravisseurs de la liberté de l'Italie, seraient toujours à craindre, tant qu'on n'aurait pas anéanti la forêt qui leur servait de repaire. » Ce ne fut qu'à la première heure de la nuit, que l'armée romaine reprit haleine, et que l'armée ennemie se retira. Le lendemain, Telesinus fut trouvé mourant. Sa figure était plutôt celle d'un vainqueur que d'un homme rendant l'âme. Sylla fit porter sa tête autour des remparts de Préneste.
Le jeune C. Marius, voyant ses affaires désespérées, se jeta dans des souterrains habilement pratiqués, et d'où l'on pouvait gagner la campagne par diverses issues. Comme il en sortait, des gens apostés le massacrèrent. Quelques-uns prétendent qu'il se tua de sa propre main. Selon d'autres, Marius et le jeune frère de Telesinus, assiégés tous les deux et fuyant ensemble, périrent des coups qu'ils se portèrent l'un à l'autre. Quoi qu'il en soit, la gloire du jeune Marius n'est pas éclipsée par la grande figure de son père et la preuve la moins équivoque de l'estime dont l'honorait Sylla, c'est qu'il ne prit qu'après la mort de ce jeune homme le surnom d'Heureux, surnom qu'on ne pourrait lui contester, s'il eût cessé de vivre quand il cessa de vaincre. C'était Ofella Lucretius, transfuge du parti de Marius, qui avait dirigé le siège de Préneste.
Pour consacrer la mémoire du jour où les Samnites et Telesinus furent défaits, Sylla institua les jeux du Cirque. On les célèbre encore, sans rappeler la victoire de Sylla.
XXVIII. Peu de temps avant la bataille de Sacriport, plusieurs des chefs du parti de Sylla, les deux Servilius, Metellus Pius, M. Lucullus, avaient obtenu de brillants avantages sur l'ennemi, les premiers à Clusium, le second à Faventia, le dernier près de Fidentia.
Les maux de la guerre civile semblaient toucher à leur terme, quand l'inhumanité de Sylla les accrut. Nommé dictateur, il usa avec une cruauté sans mesure d'une autorité que ses prédécesseurs n'avaient exercée que pour sauver la république, et dont la suspension, pendant cent vingt années (car Rome nomma son dernier dictateur un an après qu'Annibal eut quitté l'Italie), prouve assez que les Romains en souhaitaient moins l'usage dans la guerre, qu'ils n'en redoutaient l'abus dans la paix. Sylla fut le premier qui donna l'exemple de la proscription et plût aux dieux qu'il eût été le dernier ! Une récompense fut attachée publiquement au meurtre d'un citoyen romain, dans cette même ville où la loi vengeait un baladin qui se plaignait dune injure! Plus on avait égorgé de victimes, plus on recevait! La tête d'un citoyen fut mieux payée que celle d'un ennemi! Le meurtrier hérita de sa victime! On ne se contenta pas de poursuivre ceux qui avaient pris les armes ; beaucoup d'innocents furent immolés. On mit à l'encan les biens des proscrits. Dépouillés de la fortune de leurs pères, les enfants furent aussi privés du droit d'aspirer aux honneurs et, pour comble d'indignité, les fils des sénateurs furent assujettis à toutes les charges du sénat, sans en conserver les avantages.
XXIX. Au moment où L. Sylla revenait d'Italie, Cn. Pompée, (fils de ce Cn. Pompée qui, durant son consulat, s'était signalé par de brillants succès contre les Marses, ainsi que je l'ai rapporté), n'étant âgé que de vingt-trois ans, (l'on compte cent treize ans de cette époque jusqu'à nous), et éclairé de ses seules lumières, avec ses seules ressources, conçut et exécuta hardiment de grandes choses. Pour venger sa patrie, pour en relever la gloire, il assembla d'abord une forte armée dans le Picenum, tout peuple des clients de son père. Le récit des actions de ce grand homme exigerait des volumes, et je ne peux en tracer qu'une esquisse rapide, resserré comme je le suis, par les bornes de cet abrégé.
Lucilia, sa mère, sortait d'une famille de sénateurs. La beauté qu'on remarquait en lui n'était pas celle qui tient à la fleur de l'âge ; c'était un caractère de dignité solide conforme à sa grandeur et à sa fortune futures, et qu'il conserva jusqu'au dernier jour de sa vie. D'une vie remarquablement pure, de mœurs irréprochables, d'un talent oratoire médiocre, passionné pour la puissance, mais voulant qu'on lui en fit hommage, et non s'en emparer, grand capitaine à l'armée, citoyen tranquille pendant la paix, tant qu'il n'eut pas un égal à craindre, ami constant, pardonnant aisément une offense, facile à satisfaire, et d'une sincérité parfaite dans la réconciliation, n'abusant jamais, ou du moins rarement, de la puissance, Pompée eût été presque exempt de vices, si ce n'était le plus grand de tous, dans une ville libre, et maîtresse du monde, de ne pouvoir souffrir un égal, là où l'égalité régnait de droit entre tous les citoyens. Accoutumé, depuis qu'il avait pris la robe virile, à servir dans l'armée de son père, général habile, il avait heureusement appliqué à l'étude de la science militaire, sa facilité naturelle et son intelligence et si Sertorius le louait moins qu'il ne louait Metellus, il le craignait davantage.
XXX. Ce fut alors que Sertorius périt, dans la ville d'Osca, poignardé
par un des proscrits, au milieu d'un festin. Le meurtrierétait M. Perperna, prétorien, homme d'une naissance illustre et
d'une âme vile. Le succès des Romains, la ruine de son parti, pour
lui la mort la plus honteuse, furent le fruit de cette lâche perfidie.
Metellus et Pompée triomphèrent de l'Espagne. Pompée, quoique
simple chevalier, entra dans Rome sur un char de triomphe,
quelques jours avant qu'il fût consul. Comment ne pas s'étonner
qu'un homme qui, par tant de charges extraordinaires avait
été élevé au faîte, ne pût voir sans impatience, le sénat et le peuple
romain faire droit à la demande de C. César, qui briguait un
second consulat? Telle est l'injustice humaine: nous nous pardonnons
tout à nous-mêmes, et rien aux autres, au lieu de faire remonter
la source du mal aux choses, ce sont les intentions et les
personnes que nous accusons. Dans le cours de son consulat,
Pompée rendit leur puissance aux tribuns. Sylla n'en avait laissé
subsister qu'une vaine image.
Pendant qu'en Espagne on poursuit le parti de Sertorius
soixante-quatre esclaves, échappés d'une école de gladiateurs de
Capoue, se saisirent, dans la ville, de quelques épées, s'enfuirent
sous la conduite de Spartacus, et se retirèrent d'abord sur
le Vésuve. Bientôt leur troupe, qui grossissait de jour en jour, désola l'Italie; elle s'accrut au point, qu'à la dernière bataille, ils
opposèrent quarante mille hommes à l'armée romaine. La gloire
de terminer cette guerre appartint à Crassus, qui s'éleva bientôt
après au premier rang dans l'État.
XXXI . Le monde entier avait les yeux fixés sur Pompée, et chaque jour ajoutait à sa grandeur. Il s'était glorieusement engagé, pendant son consulat, à n'accepter le gouvernement d'aucune province, à l'expiration de sa magistrature, et il avait tenu sa promesse. Deux ans après, comme les pirates semaient l'effroi sur toutes les côtes, non plus par des courses de brigands, mais en faisant ouvertement la guerre avec des flottes, et comme ils avaient même pillé quelques villes de l'Italie, le tribun A. Gabinius, en vertu d'une loi qu'il porta, fit décerner à Cn. Pompée la mission d'aller les détruire. La loi l'investissait d'une autorité proconsulaire jusqu'à cinquante milles de la mer et, par ce décret du sénat, la terre presque entière se trouvait sous l'empire d'un seul homme. Il est vrai que deux ans auparavant, M. Antonius, pendant sa préture, avait été revêtu d'un pareil pouvoir mais le plus souvent, c'est la personne qui augmente ou diminue le danger des choses, selon que son exemple peut être plus ou moins nuisible. La puissance d'Antonius avait été tolérée, parce qu'on souffre la grandeur de ceux dont on ne redoute point la force, tandis qu'on s'effraye de voir déférer des emplois extraordinaires à des hommes qui pourront à leur gré les déposer ou les retenir, et qui ne seront modérés qu'autant qu'ils voudront bien l'être. Les grands s'opposaient à la loi mais la sagesse dut céder à l'entraînement général.
XXXII. Q. Catulus témoigna en cette circonstance d'une fermeté et d'une modestie tout à la fois, qui sont dignes de mémoire. « Oui, Cn. Pompée sans doute est un grand homme, » dit-il dans l'assemblée du peuple, en désapprouvant la loi « mais il est déjà trop puissant au milieu d'un peuple libre ; il ne faut pas d'ailleurs tout accumuler dans la même main s'il arrivait malheur à Pompée, qui mettriez-vous à sa place? Vous, Q. Catulus ! » s'écria-t-on d'une voix unanime. Vaincu par l'expression de cet accord, et par l'honorable témoignage de ses concitoyens, il quitta l'assemblée. Admirons ici la sage retenue de Catulus et l'équité du peuple: l'un ne s'obstine pas à défendre son avis, l'autre ne veut pas priver de l'hommage qu'il devait à son mérite, un homme qui combattait ses désirs.
C. Gracchus avait enlevé les jugements aux sénateurs, pour les attribuer aux chevaliers. Sylla les avait rendus au sénat, Aurelius Cotta les partagea entre les deux ordres. Une loi de Roscius Othon régla les places que les chevaliers occuperaient au théâtre.
Cependant Cn. Pompée partit pour son expédition contre les pirates, accompagné d'une foule d'hommes distingués. Il commença par distribuer ses vaisseaux de manière à protéger tous les points qui pouvaient servir de retraite à ces brigands invincibles puis, après les avoir battus en diverses rencontres, avec ses forces réunies, il les attaqua sur les côtes de Cilicie, les défit et les mit en fuite. Pour prévenir le retour d'un fléau dont les ravages s'étaient étendus si loin, il rassembla ceux des brigands qui survivaient, et les confina dans l'intérieur des terres. On a blâmé cette mesure mais, indépendamment du nom de son auteur, qui suffirait pour la justifier, elle honorerait la prudence de quiconque l'eût prise car ces pirates s'abstinrent de rapines, dès qu'ils n'eurent plus besoin de piller pour vivre.
XXXIII. La guerre des pirates était terminée. L. Lucullus, à qui le sort avait assigné le gouvernement des provinces asiatiques après son consulat, commandait, depuis sept ans, l'armée romaine contre Mithridate, et s'était signalé par des actions mémorables. Il avait battu ce prince en plusieurs rencontres. Il l'avait contraint, à la suite d'une grande victoire, à lever le siège de Cyzique. Il avait défait, en Arménie, Tigrane, le plus puissant des rois. En un mot, il n'eût tenu qu'à lui de mettre fin à la guerre. Malheureusement cet homme qui méritait toutes sortes de louanges, ce guerrier invincible les armes à la main, se laissait vaincre par la cupidité. Le tribun Manilius, âme vénale, et instrument de l'ambition des autres, fit adopter une loi qui déférait à Cn. Pompée la conduite de la guerre contre Mithridate. Cette loi mit aux prises les deux généraux : Pompée reprochait à Lucullus une infâme soif des richesses ; Lucullus accusait Pompée d'un désir effréné de domination et ils ne se calomniaient ni l'un ni l'autre. En effet, Pompée, du moment qu'il eut pris part aux affaires publiques, ne put souffrir d'égal. Il voulut être seul, quand il aurait dû se contenter d'être le premier. Jamais on ne fut plus passionné pour la gloire, et plus indifférent pour tout le reste. Ardent jusqu'à l'excès dans la poursuite des honneurs, il était modéré dans l'exercice du pouvoir. S'il en prenait possession avec empressement, il en voyait le terme sans peine et tout ce qu'il avait été flatté d'obtenir par lui-même, il y renonçait, au gré de ses concitoyens. Quant à Lucullus, grand homme d'ailleurs, il donna le premier exemple de ce luxe, de cette profusion qui régnent aujourd'hui dans les festins, les meubles, les édifices. Il resserra la mer par des digues, et, pour la recevoir dans les terres, il perça des montagnes. Aussi Pompée rappelait-il agréablement le Xerxès romain.
XXXIV. En ce temps-là, Q. Metellus soumit l'ile de Crète à la puissance romaine. Les Crétois, au nombre de vingt-quatre mille jeunes gens, légers à la course, endurcis aux fatigues de la guerre, habiles à lancer des fléches et marchant sous la conduite de Lasthène et de Panare, lassaient depuis trois ans les armées romaines. Cn. Pompée, tourmenté par la soif de la gloire, ne put s'empêcher de réclamer encore une part de cette victoire. Mais indépendamment du mécontentement que cette conduite souleva contre lui, le mérite peu commun de Metellus et de Lucullus, intéressa tous les hommes de bien à leur triomphe.
Nous voici parvenus au consulat de M. Cicéron, homme nouveau, qui sut ennoblir sa naissance, et ne dut son élévation qu'à lui-même, citoyen illustre, génie sublime, grâce auquel Rome eut la gloire d'égaler, par les talents, les nations qu'elle avait vaincues par ses armes. Élu consul, il découvrit, par son énergie singulière, par sa fermeté, sa vigilance, sa prévoyance, la conjuration de Sergius Calilina, de Lentulus, de Cethegus et d'un grand nombre de complices, qui tenaient aux deux premiers ordres de l'État. Catilina effrayé par les menaces de l'autorité consulaire, s'enfuit précipitamment de la ville. Lentulus, personnage honoré du consulat et de deux prétures, Cethegus et plusieurs autres, d'un nom et d'un rang distingués périrent en prison, de l'avis du sénat et par les ordres de Cicéron.
XXXV. Le jour où le sénat prit cette résolution mit en haute lumière la sagesse de M. Caton, qui s'était déjà manifestée plus d'une fois, il est vrai, avec éclat. Caton, dont le bisaïeul était M. Caton, chef de la maison Porcia, offrait une image accomplie de la vertu. Plus semblable en tout aux Dieux qu'aux hommes, jamais il ne fit le bien pour paraître le faire, mais parce qu'il n'eût pu faire autrement. Où se trouvait la justice, là seulement il voyait la raison. En un mot, il fut exempt de toutes, les faiblesses humaines, et, supérieur aux caprices de la fortune. L'opinion de quelques sénateurs avait été d'interner dans des villes municipales Lentulus et les autres conjurés. Caton, alors tribun du peuple désigné, et très jeune encore, fut presque le dernier à qui l'on demanda son avis. Mais il s'éleva contre le complot avec tant d'indignation, de véhémence, et de feu, qu'il rendît tous ceux qui penchaient pour la clémence suspects de complicité, il présenta un tableau si saisissant du péril que Rome eût couru, par la destruction, l'incendie, la subversion de l'ordre public, et fit un tel éloge du consul, qu'il ramena à son sentiment le sénat tout entier. La condamnation des coupables fut prononcée, et le sénat reconduisit en corps l'orateur jusqu'à sa demeure. Calilina poursuivit sa criminelle entreprise avec autant d'audace qu'il en avait mis à la concevoir. Il se défendit vaillamment, et finit, sur le champ de bataille, des jours dus au fer des bourreaux.
XXXVI. Ce fut un surcroît d'honneur pour le consulat de Cicéron, que de servir d'époque, il y a quatre-vingt-deux ans, à la naissance d'Auguste, dont la grandeur devait éclipser tous les grands hommes de toutes les nations. Il est en vérité presque inutile de signaler ici les époques où brilla parmi nous le génie. Qui ne sait, en effet, qu'à quelque différence près dans l'âge, fleurirent en même temps Cicéron, Hortensius, Crassus, Caton, Sulpitius puis, Brutus, Calidius, Caelius, Calvus, César, dont le talent a le plus approché de celui de Cicéron? Après eux, et comme leurs élèves, parurent Corvinus, Asinius Pollion, Salluste, l'émule de Thucydide, Varron, Lucrèce, Catulle enfin, qui, dans son genre, ne le cède à personne. Quant aux maîtres, qui sont encore sous nos yeux, ils sont en si grand nombre, que ce serait folie pour ainsi dire, de chercher à les énumérer. Notre siècle s'honore surtout de Virgile, le prince des poêtes, de Rabirius, de Tite Live, qui suit Salluste de près, de Tibulle et d'Ovide, également parfaits dans leurs écrits. Des vivants je ne dirai rien : autant vis-à-vis d'eux, l'admiration est grande, autant l'appréciation est difficile.
XXXVII. Tandis que ces événements se passaient à Rome et dans l'Italie, Cn. Pompée continuait la guerre contre Mithridate car le roi de Pont s'était relevé depuis le départ de Lucullus, et marchait à la tête d'une nouvelle et puissante armée. Pompée le battit et dispersa ses troupes. Le monarque fugitif se réfugia chez Tigrane, son gendre, le prince le plus redoutable de ce temps, avant que les armes de Lucullus eussent affaibli sa puissance. Le général romain les poursuivit l'un et l'autre. A peine entrait il en Arménie, que le fils de Tigrane, révolté contre son père, et bientôt après Tigrane lui-même, arrivèrent dans son camp. Tigrane venait, en personne, se mettre humblement à la merci de Pompée, lui et ses Etats, en déclarant qu'il ne se fût soumis à aucun homme, Romain ou non, autre que Cn. Pompée ; que, quel que fût son sort, heureux ou malheureux, il ne s'en plaindrait pas, dès le moment qu'il devait être fixé par Pompée ; qu'il ne rougissait pas d'avoir été vaincu par celui qui ne pouvait l'être, et qu'on cédait sans honte à l'homme que la fortune avait élevé au-dessus cle tous les autres. Le vainqueur lui laissa les honneurs de la rovauté, mais le força de payer une somme considérable, que, suivant son usage, il fit remettre au questeur et porter sur le registre public, Tigrane perdit, avec la Syrie , toutes les autres provinces dont il s'était emparé. Les unes n'étaient qu'une restitution ; les autres étaient une conquête nouvelle, comme la Syrie , qui devint, de ce moment, province tributaire. Le royaume de Tigrane fut réduit à la seule Arménie.
XXXVIII. Faisons connaître, en peu de mots, les chefs par qui tant de pays ont été réduits en provinces romaines et sont devenus tributaires. Le lecteur saisit mieux ces détails, réunis que séparés et cette digression ne s'écartera point du plan que je me suis proposé dans la composition de cet ouvrage. Le consul Claudius est le premier qui fit passer une armée romaine en Sicile mais ce fut Marcellus Claudius qui, cinquante-deux ans après, par la prise de Syracuse, fit de la Sicile une province.
Regulus entra le premier en Afrique, vers la neuvième année de la première guerre Punique mais elle ne devint province romaine que deux cent quatre ans après, lorsque Scipion Émilien eût ruiné Carthage, il y a cent quatre-vingt deux ans. Le consul T. Manlius assujettit la Sardaigne, entre la première et la deuxième guerre Punique. Ce qui prouve d'une manière éclatante le caractère belliqueux de notre nation, c'est que le temple de Janus, qui ne pouvait être fermé qu'à la paix, ne l'a jamais été que trois fois : sous les Rois, sous le consulat de Manlius, et sous l'empire d'Auguste. Cn. et P. Scipion pénétrèrent les premiers en Espagne, à la tête de nos troupes, au commencement de la deuxième guerre Punique, il y a deux cent cinquante ans. Tour à tour nous avons conquis et perdu diverses parties de cette province qui a été toute entière soumise au tribut sous les auspices d'Auguste. Paul Emile soumit la Macédoine , Mummius, l'Achaïe, Fulvius Nobilior, l'Étolie. Antiochus fut dépossédé de l'Asie par L. Scipion, frère de l'Africain. Mais cette province, dont la libéralité du sénat et du peuple romain accrut le royaume de Pergame, ne devint tributaire, qu'à l'époque où M. Perperna fit Aristonicus prisonnier.
Aucun général n'eut la gloire d'avoir pris l'île de Chypre. Ce fut en vertu d'un sénalus-consulte, mis à exécution par Caton, qu'après la mort de son roi, elle reconnut la domination romaine. Metellus ravit la Crète la liberté dont elle avait joui longtemps. Le Pont et la Syrie sont des monuments de la valeur de Cn. Pompée.
XXXIX. Domitius, et Fabius, surnommé l'Allobrogique, petit-fils de Paul Emile, entrèrent les premiers dans les Gaules et depuis, ces provinces, dont nous poursuivîmes souvent la possession, et qui souvent nous échappèrent, ont coûté beaucoup de sang aux Romains mais elles sont devenues le plus brillant théâtre de la gloire de C. César. Sous sa conduite, sous ses auspices, les Gaules domptées ont été réduites à payer le même tribut humiliant que le reste du monde. César brisa aussi la résistance de la Numidie.
Servilius l'Isaurique acheva de subjuguer la Cilicie , Manlius Vulson, la Gallogrèce , après la guerre d'Antiochus. J'ai déjà dit que la Bithynie fut léguée par Nicomède au peuple romain. Outre la conquête des Espagnes et des autres pays, dont les noms et les titres décorent avec éclat le forum qui porte son nom, Auguste assujettit l'Egypte au tribut, et, par cet exploit, n'enrichit pas moins le trésor public que n'avait fait César son père, lorsqu'il eut conquis les Gaules. Tibère a arraché aux Illyriens et aux Dalmates l'aveu de leur soumission. Auguste avait arraché aux Espagnols le même aveu. Tibère a pareillement soumis, par la force des armes, la Rhétie , la Vindélicie , le Norique, la Pannonie , le pays des Scordisques, et, par la seule autorité de son nom, la Cappadoce.
Je reprends l'ordre des faits.
XL. On ne saurait dire si les campagnes de Cn. Pompée, qui suivirent, furent plus glorieuses ou plus pénibles. Il parcourut en vainqueur la Médie , l'Albanie, l'Ibérie. Ensuite, il dirigea ses troupes vers les pays les plus reculés, à la droite du Pont-Euxin, Colchos, Héniochos, [l'Achaïe?]. Vaincu par les armes de Pompée et par la trahison de Pharnace son fils, Mithridate se donna la mort : c était le dernier des rois indépendants, si nous exceptons les rois des Parthes. Alors Pompée revint en Italie, vainqueur de tous les peuples chez lesquels il avait pénétré, plus grand qu'il n'aspirait à l'être, et que ne l'eussent souhaité ses concitoyens, ayant, en tout, dépassé la mesure des destinées humaines. Il dut aux bruits qui s'étaient répandus sur son retour d'être accueilli avec plus de faveur. A croire ce que la plupart répétaient avec assurance, on allait le revoir à la tête de son armée et il devait restreindre à son gré la liberté-publique. Plus on s'était alarmé, plus on fut heureux de voir ce grand capitaine rentrer dans sa patrie, comme un simple citoyen. Il avait licencié toutes ses troupes à Brindes et, sans aucun titre que celui d' imperator , il reparut à Rome, avec son simple cortège ordinaire. Il triompha magnifiquement, pendant deux jours, de tous les rois qu'il avait vaincus. Le produit du butin fut immense. Aucun des généraux de la république, sans en excepter Paul Emile, n'avait fait entrer dans les coffres publics des sommes aussi considérables.
Pendant l'absence de Cn. Pompée, les tribuns du peuple, T. Ampius et T. Labienus, firent passer une loi qui lui donnait le droit d'assister aux jeux du Cirque avec une couronne de laurier et toute la parure du triomphe, et aux représentations du théâtre, avec la même couronne et la prétexte. Il n'osa jouir qu'une seule fois de cet honneur, et ce fût trop. La fortune s'était plu à le faire arriver par degrés au comble de la gloire : il triompha successivement de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie ; les trois parties du monde furent autant de monuments de ses victoires.
La grandeur n'échappe jamais à l'envie. Lucullus se souvenait d'une préférence outrageante. Metellus Creticus reprochait, non sans raison, à Pompée, de lui avoir enlevé des chefs ennemis, ses prisonniers, qui devaient orner son triomphe. Plusieurs hommes puissants s'opposèrent avec eux à ce qu'on remplît, à l'égard des villes, les promesses que Pompée leur avait faites, et qu'on récompensât, comme il le désirait, ceux dont il avait signalé les services.
XLI. Ces événements furent suivis du consulat de C. César. César m'arrête dans la rapidité de mes récits, et m'oblige de lui consacrer quelques pages.
Issu de la noble famille des Jules, et, suivant une tradition, accréditée, tirant son origine de Vénus et d'Anchise, remarquable entre tous ses concitoyens par sa beauté et l'énergique intrépidité de son âme, libéral jusqu'à la profusion, d'un courage au-dessus de la nature humaine, et même de l'imagination ; égalant Alexandre par la grandeur des pensées, la rapidité des conquêtes, la fermeté dans les périls, mais Alexandre sobre et maîtrisant sa colère ; habitué à prendre ses repas et à céder au sommeil sans en goûter le plaisir, et seulement pour obéir à la nécessité, allié de très-près à C. Marius, et gendre de Cinna dont rien n'avait pu le déterminer à répudier la fille, bien qu'il eût sous les yeux l'exemple du consulaire M. Pison, qui, pour plaire à Sylla, s'était séparé d'Annia, première femme de Cinna, César n'avait que dix-sept ans, à l'époque où il résistait ainsi au pouvoir dictatorial de Sylla : pour dérober sa vie, moins au dictateur lui-même qu'à la poursuite des chefs et des instruments de son parti, il s'échappa de Rome, pendant la nuit, sous un habit qui le cachait à tous les yeux.
Plus tard, mais tout jeune encore, pris par des pirates, il s'en fit craindre et respecter pendant tout le temps qu'il fut en leur puissance et, comme la difficulté d'exprimer en beaux termes certains détails n'autorise point à les omettre, je dirai qu'il n'arriva jamais à César de détacher sa chaussure ni sa ceinture, de peur que le moindre changement ne le rendit suspect à des gens qui se contentaient de le garder à vue.
XLII. Il serait trop long de rappeler les projets hardis qu'il conçut, et les efforts du timide magistrat qui gouvernait l'Asie pour les faire échouer. Mais je ne puis taire un trait qui révélait le futur grand homme. Dès le soir même du jour où les villes asiatiques eurent payé sa rançon (après qu'il eut toutefois contraint les pirates à donner eux-mêmes des otages), César, de sa seule autorité, rassemblant à la hâte quelques vaisseaux, se dirigea sur le lieu que ces brigands occupaient, mit en fuite une partie de leurs bâtiments, coula l'autre, en emmena quelques-uns, et fit beaucoup de prisonniers puis satisfait de son expédition nocturne et de sa victoire, il rejoignit les siens, prit des mesures pour s'assurer des corsaires qu'il avait en son pouvoir, et courut en Bithynie demander à Junius, alors proconsul d'Asie, l'ordre de faire liv vrer ces prisonniers au supplice. Le proconsul, non moins lâche que jaloux, s'y refusa, déclarant qu'il les ferait vendre. César ne perdit pas un moment, et son retour fut si prompt, que les pirates furent mis en croix avant que qui ce soit eût pu recevoir une lettre du proconsul.
XLIII. Nommé pendant son absence grand pontife à la place du consulaire Cotta, il se hâta de revenir en Italie pour prendre possession de son pontificat : déjà, à peine sorti de l'enfance, il avait été désigné prêtre de Jupiter, par Marius et Cinna mais Sylla l'avait dépouillé de ce titre, lorsqu'exerçant les droits de la victoire, il annula tout ce qu'avaient fait les vaincus. Les pirates, qu'il avait justement irrités, couvraient les mers. Pour leur échapper, il traversa la vaste étendue du golfe Adriatique sur une barque à quatre rames, accompagné seulement de deux amis et de dix esclaves. Au milieu du trajet, il crut apercevoir les vaisseaux ennemis : à l'instant même, il se dépouilla de ses habits et, s'attachant un poignard au côté, il se tint prêt à tout événement mais bientôt il reconnut son erreur : ce qu'il avait pris pour des antennes de navires n'était qu'une ligne d'arbres qui, de loin, produisait cette illusion.
Ce qu'il fit ensuite à Rome, la fameuse accusation qu'il soutint contre Dolabella, pour qui le peuple se montra plus favorable qu'il ne l'est d'ordinaire aux accusés, ses célèbres démêlés avec Q. Catulus, et plusieurs autres personnages éminents, sur des objets d'intérêt public ; la victoire qu'il remporta sur ce même Q. Catulus, qui tenait, sans contredit, le premier rang au sénat, lorsque avant sa préture César concourut avec lui pour la dignité de grand pontife, le rétablissement des trophées de C. Marius, pendant son édilité, malgré l'opposition de la noblesse ; la réintégration des enfants des proscrits dans le droit de prétendre aux charges de l'État, la vigueur et l'habileté qu'il déploya dans l'exercice de la préture et de la questure, qu'il remplit en Espagne sous Antistius Vetus, aïeul de ce Vetus aujourd'hui consulaire et pontife, dont les deux fils ont été revêtus du consulat et du sacerdoce, homme d'une pureté de mœurs et d'une honnêteté aussi parfaites que le comporte la condition humaine, tous ces faits sont trop connus pour avoir besoin d'être retracés.
XLIV. César était consul, lorsque se forma une ligue entre Cn. Pompée, M. Crassus et lui, ligue fatale à la république, au monde entier, et dans la suite aux ligués, eux-mêmes. Chacun d'eux avait son but. Pompée pensait à profiter du consulat de César et de son crédit, pour obtenir la sanction des actes censurés de son proconsulat au delà des mers. César savait d'avance qu'en faisant ce sacrifice à la gloire de Pompée, il augmenterait la sienne, et qu'en rejetant sur lui l'odieux de leur commun pouvoir, il affermissait le sien. Crassus n'aurait pu seul parvenir au premier rang ; il s'étayait du crédit de l'un et de la force de l'autre. Une alliance intime avait même uni César et Pompée : Pompée avait épousé la fille de César. Dans le cours de ce consulat, César porta une loi qu'appuya Pompée pour autoriser une distribution agraire du territoire de Capoue. Vingt mille citoyens passèrent dans cette ville, à laquelle le droit de cité fut rendu, cent cinquante-deux ans après sa réduction en simple préfecture, lors de la guerre contre Carthage. Le consul Bibulus eût voulu s'opposer aux entreprises de César, son collègue mais il le voulait plus qu'il ne le pouvait, faute de mieux, il se tint renfermé dans sa maison pendant la plus grande partie de l'année : il croyait rendre César suspect, il le rendit plus puissant. Ce fut alors qu'on décerna le gouvernement des Gaules à César, pour cinq années.
XLV. Vers ce temps, P. Clodius, homme d'une noble origine, éloquent, audacieux, sans autre frein, dans ses actions et ses discours, que son caprice ardent à poursuivre l'exécution de ses desseins pervers, diffamé comme frère incestueux, profanateur adultère des mystères les plus saints du peuple romain, ennemi acharné de M. Cicéron (quelle liaison eût été possible entre deux hommes si différents?), passa du sénat au peuple, et fit rendre une loi qui condamnait au bannissement quiconque aurait fait mourir un citoyen romain sans jugement. Les termes de la proposition ne désignaient pas Cicéron mais c'était évidemment contre lui qu'elle était dirigée. L'exil devint le prix des services du grand consul, il fut puni d'avoir sauvé la patrie. César et Pompée furent soupçonnés d'avoir contribué à l'accabler. On a cru qu'il s'était attiré leur ressentiment, en refusant de faire partie des vingt commissaires chargés de la répartition des terres de Capoue.
Son exil ne dura que deux ans. La protection de Cn. Pompée, qui fut tardive mais que rien n'arrêta dès qu'elle se fût déclarée, les voeux de l'Italie, les décrets du sénat, le zèle et l'énergie du tribun. Annius Milon, le remirent en possession de ses dignités, et de sa patrie. Depuis le bannissement et le rappel de Metellus Numidique, aucun exil n'avait été plus impopulaire, aucun retour ne fut plus triomphant. La maison de Cicéron, que dans sa haine, Clodius avait détruite, fut, avec un égal éclat, relevée, par ordre du sénat.
Ce même P. Clodius éloigna de Rome M. Caton, sous le prétexte d'une mission honorable. Il fit une loi par laquelle il l'envoyait dans l'île de Chypre, en qualité de questeur, mais armé de l'autorité prétorienne et soutenu d'un autre questeur, pour détrôner le roi Ptolémée, dont les dérèglements et la corruption méritaient ce traitement injurieux. Ptolémée se donna la mort, à l'approche de Caton et celui-ci revint à Rome, chargé de plus de richesses encore qu'on ne l'avait espéré. Louer l'intégrité de Caton serait un sacrilège mais n'y a-t-il pas quelque chose d'étrange dans l'idée qu'il eut de ne descendre, en remontant le Tibre, qu'au lieu même où ces trésors devaient être débarqués, quand les consuls, le sénat et le peuple s'étaient portés à sa rencontre.
XLVI. Cependant C. César accomplissait en Gaule de grandes choses dont le récit aurait peine à tenir dans un grand nombre de volumes. Tant d'entreprises couronnées du succès, tant d'ennemis prisonniers ou détruits ne lui suffisaient pas, il pénétra jusque dans la Grande-Bretagne. Il semblait chercher un autre monde, pour agrandir notre empire et le sien. Ses deux collègues dans le consulat, M. Crassus et Cn. Pompée, furent, encore nommés ensemble, et ne méritèrent l'approbation de l'opinion ni dans la poursuite, ni dans l'exercice de cette seconde gestion. Une loi que Pompée fit passer, à l'assemblée du peuple, laissa César en possession du gouvernement des Gaules pour cinq années. Crassus, qui méditait une guerre contre les Parthes, eut la Syrie. Les mœurs de Crassus étaient pures et même sévères mais sa passion pour l'or et pour la gloire était insatiable, effrénée. Ce fut en vain qu'au moment de son départ, les tribus essayèrent de le retenir en le menaçant de funestes présages. Pourquoi leurs imprécations ne tombèrent-elles pas sur lui seul! C'eût été pour la république un double avantage, de perdre le général en conservant l'armée. Crassus avait franchi l'Euphrate et s'avançait vers Séleucie, lorsque, enveloppé par l'innombrable cavalerie d'Orodes, roi des Parthes, il périt avec la plus grande partie de ses troupes. C. Cassius, alors questeur, en sauva les débris et maintint la Sy rie sous notre obéissance. Les Parthes l'avaient envahie par un dénoûment heureux de nos affaires, il les défit et les chassa. C'était ce même Cassius qui devait bientôt après se rendre coupable d'un affreux attentat.
XLVII. Pendant cette période, C. César, en diverses batailles régulières, rencontres ou sorties, détruisit au moins quatre cent mille ennemis, et fit un plus grand nombre encore de prisonniers. Par deux fois il entra en Bretagne. Enfin, chacun de ses neuf étés méritait un triomphe. Quant aux grandes choses qu'il accomplit près d'Alesia, elles sont de celles qu'un homme ose à peine entreprendre, et qu'un dieu seul peut achever. Mais la septième année de son séjour dans les Gaules, Julie, femme de Pompée, mourut. Elle était le seul gage de l'union de son père et de son époux, union dont la jalousie du pouvoir avait déjà relâché les faibles liens, la fortune rompant tous les nœuds entre ces deux chefs destinés à une si grande lutte, Pompée perdit, peu de temps après, le fils qu'il avait eu de Julie. De ce moment, l'ambition des partis s'emporta jusqu'à la fureur ; plus de mesure, plus de frein, on ne recula plus devant le glaive, on versa le sang des citoyens. Cn. Pompée, consul pour la troisième fois, fut nommé sans collègue, par le suffrage de ceux même qui jusque-là s'étaient opposés à son élévation. Cet hommage, qui semblait annoncer sa réconciliation avec les nobles acheva de lui aliéner C. César. Toutefois il n'employa cette nouvelle année de pouvoir qu'à réprimer la brigue.
Ce fut en ce temps que Milon, candidat au consulat, tua Publius Clodius, dans la chaleur d'une rixe, près de Bovilles : meurtre d'un fâcheux exemple, mais utile à l'État. L'influence de Pompée ne contribua pas moins à la condamnation de Milon, que l'odieux même de l'action. M. Caton n'hésita point à l'absoudre en plein sénat. S'il avait donné plus tôt son avis, beaucoup d'autres, l'adoptant, eussent passé condamnation sur la mort d'un mauvais citoyen, fléau de la république et effroi des hommes debien.
XLVIII. On vit bientôt briller les premières étincelles de la guerre civile. Tous les bons citoyens désiraient que César et Pompée licenciassent leurs armées. A son second consulat, Pompée s'était fait décerner le gouvernement des Espagnes et; depuis trois ans, sans quitter Rome et la conduite des affaires, il gouvernait ces provinces par ses lieutenants Afranius et Petreius, l'un consulaire, et l'autre prétorien. Et adhérant à l'avis de ceux qui demandaient le licenciement des troupes de César, il combattait, ceux qui voulaient qu'il licenciât les siennes. Combien eût été différente sa destinée, si, deux ans avant d'en venir aux armes, ayant achevé son théâtre, et les monuments qui l'entourent, il eût succombé, en Campanie, à la maladie dangereuse dont il fut atteint, et qui remplit toute l'Italie des vœux formés pour sa guérison, honneur inoui jusqu'à lui! L'occasion de le perdre échappait à la fortune, et ce grand homme emportait intacte au tombeau toute la gloire de sa vie.
Personne plus que le tribun C. Curion n'attisa le feu de la guerre civile et des maux dont la république fut embrasée pendant vingt ans. Distingué par sa naissance, hardi, éloquent, prodigue de ses biens et de son honneur, de l'honneur et du bien des autres, doué d'une éloquence fatale à l'Étal, Curion alliait l'esprit à la perversité. Point de richesses, point de plaisirs capables d'assouvir sa cupidité et ses passions déréglées. D'abord il embrassa le parti de Pompée, qu'on ne séparait point alors de celui de la république ensuite il eut l'air de se déclarer contre César et Pompée, quoiqu'en secret il appartînt à César. Ce changement fut-il désintéressé? Avait-il été, comme on l'a dit, acheté au prix de cent mille sesterces ? C'est un fait que nous laisserons douteux, comme on nous l'a transmis. Toujours est-il qu'on se flattait enfin d'une paix réparatrice : elle allait être conclue. César faisait des demandes aceptables ; Pompée y souscrivait : Curion intrigua ; tout fut rompu, malgré le dévouement de Cicéron au maintien de la concorde. D'autres historiens ont retracé et exposé dans un ouvrage complet, l'ensemble de ces faits et de ceux qui les précédèrent. J'espère n'être pas moins heureux, quand à mon tour je le retracerai.
XLIX. Qu'il me soit permis de féliciter, entre parenthèse, Q. Catulus, les deux Lucullus, Metellus et Hortensius : après une brillante carrière, parcourue à l'abri de l'envie et des périls, ils ont trouvé une mort tranquille, ou qui du moins n'a pas été prématurée, puisqu'elle a devancé le commencement des guerres civiles.
Sept cent trois ans après la fondation de Rome, soixante et dix-huit ans avant votre consulat, M. Vinicius, et sous les consuls Lentulus et Marcellus, la guerre civile s'alluma. Le parti d'un des chefs semblait le meilleur, l'autre était le plus fort. Toutes les apparences de la justice étaient d'un côté, de l'autre, la puissance. Pompée se faisait une arme de l'autorité du sénat, César, du dévouement de son armée. Le pouvoir fut déféré, par les consuls et le sénat, non à Pompée, mais à la cause qu'il défendait. César ne négligea rien pour que la paix fût maintenue ; les amis de Pompée se refusèrent à tout ce qui fut offert. Un orgueil porté jusqu'à la violence égarait l'un des consuls ; l'autre, Lentulus, ne pouvait se sauver que par la ruine de l'État. Quant à M. Caton, il déclarait qu'il fallait mourir plutôt que de laisser la république recevoir la loi d'un citoyen. Un Romain de l'ancien temps eût approuvé le parti de Pompée, un politique eût suivi celui de César. II eût jugé l'un plus estimable, l'autre plus redoutable. Lorsque César eut vu toutes ses propositions dédaignées, et reçu l'ordre de rentrer à Rome, en simple particulier, sans autre titre que celui de gouverneur de la province, avec une seule légion, et de s'en remettre pour le consulat qu'il briguait aux suffrages du peuple romain, convaincu qu'il ne lui restait plus d'autre parti que d'en appeler aux armes, il passa le Rubicon. Cn. Pompée, les consuls, et la plus grande partie du sénat, quittant aussitôt Rome et l'Italie, se retirèrent à Dyrrachium.
L. De son coté, César, après avoir forcé,dans Corfinium, Domitius et ses légions, et renvoyé sur-le-champ tous ceux qui désiraient rejoindre Pompée, poursuivit sa route du côté de Brindes. Il voulait montrer qu'il eût mieux aimé prévenir une rupture, et transiger, que d'accabler un parti qui fuyait. Mais, dès qu'il eut appris la retraite des consuls, il revint à Rome, et rendit compte au sénat, ainsi qu'au peuple assemblé, de ses desseins, en gémissant de se voir réduit, par ceux qui prenaient les armes, à la malheureuse nécessité de les prendre lui-même. Cela fait, il prit le parti dépasser en Espagne. Marseille arrêta quelque temps la rapidité de sa marche. Cette ville, p lus dévouée que sage, essaya mal à propos de s'interposer comme arbitre entre les deux chefs armés. Un pareil rôle n'appartient qu'à ceux qui sont assez forts pour contraindre celui qui résiste. L'armée que commandaient le consulaire Afranius et le prétorien Petreius, surprise et comme éblouie par la soudaine arrivée de César, se rendit. Les deux lieutenants et tous ceux qui voulurent les suivre, quel que fût leur rang, eurent la liberté de se retirer vers Pompée.
LI. L'année suivante, Pompée occupa Dyrrachium, et son armée couvrit tout le pays voisin. Il avait considérablement accru ses forces, tant en infanterie qu'en cavalerie, grâce aux renforts qu'il avait appelés de toutes les provinces d'outre-mer, et au X troupes auxiliaires des rois, des tétrarques et de plusieurs autres princes et il se flattait de la confiance que la disposition de ses flottes fermerait à l'ennemi le passage de la mer. Cet obstacle ne tint point contre la rapidité de C. César et sa fortune. Il fit traverser la mer à ses légions, et vint se placer si près de Pompée, que les deux camps se touchaient. Il l'enferma même dans ses retranchements, comme pour l'y bloquer mais le manque de vivres incommodait les assiégeants plus que les assiégés. Ce fut alors que Cornélius Balbus eut l'étrange audace de s'introduire dans le camp de Pompée où il s'aboucha avec le consul Lentulus, qui, prêt à se vendre, n'hésitait que sur le prix et c'est ainsi qu'il s'ouvrit la voie des honneurs auxquels il est parvenu si bien, que, quoique Espagnol et sans cesser de l'être, il obtint le triomphée et le sacerdoce, et, de simple particulier, devint consulaire. Il y eut ensuite diverses rencontres où les succès furent partagés. L'une d'elles fut de beaucoup plus favorable à Pompée, dont les soldats poussèrent vigoureusement ceux de César.
 |
 |
 |
|---|
LII. Alors César s'avança vers la Thessalie , où l'attendait la victoire. Divers partis s'offraient à Pompée. Les uns lui conseillaient de retourner en Italie et c'était, sans contredit, l'avis le plus conforme à ses intérêts ; les autres l'engageaient à traîner la guerre en longueur : l'estime dont jouissait son parti la lui rendrait de jour en jour plus facile. Emporté par son ardeur, Pompée suivit son adversaire. Je ne décrirai point ici la bataille de Pharsale, les malheurs de cette sanglante journée, si fatale au nom romain, les torrents de sang qui coulèrent des deux côtés, le choc terrible des deux chefs de la république, la fin d'un grand homme avec lequel s'éteignit une des deux lumières de l'empire, le massacre de ses nobles partisans. Un abrégé ne comporte point ces sortes de récits mais, ce que je ne dois pas omettre, c'est que C. César, aussitôt qu'il vit plier les troupes de Pompée, n'eut rien de plus pressé, rien de plus à cœur, que de licencier (pour parler militairement) tous les partis. Dieux immortels! Quel prix réservait Brutus à l'affection du vainqueur, à sa bonté! Rien de plus admirable, de plus noble, de plus beau que cette victoire : la patrie n'eut à pleurer que des citoyens tués en combattant. Mais une fureur obstinée rendit la clémence inutile, les vaincus trouvant moins de plaisir à recevoir la vie, que les vainqueurs à la donner.
LIII. Pompée prit la fuite avec Sextus, et trois autres personnages, les deux consulaires Lentulus, et le prétorien Favonius que la fortune lui avait donnés pour compagnons. Les uns le pressaient de se réfugier chez les Parthes, les autres en Afrique, auprès du roi Juba, toujours fidèle à son parti. Pompée préféra l'Egypte. Il comptait sur le souvenir des services qu'il avait rendus à Ptolémée, père de celui qui régnait en ce moment dans Alexandrie, et dont l'âge était plus voisin de l'enfance que de la jeunesse. Mais l'adversité n'efface-t-elle par la mémoire des bienfaits? Croit-on devoir quelque chose aux malheureux? La fortune ne change-t-elle pas les sentiments? Le roi, par le conseil de Theodotus et d'Achillas, envova des gens au-devant de Cn. Pompée, que Cornélie, sa femme, accompagnait depuis Mitylène, pour l'inviter à passer, du bâtiment de transport dans lequel il était, à bord du vaisseau qu'ils avaient amené à sa rencontre. Il y consentit et là fut égorgé, par l'ordre et sur un signé d'un vil esclave égyptien, le premier des citoyens de Rome. Ainsi périt, âgé de cinquante-huit ans, la veille de son anniversaire, sous le consulat de C. César et de Publius Servilius, un homme éminemment vertueux et grand, et qui, vainqueur du monde, trois fois consul, trois fois honoré du triomphe, avait atteint un degré d'élévation au-dessus duquel il n'y a plus à monter. La fortune se démentit à l'égard de ce grand homme, la terre qui avait manqué à ses victoires, manqua à sa sépulture. Comment expliquer, autrement que par une pure distraction, qu'on se soit trompé de cinq ans sur l'âge d'un homme tel que Pompée, et qui tient de si près à notre siècle ? Il était aisé de supputer le temps écoulé depuis le consulat de C. Atilius et de Q. Servilius. Au reste, en faisant cette observation, je n'adresse de reproche à personne, je veux seulement en éviter un.
LIV. Le roi d'Egypte et ceux qui le gouvernaient, ne se conduisirent pas vis-à-vis de César avec plus de loyauté que vis-à-vis de Pompée. A son arrivée, ils lui tendirent des pièges, bientôt même, ils osèrent l'attaquer à force ouverte. Leur juste supplice satisfit aux mânes d'un grand capitaine et vengea l'autre. Si le corps de Pompée n'était plus nulle part, son nom était encore partout. Le crédit puissant de son parti avait soulevé en Afrique, une guerre dirigée par le roi Juba, aidé de Scipion, homme consulaire, dont Pompée, deux ans avant sa mort, avait épousé la fille. Leur armée s'était grossie de quelques légions, amenées par Caton, à travers les régions les plus arides et par les chemins les plus difficiles. Caton, à qui les soldats voulaient déférer le commandement suprême, aima mieux servir sous Scipion, son supérieur par le titre.
LV. La brièveté que je me suis imposée me fait un devoir de presser la marche de mes récits. César, suivant sa fortune, passa en Afrique. Curion, chef de son parti dans ces provinces, était mort : l'armée de Pompée y était maîtresse. Le succès des premières rencontres fut partagé, mais on reconnut bientôt la fortune de César : l'ennemi plia. César traita les vaincus avec la même clémence.
Vainqueur en Afrique, il eut à soutenir en Espagne une guerre plus difficile, je ne parle pas de la défaite de Pharnace, elle n'ajouta rien ou peu de chose à sa gloire. Le promoteur de cette terrible guerre était Cn. Pompée, fils du grand Pompée, jeune homme d'une valeur impétueuse. Le nom de son père avait rassemblé autour de lui, de toutes les parties du monde, un corps de troupes puissant et nombreux. La fortune de César l'accompagna en Espagne, à Munda mais il n'avait pas encore livré de bataille aussi sanglante, aussi disputée si disputée, que, dans un moment où la victoire était plus qu'indécise, il s'élança de son cheval à terre, courut se placer devant ses lignes qui lachaient pied, et maudissant la fortune de l'indigne fin qu'elle lui réservait, déclara à ses soldats qu'il était déterminé à ne point reculer d'un pas, à eux de voir s'ils abandonneraient leur chef dans une telle situation! La honte, plus que la valeur rétablit le combat, le chef se montrant plus intrépide que ses soldats. Cn. Pompée, grièvement blessé, fut trouvé dans un lieu désert et mis à mort. Labienus et Varus périrent en combattant.
LVI. César vainqueur de tous ses ennemis, revint à Rome, et, avec une générosité qui passe toute croyance, il fit grâce à tous ceux qui s'étaient armés contre lui. Ce ne fut que jeux de gladiateurs, représentations navales, combats de troupes à pied, à cheval et d'éléphants, festins publics pendant plusieurs jours : il en remplit la ville. Il mena cinq triomphes. Les trophées de la Gaule , étaient en bois de citronnier, ceux du Pont, en acanthe, ceux d'Alexandrie, en écaille de tortue, ceux d'Afrique, en ivoire, ceux de l'Espagne, en argent poli. La valeur du butin en argent excéda six cents millions de sesterces.
Cependant cet homme si grand, ce vainqueur si modéré, ne jouit que cinq mois d'un pouvoir tranquille. Il était rentré à Rome au mois d'octobre. Aux ides de mars, il fut poignardé par des conjurés, à la tête desquels étaient Brutus et Cassius. Il n'avait pas réussi à s'attacher le premier en lui promettant le consulat, il s'était aliéné l'autre en différant de l'y porter. Ils eurent pour complices ceux de ses familiers les plus intimes qui devaient leur haute fortune au succès de sa cause, D. Brutus, C. Trebonius, et plusieurs autres d'un nom illustre. M. Antoine, son collègue dans le consulat, homme prêt à tout oser, avait rendu le dictateur odieux aux Romains, en lui mettant une couronne sur la tête, tandis qu'il présidait assis à la célébration des Lupercales : insigne que César avait repoussé, mais sans en paraître blessé.
LVII. L'événement fit connaître combien était juste le conseil qu'Hirtius et Pansa donnaient à César, de maintenir par les armes une domination acquise par les armes. Mais César ne cessait de dire qu'il aimait mieux mourir que d'être craint. Comptant qu'on serait pour lui ce qu'il avait été pour tant d'aut res, et sans défiance, il se laissa surprendre par des ingrats. Ce fut en vain que les Dieux multiplièrent les présages et les avertissements : les aruspices l'avaient prévenu de se défier des ides de mars ; Calpurnia, sa femme, épouvantée d'un songe, le conjurait de ne point sortir de sa maison, des billets qui lui dénonçaient la conjuration lui avaient été remis, mais il n'en avait pas pris immédiatement connaissance. Les arrêts du destin sont inévitables, il aveugle ceux qu'il veut perdre.
LVII. Brutus et C. Cassius étaient préteurs, et D. Brutus, consul désigné, l'année où ils commirent cet attentat. Ces trois hommes et les autres conjurés, soutenus des gladiateurs de D. Brutus, se saisirent du Capitole. Cassius était d'avis qu'on se défît du consul Antoine, et que le testament de César fût cassé. Mais Brutus combattit cette proposition. « Les bons citoyens, disait-il, ne devaient vouloir que le sang du tyran. » (Il fallait bien qu'il qualifiât ainsi César pour l'action qu'il méditait.) De son côté, Dolabella, que le dictateur avait choisi pour lui succéder dans le consulat, avait déjà pris possession des faisceaux et des autres attributs de la dignité consulaire. Antoine convoqua les sénateurs et, pour garantie de la paix qu'il offrait, il envoya ses enfants, comme otages, au Capitole, en faisant dire aux meurtriers de César, qu'ils pouvaient, sur sa foi, descendre en assurance ; en même temps sur la proposition de Cicéron, le sénat décréta la célèbre loi des Athéniens sur l'oubli du passé.
LIX. Puis le testament de César fut ouvert. Il adoptait C. Octave, petit-fils de Julie, sa sœur : Octave, sur l'origine duquel nous devons dire un mot bienqu'à cet égard il nous ait prévenu lui-même.
C. Octavius, son père, issu d'une famille non patricienne, mais honorée dans l'ordre des chevaliers, était un homme sage, vertueux, pur et riche. Élu préteur le premier dans une liste de concurrents très-distingués, il méritat d'être jugé digne de s'al lier à C. César, en épousant sa nièce. Au sortir de la préture, le sort lui assigna le gouvernement de Macédoine ; il y obtint le titre d' imperator , et il revenait à Rome, pour demander le consulat, quand il mourut en chemin, laissant son fils encore revêtu de la prétexte. Recueilli chez Philippe, second mari d'Atia, qui s'était chargé de son éducation, le jeune homme se fit chérir de C. César son grand-oncle, qui l'aima comme son fils, et l'emmena en Espagne, où la guerre s'allumait, il avait dix-huit ans et, depuis ce moment, César lui fit partout et toujours partager son toit ou sa litière. Il releva même, tout jeune encore, à la dignité de pontife et les discordes civiles apaisées, il l'envoya s'exercer aux écoles d'Apollonie, afin que l'étude des lettres développât l'heureux génie dont il paraissait doué. Il devait l'emmener ensuite dans l'expédition qu'il projetait contre les Gètes et les Parthes. Au premier bruit de l'assassinat de son oncle, Octave partit pour Rome : les centurions des légions voisines se mettaient, eux et leurs troupes, à sa disposition, offres qui d'après le conseil de Salvidienus et d'Agrippa, n'étaient pas à rejeter mais il avait hâte d'arriver. A Brindes, il apprit les circonstances du meurtre de César, et les clauses de son testament. A son arrivée à Rome, ses amis accoururent en foule à sa rencontre, et son entrée fut marquée par un phénomène : le disque du soleil forma sur sa tête une sorte d'arc-en-ciel, et sembla couronner d'avance le héros qu'attendaient de si grandes destinées.
LX. Atia, mère d'Octave, et Philippe, son beau-père, ne le voyaient pas sans inquiétude hériter d'un nom et d'une fortune en butte aux passions irritées. Mais par lui devait renaître et se conserver la gloire du nom romain : ainsi l'avaient arrêté les destins qui veillaient au salut de l'empire du monde. Cette âme divine rejeta donc les conseils de la prudence humaine, préféra le rang suprême avec ses périls à une humble et obscure sécurité, et aima mieux s'en rapporter au jugement de son oncle et de César sur lui, qu'à l'opinion de son beau-père : « Quand César m'a cru digne de porter son nom,» répétait-il, « il ne m'est pas permis de m'en croire indigne. » Antoine le reçut d'abord avec hauteur, il est vrai qu'il entrait plus de crainte que de mépris dans cet accueil. Admis non sans peine à le voir, dans les jardins de Pompée, il eut à peine le temps de lui parler. Bientôt même, Antoine l'accusa perfidement de lui avoir tendu des embûches. Mais à sa honte, on reconnut, la fausseté de cette accusation. Ensuite, les deux consuls, Antoine et Dolabella ne gardèrent plus de mesure, et leur fureur ambitieuse éclata. Le premier s'empara de sept cent millions de sesterces que C. César avait déposés dans le temple d'Ops, altéra les actes et les écrits du dictateur, en supposa d'autres, mit tout à l'enchère, et vendit, lui consul, la république. En même temps, il résolut de se saisir du gouvernement des Gaules, au préjudice de D. Brutus, consul désigné. De son côté, Dolabella s'attribua les provinces d'outre-mer. La haine s'accroissait ainsi de jour en jour entre deux hommes, dont le caractère et les desseins étaient si différents ; et par suite, le jeune César était entouré d'embûches qu'Antoine ne cessait de lui dresser.
LXI . Rome opprimée languissait sous la domination d'Antoine. La douleur et l'indignation remplissaient tous les cœurs mais l'énergie manquait pour la résistance, lorsque le jeune C. César, à peine âgé de dix-neuf ans, avec un courage supérieur à celui du sénat, et, sans autre guide que sa propre sagesse, osa, pour la défense de la république, de grandes choses et les exécuta. Il appela d'abord de Calatia, puis de Casilinum, les vétérans de son père. D'autres les suivirent, et de leur réunion se forma bientôt une armée régulière. Bientôt celle qu'Antoine avait tirée des provinces d'outre-mer reçut l'ordre de s'assembler à Brindes et il se porta à sa rencontre mais la légion Martiale et la quatrième, instruites des dispositions du sénat, et frappées du caractère du jeune Octave, levèrent leurs enseignes et passèrent dans son camp. Le sénat cependant lui fit ériger une statue équestre, que nous voyons encore dans la place aux harangues, avec l'inscription qui marquait son âge, distinction accordée, dans l'espace de trois cents ans, à trois hommes seulement, L. Sylla, Cn. Pompée, C. César, et l'envoya, en qualité de propréteur, avec Hirtius et Pansa, consuls désignés, faire la guerre à Antoine. Quoiqu'il n'eût encore que vingt ans, il la conduisit avec la plus grande vigueur. Assiégé dans Modène, D. Brutus fut délivré, Antoine, réduit à fuir honteusement, et privé de son armée, quitta l'Italie. Des deux consuls, l'un mourut sur le champ de bataille, l'autre, d'une blessure, peu de jours après.
LXII. Avant la déroute d'Antoine, le sénat, sur la proposition de Cicéron particulièrement, avait rendu toute espèce de décrets honorables pour le jeune César et pour son armée. Mais, le mouvement apaisé, les sentiments que la crainte avaient contenus éclatèrent, et tout d'un coup le parti de Pompée reprit faveur. On maintint M. Brutus et C. Cassius dans le gouvernement des provinces qu'ils s'étaient attribuées, sans attendre un sénatus-consulte, on combla de louanges les troupes qui s'étaient rangées sous leur étendard ; on leur remit tous les pouvoirs d'au delà des mers. Il est vrai que, tandis qu'ils redoutaient les armes d'Antoine, et exagéraient leurs alarmes, pour le rendre plus odieux, ils avaient déclaré, dans leurs manifestes, « qu'ils étaient prêts à payer le bonheur et la concorde de la république de leur exil éternel, qu'ils ne voulaient plus fournir d'aliments à la guerre civile, et que la conscience de leurs services suffisait à leur ambition, » mais à peine sortis de Rome et de l'Italie, ils s'étaient emparés, de concert et sans autorisation, des provinces et des armées et, sous le prétexte que partout où ils étaient, était la république, ils avaient déterminé les questeurs à leur livrer les tributs que ceux-ci levaient sur les provinces d'outre-mer pour être portés à Rome. Et le sénat avait tout couvert, tout ratifié. Le triomphe avait été décerné à D. Brutus, pour le récompenser sans doute d'avoir été sauvé. Quant à Hirtius et à Pansa, leurs funérailles avaient été célébrées aux frais de la république. De César, il n'était point question, à ce point, que les commissaires qu'on députa vers ses troupes avaient ordre de l'éviter, et de ne s'adresser qu'aux soldats. L'armée n'imita point l'ingratitude du sénat ; elle ne voulut entendre les envoyés qu'en présence de leur général, quoique César feignît de ne pas comprendre l'injure. Ce fut alors que Cicéron, attaché de cœur au parti de Pompée, dit, en parlant d'Octave, qu'il convenait de le louer et de l'élever jusqu'au ciel ; expression équivoque, sous laquelle il déguisait sa pensée.
LXIII. Antoine cependant fuyait au delà des Alpes. D'abord il envoya faire des propositions à M. Lépide, qu'une nomination surprise avait donné pour successeur à C. César dans la charge de grand pontife, et qui, s'étant décerné le gouvernement de l'Espagne, s'attardait encore dans les Gaules. Ses offres furent rejetées. Mais il affecta de se montrer aux soldats et comme, lorsque le vin ne troublait, point sa raison, il était supérieur à beaucoup de généraux, tandis qu'on n'en connaissait point d'inférieur à Lépide, ils l'introduisirent dans leur camp, par une brèche pratiquée derrière. Lépide garda le titre de général, Antoine en eut l'autorité.
Juventius Laterensis détournait Lépide de toute alliance avec Antoine, qu'un décret proclamait ennemi de la république. L'admission d'Antoine au camp de Lépide lui prouvant l'inutilité de ses conseils, il se perça de son épée. Sa mort fut conséquente avec sa vie. Les forces d'Antoine s'accrurent ensuite des armées que Plancus et Pollion lui livrèrent, Plancus, esprit mobile qui ne savait trop à quel parti il appartenait, et rarement d'accord avec lui-même, tantôt appuyant D. Brutus, désigné consul, et son collègue, tantôt se prévalant, dans ses lettres, de son zèle pour le sénat, et un moment après le trahissant, Asinius Poliion, ferme dans ses idées, fidèle à César, ennemi de Pompée.
LXIV. D. Brutus, d'abord abandonné par Plancus, bientôt après en butte à ses embûches, témoin tous les jours de la désertion de ses soldats, alla se réfugier chez un homme de distinction, appelé Camelus. Des émissaires d'Antoine le découvrirent et regorgèrent. Ainsi D. Brutus porta la peine de son ingratitude. Il avait été le plus intime ami de César, il en devint l'assassin : il lui faisait un crime de cette haute fortune, dont il avait recueilli les fruits, et il trouvait juste d'immoler le bienfaiteur, en retenant ses bienfaits. Ce fut à cette époque que Cicéron, dans une suite de discours, imprima, sur le nom d'Antoine un opprobre ineffaçable. Cicéron et le tribun Canutius l'attaquaient à la fois, l'un avec les armes d'une éblouissante et céleste éloquence, l'autre avec celles d'un perpétuel accès de rage. Tous deux payèrent de leur vie leur zèle pour la liberté. La proscription s'ouvrit par la mort du tribun, celle de Cicéron en fut le terme, Antoine étant assouvi. Puis Lépide fut déclaré, par le sénat, ennemi de la république, comme l'avait été Antoine.
LXV. Alors Antoine, César et Lépide entrèrent en correspondance, et en négociation. Antoine représentait à César tout ce qu'il avait à craindre de l'inimitié des partisans de Pompée, l'ascendant qu'ils avaient acquis, les efforts de Cicéron pour relever Brutus et Cassius. Il le menaçait, s'il ne s'unissait à lui, de joindre ses forces à celles des deux conjurés, déjà maîtres de dix-sept légions. « C'était au fils de César,» ajoutait-il, « bien plus encore qu'à son ami, qu'appartenait le soin de le venger. » Ainsi se forma celte ligue qui s'empara de l'autorité suprême. La belle-fille d'Antoine fut promise à César et cette alliance, qui rapprochait encore les deux triumvirs, se conclut à l'instigation et sur le vœu des soldats. Enfin, César fut fait consul, avec Q. Pedius, avant d'avoir accompli sa vingtième année, le 21 septembre, sept cent neuf ans après la fondation de Rome, et soixante-douze ans, M. Vinicius, avant votre consulat. Cette même année vit Ventidius joindre la toge consulaire à la robe prétorienne, dans une ville où il avait suivi le char d'un triomphateur, avec d'autres prisonniers faits dans le Picenum. Quelque temps après, il obtint lui-même les honneurs du triomphe.
LXVI. Déclarés l'un et l'autre ennemis de la république, Antoine et Lépide aimèrent mieux se rappeler ce que le sénat avait fait contre eux, que ce qu'ils avaient mérité, et ils renouvelèrent les horreurs des proscriptions de Sylla. Le jeune César était seul contre deux, sa résistance fut inutile. O comble de l'indignité! César est contraint de proscrire! Et il se trouve quelqu'un pour proscrire Cicéron! Le crime d'Antoine étouffe à jamais l'organe de la patrie , sans que personne se lève pour défendre celui qui si longtemps avait défendu tout le monde, État et citoyens !
Mais c'est en vain, Marc Antoine (l'indignation qui déborde de mon cœur me fait rompre le cadre de ces récits), oui, c'est en vain, que tu as mis à prix cette tête divine, cette tête illustre, et que, par un appât de mort, tu as provoqué l'assassinat du grand consul, le sauveur de l'État. Tu n'as pu ravir à Cicéron que des jours inquiets, quelques années de vieillesse, une existence qui, sous ta domination, eût été plus misérable que ne l'était sa mort sous ton triumvirat! Mais sa renommée, mais la gloire de ses actions et de ses discours, bien loin de les lui ravir, tu nas fait qu'en accroître l'éclat. Il vit et vivra dans la mémoire des siècles et tant que subsistera ce corps de la nature, œuvre du hasard, d'une providence ou d'une autre cause, quelle qu'elle soit, tant que subsistera ce monde que, presque seul des Romains, il a vu par les lumières de son esprit, embrassé par la force de son génie, illuminé par son éloquence, il emportera dans son cours la gloire de Cicéron ; la postérité tout entière admirera ses écrits contre toi et flétrira ton attentat contre lui et le genre humain disparaîtra de la terre plutôt que le souvenir de ce grand homme.
LXVII. Il n'y aurait point dans le cœur d'un homme assez de larmes pour pleurer tous les malheurs de ces temps là, bien loin qu'aucune plume puisse en retracer l'image. Remarquons toutefois que, dans ces proscriptions, tandis que les femmes se distinguèrent par leur dévouement pour leurs époux, que les affranchis et en général les esclaves témoignèrent honnêtement leur fidélité à leurs maîtres, les fils se signalèrent par leur indifférence pour leurs pères : tant il est vrai que les hommes souffrent impatiemment tout ce qui retarde l'accomplissement de leurs espérances, quelles qu'elles soient! Afin que les plus saintes lois fussent violées, et pour offrir au crime le double attrait de la récompense et de l'exemple, Antoine proscrivit L. César, son oncle, Lépide sacrifia Paulus, son frère, et Plancus eut le crédit de faire mettre Plancus Plotius, son frère, sur la liste des victimes. Aussi tous ceux qui suivirent le char triomphal de Lépide et de Plancus répétaient-ils ces vers, au milieu des railleries des soldats et de l'exécration des citoyens : Nous voyons triompher les deux consuls romains, Non des Gaulois, mais des Germains.
LXVIII. Un trait qui m'avait échappé doit retrouver ici sa place car le nom de son auteur ne me permet pas de le laisser dans l'ombre. Pendant que César disputait l'Empire à Pharsale et en Afrique, M. Celius, homme qui ne se distinguait de Curion que par un degré de plus dans l'éloquence et l'énergie, comme lui, pervers avec habileté, et réduit par l'état de ses affaires, pire encore que celui de son esprit, à ne pouvoir vivre dans un honnête repos, résolut, pendant sa préture, nonobstant les efforts du sénat et l'autorité du consul, de publier une loi pour l'abolition des dettes. Il tira de l'exil Annius Milon, que son rappel vainement sollicité rendait hostile à César, excita dans Rome une sédition et prépara sourdement au dehors une levée de boucliers. Chassé d'abord du sein de la république, il fut bientôt poursuivi par l'armée du consul et tué près de la ville de Thurium : tel avait été l'ordre du sénat. Une semblable tentative attira le même sort à Milon. Cet homme remuant, et dont la hardiesse convenait si mal à sa fortune, mortellement atteint d'un coup de pierre, près de Compsa, ville du pays des Hirpins, expia tout à la fois le meurtre de P. Clodius, et sa rébellion. Pour réparer encore une omission, je parlerai de la liberté intempestive et immodérée avec laquelle les tribuns Marullus Epidius et Flavus Cesetius reprochèrent à C. César d'aspirer à la royauté. Peu s'en fallut qu'ils ne ressentissent les effets de son pouvoir. Perpétuellement harcelé par leurs déclamations, il se contenta de les noter en censeur, au lieu de les châtier en dictateur mais il les destitua de leurs emplois, en se plaignant d'être réduit à la malheureuse alternative, de forcer son naturel, ou de laisser porter atteinte à son autorité.
Reprenons l'ordre des faits.
LXIX. Déjà Dolabella successeur de C. Trebonius dans le gouvernement de l'Asie, avait surpris, à Smyrne, et fait périr ce consulaire ingrat, qui, redevable à César de son élévation au consulat, avait trempé les mains dans son sang. C. Cassius, à la tête des fortes légions de Syrie, que lui avaient remises les prétoriens Statius Murcus et Crispus Marcius, auxquels ces légions obéissaient, poursuivit Dolabella qui, de l'Asie dont il s'était rendu maître, avait gagné la Syrie , et s'était enfermé dans Laodicée. La ville prise, Dolabella tendit courageusement la gorge à son esclave. Dix légions se trouvèrent du coup entre les mains de Cassius. De son côté, M. Brutus avait enlevé les troupes que commandaient C. Antoine, frère du triumvir et Vatinius, l'un en Macédoine, l'autre près de Dyrrachium, et qui s'étaient volontairement rattachées à lui. Ajoutons toutefois qu'il avait provoqué C. Antoine. Quant à Vatinius, il l'avait accablé du poids de sa considération. Brutus passait pour le premier de tous les généraux, Vatinius, pour le dernier. La difformité de son corps le disputait à la turpitude de son âme, on disait que l'enveloppe répondait à l'âme. Brutus voyait donc ses forces accrues de sept légions. Cependant le consul Pedius, en vertu de la loi Pedia dont il était l'auteur, avait fait interdire le feu et l'eau aux assassins de César, son collègue. Ce fut alors que le sénateur Capiton, mon oncle paternel, souscrivit avec Agrippa à la condamnation de C. Cassius. Pendant que ces événements se passaient en Italie, Cassius, après une opiniâtre résistance, avait pris Rhodes, malgré les difficultés de l'entreprise, Brutus avait vaincu les Lyciens puis les armées des deux conjurés étaient entrées en Macédoine. Là, Cassius faisant violence à son caractère, s'étudiait à surpasser en clémence Brutus lui-même. Je ne crois pas qu'on trouve l'exemple d'hommes que la fortune ait mieux traités qu'elle ne traita d'abord Brutus et Cassius, et qu'elle ait abandonnés plus vite, comme lasse de les favoriser.
LXX. Antoine et le jeune César passèrent alors en Macédoine à la tête de leurs armées, et livrèrent bataille aux conjurés dans les plaines de Philippes. L'aile que commandait M. Brutus poussa l'ennemi si vigoureusement, qu'elle força le quartier d'Octave car celui-ci, remplissait les fonctions de général, malgré le mauvais état de sa santé, et les instances d'Astorius, son médecin, qui effrayé par une vision qui prescrivait de se tenir tranquille, lui avait donné le conseil de rester au camp. L'aile de Cassius, maltraitée, mise en déroute, gagna les hauteurs. Là, craignant que son collègue n'eût pas été plus heureux, Cassius dépêcha un centurion des vétérans pour s'assurer du fait, en le chargeant en même temps de reconnaître une troupe nombreuse qui se dirigeait de son côté. Ne recevant pas de réponse, et la troupe approchant, au milieu d'un nuage de poussière, qui ne permettait de distinguer ni les figures ni les enseignes, persuadé que c'était un corps d'ennemis qui allait fondre sur lui, il se couvrit la tête, et présenta intrépidement le cou à son affranchi. Sa tête avait roulé à terre, quand reparut le centurion, annonçant la victoire de Brutus. A la vue du corps inanimé de son général, le malheureux s'écria : « Je suivrai celui qu'a perdu ma lenteur » Et il se jeta sur la pointe de son épée. Peu de jours après, Brutus combattit encore, fut défait, mis en fuite, et se retira sur une éminence. Là, résolu de mourir, il fit consentir Straton d'Égée, son ami, à lui prêter un fatal secours puis, élevant son bras gauche au dessus de sa tête, il saisit de la main droite l'épée de Straton, en plaça la pointe contre la mamelle gauche, à l'endroit même où se font sentir les battements du cœur, et mourut percé d'un seul coup.
LXXI. Messala Corvinus, jeune homme d'un mérite éclatant, qui servait dans l'armée de Brutus et de Cassius, y tenait le premier rang après eux. Pressé de leur succéder dans le commandement, il aima mieux devoir son salut à la générosité de César, que de poursuivre encore, les armes à la main, de douteuses espérances. Le plaisir d'accorder la vie à Corvinus fut pour César le plus doux fruit de sa victoire, et je ne connais pas d'exemple d'une plus noble et plus fidèle gratitude que celle de Corvinus. Aucune guerre ne coûta plus de noble sang. Le fils de Caton y périt. Hortensius et Lucullus, fils de deux citoyens éminents, eurent le même sort. Pour Varron, avant de repaître la cruauté d'Antoine du spectacle de sa mort, il lui prédit, avec une grande liberté, la fin dont il était digne et qui l'attendait. Drusus Livius, père de Julie, femme d'Auguste, et Quinctilius Varus n'essayèrent même pas de fléchir un ennemi vainqueur. Le premier se tua dans sa tente, l'autre, après s'être revêtu des ornements de ses dignités, contraignit un affranchi de lui percer le sein.
LXXII. Telle fut la fin que la fortune réservait à M. Brutus et à son parti. Il avait trente-sept ans. Sa vertu avait été irréprochable, jusqu'au jour où la coupable folie d'une seule action ternit l'éclat de toutes ses qualités. Cassius était plus grand capitaine, Brutus, plus homme de bien. On eût préféré l'amitié de Brutus, on eût craint davantage l'inimitié de Cassius. L'âme de l'un était plus forte, celle de l'autre était meilleure. Autant il fut avantageux à Rome d'avoir Octave pour maître, au lieu d'Antoine, autant il eût été de l'intérêt de la république d'obéir à Brutus, plutôt qu'à son collègue, si la victoire se fût déclarée pour eux. Cn. Domitius, le père de L. Domitius qui fut notre contemporain, personnage d'une si noble, d'une si parfaite pureté de mœurs, et l'aïeul de notre illustre et jeune Cn. Domitius, se saisit de quelques vaisseaux, et, sans autre chef que lui-même, suivi d'un grand nombre de compagnons de sa fuite, il confia ses destins à la fortune. Statius Murcus, chef de la flotte qui gardait la mer, se retira avec ce qu'il avait de troupes sous ses ordres, en Sicile, près de Sextus. Le fils du grand Pompée, en revenant d'Espagne, s'était emparé de cette île. Auprès de lui se rendaient en foule, et du camp de Brutus, et de l'Italie, et des autres parties du monde, tous les proscrits échappés au péril. Un chef, quel qu'il fût, convenait à des hommes qui n'avaient plus d'état assuré. Le sort ne leur laissait pas la liberté du choix ; il leur montrait un asile et contre cette horrible tourmente, le moindre abri devenait un port.
 |
 |
 |
|---|
LXXIII. Le jeune Sextus était sans culture, barbare dans son langage, d'une bravoure fougueuse, prompt à l'action, d'intelligence vive, bien loin, pour la loyauté, de ressembler à son père, affranchi de ses affranchis, esclave de ses esclaves, jaloux du mérite et s'humiliant devant la médiocrité. Le prétorien Asinius Pollion l'avait combattu avec succès en Espagne mais, après la déroute d'Antoine devant Modène, le sénat où le parti de Pompée dominait, en confiant à Brutus et à Cassius les provinces d'au delà des mers, l'avait lui-même rétabli dans la possession des biens paternels, et chargé de la garde des côtes. Maître de la Si cile, ainsi que je l'ai dit, il parvint, en enrôlant les fugitifs et les esclaves, à grossir le nombre de ses légions. Et là, il vivait, lui et son armée, des rapines de Menas et de Ménécrate deux affranchis de son père, qu'il avait mis à la tête de ses flottes, et qui infestaient les côtes : il ne rougissait pas de renouveler sur les mers les brigandages dont son père les avait purgées.
LXXIV. Après la défaite du parti de Brutus et de Cassius, An toine, se disposant à passer dans les provinces au delà des mers, s'arrêta quelque temps en Grèce ; Octave revint en Italie. Il la trouva, contre son attente, très agitée. Le consul L. Antoine, qui avait tous les vices de son frère, sans aucune des vertus qu'on reconnaissait par intervalle en celui-ci, s'était fait une armée nombreuse, tant en dénigrant César auprès des vétérans, qu'en appelant aux armes les propriétaires dépossédés, et dont on distribuait les biens aux citoyens désignés pour les colonies. D'autre part, Fuivie, femme d'Antoine, Fulvie qui n'avait de son sexe que les dehors, semait partout la confusion et la violence. Préneste était sa place d'armes. Antoine, pressé de tous côtés par Octave, s'enferma dans Pérouse, comptant sur les secours dont Plancus lui offrait l'espérance plutôt que la réalité. La valeur d'Octave et sa fortune le rendirent maître de Pérouse, il renvoya le consul, en vainqueur généreux. Le traitement cruel que les habitants éprouvèrent fut moins un effet de la volonté du général, que de la fureur du soldat. Macédonicus, un des citoyens les plus considérables de cette ville, alluma l'incendie qui la détruisit. Cet homme, après avoir mis le feu à sa maison et à tout ce qu'elle contenait, se perça de son épée et se précipita dans les flammes.
LXXV. Cependant la guerre s'était allumée dans la Campanie , à l'instigation de Tib. Claudius Néron, homme d'un grand caractère et d'un esprit éclairé, ancien préteur et pontife, père de Tibère César, qui avait pris en main la défense des propriétaires dépossédés. L'arrivée de César suffit là aussi pour étouffer et éteindre le feu. S'étonnera-t-on jamais assez des caprices de la fortune et des vicissitudes des choses humaines? Ne doit-on pas toujours espérer ou craindre un autre sort que celui qu'on éprouve, des événements contraires à ceux qu'on attend? On a vu Livie, fille de l'illustre et généreux Drusus Claudianus, distinguée entre toutes les dames romaines par sa naissance, ses vertus, sa beauté, Livie qu'Auguste choisit depuis pour compagne, et qui devint sa prêtresse et sa fille, après qu'il fut allé prendre place entre les Dieux, on l'a vue, fugitive devant les armes de celui qu'elle devait bientôt appeler son époux, et emportant dans ses bras le jeune Tibère, qui comptait à peine deux ans, Tibère destiné à devenir un jour le fils d'Auguste et le vengeur de l'empire, chercher des chemins détournés pour échapper au glaive des soldats, et, escortée d'un seul homme, afin de mieux dérober sa fuite, gagner les bords de la mer, et passer en Sicile avec Néron, son époux.
LXXVI. Je ne priverai pas mon aïeul C. Velleius du glorieux témoignage que je rendrais à un étranger. Cn. Pompée l'avait élevé au rang le plus honorable parmi les trois cent-soixante juges. Il avait été également chargé de l'intendance de ses travaux, et de ceux de Marcus Brutus et de Tib. Néron. Aucun citoyen ne jouissait d'une plus grande considération dans toute la Campanie. Son dévouement à Néron en avait fait un des soutiens de son parti, dévouement si absolu que, lorsque Néron quitta Naples, son âge et ses infirmités ne lui permettant pas de le suivre, il se plongea son épée dans le cœur.
César laissa librement Fulvie sortir de l'Italie, et Plancus l'accompagner dans sa fuite. Pour Asinius Poliion, après avoir retenu longtemps la Vénétie sous l'obéissance d'Antoine, et fait plusieurs actions d'éclat autour d'Altinum et des autres villes de ce pays, il était allé rejoindre le triumvir avec sept légions, et chemin faisant, il avait su par des conseils adroits et des promesses, gagner Domitius qui balançait encore, et qui, ayant quitté le camp de Brutus, après sa mort, avait gardé le commandement de la flotte. Aux yeux de tout juge équitable, ce que Pollion fit pour Antoine, en cette occasion, payait tout ce qu'Antoine avait pu faire pour Pollion. Le retour d'Antoine en Italie et les préparatifs de César faisaient craindre la guerre mais ils se réconcilièrent près de Brindes. On découvrit, en ce temps, les criminels desseins de Rufus Salvidienus. Cet homme, que l'obscurité de son origine n'avait pas empêché de parvenir aux honneurs, n'était pas satisfait d'avoir été, après Cn. Pompée et le jeune César lui-même, le premier chevalier créé consul, il aspirait à monter assez haut pour voir au-dessous de lui César et la république.
LXXVII. Sur les réclamations pressantes du peuple, que la pi raterie des mers réduisait aux horreurs de la disette, la paix fut. aussi conclue avec Pompée près de Misène. Lors de l'entrevue de César et d'Antoine avec Sextus, l'un et l'autre étant à table dans son vaisseau, Sextus dit assez plaisamment « qu'il leur donnait à souper dans ses carènes, appliquant ce jeu de mots à Antoine qui s'était rendu possesseur de la maison du grand Pompée, dans le quartier des Carènes. Par le traité de paix, on cédait à Pompée la Sicile et l'Achaïe mais son inquiète ambition n'était pas satisfaite. Ce que la patrie du moins y gagna, c'est qu'il assura le rappel et le salut des proscrits, et de tous ceux qui, pour diverses raisons, s'étaient réfugiés auprès de lui. Parmi les hommes distingués que cet accommodement rendit à la république, il faut compter Claudius Néron, M. Silanus, Sentius Saturninus, Aruntius et Titius. Quoique Statius Murcus, en amenant à Sextus une flotte considérable, eût doublé ses forces, celui-ci le fit périr en Sicile, abusé par des accusations calomnieuses. Un collègue, tel que Murcus, ne convenait ni à Mena, ni à Ménécrate.
LXXVIII. M. Antoine épousa, dans ce même temps, Octavie, sœur de César.
Sextus Pompée revint en Sicile ; Antoine passa dans les provinces d'outre-mer, où de grands mouvements avaient éclaté, depuis que Labienus, qui, du camp de Brutus, s'était réfugié chez les Parthes, avait ouvert la Syrie à leurs troupes, et fait massacrer le lieutenant d'Antoine. Mais la sage conduite de Ventidius et sa va leur triomphèrent. L'ennemi fut défait, et Labienus périt dans le combat, ainsi que Pacorus, jeune homme très renommé, fils du roi des Parthes.
Cependant César, pour empêcher que l'oisiveté, toujours funeste à la discipline, n'amollît ses soldats, les endurcissait aux fatigues et les accoutumait au péril, par de fréquentes expéditions dans l'Illyrie et la Dalmatie.
Dans le même temps, Calvinus Domitius, qui commandait en Espagne depuis la fin de son consulat, donna l'exemple d'une rigueur comparable à celle de nos vieux Romains. Il fit battre de verges Vibilius, premier centurion d'une légion, pour s'être enfui lâchement du champ de bataille.
LXXIX. La flotte du jeune Pompée croissant de jour en jour, ainsi que sa réputation, César résolut de tourner ses armes contre un ennemi dont la puissance grossissait. M. Agrippa fut chargé de construire des vaisseaux, de rassembler des soldats et des rameurs, et de les exercer. De hautes qualités distinguaient Agrippa. Infatigable dans les travaux, les veilles, les périls, sachant obéir, mais à César seul, jaloux de commander aux autres, et d'une activité qui ne souffrait point de retard, en tout il passait rapidement du projet à l'exécution. Une belle flotte fut équipée sur le lac Lucrin et sur le lac Averne et bientôt des soldats et des matelots, formés par des exercices qui se renouvelaient tous les jours, acquirent une très grande expérience de la guerre de mer et de la manœuvre. Ce fut avec cette flotte que César porta la guerre en Sicile, contre Sextus, après avoir, sous d'heureux auspices, épousé Livie qu 'il reçut des mains de Néron , son premier mari. Mais ce grand homme, que les puissances humaines avaient trouvé invincible, reçut en ce moment de la fortune un grave échec. Le vent soufflant de l'Afrique brisa la plus grande partie de ses vaisseaux et dispersa le reste, non loin de Vélie et du promontoire de Palinure . Cet événement suspendit toutes les opérations de la guerre. On les reprit ensuite, sans aucun avantage marqué de part ni d'autre. La flotte d'Octave fut d'abord battue par la tempête, sur la même côte. Puis, si un premier combat naval, près de Myles, eut un heureux succès, il fut suivi d'un désastre causé par l'arrivée subite des vaisseaux ennemis, dans le voisinage de Tauromenium. César présent à l'action, courut lui-même quelque danger, et peu s'en fallut que les légions débarquées, à la tête desquelles était Cornificius, lieutenant d'Octave, ne fussent accablées par Sext us. Mais les caprices du sort ne tinrent pas contre la valeur et la prudence. Une action régulière s'étant engagée, Pompée perdit presque toute sa flotte, et fut réduit à s'enfuir en Asie. Là, tandis qu'il passe tour à tour du rôle de général à celui de suppliant, se targue de sa dignité, ou implore la vie, il est égorgé par l'ordre de M. Antoine, de la main de Titius. Titius devint l'objet de l'aversion publique ; à ce point, que peu -après, faisant célébrer des jeux sur le théâtre de Pompée, le peuple le chargea d'imprécations, et le chassa d'un spectacle qu'il donnait.
LXXX. Pendant qu'il faisait la guerre au jeune Pompée, César avait appelé d'Afrique Lépide, avec douze légions à moitié complètes. Ce Lépide, le plus vain de tous les hommes, e t qu'aucun mérite ne rendait digne d'une si longue faveur de la fortune, avait accru ses forces des troupes de Sextus, que leur position rapprochait de son armée, mais qui ne se rendirent que sur l'autorité du nom d'Octave et sur sa foi, sans aucun égard pour lui-même. Cependant, fier de commander à plus de vingt légions, il avait poussé la démence jusqu'à s'attribuer l'honneur d'une victoire à laquelle il avait été loin d'être utile, puisqu'au contraire il l'avait retardée longtemps, soit en heurtant l'opinion d'Octave dans les conseils, soit en proposant des avis contraires à ceux qu'on approuvait. Il eut même l'audace de signifier à César de sortir de la Sicile. Jamais les Scipions et nos autres anciens généraux n'oserait rien de plus hardi que ce que fit Octave en cette occasion. Sans armes, couvert d'un simple manteau, ne portant avec lui que son nom, il pénétra dans le camp de Lépide et là, s'élançant à travers les traits que ce méchant homme faisait diriger sur lui, son vêtement étant déjà percé d'un coup de lance, il saisit hardiment l'aigle d'une légion. Ce fut en ce moment qu'on put reconnaître la différence des deux chefs. César, désarmé, se vit suivi d'une armée. Lépide, après dix ans d'une puissance dont sa vie le rendait si peu digne, abandonné tout à coup de ses soldats et de la fortune, couvert d'un habit de deuil et caché dans la foule qui se pressait autour de César, fut réduit à se jeter à ses pieds. César lui laissa la vie, la jouissance de ses biens mais il lui retira sa dignité qu'il était incapable de soutenir.
LXXXI. Une révolte éclata tout à coup dans l'armée. Trop souvent des soldats, que leur nombre enhardit, secouent le joug de la discipline, et ne daignent pas demander ce qu'ils croient pouvoir exiger. Octave calma les mutins, en employant à propos les châtiments et les largesses.
La colonie de Capoue reçut de grands avantages. On lui avait laissé un domaine public, il fut remplacé par des terres en Crète, dont le revenu bien plus considérable s'élevait jusqu'à douze cent mille sesterces. On lui promit, aussi des eaux. Ce sont celles qui contribuent aujourd'hui à la salubrité et à l'agrément de ces lieux.
La valeur héroïque d'Agrippa, dans le cours de cette guerre, lui mérita l'honneur d'une couronne navale. Aucun Romain n'avait obtenu cette distinction avant lui.
César, de retour à Rome, après sa victoire, déclara consacrées à l' utilité publique plusieurs maisons, qu'il avait fait acheter pour agrandir son habitation. De plus, il annonça le projet de construire un temple en l'honneur d'Apollon, et de l'entourer de portiques, projet qu'il accomplit avec une rare magnificence.
LXXXII. Pendant que César combattait avec tant de succès en Sicile, la fortune de son côté combattait en Orient, pour lui et la république. Antoine, avec seize légions, était entré dans l'Arménie. De là, traversant la Médie , dans l'idée d'attaquer les Parthes, il avait été prévenu par leur roi, qui s'était avancé à sa rencontre. Il avait perdu d'abord deux légions, son lieutenant Statianus, ses machines de guerre, tous ses bagages. Bientôt après, il avait couru lui-même, avec son armée, des périls auxquels il avait désespéré d'échapper. Enfin, affaibli par la perte d'un quart de ses troupes, il ne dut son salut qu'à l'avis fidèle d'un des nôtres, prisonnier des Parthes depuis la défaite de Crassus. Ce Romain, qui n'avait pas cessé de l'être, s'étant approché pendant la nuit d'un poste des Romains, les avertit de se détourner de la route qu'ils allaient suivre, et d'en prendre une autre, toute couverte de bois. M. Antoine profita de ce conseil, qui le sauva lui et les légions. Mais cette expédition, je le répète, lui coûta le quart de ses soldats et le tiers de ses esclaves et, valets, pour les bagages, à peine en sauva-t-il quelque chose. Cependant il lui plut d'appeler sa fuite une victoire, sans doute parce qu'il n'y avait pas perdu la vie.Trois ans après, il revint en Arménie, se saisit par surprise d'Artavasde, roi de ce pays, et le chargea de chaînes. Mais il voulut honorer le rang de son captif : les chaînes étaient d'or.
Épris pour Cléopâtre d'une passion toujours plus ardente, et dominé par les vices qu'alimentent le pouvoir, la licence et l'adulation, il résolut de faire la guerre à sa patrie. Déjà il s'était fait appeler le nouveau Bacchus, et promener dans Alexandrie, sur un char, comme Bacchus, paré de guirlandes de lierre, chaussé du cothurne, une couronne d'or sur la tête, un thyrse à la main.
LXXXIIII. Au milieu des préparatifs de cette guerre, Plancus passa dans le parti d'Octave. Il ne s'y détermina, ni par un choix éclairé, ni par amour pour la république, ni par attachement pour César car il s'était toujours déclaré contre l'une et l'autre. En lui, le besoin de trahir était une maladie. Sous le nom de client, il avait été le plus lâche adulateur de la reine, le plus vil de ses es claves, secrétaire d'Antoine, il ne rougissait pas d'être l'auteur ou l'instrument des plus sales débauches de son maître. Aucun mi nistère ne rebutait son âme vénale. On l'avait vu, tout nu, le corps peint de couleur cérulée, la tête ceinte de roseaux, traînant une queue de poisson et rampant sur les genoux, représenter Glaucus pour égayer un festin. Il embrassa la cause de César, parce que Antoine lui témoigna de la froideur, à cause de ses rapines manifestes. Et il osa se faire un titre de la clémence du vainqueur à l'entendre, le pardon de sa conduite en avait été l'approbation. Titius, son neveu, ne tarda pas à suivre son exemple. Plancus, peu de temps après sa défection, déclamant au sénat contre Antoine absent, et le chargeant de crimes horribles, le prétorien Coponius, homme grave, beau-père de P. Silius, lui dit avec esprit : « Il fallait que cet Antoine en eût beaucoup fait, la veille du jour que tu l'as abandonné. »
LXXXIV. La journée d'Àctium termina la guerre, sous le consu lat de César et de Messala Corvinus. Longtemps avant qu'on en vînt aux mains, la victoire du parti de César était chose jugée. D'uncôté, tout était plein d'ardeur, chef et soldats ; de l'autre, c'é tait un découragement général. Ici, des rameurs vigoureux, là, des hommes affaiblis par les privations. D'une part, des navires d'une moyenne grandeur, et faciles à mouvoir, de l' autre, des vaisseaux qui n'avaient de redoutable que l'apparence. Dans le camp d'Antoine, aucun transfuge, tandis que, tous les jours, il en arrivait dans le camp de César. Enfin, M. Agrippa avait emporté Leucade, pris Patras, occupé Corinthe, à la vue même et sous les yeux d'Antoine et deux fois sa flotte avait été battue avant l'action décisive. De plus, Amyntas, roi de Galatie, s'était rattaché à la cause la meilleure et la plus juste ; toujours semblable à lui-même, Dellius avait abandonné le parti d'Antoine, comme il avait autrefois abandonné celui de Dolabella et l'illustre Cn. Domitius, qui, seul de tous les partisans d'Antoine, n'avait jamais salué Cléopâtre du nom de reine, s'était, à tous risques, réuni à César.
LXXXV. Le jour de l'engagement suprême était arrivé, les deux flottes se trouvaient en présence, et les deux rivaux allaient combattre, l'un pour le salut, l'autre pour la ruine du monde. M. Lurius commandait l'aile droite de l'armée navale de César : Aruntius, l'aile gauche, Agrippa dirigeait en chef le mouvement de la flotte entière. Prêt à se porter où l'appellerait la fortune, César était partout. La flotte d'Antoine avait pour chefs Sosius et Publicola. Quant aux armées de terre, Taurus commandait celle de César, cellle d'Antoine était sous les ordres de Canidius.
L'action s'engagea. D'un côté était tout, général, matelots et troupes : de l'autre, rien, sauf des soldats. Cléopâtre donna le signal de la fuite. Antoine aima mieux fuir avec elle que de combattre avec les siens, et le général, dont le devoir eût été de punir les déserteurs, déserta lui-même son armée. Elle ne se défen dit pas moins jusqu'à la fin, avec une valeur obstinée, désespé rant de vaincre, elle combattait pour mourir. César qui voulait gagner ceux qu'il pouvait exterminer, les avertissait, de la voix et du geste, qu'Antoine était en fuite. « Contre quels ennemis vous battez-vous encore ? » leur criait-il, « et pour qui? » . Après avoir longtemps soutenu la lutte pour le chef qui les avait abandonnés, ils se décidèrent, non sans peine, à mettre bas les armes et à céder la victoire. César n'attendit pas, pour leur accorder le pardon et la vie, qu'on leur eût persuadé d'implorer sa clémence. Il était clair que chacun d'eux s'était conduit en vaillant capitaine, et leur général, comme un soldat sans courage, si bien qu'en voyant Cléopâtre entraîner Antoine dans sa fuite, on se demande qui des deux, s'il fût resté vainqueur, eût été l'arbitre de la victoire? L'armée de terre se rendit également à César , Canidius ayant fui précipitamment pour rejoindre Antoine.
LXXXVI. Qui pourrait faire connaître, dans un précis aussi ra pide, tout ce que le monde entier dut à la journée d'Actium, et quel heureux changement elle opéra dans la situation de la république? Le vainqueur fit grâce à presque tous, ceux-là seuls, et ils furent en petit nombre, perdirent la vie, qui dédaignèrent de la demander. Qu'on juge par là de la modération avec laquelle César, s'il en eût été le maître, aurait usé des droits de la victoire, soit aux premiers jours de son triumvirat, soit dans les plaines de Phil ippes ! Pour ce qui est de Sosius, il fut redevable de son salut, d'abord à la fidèle amitié de L. Aruntius, personnage digne de l'ancienne Rome, et bientôt après à César lui-même. César résista longtemps, mais sa bonté l'emporta : Sosius fut sauvé.
Je ne passerai pas sous silence la noble conduite d'Asinius Pollion et sa mémorable réponse. Pollion, depuis la paix de Brindes, s'était tenu en Italie. Jamais il n'avait vu Cléopâtre, et l'amour d'Antoine qu'elle avait énervé, l'avait dégoûté de son parti. Cependant, comme César, partant pour Actium, le pressait de l'accompagner : « Les services que j'ai rendus à Antoine sont trop grands, et les faveurs dont il m'a comblé trop connues, » dit-il : « Je n'entrerai point dans votre querelle, et je serai la proie du vainqueur.»
LXXXVII. L'année d'après, Octave porsuivit jusqu'en Egypte Antoine et Cléopâtre et mit fin aux discordes civiles.Antoine se tua lui-même, rachetant ainsi, par une mort courageuse, les nombreux crimes de sa mollesse. Cléopâtre, trompant la vigilance de ses gardes, se fit apporter un aspic, et, ayant par une piqûre, introduit le poison dans ses veines, rendit l'âme avec une intrépidité au-dessus de son sexe. Ce fut une chose digne de la fortune d'Auguste et de sa clémence, qu'aucun de ceux qui avaient pris les armes contre lui ne périt par ses coups ni par ses ordres. D. Brutus fut victime de la cruauté d'Antoine. Ce même Antoine, après avoir promis à Sextus. Pompée, que César avait vaincu, de lui conserver son rang, le priva même de la vie. Brutus et Cassius, sans chercher à connaître les sentiments du vainqueur, se donnèrent la mort. J'ai dit quelle fut la fin de Cléopâtre et d'Antoine. Canidius laissa voir, en mourant, une faiblesse qu'on n'eût pas attendue d'un homme qui avait vieilli dans le métier de la guerre. Cassius de Parme fut le dernier conjuré dont le sang expia le meurtre de César : Trebonius avait été le premier.
LXXXIII. Tandis qu'Octave achevait la guerre d'Actium et d'Alexandrie, M. Lépide formait le projet de l'assassiner à son retour. Ce jeune homme, doué de plus d'agréments que de sagesse, était le fils du triumvir et de Junia, soeur de Brutus. La garde de Rome était alors confiée à C.Mécène, simple chevalier, mais d'illustre origine; homme dont la vigilance se refusait même au sommeil, lorsqu'elle était nécessaire, habile à prévoir et capable d'agir mais aimant aussi, dès que les affaires lui laissaient quelque relâche, à se bercer dans une indolence molle et plus qu'efféminée, non moins cher à César qu'Agrippa, bien que moins comblé d'honneurs, satisfait du rang de chevalier, quoiqu'il eût pu s'élever plus haut, s'il l'eût désiré mais il ne le désira point. Mécène donc observa tranquillement et dans le plus grand secret les menées du jeune imprudenl qui courait à sa perle et, soudain, sans éclat et sans trouble, il arrêta ses manoeuvres, et éteignit l'étincelle d'une guerre civile prête à se rallumer avec une nouvelle fureur. Quant à Lépide, il paya de la vie son malheureux dessein. Rivale de la femme d'Antistius, Servilie, sa femme, avala des charbons ardents, et en avançant le terme de ses jours, immortalisa sa mémoire.
LXXXIX. Parler dignement de l'accueil que César reçut à son retour en Italie, à son entrée dans Rome, peindre les transports, le concours empressé des citoyens de tous les ordres, de tous les âges ; retracer la magnificence de ses triomphes et des spectacles donnés au peuple, c'est une tâche qui ne saurait être remplie dignement dans un grand ouvrage, à plus forte raison dans un précis tel que le mien. Tout ce qu'on peut demander aux Dieux, tout ce qu'ils peuvent accorder aux hommes, tout ce que les vœux peuvent embrasser, tout ce qui peut mettre le comble au bonheur, le retour d'Auguste le procura à la république, au peuple romain, au monde entier. On vit, après vingt ans, les discordes civiles étouffées, la guerre éteinte au dehors, la paix rétablie, la fureur des armes partout assoupie. Les lois retrouvèrent leur vigueur, les jugements, leur autorité, le sénat, sa majesté ; les magistratures furent ramenées à leur organisation primitive ; sauf la préture : deux préteurs furent ajoutés aux huit qui existaient. La r épublique reparut sous sa forme antique. Les bras furent rendus à l'agriculture, le respect à la religion, la sécurité aux citoyens : chacun rentra en possession de son bien. On fit à d'anciennes lois d'heureuses réformes, on en décréta d'utiles. Le recensement du sénat se fit sans rigueur, mais non sans sévérité. Les premiers citoyens, tous ceux qui avaient passé par les triomphes et les plus hautes charges travaillèrent à l'envi, sur l'invitation du prince, à l'embellissement de la ville. Ce ne fut qu'à grand'peine, et après une longue résistance qu'on fit accepter à César un onzième consulat : quant à la dictature, il la repoussa avec une persistance égale à celle que le peuple mit à lui offrir.
Les guerres et les victoires de César, le monde soumis et pacifié, toutes les grandes choses qu'il a faites au dehors et dans l'Italie, accableraient l'écrivain même qui consacrerait à cette histoire sa vie entière. Pour nous, qui nous souvenons de l'engagement que nous avons pris, nous n'avons pu mettre sous les yeux de nos lecteurs et présenter à leur esprit qu'une idée générale de son gouvernement.
XC. Les guerres civiles étaient éteintes, les membres de la république si longtemps déchirée commençaient à se réunir. La Dalmatie , qui, depuis deux cent vingt ans, était en état de rébellion, fut alors réduite à reconnaître définitivement la domination romaine : les peuples sauvages et barbares qui habitent les Alpes, se soumirent. Pour réduire les Espagnes, il en coûta des combats multipliés dont les résultats se balancèrent. Tantôt Auguste y commanda lui-même les légions, tantôt ce fut Agrippa, qui devait à l'amitié de ce prince un troisième consulat et l'honneur de partager avec lui l'autorité tribunitienne. Les armées romaines étaient entrées pour la première fois, dans ces provinces, il y a deux cent cinquante ans, sous la conduite de Cn. Scipion, oncle paternel de l'Africain, pendant le consulat de Scipion et de Sempronius Longus, la première année de la seconde guerre de Carthage. Des torrents de sang y avaient coulé des deux côtés pendant deux cents ans. Plus d'une fois, la défaite des années de la république et la perte de leurs chefs avaient terni la gloire de nos armes et mis l'empire en danger. Les Espagnes avaient été le tombeau des Scipions. C'était là que nos ancêtres avaient péniblement soutenu, pendant vingt ans, contre Viriathe une guerre honteuse ; là que Numance avait ébranlé par la terreur de son nom la puissance du peuple romain ; là que Q. Pompée avait signé un traité déshonorant, et Mancinus, une capitulation encore plus ignominieuse que le sénat avait dû désavouer, en livrant celui qui y avait souscrit, là que tant de généraux, consulaires ou prétoriens, avaient péri, là que du temps de nos pères, Sertorius s'était élevé à un tel degré de puissance, que, pendant cinq années, la supériorité resta indécise entre les Romains et les Espagnols, et qu'on se demandait laquelle des deux nations obéirait à l'autre. Eh bien, ces provinces si barbares, si vastes, si peuplées, sont devenues si paisibles, il y a près de cin quante ans, grâce à César, que, sous le gouvernement de C. Antistius, de P. Silius et de plusieurs autres qui leur succédèrent, le brigandage même disparut d'un pays qui n'avait jamais cessé d'être en proie aux guerres les plus sanglantes.
XCI. Dans le temps qu'Octave pacifiait l'Occident, le roi des Parthes lui renvoya de l'Orient les enseignes romaines qu'Orode avait enlevées dans le désastre de Crassus, et celles que la fuite d'Antoine avait laissées entre les mains de Phraate, fils de ce roi. César reçut alors le surnom d'Auguste, sur la proposition de Plancus, appuyée de l'assentiment unanime du sénat et du peuple.
Il se trouva néanmoins des hommes qu'irritait cette prospérité de l' État. Tels furent Fannius Cépion et L. Murena. Le projet d'attenter aux jours de César unit ces deux conjurés, de caractères bien différents car Murena, s'il n'eût participé à ce dessein c omplot et fit justement retomber sur leur tête le coup que leur fureur méditait.
Peu après, la même tentative fut renouvelée par Egnatius Rufus, qui ressemblait en tout à un gladiateur plutôt qu'à un sénateur. Rufus, pendant son édililé, s'était concilié la faveur publique et le soin qu'il prenait d'envoyer ses esclaves au secours des bâtiments incendiés avait tellement accru sa popularité, que, de l'édilité, il était passé immédiatement à la préture. Il avait même osé prétendre au consulat, quoiqu'il fût plongé dans la plus honteuse corruption, et que ses affaires fussent aussi désordonnées que son esprit. Il s'associa des hommes de son espèce, et résolut d'assassiner Auguste, jugeant que l'existence de ce prince et la sienne n'étaient pas compatibles, et tout prêt à mourir après lui. De pareilles gens calculent ainsi : ils aiment mieux périr dans la ruine commune, que sous le poids de leurs propres malheurs. Mort pour mort, celle-là à moins d'éclat. Egnatius ne réussit pas mieux que les autres conspirateurs à cacher son dessein. Emprisonné avec ses complices, il subit avec eux une mort digne de sa vie.
XCII. Ne privons pas d'un souvenir la belle action d'un excellent citoyen, de C. Sentius Saturninus, consul à cette époque. César était loin de Rome. Occupé à régler les affaires de l'Asie, il portait chez tous les peuples, heureux de sa présence, les fruits d'une paix qu'on ne devait qu'à lui. Sentius, qui, pendant son absence, se trouvait seul à remplir les fonctions du consulat, rappela plus d'une fois dans sa conduite la sévérité des mœurs antiques et la vertu des premiers consuls. Il mit à découvert les frauduleuses manœuvres des publicains, châtia leur avarice, et fit reverser dans le trésor public les sommes qu'ils en avaient détournées. Mais ce fut surtout à l'occasion des comices qu'il se montra vraiment consul. Jugeant indignes de la questure quelques-uns de ceux qui s'étaient mis sur les rangs, il leur défendit de donner leurs noms et, comme ils persévéraient dans leur brigue, il leur décida que, s'ils paraissaient au Champ de Mars, il emploierait contre eux l'autorité consulaire. Egnatius, fort de la faveur publique, espérait que, pour lui, le consulat suivrait la préture, comme la préture avait suivi l'édilité. Sentius lui défendit comme aux autres de se montrer au nombre des candidats, et, n'ayant pu l'y faire renoncer, il jura que, lors même que les suffrages du peuple le porteraient au consulat, il ne le proclamerait pas. Cette fermeté me parait comparable à tout ce qu'on rapporte de plus glorieux de nos anciens consuls. Mais actuellement nous louons plus volontiers ce qu'on nous raconte que ce dont nous sommes témoins. L'envie s'attaque au présent, nous n'attachons notre respect qu'au passé. Dans l'un, nous voyons un poids qui nous écrase, dans l'autre, une leçon.
XCIII. Trois ans à peu près avant que le complot d'Egnatius éclatât, et vers le temps où Cepion et Murena conspirèrent (il y a cinquante ans), M. Marcellus, fils d'Octavie sœur d'Auguste, mourut à la fleur de l'âge. C'était l'héritier de César, dans l'opinion commune, bien qu'on ne fût pas sûr qu'Agrippa le laissât jouir paisiblement de la puissance. Il venait de donner, en qualité d'édile des spectacles magnifiques. C'était, dit-on, un jeune homme doué des plus nobles qualités, d'un aimable enjouement, et d'un esprit à la hauteur de la fortune à laquelle il était destiné. Après sa mort, Agrippa revint d'Asie. On prêtait à son vovage un motif politique mais la nécessité de se soustraire aux ressentiments secrets de Marcellus en avait été la véritable cause. A son retour, il épousa Julie, fille de César et veuve de Marcellus : la fécondité de cette princesse fut également malheureuse pour l'État et pour elle.
XCIV. Ce fut vers ce temps que Tib. Claudius Néron entra dans les affaires publiques, par l'office de questeur, à l'âge de dix-neuf ans. Il ne complaît que trois ans, nous l'avons dit, lorsque Livie, fille de Drusus Claudianus, fiancée à César Auguste par Néron, son premier mari, s'était unie avec ce prince. Élève de César, et nourri de ses divines leçons, le jeune Tibère réunissait tous les avantages, l'éclat de la naissance, la beauté des traits, une taille majestueuse, un génie supérieur cultivé par l'étude. Son début promettait ce qu'il a tenu depuis. A peine eut-il paru, qu'on reconnut le prince. Chargé par son beau-père de pourvoir aux besoins, de Rome et d'Ostie en proie à la disette, il prit ses mesures avec une habileté qui annonçait ce qu'il devait être un jour. Auguste l'envoya, peu de temps après, à la tête d'une armée, visiter les provinces de l'Orient et y rétablir l'ordre ; il y donna d'éclatantes preuves de tous les genres de mérite. De l'Orient, il entra dans l'Arménie, la soumit à la domination romaine, et la laissa sous les lois d'Artavasde. Frappé de la terreur de son nom, le roi des Parthes envoya ses fils en otage à César.
 |
 |
 |
 |
|---|
XCV. Au retour de Tibère, Auguste voulut faire l'épreuve de ses forces dans une guerre d'importance. Drusus Claudius, son frère, né de Livie, dans le palais de César, lui fut adjoint pour cette expédition. Les deux princes attaquèrent séparément les Rhétiens et les Vindéliciens et ce ne fut qu'après le siège d'une foule de villes et de forteresses, après une multitude de batailles et de victoires, et une grande effusion de sang ennemi, que les armées romaines, avec plus de périls que de pertes, domptèrent des nations à peine accessibles, défendues par la nature des lieux, par la force du nombre et leur féroce intrépidité. Avant ce temps, Plancus et Paulus avaient exercé la censure mais le peu d'accord qui régnait entre eux rendit leur magistrature inutile à la république, et peu glorieuse pour eux-mêmes. L'un n'avait pas la fermeté d'un censeur, l'autre n'en avait pas les mœurs. Le premier était incapable d'en remplir les devoir, l'autre devait les craindre car il ne pouvait reprendre la jeunesse d'aucune faute, ni rien entendre contre elle, dont, il ne pût lui-même accuser sa vieillesse.
XCVI. Agrippa mourut. Cet homme nouveau, dont tant de services avaient ennobli l'origine, s'était élevé jusqu'à l'honneur de devenir beau-père de Tibère, il avait vu ses enfants, petits-fils d'Auguste, adoptés par ce prince sous les noms de Caïus et de Lucius. Sa mort resserra encore les liens qui unissaient Néron et César. César fit épouser à Néron sa fille Julie, veuve d'Agrippa. Peu après, Néron fut chargé de la guerre de Pannonie, guerre importante et redoutable, commencée par Agrippa, sous le consulat de votre aïeul, M. Vinicius, et dont le voisinage menaçait l'Italie. Je me propose de parler ailleurs des Pannoniens, des Dalmates, de la situation de leur pays, des fleuves qui l'arrosent, du nombre et de la force des habitants, des victoires éclatantes et multipliées de notre grand capitaine. Mais je veux conserver à cet ouvrage son plan. L'ovation fut le prix des victoires que Tibère avait remportées.
XCVII. Cependant, tandis que nos armes étaient si heureuses dans cette partie de l'empire, M. Lollius reçut un échec en Germanie, c'était un homme plus jaloux de s'enrichir que de bien faire, profondément vicieux et dissimulé et la perte de l'aigle de la cinquième légion appela César dans les Gaules. Le soin et le fardeau de la guerre germanique furent alors remis à Drusus Claudius, frère de Néron. Drusus possédait toutes les qualités qu'on tient de la nature et que l'éducation achève. On ne sait ce qu'on doit le plus admirer en lui, de sa capacité militaire ou de ses talents pour le gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il joignait à ces qualités un caractère aimable, des mœurs douces, une grâce inimitable à maintenir entre ses amis et lui une noble égalité. Pour les agréments extérieurs, il rappelait son frère. Mais, à peine venait-il d'achever presque entièrement la soumission des peuples germaniques auxquels il avait fait essuyer des défaites multipliées et sanglantes, que la rigueur du sort nous le ravit, à trente ans, pendant son consulat. Le poids de la guerre retomba sur Néron. Il la conduisit avec sa valeur et sa fortune accoutumées. Il parcourut, en vainqueur, la Germanie entière et, sans rien perdre de ses troupes, qu'il était attentif à ménager, il la réduisit presque au rôle de province tributaire. Alors on lui offrit un second triomphe avec un second consulat.
XCVIII. Tandis que ces événements se passaient dans la Pannonie et dans la Germanie , une guerre terrible éclatait dans la Thrace , tous les peuples de ce pays s'étant animés à prendre les armes. Mais cette guerre fut terminée par la valeur de Lucius Pison, de ce même homme si rempli de modération et de vigilance, à qui Rome doit en ce moment encore la sécurité dont elle jouit. Lieutenant de César, il fut trois ans aux prises avec les rebelles, et ce ne fut qu'à force de batailles rangées, de sièges réguliers, et par l'extermination, qu'il les réduisit au repos. Leur soumission rendit la paix à l'Asie et à la Macédoine. Reconnaissons bien haut, comme nous le pensons tous, à la louange de Lucius Pison, que son caractère est un admirable mélange de douceur et de fermeté, qu'on aurait peine à trouver un homme qui jouisse plus fermement du repos et porte avec plus d'aisance le poids des affaires, et qui, sans ostentation d'activité, fasse mieux en toute circonstance ce qu'il faut faire.
XCIX. Peu de temps après, Tibère Néron, honoré de deux consulats et de deux triomphes ; Tibère, que le partage de la puissance tribunitienne égalait à César ; Tibère, qui ne voyait au-dessus de lui qu'un seul homme, et encore parce qu'il le voulait ainsi. Tibère, le plus grand, le plus renommé, le plus heureux de tous les généraux, la seconde lumière, la seconde tête de la république, signala sa pieuse tendresse et son inexprimable attachement pour Auguste, par une conduite dont on ne tarda pas à reconnaître la cause. C. César avait pris la robe virile, Lucius, son frère, allait la prendre. Tibère craignit que l'éclat de sa gloire ne fit ombre au début des jeunes princes. Il sollicita de son beau-père la permission de se reposer de ses longs travaux, en lui laissant ignorer le vrai motif de cette demande. Je parlerai, dans un ouvrage qui permettra ces détails, de l'effet que produisit, des sentiments qu'excita le départ de ce grand homme, des larmes qui coulèrent, de l'espèce de violence que lui fit la patrie pour le retenir dans son sein. Au moins je dois dire ici, en passant, que, durant les sept années de son séjour à Rhodes, il n'y eut pas un proconsul, pas un lieutenant d'Auguste, se rendant dans les provinces au delà des mers, qui ne vînt lui rendre visite et abaisser devant lui ses faisceaux, quoiqu'il ne fût qu'un simple particulier, si jamais simple particulier eut tant de majesté : de leur aveu même, le repos de Tibère était au-dessus du pouvoir dont ils étaient revêtus.
C. Le monde sentit bientôt que le gardien de Rome s'était éloigné. Le Parthe, au mépris de son alliance avec nous, envahit l'Arménie, le Germain, sur qui son vainqueur n'avait plus les yeux, se révolta. Cependant à Rome, l'année même où le divin Auguste, consul avec Gallus Caninius, dédia le temple de Mars (il y a de cela 30 ans) et par des combats de gladiateurs, par des représentations navales, occupa l'esprit et charma les yeux du peuple romain, des désordres honteux, et tels qu'on rougit d'en rappeler la mémoire, éclatèrent au sein de sa famille. Oubliant la grandeur d'un père et d'un époux, ne mesurant sa haute fortune qu'au pouvoir de la déshonorer, et tenant pour légitime tout ce qui flattait ses désirs, Julie épuisa dans ses dérèglements ce que la dissolution a de plus infâme. Jules Antoine, un des corrupteurs de la maison de César, se punit lui-même. L'ingratitude s'ajoutait chez lui au crime car, après avoir vaincu M. Antoine, Auguste non content de sauver la vie à son fils, l'avait honoré du sacerdoce, de la préture, du consulat, du gouvernement des provinces bien plus, il l'avait admis dans son alliance la plus intime, en lui faisant épouser une fille de sa sœur. Plusieurs autres séducteurs de Julie, Quintius Crispinus, qui, sous le masque de l'austérité, cachait une dépravation sans égale, Appius Claudius, Sempronius Gracchus, Scipion, et quelques-uns encore d'un nom moins illustre, tant sénateurs que chevaliers, furent condamnés à la même peine que s'ils eussent débauché la femme d'un simple citoyen, bien que ce fût la fille d'Auguste, l'épouse de Néron qu'ils eussent corrompue. Julie, soustraite à ses parents, à sa patrie, fut reléguée dans une île. Scribonie, sa mère, l'accompagna dans son exil, qu'elle voulut partager.
CI. A quelque temps de là, C. César, après avoir parcouru plusieurs provinces, sans autre dessein que de les visiter, reçut l'ordre de marcher en Syrie. Son premier soin fut de se présenter à Tibère Néron, auquel il rendit tout ce qu'il devait à sa supériorité. En Syrie, sa conduite fut tellement, inégale qu'elle offrirait tout à la fois une ample matière aux éloges, et une non moins grande à la critique. Ce jeune homme que l'empire voyait au rang le plus élevé, eut une entrevue, dans une île de l'Euphrate, avec le roi des Parthes. Ils étaient suivis l'un et l'autre d'un cortège également nombreux. Ce grand et mémorable spectacle des deux armées couvrant de part et d : autre le rivage, au moment où s'abordèrent ces deux princes, les premières têtes des deux empires et du monde entier, j'ai eu le bonheur d'en jouir. Je faisais alors mes premières armes, en qualité de tribun des soldats, grade où j'étais parvenu sous P. Silius et sous votre père, M. Vinicius, dans la Thrace et dans la Macédoine , je vis ensuite l'Achaïe, l'Asie, toutes les provinces de l'Orient, le détroit et les deux bords de la mer Pontique et ce n'est pas sans plaisir que je me retrace le souvenir de tant d'événements, de lieux, de peuples et de villes. Le roi Parthe vint le premier s'asseoir à la table de Caïus, sur la rive que nous occupions, le lendemain, Caïus alla souper chez le roi sur la rive opposée.
CII. Un bruit courut dans ce temps-là que le roi des Parthes avait découvert à C. César les pernicieux desseins de M. Lollius, homme pétri d'artifice, qu'Auguste avait choisi pour gouverner la jeunesse de son fis. Lollius mourut peu de jours après. Sa mort fut-elle fortuite ou volontaire, c'est ce que j'ignore. Mais autant on s'en félicita, autant on déplora la perte de Censorinus, qui, vers le même temps, périt dans ces provinces. Censorinus était né pour s'attacher tous les cœurs.
L'entrée de Caïus en Arménie fut d'abord marquée par des succès mais, ce prince s'étant engagé sans précaution dans une conférence, près d'Artagère, un certain Adduus le blessa dangereusement. Dès lors, moins actif de corps, il fut, de cœur aussi, moins propre à se rendre utile à la république. Il ne manqua point de flatteurs pour entretenir ses vices par leurs discours complaisants car l'adulation marche toujours à la suite d'une haute fortune. Ils l'amenèrent à ce point, de mieux aimer vieillir dans un coin éloigné du monde, que de retourner à Rome. Cependant il en avait repris le chemin après une longue résistance et malgré lui mais il tomba malade en route, et mourut à Limyre, ville de Lycie. Un an auparavant, Lucius son frère, était mort à Marseille, en allant en Espagne.
CIII. Mais la fortune, qui moissonnait les espérances attachées à ce grand nom, avait déjà rendu à la république son véritable support. Tibère Néron était revenu de Rhodes avant la mort des jeunes Césars, sous le consulat de P. Vinicius, et sa présence avait excité dans Rome la joie la plus vive. Auguste n'hésita pas longtemps. Il était dispensé de se chercher un successeur : il n'avait qu'à prendre celui qui se distinguait entre tous. Il persista donc à vouloir faire, après qu'il eut perdu ses deux fils, ce qu'il aurait fait quand l'un d'eux vivait encore, sans la vive résistance de Tibère : il l'associa à la puissance tribunitienne, quoique Tibère persévérât dans ses refus, tant en particulier qu'en plein sénat, et l'adopta, sous le consulat d'Élius Catus et de Sentius, le vingt-septième jour du mois de juin, l'an de Rome 754, il y a vingt-sept ans.
Je n'essayerai pas de perdre l'allégresse de cette journée, le conc ours de Rome entière, élevant, dans l'ardeur de ses vœux, ses mains jusque dans le ciel, tous les cœurs remplis de l'espérance de la perpétuité de la paix et de l'éternité de l'empire : comment resserrer ici des détails auxquels suffirait à peine le grand ouvrage que je prépare? Je dirai seulement que Tibère fut tout pour tous : alors, pères, époux, propriétaires n'eurent plus rien à craindre pour leurs enfants, leurs femmes, leurs biens, tous les citoyens furent rassurés sur leur vie, leur repos, leur tranquillité. Il eût été difficile de concevoir de plus belles espérances, impossible de les mieux justifier.
CIV. Le même jour fut adopté aussi M. Agrippa, fils de Julie et d'Agrippa, né après la mort de son père. Seulement, en faisant l'adoption de Tibère, Auguste avait prononcé ces mots significatifs : « Celle-la, je la fais pour l'État. »
Rome ne retint pas longtemps dans ses murs le vengeur, le défenseur de l'empire. L'intérêt de la patrie rappelait en Germanie, où s'était allumée, depuis plus de trois ans, une guerre affreuse, sous le consulat de M. Vinicius, votre illustre aïeul. Vinicius l'avait habilement conduite dans quelques provinces, dans quelques autres, il en avait heureusement soutenu l'effort. Aussi lui décernat-on les ornements du triomphe, avec une inscription glorieuse qui rappelait ses exploits.
Ce fut alors qu'après avoir rempli les fondions de tribun militaire, j'entrai dans l'armée que commandait Tib. César envoyé, aussitôt après son adoption, en Germanie. Successeur de mon père dans le grade de commandant de la cavalerie, je fus pendant neuf ans de suite, soit en cette qualité, soit comme lieutenant des troupes de César, le témoin de ses actions plus qu'humaines et dans la mesure de ma faiblesse, je ne laissai pas d'y contribuer. Il me fut ainsi donné de jouir du plus beau spectacle qu'un mortel puisse être admis à contempler. Pendant notre marche à travers les parties les plus peuplées de l'Italie et la Gaule entière, les peuples heureux de voir leur ancien général, longtemps César par ses services et ses vertus, avant d'en porter le nom, se félicitaient de sa présence, plus encore pour eux-mêmes que pour lui. Pour les soldats, à l'aspect de Tibère, des larmes de joie mouillaient leurs yeux. Ils tressaillaient d'allégresse, ils le saluaient avec des transports toujours nouveaux, c'était à qui toucherait ses mains, et partout ce cri leur échappait : « Nous vous revoyons donc, général! vous nous êtes donc rendu ! Général, s'écriait l'un, j'ai fait la guerre avec vous en Arménie, moi, disait un autre, dans la Rhétie , moi j'ai été récompensé par vous dans la Vindélicie ; — moi, dans la Pannonie ; — moi, dans la Germanie. » Les paroles sont impuissantes à rendre une telle scène. Peut-être même paraîtra-t-elle invraisemblable.
CV. On entra sur-le-champ en Germanie. Les Caninéfates, les Attuaires, les Bructères furent soumis, les Chérusques remis sous le joug. Le Veser fut franchi, le Veser, que la défaite d'une ar mée romaine allait bientôt rendre fameux. On pénétra même au delà, dans l'intérieur du pays. César se réservait les difficultés et les dangers. Il abandonnait les expéditions moins périlleuses à Sentius Saturninus, qui, dans ces mêmes lieux, avait été lieutenant d'Auguste. Mille qualités distinguaient Saturninus. Il était plein d'ardeur, d'activité, de prévoyance, habile à la guerre, et sachant en supporter les fatigues mais, dès que les travaux lui laissaient du loisir, il en jouissait somptueusement et jusqu'à l'excès, non pas toutefois comme un ami de la débauche ou de la paresse, mais en homme aimable et magnifique. J'ai parlé plus haut de son important et célèbre consulat.
La continuation de la campagne, qui se prolongea jusqu'en décembre, ajouta beaucoup aux avantages de ces immenses succès. La pieuse tendresse de César pour les siens le rappelait à Rome. Il traversa les Alpes, dont le passage était presque fermé par les glaces. Mais, au commencement du printemps, la défense de l'Empire le ramena en Germanie. Avant son départ, il avait établi ses troupes en quartiers d'hiver, au milieu de ce pays, à la source de la Lippe.
CVI. Dieux immortels! combien de pages fournirait à l'histoire tout ce qui fut fait, dans le cours de la campagne suivante, sous les ordres deTibère! Toute la Germanie parcourue par nos armes, des peuples presque inconnus, soumis, les Cauques ramenés sous le joug, toute leur jeunesse innombrable, de taille colossale, défendue par des positions inexpugnables, mettant bas les armes, et venant, chefs en tête, se prosterner devant le tribunal de César, au milieu de nos soldats étincelant sous leurs armures, les Longobards, plus farouches et plus sauvages encore que les Germains, domptés, enfin — ce qu'on n'avait pas encore tenté, ce qu'on n'osait pas même espérer l'armée romaine conduite, enseignes déployées, à la distance de quatre cents milles, depuis le Rhin jusqu'à l 'Elbe, qui baigne les frontières des Semnones et des Hermundes et là, grâce à la fortune du général, à la sagesse de ses dispositions, à l'exactitude de ses calculs, la flotte, après avoir côtoyé les golfes de l 'Océan, et traversé une mer inexplorée et inconnue, entrant dans l 'Elbe, et venant rejoindre César, chargée de butin et de provisions, et victorieuse de plusieurs peuplades!
CVII. Je vais raconter un fait d'un moindre intérêt mais je ne puis me défendre de le mêler au récit de ces grands événements. Nous étions campés en deçà du fleuve, vis-à-vis des ennemis dont les armes resplendissaient sur l'autre rive, et qui semblaient prêts à fuir au moindre mouvement de nos vaisseaux. Un Barbare, vieillard de haute taille, et à en juger par l'extérieur, d'un rang éminent parmi les siens, monté sur un canot fait d'un tronc d'arbre creusé suivant l'usage du pays, et gouvernant seul cette espèce d'embarcation, s'avança jusqu'au milieu du fleuve. Là, il demanda qu'on lui permît d'aborder, sans péril, au rivage que nous occupions en armes, et de voir César. Ce qui lui fut accordé. Il descendit à terre, contempla longtemps César puis, rompant le silence : « Notre jeunesse est insensée, » dit-il; « de loin, elle vous honore comme des Dieux à peine êtes-vous là qu'elle aime mieux redouter vos armes que de se livrer à votre protection. Pour moi, César, qui dois à ta bonté la permission de voir aujourd'hui les Dieux dont j'avais seulement ouï parler, je déclare que je n'ai jamais souhaité ni vu luire, dans toute ma vie, un jour plus heureux que celui-ci.» Puis ayant demandé et obtenu la faveur de toucher la main du général, il remonta dans sa nacelle, et, les yeux fixés sur César sans pouvoir les détacher, il regagna l'autre rive.
Vainqueur de tous les peuples et de tous les pays où il avait pénétré, Tibère ramena ses légions dans leurs quartiers d'hiver, elles n'avaient éprouvé aucune perte : une seule fois, l'ennemi les avait attaquées par surprise, et sa ruse lui avait coûté cher. Puis, comme l'année précédente, il revint en toute hâte à Rome.
CVIII. II n'y avait plus rien à vaincre en Germanie que les Marcomans, peuple, qui, sous la conduite de Maroboduus, avait déserté ses anciennes demeures, et s'étant avancé dans l'intérieur du pays, était venu habiter les plaines entourées par la forêt d'Hercynie. Quelque pressé que je sois, je ne dois pas me taire sur un homme tel que Maroboduus. Son origine était distinguée, sa force peu commune, son âme fière et courageuse. Barbare par sa naissance, mais non par son génie, il jouissait parmi les siens d'un pouvoir régulier et solide qu'il ne devait ni au désordre, ni au hasard, ni à la faveur d'un instant, mais à la volonté arrêtée de ses concitoyens. Jaloux de rendre cette domination souveraine et de lui donner les caractères de la royauté, il avait éloigné sa nation du peuple romain, et résolu de la transporter en des lieux où, sans avoir à craindre des armes trop redoutables, il put faire redouter les siennes. S'étant donc établi dans le pays, favorable à ses vues, que j'ai indiqué plus haut, il assujettit tous ses voisins, les uns par la force, les autres par des traités.
CIX. Une garde veillait à la sûreté de sa personne. Le soin qu'il prenait d'exercer continuellement ses troupes, presque disciplinées à la manière des Romains, accrut bientôt ses forces au point de les rendre inquiétantes pour l'empire. Sa politique à l'égard de Rome était de ne la point provoquer, mais de faire sentir que, provoqué lui-même, il avait, et au delà, les moyens et la volonté de se défendre. Les ambassadeurs qu'il envoyait à nos Césars, tantôt parlaient en suppliants, tantôt traitaient de puissance à puissance. Tout peuple qui se séparait de nous trouvait près de lui un asile, une prétention de rivalité enfin perçait à travers les voiles de sa dissimulation. Il entretenait une armée de soixante et dix mille hommes de pied et de quatre mille chevaux et, comme il l'occupait sans cesse contre ses voisins, il semblait avoir des desseins plus ambitieux. La situation de ses États le rendait encore plus redoutable. Il avait à sa gauche et de front, la Germanie , à sa droite, la Pannonie , derrière lui, le pays des Noriques et de là, toujours menaçant de fondre sur tous, il était craint de tous. L'Italie même n'était pas en sûreté contre ses envahissements, puisque le sommet des Alpes, qui en marque la limite, n'était éloigné que de deux cent mille pas des plus proches frontières de son royaume.
Tel est l'homme, tel est le pays que Tibère résolut d'attaquer de plusieurs côtés à la fois, dans le cours de l'année suivante. Il ordonna donc à Sentius Saturninus de faire traverser aux légions le pays des Cattes, et de les conduire en Bohême, où régnait Maroboduus, après avoir rasé la forêt d'Hercynie attenante à ce pays. Lui-même il se proposait de partir de Carnonte, la ville la plus voisine du royaume des Noriques de ce côté, et de conduire contre les Marcomans l'armée qui servait en Illyrie.
CX. La fortune renverse quelquefois les projets des hommes ; quelquefois elle ne fait qu'en retarder l'exécution. Tibère avait déjà disposé ses quartiers d'hiver le long du Danube. Ses légions se trouvaient à cinq journées des premiers corps ennemis : il voulait que Saturninus se réunit à lui, et l'armée de ce général, qui n'était guère plus éloignée de l'ennemi, s'ébranlait déjà pour opérer quelques jours après, sur un point convenu, sa jonction avec César, lorsque la Pannonie tout entière, enflée des avantages d'une longue paix, et la Dalmatie , arrivée à la maturité de ses forces, attirèrent dans leur ligue tous les peuples de ces contrées, et prirent les armes à la fois.
Il fallut sacrifier la gloire à la nécessité. Il ne parut pas prudent de tenir l'armée enfermée dans l'intérieur du pays, et de laisser l'Italie livrée sans défense à l'invasion d'un ennemi si voisin. Le nombre des révoltés de ces différentes nations ne s'élevait pas à moins de huit cent mille. On y complaît deux cent mille hommes de pied exercés aux combats, et neuf mille chevaux. Cette multitude immense obéissait à des chefs habiles et pleins d'ardeur. Une partie devait se porter sur l'Italie, qui, par la frontière de Nauport et de Trieste, touche aux lieux qu'ils occupaient. Une autre partie s'était déjà jetée dans la Macédoine. Le reste avait été réservé, pour la garde du pays. Le commandement était partagé entre Pinète et les deux Baton. Et la connaissance de la discipline, et même de la langue des Romains, était répandue chez tous les Pannoniens. Bien plus, ils avaient généralement, une certaine culture littéraire el n'étaient pas étrangers aux exercices de l'esprit. Aussi jamais nation ne passa-t-elle aussi rapidement du conseil au champ de bataille, et de la résolution à l'exécution.On fît main basse sur les citoyens Romains, on égorgea les marchands, on extermina jusqu'au dernier homme un corps nombreux de soldats vexillaires postés dans des quartiers fort éloignés du général. On envahit la Macédoine. Tout fut la proie du fer et du feu. Et telle fut l'épouvante, que l'âme d'Auguste, cette âme si ferme, et que des guerres si terribles avaient trempée, en fut ébranlée et terrifiée.
 |
 |
 |
 |
|---|
CXI. On fit des levées. On rappela de tous côtés les vétérans. Tous, hommes et femmes, furent tenus, suivant leur fortune, de fournir des soldats pris dans le nombre de leurs affranchis. On entendit Auguste dire, en plein sénat, que, si les mesures n'étaient promptes, l'ennemi pouvait être en vue de Rome dans dix jours. On exigea que les sénateurs et les chevaliers remplissent, en cette occasion, les engagements qu'ils avaient pris. Mais toutes ces dispositions eussent été vaines, sans un chef habile. La république demanda Tibère à César Auguste pour conduire la guerre, comme la force et l'appui de l'armée. Un glorieux emploi fut encore accordé, dans cette guerre, à mon faible mérite. Désigné questeur à la fin de mon service dans la cavalerie, élevé au rang de sénateur, sans en avoir le titre, et désigné en outre tribun du peuple, je conduisis, de Rome au camp de Tibère, une partie de l'armée qu'Auguste m'avait confiée puis, renonçant à mon droit de tirer comme questeur, une province au sort, je fus renvoyé vers Tibère en qualité de lieutenant.
Combien de fois nous vîmes, dans la première campagne, les ennemis présenter la bataille! Combien de fois nous dûmes à la sagesse de notre chef le bonheur d'échapper, en les divisant, au choc furieux de leurs forces réunies! Comme il sut ménager à la fois les intérêts et la gloire de l'Empire ! Avec quelle prudence il disposa les quartiers d'hiver! Qu'il montra d'habileté, lorsqu'il enferma l'ennemi, de manière à ce qu'il ne pût nous échapper, et que, manquant de tout, il consumât ses forces contre lui-même !
CXII. Un fait d'armes hardi et heureux, accompli, par Messalinus dans cette première campagne mérite d'être connu de la postérité. Plus noble encore de cœur que de naissance, et bien digne d'avoir Corvinus pour père et de laisser son surnom à Cotta son frère, Messalinus commandait en Illyrie, quand la rébellion éclata tout à coup. Entouré d'ennemis et n'ayant à leur opposer que la moitié de la vingtième légion, il battit et mit en fuite plus de vingt mille hommes. Les ornements du triomphe furent sa récompense.
Les Barbares se complaisaient dans la pensée de leur nombre et comptaient sur leurs forces mais, partout où se trouvait César, ils perdaient cette assurance. La partie de leur armée qui faisait tête au général, consumée par la détresse à laquelle nous la réduisions, menacée d'ailleurs de succomber à la famine, et n'osant ni soutenir nos assauts ni accepter la bataille, se retira sur le mont Claudius et s'y retrancha. Mais celle de leurs troupes qui s'était portée à la rencontre de l'armée que les consulaires A. Cécina et Silvanus Plautius ramenaient des provinces d'outremer, enveloppa cinq légions romaines, les auxiliaires et le nombreux renfort de cavalerie que le roi des Thraces Rhémetalcès leur avait fourni comme secours. Peu s'en fallut que le désastre ne fût complet. La cavalerie royale et les deux ailes furent mises en déroute. Les cohortes tournèrent le dos ; l'alarme pénétra jusqu'autour de nos enseignes. Mais la valeur du soldat romain s'assura en cette conjoncture une gloire à laquelle les chefs n'eurent point de part, puisque, bien loin d'imiter la prudence du général, les chefs s'étaient laissé surprendre, faute d'avoir envoyé à temps reconnaître l'ennemi. Le moment avait été critique. Un certain nombre de tribuns militaires, le préfet du camp, les commandants des cohortes étaient tués, plusieurs centurions blessés, les premières lignes renversées : nos légions, après s'être elles-mêmes mutuellement encouragées, fondirent sur l'ennemi, soutinrent sa résistance, rompirent ses rangs, et, finirent contre toute espérance, par lui arracher la victoire. Vers ce même temps, le jeune Agrippa, que son aïeul avait adopté le même jour que Tibère, et qui, depuis deux ans, se montrait tel qu'il était, s'aliéna le cœur d'Auguste, son aïeul et son père. Une âme perverse, un esprit déréglé le précipitèrent dans les abîmes, et bientôt ses vices croissant de jour en jour, il eut une fin digne de son aveuglement.
CXIII. Celui que vous voyez si grand prince pendant la paix, M. Vinicius, vous l'allez voir non moins grand général à la tête des armées. Après la jonction opérée entre les auxiliaires et les troupes qui marchaient sous les ordres de César, le même camp réunit dix légions, plus de soixante et dix cohortes, quatorze escadrons de cavalerie et au moins dix mille vétérans, sans parler d'un grand nombre de volontaires et de cavaliers royaux. C'était l'armée la plus considérable qu'on eût mise sur pied, depuis les guerres civiles. La joie remplissait tous les cœurs, on fondait sur ce grand nombre l'espérance de la victoire. Mais le général, meilleur juge que qui que ce soit de ce qu'il y avait à faire, préféra l'utile à ce qui n'était que brillant et, comme je l'ai vu dans toutes les guerres, plus jaloux de mériter l'approbation que de l'obtenir d'une manière telle quelle, il prit le parti de congédier une multitude dont il était difficile de régler les mouvements, et qui lui paraissait peu propre à se laisser conduire. Il retint seulement les auxiliaires, pendant quelques jours, afin qu'ils pussent se refaire des fatigues d'une longue marche. Ensuite, il les escorta bien loin, avec son armée, par des chemins si pénibles, qu'on peut à peine en donner une idée.ll voulait à la fois, en présentant à l'ennemi la masse de ses forces réunies, lui ôter l'idée de l'attaquer, et empêcher, en faisant craindre à chacun une invasion sur ses frontières, un coup de main sur un corps séparé. Après avoir ainsi ramené cescorps dans leur cantonnement, il revint à Siscia dans les premiers jours de l'hiver, qui fut très rigoureux. Il y distribua les quartiers entre ses lieutenants, au nombre desquels j'étais.
CXIV. Le détail que je veux dire n'a rien de brillant mais que la chose est grande par la solide et vraie vertu dont elle offre l'utile exemple, par l'humanité dont elle témoigne, par le bonheur de ceux qui en ont ressenti les effets ! Pendant toute la durée de la guerre de Germanie et de Pannonie, aucun de nous, soit au-dessus, soit au-dessous de mon grade, n'eut à se plaindre de l'altération de sa santé, sans que César lui fil donner les soins les plus empressés. On eût dit que sa grande âme déposait l'immense fardeau des affaires, pour se livrer exclusivement à ce soin. Une voiture était toujours prête pour ceux qui en avaient besoin. Sa litière appartenait à tous, et j'en ai profité, comme beaucoup d'autres. Ses médecins, sa cuisine, son appareil de bain transporté seulement pour cet usage, servaient à tout homme malade. On n'avait pas là sa maison ni ses domestiques, mais rien ne manquait de ce qu'on eût pu attendre ou désirer de leur service.
Je dois ajouter encore une chose dont tous ceux qui faisaient partie de l'armée, dans cette campagne, reconnaîtront aussi l'exactitude. Tibère était le seul qui voyageât toujours à cheval ; seul, il mangea assis, durant presque toute l'expédition, avec ceux qu'il avait admis à sa table. Il pardonnait une infraction aux lois de la discipline, quand l'exemple ne pouvait être nuisible. Il n'épargnait ni les avi s, ni les réprimandes. Les punitions étaient rares. Par un sage tempérament, il fermait les yeux sur beaucoup de fautes, il en châtiait quelques-unes. L'hiver produisit les avantages d'une guerre terminée, et l'été suivant, toute la Pannonie demanda la paix. La guerre s'était concentrée en Dalmatie. J'espère pouvoir un jour développer, le récit complet de ces événements. Je montrerai cette foule innombrable de jeunes et fiers guerriers, qui menaçaient la liberté de l'Italie, déposant, sur les bords du fleuve Bathinus leurs armes devenues inutiles, et se prosternant aux pieds du général, je dirai comment, de leurs deux chefs, Baton et Pinè te, Germains d'une haute stature, l'un fut fait prisonnier, et l'autre se livra lui-même. Au retour de l'automne, l'armée victorieuse rentra dans ses quartiers d'hiver. Tibère donna le commandement de toutes les troupes à M. Lepidus, général que sa réputation et sa fortune rapprochaient des Césars ; homme qu'on admire et qu'on aime d'autant plus qu'on le connaît davantage, et qu'on regarde comme ajoutant un nouveau lustre aux grands noms de ses ancêtres.
CXV. César avait à soutenir le poids d'une autre guerre. Il tourna ses vues et ses forces du côté de la Dalmatie. Avec quel zèle Magius Celer Velleianus, mon frère, son lieutenant, le servit, dans ce pays, les éloges de Tibère et ceux d'Auguste son père l'attestent, et les brillantes récompenses qu'il reçut, au moment du triomphe de César, en ont consacré le souvenir. Au commencement de l'été, l'armée sortit de ses quartiers, sous les ordres de Lepidus. Il fallait, pour atteindre César, traverser des régions que la guerre n'avait pas entamées, et dont les habitants, qui n'en connaissaient pas les fléaux, étaient pleins d'un orgueil farouche : après une lutte pénible contre des chemins impraticables et des ennemis, à qui leur résistance coûta cher - leurs champs furent dévastés, leurs habitations brûlées, leurs troupes massacrées,- Lepidus, satisfait de sa victoire et chargé de butin, rejoignit Tibère. Le triomphe était dû sans doute à ses exploits, s'il les eût accomplis sous ses propres auspices : le suffrage des armées d'accord avec le sénat lui en fit accorder les ornements. Les effets de cette guerre terrible cessèrent avec la campagne. Des lieux difficiles, un pays montueux, des esprits opiniâtres, une merveilleuse pratique de la guerre, et surtout les gorges de leurs forêts, rendaient presque inexpugnables les Perustes et les Desitiates, peuples de la Dalmatie. Pour les subjuguer, il fallut les détruire presque entièrement. César en vint à bout, non pas seulement en dirigeant contre eux les opérations de son armée, mais en combattant lui-même les armes à la main. Ce que j'ai vu de plus grand, ce qui m'a le plus frappé dans le cours de cette guerre et dans la campagne de Germanie, c'est qu'une occasion de vaincre l'ennemi ne parut jamais si belle à Tibère, qu'il voulût acheter la victoire au prix du sang de ses soldais : à ses yeux, le parti le plus sûr était toujours le plus honorable, il consultait son cœur avant de penser à sa gloire ; jamais le chef ne se réglait sur l'opinion de l'armée, toujours l'armée fut conduite par la sagesse du chef.
CXVI. Germanicus qui avait reçu l'ordre de précéder Tibère en Dalmatie, eut à traverser bien des lieux difficiles, et y donna de grandes preuves de valeur. Le consulaire Vibius Postumus, qui gouvernait cette province, mérita aussi les ornements du triomphe, par son zèle et sa vigilante activité. Quelques années auparavant, deux hommes, que des mérites différents rendaient recommandables, Passienus et Cossus, avaient obtenu les mêmes honneurs en Afrique. Cossus, transmit à son fils, jeune homme né pour tous les genres de mérite, un surnom qui rappelait sa victoire. L. Apronius prit part aux actions de Postumus, et le courage qu'il déploya dans cette expédition lui donna des droits aux récompenses qui lui furent ensuite accordées. La fortune a une grande part dans la distribution de ces récompenses et plût aux dieux qu'elle n'eût jamais donné de sa puissance de plus frappants témoignages! Élius joignait à des mœurs antiques une âme douce qui tempérait en lui la gravité des premiers Romains. La Germanie , l'lllyrie, l'Afrique l'avaient vu remplir les emplois les plus éclatants. Il avait tous les titres aux honneurs du triomphe, l'occasion d'y atteindre lui manqua. Citons encore A. Licinius Nerva Silianus, fils de P. Silius. Tel était son mérite, que ceux même qui n'en ont pas compris l'étendue, ne laissent pas néanmoins de l'admirer : il doit au moins à cette renommée de n'avoir pas tout perdu, cet excellent citoyen, ce général si modeste, à qui une mort prématurée ravit les avantages de la glorieuse amitié du prince, et le bonheur de s'élever à la haute fortune que son père avait atteinte et dont la perspective le flattait.
J'ai cherché, dira-t-on, à parler de ces deux hommes, et j'en conviens. Un jugement impartial et sincère ne saurait être un crime aux yeux des gens de bien.
CXVII. César venait de terminer la guerre contre les Panno niens et les Dalmates. Cinq jours après la consommation de cette œuvre importante, il arriva de Germanie de funestes nouvelles. Elles annonçaient la mort de Varus, le massacre de trois légions, de trois corps de troupes à cheval et de six cohortes. Grâces soient du moins rendues à la fortune, de ce que d'autres guerres n'occupaient point alors le courage de Tibère. Mais je dois m'arrêter un moment sur la personne de Varus et la cause de sa défaite.
Issu d'une famille illustrée plutôt que noble, Quintilius Varus était d'un caractère doux, de mœurs tranquilles. Une certaine paresse de corps et d'esprit le rendait plus propre au repos d'un camp qu'aux fatigues de la guerre. Il ne méprisait P as l'argent, on le vit dans son gouvernement de Syrie : entré pauvre dans la province qui était riche, il en sortit riche et la laissa pauvre. Mis à la tête de l'armée de Germanie, Varus se persuada que les Germains n'avaient, de l'espèce humaine que la figure et la parole, et que ceux que le fer n'aurait pu dompter céderaient à la douce autorité des lois. Rempli de cette idée, il s'engagea au cœur de la Germa nie et là, comme au milieu d'un peuple jouissant des douceurs de la paix, il passait à rendre la justice et à juger des procès, du haut d'un tribunal, le temps de la campagne.
CXVIII. Cependant les Germains, peuple né pour le mensonge, et alliant la ruse à la férocité, à un point dont on ne saurait se faire une idée qu'après expérience, simulaient entre eux de per pétuels procès, se provoquaient les uns les autres, témoignaient leur reconnaissance de voir la justice des Romains accommoder leurs différends, leur apreté sauvage s'adoucir par cette nouvelle espèce de gouvernement, et leurs querelles, jusque-là vidées par les armes, se terminer par le droit. Ils endormirent ainsi Varus qui en vint à se regarder comme un préteur urbain jugeant au forum, et non plus comme un chef commandant une armée romaine au sein de la Germanie.
Alors un jeune homme de noble race, brave, intelligent, d'une vivacité d'esprit qu'on n'eût point attendue d'un barbare, et qui portait dans ses yeux et sur son visage tout le feu de son âme, Arminius, noble fils de Sigimer, le plus considérable de la nation des Gattes, qui avait fidèlement servi dans nos rangs, dans la campagne précédente, et qui avait même obtenu le droit de cité et le rang de chevalier, profita de l'imprévoyance de Varus pour tramer un dessein perfide, fondé sur cette sage observation que l'homme le plus facile à surprendre est celui qui ne se défie de rien, et que la cause la plus ordinaire des catastrophes, c'est la sécurité.
Ne confiant d'abord ses desseins qu'à un petit nombre d'amis, bientôt il s'adjoint un plus grand nombre de complices. Il leur répète, il leur persuade, qu'il est possible d'accabler les Romains. L'effet suit de près la résolution, et le moment d'une embuscade est fixé. Cependant un Gatte fidèle et distingué, nommé Ségeste, dénonce le complot à Varus. Mais déjà la destinée égarait ses esprits et avait mis un bandeau sur ses yeux. Ainsi arrive-t-il trop souvent : le Ciel pervertit les pensées de ceux qu'il veut renverser et ce qui met le comble à leur misère, leur infortune paraît être leur ouvrage, et les coups du sort leur sont imputés à crime. Varus refusa de croire au rapport de Ségeste, déclarant que les services qu'il rendait aux Germains lui répondaient de leurs bons sentiments, il n'eut pas le temps, le premier avis négligé, d'en recevoir un second.
CXIX. J'essayerai ailleurs de raconter tout au long, ainsi que d'autres l'ont fait, les circonstances du plus affreux désastre que Rome ait essuvé en terre étrangère, depuis le désastre de Crassus chez les Parthes. Je n'en veux aujourd'hui que déplorer le résultat. L'armée la plus brave, la plus aguerrie, la mieux disciplinée, la première des armées romaines, victime de la mollesse de son chef, de la perfidie de l'ennemi, de l'iniquité de la fortune, enfermée dans des bois et des marécages, prise au piège, fut exterminée par ceux-là mêmes que tant de fois elle avait égorgés comme de vils troupeaux, et dont la vie et la mort étaient à la merci de sa colère ou de sa pitié, sans que les malheureux soldats eussent seulement la possibilité de disputer honorablement leur vie : plu sieurs d'entre eux furent même châtiés pour avoir fait usage de leurs armes et s'être conduits en Romains.
Varus eut plus de courage pour mourir qu'il n'en avait eu pour combattre. A l'exemple de son père et de son aïeul, il se perça de son épée. De ses deux préfets militaires, L. Eggius et Ceionius, autant l'un s'honora par sa conduite, autant l'autre s'avilit par sa lâcheté. La plus grande partie de l'armée romaine ayant péri dans le combat, Ceionius proposa de se rendre, et préféra l'opprobre du supplice à la gloire de mourir les armes à la main. Vala Numonius, lieutenant de Varus, homme d'ailleurs doux et honnête, donna aussi l'exemple le plus funeste. Il essaya de gagner le Rhin avec la cavalerie qu'il commandait, et laissa l'infanterie privée de secours. La fortune l'en punit. Il ne survécut point à ceux qu'il avait trahis, et périt avec la honte de sa trahison. Les barbares mirent en pièces le corps de Varus à demi brûlé. Puis ils lui coupèrent la tète et la portèrent à Maroboduus. Auguste, à qui celui-ci l'envoya, la fit placer avec tous les honneurs de la sépulture dans le tombeau de sa famille.
CXX. A ces tristes nouvelles, Tibère revole auprès d'Auguste. Vengeur accoutumé de l'Empire, il en prend en mains la défense. Il part pour la Germanie , affermit la tranquillité des Gaules, distribue les armées, fortifie les places de guerre. Bientôt, rassuré par le sentiment de sa force contre l'orgueil d'un ennemi présomptueux qui menaçait d'inonder l'Italie, comme autrefois les Cimbres et les Teutons, il passe le Rhin à la tête de ses légions, porte la guerre chez des peuples qu'Auguste et Rome se fussent contentés de voir arrêtés, pénètre au cœur du pays, s'ouvre des chemins nouveaux, dévaste les campagnes, embrasse les habitations, renverse tout ce qui s'oppose à son passage, et, couvert de gloire, ramène dans leurs quartiers tous ceux qu'il avait conduits au delà du fleuve.
Payons à L. Asprenas le tribut qu'il mérite. Lieutenant et neveu de Varus, il sut, soutenu par le courage et l'énergie des deux légions qu'il commandait, préserver une armée romaine du plus grand des revers puis, descendant avec rapidité vers les quartiers du bas Rhin, il retint dans le devoir les peuples placés en deçà du fleuve, dont la fidélité chancelait. Avouons-le pourtant, s'il sauva la vie d'une partie de ses soldats, on dit qu'il s'appropria l'or de ceux que les vainqueurs de Varus avaient massacrés, et qu'il s'adjugea tout à son aise l'héritage de l'armée détruite.
Louons aussi la valeur du préfet militaire Lucius Cédicius, et de ceux qu'une immense armée de Germains tenait assiégés, comme lui, dans les murs d'Alison. Malgré les difficultés d'une situation qu'un manque absolu de toutes choses rendait intolérable, malgré la force invincible des assiégeants, avec une prudence égale à leur hardiesse, ils épièrent l'occasion, la saisirent et se frayèrent une voie, le fer à la main, pour rejoindre leurs compagnons. Rien ne prouve mieux que, si Varus, homme d'ailleurs fort estimable et animé des meilleures intentions, se perdit avec une armée magnifique, c'est que la sagesse manqua au chef, plutôt que la valeur à ses soldats. Les Germains traitaient leurs prisonniers avec la dernière rigueur : Caldus Celius, homme digne de sa noble race, échappa à leur cruauté par un acte héroïque. Saisissant les anneaux de sa chaîne, il s'en frappa la tête avec tant de violence qu'il fit jaillir du même coup son sang et sa cervelle, et rendit l'âme.
CXXI. La valeur de César et sa fortune ne brillèrent pas moins dans ses dernières campagnes que dans les premières. Il avait affaibli l'ennemi sur terre et sur mer, réglé l'importante pacification des Gaules, arrêté, ce qui valait mieux que de les punir, les dissensions allumées entre les Viennois : le sénat et le peuple romain, sur le désir exprimé par Auguste, déclarèrent qu'il jouirait, dans toutes les provinces et sur les armées, d'un pouvoir égal à celui d'Auguste lui-même. En effet, il était étrange que les provinces qu'il défendait ne lui fussent pas soumises, et qu'on ne jugeât pas digne de partager les premiers honneurs celui qui était le premier à voler au secours de la patrie. De retour à Rome, il triompha des Pannoniens et des Dalmates : honneur depuis longtemps dû à ses victoires, mais que la suite ininterrompue de ses guerres avait fait différer. On ne s'étonnera point de la magnificence qui y fut déployée: c'était César qui triomphait. Mais comment ne pas admirer cette faveur de la fortune? avant qu'on sût par la renommée que les principaux chefs des ennemis n'avaient pas été tués, le triomphe les montra tous enchaînés. Mon frère et moi, nous eûmes l'honneur d'accompagner le triomphateur, au milieu d'une foule de citoyens du plus haut rang et décorés des premières distinctions militaires.
CXXIl. Entre autres preuves de la modération dont Tibère a
donné l'éclatant témoignage, qui ne l'admirerait surtout de s'être
contenté de trois triomphes, au lieu de sept qu'il avait incontestablement mérités? Qui peut douter, en effet, que l'Orient pacifié,
l'Arménie reconquise et placée sous les lois d'un prince qu'il avait
couronné de ses propres mains, ne l'eussent rendu digne, de l'ovation? Sa victoire sur les Rhètes et les Vindéliciens, ne lui donnait-elle pas le droit d'entrer dans Rome sur un char de triomphe?
La même récompense ne lui était-elle pas due et pouvait-il s'y
refuser, lorsque, après son adoption, il eut, dans une campagne de
trois ans, brisé les forces de la Germanie ? Et la vengeance du désastre de Varus dans une expedition si heureusement rapide , la
ruine de la même Germanie ne lui donnaient-elles pas encore droit
au triomphe? Mais on ne sait ce qu'on doit admirer le plus en Tibère, de son ardeur sans réserve dans les travaux et les périls, ou
de sa réserve dans la recherche des honneurs.
 |
 |
 |
 |
|---|
CXXIII. Nous arrivons à une époque de vives alarmes. Auguste venait d'envoyer Germanicus, son petit-fils, en Germanie, pour y terminer la guerre. Il allait envoyer Tibère, son fils, en Illyrie, afin d'affermir ses conquêtes par la paix. Le désir de raccompagner, et l'idée d'assister à des combats d'athlètes que Naples avait institués en son honneur, déterminèrent ce prince à s'avancer jusque dans la Campanie. Un affaiblissement sensible l'avait déjà averti du déclin de sa santé mais, son courage lui prêtant des forces, il suivit son fils jusqu'à Bénévent, d'où il se rendit à Noles. Là, le mal empira de jour en jour, et, sachant bien quel était celui qu'il devait appeler, s'il voulait que les choses demeurassent dans l'état heureux où sa mort les laissait, il manda son fils en toute hâte. Plus prompt encore qu'on ne l'attendait, Tibère revint auprès du père de la patrie. César déclara alors qu'il était tranquille, et pressant dans ses bras son cher Tibère, il lui recommanda le soin de ses œuvres, qui étaient aussi les siennes et dit qu'il était prêt à quitter la vie, si les destins la lui redemandaient. La présence et l'entretien de Tibère parurent un moment ranimer ses esprits mais le mal était sans remède. Sa dépouille alla rejoindre les éléments dont elle était sortie, et il rendit son âme divine aux Dieux. C'était sous le consulat de Pompée et d'Apuleius ; il avait soixante-seize ans.
CXXIV. Quel fut l'effroi de Rome et du monde, quelle fut l'agitation du sénat, la confusion du peuple, et combien près nous parûmes toucher à notre perte, nul ne saurait l'exprimer, ni celui qui, tel que moi, retrace les faits en courant, ni même un historien moins pressé. Ce que je puis dire, de l'aveu de tous, c'est qu'une ville qu'on s'attendait à voir bouleversée n'éprouva pas la plus légère commotion. L'autorité d'un seul homme fut si puissante, qu'il ne fut besoin de recourir aux armes ni pour soutenir les bons citoyens, ni pour réprimer les méchants. Rome fut témoin d'une seule lutte, entre César, le sénat et le peuple romain, ceux-ci désirant que Tibère prit la place de son père, et le fils d'Auguste demandant à vivre en citoyen, au sein de l'égalité. Cependant il finit par se laisser vaincre par la raison, bien plus que par l'attrait des honneurs, quand il eut reconnu que tout ce qu'il ne prendrait pas en ses mains, était menacé de périr. Il n'est arrivé qu'à lui d'avoir combattu plus longtemps, pour ainsi dire, pour éviter le pouvoir suprême, que d'autres n'ont fait pour s'en saisir. L'âme de son père remontée au ciel, les honneurs humains rendus au corps d'Auguste, les honneurs divins à son nom, le premier acte de Tibère fut d'organiser les comices selon le plan qu'Auguste avait laissé écrit de sa propre main. En ce même temps, nous eûmes l'honneur d'être nommés préteurs, mon frère et moi, sur la présentation de César, et immédiatement après les citoyens les plus illustres et qui avaient passé par le sacerdoce : nous nous trou vâmes ainsi les derniers candidats du divin Auguste, et les premiers de César.
CXXV. La république recueillit aussitôt le fruit de ses vœux et de sa sagesse. Elle ne tarda pas à reconnaître tout ce qu'elle aurait eu à craindre, si Tibère se fût refusé à sa demande, et tout ce qu'elle gagnait à avoir obtenu qu'il s'y rendît. L'armée de Germanie, que Germanicus commandait en personne, et les légions d'Illyrie, possédées de je ne sais quelle rage el de désir effréné de brouiller tout, voulaient un nouveau chef, un nouvel état de choses, une autre forme de gouvernement. Que dis-je? elles osèrent menacer le sénat de lui faire la loi, de la faire au prince lui-même. Elles prétendirent fixer, à leur gré, le taux de la solde et la durée du service. On en vint aux armes, on tira l'épée. Peu s'en fallut que dans la pensée de l'impunité, les troupes ne se portassent à de sanglants excès. Il ne manqua qu'un chef à la révolte : un chef n'eût pas manqué d'hommes prêts à marcher contre l'État. Mais ces désordres furent bientôt assoupis et comprimés par l'expérience d'un général mûri dans le commandement, qui sut réprimer avec vigueur tout ce qui appelait la répression, faire quelques promesses avec dignité, châtier sévèrement les principaux coupables, et punir les autres légèrement.
Dans le même temps, Drusus montra en lllyrie la même fermeté. Envoyé par son père dans cette province, où s'était allumé le feu d'une sédition militaire, qui s'annonçait comme un violent incendie, Drusus y parut avec la sévérité d'un ancien Romain et par une conduite hardie qui, pour lui, n'était pas sans péril, il sut apaiser cette rébellion, aussi funeste en elle-même que dangereuse par l'exemple. Les armes dont s'étaient servis les mutins pour le tenir assiégé, Drusus les employa pour les assiéger à leur tour. Il trouva, dans cette occasion, un puissant auxiliaire en Junius Blésus, homme également grand sous les armes et sous la toge. Peu d'années après, étant proconsul en Afrique, Blésus mérita les ornements du triomphe et le titre d' imperator . Nommé pour gouverner les Espagnes et pour y commander les légions, Blésus, fort de ses mérites et de l'éclat de ses exploits en Illyrie, dont nous venons de parler, maintint en repos la province et l'armée. Toutes ses vues ne tendaient qu'au bien, et l'autorité qu'il avait acquise facilitait l'exécution de ces vues. Dolabella, personnage distingué par sa généreuse honnêteté de cœur, successeur de Junius Blésus dans le gouvernement de la partie maritime de l'Illyrie, imita en tout sa vigilance et sa droiture.
CXXVI. Qui pourrait retracer en détail le tableau de ces seize premières années, tel qu'il est présenta tous les yeux et imprimé dans tous les cœurs? Tibère consacra la mémoire de son père, non par un édit, mais par son adoration ; le culte qu'il lui rendit proclama sa divinité. La bonne foi reparut au forum. On ne vit plus l'esprit de faction régner dans les assemblées publiques, la brigue au champ de Mars, la dissension au sénat, la sédition au théâtre. Après le long oubli où elles avaient paru comme ensevelies, Rome vit renaître la justice, l'équité, l'activité. Les magistrats recouvrèrent leur autorité, le sénat sa majesté, les tribunaux leur force. Les émeutes de théâtre furent réprimées. Tous les citoyens furent ramenés au goût du bien, ou par la persuasion, ou par la nécessité. Aujourd'hui les vertus sont honorées, le vice est puni. Les petits respectent les grands sans les craindre, les grands gardent leur avantage sur les petits sans les mépriser. En quel temps le prix des subsistances a-t-il été plus modéré? Quand la paix a-telle été plus prospère, cette paix auguste qui, répandue de l'orient à l'occident, et du nord au midi, met à couvert des vexations et des brigandages les coins de la terre les plus reculés? Toutes les pertes que le sort fait essuyer aux particuliers, aux villes même, la munificence du prince les répare. Il a relevé des villes en Asie. Les provinces ont été affranchies de l'oppression des magistrats. La récompense va au-devant de celui qui la mérite, la peine du crime est lente, mais le crime ne reste pas impuni. L'équité l'emporte sur le crédit, le mérite sur l'intrigue. Le meilleur des princes enseigne à faire le bien, en le pratiquant lui-même, supérieur à tous par son autorité, plus grand encore par ses exemples.
CXXVII. Il est rare que ceux qui sont élevés au-dessus des autres ne s'associent pas des aides puissants pour le gouvernement de leur fortune. Tels les deux Scipion employèrent les deux Lélius, qu'ils traitèrent en toutes choses comme leurs égaux. Tel, le divin Auguste, M. Agrippa, et après la mort d'Agrippa, Statilius Taurus. C'étaient des hommes nouveaux mais leur naissance ne les empêcha pas d'obtenir l'un et l'autre, plusieurs fois, le triomphe, le consulat, le sacerdoce. Les hommes ne manquent jamais pour les emplois faciles mais les grandes affaires ont besoin de grands ministres Il importe à la république d'honorer les talents qui lui sont nécessaires, et d'armer l'homme utile du pouvoir dont il a besoin.
A l'imitation de ces grands hommes, Tibère a pris pour partager avec lui le fardeau des affaires de l'Empire, Aelius Séjan. Né d'un père qui occupait un rang distingué dans l'ordre équestre, tenant, par sa mère, à des familles illustres, anciennes, et comblées d'honneurs ; comptant parmi ses frères, ses cousins, ses oncles, des personnages consulaires, aussi laborieux lui-même que capable, Séjan unit la force de l'âme à la vigueur de la constitution physique. Sa gravité n'exclut pas l'enjouement, il a même la gaieté franche de nos pères. Tranquille dans l'action, comme s'il n'agissait pas, ne demandant rien, et par là même obtenant tout, il s'estime toujours moins qu'il n'est estimé des autres : sa vie est calme comme son visage mais son esprit est toujours en éveil.
CXXVIII. Tel est Séjan, et ily a longtemps que Rome et le prince sont d'accord dans l'appréciation de ses mérites. Ce n'est pas d 'aujourd'hui qu'aux yeux du sénat, et du peuple romain le mérite est la vraie noblesse. Remontons de trois cents ans, au siècle qui précéda la première guerre punique : nous verrons nos ancêtres élever au premier rang Titus Coruncanius, homme nouveau, et lui conférer, avec les autres honneurs, la dignité même de grand pontife, nous les verrons accorder des consulats, des censures, des triomphes à Sp. Carvilius, simple chevalier, à Mummius L'Achaïque, à M. Caton, né àTusculum d'une famille obscure, et qui n'était même pas propriétaire, à Rome, de la maison qu'il habitait. Et ce C. Marius, cet homme de basse origine, hésitèrent-ils à le reconnaître pour chef du peuple romain, jusqu'à son sixième consulat ? Ah ! sans doute ceux qui rendirent Cicéron si puissant, qu'il disposait à son gré des plus hautes magistratures, ceux qui ne refusèrent rien à Pollion de ce que les plus nobles par la naissance n'obtenaient qu'au prix des plus pénibles travaux, ceux-là sentirent que partout où se trouvait le mérite, c'était un devoir de lui tout accorder et c'est en imitation de ces légitimes exemples, que César a voulu mettre à l'épreuve le génie de Séjan : que Séjan a été appelé à partager avec le prince le fardeau des affaires et que le sénat et le peuple romain ont été conduits à remettre le soin de leur sécurité à l'homme qu'ils ont reconnu le plus capable de l'assurer.
CXXIX. Après avoir donné, du gouvernement de Tibère César, une sorte d'idée générale, rappelons quelques détails. Avec quelle
prudence il sut attirer à Rome Rhascupolis, meurtrier de Cotys, son
neveu, dont il partageait le trône et la puissance! et combien il eutà se féliciter, en cette occasion, du ministère de Pomponius Flaccus, homme consulaire, né pour tout ce qui demande un cœur
droit, et méritant la considération plutôt qu'il ne la recherche,
par sa vertu sans faste ! Quelle gravité scrupuleuse, quand il écoute les causes plaidées au tribunal ! c'est un sénateur,
un juge, non un prince. Avec quelle rapidité il sut prévenir
l'ingrat Libon méditant de criminels desseins! Quel accueil à
son cher Germanicus, quand ce prince, auquel il avait donné
les premières leçons de l'art l de la guerre, reparut vainqueur
de la Germanie ! De quels honneurs il combla sa jeunesse,
et comme la magnificence de son triomphe répondit à la grandeur
de ses exploits ! Que de largesses au peuple! Avec quelle joie ne
se prêta-t-il pas, toutes les fois que le sénat le permit, à soutenir
la fortune des sénateurs, ne voulant pas certes encourager le désordre des mœurs, mais ne voulant pas non plus qu'une pauvreté
dont la cause était honorable compromît leur dignité. Avec quels
témoignages d'honneur, il envoya son cher Germanicus dans les
provinces transmarines. Avec quel art, aidé de son fils Drusus, qu'il chargea de l'exécution de ses desseins, il réussit à tirer Maroboduus des États qu'il avait envahis, et auxquels il se tenait comme attaché ! Je dirais, si je ne craignais d'offenser la majesté de César, que son habile politique produisit ce que produisent les enchantements qui font sortir de leur retraite les serpents cachés sous la terre. Avec quels égards et quelles précautions tout à la fois il le garde! Combien paraissait redoutable cette guerre allumée par Julius Florus, et par Sacrovir, l'homme le plus puissant des Gaules ! Avec quelle rapidité, avec quelle vigueur merveilleuse il l'a étouffée! Le peuple romain apprit qu'il avait vaincu, avant de savoir qu'il était en guerre, il ignorait encore le péril, quand il reçut la nouvelle de la victoire. La guerre d'Afrique ne causait pas une moindre terreur et s'étendait de jour en jour. Sous les auspices de Tibère, et par la sagesse de ses mesures, en moins de rien, elle fut éteinte.
CXXX. Combien d'édifices élevés sous son nom, ou sous le nom des siens ! Quelle munificence pieuse, et à peine croyable, dans le temple consacré à la mémoire de son père ! Avec quel mélange de modestie et de magnificence il relève le théâtre de Cn. Pompée détruit par la flamme ? Il semble qu'un sentiment personnel l'intéresse à la conservation de tout ce qu'il y a eu de grand dans Rome. Avec quelle libéralité, il a tout récemment, entre autres exemples, secouru de sa fortune personnelle les malheureux de tout rang, victimes de l'incendie du mont Célius ! Avec quel calme et quel ordre, il procède à la levée des soldats, qui fut toujours un si grand sujet d'effroi ! Si la nature le permettait, si la faiblesse humaine avait le droit de se plaindre des Dieux aux Dieux mêmes, j'oserais leur dire : « Comment Tibère a-t-il mérité de voir tramés contre lui des desseins criminels, d'abord par Drusus Libon, et après lui, par Silius et Pison, quand l'un de ces hommes lui devait sa fortune même, et l'autre l'agrandissement de sa fortune? » Et pour déplorer de plus grands malheurs quoique ceux-là lui aient été plus sensibles : « Pourquoi a-t-il perdu et ses jeunes fils, et son petit-fils, enfant de son cher Drusus? »
Encore ces malheurs ne sont-ils que douloureux : il en est dont on ne saurait parler sans rougir. Hélas ! M. Vinicius, combien ces trois dernières années ont déchiré son âme ! combien il souffre d'une peine secrète, que la nécessité de la dissimuler rend encore plus cuisante! Sa belle-fille, son petit-fils l'ont désolé, l'ont indigné, l'ont fait rougir. A ces chagrins poignants s'est joint, pour comble, le malheur de perdre sa mère, princesse accomplie, plus semblable aux Dieux qu'aux hommes et dont personne n'a senti le pouvoir que par le soulagement de ses maux ou l'accroissement de ses honneurs.
CXXXI. Terminons cet ouvrage, par un vœu. Jupiter, qui règnes au Capitole ; Mars, dieu des combats, père et défenseur du nom romain ; Vesta, gardienne des feux éternels et vous tous, ô Dieux par qui le majestueux édifice de la grandeur romaine s'est élevé au-dessus de tous les empires de la terre, je vous en prie, je vous en conjure, au nom de la patrie, gardez, maintenez, protégez l'état heureux où nous sommes, la paix dont nous jouissons. Accordez au prince qui nous gouverne la carrière la plus longue que puisse fournir un mortel. Donnez-lui le plus tard possible les successeurs que vous lui destinez, et que leurs épaules soient aussi capables que les siennes de soutenir le poids de l'empire du monde. Favorisez les desseins de tous les bons citoyens; [étouffez les complots des méchants.]
