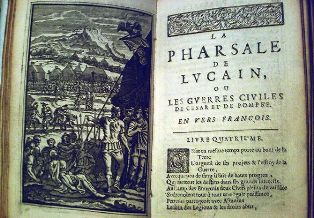
Les Sources de Lucain
par
René Pichon
Docteur ès lettres
Professeur de Première Supérieure au Lycée Henri IV,
Maître de conférences à l'École Normale Supérieure de Sèvres
1912
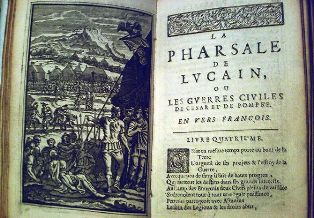
Biographie de René Pichon
CHAPITRE Ier. — LES SOURCES HISTORIQUES.
CHAPITRE Il. — LES SOURCES HISTORIQUES(Suite). Le récit de la guerre civil.
CHAPITRE III. - LES SOURCES HISTORIQUES (Fin). Les altérations de l'histoire.
CHAPITRE IV. - LES SOURCES PHILOSOPHIQUES.
CHAPITRE V. - LES SOURCES LITTÉRAIRES.
APPENDICE. — LA COMPOSITION DE LA PHARSALE.
L'étude des sources, Quellenkunde, appliquée aux auteurs
anciens, est une des plus précieuses conquêtes de la philologie
de notre temps. Il serait superflu d'en vanter longuement
l'utilité à la fois littéraire, psychologique et historique : elle seule permet de mesurer la valeur véritable d'un
écrivain, de surprendre le secret mécanisme de son travail,
de le rattacher à la série dont il dépend, et, plus loin que lui,
de saisir un peu le mouvement des idées et des formes d'art
dans le monde antique.
Lucain était jusqu'ici un des poètes latins pour lesquels
cette étude n'avait encore été faite que d'une manière fragmentaire.
Quelques dissertations ou articles de Baier, de
Westerburg, de Ussani, de Vitelli, de Hosius, étaient loin
d'épuiser la question. Pourtant, par la richesse de son contenu
autant que par la beauté de sa forme, la Pharsale méritait
un examen plus approfondi.
Et surtout un examen plus complet. Elle est en même
temps une oeuvre d'histoire, une oeuvre de pensée, une oeuvre
d'art; elle contient des faits précis et une doctrine morale
sous une forme poétique. Il fallait donc l'envisager à ce
triple point de vue, et si le problème de ses sources historiques,
plus délicat et plus complexe, devait être traité
plus longuement, on ne pouvait cependant en négliger les
sources philosophiques ni les sources littéraires. Ainsi compris, le sujet que j'ai essayé de traiter est très
vaste. et souvent encombré de difficultés épineuses Je ne me
flatte pas de les avoir toutes résolues : je souhaite seulement
d'avoir jeté un peu de clarté dans les discussions engagées.
Je voudrais que mon travail aidât à mieux comprendre un
poète que j'ai toujours aimé, et que j'aime encore mieux
depuis que je l'ai plus patiemment étudié.
LES SOURCES HISTORIQUES
A) Les faits accessoires.
§ 1.
Il suffit de jeter les yeux sur la Pharsale pour s'apercevoir
que ce n'est pas du tout une fantaisie de virtuose se jouant
dans la fiction pure, mais bien une oeuvre pleine et solide.
Elle contient un très grand nombre de faits, et par conséquent
nous invite dès le premier abord à nous poser une
question : d'où viennent ces faits? comment le poète les a-t-il
connus? Mais tout de suite aussi une distinction s'impose.
Les détails dont l'ouvrage est rempli n'ont pas tous la même
importance, ni surtout le même caractère. Il y en a qui,
très curieux en soi, demeurent épisodiques et comme accessoires,
qu'on pourrait retrancher sans nuire à la vie essentielle
du poème ; et il y en a d'autres, au contraire, qui en
constituent la trame intime et indispensable, ceux qui se
rapportent au grand duel de César et de Pompée. Ceux-ci,
on le comprend, sont de beaucoup les plus intéressants.
C'est pourtant par les autres que je commencerai; je chercherai
d'abord où Lucain a pris toutes les allusions historiques
et géographiques dont il a renforcé son récit, et c'est seulement après avoir ainsi désencombré le terrain que
j'arriverai aux événements principaux, pour lesquels le problème
des sources se pose d'une façon bien plus pressante.
Parmi les faits secondaires eux-mêmes, je crois qu'il faut
encore distinguer. La plupart de ceux que nous rencontrons
dans la Pharsale y sont mentionnés en quelques mots rapides,
incidemment, à propos d'autre chose ou en manière de comparaisons.
Par contre, quelques-uns sont traités avec plus
d'abondance, avec une précision plus minutieuse, en des dissertations qui
finissent par former de véritables excursus. Entre
ces deux catégories, il y a plus qu'une différence de longueur
dans le développement : on sent que les premiers n'ont pas
beaucoup préoccupé le poète, qu'il en a parlé parce qu'il les
connaissait, mais sans se soucier beaucoup de les mieux connaître,
tandis que les seconds ont plus vivement piqué sa
curiosité, et par suite l'ont contraint à une documentation
plus rigoureuse.
Pour les premiers, la question des sources ne se pose même
pas. On s'en convaincrait bien vite en dressant la liste de
tous les renseignements d'histoire nationale ou étrangère,
de géographie, de sciences naturelles, que Lucain a utilisés
en passant et selon l'occasion. De l'histoire romaine, par
exemple, il mentionne plusieurs faits antérieurs à la guerre
civile; mais presque toujours ces faits sont de ceux que tout
homme cultivé de son temps pouvait se rappeler sans effort
spécial de mémoire ou de recherche. Il sait que Lavinium et
Albe sont d'origine troyenne, que Capouea été fondée
par des colons Dardaniens, Padoue par Anténor,
Brindes par des Crétois. Il sait que Romulus et Remus se
sont battus pour régner sur la bourgade naissante, et que
les Sabines ont arrêté le conflit entres leurs pères et leur
époux. Il connaît les principaux héros et les principales batailles des guerres républicaines, Camille et Curius,
Veies et l'Allia, la lutte contre Pyrrhus, la bataille
de Cannes, la campagne de Scipion en Afrique, la
destruction de Sagonte, l'invasion des Cimbres et des Teutons, les agitations démagogiques des Gracques, et le
démêlé de Crassus avec les tribuns. Mais comment aurait-il
pu ignorer des événements aussi célèbres, aussi «classiques» en quelque sorte, que ceux-là? A coup sûr, il n'avait
pas besoin d'ouvrir un livre d'histoire pour en apprendre
l'existence, pas plus qu'il n'avait besoin de consulter un
manuel d'antiquités religieuses pour connaître les dieux que
César devait invoquer dans sa prière, pas plus qu'il n'avait
besoin de fouiller dans un De re rustica quelconque pour
savoir que la Sicile et la Sardaigne étaient avec l'Afrique les
pays producteurs de blé par excellence, ou que l'Apulie
était tout entière transformée en pâturages, au lieu d'être
cultivée comme jadis. Toutes ces notions lui étaient à
coup sûr depuis longtemps familières, et il n'a eu, en écrivant
son poème, ni à les acquérir, ni même à les rafraîchir.
L'histoire de la Grèce et de l'Orient lui fournit également
des allusions d'usage courant, banales même. La splendeur
des murailles de Babylone, la sépulture d'Alexandre et
des Ptolémées à Alexandrie étaient choses de notoriété
publique. Et quant au fameux pont de bateaux et au non moins
fameux canal de l'Athos, par lesquels Xerxès avait immortalisé
son orgueil, c'étaient alors des « clichés » de moralistes, sans cesse ressassés en vers comme en prose : ne fût-ce que
dans les écoles des rhéteurs, Lucain avait certainement
entendu plus d'une déclamation sur ce thème, et il était naturel
que le souvenir lui en revînt spontanément à l'esprit en
présence des grands travaux exécutés par César pour fermer
le port de Brindes. Ici encore des réminiscences d'études bien
faites, selon l'opinion répandue à cette époque, suffisent pour expliquer cette érudition tout à fait superficielle.
Enfin, il faut attribuer à la même origine la plupart des
connaissances géographiques dont Lucain fait étalage. La
géographie, nécessaire pour l'intelligence des poèmes grecs
et latins, était, comme on le sait, une partie essentielle de
l'enseignement des grammairiens : leurs élèves s'en souvenaient,
trop peut-être, lorsqu'ils se mettaient eux-mêmes
à versifier. C'est de là que proviennent ces avalanches de
noms de peuples, avalanches un peu hétéroclites et confuses
parfois, qui encombrent maints passages de la Pharsale.
Surtout les peuples barbares du Nord et de l'Orient, Daces
ou Dahes, Gètes et Massagètes, Sarmates, Pannoniens
d'une part, et de l'autre Parthes, Mèdes, Assyriens, Babyloniens,
Indiens, sont fréquemment énumérés, sans que
du reste l'auteur paraisse se préoccuper beaucoup de ce que
recouvrent ces appellations exotiques. Quelquefois, au
contraire, il témoigne de connaissances plus précises. Cela
arrive d'abord, tout naturellement, quand il parle des
localités italiennes, du mont Garganus et du mont Matine,
des volcans de Sicile et de Campanie, du promontoire de
Circé, des inondations du Pô, des sites traversés par la
voie Appienne, ou des routes maritimes qui partent de
Brindes. Mais, même sur les régions étrangères, il est au courant de détails assez particuliers. Il connaît la peuplade
des Rutupini en Bretagne, les mines d'or d'Asturie et les
gisements du Tage et du pays des Arimaspes, les canots
légers employés par les Bretons, les Vénètes et les Égyptiens. Il n'ignore pas que Corcyre est l'ancienne île des
Phéaciens, que les Psylles n'ont pas à redouter la morsure
des serpents, que le Méandre est sinueux, le Rhône
rapide et la Saône lente. Seulement, toutes ces curiosités,
dont beaucoup se retrouvent chez d'autres écrivains, ne lui
ont pas coûté grande peine à apprendre. La géographie
qu'enseignaient les grammairiens, et dont nous pouvons
nous faire une idée par les compilations que l'antiquité nous
a laissées, avait un caractère beaucoup plus anecdotique que
scientifique. Les menus renseignements dans le goût de ceux
que je viens d'énumérer, tantôt intéressants et tantôt
puérils, y étaient collectionnés en abondance. Pour peu que
Lucain eût une bonne mémoire, il lui était aisé de les
retrouver à l'occasion, sans le secours d'aucun livre, et de
s'en servir pour orner ses vers, ou pour les surcharger.
Ainsi donc en ce qui concerne ces notions éparses d'histoire
et de géographie, il serait superflu de se demander chez qui
Lucain les a prises. Elles ne sont nullement des emprunts
faits à tel ou tel auteur, mais des souvenirs d'école, appartenant
au bagage commun de tous les Romains tant soit peu
instruits. La seule question qu'on puisse se poser à leur
sujet, c'est de savoir si Lucain les a traitées avec un respect
fidèle ou avec une libre fantaisie. Quoiqu'elles n'aient pas
dans son ouvrage une très grande importance, il n'est pas
indifférent de mesurer déjà, dans ces petites choses, jusqu'à
quel point il a l'esprit exact et l'application consciencieuse.
Or, dans cet ordre d'idées, certains critiques lui ont
adressé des reproches dont quelques-uns sont justes, dont quelques-uns aussi semblent reposer sur des malentendus, et
qu'en tout cas il faut discuter.
Un de ces reproches est relatif à ce que Lucain dit de la
jeunesse de Pompée. Dans l'admirable peinture du songe de
Pompée à la veille de Pharsale, il montre le futur vaincu se
revoyant tel qu'il était lors de son premier triomphe, après
sa victoire sur Sertorius. Or le premier triomphe de
Pompée lui fut décerné après son succès en Numidie ; il ne
triompha de Sertorius que 8 ans après. Mais la campagne de
Numidie ne parait pas avoir eu d'autre importance que de
signaler Pompée à l'attention des hommes d'État. Celle
d'Espagne eut plus de retentissement, et débarrassa la noblesse
d'un péril bien autrement redoutable. Voilà pourquoi,
jugeant les choses à distance et sans compulser les dates,
Lucain a pu s'imaginer que la victoire sur Sertorius, qui
avait été réellement le premier grand exploit de Pompée, lui
avait aussi valu officiellement son premier triomphe.
C'est là sa seule inexactitude en ce qui concerne les faits
incidemment rappelés de l'histoire romaine. Quant à l'histoire
grecque, il en parle peu, comme on a pu le voir, et en
général avec assez de compétence. Une opinion souvent soutenue
veut qu'il ait confondu la Phocide et Phocée dans les
vers où il s'occupe de Marseille. A y regarder de près, cela
ne me paraît pas vrai. Il ne croit pas du tout que Marseille
soit une colonie de Phocidiens : il parait au contraire bien
connaître l'histoire des émigrants Phocéens, à laquelle il fait
une allusion fort précise. Il est vrai qu'il applique indifféremment
le même adjectif, Phocaicus, aux choses des
deux pays : mais Ovide en fait autant (1), et cet adjectif
peut aussi bien dériver des deux noms de pays.
(1) Ov., Met. Il, 569 (Phocaicus : de Phocide), et 11, 8 (Phocaicus : de Phocée).
Plus grave est peut-être l'emploi de Phocis pour désigner Phocée et même sa colonie Marseille : mais cela n'est pas non plus sans exemple ; Sénèque et Aulu-Gelle (1) en ont usé de même, sans avoir l'excuse des exigences du vers.
(1) A. GELL., X, 16.
En tout
cas, il n'y aurait là qu'une confusion de noms, et pas du tout
une erreur historique.
On est plus dans le vrai, je crois, lorsqu'on fait observer
que Lucain suppose les conquêtes d'Alexandre plus étendues
qu'elles ne l'ont été. A en croire deux vers de la Pharsale,
Alexandre serait allé jusqu'au Gange, tandis qu'il n'a pas
dépassé l'Hyphasis. L'erreur est réelle ; mais elle s'explique
par le vague des connaissances généralement répandues à
cette date sur cette contrée lointaine ; elle ne porte d'ailleurs
que sur un détail tout épisodique.
Ceci nous amène à examiner les erreurs géographiques
que l'on a imputées à Lucain. Elles sont surtout fréquentes,
comme il est naturel, en ce qui concerne les peuples et les
pays les plus éloignés de Rome. On est quelque peu surpris
de lire, par exemple, que Jupiter Hammon est le dieu des
Ethiopiens, des Arabes et des Indiens, et que les Seres
sont les premiers riverains du haut Nil :mais quand on
se rappelle que Virgile fait sortir le Nil de l'Inde, on s'aperçoit
qu'il y a là une fausse conception qui est commune
à la plupart des écrivains anciens. Ils se représentent le
monde qu'ils connaissent comme beaucoup moins étendu
dans le sens de la longitude qu'il ne l'est vraiment, et ainsi
les contrées du Sud-Est et celles de l'Est finissent par se confondre.
Pour ce qui est des peuples du Nord-Est, on a beaucoup
reproché à Lucain d'avoir fait des Daces et des Gètes deux
peuples distincts, tandis que, selon Strabon, c'étaient
deux rameaux d'un même peuple. La différence n'est pas
nommer presque toujours ensemble ces deux tribus semble indiquer par là mêmeleur parenté. On pourrait se
demander, d'autre part, s'il ne confond pas les Daces, riverains
du Danube, avec les Dahes, population située à l'Est de
la mer Caspienne : comme il joint également ces deux noms
à celui des Gètes, la supposition ne serait pas téméraire ;
mais il parle trop peu des Dahes pour qu'on puisse savoir
exactement où il les place. Enfin, il est possible qu'il confonde
les Massagètes et les Gètes : les premiers ne sont nommés
que deux fois, dont une comme voisins du Danube,
ce qui ne s'applique pas du tout à leur vraie position (1),
mais bien à celle des Gètes.
(1) Les Massagètes étaient à l'Est de la Caspienne
La vérité, c'est que Lucain n'a
que des notions assez vagues sur tous ces peuples, et les
localise d'une manière incertaine. Mais il ne faut pas tout de
même lui prêter de trop fortes inexactitudes. Ainsi Heitland
prétend qu'il fait déboucher le Danube dans le Palus-Méotide
: ceci n'est pas vrai ; le paysage ainsi visé est une
description synthétique de l'hiver dans les régions du Nord-Est, où sont nommés successivemen tle Bosphore, les Scythes,
l'Ister, le Palus-Méotide et les Besses, sans qu'un rapport
précis soit indiqué entre toutes ces dénominations.
Quand il s'agit de pays plus connus des Romains, Lucain
parle en termes plus compétents. On lui a pourtant attribué
quelques fautes, qui, à mon avis, n'en sont pas. Dans sa
description du Pô, il dit que ce fleuve ne serait pas inférieur
au Danube si celui-ci était réduit à ses seules eaux: sur
quoi Heitland et Ussani déclarent qu'il ignore l'existence
des affluents du Pô. Mais il dit tout simplement que le Pô
n'a pas d'affluents aussi considérables que ceux du Danube,
ce qui n'a rien d'erroné. On le blâme aussi d'avoir placé le
mont Atlas sur le bord de la mer: mais une phrase de
Strabon, et plus encore la célèbre description de Virgile, prouvent que c'était une opinion commune chez les
anciens. On prétend qu'il a confondu l'Ida de Crète et l'Ida
de Phrygie, en faisant pousser sur le premier l'aconit, qui
n'existait que sur le second : qu'est-ce que nous en
savons ? de ce qu'aucun des auteurs connus de nous ne mentionne
l'aconit en Crète, il ne s'ensuit point qu'il n'y croissait
pas. Properce parle des herbes médicinales de la
Crète ; or, on sait quel étroit rapport les plantes médicinales
et les plantes vénéneuses avaient aux yeux des anciens.
Enfin, l'on se récrie sur l'invraisemblance de la chute du
mont Eryx dans la mer Égée, et en effet, la position de
l'Eryx à l'extrême Ouest de la Sicile rend l'hypothèse
absurde : mais, justement parce qu'elle est absurde, a-t-on
le droit de l'attribuer à Lucain ? Haskins essaie de l'excuser
en disant que Eryx signifie seulement ici une montagne très
haute et Aegaeum mare une mer très profonde : ce n'est pas
une explication, d'autant plus que les vers suivants évoquent
une autre image, très précise celle-là, celle du Gaurus tombant
dans l'Averne. Les vers en question doivent, eux
aussi, contenir le nom d'une montagne et d'une mer voisines
l'une de l'autre. Une correction s'impose donc, mais
laquelle? A Eryx, on a voulu substituer Athos, ce qui
est très arbitraire, ou apex, ce qui est trop vague. Si l'on
garde Eryx et que l'on cherche à corriger Aegaei maris, on
s'aperçoit que, tout près du mont Eryx, il y a un groupe
d'îles dont le nom ressemble singulièrement à celui de la
mer Égée, les îles Egates. Lucain a fort bien pu employer
un adjectif dérivé de ce nom pour désigner la partie de
la mer la plus rapprochée du mont Eryx, et cet adjectif aura
été remplacé, selon la coutume des copistes, par le mot Aegaei, beaucoup plus connu, quoique d'ailleurs inepte ici.
Exception faite pour ce passage douteux, les prétendues
erreurs géographiques de Lucain se ramènent en somme à
peu de chose. Tantôt elles n'existent que dans l'esprit de
commentateurs qui ne le comprennent pas ; tantôt elles lui
sont communes avec la plupart des auteurs anciens; tantôt
elles consistent en des énumérations un peu confuses de
peuples exotiques, comme pouvait en faire un jeune homme
qui jadis avait su assez de géographie, et qui en avait conservé
des souvenirs à moitié précis.
C'est là, je crois, qu'il faut en revenir. La rapidité des indications
historiques et géographiques que nous venons d'étudier,
le caractère approximatif qu'elles présentent le plus
souvent, la ressemblance qu'on peut leur trouver avec les
façons de parler en usage chez tous les écrivains, tout nous
atteste que Lucain, pour ces passages absolument accessoires,
ne s'est pas imposé le labeur d'une information spéciale : il
a simplement utilisé, tant bien que mal, et en général assez
bien, son ancien bagage d'écolier.
§ 2.
Pour les brèves mentions que nous venons de passer en
revue, il n'est pas à croire que Lucain ait senti le besoin de
se documenter : pour les faits qui, sans être liés à l'action
essentielle de son poème, y tiennent cependant une place
assez considérable, pour ceux qui sont l'objet, non plus d'allusions
fugitives, mais de digressions étendues et méthodiques,
la question est plus difficile à résoudre. Il y en a
qu'il a fort bien pu traiter en se servant uniquement des connaissances
autrefois acquises, et d'autres pour lesquels il a
dû sans aucun doute se livrer à des recherches spéciales.
Le premier cas me paraît être le plus fréquent dans les
dissertations et énumérations relatives à l'histoire romaine.
Ici, nous devons, je crois, nous garder d'une illusion. Parce
que certaines pages de la Pharsale nous apportent des renseignements
intéressants sur les choses de Rome, nous sommes portés à penser que le poète, pour les écrire, a dû se renseigner
lui-même. Cela n'est nullement nécessaire. Ainsi, au livre I,
il décrit complaisamment la cérémonie de l'amburbium, et
nomme tous les collèges religieux qui y prennent part : pontifes,
vestales, quindécemvirs, augures, septemvirs epulones,
titiens, saliens et flamines. Cette liste si précise a-t-elle
été copiée dans quelque manuel à Antiquités divinés, analogue
à celui de Varron? la chose est possible à coup sûr. Mais un
jeune homme instruit de cette époque était probablement
capable de retrouver par lui-même les titres des grandes
confréries sacerdotales, et, de plus, nous savons que Lucain
avait précisément fait partie de l'une d'elles, celle des
augures, ce qui l'avait sans doute amené à mieux connaître
l'organisation religieuse de Rome. Il est donc permis
de supposer qu'en cet endroit il n'a eu qu'à faire appel à son
expérience personnelle. De même, à propos de l'union de
Caton et de Marcia, il trace indirectement, par voie de contraste,
un tableau du mariage romain très précieux pour
nous : en nous disant qu'il n'y a pas eu ce jour-là de guirlandes
de fleurs à la porte du logis, ni de torches allumées,
ni de torus genialis, etc., il nous signale du même coup bon
nombre de détails des cérémonies nuptiales ordinaires.
Mais ces détails, qu'il a consciencieusement et minutieusement
cités, il n'a eu besoin de les chercher nulle part : la vie
de tous les jours les lui offrait d'elle-même. Si des digressions
comme celles-là ont pour nous une haute valeur historique,
elles n'ont réclamé du poète aucun apprentissage
d'historien.
Des institutions et des moeurs, passons aux faits proprement
dits, non pas, bien entendu, aux faits isolés que nous
avons envisagés tout à l'heure, et dont l'évocation ne remplit
qu'un ou deux vers, mais aux faits groupés en séries,
composant des morceaux d'histoire romaine. Voici, par
exemple, au moment où César s'empare du trésor public
malgré l'opposition de Metellus, une «analyse » de ce trésor une énumération des victoires et des conquêtes qui l'ont successivement
constitué. Devons-nous penser que, pour
écrire ces huit ou dix vers, Lucain ait consulté, soit un
ouvrage particulier sur les finances de Rome, soit une histoire
générale de la république? Ces deux hypothèses ne
seraient pas absurdes; mais elles sont arbitraires. Je crois
bien plutôt qu'il étale ici de simples réminiscences, qu'il les
étale sans grand souci de la chronologie, par des associations
d'idées dont on peut retrouver la marche. Les victoires les
plus célèbres se présentent d'abord à son esprit : victoires sur
Carthage, sur Persée, sur Philippe, sur Pyrrhus. Ce dernier
nom l'arrête un peu plus longtemps, à cause du désintéressement
opposé par Fabricius aux tentatives corruptrices de
ce roi. Ce désintéressement,à son tour, lui suggère une antithèse
entre l'économie des vieux Romains et l'opulence des
provinces d'Asie, auxquelles il joint tout naturellement les
îles de Crète et de Chypre. Il termine en rappelant les conquêtes
de Pompée, parce qu'elles sont les plus récentes de
toutes, et ausi parce qu'elles le ramènent plus près de son
sujet propre. En tout cela, je vois les réflexions spontanées
d'un homme qui connait dans ses grandes lignes l'histoire
de son pays ; je ne vois pas du tout le résultat d'une
érudition amassée tout exprès pour la circonstance.
On peut porter un jugement analogue sur un passage du
discours que Pompée prononce afin d'entrainer ses troupes
contre César. Dans ce passage, il compare César aux démocrates
déjà vaincus par lui-même ou par les autres défenseurs
de la noblesse : Lepidus, Carbo, Sertorius, Spartacus.
Il s'agit là de faits qui devaient être on ne peut plus familiers
aux jeunes Romains pourvus d'une bonne éducation. Ils
avaient lu certainement des récits de ce temps troublé chez
tous les historiens de la république. Les orateurs classiques,
Cicéron entre autres, y avaient fait de fréquentes allusions.
Les exercices de l'école devaient sans doute plus d'une fois
s'en inspirer. Lucain, par conséquent, connaissait le soulèvement
des esclaves ou la défaite de Sertorius comme, chez nous, le premier venu peut connaître le quatorze juillet ou
le neuf thermidor, sans avoir besoin de lire pour cela aucun
ouvrage spécial.
Je serais moins affirmatif pour un autre passage du même
discours, où Pompée rappelle ses victoires de jadis sur les
pirates, sur Mithridate, les Espagnols, les Arabes, les Juifs,
etc. Ici l'énumération est beaucoup plus détaillée. Il est
bien possible que Lucain l'ait faite de mémoire, pour peu
que, dans son enfance, il eût appris consciencieusement les
campagnes de Pompée. Mais il est non moins possible qu'il
ait cru nécessaire de vérifier ou de compléter ses souvenirs,
d'autant plus qu'il avait à parler cette fois du passé d'un
de ses personnages principaux, de faits qui touchaient de
près au sujet essentiel de son poème. Il est donc légitime de
supposer qu'il a relu la vie de Pompée avant la guerre civile,
soit dans une biographie particulière, soit dans une histoire
générale. Et enfin voici une dernière hypothèse, qui n'est
pas la moins probable. Nous verrons plus loin que la source
habituelle, sinon unique, de son poème, en ce qui concerne
la guerre civile, a été l'histoire de Tite-Live. Il est à peu
près certain que Tite-Live avait placé dans la bouche de Pompée
une ou plusieurs harangues. Or, dans les discours de
cette espèce, les personnages de Tite-Live reviennent volontiers
sur leurs actes antérieurs, présentent eux-mêmes leur
autobiographie, non sans partialité, cela va sans dire. On
pourrait reconstituer presque toute la carrière de Scipion
rien que par les paroles qu'il prononce dans sa discussion
avec Fabius Maximus (1).
(1) Liv.. XXVIII, 42.
Pompée, lui aussi, devait faire chez
Tite-Live un exposé élogieux de ses propres exploits, et
Lucain n'a eu qu'à mettre en beaux vers cette page d'histoire
qu'il rencontrait tout naturellement sur sa route.
De toutes les digressions relatives aux choses de Rome
avant l'époque de César, la plus copieuse est le tableau
rétrospectif de la lutte entre Marius et Sylla. Cette description
très longue, qui compte plus de 150 vers, est trop précise pour avoir pu, semble-t-il, être fabriquée à coups de
vagues réminiscences. Il y a donc lieu, ici, d'examiner la
question qui, dans les cas précédents, ne se posait pas ou
se posait à peine : quel est l'auteur que Lucain a suivi dans
cette partie de son poème?
On ne peut faire, bien entendu, qu'une réponse hypothétique;
mais de toutes les hypothèses, la plus vraisemblable
est celle qui nous conduit à Tite-Live. D'abord, s'il est vrai
que Lucain s'est inspiré de Tite-Live pour les événements
essentiels, il est peu croyable qu'il ait songé, sans raison
apparente, à un autre historien pour les épisodes. De plus,
quoique nous n'ayons pas conservé les livres dans lesquels
Tite-Live racontait la tyrannie de Marius et la dictature de
Sylla, nous connaissons assez ses habitudes d'esprit pour
être sùrs que son récit ne devait pas différer beaucoup de ce
que nous lisons dans la Pharsale. Que trouvons-nous en effet
chez Lucain ? pour ce qui est de la forme, une peinture générale,
très éloquente, un peu amplifiée, des massacres commis
par les deux rivaux; et, se détachant sur ce fond
commun, quelques scènes dramatiques très nettement indiquées ; pour ce qui est du fond, un jugement un peu plus
favorable peut-être à Sylla qu'à Marius, à cause des tendances
aristocratiquesdu dictateur ; mais, malgré cette nuance,
et dominant tous les détails, une profonde horreur, une
révolte généreuse d'humanité indignée en présence de toutes
les atrocités accumulées. Tout cela nous rappelle, et les
procédés narratifs de Tite-Live, et ses préférences politiques,
et ses sentiments de moraliste. Enfin on peut déjà faire
usage ici de l'argument que nous rencontrerons quand il
s'agira des faits principaux de la Pharsale : ce que dit Lucain
s'accorde en général avec ce que nous apprennent les
auteurs qui dérivent de Tite Live, Velleius, Florus, Appien,
Dion, Plutarque, etc. ; cette identité de témoignages suppose
une source identique. L'accord n'est pas complet, dira-t-on, et en effet on peut
relever quelques divergences entre Lucain et les historiens,
mais des divergences légères et aisément explicables. L'une
d'elles porte sur la nationalité du sicaire qui, à Minturnes,
essaya d'assassiner Marius et en fut détourné par une vision
miraculeuse. L'Epitome de Tite Live, le scoliaste de
Lucain dont les remarques ont constitué le Commentum
Bernense, et enfin Appien, en font un Gaulois; Velleius
Paterculus, Valère-Maxime et Lucain en font un Cimbre;
quant à Plutarque, il donne les deux traditions, sans choisir
entre elles. De cette diversité, Ussani conclut qu'il y a deux
versions irréductibles, celle de Tite-Live, suivie par l'Epitome,
le Commentum Bernense et Appien, et celle d'un autre
historien, peut-être Valerius Antias, suivie par Velleius,
Valère-Maxime et Lucain. Il me parait peu soutenable, je
l'avoue, que Lucain ait imaginé d'aller consulter un vieil
auteur tel que Valerius Antias, et j'aperçois une autre explication.
Selon moi, Tite-Live rapportait, comme il le fait
souvent, les deux versions, et se décidait pour l'origine gauloise.
De ceux qui l'ont suivi, les uns ont reproduit exactement
sa conclusion comme Appien ; les autres ont préféré
l'opinion contraire, parce qu'elle leur fournissait un contraste
frappant entre la victoire de Marius sur les Cimbres et
l'entreprise d'un Cimbre contre Marius. Des historiens rhéteurs
comme Velleius et Valère-Maxime, et un poète comme
Lucain, sont en effet grands amateurs d'antithèses dramatiques.
Je crois donc que Lucain a, en cette occasion, use
avec une certaine indépendance des matériaux que lui
offrait Tite-Live, mais qu'il n'a pas cherché ailleurs d'autres
matériaux.
Un peu plus loin, en énumérant les victimes de Marius, il
cite un Baebius qui fut déchiré par les mains de la populace. Il y eut bien un Baebius qui fut supplicié de cette
manière, mais plus tard, lors des proscriptions de Sylla.
Le Baebius tué par ordre de Marius eut un genre de mort un peu moins atroce; il fut traîné par des crocs sur le forum.
C'est du moins ce que raconte Florus, et à vrai dire, la
symétrie de ces deux homonymes qui se font si bien pendant
pourrait mettre en défiance. Admettons cependant qu'il y
ait eu deux Baebius, et que Lucain ait transporté à l'un le
genre de supplice subi par l'autre : cette inadvertance prouvera
qu'il a lu un peu rapidementTite-Live, et non qu'il a lu
un autre auteur.
Plus loin encore, le poète décrit le meurtre de Scaevola,
tué devant l'autel de Vesta, et il place ce crime sacrilège
parmi les cruautés commandées par Marius. En réalité,
Scaevola ne fut égorgé qu'après la mort de Marius, lorsque
ses partisans désespérés laissèrent éclater toute leur rage (1).
Lucain a-t il, encore ici, commis une confusion de nom, appliqué à Marius ce qui concernait Marius le Jeune? C'est possible; pourtant je croirais plutôt que nous sommes en présence d'une de ces concentrations synthétiques comme nous en trouverons plus d'une dans son récit de la guerre civile. Scaevola ayant été massacré, sinon par Marius lui-même, au moins par ses successeurs et vengeurs, il lui a paru naturel de l'ajouter aux victimes proprement dites du terrible démagogue (1) : la narration y gagnait en clarté, et le tableau en force saisissante.
(1) On notera que le meurtre de Scaevola est raconté le dernier de ceux qui sont attribués à Marius.
En somme, aucune des digressions qui se rapportent à l'histoire romaine ne paraît déceler de recherches bien compliquées. Tantôt Lucain reproduit les souvenirs que lui ont laissés ses études d'autrefois, tantôt il puise dans l'histoire de Tite-Live, la plus répandue alors et pour ainsi dire la plus classique, et, là même où il s'en écarte, c'est pour des raisons littéraires, et pas du tout pour se mettre à l'école d'un autre historien.
S3.
Si, de l'histoire romaine, nous passons à l'histoire grecque,
nous constatons d'abord que celle-ci n'a fourni à Lucain qu'un
très petit nombre de développements : l'un sur Delphes,
au moment où Appius Claudius vient y consulter l'oracle
d'Apollon; un autre sur laThessalie,au moment où y arrivent
les deux armées rivales ; un autre enfin sur Alexandre, à
propos de sa sépulture à Alexandrie. On peut passer rapidement
sur ce dernier, qui ne contient rien de bien précis,
mais seulement des réflexions générales au sujet de la soif
de conquêtes d'Alexandre, de l'étendue de son empire, de sa
mort prématurée, et des dissensions intestines qui mirent
aux prises ses successeurs. Ce que Lucain écrit là, c'est le
« lieu commun », j'allais dire le « sermon » sur l'ambition,
que maints poètes et moralistes ont repris en choisissant
comme exemple typique le vainqueur d'Issus et d'Arbèles. On
n'y rencontre pas plus de détails particuliers que dans la satire
de Juvénal sur les voeux. C'est donc une page que Lucain a
pu parfaitement écrire avec des notions très vagues, les
notions de tout le monde, sur les conquêtes d'Alexandre, et
ceserait perdre son temps que de chercher la source historique
d'une pareille amplification.
Je ne crois pas non plus que Lucain ait été obligé de
compulser aucun livre d'histoire pour y trouver ce qu'il a
écrit au sujet de Delphes. Les indications qu'il donne
portent toutes sur des choses qui étaient alors, si l'on peut
dire, de notoriété publique parmi les littérateurs. «La double
cime du Parnasse se dresse dans les airs, aussi loin de l'Orient
que de l'Occident » : c'est tout simplement une paraphrase
de l'expression bien connue qui plaçait à Delphes le centre
ou le « nombril » de la terre. Puis vient la mention du double
culte de Phébus et de Bacchus sur la colline sacrée, puis celle
du déluge de Deucalion, puis celle de la lutte entre Apollon
et le serpent Python, de l'oracle deThémis, du gouffre aux exhalaisons prophétiques. La poésie gréco-latine avait
rendu familières aux jeunes écrivains toutes ces traditions.
De même, un peu plus loin, lorsqu'il mentionne les conseils
donnés par la Pythie aux Tyriens émigrants, aux Grecs
attaqués, aux victimes de disettes ou d'épidémies, etc. Lucain
ne fait que mettre en oeuvre des faits très connus, dont
ses lecteurs aussi bien que lui-même avaient cent fois entendu
parler. Il serait tout à fait superflu d'imaginer que,
pour composer ce développement assez court, Lucain ait dû
se référer à quelque traité spécial sur l'oracle de Delphes.
La digression sur la Thessalie est beaucoup plus étendue, et il me semble qu'on peut y distinguer deux
éléments différents. Il y a, d'une part, ce qui se rapporte au
passé de la Thessalie, c'est-à-dire des faits légendaires et non
historiques : la séparation de l'Olympe et de l'Ossa par
Hercule, et la mort de ce héros à Trachine ; la punition de
Thamyris par les Muses; la fureur d'Agavé;la querelle des
Centaures et des Lapithes ; le départ du navire Argo; la révolte
des Titans. Toutes ces fables Lucain les connaissait bien
avant de se mettre à l'oeuvre : elles étaient le fond même de
l'enseignement mythologique donné à propos de l'explication
des poètes; un bon élève des grammairiens et des rhéteurs
ne pouvait les ignorer. De plus, Lucain avait, pour son
propre compte, fait des vers sur des sujets mythiques;
nouvelle raison pour qu'il possédât à merveille les traditions
qu'il a ici rappelées. Mais, à côté de cela, nous trouvons
dans ce morceau des renseignements d'un caractère plus
scientifique, sur la configuration du pays, ses montagnes,
ses fleuves, les arts et les industries qui y ont pris naissance.
Ces renseignements sont donnés avec une précision minutieuse,
qui n'exclut pas les inexactitudes, mais qui, là même
où il y a erreur, prouve cependant une application particulière
et un recours probable à quelque livre de science.
Analysons-les de plus près.
Le poète commence par faire le tour, en quelque sorte, de
la région décrite, en indiquant dans leur ordre les divers massifs qui l'encerclent : Ossa, Pélion, Othrys, Pinde et
Olympe. Mais ici, il faut signaler une difficulté qui a échappé
aux éditeurs modernes. Lucain, fidèle à l'habitude de périphrase
astronomique si chère aux poètes latins, définit ainsi
la position de l'Ossa et du Pélion : « La Thessalie, du côté où
le Soleil se lève en hiver, est bornée par les rochers de
l'Ossa; lorque l'été, plus avancé, conduit Phébus dans les
hauteurs du ciel, c'est le Pélion qui oppose son ombre aux
rayons naissants de l'astre ». L'éditeur anglais Haskins
traduit la première périphrase par « au Sud-Est » et la
seconde par au « Nord-Est »; et en effet rien n'est plus
exact si l'on ne regarde que le texte de Lucain. Mais Haskins
oublie une chose : c'est le Pélion qui est au Sud-Est, et
l'Ossa au Nord-Est. Que penser dès lors? Lucain s'est il
trompé sur la position relative de ces deux montagnes? je
ne le crois pas, d'autant moins qu'il les a bien mises toutes
deux à leur place dans la ligne circulaire qui entoure la
Thessalie. Il me semble qu'il a commis, non pas une erreur
géographique, mais une erreur astronomique, ou tout au
moins une inadvertance de rédaction. Il a trouvé probablement
dans l'ouvrage consulté l'indication exacte ; Ossa au
Nord-Est, Pélion au Sud-Est. Voulant traduire cela en langage
astronomico-poétique, il a inconsciemment associé l'idée
de « Nord » à l'idée d'« hiver », et a oublié qu'en hiver
le soleil se lève, non pas plus au Nord, mais plus au Sud
qu'en été. La même confusion semble d'ailleurs se poursuivre
dans la phrase suivante : l'Othrys y est représenté
comme écartant « les feux du midi et la tête solstitiale du
Lion »; la première indication est très exacte, puisque
l'Othrys ferme au Sud la plaine Thessalienne; mais la seconde,
prise au pied de la lettre serait fausse, puisque le Lion se
lève, non au Sud-Est, mais au Nord-Est. Lucain ne dit donc
pas ce qu'il veut dire; mais ce qu'il veut dire est exact, et certainement emprunté à un livre de géographie. Son effort de
transcription a été plus heureux pour les autres massifs, le
Pinde et l'Olympe, qu'il définit l'un comme barrant la route
aux Zéphyrs et hâtant la tombée du soir, l'autre comme
protégeant les Thessaliens contre le Borée et les empêchant
de voir l'étoile polaire : ces périphrases conviennent bien
à la position occidentale du Pinde et à la position septentrionale
de l'Olympe.
Lucain décrit ensuite la « cuvette » ainsi bordée de tous
côtés, et jadis remplie d'un immense lac. Puis, ce lac a été
mis en communication avec la mer, et ici le poète énumère
les fleuves qui s'écoulent soit vers la mer Ionienne,
soit vers le golfe Maliaque, soit vers le golfe Thermaïque,
en caractérisant d'une formule brève le régime de chacun
d'eux : l'Aeas limpide, mais peu profond; l'Achéloüs bourbeux;
le Sperchius torrentiel; l'Enipeus, qui ne devient
rapide que lorsque ses eaux se mélangent à d'autres. Ce
dernier détail semble en contradiction avec celui que fournit
Ovide lorsqu'il appelle ce même fleuve irrequietus, mais
il ne faut pas croire à une inexactitude de la part de Lucain.
Ovide a pu confondre l'Enipeus avec le fleuve dans lequel il
se jette, l'Apidanus. Lucain, lisant dans un traité de géographie
que c'est l'Apidanus qui est rapide et que l'Enipeus ne
le devient que lorsqu'il est joint à lui, a saisi avec joie cette
occasion de rectifier ce qu'avait dit son prédécesseur,
rectification un peu pédantesque, qui témoigne d'une
science fraîchement acquise. Il en est de même des vers suivants,
où Lucain signale la curieuse particularité du Titarèse,
qui coule avec le Pénée sans se confondre avec lui. Qu'on joigne à cette énumération les vers où le poète
rappelle, un peu plus loin, que c'est en Thessalie qu'ont pris
naissance l'élevage des chevaux, la fabrication des navires et
le travail des métaux (1) : on aura un fragment d'exposé
géographique, développé en une langue poétique souvent
ingénieuse, quoique parfois inexacte.
(1) Luc., VI, 395-402. Ces « inventions » sont, il est vrai, présentées sous forme mythique; mais les géographes anciens faisaient souvent une place au récit des légendes locales.
Il n'est guère à présumer
que les souvenirs d'école de Lucain aient pu ici le servir
d'une manière suffisamment sûre. Autant, tout à l'heure,
pour les faits légendaires, j'inclinais à croire qu'il exploitait
simplement des connaissances communes à tous les lettrés
d'alors, autant je suis disposé cette fois à admettre l'influence
directe d'une source scientifique. Laquelle? est-ce un livre
spécial sur la Thessalie? est-ce un chapitre d'une géographie
générale? cette seconde hypothèse me paraît préférable,
d'autant plus que le passage en question n'est pas le seul
qui la suggère, loin de là.
En effet, si les digressions purement historiques ne sont
pas très nombreuses dans la Pharsale, en revanche les
excursus géographiques n'y sont pas rares. La topographie,
et aussi l'étude des moeurs des peuples, inséparable chez les
anciens de celle des pays, fournissent au poète une ample
matière. Supposons qu'il ait eu entre les mains une Descriptio
orbis terrarum analogue à celles de Pomponius Mela et de
Pline l'Ancien : il sera peut-être assez facile de reconnaître à
quels moments il s'en est servi.
Il a dû en faire usage dans sa description des montagnes
et des cours d'eau de l'Italie. Cette description est en effet
tracée avec une réelle exactitude. S'il y a dans l'énumération
des fleuves un peu de désordre, imputable peut-être
aux nécessités de la versification, la configuration
générale du pays est par contre très bien dessinée : l'Apennin dressant l'arête centrale de la Péninsule; de chaque côté,
deux contreforts aboutissant à Pise et à Ancône ; au Nord,
la plaine à travers laquelle le Pô charrie à la mer les arbres
arrachés aux Alpes ; au Sud le massif sicilien, qui jadis
n'était pas séparé de l'Apennin. Même en ce qui concerne
les rivières, Lucain se plaît à mentionner quelques particularités
caractéristiques : la vitesse torrentielle du Métaure et
du Crustumium, les gorges traversées par le Rutuba,
les exhalaisons qui pendant la nuit se dégagent du Sarnus,
les plaines cultivées qu'arrose le Siler, les bas-fonds du
Macra et son voisinage du port de Luna. Ou bien encore
il évoque les vieilles fables associées aux noms de ces
fleuves : la légende de Phaéthon et de ses soeurs sur les rives
du Pô, celle de Marica sur les bords du Liris. L'érudition
dont il fait preuve dans tout ce passage me paraît dépasser
celle que pouvait posséder le public simplement lettré; il
a dû la puiser dans la Géographie dont nous avons supposé
l'existence.
Il a pu se reporter au même ouvrage en notant les diverses
étapes du voyage de Pompée après la défaite de Pharsale,
soit pour contrôler les données de Tite-Live, soit pour les
compléter : en particulier les détails qu'il fournit sur la mer
calme de Colophon, les roches écumantes de Samos, les côtes
ensoleillées de Rhodes et la dépopulation de Phaselis, ne
pouvaient guère se trouver dans le récit de l'historien.
Un peu plus loin, lorsque Pompée songe à s'allier avec
les Parthes et que Lentulus combat son avis, le poète
nous donne sur ce peuple des renseignements très précis. Sans doute, il y en a dans le nombre qui devaient être à
Rome de notoriété courante : l'habileté des Parthes à tirer
de l'arc, par exemple, et leur pratique de l'inceste.
Mais Lucain ne s'en tient pas à ces connaissances banales.
Relisons ce que dit Pompée au commencement du débat :
il connaît les frontières des Parthes (Euphrate et Caspienne),
l'étendue de leur empire et la couleur rouge de la mer qui
le baigne, la grandeur de leurs chevaux, leurs victoires (sur
les Macédoniens, Baciriens, Mèdes, Babyloniens), leur
usage de traits empoisonnés. Son contradicteur Lentulus
paraît également bien documenté sur les Parthes : il
parle de leurs longues robes ; il rectifie l'opinion de Pompée
sur leur valeur guerrière, en spécifiant qu'autant ils sont
redoutables dans les steppes d'Asie, autant ils sont peu faits
pour combattre en pays de montagnes; il signale tout ce
qui manque à leur armement. Bref ces deux argumentations
contradictoires reposent toutes deux sur des faits très particuliers,
qui ne peuvent avoir été tirés que d'un ouvrage
géographique.
§4
Nous avons rencontré jusqu'ici dans la Pharsale, d'une part
des allusions historiques assez banales pour pouvoir être
attribuées à de simples réminiscences d'écolier, d'autre part
des renseignements géographiques beaucoup plus précis,
qui nous donnent à penser que Lucain s'est servi de quelques
Descriptio orbis terrarum, sans que, bien entendu, nous
puissions deviner laquelle. Mais, en dehors des passages que
nous venons d'étudier, il y en a trois dans lesquels le poète
étale une érudition tout à fait exceptionnelle : c'est l'énumération
des peuples gaulois, la description de l'Afrique, et
celle de l'Égypte. Sur ces trois points, il paraît posséder
des notions trop abondantes et trop minutieuses pour que l'on puisse raisonner comme dans les cas précédents : il en
sait beaucoup plus que n'en devaient savoir la plupart des
gens cultivés ; il en sait même plus que n'en disaient sans
doute les « manuels » de géographie. Il est donc extrêmement
probable que, sur chacun de ces trois sujets, ce qu'il
dit provient d'une source scientifique plus ou moins autorisée,
peut-être, plus ou moins fidèlement suivie aussi,
mais d'une source spécialement consultée.
En ce qui concerne la Gaule, nous ne connaissons pas de
géographe qui ait consacré un ouvrage à l'étude exclusive
de ce pays ; mais nous connaissons au moins un historien
qui s'en est occupé d'une manière détaillée : c'est l'historien
le plus célèbre de tous à cette époque, et celui que Lucain
a le plus assidûment pratiqué, c'est Tite-Live. Son livre CIII
contenait, à propos des guerres de César, une description de
la Gaule, comme le livre suivant en contenait une de la
Germanie : le témoignage de l'Epitome est formel à cet
égard. Vainement voudrait-on le révoquer en doute sous
prétexte que, dans les parties conservées de son histoire,
Tite-Live ne s'étend pas longuement sur les régions conquises
: ici la situation est tout autre. La Sicile, la Macédoine,
la Grèce, l'Asie, la Numidie, étaient des pays depuis
longtemps connus du public romain : la géographie n'en
aurait pas offert grand intérêt. Au contraire, à l'époque où
Tite-Live écrivait, la Gaule était encore une terre neuve,
récemment incorporée à l'empire, à demi assimilée seulement,
et dont les rites et les moeurs devaient piquer au vif
la curiosité des lecteurs romains, sans compter que l'annexion
de ce vaste territoire était un des faits sensationnels
de la plus récente histoire. Il est donc fort compréhensible
que Tite-Live, avant de narrer les campagnes de César, ait
voulu en décrire assez longuement le théâtre.
Et s'il l'a fait il est fort naturel aussi que Lucain se soit
adressé à lui de préférence à tout autre. Ussani prétend le
contraire : puisque, dit-il, le poète a cité dans cette partie
du Ier chant des noms propres qu'il n'a reproduits nulle part ailleurs, c'est qu'il avait sous les yeux un texte auquel il
n'est pas revenu depuis. Mais la chose peut s'expliquer plus
simplement : si Lucain n'a pas nommé ailleurs les peuples et
les localités de la Gaule, c'est qu'il n'avait pas à en reparler,
et voilà tout. D'ailleurs le texte de Tite-Live sur la Gaule
constituait bien pour Lucain une source particulière, distincte
de celle qui lui a servi pour l'ensemble de son poème :
il appartenait, sans doute, au même ouvrage que les livres
qui racontaient la guerre civile, mais à une autre partie de
cet ouvrage ; et il est plus que probable que Lucain, qui s'est constamment inspiré des livres CIX à CXI, n'a fait appel au
livre CIII que pour le passage relatif aux peuples gaulois.
Si l'on admet notre hypothèse, ce passage acquiert une
importance singulière, puisqu'il devient le reflet de la grande
oeuvre perdue de Tite-Live en une de ses parties les plus
intéressantes pour notre curiosité moderne. Il est vrai que
l'on peut discuter sur le plus ou moins d'exactitude que
Lucain a dû mettre à traduire en vers les indications fournies
par Tite-Live. Et ici nous nous heurtons à l'opinion d'un de
ses plus savants éditeurs, opinion très nette et très dure pour
le poète. « Lucain, dit M. Lejay, avait dans ses papiers une
liste, peut-être une carte des peuples de la Gaule avec les
noms de quelques fleuves et de quelques montagnes.
D'autre part, outre quelques notes sur la conquête et sur les
druides, il possédait une description générale et schématique
du Gaulois. Pour grouper et utiliser cette double
série de renseignements, il n'y avait plus qu'à appliquer au
petit bonheur chacun des traits de la description à l'un des
noms de peuples, un de ceux que la situation géographique
ou les souvenirs de la guerre des Gaules laissaient sans épithète
caractéristique. »
Ce jugement sévère n'a pas été sans soulever des protestations,
et Lucain a trouvé d'énergiques défenseurs : « Lucain
aime à montrer son savoir, dit M. Salomon Reinach, mais
son savoir est réel ; » et M. Jullian, à son tour, reprend :
« Ce n'est pas par fantaisie de poète, je crois, que Lucain a donné à chacun des peuples gaulois dont il parle une caractéristique
». La question, ainsi posée, mérite d'être examinée
de près : si l'on devait en croire M. Lejay, non seulement
le passage relatif à la Gaule n'aurait aucune autorité,
mais il deviendrait même superflu d'en rechercher la source :
peut-on parler de « source » à propos d'une peinture faite
« de chic », d'une amplification d'écolier verbeuse et vide?
Heureusement pour Lucain, il me semble possible de démontrer
qu'il a voulu, non pas faire du remplissage, mais composer
une description méthodique, aussi méthodique que
la poésie le comporte.
Essayons d'abord de définir l'ordre qu'il a suivi. A première
vue, cet ordre nous parait quelque peu incohérent.Mais il faut
nous rappeler que les désignations géographiques des anciens
ne concordent pas toujours exactement avec les nôtres, et
aussi que certains noms de lieux ou de peuples risquent de
nous induire en erreur parce que nous n'avons que des
notions fragmentaires sur la géographie de la Gaule. Ainsi
le mot Vosegus peut s'appliquer aux monts Faucilles ou au
plateau de Langres aussi bien qu'aux Vosges proprement
dites ; d'autre part, il a dû y avoir d'autres Némètes que
ceux de Spire, etd'autres Cinga que l'affluentde la Sègre (1).
(1) Luc., I, 432. — L'hypothèse de LEJAY, que cette Cinga est celle d'Espagne, me semble insoutenable. S. REINACH rappelle la conjecture de Weber, Sulga (la Sorgue). Mais les habitants de la région de Vaucluse auraient dû être mentionnés plus haut, aux vers 402 sqq. Je crois plutôt qu'il s'agit d'une Cinga du centre de la Gaule, que nous ne pouvons identifier. Les noms de rivières se répètent souvent dans les régions gauloises : Isara est à la fois l'Isère et l'Oise, etc
Ces précautions prises il me semble qu'on peut se rendre compte de l'ordre adopté par Lucain, au moins dans l'ensemble de son énumération. Il mentionne d'abord, en allant vers le Sud, les peuples du bassin du Rhône : riverains du Léman et Lingons, riverains de l'Isère, Rutènes, riverains de l'Aude et du Var. Puis, passant au versant de l'Océan, et indiquant avec un soin extrême qu'il s'agit d'une mer toute différente de la Méditerranée, il cite les Némètes et les riverains de l'Adour, les Santons, les Bituriges, les Suessions, les Leuques et les Rèmes, les Séquanes, et, sous le nom de Belges, un peuple qui pourrait être les Médiomatriques : c'est-à-dire qu'il va sensiblement du Sud-Ouest au Nord-Est. Ici une difficulté se présente, avec les deux vers consacrés aux Arvernes. Puis, Lucain reprend sa marche vers le Nord, avec les Nerviens, les Vangions et les Bataves. Ensuite, il revient au centre de la Gaule, qu'il a laissé de côté, et parle de la Cinga (?), de la Saône, des Cévennes. Là se trouve la fameuse interpolation relative aux Pictones, Turones et Andes, dont il n'y a pas à tenir compte puisqu'elle ne se trouve pas dans les manuscrits, et lorsque le texte de Lucain reprend, nous rencontrons les Trévires, assez singulièrement placés ici ; puis les Ligures; puis les adorateurs de Teutatès, d'Esus et de Taranis, c'est-à-dire probablement les Carnutes (1).
(1) Opinion de JULLIAN (Revue des Etudes Anciennes, 1902, p. 218). S. REINACH
avait précédemment émis l'hypothèse que les vers 444-446 se rapportaient
à un ou plusieurs peuples de la région entre la Seine, la Loire et l'Océan.
L'interprétation de JULLIAN précise cette hypothèse plutôt qu'elle ne la contredit,
et elle est d'accord avec ce que nous savons du culte sanglant en usage
chez les Carnutes.
Enfin, tout à fait en dernier lieu, après la digression sur les bardes et les druides, Lucain parle d'une tribu transrhénane,dont le nom est défiguré par les manuscrits, et qui doit être celle des Chauques : nous avons d'autant moins à nous en occuper que les trois vers qui lui sont consacrés ont été suspectés par plusieurs commentateurs. Dans tout ce qui précède, il n'y a en somme que deux anomalies véritables : c'est la mention des Arvernes entre les « Belges » et les Nerviens, et celle des Trévires entre les habitants des Cévennes et les Ligures. Elles ont ceci de particulier que les choses deviendraient bien plus claires, si chacun des deux peuples en question était nommé à la place de l'autre (1). Il serait peut-être téméraire de conclure à une transposition. Si l'on s'y décidait, on aurait un ordre parfaitement régulier, savoir : l°le bassin du Rhône ; 2° la grande courbe qui contourne le massif central, allant du Sud-Ouest au Nord-Est ; 3° le massif central ; 4° tout à fait au Sud-Est, le groupe isolé des Ligures; 5° tout à fait au Nord-Ouest, la forêt des Carnutes. Quoi qu'il en soit, étant donnée la facilité, dans un passage de ce genre, des additions, omissions et transpositions (2), il me parait incontestable que Lucain a cherché à suivre une marche méthodique, là même où l'état actuel du texte ne nous permet pas de la ressaisir.
(1) Si l'on transposait 427-428 et 441, il faudrait admettre que nimiumque rebellis (ou plutôt rebelles, leçon du Ms. de Paris 7502) se rapporte à Aruerni et non à Neruius ; que par suite le vers 429 Neruius et caesi poilutus sanguine Cottae est rattaché au vers 441 par la conjonction et placée après le premier mot. Mais ni l'une ni l'autre de ces deux difficultés n'est insurmontable : l'épithète nimium rebelles peut convenir aux Arvernes, auteurs du principal soulèvement contre César; la postposition de et après le sujet est possible en poésie. Une objection plus forte peut se tirer de l'apostrophe du vers 442, et nunc tonse Ligur : elle s'explique bien après l'apostrophe du vers 441, tu quoque laetatus ; après un vers sans vocatif elle serait un peu brusque.
(2) L interpolation des vers 436-440 est certaine parce qu'aucun manuscrit ne les donne de première main. Mais d'autres additions ont pu être imaginées antérieurement et prendre place dans le texte même. Qui nous dit, par exemple, que le vers sur les Trévires n'a pas été fabriqué par un scribe du III ou du IVe siècle, étonné de ne pas voir nommé le pays où s'élevait alors une des capitales de l'empire?
De l'ensemble de cette énumération, si nous descendons
aux détails, nous voyons que tous n'ont pas le même caractère.
Il y a des peuples que Lucain définit en se servant de
particularités géographiques de leur territoire ; d'autres auxquels
il applique une qualification tirée de leur genre de vie ;
d'autres enfin à propos desquels il rappelle un fait historique. Les indications de la première catégorie sont très exactes.
La profondeur des eaux du Léman; le long cours de
l'Isère avant d'aller se joindre au Rhône ; la tranquillité de
l'Aude ; le choix du Var, à une époque postérieure à la
guerre civile, pour marquer la frontière de l'Italie ; la
position du port de Monaco ; l'importance de la marée
sur les côtes de l'Océan ; la courbe du golfe de l'Adour ;
la rapidité du Rhône entraînant avec lui les eaux de la
Saône ; les pics neigeux et escarpés des Cévennes : ce
sont là autant de traits dont il n'y a qu'à noter au passage
la très suffisante précision.
Lucain met-il autant de soin à caractériser les peuples
qu'à décrire les pays? C'est ici que les assertions de M. Lejay
sont le plus délicates à discuter, parce que nous connaissons
assez mal les différentes nations de la Gaule. Essayons
cependant d'apprécier ce que dit le poète de chacune d'elles.
A propos des Lingons, il parle de picta arma : qu'est-ce au
juste ? arma désigne proprement des armes défensives, sans
doute ici des boucliers; picta peut s'appliquer indifféremment
au coloriage, à la gravure, à l'incrustation : peut-être
faut-il y voir une allusion aux boucliers ornés d'émail que
l'on fabriquait à Bibracte, et dont les Lingons, proches voisins
des Eduens, devaient user volontiers. Les Rutènes
sont appelés flaui, et sans doute ils ne sont pas les seuls
hommes blonds parmi les Gaulois; mais si leur nom, comme
le pensent certains linguistes, vient d'une racine signifiant
« rouge », l'épithète leur sied fort bien. Les peuples du
Nord-Est sont représentés comme employant des armes spéciales, tantôt la longue lance (les Suessions), tantôt le
javelot (les Leuques et les Rèmes) : ces armes ont dû être
connues, à une certaine époque, de tous les Gaulois, et en
cela M. Lejay a parfaitement raison ; mais en fait, à l'époque
de César, nous les voyons surtout utilisées par des peuples duBelgium. De même le char de guerre, le couinnus, parait
s'être plus longtemps conservé chez les Belges que chez les
peuples de la Celtique, et c'est surtout dans les sépultures du
Nord-Est que nous le trouvons aujourd'hui : Lucain est
donc parfaitement fondé à appeler un peuple belge (probablement
les Médiomatriques, comme nous l'avons dit plus
haut) docilis rector couinni. Le soin qu'il prend de distinguer
ce peuple de son voisin, le peuple séquane, et d'opposer aux
chars de l'un les chevaux montés de l'autre, prouve bien
qu'il a en vue deux nations distinctes et deux modes de combat
distincts. Au sujet des Vangions, M. Lejay reproche à
Lucain d'avoir cité leurs laxae bracae, qui, dit-il, sont un
vêtement essentiellement gaulois, répandu dans toute la
Gaule, et d'autant moins opportun à mentionner ici que les
Vangions sont précisément des demi-Germains : mais le poète
dit en propres termes que les braies des Vangions rappellent
celles des Sarmates par leur largeur ; c'est donc qu'il ne leur
attribue pas le même costume qu'aux autres Gaulois. Restent les Bataves, qualifiés de «farouches », ce qui est à
coup sûr une épithète un peu vague ; Lucain parle aussi des
trompettes stridentes et recourbées qui les excitent au combat : nous savons trop peu de chose sur les Bataves pour pouvoir dire si ce détail leur convient particulièrement.
Mais, dans tout ce qui précède, nous avons trouvé le poète
soucieux d'approprier ses épithètes et ses périphrases aux
peuples dont il parle, et nullement disposé à les jeter au
hasard.
Quant aux allusions à des faits historiques, elles sont au
nombre de trois seulement. L'une d'elles est parfaitement
claire : c'est celle qui concerne le massacre de Cotta et de ses
compagnons par les Nerviens. Une autre rappelle l'ancienne
prééminence des Ligures en Gaule, et la longueur de
leurs cheveux, contrastant avec leur habitude actuelle d'avoir
la tête rasée : elle ne soulève aucune difficulté. Celle qui
a provoqué le plus de discussions, et qui est d'ailleurs la plus
intéressante, est celle qui se rapporte aux Arvernes et à
leur prétendue origine troyenne. Le texte de Lucain est le
seul qui nous ait conservé le souvenir de cette tradition si
curieuse, car les deux passages de Sidoine Apollinaire
que l'on cite souvent sont inspirés par une réminiscence de
la Pharsale. De plus, ce texte semble démenti par l'assertion
de Tacite, que «les Eduens étaient seuls à être appelés frères
du peuple romain » (1).
Aussi a-t-on pensé que le poète avait confondu les Arvernes avec leurs voisins et rivaux les Eduens : cette opinion, qui se trouve déjà dans le Commentum Bernense, a été reprise par Hirschfeld et par Haskins. Par contre, Birt, M. Lejay, M. Jullian, inclinent à prendre au sérieux l'allégation de Lucain : je crois qu'ils ont tout à fait raison, et voici, à l'appui de leur façon de voir, deux arguments qui ne me semblent pas avoir encore été mis en lumière, et qui sont peut-être assez probants. D'abord, il n'est pas exact que la « fraternité » des Eduens avec les Romains ait reposé, comme on le croit, sur une parenté ethnique : l'orateur qui, au début du ive siècle, a présenté à Constantin les remerciements de la cité d'Autun, dit formellement le contraire, en opposant ses compatriotes aux Iliens d'Asie ; à l'en croire, le lien entre les Eduens et Rome est purement moral, fait de sympathie mutuelle et de services échangés. Lucain, au contraire, dit que les Arvernes prétendent descendre des Troyens, ce qui n'est pas du tout la même chose En outre, les Eduens ont été appelés « frères » par le gouvernement romain, tandis que les expressions de Lucain ne conviennent qu'à une prétention désavouée par Rome. Dès lors, voici, je crois, comment les choses ont dû se passer. Après la conquête, voulant gagner la bienveillance des vainqueurs, et rivaliser en cela avec leurs vieux adversaires les Eduens, les Arvernes ont imaginé une fable qui les faisait descendre de Troie, peut-être en s'appuyant sur quelque légende que nous ignorons. Cette tentative a échoué, ce qui explique et la phrase de Lucain et l'assertion de Tacite. Seulement leur prétention avait été enregistrée par Tite-Live, chez qui Lucain l'a trouvée. Il nous a donné aussi des détails sur la vie religieuse des Gaulois, moins nombreux que nous ne le voudrions, non négligeables pourtant. Parmi les dieux, il ne mentionne que Teutatès, Esus etTaranis, sans les caractériser autrement que par le culte sanglant qui leur est rendu (1), sans même que nous puissions savoir avec certitude s'il y voit des dieux locaux ou des divinités communes à toute la Gaule (2).
(1) Nous ignorons le sexe de Taranis, et la vraie forme de son nom : Taranis peut être un nominatif ou un génitif régime de ara, sans compter qu'un Ms. a Tarani.
(2) La thèse des dieux panceltiques a été soutenue par la plupart des historiens. Celle des dieux locaux a été proposée par S. REINACH, Cultes, mythes et religions, 1, pp. 204 sqq., et discutée par JULLlAN, Revue des Et. Anc., 1902, p. 118. L'hypothèse la plus probable est celle de JULLIAN : des dieux adorés partout, mais spécialement sur un territoire particulier (Carnute)
Il
signale en passant les poèmes consacrés par les bardes aux
exploits des héros, et arrive enfin aux druides. Ce qu'il
en dit n'est certainement pas tout ce qu'il en aurait pu dire,
tout ce qu'en savaient les anciens : il néglige ce qui a trait à
leur discipline intérieure, à leurs relations avec la Bretagne,
à leur rôle judiciaire, politique, amphictyonique, etc II ne
s'attache qu'à ce qui l'intéresse comme poète ou comme
philosophe : d'une part ce qu'il y a de curieux ou de pittoresque
chez les druides, leurs sacrifices humains et leur
vie au fond des forêts ; d'autre part leur doctrine métaphysique
et morale, leur croyance à une vie future dans un
autre monde, et leurs exhortations au mépris de la
mort. Sur tous ces points, son témoignage est d'accord
avec celui des autres écrivains anciens, notamment de César
et de Pomponius Mela (1). Diodore et Strabon, qui parlent
des sacrifices humains, sont muets sur l'enseignement
druidique (2) ; et cela doit peut-être nous amener à corriger
légèrement l'hypothèse admise en général, d'après laquelle
tous ces écrivains procéderaient de Posidonius.
(1) Sur les sacrifices humains, CAES., VI, 16. — Sur la vie future, CAES., VI, 14, 5; MEL, 1II,2, 19. — Sur l'enseignement druidique en général, CAES., VI, 14, 5; MELA, 111, 2, 18-19.
(2) Noter toutefois que DIODORE, VI.28, 6, parle de la croyance à la vie future
Il est possible que Posidonius n'ait rien dit de cet enseignement : César a dû ajouter aux indications de ce géographe celles qu'il tenait de ses propres observations et de ses entretiens avec le druide Divitiacus. Tite-Live a dû utiliser à la fois Posidonius et César, et servir à son tour de source à Lucain et à Pomponius Mela. De la sorte, si, dans cette question tant discutée du druidisme, Lucain n'ajoute rien à ce que nous pouvons savoir par ailleurs, la comparaison que nous venons d'établir entre lui et les autres auteurs grecs et latins nous atteste du moins la sûreté de son information. C'est par là, je crois, qu'il est permis de conclure sur ses assertions relatives à la Gaule. Moins minutieux qu'un historien ou un géographe de profession, il se montre aussi précis que peut l'être un poète épris de réalité historique et géographique. Loin d'amplifier sans ordre et sans choix, comme on l'en a souvent accusé, il note, sur les différents peuples de la Gaule, maints détails typiques, qu'il a empruntés de Tite-Live, que Tite-Live lui-même tenait d'autorités plus anciennes, et qui par là sont d'un prix considérable aujourd'hui encore.
§ 5.
Lucain n'a parlé, et ne pouvait guère parler, qu'une seule
fois de la Gaule. Au contraire, il est revenu à deux reprises
sur l'Afrique, d'abord à propos de la guerre soutenue par
Curion contre Juba et Varus, puis à l'occasion de la marche
entreprise par Caton pour aller retrouver Juba. Ces deux
digressions n'ont, tant s'en faut, ni la même étendue, ni la même valeur. La première n'est qu'une définition assez
sommaire du pays que le poète considère comme gouverné
par Juba. Il en détermine les limites, d'une façon quelque
peu obscure, par l'Atlas (près de Gadès), l'oasis d'Hammon
et l'Océan. Il en énumère ensuite les peuples, sans beaucoup
d'ordre, mais en les qualifiant d'épithètes assez
justes, sinon très strictement particularisées : les Numides
sont vagabonds, les Nasamons pauvres, les Gétules et
les Massyliens savent monter les chevaux sauvages, les
Marmarides sont agiles, les Mazaces sont d'adroits
tireurs, les Africains d'excellents chasseurs de lions,
les Maures et les Garamantes ont le teint brûlé par le
soleil. Toutes ces notions, d'une exactitude suffisante,
peuvent avoir été prises dans une géographie générale, mais
plutôt encore dans un traité spécial. Enfin, il y a une grosse
difficulté, d'ordre historique plutôt que géographique :
Lucain regarde tous ces peuples, depuis le détroit de Gadès jusqu'à l'Égypte, comme soumis à Juba : en réalité,
Juba ne possédait que la Numidie ; la Maurétanie appartenait
à Bocchus et à Bogud. Plus tard, son fils Juba II reçut la
Maurétanie, mais perdit en même temps la Numidie, qui
devint province romaine, si bien que jamais ce vaste empire
imaginé par le poète n'a appartenu à aucun prince de cette
dynastie.
La description de l'Afrique tient beaucoup plus de place
au livre IX qu'au livre IV. A partir du moment où Caton
s'empare de Cyrène jusqu'à celui où il arrive en vue de
Leptis, la géographie se mêle constamment au récit. Les
connaissances que possède Lucain sur le pays africain sont
d'ailleurs complexes et d'une sûreté fort inégale. Sur la
topographie générale, il fait une remarque très juste, en disant qu'on a peut-être tort de distinguer trois parties du
monde, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, puisque l'Afrique et
l'Europe sont égales entre elles, et que l'Asie à elle seule est
aussi grande qu'elles deux. Sans doute cette discussion de
mots n'a pas une très grande importance, mais enfin Lucain
se montre soucieux de précision en rectifiant l'opinion commune et en comparant les dimensions des trois parties
du monde.
Sur la topographie particulière des diverses contrées
africaines, ses indications prêtent beaucoup plus à la critique.
Tout d'abord, son exposé est assez clair : après avoir
pris Cyrène, Caton s'embarque pour traverser les Syrtes, y
subit une violente tempête, finit tout de même par atterrir
auprès du lac Tritonis. Il devrait donc être tout au fond de la petite Syrte, aux confins de la Tripolitaine et de la
Numidie. Mais voici que le poète, en décrivant le lac Tritonis,
le place près du Léthon et du jardin des Hespérides,
lesquels se trouvent de l'autre côté des Syrtes, dans la Cyrénaïque. Est-ce le jardin des Hespérides qu'il met trop à
l'Ouest ou le lac Tritonis trop à l'Est? Francken penche pour
cette seconde explication; elle me paraît, comme à lui,
confirmée par la suite du récit. Je crois même qu'on peut,
jusqu'à un certain point, rendre compte de l'erreur de
Lucain : il aura confondu les deux Syrtes, lu peut-être ou cru
lire Tritonis pallus iuxta Syrtim maiorem au lieu de minorem.
Il faut donc admettre que, dans la Pharsale, Caton, au lieu de
traverser les Syrtes. est rejeté par la tempête à son point de
départ ou à peu près ; alors, il renonce à son premier
projet, et entreprend de faire le tour du golfe. Ici se
dresse une autre difficulté, ou plutôt deux. La petite armée
romaine vient à passer par l'oasis d'Hammon : or, non
seulement, en fait, Caton n'y est jamais allé, mais on ne
peut y passer quand on se dirige de la Cyrénaïque vers la
Numidie, puisqu'elle est située à l'Est de la Cyrénaïque; il y
a donc là, non seulement une inexactitude historique, mais
une impossibilité géographique. En outre, cette oasis, au
dire du poète, est caractérisée par des phénomènes astronomiques
qui ne peuvent convenir qu'à un lieu situé sous l'Equateur : l'obliquité de l'écliptique n'y est pas sensible ;
les jours et les nuits y sont égaux en toute saison ; enfin
les peuples situés au delà de cette oasis voient tomber au
Sud l'ombre qui pour nous tombe au Nord, et pour eux
l'étoile polaire va au-dessous de l'horizon. Mais l'oasis
d'Hammon est située au Nord du tropique du Cancer, à fortiori
au Nord de l'Equateur. Ces deux anomalies doivent tenir à la même cause : Lucain a supposé l'oasis beaucoup
plus au Sud qu'elle ne l'est réellement; comme d'autre
part il a cru la côte méditerranéenne de l'Afrique dirigée,
non de l'Ouest à l'Est, mais du Nord-Ouest au Sud-Est,
ces deux erreurs combinées ensemble nous permettent de
comprendre la topographie que suppose le voyage de Caton.
Elle n'en reste pas moins d'une inexactitude remarquable,
et il faut, ou bien que Lucain ait eu sous les yeux un traité
très mal documenté à cet égard, ou qu'il l'ait lui-même
interprété d'une manière singulièrement fautive.
Par contre, autant il nous déconcerte en ce qui touche à
la configuration des lieux, autant il est bien renseigné sur ce
que nous appellerions la géographie économique de l'Afrique.
Il distingue deux régions fort différentes : celle de
l'Ouest, fertile malgré le manque d'eau, dépourvue de
richesses minérales mais ombragée de citronniers et
abondante en terres labourables, et celle qui s'étend entre
la Numidie et la Cyrénaïque, la plus pauvre et la plus
curieuse, celle sur laquelle il donne le plus de détails. La
mer elle même y est d'un aspect bizarre, tellement entrecoupée
de bas-fonds qu'on dirait un marécage mal desséché, un domaine ambigu entre la terre et la mer (1).
(1) Luc., IX, 303-307. Sur l'origine de cet état de choses, Lucain ne se prononce pas. Il émet successivement deux hypothèses : ou bien c'est un état durable, voulu par la nature (303-311) ; ou bien il provient de ce que les Syrtes sont une ancienne mer, à demi desséchée, et destinée à se dessécher encore plus (311-318).
Tout autour de ce golfe des Syrtes sont des déserts de sable,
également réfractaires à la culture du blé, de la vigne et de toute autre plante: c'est à peine s'il y pousse quelques
herbes clairsemées. Les sauvages qui habitent ce pays stérile
et brûlé par le soleil ne vivent que de leur industrie
de naufrageurs. Cette vaste plaine nue est exposée aux
ravages furieux du vent; c'est le simoun, dont les effets
sont décrits avec autant de précision pittoresque que la
navigation à travers les Syrtes : nuages de poussière,
débris de toitures et armes pesantes enlevées par le tourbillon, monceaux de sable transportés d'un endroit à
l'autre et menaçant d'engloutir les voyageurs. En
contraste avec cette scène de désolation, le poète nous présente
l'oasis d'Hammon, le seul point où il y ait de l'eau et
des arbres au milieu de la plaine poussiéreuse et sèche.
Voilà autant de peintures, non seulement exactes, mais fortes,
saisissantes, telles que pourrait les tracer un témoin oculaire.
En somme, dans ces excursus du IXe livre, plus encore
que dans celui du IVe, nous apercevons une opposition fort
nette : les renseignements techniques sont peu sûrs, et ceux
qui concernent les sites et les habitants sont très précis ;
d'une part une topographie imparfaite, d'autre part des
« vues » d'Afrique tout à fait vivantes. Une telle inégalité
s'expliquerait peut-être si l'on admettait que, pour ce qui est
géographie pure, Lucain s'est documenté, un peu à la légère,
dans un manuel médiocre, et qu'au contraire il a pris ses
descriptions dans un ouvrage plus détaillé, peut-être même
dans un ouvrage rédigé d'après des impressions personnelles.
Mais ce n'est qu'une hypothèse; nous connaissons
trop mal la littérature géographique des anciens relative à
l'Afrique pour oser prononcer des noms propres. Nous
savons bien que Suetonius Paulinus écrivit un ouvrage sur l'Afrique après son expédition dans ce pays : mais cette
expédition fut dirigée contre les peuplades de l'Ouest, et au
contraire ce qu'il y a de plus frappant, de plus « vécu »,
dans les peintures de Lucain, se rapporte aux Syrtes et aux
plaines de sable qui les bordent. Force nous est donc de
rester dans l'incertitude.
C'est à dessein que j'ai laissé de côté l'épisode des serpents. D'abord il a un caractère tout particulier et doit
provenir d'une source spéciale. Ensuite nous avons à son sujet
un renseignement précieux : le COMMENTUM BERNENSE dit
que Lucain s'est documenté sur les noms des serpents, soit
en lisant les Theriaca de Macer, soit en interrogeant les
Marses, aussi célèbres que les Ophiogènes et les Psylles
comme charmeurs de serpents. De ces deux hypothèses, la
seconde est invraisemblable : on voit mal Lucain allant
faire une enquête chez les Marses, et d'ailleurs, s'il leur avait
dû ses connaissances en matière herpétologique, il les aurait
mentionnés, tandis qu'il dit formellement que les Psylles sont
le seul peuple à l'abri du venin des reptiles. La seconde
supposition, au contraire, a été développée par Fritzsche,
et est très plausible. En effet, le texte de Lucain présente de
nombreuses ressemblances avec celui du poète grec Nicandre : or, nous savons que les Theriaca de Nicandre
étaient le modèle imité par Macer. D'un autre côté,
l'énumération de la Pharsale mentionne plusieurs serpents qui ne sont pas nommés par l'auteur grec : donc celui-ci
n'est pas la source directe de Lucain ; au contraire il est
probable que Macer, suivant l'habitude des adaptateurs
romains, avait ajouté aux notions qu'il tenait de Nicandre
des renseignements puisés ailleurs. A ces arguments très
convaincants, je ne vois pas quelle objection on pourrait
opposer.
J'y ajouterais volontiers pour ma part la considération
suivante. Après avoir décrit plusieurs morts de soldats
romains victimes des reptiles, et après avoir éloquemment
résumé les plaintes des compagnons de Caton, Lucain continue
en montrant les Romains sauvés par les Psylles, et à ce
propos il décrit les procédés par lesquels les gens de
ce peuple chassent les serpents ou en guérissent les morsures.
Il les décrit d'une manière très précise, assez pour que
nous puissions distinguer ce qu'il y a dans ces procédés à la
fois de scientifique et de magique. Pour écarter du camp les
reptiles, les Psylles prononcent des formules purificatrices
et en même temps ils brûlent des plantes aromatiques
(1).
(1) Luc., IX, 915-921. Ce feu a d'ailleurs lui-même une vertu magique : on y brûle les cornes d'un boeuf des régions lointaines (921) : ce détail (la provenance exotique) est un des plus fréquents dans les superstitions magiques
De même, pour secourir les blessés, ils ont
recours à des pratiques médicales, telles que la succion du
venin, et aussi à des moyens d'ordre surnaturel : ils
crachent sur la plaie pour empêcher les virus de se répandre
plus loin ; ils font entendre des mélopées interminables, la bouche écumante comme dans des accès d'hystérie. Tous ces détails sont pris sur le vif, évidemment d'après un auteur qui avait assisté à ces cures merveilleuses,
ou qui lui-même reproduisait un témoignage direct. Mais ce
qu'on peut y remarquer entre autres choses, c'est la grande
importance donnée aux contre-poisons, végétaux ou autres.
Or justement Macer, soit dans ses Theriaca, soit plutôt dans
un poème distinct, s'était occupé des antidotes aussi bien
que des serpents venimeux : il avait adapté les Alexipharmaca de Nicandre comme ses Theriaca. Il est donc raisonnable
de supposer que Lucain, s'étant servi du premier
ouvrage pour le commencement de l'épisode, s'est inspiré
du second pour la fin : ces deux probabilités se fortifient l'une
par l'autre.
Ainsi donc, pour résumer tout ce qui, dans la Pharsale, se
rapporte à l'Afrique, il me semble que l'on peut distinguer
trois sources : pour la configuration des lieux, un manuel
de géographie assez peu exact; pour la description, un
ouvrage dans le genre des Itinéraires, soit grec soit latin,
soit en prose soit en vers; pour l'épisode des serpents, le
ou plutôt les poèmes de Macer, eux-mêmes dérivés de
Nicandre, mais non sans de notables additions.
§6.
Parmi les choses d'Égypte, Lucain ne mentionne que
celles qui peuvent le plus émouvoir l'attention d'un poète
philosophe comme lui. Libre-penseur, il nomme sur un ton
ironique les dieux égyptiens, Isis, Anubis le chien,
Apis le boeuf, Osiris dont la divinité est démentie par les lamentations mêmes de ses adorateurs. Moraliste, il
décrit avec colère les raffinements du luxe de Cléopâtre :
l'emploi, à l'état massif, de l'or, du marbre, de l'agate, du
porphyre, de l'onyx, de l'ébène ; celui de l'ivoire, de
l'écaille, de l'émeraude, des perles et du jaspe comme ornements
; celui des tapisseries brodées d'or ; le grand
nombre des esclaves, parmi lesquels il distingue très précisément
les esclaves blonds, les nègres aux cheveux
crépus, les jeunes eunuques, et les hommes adultes
sans barbe. Savant (ou curieux de science tout au moins),
il fait exposer par le prêtre Achorée ce que l'on sait et ce que
l'on voudrait savoir au sujet du Nil, de la cause de ses inondations, de sa source, et des diverses parties de son
cours. Cette dernière digression est particulièrement
développée; elle a été étudiée à part dans un travail de
Diels, et elle mérite qu'on s'y arrête un peu.
Diels rapproche les pages de Lucain à ce sujet de celles
qu'on lit dans les Questions Naturelles de Sénèque. La ressemblance
est en effet on ne peut plus frappante. Parmi les
causes assignées à l inondation du Nil, Lucain, comme
Sénèque, rejette celle qu'admettait Anaxagore, la fonte
des neiges, et pour les mêmes motifs que Sénèque : d'abord
parce qu'il ne peut y avoir de neiges dans un pays aussi
chaud que l'Ethiopie; ensuite parce que les fleuves
grossis par des neiges fondues ont leur crue au printemps et
non en plein été. Il élimine aussi, toujours comme Sénèque, l'hypothèse d'une action des vents Étésiens [opinion
de Thalès], celle de l'existence d'une caverne souterraine remplie
d'eau chaude [opinion d'OEnopide], celle d'une communication
entre le Nil et l'Océan [opinion d'Euthymène],
celle du déversement de l'eau aspirée en excès par le
soleil [opinion de Diogène d'Apollonie]. Quant à celle
qu'il adopte, à savoir que certaines sources d'eau, celles de
l'Océan et des grands fleuves, sont éternelles, contempoporaines
du monde lui-même, et échappent à la loi des
rivières ordinaires, elle se rencontre chez Sénèque, dans un
autre livre des Questions Naturelles. Pour compléter le
parallélisme, on peut ajouter que ni Sénèque ni Lucain ne
parlent de l'opinion qui attribuait la crue du Nil aux bancs
de sable accumulés à son embouchure par les vents Étésiens,
opinion que nous connaissons par Lucrèce et par Pomponius
Mela. En un mot la marche de la discussion chez Sénèque
et chez Lucain est à très peu de chose près identique.
La ressemblance devient encore plus complète lorsque le
poète se met à décrire le cours du Nil. La situation de
Philae, les cataractes avec leur bruit, leur écume, la lutte
du fleuve contre les rochers, le rocher Abatos, les écueils appelés « Veines du Nil », la chaîne de montagnes
qui barre au fleuve le chemin de la Libye, la vallée où il
coule encaissé et paisible, la plaine élargie à partir
de Memphis, tout cela est décrit absolument de même par les deux auteurs. Si Lucain personnifie le fleuve, lui
prête des sentiments et des volontés, Sénèque le fait
aussi. Quelquefois les analogies sont presques textuelles. On croire que le poète n'a guère fait autre chose
que mettre en vers la prose du philosophe.
Il y a, comme on le voit, de bonnes raisons à l'appui de la
thèse de Diels. Et pourtant sa conclusion ne me semble pas certaine ; je suis beaucoup moins sûr que lui que Lucain
ait eu sous les yeux le texte des Questions Naturelles en écrivant sa dissertation poétique sur le Nil. D'abord, il y a chez
Lucain plusieurs détails qui ne se trouvent pas chez Sénèque.
Celui-ci ne parle ni de la théorie astronomique d'après
laquelle le Nil serait sous la dépendance de la planète Mercure, ni de l'hypothèse qui attribue l'inondation à des
pluies torrentielles survenues lorsque les vents Etésiens ont
refoulé les nuages dans la zone méridionale (1). En exposant
l'opinion d'Euthymène, Lucain dit que les eaux salées de
l'Océan s'adoucissent peu à peu au cours de leur trajet :
Sénèque omet cette explication (2).
(1) Luc., X, 242-241. Cf. MELA, 1, 53. — On s est étonné que Lucain appelât « Zéphyrs » les vents Etésiens. Mais le De mundo, § 4, dit qu'il y a des vents Etésiens venus du Nord d'autres venus de l'Ouest. Comment ces vents d'Ouest peuvent-ils pousser des nuages vers le Sud? pour le comprendre, il faut songer à la forme du monde telle que la conçoit Lucain.
(2) Luc., X, 251. Pour Sénèque (citant Euthymène),l'Océan est partiellement formé d'eau douce.
La description du cours du fleuve chez Sènèque, ne commence qu'à Philae : Lucain en détermine aussi le cours supérieur, d'une façon d'ailleurs assez singulière (1).
(1) Luc., X, 287-310. Parmi les indications que donne Lucain, il y en a de
fort exactes : sur les courbes décrites par le Nil vers l'Ouest et vers l'Est, et
sur l'île de Méroé. Par contre, on est surpris de voir les Sères mentionnés
comme riverains du haut Nil ; il est probable que Lucain en ramenait la position
beaucoup trop au Sud-Ouest, comme il ramenait beaucoup trop au Sud-
Est la position de l'Oasis d'Ammon.
Voilà autant de passages, non dénués
d'importance, pour lesquels le poète n'a pas pu s'inspirer du
chapitre des Questions Naturelles. A cela, Diels répond que ce
chapitre, sous sa forme actuelle, est incomplet; que Jean
Lydus se réfère en effet à des textes de Sénèque qui ne nous
sont pas connus. Mais le témoignage de Jean Lydus peut
s'interpréter autrement, et, quant aux lacunes, ce n'est pas une ou deux, c'est un assez grand nombre qu'il faut
admettre si l'on veut faire coïncider l'exposé de Sénèque
avec celui de Lucain.
Si certaines données existent dans la Pharsale et non dans
les Questions Naturelles, l'inverse se produit aussi. Il se produit
notamment pour un renseignement très intéressant que
nous a transmis Sénèque : je veux parler de l'expédition
des deux centurions envoyés par Néron à la recherche des
sources du Nil, et arrêtés dans leur voyage par d'inextricables
marécages, encombrés d'herbes et réfractaires à la
navigation. Si ce fait, tout récent, très important pour la
curiosité scientifique d'alors, a été connu de Lucain, est-il
croyable qu il se soit privé d'y faire allusion? Oui,
réplique Diels ; il détestait trop Néron pour consentir à le
louer de son amour pour la vérité. Est-ce une raison suffisante?
son ingéniosité poétique ne pouvait-elle lui
fournir un moyen de mentionner cette découverte sans en
reporter l'honneur au souverain ? ne pouvait-il faire dire à
son Achorée que la tradition, rumor (comme il dit ailleurs),
parlait de vastes marais herbeux dans la haute région du
fleuve ? Je suis persuadé qu'il n'a pas renoncé de gaîté de
coeur à introduire dans son poème un détail aussi neuf ; s'il
l'a omis, c'est qu'il l'ignorait, et s'il l'ignorait, c'est qu'il
n'avait pas lu les Questions Naturelles.
Comment donc concilier, d'un côté tant de ressemblances,
et de l'autre des divergences aussi considérables entre
Sénèque et Lucain ? tout simplement en supposant que
Lucain s'est documenté, chez Sénèque il est vrai, mais non
dans les Questions Naturelles. On connaît malheureusement
peu de chose sur le De situ et sacris Aegyptiorum que le philosophe avait composé lors de sa jeunesse, mais on peut
être sûr que cet ouvrage, spécialement consacré à l'étude
de l'Égypte, devait être plus développé que les chapitres des
Questions Naturelles dans lesquels le philosophe n'y est
revenu qu'incidemment. Sans doute, il y relatait, sans
omission et en les analysant dans le plus grand détail,
toutes les théories sur les causes de l'inondation. Sans doute
il y décrivait d'un bout à l'autre le cours du Nil, en renforçant
les données certaines par des indications hypothétiques
et fabuleuses. Plus tard, dans ses dernières années, ayant à
s'occuper du Nil, il a utilisé son ancien écrit, mais il en
a laissé tomber des fragments qui lui semblaient moins
bons à reprendre. A la même époque, Lucain s'en servait
également de son côté, et c'est ce qui fait que les renseignements
scientifiques et géographiques contenus dans la Pharsale concordent en partie, mais en partie seulement, avec
ceux que nous trouvons dans les Questions Naturelles.
Allons plus loin. Le traité de Sénèque sur l'Égypte contenait,
le titre seul en fait foi, des indications sur la religion
de ce pays : est-il téméraire de penser que Lucain a pris
là ce qu'il dit en plusieurs endroits d'Osiris, d'Anubis et
d'Apis? De même un homme comme Sénèque, très
attentif à tous les raffinements du luxe même quand il se
piquait de les condamner, n'avait pas dû négliger d'énumérer
tous les bois précieux, les métaux, les pierres rares,
les étoffes, dont faisaient usage les riches Égyptiens : n'avons nous
point ici la source de la description tracée par Lucain
à propos du repas de Cléopâtre)? De même encore il est
probable que Sénèque relatait les diverses expéditions envoyées
vers le haut Nil par Sésostris, Cambyse et Alexandre
: n'est-ce pas à lui que Lucain doit ce qu'il écrit à ce sujet? En un mot, je crois que Sénèque, mais le
Sénèque du De situ et sacris Aegyptiorum, et non celui des
Questions Naturelles,est l'auteur dont Lucain s'est inspiré,
non seulement en ce qui concerne la géographie du
Nil, mais en tout ce qui concerne l'Égypte.
C'était d'ailleurs un bon auteur (1), comme était bon,
sur l'Afrique, le narrateur inconnu de nous dont il semble
avoir utilisé les descriptions d'après nature, comme, sur
la Gaule, était bon Tite-Live.
(1) Il est probable, comme DIELS l'a conjecturé, que Sénèque s'était inspiré lui-mème de Posidonius. Mais je ne veux pas plus rechercher les sources de Sénèque que celles de Tite-Live.
Le choix judicieux de ses sources, comme son application à leur être aussi fidèle que possible, explique la solidité et l'intérêt encore très vif de ses excursus historico-géographiques. Tant d'intelligence, de conscience et de précision, même dans des parties relativement secondaires de son oeuvre, sont d'un heureux présage : voyons maintenant si ces qualités se retrouvent dans sa façon de traiter les faits essentiels.
LES SOURCES HISTORIQUES (Suite.)
B) Le récit de la guerre civile.
§1
Avant d'examiner les sources historiques auxquelles
Lucain a dû puiser pour raconter la guerre civile, il importe
de bien comprendre dans quelles conditions il a composé
son poème. Nous risquerions fort de nous égarer si nous nous
le représentions travaillant à la façon d'un auteur moderne.
Il y a là une illusion à laquelle on est inconsciemment
exposé, dont certains critiques ne se sont peut-être pas assez
défendus, et qui leur a fait commettre de fâcheuses
erreurs.
Comment s'y prendrait un écrivain d'aujourd'hui, je
ne dis pas seulement un historien, mais même un littérateur,
un romancier un tant soit peu soucieux d'exactitude,
pour raconter la guerre civile entre César et Pompée? Il
irait tout droit aux oeuvres immédiatement contemporaines
de cette grande lutte, aux Commentaires de César ou aux
lettres de Cicéron, afin d'y retrouver la réalité présente et
vivante. Il ne négligerait pas pour cela les livres postérieurs : il consulterait cette abondante productionde l'époque
impériale, depuis Velleius Paterculus jusqu'à Paul Orose, en
passant par Appien et Dion Cassius, Suétone et Plutarque.
Mais il se garderait bien de se fier exclusivement à l'un quelconque
de ces narrateurs. Il les confronterait les uns avec
les autres, de manière à découvrir la divergence des opinions
et la complexité des faits. Et surtout, dans chacun des témoignages
allégués, il chercherait bien moins l'auteur qui nous
l'apporte que la source à laquelle cet auteur l'a emprunté.
Appien ne l'intéresserait que dans la mesure où il s'inspire
d'un écrivain du siècle d'Auguste, qui lui-même a pu utiliser
les mémoires des acteurs de la guerre. Les documents de
l'époque, directement ou indirectement ressaisis, et aperçus
dans leur diversité irréductible, voilà à quoi s'attacherait
essentiellement la méthode moderne.
Cette méthode ne pouvait être celle de Lucain. Eût-il été
un historien de profession qu'il ne se serait pas assujetti, je
crois, à une recherche trop laborieuse dont il n'aurait senti
ni la sécurité scientifique ni le passionnant intérêt. Je ne
veux pas ici réveiller le débat jadis soulevé par la fameuse
théorie de Nissen sur l' « unité de source » dans l'historiographie
latine. Cette théorie est sans doute excessive : il
n'est pas démontré que les annalistes romains se soient fait
une « loi » de ne suivre jamais qu'un seul à la fois de leurs
prédécesseurs ; bien au contraire, on a signalé chez maint
d'entre eux, chez Tacite par exemple, des indices certains
d'hésitation ou de contamination entre des autorités différentes. Mais, si l'usage exclusif d'un seul modèle n'est
pas à Rome une règle absolue, c'est du moins une pratique
fréquente. Les historiens suivent volontiers, pour la trame
générale de leur récit, celui de leurs devanciers qui leur inspire
le plus de confiance, et ne font appel aux autres que
pour des faits particulièrement contesté ou particulièrement
importants, c'est-à-dire exceptionnels. De plus, leur critique
ne va guère au delà des ouvrages de seconde main. Ils complètent
et corrigent bien deux historiens l'un par l'autre : mais ils ne se demandent pas d'où chacun d'eux tient les
renseignements qu'il leur fournit (1).
(1) Ceci n'est vrai que des « historiens » proprement dits. Les érudits de l'école de Varron et de Suétone ont au contraire le goût des documents de première main
Ils n'éprouvent pas le
besoin de remonter à la source originale et lointaine.
Si une documentation relativement récente et assez simple
suffit aux historiens de métier, à plus forte raison Lucain
a-t-il-dû s'en contenter. Rien ne nous permet de croire qu'il
fût plus épris d'investigations minutieuses et pénibles qu'on
ne l'était communément alors. Son éducation avait été celle
de tous les jeunes gens distingués de cette époque, ce qui
veut dire que la rhétorique y avait tenu plus de place que
l'érudition. Sa vie était celle, non d'un fureteur voué à la
compilation savante, mais d'un homme du monde, d'un
courtisan brillant et spirituel, faisant des vers sur toute
espèce de sujets, avec une abondance qui exclut l'idée de
lentes recherches : avant 25 ans il avait déjà composé cinq
ou six poèmes suivis, et quatre recueils de pièces détachées. Même pour écrire la Pharsale, que les anciens
regardaient pourtant comme une oeuvre beaucoup plus
forte et plus mûrie, il ne rompit pas tout à fait avec ses
habitudes d'improvisateur. Nous ne savons malheureusement
pas la date où il commença ce poème, pas plus que
l'ordre dans lequel il en versifia les différents livres, mais
nous ne pouvons douter que cette date ne soit très rapprochée
de celle de sa mort. N'a-t-on pas soutenu que tout l'ouvrage avait été rédigé entre juillet 64 et avril 65? Sans
aller jusque là, admettons, avec la plupart des critiques,
que Lucain ait publié trois livres de son épopée avant 62,
qu'il se soit brouillé avec Néron vers 62 ou 63, en même
temps que son oncle Sénèque, et qu'il ait, depuis cette rupture
jusqu'à sa mort en 65, travaillé aux sept autres livres :
même dans cette hypothèse plus modérée, il reste vrai que
la majeure partie du poème fut composée en deux ou trois
ans. Encore, pendant ces années-là, Lucain ne put pas consacrer
tout son temps à sa besogne d'écrivain : les intrigues
de la cour, puis les préparatifs de la conjuration, absorbèrent
sans doute le plus grand nombre de ses heures. C'est
dans ces conditions de hâte, et aussi d'inquiétude et de fièvre,
que la Pharsale fut mise au jour. Elle ne pouvait ressembler à un ouvrage d'érudition, froidement conçu, patiemment
élaboré. Pressé comme il l'était, sans cesse secoué par sa
passion, Lucain n'avait pas le loisir de chercher à droite et à
gauche, parmi tous les auteurs qui avaient raconté les événements
d'Ilerda, de Dyrrhachium, de Pharsale ou d'Alexandrie
; il lui était beaucoup plus commode de faire ce que l'on
faisait à son époque : il n'avait qu'à prendre une bonne histoire
de la guerre civile, et à en tirer la matière de beaux vers.
Cette " bonne histoire de la guerre civile", où pouvait-il
la trouver? Ce n'était pas, à coup sûr, les Commentaires de
César qui étaient capables de la lui fournir, et cela pour plus
d'une raison. D'abord, quelque estime que nous fassions
aujourd'hui des écrits historiques de César, il faut bien
reconnaître que les anciens ne paraissent pas leur avoir
rendu pleine justice. Hirtius, sans doute, déclarait qu'ils
surpassaient par leur élégance tout ce qu'on avait vu de
plus achevé : mais c'était Hirtius, le lieutenant, le continuateur
et l'ami de César. Sans doute aussi, dans son Brutus, Cicéron proclamait que, tout en ayant l'air de ramasser simplement des matériaux pour les narrateurs futurs, César
les avait découragés d'avance par la perfection de son travail mais dans cet éloge, formulé sous la dictature de
César par un homme qui cherchait à le ménager, comment
démêler la part de l'admiration sincère et celle de la politesse
opportune? En fait, l'opinion traditionnelle à Rome, celle
du monde des écoles par exemple, ne paraît pas avoir beaucoup
admiré les Commentaires : Quintilien, dans son jugement
sur la littérature latine, ne les nomme même pas. Sans
doute les regardait-on moins comme une oeuvre vraiment
historique que comme un journal de campagne. Ce journal,
au surplus, devait sembler à Lucain un peu trop inégal
ou irrégulier. Très développé sur certains points, plus court
sur d'autres, avec des lacunes plus ou moins volontaires, le
récit de César ne lui offrait pas le tableau complet et sûr
dont il avait besoin. Mais surtout il devait s'en défier à
cause même du nom de son auteur. La partialité qui se trahit
à chaque page, malgré l'apparente froideur du ton, par
un détail jeté en passant, une parenthèse, un mot, un sous-entendu,
une omission à première vue insignifiante, cette partialité
ne pouvait qu'être suspecte à Lucain, je dis même
à priori, et sans qu'il prît la peine d'ouvrir les Commentaires.
S'en est-il servi quelquefois à l'occasion, pour tel ou
tel fait particulier ? on l'a dit ; je ne le crois pas, et j'essaierai
plus loin d'expliquer pourquoi. Mais dès à présent il me
semble inadmissible qu'il les ait pris comme source principale
et essentielle : il lui aurait fallu pour cela une objectivité,
et, si je puis dire, une abnégation de ses propres sentiments
tout à fait invraisemblable.
La même raison, à mon sens, l'empêchait de suivre fidèlement
cette grande histoire des guerres civiles composée
par Pollion et célébrée par Horace en termes si enthousiastes.
Malgré toute sa réputation, malgré tout son talent, Pollion
avait joué un rôle trop actif dans l'armée césarienne pour
être à ses yeux un guide digne de foi. Quant à ceux qui, dans
le camp adverse, avaient raconté les événements auxquels
ils avaient été mêlés, ils étaient certainement beaucoup plus
près des opinions de Lucain que César ou Pollion, mais il n'est guère croyable que cette conformité de vues politiques
fût un mérite suffisant pour enlever son choix. Qui étaient
ces mémorialistes, anti-césariens? nous en connaissons de
nom trois ou quatre : Tanusius Geminus, Actorius Naso,
Ampius Balbus, Labienus. Les trois premiers paraissent
avoir été bien obscurs, et pour ce qui est de Labienus, son
personnage est si effacé dans la Pharsale que Lucain ne
semble guère l'avoir beaucoup admiré ; il n'est donc pas
probable qu'il s'en soit rapporté à son témoignage.
Écartons donc, nous le pouvons sans crainte, tous
les écrivains qui ont été les acteurs en même temps que les
narrateurs de la guerre civile. Éliminons, pour des raisons
faciles à comprendre, les compilateurs tels que Trogue-Pompée
et Fenestella, les abréviateurs comme Velleius Paterculus.
Parmi les historiens proprement dits qui, entre
l'époque de César et celle de Lucain, ont eu une grande réputation,
je n'en vois que trois qui se soient occupés des
guerres civiles, et dont les ouvrages, par conséquent, aient
pu servir de sources à la Pharsale : c'est Tite-Live, Cremutius
Cordus, et Aufidius Bassus. De ces trois auteurs, lequel
le poète a-t-il réellement consulté? il est, on le comprendra,
impossible de le déterminer d'une manière indubitable,
puisque les deux derniers nous sont à peu près totalement
inconnus. Nous ne savons même pas quelles étaient les
limites de l'oeuvre d'Aufidius Bassus : commençait-elle au
premier triumvirat, ou à la mort de César, ou à l'endroit
où s'arrêtaient les Décades de Tite-Live? ce n'est que dans
la première de ces hypothèses qu'Aufidius Bassus aurait
pu être le guide de Lucain, et cette hypothèse n'est nullement
plus certaine que les autres. Même incertitude
en ce qui concerne Cremutius Cordus, et plus fâcheuse
encore peut-être; car il n'est pas douteux que Lucain ait
connu et admiré l'histoire de Cremutius. La passion libérale
de cet écrivain, l'éclat de son procès et de sa mort
volontaire, les relations de Sénèque avec sa fille Marcia,
tout le désignait à l'enthousiasme du jeune poète stoïcien.
Mais nous ignorons le sujet exact de son livre. Nous
savons qu'il y mentionnait les derniers événements de l'époque républicaine, qu'il y parlait de Brutus et de Cassius,
des proscriptions des triumvirs, de la mort de Cicéron (1) :
mais remontait-il plus haut?
racontait-il la lutte entre César
et Pompée? c'est possible, et dans ce cas, il n'y aurait rien
d'extraordinaire à ce que Lucain eût puisé chez lui la plupart
de ses renseignements. Mais, dans l'ignorance où nous
sommes, nous n'avons pas le droit d'aller plus loin que cette
hypothèse, forcément très imprécise.
Au surplus, quelle que fût la célébrité de Cremutius au
temps de Lucain, elle ne pouvait, je crois, rivaliser avec la
gloire de Tite-Live. L'opinion du monde lettré avait très vite
reconnu dans son oeuvre le monument le plus imposant de
l'historiographie romaine Ce n'est pas ici le lieu de rappeler
tous les éloges qui furent adressés à sa franchise, à sa
science, à son talent oratoire et littéraire, et qui se résument
dans la formule de Tacite : eloquentiae ac fidei praeclarus imprimis. Mais parmi ces éloges, il y en a quelques-uns
qui nous intéressent davantage, parce qu'ils nous apprennent
ce que l'on pensait de Tite-Live dans la famille de Lucain.
Sénèque le Père rapporte, en ayant bien l'air d'y souscrire,
les témoignages d'admiration dont le grand historien avait
été l'objet; ailleurs, il le félicite d'avoir su apprécier les
grands hommes avec une sincérité, une « candeur »
absolue. Sénèque le Philosophe, à son tour, le met, avec
Cicéron et Pollion, parmi les auteurs les plus « éloquents »
de Rome (1).
(1) SEN., Ep., 100, 9 sqq. (ce jugement, il est vrai, vise les Dialogues de Tite-
Live, mais Sénèque y voyait des oeuvres historiques plus encore que philosophiques).
Tout porte à supposer que Lucain partageait, sur la valeur historique et littéraire des Décades, l'avis de son aïeul et de son oncle Il devait aussi être attiré par la sympathie non dissimulée avec laquelle Tite-Live avait parlé de Pompée, de Brutus et de Cassius. Sans doute cette sympathie n'avait pas été assez ardente pour faire de Tite-Live un écrivain d'opposition ; tout « pompéien» qu'il était, il avait su demeurer l'ami d'Auguste : mais cela même n'était-il pas une garantie de plus? et l'honnête déposition d'un libéral modéré n'était-elle pas plus précieuse à consulter que les assertions d'un pamphlétaire fanatique? Si surtout Lucain, comme cela est à peu près sûr, a commencé d'écrire la Pharsale avant de rompre avec Néron, il y avait, entre sa situation personnelle et celle de Tite-Live, une analogie singulière : tous deux bien accueillis de l'empereur, et tous deux maudissant l'ambition du fondateur de l'empire. Cette conformité était un motif, parmi bien d'autres, pour qu'il accordât à Tite-Live toute sa confiance. Telles sont les conclusions que nous suggère le coup d'oeil que nous venons de jeter sur la situation où se trouvait Lucain en composant son poème, sur les habitudes de son temps, sur les opinions de son entourage. Résumons-les en deux mots : il est vraisemblable qu'il n'a consulté qu'un seul auteur, et un auteur de seconde main ; cet auteur peut avoir été Cremutius Cordus, mais plus probablement Tite-Live. Ce n'est encore qu'une hypothèse provisoire : éprouvons-la au contact des faits.
§2.
L'hypothèse qui assigne comme source à la Pharsale les
livres CIX-CXII de Tite-Live ne remonte pas à plus de quarante
ans. Encore en 1863, Kortüm déclarait expressément
que Lucain avait puisé dans les Commentaires de César,
et l'année suivante, dans un mémoire sur le rapport de la
Pharsale avec l'histoire, Schaubach admettait cette opinion
comme chose démontrée, ne soupçonnait pas même qu'elle
pût soulever une discussion. Sept ou huit ans plus tard,
Reifferscheid conseilla à l'un de ses étudiants, Gustav Baier,
de rechercher la source historique de Lucain, en ajoutant
que, pour sa part, il était convaincu que cette source n'était
autre que Tite-Live. Baier s'empara de cette indication, la précisa, l'exposa dans une dissertation inaugurale qui
marqua le renouvellement de la question. L'opuscule de
Baier, sobre, net et précis, d'une méthode aussi juste que
l'érudition en est abondante, contient les principaux arguments
que l'on puisse invoquer en faveur de la thèse de
Reifferscheid. Il a d'ailleurs servi de base à toutes les controverses
ultérieures. Pour.cette double raison, et parce qu'il
est à peu près introuvable, je crois utile de le résumer ici,
au moins dans ses lignes essentielles.
Baier commence, comme je l'ai fait moi-même et par des
arguments quelquefois analogues à ceux que je viens d'employer,
par mettre hors du débat tous les historiens autres
que Tite-Live. Pour celui-ci, il fait valoir toutes les raisons
qui pouvaient le recommander au choix d'un poète
« pompéien ». Il joint, à cet argument de vraisemblance,
un indice tiré du témoignage des scholies : jamais César n'y
est nommé ; du moins dans les scholies d'origine antique; Tite-Live l'est au contraire assez souvent.
Puis, il entre dans le vif du problème.
Il distingue d'abord une série de faits pour lesquels César
et Lucain sont d'accord. Cette concordance ne prouve pas du
tout que Lucain se soit inspiré de César, puisque les mêmes
faits devaient figurer assi dans le récit de Tite-Live. Qui
nous l'affirme ? c'est qu'ils sont mentionnés par des auteurs
qui, très certainement, procèdent de Tite-Live. Il n'est du
reste aucunement nécessaire que tous ces auteurs les rapportent
: il suffit que quelques-uns en parlent pour que nous
ayons le droit de remonter par là jusqu'aux Décades. Ainsi
ni l'établissement de Pompée à Capoue, ni le départ d'un premier convoi pour l'Epire sous les ordres des consuls, ni
l'effort de Petreius contre les intentions pacifiques de ses
soldats, ne sont racontés par Florus et par Orose, deux auctores Liuiani; mais, de ces trois événements, le premier
et le dernier sont chez Dion Cassius et chez Appien, et le second chez Appien seul. Or Appien et Dion Cassius
dérivent, eux aussi, de Tite-Live, non pas exclusivement il
est vrai : mais comme ici il n'y a pas de raison pour que
Tite-Live ait omis ces détails, nous pouvons les lui attribuer
sans crainte. Ailleurs, la concordance existe entre César,
Lucain et Florus, tandis qu'Orose et l'auteur des Periochae gardent le silence : c'est le cas pour l'arrivée de Pompée à
Brindes, pour celle de César, pour les opérations du siège.
Ailleurs encore, le témoignagede Tite-Live, identique à celui
de César et à celui de Lucain, nous a été conservé par Florus
et par l'auteur des Periochae (pour la mort de Curion), par
Florus et Dion (pour le campement des deux chefs entre
l'Apsus et le Genusus), par Appien, Dion et Valère-Maxime
(pour la fuite de Pompée à Larisse), par Orose et les Periochae (pour la mort de Pompée), etc. Ailleurs enfin, ce sont les
scholies de Lucain qui nous informent de ce que disait Tite-Live sur les opérations de Sicile, sur la coopération d'Athènes
au recrutement de la flotte de Pompée, sur le rôle
de Crastinus à Pharsale, sur celui de Ganymède à Alexandrie. Tous ces renseignements fragmentaires sont comme
la menue monnaie du récit de Tite-Live ; en les rapprochant,
en les complétant l'un par l'autre, nous arrivons presque à
reconstituer ce récit, et nous voyons que sur beaucoup de
points il coïncidait avec celui de César. Là où nous constatons
cet accord, nous avons lieu de supposer que Lucain a pu
s'inspirer des Décades tout aussi bien que des Commentaires. Ce n'est encore qu'une possibilité. Pour la transformer en
probabilité, il faut quelque chose de plus, et c'est ce qui
donne une haute importance au second groupe de faits classés par Baier, ceux où il y a divergence entre les Commentaires et la Pharsale.En procédant comme tout à l'heure,
c'est-à-dire en essayant de retrouver à travers les écrivains
postérieurs les assertions de Tite-Live, on s'aperçoit qu'autant
Lucain s'écarte de la version de César, autant il se conforme
à celle de Tite-Live, ou du moins à ce que nous en
pouvons connaître. Dès le préambule, toutes les réflexions
de Lucain sur l'excès de prospérité de Rome, sur l'ambition
des deux chefs, sur la mort de Crassus et celle de Julia, se
retrouvent dans Florus, et par conséquent devaient être dans
Tite-Live. La harangue de César à ses troupes, au début de
la guerre, est prnoncée à Ravenne selon Appien et César,
à Ariminum selon Lucain, Suétone, Dion, Orose, et ce dernier
se réfère expressément à l'autorité de Tite-Live. Sur
l'affaire de Corfinium, Lucain ne s'accorde pas avec César,
mais s'accorde avec Dion et Orose ; sur celle du trésor public
de Rome, il dit la même chose que ces deux auteurs encore
et qu'Appien ; on peut également le rapprocher de Dion
pour la harangue des Marseillais, de Florus et des Periochae pour l'héroïque suicide des marins de C. Antonius, de
Valère-Maxime et d'Orose pour le voyage d'Appius Claudius
à Delphes, d'Appien et de Dion pour la révolte de Plaisance.
Ce n'est pas dans César que Lucain a trouvé les prodiges
qu'il énumère, soit au début du poème, soit avant la bataille
de Pharsale : les premiers sont mentionnés par Dion, Appien
et Julius Obsequens, les autres par Florus, Plutarque et
Julius Obsequens encore; les deux listes remontent certainement
à Tite-Live. César ne dit pas combien son passage
en Grèce a été difficile : mais Plutarque le dit, et Appien, et
Dion, et Florus, et par conséquent Tite-Live. Dans le combat
de Dyrrhachium, il ne nomme pas Torquatus, nommé au
contraire par Lucain et par Orose. Il ne parle pas du conseil
tenu par Pompée à Syedrae, ni de son projet de se réfugier chez les Parthes : Florus sur le premier point,
Florus, Dion, Appien, sur le second, corroborent les allégations
de Lucain. Ptolémée a-t-il été informé de la résolution
prise par ses ministres? non, d'après César; oui,
d'après Lucain, comme d'après Florus, Eutrope et Orose.
Cornélie assistait-elle au meurtre? non, d'après César; oui,
d'après Lucain, Dion, Appien, Florus et les Periochae. César
ne parle pas de sa liaison avec Cléopâtre, mais Lucain n'est
pas seul à la raconter, témoin Florus, Dion, Eutrope, Aurelius
Victor. César ne se donne pas non plus comme ayant été en
grand péril à Alexandrie, mais la narration de Lucain est
identique à celle de Sénèque, de Florus et d'Orose. Il n'y a
pas jusqu'au petit détail de la sépulture secrète de Pompée
qui n'ait été fourni au poète par une source autorisée
César s'en tait, et avec lui tous les historiens sauf un, si
bien que l'on serait tenté de croire à une pure fiction de
Lucain ; mais le témoignage d'Aurelius Victor nous montre
que le fait devait. être déjà relaté par Tite Live. Tout, en
somme, nous ramène à lui. Et, en comparant cette seconde
catégorie à celle que Baier a d'abord étudiée, je crois qu'on
peut arriver à cette double formule : ce qui est à la fois dans la Pharsale et dans les Commentaires, Lucain a pu le prendre
chez Tite-Live tout aussi bien que chez César; et, ce qui n'est
pas chez César, il n'a pu le prendre que chez Tite-Live.
Cette dernière affirmation ne va pas sans quelques
réserves. Baier reconnaît, tout le premier, que Lucain n'a
pas dû suivre Tite-Live avec une fidélité absolue, et il consacre
le dernier chapitre de sa dissertation à relever les
divergences probables entre l'historien et le poète. Il énumère
ainsi : l'apparition de la Patrie à César sur les bords
du Rubicon; le débordement de ce fleuve ; les hésitations de
la XIIIe légion ; la proclamation d'un justitium à Rome ; la
conversation entre Caton et Brutus ; le refus des troupes
pompéiennes de marcher au secours de Corflnium ; l'apparition
de Julia à Pompée ; la servilité du Sénat envers César ;
le sacrilège commis par celui-ci dans la forêt de Marseille ;
la répugnance de Pompée à poursuivre ses ennemis vaincus;
la présence de Sextus et de Cicéron à Pharsale; la mort héroïque de Domitius; le repas de César sur le champ de
bataille et sa visite aux ruines de Troie; la fuite majestueuse
de Pompée, et l'aspect grandiose conservé par sa physionomie
après sa mort. Voilà autant de faits qui, selon Baier, sont
autant d'inventions, étrangères au récit de Tite-Live. Il
signale aussi quelques omissions volontaires : Lucain passe
sous silence la rupture de la trêve par les Marseillais, les
lois promulguées par César avant de partir pour l'Épire, les
premiers combats qui ont précédé la grande bataille de
Dyrrhachium, le voyage de Pompée pour accompagner sa
femme à Lesbos. Enfin il rappelle quelques jugements discutables
du poète, sur le talent militaire de César, ou sur la
sincérité de ses larmes devant la tête de son rival. Ce
n'est pas ici le moment d'expliquer d'où viennent ces altérations
de la vérité historique : je l'essaierai plus tard; mais
dès à présent, je puis dire qu'aucune d'elles n'est de nature à
faire supposer que Lucain ait consulté une source autre que
Tite-Live. Là où il n'est pas d'accord avec son modèle habituel,
la raison doit en être cherchée dans ses propres tendances,
et non dans l'influence de quelque autre historien.
Par conséquent ses inexactitudes, quand bien même elles
seraient plus nombreuses, n'infirmeraient en rien les résultats
déjà acquis, et Baier se juge autorisé à conclure que
Tite Live est la source unique de Lucain pour toute la partie
historique de la Pharsale.
Voilà sa thèse, claire, ingénieuse, plausible. Voyons si elle
résiste à tous les doutes amoncelés sur elle par la critique
ultérieure.
§3.
Si l'on veut apprécier sainement la thèse de Baier, il faut
la prendre telle qu'elle est en elle-même, et non pas sous la
forme excessive qu'elle a revêtue chez des critiques plus
récents. Baier, pour sa part, s'est presque toujours gardé de
ces outrances Tout au plus pourrait-on lui reprocher
quelques comparaisons forcées, comme celle qu'il a établie
entre la phrase de Lucain sur Achillas sceleri delectus Achillas, et celle de la Periocha, facinus delrgatum; là où
l'idée est assez banale et où les expressions ne sont pas
identiques, comme c'est le cas ici, le rapprochement ne
s'impose pas. Mais, dans l'opuscule de Baier, ces erreurs de
jugement sont très rares. Habituellement, il se contente de
démontrer que Lucain s'est inspiré de Tite-Live pour la relation
de tel ou tel fait en général ; il n'entreprend pas de
prouver qu'il l'ait copié pour tous les détails, pour tous les
mots de son récit.
Certains de ses successeurs n'ont pas gardé la même
réserve. Ziehen, par exemple, dans un article d'ailleurs judicieux
au sujet de l'opuscule d'Ussani, affirme que Tite-Live a dû fournir au poète, non seulement des faits, mais
des raisonnements philosophiques et politiques. Et, pour
qu'on ne lui objecte pas que les raisonnements de cette
espèce n'abondent pas chez l'historien, il déclare qu'il ne
faut pas comparer les derniers livres des Décades à ceux que
nous avons conservés : le récit des premiers temps de Rome
et celui des guerres puniques sont des oeuvres de jeunesse ;
au contraire, quand Tite-Live a raconté la guerre civile
entre César et Pompée, il était dans toute sa maturité, il
avait plus de force de pensée, et par suite pouvait suggérer
à son imitateur bon nombre de réflexions profondes.
C'est là, est-il besoin de le dire, une supposition tout arbitraire
? rien n'indique que Tite-Tive ait changé de manière
en vieillissant, et, de narrateur pittoresque et dramatique,
soit devenu écrivain à « considérations ». Mais j'admets que
la fin de son oeuvre ait renfermé plus d'idées que le commencement
: croirons-nous que Lucain ait eu besoin de ces
idées pour concevoir les siennes? nous verrons plus tard
d'où lui viennent ses tendances en philosophie et en politique,
ce qu'il doit au stoïcisme, à l'influence de sa famille,
à la tradition des écoles, à sa rancune personnelle contre
Néron. Mais, sans entamer ici cette recherche, on peut noter
au moins que les idées du poète semblent bien avoir été
fixées avant qu'il se mît à composer son oeuvre. Mieux encore : ce sont ces idées qui ont dû le déterminer à choisir
telle source historique plutôt que telle autre : il a pris celle
qui s'accordait le mieux avec les tendances déjà existantes
en son esprit. De la sorte, l'hypothèse de Ziehen n'a pas
seulement l'inconvénient de restreindre outre mesure l'originalité
intellectuelle du poète ; elle renverse l'ordre réel et
naturel des choses : Lucain n'a pas émis des opinions libérales,
pompéiennes et stoïciennes parce qu'il avait lu Tite-Live, mais il a consulté Tite-Live parce qu'il était stoïcien,
pompéien et libéral.
S'il ne doit pas à l'historien ses réflexions morales et
politiques, est-il son tributaire pour les menues particularités
de sa narration, pour les expressions même dont il s'est
servi en exposant les événements ? Ici s'offre à notre examen
le travail inachevé d'un jeune érudit italien mort prématurément,
Vitelli, travail fort intéressant du reste, mais
souvent discutable (1).
(1) VITELLI, Studi sulle storiche fonti della Farsaglia.
Avec une patience héroïque et une
subtilité minutieuse, Vitelli avait entrepris de démonter, si
je puis dire, le poème de Lucain vers par vers et presque
mot par mot, et, pour chacun des détails qui y sont contenus,
d'en rechercher l'origine en même temps que la valeur.
Ayant commencé cette étude avec la description du siège de
Marseille, il n'a pu la conduire que jusqu'au départ de César
et de Pompée pour la Thessalie. Dans la masse des observations
qu'il a accumulées, il y en a beaucoup de précieuses,
mais il en est aussi d'assez contestables, principalement sur
la question qui nous occupe ici. Il est vrai que Vitelli ne dit
nulle part que Lucain ait emprunté à Tite-Live jusqu'aux
plus petites choses que nous rencontrons dans son ouvrage
mais c'est bien vers cette conclusion que tendent, me
semble-t-il, un grand nombre de ses remarques. Lorsque le
poète dépeint Curion abordant sur la côte africaine entre
Clupea et les ruines de Carthage, puis venant camper sur les
bords du Bagrada aux eaux lentes, il ne suffit pas à Vitelli
de faire remonter à Tite-Live l'indication topographique ; il veut encore que Lucain ait pris dans son modèle et la mention de Carthage et l'épithète de lentus appliquée au fleuve.
Sans doute, cela n'a rien d'impossible, mais cela n'a rien de
nécessaire non plus ; je crois que Lucain était bien capable,
à lui tout seul, d'évoquer le souvenir des ruines carthaginoises
et de trouver un adjectif pittoresque pour qualifier le
Bagrada. Un peu plus loin, en racontant l'arrivée de
Pompée à Dyrrhachium, le poète emploie des périphrases
qui font allusion au lointain passé de cette ville, Taulantius
incola, Ephyraea moenia : ces expressions, à elles seules,
dit Vitelli, prouvent que Tite-Live devait faire à cet endroit
un exposé rétrospectif de la fondation de Dyrrhachium. Ce
n'est nullement certain ; Lucain a très bien pu utiliser ici
tout simplement des souvenirs d'école ; il a pu se rappeler
ce qu'il avait appris d'histoire et de géographie à l'école du
grammaticus, et en extraire cette notion, assez facile à
retrouver, que Dyrrhachium était une colonie corinthienne.
Il est tout à fait arbitraire de se le représenter comme un
copiste servile, perpétuellement penché sur le texte de l'historien
qu'il consulte, et impuissant à imaginer quoi que ce
soit en dehors de ce texte.
Cette conception, qui est un peu trop souvent celle de
Vitelli, a encore un autre résultat fâcheux. Comme nous
avons perdu les livres où Tite-Live retraçait la lutte entre
César et Pompée, les rapprochements qu'on peut faire de la
Pharsale avec l'ouvrage qui lui a servi de source, restent
forcément très incertains. C'est alors que Vitelli fait intervenir
d'autres parties de l'oeuvre de Tite-Live, qui n'ont
aucun rapport avec la guerre civile, mais qui, d'après lui,
présentent avec les vers de Lucain des analogies frappantes.
Ainsi, les envoyés de Marseille, quand ils viennent trouver
César, portent des rameaux d'olivier : aussitôt Vitelli cite
d'autres ambassades, mentionnées par Tite-Live dans l'histoire
de la seconde guerre punique, où le même rite est observé (1).
(1) Liv., XXIX, 16,6, XXX, 36, 4.
La description d'Ilerda, celle de Dyrrhachium, lui rappellent celle que Tite-Live a tracée de la forteresse illyrienne de Scodra. Lucain dépeint les soldats pompéiens d'Espagne surpris par leurs adversaires, alors qu'ils hésitent entre la fuite et le combat : Vitelli signale une expression presque identique en deux endroits de la première Décade. De même, à propos de la confiance inspirée à Curion par la « Fortune du lieu », voici d'autres textes de Tite-Live où la même façon de parler se retrouve (1).
(1) Liv., V, 54, 6- VI, 28. 9; VI, 29, 1.
Tout cela est bel et bien, mais qu'en faut-il conclure? Si Vitelli veut seulement étoffer le commentaire de la Pharsale en recherchant dans un autre ouvrage des passages semblables à ceux qu'il étudie, ces comparaisons peuvent être curieuses. Mais s'il prétendait en inférer quoi que ce fût sur les rapports de Tite-Live et de Lucain, il se tromperait grièvement. Comme ses remarques peuvent se prêter aux deux interprétations, il n'est peut-être pas inutile d'y insister quelque peu. Que les vers du poète fassent songer, dans les endroits dont je viens de parler, à tel ou tel épisode de l'historien, cela ne prouve pas que ces épisodes lui aient servi de modèles, pas même qu'il les ait connus. Analogie n'est pas forcément imitation. L'emploi des branches d'olivier dans les ambassades pacifiques est une coutume très générale dans l'antiquité, et Lucain aurait pu la trouver indiquée aussi bien chez Virgile que chez Tite-Live. Très habituelle aussi, universelle même, est la croyance à une divinité mystérieuse, Fortune ou Génie, spécialement attachée à chaque localité ; si Tite-Live en parle, Ovide en parle aussi (1) et bien d'autres.
(1) Ov., Metam., IV, 565.
La
description d'Ilerda ou celle de Dyrrhachium ont des traits peu différents de celle de Scodra: mais ces traits conviendraient également à toute citadelle juchée sur une colline
rocheuse, escarpée,dominant une vallée de fleuve ou un golfe.
Et enfin, en lisant le vers dubiique fugae pugnaeque tenentur, on peut se souvenir de phrases du Ier livre de Tite-Live;
mais pourquoi aller chercher si loin? César décrit à merveille cette situation de l'armée pompéienne, ces mouvements
incertains, ces oscillations entre la résistance et la
débandade. Tite-Live, qui s'était documenté dans les Commentaires,
n'avait sûrement pas omis de reproduire ce
tableau : et c'est bien chez lui, mais au livre CX et non au
livre Ier, que Lucain en a pris les traits essentiels.
Et ceci m'amène à formuler une dernière critique contre
les remarques de Vitelli que je viens de discuter. Toutes les
ressemblances verbales qu'on peut découvrir entre la Pharsale et l'histoire de Tite-Live ne signifient rien, justement
parce qu'elles ne portent que sur des parties de cette histoire
autres que celle qui intéressait véritablement Lucain. Je ne
le vois pas du tout parcourant anxieusement les Décades entières pour y glaner çà et là quelque détail pittoresque ou
quelque terme expressif. Je ne le vois pas, par exemple,
pour dépeindre Ilerda, allant chercher la Scodra de la guerre
d'Illyrie. De Tite-Live, il n'a dû lire, au moins lire attentivement,
que les livres qui lui apprenaient ce qu'avait été
la guerre civile. Là il pouvait prendre le nécessaire, la trame
générale des événements, et peut-être aussi quelques expressions
particulièrement heureuses; quant au reste, il lui était
aisé de le trouver dans son talent et ses habitudes de poète.
Son travail a dû être une adaptation libre, et non un décalque
puérilement littéral.
Limitons donc, d'une façon très précise, la question de
l'influence de Tite-Live sur Lucain. Ne nous inquiétons, pour
le moment, ni des idées morales et politiques renfermées
dans la Pharsale, ni des détails de style qu'elle présente. Ce que Tite-Live a pu fournir au poète, ce ne sont ni des
réflexions philosophiques ni des ornements littéraires, ce
sont avant tout des faits historiques. C'est sur ce terrain
que Baier avait posé le débat, et c'est sur ce terrain que
nous devons nous placer à notre tour pour considérer la
valeur de sa théorie et celle des objections qu'on lui a
opposées.
§ 4.
Quelque ingénieuse que fût la tentative de Baier pour
attribuer à Tite-Live seul l'origine des connaissances historiques
de Lucain, sa thèse, au moins dans la rigueur de ses
conclusions, a suscité plus d'un contradicteur. Pour la combattre,
on s'y est pris de plusieurs manières. Tantôt on a
cherché à. infirmer la valeur de quelques-unes des preuves
dont il s'était servi pour construire son argumentation, tantôt
on s'est efforcé de découvrir chez Lucain des assertions
qui pussent révéler une influence autre que celle de Tite-Live.
La première de ces deux tactiques a été celle de Westerburg;
la seconde, celle de Giani et surtout d'Ussani.
Pour établir que Lucain, en tant que narrateur de la guerre
civile, procède de Tite-Live, Baier avait insisté sur la parenté
entre la Pharsale et les ouvrages historiques que l'on regarde avec
raison comme dérivant des Décades perdues : ceux de
Valère-Maxime et de Florus, d'Appien, de Dion Cassius et de
Plutarque, de Julius Obsequens, d'Eutrope et du Pseudo-Aurelius Victor. Si les témoignages de tous ces auteurs, en
y comprenant Lucain, concordent entre eux, c'est qu'ils
découlent d'une source commune; et du moment que nous
savons d'une façon certaine que, pour quelques-uns d'entre
eux, cette source est Tite-Live, nous sommes en droit de est inattaquable,
mais à une condition : c'est que ces divers écrivains
soient respectivement indépendants. Si l'un d'eux a imité l'un
de ses voisins, les ressemblances qu'on peut relever entre
eux ne signifient plus rien quant à leur prétendue descendance
d'un même ancêtre. Si par exemple, en retraçant le
conflit de César et de Pompée, l'abréviateur Florus a eu sous les yeux le texte de Lucain, les analogies qu'offrent leurs
deux récits s'expliquent toutes seules, sans qu'on en puisse
inférer que tous deux aient puisé dans Tite-Live. Or, précisément,
une opinion déjà ancienne voyait dans Florus
un imitateur, un copiste même de Lucain : Westerburg
l'a reprise, afin de ruiner un des étais sur lesquels s'appuyait
la thèse de Baier. Discutons la sienne à notre tour, et voyons
ce qu'il faut penser des rapprochements qu'il a signalés
entre l'Epitome et la Pharsale.
Les plus frappants en apparence sont peut-être au fond les
moins probants. Lorsque Florus dit que Pompée ne voulait
pas d'égal et César pas de maître. qu'ils luttaient pour la
suprématie comme si la fortune de l'immense empire
romain n'avait pu ieur donner place à tous deux, certes,
de telles formules évoquent tout de suite le souvenir des
beaux vers de Lucain. Prenons-y garde, pourtant : il est fort
possible qu'avant d'être chez Lucain, ces réflexions si naturelles,
si directement commandées par les faits, aient existé
chez Tite-Live, et que Florus les ait prises là, et non dans la
Pharsale. César, qui ne cherche pas d'effets littéraires, dit
bien que Pompée ne voulait pas qu'on lui égalât qui que ce
fût : voilà déjà la moitié de la célèbre antithèse; elle
suggère invinciblement la contre-partie. Qu'y a-t-il d'invraisemblable à
ce qu'un auteur tout imprégné des procédés de la
rhétorique, comme Tite-Live, ait présenté l'idée complète
sous forme de sententia? De même, on ne peut s'étonner de
rencontrer à la fois chez les deux écrivains des expressions
comme « l'audace de la Fortune contre César » (à propos de
la défaite subie sur la côte illyrienne), ou « la hâte précipitée des destins » (à propos de la bataille décisive de
Pharsale) ; ces façons de parler, plus ou moins ingénieuses,
ne sont en somme que des « clichés » qui ont dû se
présenter de bonne heure à l'esprit de n'importe quel historien,
de Tite-Live ou d'un autre, et passer ensuite de mains
en mains. « Cliché » encore, et à plus forte raison, l'éloge
donné à Marseille, d'être disposée à tout sacrifier plutôt que
sa liberté. Qu'on le retrouve placé par Lucain dans le
discours qu'il prête aux Marseillais, et par Florus à la fin du
récit du siège, en quoi cela implique-t-il que le second l'ait
copié chez le premier? Cette phrase est une banalité pure, et
je suis surpris que Westerburg ait cru pouvoir en conclure
quoi que ce soit
ce que je viens de dire de certaines expressions, on peut le
dire aussi de certains faits, que les deux écrivains rapportent
également, mais qu'ils ont très bien pu trouver tous deux
chez Tite-Live. Ils parlent des influences qui ont pesé sur
Pompée pour le décider à livrer bataille malgré sa répugnance
: mais comment penser que Tite-Live ne les ait pas
mentionnées? il faudrait pour cela qu'il n'eût jamais lu ni les
Commentaires de César ni la correspondance de Cicéron!
Ils parlent aussi du songe qui apparut à Pompée un peu
avant le combat : mais cette vision célèbre, à laquelle
d'autres historiens font aussi allusion, n'avait pas dû être
omise par Tite-Live, habituellement épris de ces anecdotes
merveilleuses.Ils confondent Philippes et Pharsale mais cette erreur leur est commune avec beaucoup d'autres écrivains. Soit qu'on ait fait de bonne heure un contre-sens sur
les vers fameux où Virgile maudit les deux batailles de Philippes, soit qu'on ait simplement usé d'une façon de parler
largement approximative (ce qui n'est pas rare chez les
anciens), toujours est-il que déjà dans Ovide, et sans cesse
après lui, on ne discerne pas entre Philippes et Pharsale,
entre la Thessalie et la Macédoine. Il n'y a, dans aucun de
ces détails, rien qui soit propre à Lucain et à Florus à l'exclusion
de tous les autres historiens, rien par conséquent qui
force à admettre une filiation directe de l'un à l'autre.
Il y a au contraire un certain nombre de points sur lesquels
ils sont d'accord entre-eux et en divergence avec la
plupart des autres narrateurs. Westerburg n'a pas tort de le
constater, mais il se hâte trop d'en tirer une déduction favorable
à sa thèse. La coïncidence qu'il signale peut s'interpréter
d'autre manière. Voici, par exemple, dans le seul récit
du siège de Marseille, deux ou trois omissions qui nousfrappent
également chez les deux auteurs : ils ne racontent qu'une seule
bataille navale alors qu'il y en eut deux; ils taisent la perfidie
des Marseillais, qui attaquèrent brusquement les Césariens au
mépris de la trêve jurée; ils taisent aussi le rôle joué dans
la défense de la ville par Domitius Ahenobarbus. Admettons
que le texte de Tite-Live n'ait présenté aucune de ces
lacunes, et supposons les deux écrivains en présence de ce
texte. Lucain, très évidemment, ne s'astreindra pas à suivre
l'historien d'un bout à l'autre : il sacrifiera l'un des combats
sur mer pour ne pas avoir à tracer deux tableaux trop semblables; étant sympathique aux Marseillais, il évitera de
rappeler leur perfidie; pour un motif analogue sans doute,
je veux dire poussé par un sentiment personnel, il passera
sous silence l'activité de Domitius. Florus, à son tour,
négligera tous ces détails uniquement parce que ce sont des détails, et que surcharger son résumé serait absolument
contraire à l'intention de son ouvrage. Ils ont, on le voit, des
motifs différents pour choisir et éliminer dans ce que leur
fournit leur source commune : l'un a des motifs, tantôt de
poète, tantôt de polémiste, l'autre des motifs d'abréviateur.
Mais ces raisons dissemblables les mènent à des résultats
identiques, et par suite, de ce que tous les deux ont laissé de
côté les mêmes parties du récit de Tite-Live, il ne s'ensuit
pas que le second n'ait connu Tite-Live qu'à travers le
premier.
On peut faire un raisonnement analogue en ce qui concerne
l'énumération des présages relatifs à la bataille de
Pharsale. Florus, comme l'a remarqué Westerburg, cite
trois prodiges qui sont aussi rapportés par Lucain : les
ténèbres en plein jour, les essaims d'abeilles posés sur les
enseignes, et la fuite des victimes loin de l'autel. Au contraire
il ignore ceux qu'a racontés César : le miracle de la
statue de la Victoire à Élis, celui du palmier deTralles, et les
bruits mystérieux entendus dans les temples d'Antioche, de
Ptolémaïs et de Pergame. Or, dit Westerburg, les prodiges
mentionnés par César se retrouvent chez des historiens
qui, à coup sûr, procèdent de Tite-Live (Valère-Maxime, Dion,
Plutarque, Julius Obsequens). Donc, ils étaient cités par
Tite-Live, et puisque Florus les a omis, c'est qu'il n'a pas
consulté directement Tite-Live.
Mais, d'abord, la conformité entre Lucain et Florus n'est
pas absolue. Lucain parle de certains présages, tels que les
météores célestes, les pila fondus par la foudre, les apparitions de fantômes, que Florus paraît ne pas connaître.
Ensuite, et surtout, essayons de nous représenter ce que
devait être, sur le sujet qui nous occupe, le texte de Tite-Live.
Nous savons par la troisième Décade, comment il procède en
pareille matière : il se pique d'être très complet, et recueille
pieusement tous les signes, y compris les plus bizarres, de
la volonté divine. Son récit comprenait donc, très probablement, tous les prodiges observés avant Pharsale, aussi bien
ceux que nous lisons chez César que ceux qui nous ont été
transmis par Lucain. Dans ce vaste répertoire, chacun de
ces imitateurs a pris ce qui lui a paru le plus intéressant. Et
si, cette fois encore, le choix de Lucain s'est trouvé analogue
ou à peu près à celui de Florus, cela n'est pas étonnant. Les
miracles décrits par eux sont ceux qui ont eu lieu à Pharsale
même, tandis que ceux dont il est question chez César se
sont produits en Asie. Lucain s'est attaché à ceux-là de préférence
parce qu'ils faisaient en quelque sorte partie intégrante
du récit de la bataille, et Florus parce que l'endroit
où ils s'étaient manifestés leur donnait une importance capitale.
Ici, comme tout à l'heure, la coïncidence s'explique sans
qu'on ait besoin de recourir à l'hypothèse d'un emprunt de
Florus à Lucain.
Il y a d'autres détails, dans l'Épitome, qui paraissent à
Westerburg offrir des réminiscences plus ou moins déformées
de la Pharsale. Ainsi, lorsque César revient à Rome après
avoir chassé Pompée d'Italie, et qu'il veut s'emparer du trésor
public, Florus dit que « les tribuns » tardèrent à lui en
ouvrir les portes. Pourquoi « les tribuns »? C'est, dit
Westerburg, que dans le passage correspondant du livre III
Lucain en nomme deux, Metellus et Cotta. Or, précisément,
chez Lucain, Metellus est seul à vouloir résister aux
ordres de César, et Cotta n'intervient que pour l'exhorter à
la soumission. Il faut donc supposer que Florus a lu le texte
du poète d'un oeil singulièrement distrait, et c'est ce que
Westerburg admet en effet. Mais, au lieu de cette explication
quelque peu subtile, n'est-il pas plus simple de penser
que Tite-Live a pu nommer plusieurs tribuns comme ayant
tenu tête au vainqueur? Lucain en aura choisi un pour personnifier et mettre en relief cette fière obstination, ce qui est
un procédé très poétique; et Florus, rapide comme toujours,
se sera contenté d'une expression collective un peu sommaire Un peu plus loin, en racontant le siège de Marseille, Florus
dit que les opérations étaient confiées à Brutus. En
réalité, Brutus ne commandait que la flotte; l'armée de
terre était dirigée par Trebonius. Seulement Lucain ne
nomme que Brutus ; et sans doute, d'après son récit, Florus se
sera imaginé qu'il n'y avait pas d'autre chef. Tel est le raisonnement
de Westerburg, et je conviens qu'il est spécieux.
Pourtant, à bien y regarder, on peut, je crois, découvrir
d'autres raisons de l'inexactitude de Florus. La guerre
navale, si elle ne fut pas réellement plus importante que le
blocus par terre, semble du moins avoir frappé davantage
les esprits : il est donc naturel que, dans un abrégé, on ait
mis au premier plan celui qui l'avait conduite. La personnalité
de Brutus paraît avoir été d'ailleurs plus connue que
celle de Trebonius. Enfin, dans une circonstance relatée par
César, Trebonius s'opposa à ce que l'on prît la ville d'assaut ;
il ne faisait que se conformer aux ordres laissés par le général
en chef, mais il n'en fut pas moins en butte aux récriminations
des soldats. Tout cela, dans une certaine mesure,
pouvait concourir à faire regarder Brutus comme le véritable
vainqueur de Marseille, et c'est peut-être ce qui fait que
Florus ne s'est souvenu que de lui.
Plus loin encore, au cours de la lutte navale engagée sur
la côte illyrienne, Florus parle de radeaux envoyés par Basilus
à C. Antonius, tandis qu'en fait ces radeaux ont été lancés
par C. Antonius pour rejoindre Basilus. Westerburg
pense que cette erreur procède du récit de Lucain mal compris. Mais ce récit est très clair, et concorde absolument
avec celui des autres historiens. Florus a pu l'interpréter de travers, sans doute : mais il a pu tout aussi bien se méprendre
sur le texte de n'importe quel auteur, voire même de
Tite-Live. Son contre-sens ne porte pas en soi de certificat
d'origine. Autre contre-sens, selon Westerburg, dans le récit de la
guerre d'Épire. Lucain dit que César marche sur Dyrrhachium
pour empêcher Pompée d'avoir l'accès de cette
place. Dans cette phrase, peut-être légèrement équivoque,
Florus croit qu'il s'agit d'un assaut contre Dyrrhachium, et
le mentionne en propres termes. Mais y a-t-il là vraiment
une inexactitude ? César dit lui-même que sa manoeuvre
avait un double but : ou bien enfermer Pompée à Dyrrhachium,
ou bien le couper de ses communications avec cette
ville. C'est ce dernier résultat qui fut atteint. Florus a
bien pu s'embrouiller dans le récit de ces opérations un peu
compliquées, récit qu'il lisait probablement chez Tite-Live.
Son erreur la plus grave, à mon sens, ce n'est pas d'avoir
cité une attaque contre Dyrrhachium ; c'est plutôt de l'avoir
citée dans la même phrase que le blocus du camp de Pompée
et après ce blocus, alors qu'elle lui est bien antérieure.
Mais, de cette confusion-là, Lucain n'est aucunement responsable,
puisqu'il distingue, avec autant de précision que
César ou peu s'en faut, les diverses phases de la campagne (1).
(1) Les opérations du blocus ne sont racontées par Lucain qu a partir de VI, 29 sqq.
Ainsi donc, aucune des assertions de Florus n'est telle qu'il ait dû forcément l'emprunter à Lucain. Par contre, il en est plusieurs qui n'existent pas chez Lucain, et qui, par suite, ont dû être puisées à une autre source. C'est ainsi que, dans le préambule, Florus résume en quelques phrases, les principales parties de la guerre, fait une comparaison entre les forces des deux adversaires, et rappelle leur conflit antérieur, toutes choses dont Lucain ne lui offrait pas le modèle. C'est ainsi encore qu'il termine le passage relatif au siège de Marseille en indiquant le sort que fit César aux ennemis une fois vaincus : Lucain s'était abstenu de donner ce renseignement. De même, il rapporte la soumission de Varron à César,de Varron dont le nom n'est même pas prononcé dans la Pharsale. Il attribue le commandement de la flotte pompéienne dans l'Adriatique à Octavius Libo: par une bizarre contamination entre les deux amiraux M. Octavius et Scribonius Libo : or, le premier seul figure chez Lucain (1), et il faut donc que Florus ait lu ailleurs le cognomen qu'il a si singulièrement accolé au gentilicium Octavius.
(1) Le nom de Libo n'est cité qu'une fois, beaucoup plus tôt, Il, 462, à propos de l'entrée de César en Etrurie.
Il n'a pas trouvé non plus chez le poète
le chiffre des 120 traits enfoncés dans le bouclier du centurion
Scaeva, ni les détails sur la mort de Crastinus.
A supposer donc qu'il ait consulté Lucain, supposition,
qui, nous l'avons vu, n'est point du tout nécessaire, il ne
peut pas n'avoir consulté que lui. Or, recourir en même
temps à deux ouvrages, l'un historique, l'autre poétique, pour
documenter une seule et même partie de son Epitome, serait,
de la part d'un abréviateur, une façon de procéder tout à
fait invraisemblable.
Westerburg va plus loin encore. A ses yeux, la Pharsale a
servi à Florus, non seulement pour le récit de la guerre entre
César et Pompée, mais pour d'autres chapitres. Ainsi Crassus,
lorsqu'il part pour son expédition contre les Parthes,
subit les malédictions d'un tribun, et, parce qu'il a osé les
mépriser, meurt victime de son sacrilège; ce tribun, qui se
nommait en réalité Ateius, est appelé dans l'Epitome Metellus. Aussitôt Westerburg triomphe : Florus a lu, dans
l'épisode de Metellus, des vers qui font allusion aux « imprécations
tribuniciennes » lancées contre Crassus ; il en a
conclu que ces imprécations émanaient de Metellus lui-même.
Mais la façon de parler qu'emploie Lucain exclut,
pour tout lecteur de bon sens, l'idée que Metellus puisse être
l'auteur des malédictions; il ne dit pas « mes menaces » ni même « nos menaces », mais « les menaces d'un tribun ». Ici
comme tout à l'heure, il faudrait que Florus eût fait un
contre-sens sur le texte de Lucain; cela n'a rien d'impossible,
mais il n'est pas impossible non plus qu'il ait commis
un simple lapsus, dû peut-être à l'analogie de situation entre
Ateius devant Crassus et Metellus devant César.
Pareillement, que Florus fasse mourir deux fois le
même personnage, Baebius, d'abord parmi les victimes de
Marius et ensuite parmi celle de Sylla, c'est à coup sûr
une énorme bévue, mais je n'arrive pas à comprendre en
quoi elle prouve une influence quelconque de Lucain sur
Florus : dans la Pharsale comme chez d'autres écrivains,
Baebius est représenté simplement comme ayant été tué
par les agents de Marius.
Westerburg prétend aussi que la description de la bataille
navale de Marseille, telle que l'a tracée Lucain, n'a pas été
sans influence sur Florus : à vrai dire, il ne s'en est pas
servi dans son récit de la guerre de Marseille, mais il s'en est
souvenu plus tard, en racontant la bataille d'Actium.
Mais le passage de l'Epitome consacré à ce combat n'a rien
de très particulier; les quelques détails précis qu'il contient
sont de ceux qui peuvent convenir à plus d'une bataille sur
mer.
Enfin, il est superflu d'attacher la moindre importance à
ce fait que Lucain et Florus comparent à Hannibal, l'un
César et l'autre Marius : c'est un pur lieu commun de
rhétorique, qui sans doute a été repris plus d'une fois à propos
de tous les chefs de guerre. De même, combien d'auteurs
ont dû appeler César une « victime » destinée au
meurtre ! et pourquoi vouloir que Florus soit allé emprunter
à Lucain, plutôt qu'à tel ou tel autre, une expression
aussi courante? Ce sont là de simples banalités, dont la
présence ne prouve rien. Un peu plus significatif, peut-être, est le rapprochement
que Westerburg indique, après Otto Jahn, entre les textes de
Lucain et de Florus relatifs à Camille. On sait que
Camille fut d'abord exilé à Ardée, puis nommé dictateur par
le peuple romain émigré à Veies. Lucain, qui ne songe qu'à
cette dernière partie de son histoire, le représente « habitant
à Veies » pendant l'invasion gauloise, et, en cela, il ne dit
rien qui ne soit exact. Florus au contraire, parle de l'exil
de Camille à Veies, ce qui est une erreur. D'où vient cette
erreur, dit Westerburg, sinon de ce que Florus a mal compris
le Veios habitante Camillo du poète? La chose n'est pas
impossible. Cependant, il se peut aussi que Florus ait simplement
confondu les deux résidences de Camille que le
récit de Tite-Live distinguait. De semblables inadvertances
ne sont pas rares chez lui. Celle-ci, au surplus, se comprend
d'autant mieux qu'elle se trouve, non dans le récit de la
guerre gauloise, mais dans un coup d'oeil rétrospectif sur les
sécessions; là, Florus n'aura pas pris la peine de relire le
livre V de Tite-Live; il aura cité de mémoire, non sans un
peu de fantaisie, les grands faits de la vie de Camille. En tout
cas, l'explication proposée par Jahn et Westerburg, et reprise
par Lejay, n'est, en mettant les choses au mieux, qu'une
hypothèse vraisemblable et non une certitude. C'est peu
pour affirmer la dépendance de Florus, d'une manière générale,
à l'égard de Lucain.
Ussani, reprenant à son tour cette question, a cru devoir
ajouter un nouvel argument à ceux de Westerburg. Lucain, nous dit-il, montre Vulteius exhortant ses camarades à
bien mourir, à se frapper réciproquement plutôt que de tomber
entre les mains de l'ennemi. Il en est de même chez Florus
.Or le Commentum Berriense nous apprend que, chez
Tite-Live, le discours de Vulteius était une exhortation à bien
se battre contre les pompéiens. Florus aurait donc suivi Lucain
et non Tite-Live. Mais, d'après le Commentum Bernese lui-même, Tite-Live décrivait aussi le suicide collectif des
soldats de Vulteius, et la Periocha CX confirme ce témoignage, de son coté Lucain n'oublie pas que Vulteius a
commencé par essayer de combattre. Et enfin Florus le
dit également. Les trois auteurs ont donc distingué exacment
les mémes phases de l'événement : d'abord une tentative
de résistance; puis, après que cette tentative a été vaine,
une résolution de mort volontaire. Lucain et Florus sont ici
de fidèles imitateurs de Tite-Live, et voilà tout. L'exemple
allégué par Ussani est donc incapable de renforcer la thèse
de Westerburg, dont j'ai essayé de démontrer la faiblesse.
Cette thèse, Westerburg l'a étendue, mais d'une façon
beaucoup plus sommaire, au Pseudo-Aurelius Victor, l'auteur
du De uiris illustribus. Il remarque d'abord que Victor,
comme Lucain, se sert en décrivant le meurtre de Pompée de
l'expression mucrone latus fodit. C'est une expression toute
faite, dont l'emploi n'a rien qui doive surprendre. Mais
voici qui est assez curieux : le coup de poignard en question,
Lucain l'attribue à l'égyptien Achillas, et Victor au romain
Septimius. La divergence est assez notable pour empêcher
de croire que Victor se soit ici inspiré de Lucain. Un peu
plus loin, Westerburg me parait mieux raisonner lorsqu'il
suppose que Victor a pu mal interpréter la réflexion de
Lucain sur l'art de la décollation, nondum artis erat caput
ense rotare. Il semble bien que la phrase du De uiris, assez obscure du reste, soit une reproduction inintelligente
du vers de la Pharsale. Il est donc possible que Pseudo-Victor ait subi l'influence de Lucain : il était d'une époque
où l'on pouvait se documenter indifféremment chez un historien
et chez un poète, et je serais assez disposé à donner
raison à Westerburg en ce qui le concerne. J'ajoute d'ailleurs
que la chose a beaucoup moins d'importance que pour
Florus. La conformité de Victor et de Lucain est un argument
négligeable dans la démonstration de Baier ; au contraire, si
l'on avait pu prouver que Florus ressemble à Lucain parce
qu'il l'imite et non parce que tous deux imitent Tite-Live,
une pièce maîtresse de la thèse de Baier serait compromise.
Mais j'espère avoir établi qu'il n'en est rien.
§5
La démonstration que Westerburg a essayé de faire pour
Florus et Pseudo-Victor, Ussani l'a entreprise pour d'autres
écrivains postérieurs à Lucain, pour Appien, Dion Cassius
et Paul Orose. A l'en croire, ces trois auteurs auraient
subi, au même titre que Florus, l'influence de la Pharsale,
et par conséquent leur accord avec Lucain ne prouverait
nullement qu'ils dérivent tous de Tite-Live. Quoique l'argumentation
d'Ussani soit beaucoup moins complète que celle
de Westerburg, et moins propre à faire impression, on ne
peut la passer sous silence.
Chez Appien, Ussani aperçoit deux passages qui lui semblent
avoir été imités de Lucain : la péroraison de la
harangue de César à Pharsale, et le portrait de Caton. A la
fin de son discours, César donne à ses soldats l'ordre de
démolir les murs de leur camp et d'en combler le fossé, afin
de ne conserver aucun refuge en cas de défaite, et, par là
même, de bien montrer aux ennemis leur résolution désespérée. Chez Lucain, César termine par une exhortation
analogue son appel aux armes. Et comme elle est tout à
fait déraisonnable, qu'elle ne peut par conséquent se trouver
chez un historien sérieux tel que Tite Live, il faut donc
que Lucain l'ait inventée, et qu'Appien l'ait copiée sur lui.
Voilà, en substance, le premier argument d'Ussani :
qu'en devons-nous penser ?
D'abord, quand on y regarde de près, les paroles de César
ne sont pas identiques chez Appien et chez Lucain ; ou, si
l'on préfère, la conclusion est bien la même, les motifs
invoqués, au contraire, sont assez dissemblables. Chez
Appien, César dit : Détruisez le camp tout exprès, pour que
l'on voie que vous n'avez pas peur. Chez Lucain, il dit seulement
: Détruisez le camp s'il le faut, pour que l'armée
puisse sortir plus aisément, et, s'il vous en faut un autre,
vous aurez celui de l'ennemi. La différence me parait assez
considérable, puisqu'ici l'ordre est fondé sur le désir d'étonner
et de terrifier l'adversaire, là sur une nécessité tactique
qui peut être réelle. Il en résulte que l'absurdité est beaucoup
plus choquante dans la version d'Appien que dans celle de
Lucain. Appien nous présente, si je puis dire, une« gasconnade» emphatique et déplacée. Au contraire, le langage
que Lucain met dans la bouche de César n'est pas complètement
indigne d'un véritable général. On a supposé qu'en
réalité César avait commandé d'ouvrir une large brèche dans
le retranchement, pour que l'armée pût se mettre plus vite
en marche. Si cette hypothèse est fondée, il n'y a pas
une très grande distance entre le fait exact et les expressions
de Lucain : on peut même prétendre qu'il s'est borné à transposer en une hyperbole poétique les paroles réellement prononcées.
Mais cette hyperbole elle-même, sommes-nous sûrs qu'elle
n'ait pas déjà existé chez Tite-Live ? On sait que les harangues
composées par cet historien ont une couleur de rhétorique
très fortement marquée. Il a donc très bien pu s'inspirer
d'un fait historique pour prêter à César une péroraison
à peu près aussi retentissante et aussi héroïque que celle
qne nous lisons chez Lucain. Et par conséquent Appien a pu
se méprendre aussi bien sur le texte des Décades que sur celui
de la Pharsale, ou plutôt il ne l'a pas mal interprété ; il a cru
l'embellir en renforçant encore la superbe confiance de César.
Voici donc, si je ne me trompe, comment s'est transformé
ou développé le « mot historique » en question. A l'origine,
ç'a été tout simplement un ordre militaire, motivé par le
désir de faciliter la formation de combat des troupes césariennes.
Tite-Live, sans modifier le fond de cet ordre, lui a
donné un tour plus oratoire. Lucain, à son tour, en a tiré
une sententia brillante, tout en ayant soin d'indiquer encore
la raison précise et positive qui avait fait ainsi parler le
général. Appien, enfin, reprenant lui aussi la phrase de
Tite-Live, et ne voulant pas rester en arrière dans ce concours
d'éloquence déclamatoire, a exagéré et faussé une
idée parfaitement explicable jusqu'alors, en y introduisant
une jactance on ne peut plus inopportune. Mais que, dans ce
travail saugrenu, il ait pris pour base la harangue de Lucain
au lieu de celle de Tite-Live, rien ne le démontre, et c'est là
l'essentiel pour le problème qui nous occupe.
Quant aux deux ou trois lignes qu'Appien consacre à
esquisser le portrait de Caton après avoir raconté son suicide,
il m'est impossible de découvrir pourquoi Ussani les rapproche
des admirables vers du livre II de la Pharsale. L'éloge
qu'Appien décerne à Caton est bien sommaire : il le loue seulement
de s'être montré toujours très ferme, et d'avoir réglé
sa conduite sur des principes fixes plutôt que sur les habitudes
courantes. Il ne rappelle ni son abnégation, ni sa sobriété, ni son horreur du luxe et des plaisirs, ni sa passion
farouche de la justice, aucune de ces qualités que Lucain a
signalées, et qui composent une si originale figure de stoïcien
rigide et acharné. Le jugement de Lucain se rattache
directement aux traditions d'une école philosophique déterminée
: celui d'Appien n'est qu'une appréciation banale et
succincte, dont il a pu rencontrer partout la première idée.
Ussani fait ensuite, d'après Baier, une remarque qui, si elle
était exacte, infirmerait sa thèse sur les rapports entre Appien
et Lucain. Dans Appien, dit-il, Marcia revient chez son
ancien époux Caton du vivant de son second mari Hortensius;
Lucain, comme Plutarque, ne place son retour chez
Caton qu'après la mort d'Hortensius. Ce n'est pas tout à fait
vrai. Si Lucain s'exprime d'une manière précise, le texte
d'Appien est plus vague, et peut s'interpréter dans les deux
sens à volonté. En somme, tout ce qu'Appien dit de Caton présente le même caractère de rapidité superficielle,
et par suite, il est impossible de déterminer s'il l'a emprunté
à Lucain, ou à Tite Live, ou à quelque panégyriste de Caton,
tel que Cicéron ou Brutus.
Pour établir que Dion Cassius s'est inspiré directement
de Lucain, Ussani n'allègue qu'une preuve : c'est que tous
deux se refusent à croire sincères les larmes versées par
César devant la tête de Pompée et son accès de colère contre
les meurtriers. Mais ce doute, si naturel chez tout écrivain
qui n'est pas un partisan systématique de César, qu'est-ce
qui nous prouve que Tite-Live ne l'avait pas déjà formulé?
Non, répond Ussani, car dans la Periocha du livre
CXII, il est dit expressément que César se fâcha et pleura.
Ceci ne signifie rien. Il faut distinguer entre le fait matériel
et l'interprétation, forcément conjecturale, qu'on en propose.
Le fait matériel n'est pas douteux, et n'est contesté par personne,
à telles enseignes que les deux mots de la Periocha ont leurs équivalents textuels chez Lucain et chez Dion.
Mais, une fois que l'on a mentionné ces pleurs et ces reproches
véhéments de César, il faut les expliquer, et c'est ici
que le désaccord commence. Or Tite-Live, sans être un
psychologue aussi pénétrant et surtout aussi pessimiste que
Tacite, n'ignore tout de même pas complètement qu'il y a
des « dessous » aux plus belles actions. Il a parfois discuté
la sincérité de ses personnages (1).
(1) Par exemple pour les visions de Scipion l'Africain (XXVI, 24).
J'ai peine à croire qu'il
ne l'ait pas fait pour César en cette occasion, d'autant mieux
qu'il ne l'aimait ni ne l'estimait beaucoup. Seulement la
Periocha, et cela se comprend aisément, n'a enregistré que
le fait tangible de la colère de César, et a négligé de dire ce que
Tite-Live pensait de cette colère. Ceci n'est pas une supposition
arbitraire. On sait que certains manuscrits nous ont
conservé des « arguments » des divers livres de la Pharsale. Pour le passage qui nous occupe, voici ce que donne l'argument
: « César arrive en Égypte, et, voyant la tête de Pompée,
gémit sur la mort d'un si grand homme ». Imaginons
un instant que la Pharsale ait péri, qu'elle ne nous soit connue
que par ces brefs résumés, et que les critiques modernes,
à l'aide de ces vestiges, essaient de la reconstituer conjecturalement
: plus d'un, à coup sûr, affirmerait que Lucain a
ajouté foi à la douleur de César, que, malgré sa haine, il n'a
pas voulu calomnier un grand homme, qu'il s'est laissé
désarmer par l'imposante majesté de cette scène sublime, etc.
Ce serait aussi ingénieux que faux. On voit, par cette analogie,
ce que vaut la preuve qu'Ussani a cru pouvoir tirer
de la Periocha.
Mais, dit-il encore, si ces insinuations malveillantes, que
Lucain et Dion lancent contre César, avaient été dans Tite-Live, on les retrouverait chez les autres imitateurs de Tite-Live, chez Valère-Maxime, Florus, Plutarque, Eutrope, Paul
Orose. Et on ne les y retrouve pas. Cela peut s'expliquer aisément. Parmi ces écrivains, les uns sont plus favorables
à César que ne l'était Tite-Live, comme Valère-Maxime et
Plutarque; il est naturel qu'ils n'aient pas accusé leur héros
d'avoir joué la comédie du regret. Les autres, comme Florus,
Eutrope et même Paul Orose, sont plus ou moins abréviateurs
: ils n'ont pas eu le temps d'entrer dans une controverse
aussi subtile.
Ce qui montre que Dion a eu sous les yeux le texte de
Lucain, ajoute Ussani, c'est qu'il ne l'a pas compris. II a cru
que, chez le poète, César commandait aux Romains d'ensevelir
la tête de Pompée, tandis qu'en réalité cet ordre s'adresse
aux Égyptiens coupables du meurtre. Il a cru
aussi que Lucain dépeignait les compagnons de César se
moquant de lui, alors que le mot employé dans la Pharsale n'exprime qu'une sérénité indifférente, et nullement la
raillerie, et là-dessus il a imaginé de raconter que les larmes
feintes de César avaient excité le rire. Comme nous n'avons
pas le récit de Tite-Live, il est impossible de préjuger
s'il se prêtait ou non à de tels contre-sens. Mais ces contre-sens
sont-ils bien réels? et Ussani, qui accuse Dion d'avoir
mal compris Lucain, comprend-il bien Dion à son tour?
Dans ces conditions,
l'idée d'un rapport direct et étroit entre Dion Cassius et
Lucain devient une hypothèse, non pas invraisemblable, sans
doute, mais absolument gratuite.
C'est également, je crois, ce qu'il faut penser du rapprochement
établi par Ussani entre Lucain et Paul Orose. Ce dernier, dans son récit de la bataille de Pharsale, attribue à
Pompée le mot célèbre de César : «Épargnez les citoyens
». Suivant Ussani, cette erreur reposerait sur le
témoignage, mal interprété, de Lucain, qui félicite Pompée
d'avoir voulu faire cesser le carnage le plus tôt possible en
se résolvant à fuir. Mais comme Lucain lui-même
reproduit, en un autre endroit, la parole de César, il
faudrait que Paul Orose eût lu bien négligemment le poème
pour s'y tromper à ce point. Il faudrait aussi qu'il eût fait
exprès de mal comprendre le vers de Lucain relatif à Pompée,
vers dont la signification est toute différente. Il est
plus simple, me semble-t-il, de supposer que la bévue
d'Orose est tout simplement un lapsus ou une faute de
mémoire, et que Lucain n'y est pour rien.
Ussani conclut sa démonstration en disant qu'à part Plutarque,
tous les historiens de l'époque impériale ont subi
l'action de Lucain. Je crois être arrivé à un résultat diamétralement
opposé. Ni pour Florus, ni pour Appien, ni pour
Dion Cassius, ni pour Paul Orose, il ne me paraît possible
de soutenir que Lucain ait été, au sens propre du mot, une
« source » historique. Quelques-uns d'entre eux ont pu lire
la Pharsale, sans doute; ils ont pu, à l'occasion, en reproduire,
par une vague et inconsciente réminiscence, une pensée
ou une locution. Mais aucun d'eux n'a consulté Lucain
d'une manière habituelle et régulière, comme un abréviateur
ou un compilateur consulte un historien. Comme
cependant tous présentent avec lui des ressemblances trop
nombreuses et trop frappantes pour être le fruit d'une
coïncidence fortuite, la conclusion s'impose, et c'est celle
de Baier, qui doit rester debout malgré les objections que
je viens de discuter : tous ces écrivains, si voisins de
Lucain sans l'avoir copié, procèdent de la même source que
lui, laquelle source ne peut être que Tite-Live.
§ 6.
Jusqu'ici la discussion nous conduit à admettre que
Lucain s'est inspiré de Tite-Live : mais ne s'est-il inspiré
que de lui ? n'a-t-il pas, tout en se servant des Décades, cherché
à renforcer les éléments qu'il y prenait par des matériaux
empruntés à d'autres écrivains? c'est ce qu'ont soutenu
plusieurs critiques, Ussani entre autres, et d'une
façon particulièrement systématique. Il faut donc ici
examiner sa théorie « décentralisatrice ».
J'ai dit plus haut pourquoi il me paraissait difficile
d'imaginer que Lucain eût compilé ou «contaminé » divers
auteurs pour écrire la Pharsale. Cependant cette objection,
bien qu'inspirée par la pensée des conditions dans lesquelles
se trouvait alors le poète, ne saurait suffire pour écarter a
priori l'opinion d'Ussani. Un argument de vraisemblance
est toujours trop hypothétique pour prévaloir contre les
faits. Voyons donc si, parmi les détails que présente le
poème de Lucain, il y en a quelques-uns qui ne puissent pas
découler de Tite-Live.
Ussani commence par poser une question préjudicielle :
Lucain a-t-il connu l'oeuvre de Tite-Live directement, ou
par l'intermédiaire d'une Epitome qui en aurait été faite
vers l'an 30 de notre ère, et qui aurait servi également à
Valère-Maxime et à Velleius Paterculus? il se prononce pour
la seconde alternative. Les arguments sur lesquels il se
fonde me paraissent assez faibles. L'un d'eux consiste à
relever chez Lucain des expressions qui, étant d'un usage
peu classique, doivent venir plutôt d'une histoire écrite sous
Tibère que d'un ouvrage contemporain d'Auguste. Mais, en premier lieu, il faudrait établir que ces expressions appartiennent
vraimentà la langue de la décadence, chose assez difficile
à démontrer avec l'insuffisance de nos renseignements
sur l'évolution grammaticale du latin. D'ailleurs, on le sait
depuis les beaux travaux de Riemann, la décadence de la
langue latine, puisque « décadence » il y a, apparaît déjà
chez Tite-Live par plus d'un indice. Enfin, n'oublions pas que
Lucain a fort bien pu employer de son propre mouvement
les termes en question : ils n'ont rien d'assez rare pour qu'il
faille rejeter cette supposition si simple. De toute manière,
l'argument grammatical doit, je crois, être écarté du débat.
Ussani en invoque un autre : suivant lui, une commune
influence de l'Epitome expliquerait seule les ressemblances
que l'on peut constater entre Lucain et Velleius Paterculus.
Il a raison de dire que ces ressemblances ne peuvent avoir
pour cause une imitation de Velleius par Lucain, que l'opuscule
du premier est trop sommaire, et il pourrait ajouter
: trop animé aussi d'esprit césarien, pour que le second
ait songé à l'utiliser. Mais quelles sont ces analogies si
frappantes entre les deux auteurs? Tous deux dépeignent
Carthage et Marius se consolant réciproquement de leur
ruine : sententia pure et simple, que n'importe quel rhéteur,
un tant soit peu habitué à aiguiser l'antithèse, pourrait
imaginer. Tous deux parlent du triomphe remporté par
Pompée alors qu'il n'était encore que chevalier : fait bien
connu, que tous les biographes et panégyristes de Pompée
ont dû relever. Tous deux rappellent la vanité de Pompée,
qui ne peut souffrir d'égal : j'ai montré plus haut que
déjà César avait formulé ce reproche dans des termes à peu
près identiques, et, depuis, bien des historiens ont dû le
reproduire. Tous deux déplorent que la mort de Julia ait fait
disparaître le « gage » suprême de concorde entre les deux
rivaux : ce regret est de ceux qu'un narrateur de la guerre civile ne pouvait guère manquer d'exprimer. Tous deux
mentionnent le procès de Milon et la part que Pompée prit
à sa condamnation : encore un événement de grande notoriété,
qui faisait partie du domaine commun de l'historiographie.
Tous deux appellent Curion « audacieux » et lui
reprochent d'avoir « allumé » la guerre civile : ni l'idée ni la
métaphore n'ont rien d'extraordinaire. Tous deux signalent
le retard que la résistance de Marseille apporta aux projets
de César : constatation également à la portée de tout le
monde. Tous deux remarquent que Pompée était arrivé,
quelque temps avant la guerre civile, à une hauteur de gloire
et de puissance impossible à surpasser : ici, comme tout à
l'heure, la réflexion est fatalement suggérée par le spectacle
des faits. Tous deux enfin exagèrent démesurément l'importance
du carnage de Pharsale : tandis que César ne compte
que 15.000 morts dans l'armée de Pompée, et que Plutarque,
d'après Pollion, réduit ce chiffre à 6.000, Velleius
déclare que ce jour fut le plus sanglant de l'histoire
romaine et que les deux partis y perdirent des flots de sang ;
Lucain, lui aussi, décrivant cette bataille qu'il appelle « la
mort de tous les peuples», dépeint les plaines thessaliennes
noyées dans le sang italien. Mais il faut noter que ni l'un
ni l'autre ne donnent de nombre précis, et dès lors leurs
façons de parler, qui traduisent une impression et non un
renseignement statistique, peuvent facilement être analogues.
L'hyperbole n'est surprenante ni chez un historien déclamateur
ni chez un poète (1).
(1) USSANI trouve encore une ressemblance entre la dédicace finale de Velleius à Tibère (II, 131) et la dédicace initiale de Lucain à Néron (I, 45-66). Mais les flatteries que contiennent ces deux morceaux appartiennent au genre de la rhétorique courtisanesque; elles sont déjà en germe chez Virgile et Horace.
Autrement dit, les rapprochements
qu'Ussani établit entre Velleius et Lucain portent sur des idées ou sur des expressions qui, ni les unes ni les autres,
n'offrent rien de nettement caractérisé, et dont on ne peut,
par là même, rien conclure.
A vouloir chercher des ressemblances plus précises, on
risque de s'égarer. Je n'en veux alléguer ici que deux exemples,
que me fournit l'argumentation d'Ussani. A propos des
obstacles qui, durant quelques années, ont retardé la rupture
de César et de Pompée, Velleius et Lucain se servent tous
deux du verbe dirimere. Mais le premier dit que la Fortune
« supprima » tout ce qui pouvait retenir les deux chefs,
et le second, que Crassus, pendant longtemps « sépara » ses
deux complices prêts à en venir aux mains. Y a-t-il là le
moindre rapport réel? De même, Velleius dit que le parti
de Pompée « semblait le meilleur » ; mais il entend par là
qu'il paraissait plus fort que celui de César sans l'être en
réalité. La même locution, chez Lucain, s'applique à la valeur
morale, à la justice de la cause. Dans les deux cas,
il ne s'agit que d'une similitude toute verbale et toute décevante.
Nulle part donc nous ne découvrons un lien particulièrement
étroit entre Velleius et Lucain. Dès lors, rien n'établit
qu'ils aient eu tous deux entre les mains une Epitome composée
sous Tibère. Cette Epitome, dont je ne songe à nier ni
l'existence ni l'influence, devait, par la force des choses,
ressembler beaucoup à l'oeuvre de Tite-Live, et, de toutes
les réflexions que nous venons de passer en revue, il n'en
est pas une qui n'ait pu et dû exister déjà dans le récit original
de l'historien. Si Velleius et Lucain avaient en commun
quelques traits tout à fait spéciaux qu'on fût incapable d'expliquer
autrement, alors, mais alors seulement, il
faudrait interposer entre eux et Tite-Live une Epitome Liuiana. Mais je crois avoir avoir montré que ce n'est pas le cas.
Par conséquent, l'hypothèse que cette Epitome (et non le texte même de Tite-Live) est la source de la Pharsale n'a
aucune base solide. Elle est «possible», logiquement parlant,
en ce sens que rien ne la contredit, mais elle est parfaitement
inutile, et il est sage de ne pas surcharger la discussion
par cette complication superflue.
C'est pourtant sur cette hypothèse, déjà si fragile par elle-même,
qu'Ussani croit pouvoir en échafauder une autre.
D'après lui, non seulement Lucain se serait servi de l'Epitome,
mais c'est par l'intermédiaire de cette Epitome qu'il aurait
connu l'ouvrage historique de Pollion. L'abréviateur aurait
senti le besoin, en effet, de compléter le récit de Tite-Live,
trop exclusivement pompéien, par celui d'un partisan de
César, et, dans ce dessein, aurait choisi Pollion comme
source accessoire. Cette théorie, ingénieuse, soulève plus
d'une difficulté. Il ne semble pas que que les « épitomateurs»,
en général, aient eu l'habitude de pareilles contaminations,
fût-ce même en vue d'arriver à une plus sûre impartialité.
D'ailleurs, si, par exception, celui-ci croyait nécessaire de
faire appel à un témoignage d'origine césarienne, pourquoi
ne s'adressait-il pas à César lui-même? J'insisterais davantage
sur ces objections, si Ussani paraissait tenir beaucoup à
sa conjecture d' une Epitome mi-farcie de Tite-Live et de
Pollion. Mais au fond, sans la démentir, il raisonne de telle
manière qu'elle finit par être sans objet. Il admet la thèse
autrefois soutenue par Giani, selon laquelle Lucain a
directement consulté Pollion. S'il en est ainsi, à quoi sert
de faire intervenir ici l'Epitome? Mieux vaut la laisser de
côté, et examiner en elle-même la question des prétendus
emprunts de Lucain à Pollion.
Ussani en voit un dans le jugement, assez détaillé, que
Lucain porte sur Curion en racontant sa mort. Suivant
lui, ce jugement doit être comparé à celui de Velleius,
et cette communauté d'opinion ne prouve plus simplement,
comme tout à l'heure, une influence de l'Epitome, mais,
d'une façon plus précise, une influence de Pollion. Pourquoi de Pollion plutôt que de tout autre historien? plutôt que de
Tive-Live? quelle raison aurait pu avoir ce dernier de
ménager davantage le tribun versatile et vénal qui fut un
des auteurs responsables de la guerre civile? ou inversement
quel motif aurait pu l'empêcher de rendre justice à sa forte
éloquence? L'appréciation de Lucain sur Curion, comme celle
de Velleius, peut se résumer en deux mots : talent et immoralité.
C'était, je n'en doute pas, celle de Pollion. Mais j'ai
peine à croire que ce n'ait pas été aussi celle de Tite-Live, et
je ne vois pas d'argument pour faire remonter à l'un plutôt
qu'à l'autre la paternité d'un jugement d'ailleurs si conforme
à la vérité des faits.
Je vais plus loin, et je me demande si, dans le portrait
qu'ils tracent de Curion, Velleius et Lucain s'inspirent bien
du même auteur. Évidemment ils s'accordent sur les principaux
points, et ne peuvent pas ne pas s'y accorder : tous
deux font de Curion un homme admirablement doué,
mais d'une audace éhontée, et un des principaux agents
des troubles politiques. Mais sa vénalité, que Lucain,
par deux fois, affirme sans hésiter, paraît douteuse à
Velleius. La divergence, sur une question aussi importante,
est au moins curieuse. En d'autres termes, toutes les
assertions de ces deux écrivains au sujet de Curion ne sont
pas identiques; celles qui le sont se rapportent à des choses
extrêmement connues, qui ont du être mentionnées par plus
d'un historien antérieur; et enfin, à supposer qu'ils aient
usé l'un et l'autre de la même source, rien n'établit que cette
source soit Pollion, et non Tite-Live.
Ussani découvre encore l'influence de Pollion dans les
vers que Lucain consacre au passage du Rubicon par César.
Il distingue à ce propos deux groupes parmi les auteurs qui ont parlé de la guerre civile. Pour les uns, Dion, Florus,
Paul Orose, le passage du Rubicon est un fait si insignifiant
qu'ils ne prononcent même pas le nom du fleuve. Pour
les autres, Lucain, Plutarque, Appien, c'est un acte
décisif, le commencement réel des hostilités, le symbole
matériel qui manifeste d'une façon éclatante la rupture de
César avec la légalité républicaine. Les premiers s'inspirent
de Tite-Live, et les seconds de Pollion, puisque Plutarque
cite Pollion comme un des officiers qui étaient aux côtés de
César en ce jour mémorable, témoins de ses perplexités et
auditeurs du fameux alea iacta esto. Il est très naturel que
Pollion ait en effet mis en relief l'importance du passage du
Rubicon : mais avons-nous quelque raison de supposer
qu'elle ait été méconnue par Tite-Live? Celui-ci était trop
près des événements pour ignorer l'importance, dans ce
qu'on pourrait appeler la géographie constitutionnelle, du
fleuve qui formait la limite entre la Gaule et l'Italie. Il était,
selon toute apparence, trop bien documenté par les souvenirs
des contemporains pour ne pas avoir entendu parler
des hésitations de César au moment de franchir cette limite.
Il était trop attaché au parti aristocratique pour laisser
échapper cette occasion de montrer l'usurpateur puni, dès
le début de son crime, par un remords anticipé. Il était enfin
trop épris de narrations dramatiques pour passer sous
silence une scène aussi émouvante. Même dans le récit
volontairement froid et impersonnel des Commentaires, on
aperçoit pourtant la haute signification de cette entrée sur
le territoire italien. Sans nommer le Rubicon, César place à
ce moment-là, à la veille de la marche sur Ariminum, sa
harangue essentielle à ses soldats, celle dans laquelle il
leur expose ses griefs et leur justifie sa conduite :
preuve évidente qu'à ses yeux la marche du lendemain
sera tout de même quelque chose de plus qu'une étape
ordinaire ! Comment croire que Tite-Live ne s'en soit
pas rendu compte? L'objection d'Ussani consiste à dire :
« Si Tite-Live avait parlé de la scène du Rubicon, Florus, Dion, Orose en parleraient aussi. » Cela n'est pas sûr.
Florus, comme abréviateur, omet bien des détails, même
frappants. Dion laisse tomber certains épisodes et en
développe démesurément certains autres, d'une manière
très arbitraire, souvent inintelligente. Orose, lui non plus,
ne suit pas régulièrement l'auteur qu'il imite. Le silence de
ces trois écrivains ne prouve donc pas le silence de Tite-Live, et par conséquent Lucain a pu lire chez cet historien,
tout aussi bien que chez Pollion, le récit des inquiétudes de
César sur les bords du Rubicon. Avait-il même besoin de
le lire chez un historien quelconque ? il me semble que cette
anecdote si frappante devait être de celles qui sont partout
et nulle part. Je ne serais pas surpris qu'elle eût fourni un
thème aux suasoriae d'école : « un officier de César lui conseillant,
ou le dissuadant, de franchir le Rubicon »,
« César haranguant ses troupes pour les rassurer avant
d'entrer en Italie », ce sont, à mon avis, des sujets aussi
scolaires que le «discours à Cicéron pour l'empêcher de
brûler les Philippiques », etc. (1).
(1) SEN. RHET., Suas., 7.
Il se peut donc fort bien
que Lucain ait trouvé simplement dans ses souvenirs d'école
la matière de l'épisode du Rubicon ; mais si l'on veut qu'il
l'ait empruntée à quelque historien, nulle raison ne nous
force à penser que cet historien ait été un autre que Tite-Live.
Enfin, toujours suivant Ussani, il faudrait expliquer par
l'influence de Pollion la sévérité que Lucain, comme Velleius,
témoigne à Sextus Pompée. Ou plutôt il y aurait lieu de distinguer
chez Lucain deux jugements sur Sextus : l'un au
livre II, favorable, et venant de Tite-Live, l'autre au livre VI,
hostile, et procédant de Pollion. Mais en réalité le
premier jugement se réduit à un groupe de trois mots,
dont le sens n'est pas clair, et dont le texte même est peut-être
douteux; mieux vaut n'en pas tenir compte. Quant
au second, il concorde bien dans les grandes lignes avec celui de Velleius, mais il s'en sépare quelque peu dans le
détail; ni Velleius ni Lucain ne font beaucoup de cas de Sextus
Pompée, mais Lucain le qualifie de lâche, et Velleius
le représente plutôt comme un aventurier téméraire et stupide
(1).
(1) VELL., II, 73, 1.
Ici encore la parenté des deux écrivains n'est nullement évidente. Quant à prétendre que Tite-Live était trop pompéien pour parler en termes si durs de Sextus Pompée, c'est, en vérité, jouer sur les mots. Le « pompéianisme » de Tite-Live, qui ne l'empêchait pas d'être l'ami d'Auguste, ne l'obligeait pas à être le panégyristede Sextus. On pouvait admirer la gloire du père sans fermer les yeux sur les défaut du fils. Il semble bien que c'ait été la façon de penser la plus habituelle. J'en trouve un vestige dans la phrase où Florus oppose l'un à l'autre les deux Pompées, l'un destructeur des pirates de Cilicie, et l'autre chef de nouveaux pirates (1).
(1) FLORUS, IV, 8, 2.
Cette antithèse est à retenir : elle ressemble au
vers de Lucain sur "ce pirate de Sicile qui souille les
triomphes paternels" ; et, comme Florus, de l'aveu même
d'Ussani, ne doit rien à Pollion, il est fort probable que nous
avons là un souvenir de Tite-Live. Ce n'est donc pas l'opinion
de Lucain sur Sextus, pas plus que sa description du
passage du Rubicon ni son jugement sur Curion, qui nous
forcera à admettre qu'il ait consulté l'histoire de Pollion en
même temps que celle de Tite-Live.
Quant aux autres réflexions qui se trouvent chez Lucain
après avoir été formulées probablement par Pollion, mais
aussi par beaucoup d'autres écrivains, Ussani est le premier
à déclarer qu'on n'en peut tirer aucun argument. Il est
tout à fait dans le vrai, et je ne songerais pas à relever cet
aveu si, à ce propos, il ne faisait incidemment une remarque
singulièrement défavorable à sa propre thèse. Il parle en note de ce qu'il appelle les loci communes de l'historiographie
romaine. L'expression est heureuse, mais on voudrait que
l'idée eût été plus souvent présente à son esprit. C'est pour
avoir méconnu certains de ces « lieux communs » qu'il a si
inutilement compliqué la question des sources de Lucain. Il
aurait pu se dire que bon nombre de faits, de jugements,
d'expressions même, constituent une sorte d'arsenal public,
où chacun peut venir puiser à volonté, et que dès lors,
quand il s'agit de choses aussi générales, ressemblance
n'est nullement synonyme de dépendance.
En ce qui concerne les Commentaires de César (1), Ussani
reconnaît qu'il est aussi difficile d'affirmer que de nier leur
influence directe sur Lucain, puisque César était déjà l'une
des sources de Tite-Live.
(1) Il ne s'agit ici que du De bello ciuili.
Il fait à ce sujet quelques rapprochements
qui ne laissent pas d'être curieux, mais qui, de son
propre aveu, ne sauraient trancher la question. Par exemple,
il remarque que le départ des tribuns au début de la guerre,
spontané d'après Cicéron, est présenté comme une expulsion
par Lucain aussi bien que par César : mais il ajoute
qu'il en est de même dans la Periocha du livre CIX des
Décades et dans le récit de Plutarque; on ne peut donc douter
que, sur ce point, Tite-Live se soit rangé à l'opinion
de César, et non à celle de Cicéron. Ussani signale aussi une
certaine ressemblance entre les passages où César et Lucain
décrivent les canots fabriqués par les soldats césariens lors de
l'inondation de la Sègre : il pourrait noter que Lucain est
ici plus précis et plus prodigue de détails que César; ce dernier
compare simplement ces canots à ceux qui sont en usage
en Bretagne, Lucain rappelle en outre ceux dont se servent
les Vénètes sur le Pô et les Égyptiens sur le Nil. De tout cela,
d'ailleurs, Ussani se refuse à rien conclure. Et pourtant, il lui répugne de croire que Lucain ait pu écrire un poème
sur la guerre civile sans consulter les Commentaires. Je crains
bien que ce ne soit lui prêter un scrupule d'érudit moderne,
peu conforme aux habitudes des anciens, et je crois que, loin
d'être attiré vers César comme vers une source originale, il a
dû s'en défier plutôt comme d'une source suspecte. Pour
renoncer à cet avis, dont j'ai déjà donné les raisons, il
me faudrait des arguments de fait : or Ussani n'en cite qu'un,
et assez douteux. Le voici.
Au livre 1, Lucain mentionne le rappel des troupes de
Gaule après l'attaque d'Ariminum. Il en est de même de
César. Or, il est impossible d'admettre l'exactitude de cette
date, En effet, la première des légions de Gaule qui rejoignit
César, la XIIe, arriva entre Auximum et Cingulum le2 février;
si l'ordre de rappel avait été lancé d'Ariminum (où César
n'entra que le 11 janvier), cela supposerait 600 milles romains
(près de 900 kilom.) parcourus en 14 jours, soit une vitesse de
64 kilomètres par jour. Cette vitesse est tout à fait extraordinaire,
car si, pendant la guerre des Gaules, quelques marches
forcées ont atteint 75 kil., la longueur moyenne du chemin
quotidiennement parcouru semble n'avoir été que de
30 kil. Le récit de César, sur ce point, est donc erroné. Et
l'erreur est volontaire : César a voulu donner le change sur
ses dispositions, faire croire qu'il avait longtemps essayé de
négocier, et ne s'était résigné à recourir aux armes qu'en
désespoir de cause, lorsque l'expulsion des tribuns lui eut
prouvé l'hostilité irréconciliable du parti adverse. Mais,
cette inexactitude voulue de la version césarienne, Tite-Live
n'a pu l'accepter. Puisque donc Lucain reproduit cette fausse
chronologie, il faut qu'il se soit inspiré ici de quelque écrivain
autre que Tite-Live : et de qui, sinon de César?
Telle est l'argumentation d'Ussani. Malgré son apparente
rigueur, elle soulève une grosse objection. Il faut que la version
de César ait trompé quelqu'un, ou Tite-Live, ou Lucain. Pourquoi Lucain plutôt que Tite-Live? Dira-t-on qu'un
poète est, de sa nature, plus sujet qu'un historien à se laisser
duper par des évaluations fantaisistes? Soit, si l'on met
en parallèle, d'une part un poète habitué à vivre dans un
monde de pures fictions, de l'autre un historien d'un sens
critique aiguisé. Mais Lucain a le goût du détail précis et
positif plus que du rêve, et inversement Tite-Live est souvent
disposé à enregistrer sans contrôle sérieux des affirmations
contestables. Des deux, le plus imaginatif n'est pas celui
qu'on pense, ni le plus crédule. Au surplus, comme on vient
de le voir, l'assertion de César, même si elle est fausse, n'est
pas une de ces invraisemblances énormes qui sautent tout
de suite aux yeux. Elle peut très bien être admise par un narrateur
ordinaire, par un homme qui ne s'attache pas à supputer
minutieusement les jours et les lieues, qui juge des
choses avec un simple bon sens un peu hâtif et superficiel.
Et sans doute Lucain répond à cette définition, mais Tite-Live n'y répond guère moins. Ou bien dira-t-on, comme
le fait Ussani, que Tite-Live était trop pompéien pour accepter
une version dans laquelle il était très facile de reconnaître
un mensonge intéressé de César? Mais était-ce réellement
si facile ? César a des intentions d'apologie personnelle,
je n'en disconviens pas; mais, en cet endroit du moins, il
les dissimule habilement. Le rappel des troupes de Gaule est
mentionné dans les Commentaires presque incidemment,
comme un fait sans importance : avant comme après, il y a
des opérations militaires ; après comme avant, il y a des
négociations. Un lecteur qui n'est pas sur ses gardes peut
très bien ne pas se douter que César a eu une arrière-pensée
en relatant ce petit détail à tel moment plutôt qu'à tel autre.
Enfin et surtout, si l'argument d'Ussani vaut pour Tite-Live,
il vaut également pour Lucain. Le premier a dû tenir pour
suspect le récit des Commentaires parce qu'il était défavorable
à leur auteur : le second n'a dû être ni moins hostile ni
moins défiant.
Il est vrai que Lucain, dans l'hypothèse d'Ussani, serait
plus césarien, non seulement que Tite-Live, mais que César
lui-même. Dans les Commentaires, l'arrivés des tribuns fugitifs précède, et sans doute explique, l'ordre de
marche envoyé aux légions de Gaule, mais déjà, sur la
simple nouvelle de ce qui s'est passé à Rome, César s'est
mis en mouvement, a harangué ses troupes, et les a lancées
sur Ariminum. Dans la Pharsale, il n'expose ses projets aux
soldats et ne sollicite leur concours qu'après avoir été rejoint
par les tribuns et après avoir subi leur influence : quelque
furieuse que soit sa passion de combattre, elle ne se traduit
par un acte décisif que lorsqu'elle a été encouragée par les
exhortations de Curion. En d'autres termes, Lucain diminue
l'initiative et la responsabilité de César, ce que César
s'était abstenu de faire. Appien, à son tour, va plus loin
dans la même voie. Il commence par raconter une première
entrevue entre César et Curion, dans laquelle Curion est
pour la guerre immédiate, tandis que César veut encore négocier. Puis, il place l'arrivée des tribuns expulsés, non
seulement avant la proclamation aux troupes (comme le fait
Lucain), mais avant la marche sur Ariminum (1).
(1) App., 33. Il semble (quoiqu'Appien ne le dise pas expressément), que, chez lui, les tribuns rejoignent César à Ravenne. Chez César lui-mème, chez Lucain et chez Dion, la rencontre a lieu à Ariminum. Cette divergence s'explique probablement par une méprise d'Appien sur le texte de Tite-Live ; si Tite-Live a dit, comme César, que les tribuns se sont mis en route pour rejoindre César alors que celui-ci était encore à Ravenne, Appien a pu en conclure à tort que c'est à Ravenne qu'ils se sont réunis.
Cette façon
de présenter les choses est assez singulière, et puisqu'Appien
a certainement subi l'influence de Tive-Live, elle prouve
combien la question est complexe et obscure.
S'il faut cependant une conclusion, j'incline à croire que
Tite-Live a dû raconter d'une manière assez détaillée, mais
un peu confuse, toute cette période de négociations et de
préparatifs. Peut-être ne mentionnait-il pas la date exacte où
fut envoyé en Gaule l'ordre de mobilisation. Cette date,
Lucain l'aurait arbitrairement rapprochée du commencement
effectif des hostilités, de l'arrivée des tribuns et de la
prise d'Ariminum, afin de présenter un tableau plus synthétique et plus frappant. Mais c'est bien dans le récit de
Tite-Live, hardiment simplifié, que je vois l'origine de celui
de Lucain, ce n'est pas dans celui de César. Rien ne me
paraît démontrer que, là plus qu'ailleurs, le poète ait retiré
à son guide habituel une part de sa confiance, pour l'accorder
à celui qu'il devait regarder comme un ennemi.
Avec les Commentaires, les Lettres de Cicéron sont au
nombre des documents originaux auxquels nous recourons
le plus volontiers aujourd'hui pour connaître l'histoire de
la guerre civile. C'est sans doute pour cela qu'Ussani, transportant
dans l'antiquité nos méthodes actuelles de travail,
suppose que Lucain a dû consulter la correspondance du
grand orateur. Il reconnaît du reste qu'on ne peut l'affirmer
avec certitude, puisque très probablement Tite-Live s'en
était déjà servi; mais il essaie de soutenir son hypothèse par
une raison a priori et par des rapprochements de textes qui
me paraissent également faibles.
La raison a priori, c'est le culte de Lucain pour Cicéron.
Je ne veux pas examiner si l'on ne commet pas un sophisme
en concluant, de l'admiration littéraire, à la documentation
historique. Mais je me demande où Ussani découvre, dans
la Pharsale, un si vif enthousiasme pour l'auteur des Lettres
d'Atticus? Il me semble au contraire que Lucain le traite
assez froidement. Il ne signale pas, comme il lui était facile
de le faire, ses efforts opiniâtres pour maintenir ou rétablir
la paix entre les deux rivaux. Il ne parle pas davantage de
son adhésion au parti de Pompée. Il le nomme tout juste
une fois. Il est vrai qu'il le qualifie assez élogieusement,
qu'il vante son grand talent oratoire et son triomphe pacifique
sur Catilina. Mais aussitôt il lui reproche d'avoir mis
son éloquence au service d'une mauvaise cause en se faisant
l'interprète des pompéiens impatients de combattre, et cela
par un égoïste regret du forum et des rostres. Il le rend
donc en partie responsable du désastre de Pharsale : je chercherai plus tard si cette imputation a le moindre fondement
de vérité, mais dès à présent je peux bien remarquer qu'elle
se concilie mal avec la grande admiration dont parle Ussani,
puisqu'elle prête à Cicéron un rôle aussi ridicule que fâcheux.
L'argument tiré de la prétendue vénération de Lucain
pour Cicéron est, comme on le voit, assez discutable. Laissons
donc de côté cette question, trop générale d'ailleurs, et
voyons si, en fait, la Pharsale présente avec la correspondance
cicéronienne des analogies qui ne puissent avoir pour
cause qu'un emprunt direct. Ussani note qu'au début du
poème, comme dans une lettre à Atticus, l'invasion de
César en Italie est comparée à celle d'Hannibal. Mais
c'est une comparaison absolument banale. Le souvenir de
celui qui fut le plus terrible agresseur de Rome avant César,
et qui, par surcroît, arriva en Italie par la même route que
César, se présente tout naturellement à l'esprit dès qu'on
songe aux premières conquêtes du futur dictateur. La rencontre
est trop nécessaire entre Cicéron et Lucain pour prouver quoi que ce soit.
Ussani met en regard d'un autre vers de Lucain une autre
expression de la même lettre à Atticus, où il est question de
l'impression produite par la fuite de Pompée. Peut-être
y aurait-il lieu de remarquer que, jusqu'ici, les textes allégués
viennent d'une seule et même lettre. Il ne faut pas
oublier que cette lettre à Atticus est une des plus vivantes
et des plus dramatiques de toutes : elle raconte les premiers
progrès de César, peint le désarroi du parti sénatorial,
et exprime avec violence une réprobation formelle des ambitions
de l'usurpateur. Aussi serait il possible que Lucain
l'eût particulièrement lue et étudiée, comme une sorte de
« page choisie », sans pour cela consulter l'ensemble de la
correspondance. Mais ceci même n'est pas certain. Car, si
le premier des rapprochements établis par Ussani porte sur
un simple lieu commun, le second repose sur un contre-sens.
Le texte de Lucain est si peu calqué sur celui de Cicéron qu'il dit juste l'inverse. Lucain parle de la panique engendrée par
la fuite de Pompée, et Cicéron, au contraire, dit que cette
fuite provoque une émotion salutaire, une réaction indignée
contre les prétentions de César, et finalement une résolution
d'énergique résistance (1). Il est donc tout à fait inexact de
parler ici d'imitation.
Le dernier argument d'Ussani, pour prouver que Lucain
s'est servi de la correspondance de Cicéron, se rapporte non
plus à une expression du poète, mais à un fait historique.
Lucain, dit-il, représente Pompée désireux d'aller au secours
de Domitius quand celui-ci est assiégé à Corfinium, mais
arrêté par la mauvaise volonté de ses troupes, et condamné à
l'inaction, bientôt même forcé de battre en retraite.
(1) Cic., ad Att., VII, ii, 4.
Or César ne parle pas de ce projet de Pompée ; Plutarque, Appien, Dion, n'en parlent pas non plus, ce qui donne lieu de croire qu'il n'était pas mentionné dans Tite-Live. Il faut donc que Lucain l'ait trouvé ailleurs, et précisément il a pu lire toute cette histoire, très détaillée, dans les lettres de Cicéron à Atticus, ou dans les messages de Pompée transmis par le grand orateur à son ami (1).
(1) Cic, ad Att., VIII, 6, 2.
Je ne m'arrêterai pas à montrer combien il est peu vraisemblable que Lucain ait, seul entre tous, eu l'idée de consulter un texte qui a échappé à tous les historiens. Je n'insisterai par non plus sur cette autre invraisemblance qui consiste à supposer Tite-Live capable de négliger un détail si avantageux pour Pompée, et cela dans une affaire si délicate Car la conduite de Pompée, en cette occurrence, avait donné prise à d'âpres critiques : son refus d'aller délivrer Domitius avait paru tout ensemble une maladresse et une làcheté (1).
(1) Voy par exemple Cic., ad Alt., VIII, 7 et 8. C'est pour exploiter à son profit ce sentiment de réprobation que César rappelle la réponse négative de Pompée à la lettre de Domitius (De bello ciu., 1,19, 4).
Au contraire,
du moment que ce n'était pas la volonté qui lui avait manqué, du moment qu'il n'avait été paralysé que
par l'opposition de ses soldats, tous les blâmes étaient
forcés de se taire. Comment donc admettre que Tite-Live,
ayant le moyen de le disculper sur ce point, ait pu le
laisser échapper? Toutefois, ce n'est là qu'une probabilité
: ne nous attardons pas à la discuter, et venons aux
faits. Il est très exact que ni Plutarque, ni Dion, ni Appien,
ne rapportent le projet de marche vers Corfinium : mais
Lucain lui-même en parle-t-il ? Il dit seulement que Pompée
avait songé à préparer son armée, à fortifier son parti en
réunissant toutes ses forces. Cette formule peut s'appliquer
tout aussi bien, et mieux même, à une concentration
sur un point quelconque de l'Italie, qu'à une expédition
entreprise pour débloquer une ville assiégée. Personne,
donc, pas plus Lucain que les autres, ne mentionne le dessein
dont parle Ussani, et il y a pour cela une bonne raison
: c'est que ce dessein n'a jamais existé. Peut-être a-t-il
existé dans les imaginations troublées de quelques aristocrates,
qui se sont figuré que Pompée allait courir pour sauver
Corfinium, comme ils s'étaient figuré un peu auparavant
que César se précipiterait tout droit sur Rome. Du moins
voyons-nous Cicéron prétendre, en écrivant à Pompée, que
« tout le monde » avait interprété en ce sens son message à
Lentulus. Mais Cicéron lui-même, dans une lettre intime à
Atticus, avait déjà dit que, pour sa part, il ne croyait pas que
Pompée allât secourir Domitius, et en effet, toutes les décisions
de Pompée, toutes ses communications adressées à Domitius
ou aux consuls, excluent cette hypothèse. Il n'a jamais
eu qu'un objectif : la jonction, autour de Luceria, de toutes les
légions disponibles, et c'est pour ne pas compromettre le succès
de ce plan qu'il a sacrifié, de propos délibéré, Domitius et
Corfinium. Lucain ne dit rien qui ne s'accorde avec cette façon
de comprendre les choses; l'idée d'une expédition de secours est absente de son récit, comme elle devait l'être de celui
de Tite-Live, parce qu'elle ne concorde pas avec la réalité.
Reste ce que dit Lucain de la fidélité chancelante des
troupes pompéiennes. La même constatation se rencontre
déjà dans un billet de Pompée à Domitius, transcrit
par Cicéron. Il me paraît impossible que Tite-Live l'ait
ignorée, ou que, la connaissant, il l'ait passée sous silence.
La seule raison qu'on puisse invoquer là-contre, c'est que
rien de tel ne se trouve chez aucun des imitateurs de Tite-Live. Mais Appien ne fait qu'un résumé assez rapide. Dion
semble insinuer quelque chose d'analogue, quand il fai
allusion aux défections qui se produisirent alors, et qui décidèrent Pompée à quitter l'Italie. Quant à Plutarque,
son témoignage, sur cette partie des événements, est sujet
à caution : rappelons-nous que, dans son récit, César entre
à Rome avant d'être allé à Brindes ! D'ailleurs, en ce qui
concerne les sentiments de l'armée pompéienne, aucun ne dit
le contraire de ce que nous lisons chez Lucain : ils s'en taisent,
et voilà tout. On peut donc croire que Tite-Live avait mentionné
les velléités de révolte des soldats, que plusieurs de
ceux qui l'ont suivi ont omis ce détail, et que Lucain, plus
fidèle cette fois, nous en a seul conservé le souvenir.
Ainsi, pas plus pour les lettres de Cicéron que pour les
Commentaires de César, il n'est à penser que la valeur documentaire
de ces textes si précieux ait frappé Lucain au point
de l'attirer directement. Il leur doit beaucoup, cela est sûr;
mais ce qu'il leur doit, il l'a reçu par l'intermédiaire de Tite-Live; nulle part nous ne découvrons de trace certaine d'une
consultation immédiate et personnelle.
LES SOURCES HISTORIQUES (Fin.)
C) Les altérations de l'histoire.
§1
Quand on sait quelle est la source dont un auteur s'est
servi, on est tout naturellement amené à se demander comment
il s'en est servi, dans quelle mesure précise, avec
quelle fidélité ou quelle indépendance. Ici, malheureusement,
le problème est on ne peut plus difficile, si l'on admet,
comme je crois qu'il faut le faire, que la Pharsale dérive
exclusivement du récit de Tite-Live. Nous ne connaissons pas
ce récit, et nous n'avons pas le moyen de le connaître. Rien
ne nous permet de le reconstituer avec une entière certitude,
pas plus les ouvrages qui lui ont servi de matériaux que
ceux dont il a été, à son tour, l'origine. Il est probable que
Tite-Live a consulté les Commentaires, mais il est non moins
probable qu'il a dû les consulter avec une défiance qu'imposait le nom seul de leur auteur; il a dû en retenir beaucoup
de détails, en laisser tomber beaucoup d'autres : lesquels?
nous l'ignorons, et par suite, de ce qu'un fait se rencontre
chez César, nous n'avons pas le droit de conclure qu'il se
trouvait aussi chez Tite-Live. Si, des auteurs utilisés par lui,
nous passons à ses imitateurs, même embarras. Plutarque,
Appien et Dion, pour ne citer que ces trois là, dérivent certainement
de lui, mais pas exclusivement peut-être, et, en tout cas, pas avec une exactitude assez rigoureuse pour nous
rassurer. Il y a un assez grand nombre de points sur lesquels
ils divergent, sans que nous puissions démêler lequel des
trois représente vraiment l'opinion de leur commun inspirateur.
Nous sommes donc réduits à des conjectures surTite-Live, et par conséquent aussi sur le degré de précision avec
lequel Lucain l'a suivi. Si, par exemple, un événement est
mentionné par César et non par Lucain, deux hypothèses
sont également plausibles : ou bien Tite-Live a négligé de le
rapporter, quoiqu'il le trouvât chez César; ou bien il l'a
reproduit, et c'est Lucain qui l'a omis. De même, si, sur un
fait quelconque, nous avons deux versions différentes, l'une
commune à Lucain et à Appien, l'autre à Dion et à Plutarque,
comment affirmer que c'est la seconde plutôt que la première
qui est l'authentique version de Tite-Live? Tout au plus,
lorsque Lucain est seul d'un côté, et les autres auctores Liuiani de l'autre, peut-on croire qu'il s'écarte de la tradition
de Tite-Live : encore n'est-ce pas absolument sûr. Dans
ces conditions, toutes les recherches sur la façon de travailler
de Lucain ne peuvent être que très aléatoires. Ziehen prétend
qu'il est possible de la reconnaître, de discerner les
emprunts du poète et ses inventions personnelles, même sans
le comparer aux autres écrivains issus comme lui de Tite-Live. J'admire une si belle assurance, mais je ne la partage
point. En essayant à mon tour d'étudier la manière dont
Lucain en a usé avec son modèle, je veux au contraire que
l'on sous-entende à chaque page : « dans la mesure où ce
modèle peut être restitué par conjecture. » C'est sous la sauvegarde
de cette formule, aussi utile que modeste, que je
place toute la discussion qui va suivre.
Pour cette discussion, deux méthodes se présentènt. On
peut, en suivant le récit de Lucain d'un bout à l'autre, noter
point par point, vers par vers, ce qu'il offre de commun ou
non avec les témoignages des historiens anciens, particulièrement
de ceux qui passent pour être des échos de Tite-Live.
Cette sorte de commentaire perpétuel, qui peut aisément abonder en rapprochements fort curieux, se trouve, comme
il est naturel, dans les notes des éditeurs de la Pharsale, Haskins, Francken, Lejay (1), et aussi dans les savantes
études de Singels et de Vitelli. Peut-être serait-il fastidieux
de reprendre une besogne déjà faite avec tant de précision
minutieuse. Il me paraît plus intéressant, après
avoir refait pour mon compte ce dépouillement détaillé,
d'essayer d'en classer les résultats suivant un ordre qui soit
méthodique sans être artificiel (2).
(1) Ce dernier pour le Ier livre seulement.
(2) USSANI, dans la seconde moitié de son travail a esquissé ce classement, mais d'une manière qui reste, à mon avis, bien confuse et bien superficielle, et que gâte en outre une trop évidente partialité contre Lucain.
Il y a lieu, tout d'abord, de distinguer les passages où Lucain s'écarte de ce que nous pouvons regarder comme la vérité historique, et ceux au contraire où il se montre à nous comme un esprit avide de réalité assurée, doué d'un certain jugement critique, voire même d'une impartialité relative, bref comme un homme qui a le goût et le sens de l'histoire. Et, parmi ses inexactitudes, il est possible de discerner celles qui sont de pures erreurs, des bévues causées par l'étourderie et la précipitation, celles qui sont voulues par le poète en vue de produire certains effets artistiques, celles enfin qui laissent transparaître les préjugés ou les rancunes de l'écrivain politique. Il me semble que cette manière d'envisager les diverses assertions contenues dans la Pharsale aura l'avantage de nous faire pénétrer, avec plus de clarté et de sûreté, dans le travail de composition de Lucain, et même, s'il se peut, dans le secret de son caractère.
§ 2.
Il est certain que Lucain s'est plus d'une fois trompé. En
plusieurs endroits, et sans qu'on puisse lui attribuer
aucune arrière-pensée, ni littéraire, ni politique, son
récit présente des divergences notables avec celui des historiens les plus autorisés, de ceux qui paraissent le mieux
avoir conservé la tradition de Tite-Live. Ces ereurs ne sont
pas d'ailleurs très surprenantes, si l'on songe que Lucain a
écrit très vite son poème, qu'il n'avait pas fait d'études historiques
préalables, et que ses improvisations antérieures lui
avaient sans doute donné des habitudes de légèreté irréfléchie
dont il est assez malaisé de se dépouiller. D'ailleurs,
ces erreurs ne sont peut-être ni aussi nombreuses ni aussi
grossières que l'ont prétendu certains critiques, dont la sévérité
pointilleuse ne va pas, je le crains, sans quelque
excès. Tâchons de démêler les inadvertances apparentes
et celles qui sont réellement imputables à l'auteur, afin de
porter sur son respect envers l'histoire, sur sa gravité, je
dirais volontiers sur sa probité, un jugement qui ne pèche
ni par indulgence ni par malveillance.
Tout d'abord, il me parait peu équitable de mettre sur le
compte du seul Lucain une confusion qui se retrouve chez
plusieurs autres écrivains latins, celle qu'il a commise entre
Pharsale et Philippes. Il est possible, comme M. Cartault
l'a ingénieusement supposé, qu'à l'origine de cette méprise
il y ait un contre-sens sur le fameux passage des Géorgiques.
Il est possible aussi que Virgile lui-même ait de parti-pris
négligé la distance géographique qui séparait les deux
champs de bataille, pour ne voir que leur proximité relative,
et pour insister sur la fatalité singulière qui avait placé dans
la même région du globe deux des épisodes les plus tragiques
de la guerre civile. Quoi qu'il en soit, après Virgile, on peut
dire que cette fausse identification devient classique dans la
littérature latine ; on la retrouve, par exemple, chez Ovide,
chez Pétrone, chez Juvénal. Par conséquent Lucain n'a
nullement innové en se servant, toutes les fois qu'il en a eu
besoin, des mots de Philippi et Emathia au lieu de Pharsalia et de Thessalia. Ce n'est en somme qu'une licence
poétique.
J'en dirais volontiers autant d'une autre inexactitude
qu'on a relevée chez Lucain. Lorsqu'il énumère les contingents
fournis à l'armée pompéienne par les États de l'Orient,
il dit que les Athéniens arrivèrent péniblement à armer trois
vaisseaux. Or le texte de Tite-Live, qui, cette fois, nous a
été conservé par le Commentum Bernense, ne parle que de
deux navires, et Ussani a aigrement reproché au poète cette
altération de la vérité. Elle a cependant peu d'importance,
sans compter que « trois » se prend souvent en latin dans un
sens indéterminé pour désigner un nombre peu élevé, quel qu'il soit.
Pas plus qu'il n'exagère le chiffre des vaisseaux athéniens,
Lucain ne me semble exagérer, quoi qu'on en ait dit, la force
de l'armée que César avait sous ses ordres en commençant la
guerre. Il appelle ces troupes « immenses », et elles ne
comptaient, d'après l'évaluation de Stoffel, que 12.000
hommes environ (1).
(1) Exactement, selon STOFFEL, 11.800 h., ou trois légions : la VIlle, la XIIe, la XIIIe.
Mais ce qui est peu pour des modernes
pouvait sembler beaucoup à des anciens, qui n'étaient pas
habitués comme nous à des armées gigantesques, et puis
« immenses » est un terme vague, une épithète poétique, et
non une évaluation technique.
Si, même dans les passages purement narratifs, où
l'auteur parle pour son propre compte, il faut faire la part
d'une certaine liberté d'expression, a fortiori n'a-t-on pas le
droit de condamner les hyperboles qu'il met dans la bouche
de ses personnages, et qu'explique leur passion intense. J'en
trouve un double exemple dans les tragiques paroles que Julia adresse à Pompée lorsqu'elle lui apparaît en songe.
Elle lui rappelle que, tant qu'elle a été sa femme, il n'a
remporté que des triomphes sans tache et sans tristesse.
On a fait remarquer que le dernier triomphe de Pompée
était de trois ans antérieur à son mariage avec Julia. Mais
il est bien évident que le mot « triomphes » doit être ici pris
en un sens large, dans l'acception de « succès ». Il désigne,
si l'on veut, l'heureux accomplissement de la mission que
Pompée avait reçue en vertu de la loi Manilia, ou plutôt
encore il désigne sa toute-puissance au moment du premier
trinmvirat. Un peu plus loin, Julia accuse son mari d'avoir
épousé Cornelia alors que les cendres de son propre bûcher
étaient encore tièdes : d'où la réflexion ironique d'Ussani,
qu'il y avait eu en réalité un intervalle de deux ans. Mais de
telles exagérations sont habituelleschez des personnages vraiment
émus sans citer ceux de l'épopée ou de la poésie dramatique,
je rappellerai que, chez Tite-Live, Vibius Virrius
prétend que les soldats romains qui assiégaient Capoue pouvaient
entendre les gémissements de leurs femmes et de leurs
enfants menacés dans Rome par Hannibal. Dirons-nous pour
cela que Tite-Live ne connaissait pas la distance qui séparait
Rome de Capoue?
Dans les quatre ou cinq passages que je viens de passer en
revue, on a reproché à Lucain d'être peu exact parce qu'on
a méconnu les habitudes du style poétique ou oratoire. En
d autres endroits, on lui a fait le même reproche parce qu'on
n 'a pas compris le sens de ses vers. On a incriminé, par
exemple, la phrase où il montre le Rubicon grossi par les
eaux que l'Eurus fait tomber du haut des Alpes. D'abord,
a-t-on dit, le Rubicon ne prend pas sa source dans les Alpes,
mais dans l'Apennin. Pour nous, modernes, soit. Mais les
anciens, de même qu'ils faisaient aller la Gaule jusqu'au Rubicon, semblent avoir rattaché le nord de l'Apennin à la
chaîne des Alpes. Il est absurde, a-t-on dit encore, de
supposer une fonte des neiges le 10 janvier. Lucain s'est-il
trompé sur la date du passage du Rubicon? Mais telle n'est
pas la signification de ses vers, puisque précisément il dit
que le Rubicon n'est torrentiel qu'en hiver. Il s'agit ici,
très certainement, dans son esprit, d'une crue hivernale, et
non d'une crue printanière.
Ussani dit aussi que Lucain a commis une erreur en
représentant César accompagné de ses troupes dans son
voyage de Brindes à Marseille, ce qui en effet serait
impossible à admettre. Seulement ce n'est pas Lucain qui
a fait une erreur, c'est Ussani qui a fait un contre-sens.
Agmine rapto ne signifie pas, comme il l'a cru, « en emmenant
son armée », mais à « marche rapide ».
Trois lignes plus loin, Ussani lit que Marseille a voulu
rester fidèle au traité qu'elle avait conclu avec Pompée,
et, comme un tel traité n'a jamais existé ,il en infère que
Lucain a dû mal comprendre quelque expression vague,
comme fides, qu'il lisait chez Tite-Live. Mais la vérité est
tout autre. Marseille a conclu un traité avec Rome. Or, du
point de vue où se place Lucain, la cause de Pompée est
la cause de Rome même. Par conséquent, en prenant fait
et cause pour le parti pompéien, Marseille lui paraît exécuter
tout naturellement ses obligations d'alliée de Rome.
Dans d'autres passages, le récit de Lucain, comparé à celui
des historiens inspirés par Tite-Live, présente des divergences
indéniables, sans qu'on puisse dire avec certitude de
quel côté est la vraie tradition. Parmi ces divergences,
quelques-unes sont assez insignifiantes. On a discuté pour
savoir si l'Iader mentionné dans la Pharsale était un fleuve ou une ville : les autres écrivains en font une ville; le texte
de Lucain se prête aux deux interprétations; enfin il se peut
qu'il y ait eu à la fois une ville et un fleuve portant le même
nom. On s'est demandé aussi quelquefois si la traversée
téméraire de César dans une barque de pêcheur avait eu lieu
sur la mer, comme le disent Lucain et Dion, ou sur un
fleuve, comme le disent Appien et Plutarque, ou enfin
sur un fleuve d'abord et sur la mer ensuite, comme le veut
Valère-Maxime.
On a remarqué encore que, chez Lucain,
à Dyrrhachium, le centurion Scaeva saute du haut du mur
avant d'avoir été blessé à l'oeil, tandis que chez Appien
il ne saute qu'après : l'inexactitude, par rapport au récit
de Tite-Live, peut être aussi bien du fait d'Appien que de
Lucain. Tout cela a peu d'importance. Bien plus considérables
sont les questions qui se posent au sujet de la guerre
d'Afrique, de la bataille de Pharsale, et du meurtre de
Pompée.
Les opérations de Curion en Afrique, du moins les premières,
sont très compliquées et difficiles à suivre. Le récit
d'Appien et celui de Lucain, non seulement ne concordent
pas, mais présentent tous deux des lacunes nombreuses.
Lucain ne mentionne pas le premier combat contre la cavalerie
numide, ni la victoire navale, ni le siège d'Utique, dont
il ne prononce même pas le nom. Par contre, Appien ne
parle pas des efforts de Varus pour faire déserter les soldats
césariens, ni de sa défaite. Le récit de César est
beaucoup plus complet et plus détaillé, et sans doute celui de
Tite-Live devait l'être aussi. Il semble qu'Appien et Lucain
y aient découpé, chacun de son côté et d'une façon assez
arbitraire, un certain nombre d'événements, en laissant de
côté tout le reste. Mais du moins on ne peut pas dire que Lucain ait commis plus d'inexactitudes sur ce sujet qu'Appien.
Celles qu'on lui a quelquefois reprochées n'en sont pas véritablement.
S'il dit que le premier campement de Curion
eut lieu sur le bord du Bagrada, alors que, d'après César,
il n'y arriva qu'après trois jours de marche, il l'entend probablement
du premier campement important, et en effet
César ne nomme pas les haltes précédentes, qui sans doute
lui paraissaient moins intéressantes à signaler. Vitelli a
noté aussi que, chez César, la victoire sur Varus révèle
l'établissement de Curion aux Castra Cornelia, tandis
que chez Lucain, l'ordre est renversé. Mais quand on y
regarde de près, on s'aperçoit que, dans les Commentaires,
les Castra Cornelia sont mentionnés deux fois : Curion y va
d'abord, en reconnaissance, avant la bataille contre
Varus, et, plus tard, revient s'y installer. Les vers de
Lucain correspondent au premier des deux passages de César,
et non, comme l'a cru Vitelli, au second. En somme, donc,
son récit de la guerre d'Afrique est fort incomplet (et nous en
verrons plus tard les raisons), mais il n'est pas précisément
erroné.
La disposition des troupes pompéiennes (1) à Pharsale est
un des points sur lesquels les écrivains anciens sont le moins
d'accord.
(1) Lucain ne parle pas de l'armée césarienne.
Les récits de César, de Lucain, d'Appien et de Plutarque ne coïncident que pour le centre de l'armée, que tous
nous donnent comme ayant été commandé par Scipion.
Mais, quant aux deux ailes, voici le tableau de leurs indica
tions contradictoires :
AILE GAUCHE AILE DROITE
chez César... Pompée anonyme
chez Lucain .. Lentulus Domitius
chez Appien .. Domitius Lentulus
chez Plutarque...
Domitius Pompée
Si l'on jette les yeux sur ce tableau, on voit d'abord qu'il est assez facile de concilier les données de César et celles de
Lucain. Rien n'empêche que le commandant de l'aile droite,
qui n'est pas nommé par César, ait été Domitius. Pour ce
qui est de l'aile gauche, la contradiction entre les Commentaires et la Pharsale n'est, je crois, qu'apparente. César
ne nomme pas Lentulus, et inversement Lucain ne nous dit
pas où était Pompée. Il est fort possible que tous deux aient
pris placeà gauche, Pompée comme généralissime,et Lentulus
comme chef spécial de cette aile. Ce qui me le fait croire,
c'est que, au chapitre suivant, César dit qu'il a placé, dans
sa propre armée, Antoine à gauche, Cn. Domitius au centre,
et P. Sulla à droite, et qu'il s'est posté lui-même à droite,
en plus de P. Sulla. Par un raisonnement analogue, il est
aisé de faire cesser la divergence entre Appien et Plutarque,
qui est la même que celle que je viens d'expliquer (1).
(1) APPIEN (B. Ciu., 11, 16), dit que Pompée était en arrière, avec Afranius et gardait le camp. II est possible que Pompée se soit en effet tenu un peu en arrière, mais pour mieux diriger la manoeuvre générale des troupes.
Et dès lors, il ne subsiste plus que deux groupes de témoins : César et Lucain, Appien et Plutarque; d'une part Pompée (avec Lentulus) à gauche, Domitius à droite; de l'autre, l'ordre radicalement inverse.De ces deux versions, laquelle est la vraie ? celle d'Appien, répond Ussani sans hésiter, et d'ailleurs sans dire pourquoi. Je pense au contraire qu'il faut donner raison à César et à Lucain. D'abord, parmi ceux-ci, il y en a un qui est un témoin oculaire; dans l'autre groupe, il n'y a que des auteurs de seconde, ou plutôt de troisième main. De plus, Appien et Plutarque, écrivains grecs, ont pu faire un contresens sur l'historien latin, Tite-Live en l'espèce, dont ils se sont inspirés. Enfin il n'est pas douteux que César se soit placé à l'aile droite de son armée : là-dessus, son récit est d'accord avec celui de Plutarque; mais, d'autre part, il dit formellement qu'il a voulu se trouver en face de Pompée, et cela n'a rien que de très vraisemblable ; donc, César étant à droite, il faut que Pompée ait été à gauche. Il est donc très probable que Tite-Live donnait l'aile gauche à Pompée et Lentulus, l'aile droite à Domitius, et le centre à Scipion. Cet ordre, conforme en somme à celui de César, a été mal compris d'Appien et de Plutarque, tandis que Lucain le reproduisait à peu près fidèlement (1).
(1) Il y a deux divergences de détail entre César et Lucain. Les deux légions placées à l'aile gauche sont, chez César, la Ire et la III°, chez Lucain la Ire et la IVe : il est possible que le manuscrit dans lequel Lucain a lu Tite Live ait porté, par erreur de copiste, quatre jambages au lieu de trois. Lucain a confondu les troupes de Cilicie avec celle de Syrie, et les a placées au centre au lieu de les mettre à l'aile gauche. Il constate d'ailleurs, comme César, que c'était la partie la plus forte de l'armée pompéienne.
Enfin, dans l'histoire de la mort de Pompée, quelques
détails séparent Lucain des autres écrivains. La version qu'il
expose de l'arrivée de Pompée en Égypte est la plus détaillée,
et, mesemble-t-il, la plus vraisemblable : d'après lui, Pompée
ne peut aborder à Alexandrie, est porté à Péluse, apprend
que Ptolémée est campé au montCasius, et profite de ce que le
vent d'Ouest continue à souffler pour aller l'y rejoindre.
Appien est plus bref : il dit simplement que le vent amena par
hasard Pompée au mont Casius. Plutarque et Dion ont
l'air d'ignorer cette dernière localité, et le font aborder à
Péluse, sans parler de sa tentative pour aller à Alexandrie.
La différence est réelle, sans être très importante, mais elle
me paraît tout à l'avantage de Lucain. Autre désaccord
sur le nom du conseiller qui fit décider par Ptolémée le
meurtre de Pompée. Appien et Plutarque attribuent cette initiative
au rhéteur Théodote ; Lucain ne le nomme même
pas, et rejette toute la responsabilité sur Pothin. Mais
Plutarque reconnaît que le conseil fut assemblé sur l'ordre
de Pothin, et fut unanime à adopter l'avis de Théodote (ce
que confirme Appien). Lucain n'a donc pas commis une bien
grosse erreur en prêtant à Pothin une décision que celui-ci
avait faite sienne et sanctionnée de son autorité de premier
ministre. Troisième et dernière divergence sur le nom du
meurtrier de Pompée : selon Florus, Appien et Plutarque, c'est
Septimius qui a frappé le coup mortel, tandis que, selon Lucain et l'abréviateur de Tite-Live, c'est Achillas. Il est
probable que, dans le récit de Tite-Live, tous deux étaient
nommés comme ayant porté la main sur Pompée; mais
il est probable aussi que la blessure décisive était mise sur le
compte d'Achillas. Florus, Appien et Plutarque ont cité de
préférence Septimius, parce qu'il leur a semblé plus dramatique
de faire assassiner Pompée par un de ses anciens compagnons
d'armes. Au contraire, ni Lucain ni l'auteur de
la Periocha n'avaient aucun motif de substituer le nom d'Achillas
à celui de Septimius. Ici, comme en ce qui concerne
l'arrivée de Pompée au mont Casius, Lucain me paraît être
l'auteur le plus proche de la vraie tradition.
Ainsi donc, dans tous les passages que je viens d'étudier,
on peut parler de désaccord entre Lucain et les autres écrivains,
mais non pas d'erreurs du poète. Les erreurs réelles,
je ne parle ici que de celles qui ont trait à la guerre civile
proprement dite, et j'omets pour le moment celles qui sont
des altérations tendancieuses de la vérité, ses erreurs ne
sont guère au nombre que de trois ou quatre.
La première, et la plus singulière, porte sur la date du
départ de Pompée pour l'Epire. Lucain formule cette date
par une de ces périphrases astronomiques si chères aux
poètes latins : « Déjà les dernières étoiles de la Vierge
avaient commencé à précéder dans leur lever les Pinces du
Scorpion qui devaient accompagner le Soleil ». Quelle
est l'époque de l'année que désigne cette circonlocution
compliquée? Nous ne pouvons le dire avec certitude, parce
que nous ignorons si Lucain suit le vieux calendrier romain,
c'est-à-dire s'il parle comme parlaient les contemporains
des événements qu'il raconte, ou s'il adopte le calendrier
réformé par César. Mais, dans un cas comme dans l'autre, il
n'est pas douteux qu'il s'agisse d'une date de l'automne. D'ailleurs, un peu auparavant, Pompée a dit aux consuls de
profiter, pour renforcer leurs contingents, des loisirs que
va leur assurer l'hiver. Donc, pour Lucain, Pompée a
quitté Brindes en automne. Or, cela est faux. Les lettres
de Cicéron nous fournissent, très exactement, la date du
17 mars (vieux style). Et non seulement cela est faux,
mais cela est en contradiction avec les données chronologiques
que l'on trouve ailleurs dans la Pharsale. Lucain
place l'inondation de la Sègre, à laquelle César assiste,
quelque temps après l'entrée du Soleil dans le signe du
Bélier. Il est impossible que César soit à Ilerda au printemps
si la lutte contre Pompée l'a retenu en Italie jusqu'en
automne. Ou bien, par hasard, Lucain veut-il parler de deux
années différentes? s'imagine-t-il que César a mis cinq mois
pour aller de Brindes à Ilerda? et entend-il espacer toute la
série des faits, depuis le passage du Rubicon jusqu'à la
défaite de Pharsale, sur une durée de près de deux ans (au
lieu d'un an et sept mois)? De quelque façon qu'on retourne
ces indications chronologiques, on aboutit à des conséquences
invraisemblables.
Si la périphrase était seule en cause, on pourrait être
tenté par l'idée de la corriger de manière à la faire coïncider
avec la date exacte. Mais, sans compter que rien ne serait
plus arbitraire qu'une telle méthode, il faudrait aussi
corriger les paroles prononcées un peu plus haut par Pompée.
Et surtout, ce qui complique la question, c'est que
Lucain n'est pas seul à fournir cette date fausse. Dion, lui
aussi, met en automne le départ de Pompée. Dès lors, le
problème est de savoir, non pas si Lucain et Dion Cassius
ont raison, ils ne peuvent pas avoir raison, mais
comment ils en sont venus à commettre une telle erreur.
Existait-elle déjà chez Tite-Live? cela me semble peu
croyable, de la part d'un auteur qui donne en général avec assez d'exactitude les renseignements de cette sorte, et qui,
dans l'espèce, pouvait sans peine être bien informé. Le
texte de Tite-Live contenait-il quelque phrase susceptible
d'être faussement interprétée? je pencherais plutôt pour
cette seconde explication, et voici l'hypothèse que, faute de
mieux. je me risquerais à proposer. Admettons que Tite-Live ait donné, non la date officielle du 17 mars (vieux
style), mais l'époque réelle à laquelle correspond cette date,
c'est-à-dire le milieu de la mauvaise saison. Supposons
notamment qu'il ait répété ce que dit César, à savoir
que ce dernier n'osa pas poursuivre Pompée parce qu'il
n'avait pas le moyen, à cette époque de l'année, de faire
venir rapidement d'autres navires de la Gaule et du Picenum, etc. D'une telle formule, si elle n'était pas très explicite,
on pouvait à la rigueur conclure que le départ de
Pompée avait eu lieu au commencement de la mauvaise
saison. C'est probablement ce que Dion Cassius a compris,
et ce que Lucain, de son côté, a voulu exprimer par un
détail astronomique d'une précision on ne peut plus intempestive.
A côté de cette erreur de chronologie, il faut en signaler
une qui concerne la géographie, et qui est d'autant plus
grave qu'elle se reproduit plusieurs fois. Trois navigations
entre Brindes et la côte grecque sont décrites dans la Pharsale : celle de Pompée, celle de César, et celle d'Antoine ; Lucain ne semble pas savoir très bien quelle
est la position du point d'arrivée par rapport au point
de départ, et par conséquent quel est le vent qui doit rendre
possible la traversée. Au livre II, Pompée dit aux consuls
qu'ils devront quitter Brindes dès que le Borée soufflera ;
par contre, au chant suivant, lui-même s'éloigne de la côte
italienne vers l'Epire en profitant de l'Auster : peut-être, d'un livre à l'autre, Lucain a-t-il eu le loisir et l'idée de se
renseigner plus précisément, et d'apprendre que Dyrrhachium
n'était pas au Sud de Brindes. Pour le voyage de César, il
n'est question que de l'Aquilon; mais cette fois cela
s'explique, ou à peu près, car le lieu de débarquement n'est
pas Dyrrhachium; c'est Palaeste, plage située au delà de la
presqu'île formée par l'extrémité de la chaîne Acrocéraunienne : pour y arriver en venant de Brindes, il faut un
vent, sinon du Nord, au moins du Nord Ouest; on peut donc
accepter comme approximativement vraie l'indication de
Lucain. Par contre il décrit d'une manière géographiquement
insoutenable la traversée de la flotte d'Antoine, racontée
avec tant de précision par César et par Appien : cette
flotte, qui est emportée par un fort vent du Sud au delà
d'Apollonie et de Dyrrhachium, au delà même de Lissus,
jusqu'à Nymphée, il la représente poussée par le vent du
Nord ; il ne fait intervenir l'Auster qu'au moment de
l'entrée au port, c'est-à-dire juste à l'instant où en réalité
l'Auster cesse de souffler et est remplacé par l'Africus ou
vent du Sud-Ouest. Cette narration, dénuée de toute vérité
topographique, achève de prouver ce que montraient déjà les
paroles de Pompée au livre II, à savoir que, pour Lucain,
toute la côte illyro-épirote était située au Sud-Est de Brindes.
Pour Lucain? ou pour l'auteur qu'il a consulté? Vitelli
adopte cette dernière opinion, sans en donner les motifs.
Elle n'est pas absolument inadmissible en soi : il y a chez
les historiens anciens des méprises aussi fortes sur la situation
relative des divers pays. Tacite, dans la Vie d'Agricola, place bien l'Espagne à l'Ouest de la Bretagne : il n'est
donc pas absurde de supposer que Tite-Live mettait l'Epire au Sud de l'Apulie. Cependant, la bévue commise dans le
récit du voyage d'Antoine est vraiment bien grossière ! et
d'ailleurs Tite-Live devait avoir lu le chapitre des Commentaires,
où les indications sur la direction des vents sont d'une
lucidité parfaite ! En outre, la contradiction que nous avons
relevée entre deux textes de Lucain lui même, au livre II et
au livre III, prouve que le poète a traité avec une certaine
négligence cette partie de son récit. Il a dû se figurer d'une
manière vague et confuse la carte des côtes de la mer
Ionienne, et, d'après cette idée très inexacte, mettre au petit
bonheur les noms de Borée, d'Aquilon et d'Auster. Cela ne
lui a pas réussi le moins du monde.
Ce n'est pas, au surplus, la seule méprise «cartogrophique » qu'il faille lui reprocher. On a vu que, lorsque
Caton quitte la Cyrénaïque pour aller rejoindre Varus et
Juba, Lucain le fait passer par l'oasis d'Hammon, ce qui
n'est pas du tout sa route directe, mais lui impose un crochet
vers le Sud extrêmement invraisemblable. Ici encore
on ne peut mettre en doute l'erreur ; on peut seulement se
demander d'où elle vient. Lucain a-t-il, comme le pense
Ussani, subi d'une façon plus ou moins consciente l'influence
des souvenirs que lui avait laissés l'histoire d'Alexandre?
a-t-il voulu faire naître l'occasion de décrire un lieu célèbre,
de raconter une scène intéressante, de discuter, en philosophe
stoïcien, la question des oracles et des rapports entre
la divinité et les mortels? ou bien, tout simplement, a-t-il
cru que l'oasis était située plus au Nord qu'elle ne l'est en
réalité ? Je croirais assez qu'il ne se représentait pas très
précisément la distance qui pouvait séparer l'oasis de la
côte, et que, par suite, il ne devait pas trouver invraisemblable
de faire passer par là l'itinéraire de Caton.
Telles sont les inexactitudes les plus choquantes de la Pharsale.
Je ne crois pas en avoir dissimulé la gravité. Cependant
je me demande si la plupart des oeuvres historiques de l'antiquité,
oeuvres écrites plus à loisir, plus tranquillement,
et avec plus de prétentions à la vérité scientifique, n'en contiennent pas d'aussi nombreuses et d'aussi frappantes. Il
ne semble donc pas que ces deux ou trois bévues suffisent à
disqualifier Lucain comme historien.
§3.
Les erreurs que nous avons constatées jusqu'ici paraissent
bien être involontaires. On ne voit pas quel intérêt Lucain
aurait eu, par exemple, à mettre l'Aquilon à la place de
l'Auster : cela ne pouvait lui servir, ni à faire admirer son
talent de poète, ni à faire triompher ses opinions de polémiste.
Tout au plus serait-on fondé à se demander si peut-être,
en faisant passer Caton par l'oasis, il n'a pas songé à
se ménager un motif dramatique et pittoresque : encore n'est-ce
pas certain. Mais les autres inexactitudes semblent être
des inadvertances, beaucoup plutôt que des altérations systématiques
de la vérité.
Il en est tout autrement pour celles que nous allons maintenant
passer en revue. Il s'agit cette fois de détails que Lucain
n'a guère pu ne pas connaître, qui n'étaient pas non plus de
nature à choquer ses passions ni à nuire à sa thèse, et qu'il
a cependant sacrifiés ou modifiés délibérément, sous l'empire
d'un sentiment artistique, très légitime d'ailleurs et souvent
très heureux.
En tant qu'artiste, il procède avant tout par élimination.
Il laisse tomber de parti-pris des faits qu'il ne juge pas susceptibles
de renforcer l'impression pittoresque ou pathétique
qu'il veut produire. Prenons, par exemple, les événements
qui se sont passés après le départ de Pompée pour l'Epire.
Aussitôt qu'il a raconté les opérations de Brindes, César
énumère les gouverneurs envoyés dans les diverses provinces,
tant par lui-même que par le Sénat, et analyse le discours
qu'il a prononcé à Rome. Toutes ces indications,
soyons-en sûrs, devaient se retrouver chez Tite-Live, qui, en
pareille matière, est habituellement consciencieux jusqu'à la minutie. Lucain en prend quelques-unes et néglige les
autres : il ne parle pas du discours de César; il mentionne
bien l'envoi d'une troupe césarienne en Sardaigne, mais sans
nommer le général qui la commanda ; il dit bien que
Curion est chargé de la Sicile, mais il n'ajoute pas qu'il lui est
enjoint de passer ensuite en Afrique; quant aux gouverneurs
pompéiens des provinces, il n'en souffle mot. Quand
il raconte le siège de Marseille, il passe sous silence l'arrivée
de la flotte venue de Sicile sous les ordres de Nasidius.
Dans le récit de la guerre d'Espagne, il n'expose ni la situation
des troupes pompéiennes avant que Petreius et Afranius aient
opéré leur jonction, ni les motifs qui ont déterminé César à
porter la guerre en ce pays; il oublie même les premiers
combats livrés autour d'Ilerda, alors que l'armée césarienne
est commandée par Fabius : il commence sa narration juste
avec l'arrivée de César, jetant le lecteur in medias res; et,
dans la suite encore, il tait la marche des césariens à la
poursuite de leurs adversaires. C'est surtout dans les
livres V, VI et VII que les omissions apparaissent nombreuses
pour peu qu'on se reporte aux chapitres correspondants des
Commentaires. Lucain ne nous dit pas que César a eu très
peu de vaisseaux pour embarquer ses troupes, et a été obligé
de faire revenir ses navires pour former un deuxième convoi, ni que Pompée est allé en Macédoine avant de revenir
sur la côte illyrienne; il ne rappelle pas la prise d'ApolIonie la défaite de Libo, la retraite de Pompée vers
Asparagium, les combats près d'Oricum, les petits
engagements près de Dyrrhachium, l'envoi de lieutenants de César dans la province d'Achaïe, la soumission de
Gomphes et de Metropolis, les opérations maritimes qui
ont suivi la bataille de Pharsale. Tous ces faits, qui sont
dans César, étaient aussi, très certainement, dans Tite-Live :
il n'y a aucune raison pour que cet historien se soit abstenu
de les rapporter. Si donc Lucain les a laissés de côté, c'est
qu'il les a trouvés trop longs et trop insignifiants. Aucun
d'eux, au surplus, ne changeait l'aspect de l'histoire ; aucun
ne faisait apparaître les protagonistes du drame sous un
jour nouveau, ni même sous un jour plus frappant que
celui qui était projeté par les événements essentiels. C'est
pourquoi le poète s'est cru autorisé à émonder cette végétation
de détails superflus, que les historiens de métier étaient
tenus de respecter pieusement.
Quelques lacunes volontaires nous sont attestées, non plus
par la comparaison de Lucain et de César, mais par la seule
lecture de la Pharsale. Il arrive parfois que l'auteur commence
un récit et, intentionnellement, ne le finisse pas.
Ainsi, nous ne savons pas quel est le sort des Marseillais
une fois qu'ils ont été battus sur mer; nous ne savons
pas davantage ce que devient l'armée césarienne d'Afrique
privée de son chef Curion. Chez un historien, de tels
oublis seraient de graves fautes, et nous pouvons être
certains que Tite-Live s'était bien gardé de les commettre.
Mais Lucain ne se juge pas astreint à tout dire. Il préfère,
afin de laisser dans l'âme du lecteur une impression forte,
s'arrêter après un événement tout à fait marquant. Or,
comme il nous l'a dit lui-même, Brutus, en triomphant
des Marseillais, « fut le premier à enrichir les armes de
César de la gloire d'une victoire navale », et, d'autre
part, la mort de Curion, du principal instigateur de la
guerre civile, est aussi un fait de grande importance. Dans chacun de ces deux cas, s'arrêter après une scène aussi
caractéristique, et en même temps aussi émouvante, est très
naturel au point de vue poétique. Et, même au point de vue
historique, on ne peut pas dire que le récit souffre d'être
ainsi suspendu. En réalité, rien ne manque, rien d'essentiel
du moins. Il n'est pas besoin de consulter le témoignage de
César ou d'Appien pour se douter que Marseille, après sa
défaite navale, est forcément perdue et devra se soumettre
tôt ou tard : le simple bon sens l'indique. De même il est
bien clair qu'après la perte de son général et le sanglant
combat du Bagrada, l'armée césarienne d'Afrique ne peut
plus soutenir la lutte. Rien n'est plus facile que de suppléer
ce qui n'est pas dit d'après ce que suggèrent les événements
mentionnés. Au fond, si l'art gagne beaucoup à ce procédé,
l'histoire n'y perd rien.
De même que Lucain élimine complètement certains faits,
il applique à quelques autres une sorte de sélection, triant
les particularités caractéristiques, et reléguant dans l'oubli
celles qui lui paraissent trop incolores. On en peut citer
comme exemple ce qu'il dit des négociations entre César et
le gouvernement de Marseille avant le siège de cette ville.
D'abord, tandis que, chez Dion comme chez César (1), la
déclaration des Marseillais est une réplique à une demande
du général romain, Lucain semble la présenter comme une
démarche spontanée, ou du moins il ne dit pas du tout
qu'elle ait été provoquée par les exigences de César.
(1) CARS., 1, 35. — Dio, XLI, 19. Dion donne beaucoup moins de détails que César; mais le mot qu'il emploie, prouve que lui aussi regarde ce discours comme une réponse.
L'entrevue
antérieure de celui-ci avec quinze notables marseillais,
que Tite-Live racontait vraisemblablement, lui a semblé de
peu d'importance; une seule chose l'a frappé : la fière résistance
de la cité grecque. Dans le langage qu'il lui prête, il
est probable qu'il a suivi la même méthode. Nous ne savons
pas exactement ce qu'était chez Tite-Live la harangue des
Marseillais, mais nous pouvons essayer de le deviner en
comparant la version de César, dont Tite-Live a dû se servir, et celles de Lucain et de Dion, à qui il a servi à son tour. Chez
ces trois écrivains, l'argument initial et fondamental est le
même : c'est l'affirmation du principe de neutralité; Marseille
ne peut ni ne veut savoir lequel des deux partis a le bon
droit de son côté. Chez tous les trois aussi la conclusion est
à peu près la même : « nous ne recevrons ni l'un ni l'autre
des deux chefs », voilà la formule relatée par César; celle de
Dion et de Lucain, « nous nous recevrons tous deux si vous
venez pacifiquement, mais ni l'un ni l'autre si vous venez en
armes », n'est pas différente; elle est seulement un peu
plus explicite, et devait être telle aussi chez Tite-Live. Quant
aux arguments de détail, il y en a un qui se trouve chez
César et chez Dion, mais pas chez Lucain : c'est le souvenir
des bienfaits que Marseille a reçus et de César et de Pompée.
Un autre, le souvenir de la fraternité d'armes entre Marseille
et Rome, est chez Dion et chez Lucain, mais pas chez César.
Un dernier n'existe que chez Lucain : c'est la déclaration que
tous les Marseillais sont prêts à souffrir et à mourir plutôt
que de renoncer à leur liberté. On ne s'aventurera pas beaucoup,
à mon avis, en supposant que tous ces thèmes oratoires,
non seulement ceux qui sont communs aux trois
auteurs, mais ceux qui ne se rencontrent que chez un ou
deux, étaient réunis chez Tite-Live. La plupart de ses harangues,
en effet, sont remarquables par le soin qu'il apporte à
rassembler méthodiquement toutes les idées que la thèse et
la situation peuvent fournir. Ici, aucune de celles que nous
venons d'énumérer n'est inutile ou inopportune. Même celle
qui pourrait paraître la plus éloignée du sujet, celle qui
forme la péroraison du discours de Lucain, le serment de
mourir pour l'indépendance, est un de ces « lieux communs
» par lesquels Tite-Live ne dédaigne pas de clore ses
harangues. On peut donc se représenter son texte comme
contenant la substance des trois que nous avons conservés.
Et ainsi l'on voit les raisons du choix fait par Lucain : la
déclaration de neutralité était essentielle; l'évocation de
l'antique alliance entre Rome et Marseille rendait plus dramatique,
par contraste, la lutte entre Marseille et une armée
romaine ; la péroraison héroïque se prêtait admirablement aux vers grandioses et sonores (1).
(1) César ne parle pas de cette alliance, et l'on comprend sans peine pourquoi il ne pouvait guère s'accuser lui-même d'avoir attaqué, par intérêt personnel, un peuple « ami et allié » de Rome. Mais cette mention devait au contraire se trouver dans le récit d'origine pompéienne qui a été l'autre source de Tite-Live
Tout cela était donc à conserver.
Par contre, était-il bien utile de parler des services que
Marseille avait reçus des deux belligérants? Ne courait-on
pas le risque d'embrouiller la question en la compliquant par
ces considérations de personnes? l'attitude des Marseillais
n'allait-elle pas y perdre un peu de sa dignité et beaucoup
de sa netteté? Le poète l'a craint sans doute, et s'est volontairement
privé de cet argument, moins frappant que les
autres et moins capital.
Un nouvel exemple de ce discernement entre l'essentiel et
l'accessoire nous est fourni par le récit des prodiges qui ont
annoncé la bataille de Pharsale. Le texte des Commentaires,
à cet endroit, présente une lacune, et nous n'avons conservé
que l'énumération des miracles survenus à Élis, Antioche,
Ptolémaïs, Pergame et Tralles. Dion raconte ces mêmes
miracles (sauf celui d'Élis), mais en outre il cite ceux
qui ont eu lieu à Pharsale : foudre et météores, arrivée des
abeilles qui viennent se poser sur les étendards de Pompée,
fuite des victimes conduites à l'autel; il mentionne encore la
présence de deux messagers divins en Syrie, et les révélations
du devin Cornelius à Padoue. Chez Lucain, les prodiges
de Pharsale sont narrés avec plus de détails que chez
Dion ; le poète parle en outre de tremblements de terre en
Thessalie,de voix mystérieuses entendues, de fleuve de sang,
d'apparitions de fantômes; il résume d'une façon très générale
les signes envoyés par les dieux dans toutes les autres
parties de l'univers, depuis Gadès jusqu'à l'Araxe, et n'insiste
un peu longuement que sur l'histoire du devin de Padoue.
Ici encore, il me semble que le récit de Tite-Live devait être
très complet, plus complet qu'aucun de ceux qui sont parvenus
jusqu'à nous. Dans tout le cours de son oeuvre, il note avec un soin scrupuleux toutes les manifestations surnaturelles
qu'il trouve chez les anciens historiens : il est donc
très croyable qu'il a apporté aux prodiges en question la
même attention consciencieuse et dévote. Seulement, dans
cette liste très longue, Lucain n'a pas voulu tout prendre. Il
a retenu les miracles qui avaient eu pour théâtre Pharsale
même ou les environs, qui, par suite, touchaient plus directement
les personnages de son épopée. Il a gardé aussi le
prodige de Padoue, comme étant le plus clair de tous : dans
les autres, les dieux font seulement savoir qu'il se prépare
quelque grand événement; mais, à Padoue, l'augure explique
en détail et formellement la nature de ce fait mystérieux.
Comme les miracles de Tralles ou de Pergame, d'Antioche ou
de Ptolémaïs, n'ont pas un caractère aussi surprenant,
comme d'ailleurs ni César ni Pompée n'en ont eu connaissance
ce jour-là, il est superflu de les narrer longuement; il
suffit de les envelopper dans une formule synthétique.
Si le poète se permet d'éliminer les détails qu'il juge encombrants,
à plus forte raison ne s'interdit-il pas de transposer
ceux qu'il croit susceptibles de produire ailleurs une impression
plus saisissante. Ainsi, en racontant le débarquement
d'Antoine sur la côte illyrienne et sa lutte contre Libo,
Dion remarque que la tempête, tout en maltraitant les
deux partis, a cependant été utile aux césariens, puisqu'elle a
paralysé l'attaque de leurs adversaires. Cette réflexion, que
Tite-Live a dû faire aussi, Lucain s'en empare ; mais, pour lui
donner plus de force, il la met dans la bouche de César,
au moment où celui-ci, par un héroïque défi, appelle de tous
ses voeux l'Aquilon, qui empêchera du moins ses ennemis de
se jeter sur lui : ce qui n'était qu'une observation de bon
historien militaire devient un trait d'observation psychologique,
en même temps qu'une matière à fort beaux vers.
Voici d'autre part une harangue de Pompée, qu'Appien
place au commencement des opérations d'Épire, un peu
avant la traversée de César. Elle contient deux idées principales : d'abord, le grand principe, que, là où est la liberté,
là aussi est la patrie, et, venant à l'appui de cette thèse, le
souvenir de l'émigration romaine à Ardée lors de l'invasion
gauloise; puis, vers la fin du discours, un appel à la confiance,
motivé par le grand nombre des troupes coalisées contre
César. Rien n'empêche de croire que cette allocution de
Pompée ait existé telle quelle dans l'histoire de Tive-Live.
Lucain, en un certain sens, la conserve, mais il en use librement.
Le premier des deux thèmes indiqués, à savoir
l'identification de la patrie et de la liberté, l'énergique allégation
que Rome est bien là où sont les aristocrates émigrés,
il le fait développer par Lentulus dans la réunion du
1er janvier 48 : la personnalité du consul sortant de charge,
la solennité de la circonstance, tout concourt à donner à
cette déclaration une importance exceptionnelle (1).
(1) Luc., V, 11-29. L'allusion à Camille et aux Gaulois n'est pas oubliée (vers 27-29).
Quant
à l'exhortation encourageante, tirée de l'unanime accord de
tout l'Orient contre César, elle trouve place dans une harangue
de Pompée, mais à un tout autre moment, à l'heure
décisive où va s'engager le combat de Pharsale. Ainsi
détachées, placées dans des situations auxquelles elles
s'adaptent fort bien, les deux idées ne sont pas moins conformes
à l'histoire que chez Appien, mais elles ont beaucoup
plus de relief.
De la même tendance à simplifier et à choisir découle un
autre procédé, assez voisin de ceux que nous venons de voir
fonctionner, un procédé de fusion, ou, si je puis dire, de contamination. Je me sers à dessein de ce mot, parce qu'il
y a là quelque chose qui rappelle les habitudes de la vieille
comédie latine. De même que Térence, avec deux comédies
grecques d'intrigue analogue, l'Andrienne et la Périnihienne,
ou l'Hécyre et les Epitrepontes, compose une
seule pièce, de même Lucain, lorsqu'il est en présence d'événements
qui se ressemblent, qui se répètent ou se doublent,
prend à chacun d'eux quelques détails, et fabrique ainsi un
événement unique qui est comme la synthèse des deux faits réels. Cette manière d'agir a été bien mise en lumière par
Ussani. Il est vrai que tous les exemples qu'il en donne
ne sont pas également probants. Il y a peut-être quelque
exagération à prétendre que Lucain a confondu en une seule
les deux séditions auxquelles César fut exposé, celle de
Plaisance et celle qui eut lieu après Pharsale, avant la
guerre d'Afrique, sous prétexte qu'à Plaisance il fait prononcer
par le général le fameux Quirites, qui ne fut dit
effectivement que lors de la seconde révolte ; c'est un détail
dont il ne faut pas outrer l'importance. Je ne suis pas non
plus convaincu que le poète ait voulu réunir en une seule
les deux batailles navales qui eurent lieu devant Marseille.
Sa description concorde assez exactement avec celle que
César a tracée du deuxième combat, et je n'y vois guère de
détails qui soient empruntés à l'autre engagement : ceux
qu'Ussani cite comme tels sont des traits extrêmement généraux,
qui peuvent indifféremment convenir à toute lutte sur
mer. Dans le Commentum Bernense, il est dit que Lucain a
voulu dépeindre la seconde bataille, et celle-là seulement.
Je crois que cette opinion est juste, et qu'Ussani, comme
aussi Vitelli, mais celui-ci avec plus d'hésitation, ont
eu tort de s'en écarter.
Ou Ussani a tout à fait raison, au contraire, c'est en ce
qui concerne les deux phases de la bataille livrée sous Ilerda.
Chez César, elles sont nettement distinctes : d'abord, une
attaque malheureuse des césariens contre une colline située
entre leur camp et la ville; puis, après un moment de succès,
une seconde attaque, contre la ville même cette fois,
attaque imprudente et qui tournerait en désastre sans l'intervention
de la cavalerie. Dion Cassius donne un récit
moins détaillé, mais lui aussi discerne d'une manière fort
claire l'assaut de la colline et celui dé la ville. A coup
sûr ils n'étaient pas confondus chez Tite-Live. Or ils le sont, exprès sans doute, chez Lucain. Celui-ci ne parle que de
la tentative dirigée contre la colline, mais il y fait intervenir
la cavalerie, alors qu'en réalité elle ne chargea que pour
dégager les soldats qui s'étaient témérairement avances
sous les murs d'Ilerda. Une autre observation très exacte
d'Ussani porte sur la marche de Pompée vers Dyrrhachium.
Les Commentaires mentionnent deux marches de
cette sorte : l'une après la prise d'Oricum et d'Apollonie
par César, l'autre quand César veut couper l'armée adverse
de ses communications avec Dyrrhachium. Dans la
Pharsale, il n'y en a qu'une, et, si l'on s'en tient aux
traits essentiels, c'est la seconde : Pompée revient d'Asparagium
en longeant la côte, par une voie plus courte que
celle de César ; à la suite de cette marche, il s'établit fortement
à Petra, et c'est alors que se produisent tous les travaux
du blocus et du contre-blocus; bref, il est certain que
Lucain a en vue la deuxième marche sur Dyrrhachium. Seulement
il y introduit un détail qui ne convient qu'à la première,
à savoir que Pompée, dans cette lutte de vitesse,
arrive le premier. Ici, comme tout à l'heure, il y a mélange
d'éléments pris en deux endroits différents. Enfin voici
un dernier exemple, qu'Ussani n'a pas relevé, mais qui n'est
pas moins curieux que les siens. Tout à fait au début de la
guerre civile, Appien raconte deux entrevues de César et de
Curion : dans la première, Curion vient seul à Ravenne
auprès du futur dictateur, et là, il l'engage à mobiliser ses
troupes, tandis que César veut encore temporiser; puis, un
peu plus tard, Curion revient avec les tribuns Antoine et
Cassius, et cette fois la guerre est décidée. Chez Lucain,
ces deux scènes n'en font qu'une : Curion arrive avec les
tribuns, comme dans le second récit d'Appien ; mais, comme
dans le premier, il exhorte vigoureusement César à rappeler ses légions de Gaule et à entamer les hostilités. Dans ce
passage, comme dans ceux dont Ussani a montré le caractère,
le travail de Lucain consiste à accumuler sur un même
point des détails qui sont tous vrais, mais qui, dans le récit
historique dont il s'est servi, étaient disséminés en divers
endroits. La vérité historique n'est pas faussée au sens strict
du mot; elle est seulement concentrée, et en reçoit une
lumière plus nette et plus éclatante.
Suppressions, transpositions, contaminations, ce sont
pour Lucain autant de moyens de simplifier l'histoire. Il
déblaie le terrain des détails broussailleux qui l'obstruent,
afin que les faits essentiels, ainsi isolés, se dressent plus
visibles. Mais quelquefois, au contraire, il ajoute à l'histoire
certaines particularités, en vue de la rendre plus intéressante,
plus dramatique. Sur ce point, il est vrai, l'affirmation
doit être prudente, et il faut craindre d'attribuer à
l'invention de Lucain des choses qu'il peut très bien avoir
trouvées dans Tite-Live. Ainsi, en racontant l'arrivée de
Curion, en Afrique, César dit simplement qu'il débarqua
près de Clupea ; Lucain dit en termes plus circonstanciés :
« entre Clupea et les murs à demi-ruinés de la grande Carthage», et l'on sent tout de suite ce que cette évocation
de la vieille colonie phénicienne, de l'antique ennemie de
Rome, ajoute de force et de poésie à cette seule énonciation.
Mais qui est-ce qui a eu l'idée de jeter ainsi dans le récit le nom
de Carthage? est-ce Lucain? est-ce Tite-Live? Vitelli penche
pour cette dernière hypothèse, et, en effet, Tite-Live connaissait
assez bien le maniement des effets oratoires pour s'aviser
d'une pareille allusion ; mais la chose reste incertaine.
Dans les Commentaires, lors du pronunciamiento de Ravenne,
les soldats de la XIIIe légion accueillent par une manifestation
collective d'enthousiasme les paroles de leur chef ;
Lucain, au lieu de cette foule anonyme, nous montre un centurion,
Laelius, qui adresse à César un long discours. Suivant Ussani, ce Laelius est entièrement imaginé par le
poète. Mais cela n'est pas sûr. Si Lucain avait pensé qu'en
mettant en scène un acteur déterminé il donnait plus de
vivacité au récit, il l'aurait fait en d'autres occasions, pour la
harangue des Marseillais, ou pour celle des soldats révoltés
de Plaisance. Or il n'en est rien. Alors, qui nous prouve
qu'il n'y a pas eu réellement un centurion nommé Laelius, qui
a joué un rôle quelconque à Ravenne, à qui César n'a pas cru
devoir consacrer une mention spéciale, mais dont Lucain a pu
lire le nom chez Tite-Live? En pareil cas, nous ne sommes
pas sûrs d'être en présence d'additions dues à l'initiative
artistique du poète.
Nous pouvons en être sûrs, au contraire, lorsque les détails
qu'il relate sont manifestement inexacts. Quand il fait célébrer
au début de l'année les Féries Latines, qui n'avaient
lieu qu'au mois d'avril, il invente, et nous voyons bien
pourquoi : il veut décrire un prodige calqué sur celui du
bûcher d'Étéocle et de Polynice, et il le place lors des Fériés,
parce que cette cérémonie, très solennelle et toute nationale,
rend le miracle plus frappant et plus terrible. Quand il donne
à la Sègre l'épithète de « paisible », qu'elle ne mérite
guère, son intention n'est pas douteuse non plus : il veut
ménager un contraste entre la tranquillité ordinaire du
fleuve et l'inondation furieuse qui va bientôt déjouer les projets
de César.
Ce sont là, d'ailleurs, de fort petites choses ; il y a dans la
Pharsale des parties plus étendues qui sont de l'invention du
poète : les différentes « morts » des combattants de Marseille, et celles des soldats de Caton en Afrique ; la consultation
de la sorcière thessalienne par Sextus Pompée;
et j'y joindrais volontiers le récit du suicide de Vulteius et celui des exploits de Scaeva, récits dont le point
de départ est historique, mais que l'imagination de l'auteur
a singulièrement amplifiés. Il n'est pas douteux qu'il
y ait dans toutes ces narrations une large part de fiction
personnelle. Seulement, il faut bien noter qu'elles sont
des « épisodes » au sens strict du mot : aucun des faits imaginés
n'a de répercussion sur la marche générale des événements
Qu'Aulus soit mordu par une dipsade et Murrus par
un basilic, ou inversement, cela ne change rien au sort de
l'armée de Caton. La fantaisie du poète se joue ici librement,
mais en marge de l'histoire, et non dans l'histoire elle-même.
J'en dirais à peu près autant des deux belles scènes qui
remplissent le milieu du second chant, la conversation de
Caton et de Brutus et l'arrivée de Marcia chez son ancien
époux, s'il était prouvé qu'elle fussent absolument des
inventions du poète. En réalité, nous ne pouvons pas savoir
si Brutus a vraiment débattu ou non avec Caton l'attitude
qu'ils devaient prendre dans la guerre civile ; nous ne savons
pas non plus à quelle date précise Marcia est redevenue la
femme de Caton. Il est bien probable que les choses ne
se sont point passées exactement comme Lucain les rapporte :
il a dû ramasser dans une seule conversation des propos
échangés à plusieurs reprises par les deux interlocuteurs, et
retarder un peu la date du second mariage de Caton pour le
faire coïncider avec l'éclosion de la guerre civile. Mais il ne
s'agit pas ici d'événements politiues ou militaires : avec des
choses de la vie privée, l'auteur peut en prendre plus à son
aise, pourvu qu'il ne dénature point les caractères des personnages,
et l'on sait avec quelle franchise de touche
Lucain les a représentés. Du moment que les sentiments de
Caton et de Brutus sont bien ce qu'ils doivent être, il importe
peu qu'ils se les communiquent par lettres ou de vive
voix, la veille, le jour ou le lendemain du retour de Marcia. Ces détails matériels ne touchent pas à la vérité supérieure et
essentielle.
Lucain s'est plus audacieusement écarté de l'histoire dans
le livre VII : il y a commis, volontairement je crois, plusieurs
inexactitudes, qui sont peut-être compensées par la
beauté artistique qui en résulte, mais qui ne laissent pas que
d'être graves. D'abord, s'il a raison de montrer toute l'armée
pompéienne réclamant la bataille et l'imposant à son général,
il est assez singulier qu'il fasse exprimer par Cicéron les
voeux imprudents de l'aristocratie. Cicéron n'avait pas
suivi Pompée à Pharsale, il était resté à Dyrrhachium, et
Lucain ne pouvait l'ignorer, car il est on ne peut plus
incroyable que Tite Live ait laissé échapper une erreur
aussi forte. C'est donc bien, comme le dit l'auteur du
Commentum Bernense, une « invention » du poète. Mais,
qui plus est, cette invention n'est même pas conforme à la
vraisemblance morale, puisque Cicéron avait conseillé à
Pompée de traîner la guerre en longueur. Aussi peut-on
se demander d'où est venue à Lucain l'idée de lui faire tenir
un langage si contraire à son attitude véritable. A-t-il voulu,
coûte que coûte, donner dans son poème une place quelconque
au grand orateur, et a-t-il saisi cette occasion faute de
mieux? Mais il lui était aisé de trouver une occasion
meilleure : de même qu'il a dépeint Caton et Brutus discutant
la conduite à tenir pendant la crise, il aurait pu décrire
les hésitations de Cicéron, ou ses efforts persévérants pour
empêcher la guerre ou pour ramener la paix. Ou bien s'est-il
souvenu des critiques, parfois amères, que Cicéron, pendant
la campagne d'Épire, avait lancées contre l'orgueil,
l'ambition et la maladresse de Pompée, et en a-t-il conclu
témérairement que Cicéron était partisan d'une solution
rapide? Quoi qu'il en soit, le récit de la bataille de Pharsale
commence de cette façon par un fait doublement faux, contraire
à la vérité psychologique aussi bien qu'à la vérité
matérielle. Un peu plus loin viennent les deux harangues militaires
de César et de Pompée. Dion Cassius déclare qu'elles se ressemblèrent
beaucoup. Lucain, au contraire, les a conçues
d'une manière toute différente. Dion justifie son assertion
en disant que les deux chefs se trouvaient dans des
situations analogues, qu'ils parlaient à des soldats du même
peuple, qu'ils pouvaient invoquer des griefs presque identiques,
chacun d'eux traitant l'autre de « tyran » et se posant
lui-même en « libérateur » : ces considérations, encore qu'un
peu outrées, ne laissent pas que d'être judicieuses. Mais on
comprend qu'elles ne peuvent convenir à Lucain. S'il veut
mettre dans son oeuvre une certaine variété, s'il veut surtout
que chacun de ces discours reflète la personnalité du général
qui le prononce, il lui faut les opposer l'un à l'autre, et c'est
ce qu'il fait. Que trouvait-il dans Tite-Live à cet égard ? Nous
l'ignorons, mais je croirais assez volontiers que l'historien
s'était arrêté à une solution moyenne, très conforme à ses
habitudes. Les morceaux oratoires qu'il avait probablement
insérés à cet endroit de son ouvrage devaient présenter
entre eux des ressemblances, dues à la conformité des situations,
et des différences, provenant du contraste des caractères.
Dion n'a vu que les analogies ; Lucain a été plus sensible aux divergences, et les a accusées plus nettement que
n'avait fait son modèle, afin d'établir une antithèse dramatique.
De ces deux discours, celui qu'il a le plus modifié, me
semble-t-il, est celui de Pompée, autant qu'on peut le conjecturer
en se référant au témoignage d'Appien. César, chez
Appien, parle à peu près comme chez Lucain : il exprime
sa joie de pouvoir enfin combattre, rappelle les victoires
passées, insiste sur le caractère exotique et oriental des
troupes pompéiennes. Au contraire, le langage de Pompée
n'est pas le même chez l'historien et chez le poète : ce
dernier lui donne un ton beaucoup moins assuré, surtout à la fin de la harangue ; on y sent un peu de ce découragement
qui apparaissait déjà dans la réponse de Pompée à Cicéron, et qui expliquera son attitude pendant la bataille.
Cette sorte de résignation désenchantée ne devait pas être
aussi fortement empreinte dans le discours composé par
Tite-Live : cet écrivain, d'ordinaire, prête à ses héros l'accent
qui peut le mieux convenir aux nécessités de leur position,
et ici il s'agit d'encourager les soldats, ce qui exclut
toute velléité d'abattement. Mais Lucain a conçu son personnage
comme une victime condamnée d'avance par la
fatalité, et c'est pourquoi il a mis dans son âme une sorte
de pressentiment douloureux, une passivité triste et noble,
qui se trahit dans tous ses actes et toutes ses paroles. On voit
sans peine quels effets profondément pathétiques il a pu tirer
de cette idée, mais je me hâte d'ajouter que le pathétique
n'est pas ici acheté au prix de la vérité. Toute la conduite de
Pompée, depuis son départ de Rome jusqu'à la bataille de
Pharsale, donne l'impression d'un homme hésitant et désemparé,
d'un vainqueur qui n'a plus foi en lui-même et dans le
destin. Il est bien possible que, dans le secret de son coeur,
il se soit rendu compte, au moins obscurément, qu'il jouait
une partie perdue. Sur le champ de bataille, à la tête de ses
troupes, il n'a dû rien laisser percer de cette inquiétude,
mais elle était en lui, et l'inexactitude de Lucain consiste
seulement à lui avoir fait dire tout haut quelque chose de ce
qu'il pensait dans son for intérieur. Il a un peu altéré la
vérité du langage pour mieux marquer la vérité des sentiments.
Et c'est par là que nous pouvons conclure sur les rapports,
en Lucain, de l'historien et de l'artiste. Le second est loin
d'avoir fait au premier tout le tort qu'on aurait pu craindre;
peut-être même lui a-t-il quelquefois rendu service. Lucain,
en somme, n'a eu envers la réalité ni servilité puérile ni
dédain arrogant. Il a retracé les faits, en les simplifiant assez
souvent par des éliminations légitimes, en les renforçant
quelquefois par des créations fort peu arbitraires, et en respectant tout ce qui était essentiel. Il a interprété l'histoire,
mais, du moins en tant que poète, il ne l'a pas faussée.
§ 4.
Si l'artiste s'est tenu assez près de la vérité historique,
l'homme de parti l'a-t-il aussi fidèlement respectée? D'avance
on est porté à répondre négativement: il ne semble pas qu'un
écrivain aussi passionné que Lucain puisse s'astreindre à
relater objectivement tous les faits, même ceux qui lui
donnent tort. Et en effet, les altérations tendancieuses de la
réalité paraissent être beaucoup plus nombreuses, dans la
Pharsale, que les altérations purement poétiques que nous
venons d'étudier; elles sont surtout plus frappantes, et, pour
cette raison, elles ont été maintes fois signalées par les commentateurs.
Il nous faut cependant les examiner de nouveau,
afin d'en marquer aussi précisément que possible la nature
et l'importance.
Il est visible d'abord que Lucain omet systématiquement
à peu près tout ce qui peut être à l'avantage de César. Prenons
comme point de comparaison les Commentaires; quelque
suspects et quelque discutables qu'ils puissent être, ils
demeurent malgré tout un document qu'on ne peut s'abstenir
de consulter, quitte à le contrôler et rectifier comme il convient.
Une chose très frappante,c'est que, dans ce récit d'une
guerre civile, les négociations tiennent presque autant de
place que les combats. Non seulement César patiente aussi
longtemps qu'il le peut, espérant toujours que le sénat accédera
à ses justes demandes, mais, même après l'ouverture
des hostilités, il ne cesse pas d'entamer de nouveaux pourparlers
chaque fois que l'occasion lui en est offerte. Après
la prise de Corfinium, il envoie à Brindes d'abord Magius,
puis Caninius Rebilus. Lorsque ses succès en Gaule et en
Espagne lui ont déjà à moitié assuré la victoire, il condescend
encore à offrir la paix, par l'entremise de Vibullius Rufus, et ensuite de Vatinius. Plus tard encore, voyant
que Pompée est intraitable, il s'adresse à Scipion, à qui il
fait porter par Clodius une lettre conciliante. Bref, dans
tout le De bello ciuili, César se donne l'attitude d'un homme
qui combat malgré lui ,et qui est vainqueur malgré lui.
De tout cela, pas un mot dans la Pharsale. Et ici une question
se pose : est-ce à Lucain, est-ce à Tite-Live que l'on doit
imputer ces omissions? Je crois bien que c'est à Lucain.
Sans doute Tite-Live n'a pas été dupe des efforts pacifiques
de César ; il a dû y voir, comme beaucoup d'historiens
modernes, ou bien des manoeuvres perfides en vue d'abuser
l'ennemi, ou bien des parades charlatanesques destinées à
gagner l'opinion publique. Mais ce n'est pas une raison pour
qu'il les ait passées sous silence. Il a souvent, en racontant
des guerres étrangères, mentionné des propositions de
paix qu'il savait peu sincères; pourquoi en aurait-il usé
autrement avec celles de César? il est probable qu'il les a à la
fois enregistrées en bon historien, et démasquées en bon
pompéien. Lucain aurait pu en faire autant; il aurait pu faire
ressortir la duplicité de cet usurpateur, qui mène si vivement
la guerre et qui ose invoquer le nom de là paix ; ç'aurait
été pour lui la matière d'une éloquente invective, comme
celle par laquelle il a flétri les pleurs hypocrites de César
devant la tête de Pompée. Mais peut-être a-t-il jugé que cette
façon de présenter les choses compliquerait inutilement sa
narration. Puisque les négociations illusoires dont il trouvait
la trace dans Tite-Live n'avaient abouti à rien, puisque
surtout elles ne correspondaient pas à la pensée intime de
leur auteur, autant valait les supprimer tout à fait : le récit
deviendrait ainsi plus clair, et aucun lecteur ne courrait le
risque de s'égarer en croyant à la bonne foi de César, ou à la
mauvaise volonté de ses adversaires.
Le désir de paix n'est d'ailleurs qu'un des aspects du rôle
généreux que César s'est composé; il en est d'autres qui sont également mis en pleine lumière dans le De bello ciuili, et
relégués dans l'ombre par Lucain. César n'oublie jamais de
mentionner, brièvement, comme si c'était la chose
du monde la plus simple, mais assez nettement tout de
même pour qu'on la remarque, l'indulgence qu'il a témoignée
à ses ennemis abattus : Domitius et ses officiers à
Corfinium, les soldats d'Afranius en Espagne, Varron, Torquatus
à Oricum, les naufragés jetés par les vents sur la côte
illyrienne, les vaincus de Pharsale, tous, dès qu'ils ont été
en son pouvoir, ont éprouvé sa mansuétude; et à son
exemple, s'inspirant du même esprit, ses lieutenants, lors du
siège de Marseille, accordent volontiers « par pitié » l'armistice
qu'on leur demande. Parmi tous ces actes de clémence,
Lucain en a conservé deux ou trois, en les interprétant
du reste avec malignité, comme des marques d'orgueil
méprisant : ceux de Corfinium et de Pharsale. Il a rappelé
aussi l'amnistie accordée aux soldats d'Afranius ;
mais, pour en diminuer la valeur, il l'a représentée comme
sollicitée par les vaincus et seulement accordée par César :
celui-ci, au contraire, s'en attribuait toute l'initiative, et par
conséquent tout le mérite. Quant aux autres pardons, il s'est
arrangé pour n'avoir pas à en parler. S'il n'a pas raconté les
dernières phases du siège de Marseille, s'il n'a pas fait figurer
dans son poème ce personnage de Varron, pourtant si célèbre
et si curieux, c'est peut-être qu'il lui aurait fallu, dans de
tels épisodes, prêter au vainqueur une attitude magnanime,
qu'il lui eût été trop pénible de dépeindre. Ici encore, je
crois que nous pouvons raisonner comme nous l'avons fait
tout à l'heure. Sur les faits matériels, Tite-Live devait être
d'accord avec César: puisque les pompéiens pris à Corfinium
ou à Pharsale, à Oricum ou à Nymphée, n'avaient été ni
massacrés ni maltraités, Tite-Live ne pouvait pas nier que
César leur eût laissé la vie sauve; seulement, il lui était permis de faire des réserves sur le vrai motif de cette tolérance.
La clémence de César devait lui paraître, comme
celle d'Auguste a paru à Napoléon, une sage politique plutôt
qu'une réelle grandeur d'âme. Épris, comme toujours, de
simplification, Lucain s'est cru le droit d'éliminer les gestes
extérieurs pour aller droit aux sentiments intimes. Il
a pensé qu'en se taisant sur ces amnisties qu'il jugeait illusoires.
loin de s'écarter de la vérité essentielle, il s'en rapprochait
au contraire ; que l'important était de faire connaître
le fond de l'âme de César, ce fond d'âpre et dure ambition,
et non les dehors spécieux de bonté sous lesquels il
avait voulu le déguiser. En d'autres termes, Tite-Live avait
raconté les actions généreuses de César sans les croire sincères;
Lucain, parce qu'il ne les croyait pas sincères, a préféré
ne pas les raconter.
Il ne s'est pas seulement appliqué à dissimuler, par des
oublis volontaires, l'humanité, vraie ou fausse, de César, il
semble aussi avoir voulu diminuer l'héroïsme, sinon de
César lui-même, au moins de ses partisans. Il y a dans les Commentaires quelques passages où l'auteur a pris plaisir à
exalter le courage et le dévouement de ses soldats : il montre
l'enthousiasme des troupes de Curion à la veille de la
bataille contre Varus (1) ;
(1) CAES., 11, 33. — Plus loin (II, 41), au moment de la bataille contre Saburra, César prête aux soldats de Curion une attitude assez résolue, mais on sent qu'il s'attache à pallier leurs défaillances et Lucain est dans le vrai quand il les représente (IV, 749) « trop peu lâches pour fuir et trop peu vaillants pour courir au combat».
il reproduit le serment si énergique
fait par ses vétérans de manger l'écorce des arbres plutôt
que de laisser fuir Pompée ; il cite les belles paroles d'un
de ses porte-étendards, qui, en mourant, ne s'inquiète que
du sort de l'aigle confiée à sa garde ; il décrit le furieux
remords et l'ardent désir de revanche qui animèrent ses
légions après leur échec à Dyrrhachium. Tous ces épisodes,
où revit si bien l'intense passion militaire des vieilles
troupes césariennes, n'ont pas dû être négligés par Tite-Live : ils lui fournissaient des anecdotes trop frappantes
pour qu'il se privât d'en rehausser sa narration. Lucain, s'il
n'avait cherché que le pittoresque, les aurait également
recueillis avec joie : quel beau vers, par exemple, aurait pu
lui suggérer le serment des soldats de César ! Mais ici
l'homme de parti a été plus fort que l'artiste. Il s'est dit
qu'il était immoral et dangereux de trop célébrer une vaillante mise au service d'une cause injuste ; que, selon la
maxime stoïcienne, le courage mal employé cessait d'être
une vertu; et que par suite tous ces héros, si aveuglément
dévoués à un usurpateur, étaient plus à plaindre qu'à
vanter. Il ne les a pas représentés comme des lâches,
tant s'en faut ; il a souvent rappelé leur zèle et leur endurance
: qu'on se souvienne des vers où il dépeint leur
marche infatigable à la poursuite des pompéiens dans les
montagnes espagnoles, ou bien de ceux où il raconte
les exploits de Scaeva. Mais il a cru que cela suffisait
pour la vérité historique; à insister davantage, à mettre en
un relief plus saillant la valeur des césariens, il aurait craint
de pécher contre la morale stoïcienne.
De même qu'il a passé sous silence les détails trop favorables
à César et à ses partisans, il a éliminé ceux qui étaient
trop désavantageux pour Pompée et pour les pompéiens. Les
traits de cette espèce, comme on peut s'y attendre, sont
extrêmement nombreux dans le De bello ciuili, qui, sous ses
apparences d'histoire objective, recèle bien des intentions
satiriques. Tantôt César s'arrange pour rendre visible la
cruauté de ses adversaires : celle de Pompée, qui s'est répandu
en menaces si violentes qu'aucun sénateur n'ose accepter
d'aller lui porter un message pacifique de César ; celle de
Bibulus, qui fait brûler 30 vaisseaux césariens avec leurs
équipages, ou mettre à mort tous les passagers d'un autre
navire jusqu'aux petits enfants ; celle d'Otacilius, qui
massacre des soldats ennemis après leur avoir promis la vie sauve : celle de Labienus, qui, passé dans le camp de
Pompée, fait égorger ses anciens compagnons d'armes afin
de prouver sa sincérité nouvelle; celle de Scipion, qui
gorge ses légions de pillage, en vue de s'assurer leur appui
contre Césa. Tantôt d'autres épisodes des Commentaires montrent la déloyauté des pompéiens : les Marseillais, profitant
d'une trêve que le lieutenant de César leur a accordée
par pitié, se jettent à l'improviste sur le camp ennemi et y
mettent le feu ; Pompée à Brindes, Domitius à Marseille,
Petreius en Espagne, enrôlent des esclaves contrairement
aux lois de la guerre (1);
(1) Lucain, qui n'a pas mentionné les enrôlements d'esclaves faits par Pompée et Domitius, signale au contraire celui de Petreius. D'ailleurs le livre IV de la Pharsale est celui où il se montre le plus dur pour les pompéiens.
Varus, en Afrique, corrompt les soldats de Curion; Bibulus et Libo entament de fausses négociations pour tromper César. Tant d'acharnement et tant de duplicité, contrastant avec la bonne foi et l'humanité de César lui-même, ne peuvent manquer de faire impression sur tous les esprits non prévenus : les indigènes d'Espagne, les villes alliées d'Asie, ne tardent pas à reconnaître de quel côté est la cause véritablement sympathique; et, même. parmi les troupes de Pompée, des défections se produisent chaque jour, alors que les désertions en sens inverse sont extrêmement rares. Enfin, comme il ne suffit pas de rendre l'adversaire odieux si l'on ne le rend pas un peu ridicule, César s'amuse souvent à dépeindre ses adversaires dans une posture comique : c'est Caton, en Sicile, qui se plaint d'avoir été abandonné par Pompée après tant de belles promesses; c'est Varron, en Espagne,qui, longtemps irrésolu entre les deux partis, a 1'esprit de se décider pour Pompée juste la veille de la victoire de César (1);
(1) CAES., Il, 17. — Lucain ne nomme même pas Varron.
c'est
surtout Pompée lui-même, qui ne comprend rien aux manoeuvres
de l'ennemi, qui se gonfle d'orgueil après le plus
léger succès, se croit sûr du triomphe, le laisse crier bien
haut par tous ses officiers et l'écrit aux cités alliées, et
qui, tout d'un coup, à Pharsale, découvre avec stupeur qu'il
a été lâché précisément par les troupes sur lesquelles il
comptait le plus, aussi incapable que fanfaron, véritable
« général d'opérette ».
Que Lucain n'ait rien conservé d une telle caricature, on le
comprend sans peine, et il est plus que probable que déjà
chez Tite-Live tous ces traits à la fois antipathiques et grotesques,
qui composent chez César la physionomie des pompéiens,
devaient être fortement atténués, sinon complètement
modifiés. Mais ici la question est trop compliquée pour que
l'on puisse aboutir à des affirmations bien nettes. César n'est
pas seul, en effet, à nous faire connaître, soit la cruauté,
soit la maladresse de ses ennemis. Appien nous a conservé
un mot typique de Pompée, lorsqu'il voit que l'on va en venir
aux mains avec les césariens alors qu'il aurait été si simple
de continuerà les affamer : « la famine est le seul poison des
bêtes féroces ». Et quant à son impéritie, elle est, chez le
même Appien, vertement raillée par Favonius, qui lui
demande ironiquement de faire sortir du sol les légions promises. Mais qu'est-il besoin de descendre jusqu'à un
auteur aussi éloigné des événements ? Nulle histoire ne contient de détails plus frappants sur les pompéiens que les
lettres écrites au jour le jour par Cicéron. Pompée y apparaît
comme un politique inepte, comme un stratégiste
médiocre, comme un ambitieux avide de pouvoir personnel, et surtout comme un homme assoiffé de vengeance :
lui et tout son parti ne rêvent que proscriptions et confiscations,
même à l'égard des neutres ; ce sont de véritables
Syllas. Or Appien s'inspire en grande partie de Tite-Live, et d'autre part Tite-Live a dû connaître les lettres de
Cicéron : ce double rapprochement ne nous autorise-t-il pas
à conclure que chez cet historien, qui est un historien
véritable, d'une bonne foi candide, sinon toujours très éclairée,
l'aspect antipathique du rôle joué par Pompée et ses
amis, sans être aussi accusé que chez César, devait être
moins effacé que chez Lucain ? La formule est un peu vague,
mais il n'en peut être autrement. A vouloir définir exactement
la nuance qui devait séparer Lucain de Tite-Live, à
vouloir surtout se prononcer avec précision sur tel ou tel détail particulier, on rencontre des obstacles dont un ou
deux exemples feront comprendre l'embarras.
Appien, en racontant la campagne d'Afrique, mentionne
entre autres choses deux faits qui ne se rencontrent que
chez lui : d'abord l'empoisonnement des sources auprès des
Castra Cornelia par les ennemis de Curion; ensuite la
présentation à Juba de la tête coupée du général césarien.
Vitelli raisonne ainsi au sujet de ces deux faits : ils ne
sont pas narrés par Lucain; donc ils n'étaient pas dans
Tite-Live, car Lucain n'aurait pas manqué de reproduire
ces épisodes si dramatiques; donc Appien, en cette partie de
son histoire, a suivi un autre écrivain que Tite-Live. La conclusion,
en elle-même, est assez plausible, mais l'argument
sur lequel Vitelli l'appuie me paraît très faible. Je suis assez
disposé à croire comme lui que Tive-Live ne parlait pas des
deux événements en question : César n'en dit rien non plus, et
il me semble bien que ces anecdotes proviennent simplement
du récit de Pollion, de ce Pollion à qui, dans tous ces chapitres,
Appien donne une place si considérable. Mais quant
à prétendre,comme le fait Vitelli, que si Lucain avait trouvé chez Tite-Live la mention des sources empoisonnées et celle
de la tête coupée de Curion, il les aurait nécessairement
conservées dans la Pharsale, ceci est tout à fait discutable.
De ces deux faits, le premier montre la perfidie des pompéiens,
le second leur crauté : cela suffit, je pense, pour que Lucain
ait eu un motif de les supprimer, et l'on ne peut inférer de
son silence celui de Tite-Live.
Voici maintenant, sur un autre point, une difficulté qui
vient du récit même de Lucain. Dans la harangue qu'il prète
à César au moment de la bataille de Pharsale, il y a une
allusion explicite à la cruauté dont Pompée aurait fait preuve
lors du combat de Dyrrhachium. Or, de cette cruauté,
Lucain n'a pas dit un mot au livre précédent. Que penser de
cette contradiction? A-t-il voulu mettre dans la bouche de
César une imputation purement calomnieuse, expression
d'une haine acharnée, qui ne recule pas devant les plus flagrants
mensonges? ou bien s'agit-il d'un fait réel qu'il a pu
lire chez Tite-Live, qu'il n'a pas voulu raconter pour son
propre compte afin de ne pas noircir la mémoire de Pompée,
mais dont il a tiré parti en composant le discours de César?
la question est aussi insoluble que celle que j'examinais tout
à l'heure, et l'on voit par ces deux exemples combien il est
difficile de dire avec certitude : « Ceci n'est pas dans Lucain,
parce que ce n'était pas dans Tite-Live », ou inversement :
« Ceci était dans Tite-Live, et a été éliminé volontairement par
Lucain ». Tout ce qu'on peut supposer légitimement, en ce
qui concerne les fautes des pompéiens, c'est que Tite-Live a
dû les estomper autant que le lui permettait sa conscience
d'historien, et que Lucain a dû, plus résolument que son
modèle, écarter les faits les plus gênants pour la cause qu'il
avait embrassée.
Jusqu'ici, c'est par des omissions que nous avons vu
Lucain chercher à rabaisser le rôle de César, ou à embellir
celui du parti contraire. Est-il allé plus loin? à ces inexactitudes,
négatives en quelque sorte, a-t-il joint des altérations
positives de la vérité? a-t-il inventé des détails qui pussent servir sa passion politique? on l'a souvent prétendu, et
pourtant il me paraît bien téméraire de l'affirmer. Rappelons nous
qu'en fait de narration circonstanciée des événements,
nous ne possédons que celle de César, laquelle est forcément
suspecte; tous les autres écrivains qui nous en ont conservé
le souvenir sont des abréviateurs sans compter que certains
d'entre eux, Velleius, Appien, Dion Cassius, ont subi l'influence
des sources césariennes : pour cette double raison,
nous pouvons être sûrs qu'ils ne nous disent pas tout, et
leur silence sur un fait rapporté par Lucain n'est pas une
raison suffisante pour rejeter ce fait a priori. Cela posé,
examinons les divers points sur lesquels on a cru trouver
chez Lucain des fictions arbitraires et tendancieuses.
Lorsque César revient à Rome après la fuite de Pompée, et
qu'il préside une réunion des sénateurs restés dans la Ville,
Lucain s'indigne de voir cette assemblée si lâche, prête à
toutes les concessions. César, au contraire, se plaint de
la mauvaise volonté des sénateurs, qui ne veulent pas le
seconder efficacement dans ses négociations avec Pompée.
De ces témoignages contradictoires, Ussani conclut que
Lucain ne dit pas la vérité. Mais est-il légitime d'accorder
plus de crédit à l'une des versions qu'à l'autre? Il s'agit, ici,
moins de faits matériels que d'appréciations subjectives.
Supposons, comme il est probable, que les sénateurs, déconcertés
par la situation critique où ils se trouvaient jetés à
l'improviste, soient restés indécis entre les deux factions :
leur neutralité, un peu flottante, peut être jugée très diversement
selon le point de vue où l'on se place. César, naturellement,
les trouve trop rebelles, et un pompéien comme
Tite-Live les juge au contraire trop serviles. D'ailleurs César
ne les accuse pas précisément de révolte ouverte : loin de là,
il reconnaît qu'ils ont applaudi à ses paroles; il leur reproche
seulement de s'en être tenus à cette adhésion passive .
Mais cette adhésion passive elle-même était déjà pour
l'opinion pompéienne un objet de scandale. Un peu plus loin, voici une autre divergence entre César
et Lucain, qui peut s'expliquer de la même manière. La colline
sur laquelle est située la ville d'Ilerda est représentée par
Lucain comme s'élevant en pente douce, tandis que César
la dépeint plus escarpée. Mais les épithètes employées
par les deux auteurs sont assez vagues. Une côte d'inclinaison
moyenne peut être qualifiée de deux manières bien
différentes, selon que l'on veut exagérer ou diminuer la
difficulté qu'elle présente. Or, César a intérêt à insister sur
la gravité de l'obstacle contre lequel ses soldats viendront
se heurter inutilement. Lucain est naturellement porté à
adopter une manière de voir opposée. Il est donc probable
que tous deux s'écartent également de la stricte vérité, en des
sens différents, et pour des motifs inverses.
Les Commentaires ne nous ont pas conservé le récit de la
révolte de Plaisance; mais nous la connaissons par Dion
Cassius (1), et sa narration offre, avec celle de Lucain,
quelques dissemblances notables.
(1) Dio, XLI, 26 sqq.
Chez lui, les soldats
parlent sur un ton beaucoup moins menaçant que dans la
Pharsale, et César, à son tour, leur répond en termes beaucoup
moins hautains : on y chercherait en vain l'équivalent
du célèbre mot, humanum paucis uiuit genus. Il n'est pas
douteux que le poète ait pris plaisir à nous montrer César
puni de son crime par l'insolence de ceux dont il a fait ses
complices, puis le même César criant avec arrogance sa
résolution de poursuivre la lutte et son dédain superbe de
l'humanité vulgaire. Il a donc pu forcer l'intensité des sentiments
exprimés de part et d'autre, mais cela ne veut pas
dire qu'il en ait faussé la nature. Et quant à la harangue que
Dion met dans la bouche de César, elle est si longue, si
diffuse, avec ses lieux communs sur la discipline, qu'on ne
peut guère y reconnaître l'éloquence précise et nerveuse du
vrai César. Entre l'exaltation outrancière de Lucain et la
rhétorique banale de Dion, je ne sais si la première n'est pas encore la moins éloignée du langage qui a dû être réellement
tenu.
Dans le récit de la bataille de Pharsale, Lucain nous
dépeint César exhortant ses troupes à piller le camp de
Pompée; dans les Commentaires, nous le voyons au contraire
empêcher ses soldats de s'attarder trop longtemps au
pillage. Mais la contradiction n'est pas aussi importante
qu'elle semble l'être. César dit lui-même qu'à la fin du combat
il a harangué ses vétérans pour les décider à s'emparer
du camp ennemi malgré leur fatigue : il a dû, à ce
moment-là, faire luire à leurs yeux l'espoir d'un riche butin.
C'est cette exhortation que paraphrase Lucain. Puis, les
voyant trop absorbés par le soin de ramasser ce qu'avaient
laissé les pompéiens, il leur a commandé d'assiéger la montagne
où s'étaient réfugiés ses adversaires : ce nouveau
moment de l'action a été omis par le poète.
Vient ensuite une autre contradiction, non entre Lucain
et César, mais de Lucain avec lui-ême, s'il faut en croire
Ussani : il aurait prêté à Pompée fugitif, d'abord, au
livre VII, une attitude calme et résignée, puis, au livre VIII,
des sentiments de fureur haineuse contre son vainqueur.
Si cela était vrai, peut-être en pourrait-on tirer des conclusions
intéressantes sur la date de composition des livres VII
et VIII, mais en fait Ussani exagère beaucoup cette prétendue
différence. Les vers du livre VIII qu'il cite, pour prouver que
Pompée en veut mortellement à César et souhaite de le voir
tué, ont un tout autre sens : «Bien qu'il soit tombé du faite de
la gloire, il ne sait pas encore combien son sang a peu de
prix; se rappelant sa destinée, il croit que sa vie vaut encore
la somme qu'il donnerait lui-même pour la tête coupée
de César ». Ce que le poète veut mettre en relief, ce n'est
pas du tout la rage de Pompée; c'est l'illusion qui lui fait penser qu'il est encore sur un pied d'égalité avec son adversaire.
A part ce passage, sur lequel Ussani a commis un
réel contre-sens, le début du livre VIII n'offre rien qui
démente la peinture tracée au livre précédent. Pompée apparaît
toujours triste, découragé, renonçant à la lutte, et ceci
est absolument conforme à ce que disent et César, et Appien,
et Dion Cassius, et Plutarque (1).
(1) Lucain est seul de tous les auteurs anciens à raconter l'abandon des cadavres à Pharsale (VII, 191 sqq.), mais ce n'est pas une raison pour suspecter sa véracité sur ce point. Au contraire, on peut affirmer que si César avait pris soin de faire ensevelir les soldats morts, il n'aurait pas négligé de s'en vanter dans les Commentaires.
Enfin on peut relever une dernière divergence entre les
Commentaires et la Pharsale, en ce qui concerne les événements
d'Alexandrie : chez Lucain, César est fortement effrayé
par le soulèvement des Égyptiens. Mais, si ce mouvement
de terreur est très compréhensible, il est très compréhensible
aussi que César ait voulu le cacher, et le silence des Commentaires sur ce point n'est pas un argument contre Lucain.
Il resterait à examiner quelques endroits où le désaccord
entre le poète et les autres écrivains porte, non sur les faits
eux-mêmes, mais sur les intentions que ces faits révèlent.
Ces intentions, Lucain ne peut les affirmer que par hypothèse,
et il faut voir jusqu'à quel point ses inductions sont
légitimes.
Lorsque César arrive à Ilerda, il attend un peu avant
d'engager la lutte : il ne nous dit pas expressément
pourquoi, mais il laisse entendre que c'est pour une raison
d'ordre stratégique. Lucain prétend que les troupes césariennes
ont hésité à combattre par honte de leur crime.
Présentée en ces termes, l'explication n'est pas acceptable,
mais il est possible que les assiégeants, découragés par
l'insuccès de leur tentative antérieure, aient manifesté quelque
indécision. Ce serait cette répugnance à attaquer l'ennemi
que César aurait masquée sous une formule un peu vague, et que Lucain aurait au contraire amplifiée pour en tirer un
argument contre César.
Dans l'épisode si curieux où les deux armées ennemies,
campées l'une près de l'autre, se mettent à fraterniser,
Lucain semble insinuer que la sympathie des soldats de
Petreius pour les césariens est le résultat d'une corruption.
Naturellement, dans les Commentaires, il n'y a rien de tel.
Mais il est trop évident que, même si le fait eût été vrai,
César aurait eu de bonnes raisons pour n'en point parler,
pour laisser à la manifestation des pompéiens le caractère
d'un mouvement spontané. A la suite de cet événement,
les chefs pompéiens rejoignent Ilerda : selon César, c'est
parce qu'ils manquent de blé; selon Lucain, c'est parce
qu'ils n'osent pas maintenir à la même place les troupes qui
viennent de se souiller par le meurtre sacrilège de leurs concitoyens. Ne nous hâtons pas de déclarer romanesque
cette dernière explication. A cette époque, les scrupules religieux
qui s'attachent au serment, au lien d'hospitalité, etc.,
ont encore beaucoup de force ; l'histoire de Varus et de Curion
en Afrique, chez César lui-même, le prouve surabondamment,
et il n'est pas impossible que les pompéiens d'Espagne
aient été réellement épouvantés du massacre commis en
dépit de la parole donnée.
Pendant toute cette guerre de montagnes, César évite
autant que possible les engagements à main armée: il ne
veut pas risquer sans besoin le sang de ses soldats, il n'aime
pas non plus à verser celui de ses ennemis. Lucain lui
prête la même tactique, mais la motive par une raison moins
désintéressée, la peur d'avoir affaire à des adversaires que
leur courage désespéré peut rendre redoutables. C'est
moins beau, moins touchant : est-ce moins vrai ? et, si nous
pouvons soupçonner Lucain d'avoir attribué à César un calcul d'utilité pratique, oserions-nous prétendre que César
n'a pas pu vouloir se poser dans une attitude de noble philanthropie?
Lorsque César est en Épire, et qu'il attend en vain l'arrivée
des renforts commandés par Antoine, il écrit sévèrement à
celui-ci pour le blâmer de sa lenteur. Lucain va plus
loin, et l'incrimine de trahison à mots couverts. Nous
n'avons pas à rechercher si cette imputationest fondéeounon,
mais si elle est vraisemblable, et si elle a pu être formulée
par Tite-Live. Je n'y vois pas d'objection : Antoine, ennemi
de Pompée, puis de Brutus et de Cassius, puis d'Octave,
devait être triplement odieux à Tite-Live, et il ne serait pas
étonnant que l'historien l'eût dépeint à demi traître envers
César.
On sait qu'après sa victoire de Dyrrhachium, Pompée ne
voulut pas prendre l'offensive hardie qu'on lui conseillait.
César, Appien et Plutarque expliquent ce refus par des considérations
stratégiques. Lucain, suivant Ussani, invoquerait
au contraire un motif purement sentimental, la tendresse
ou le respect pieux de Pompée envers son beau-père.
C'est se tromper, à mon avis, sur le sens de pio dans le vers
en question : Lucain songe, non pas du tout à la « piété »
de Pompée envers César, mais à sa « piété » envers Rome.
D'après lui, Pompée ne veut pas de proscriptions, ni de massacres,
ni d'une guerre en Italie, et voilà pourquoi il se contente
d'avoir mis en fuite son adversaire. Ce sentiment n'a
rien d'invraisemblable : on le retrouve mentionné chez
Plutarque ; on en retrouve un analogue, attribué à Caton
cette fois, chez Appien (1).
(1) App., B. Ciu, Il, 40 (Caton ne veut pas livrer bataille à Curion, pour ménager les Siciliens).
On ne peut donc accuser ici Lucain
d'avoir voulu idéaliser arbitrairement le personnage de
Pompée. On le pourrait plus légitimement, je crois, à
propos de la fin du livre VII. D'après son récit, c'est par patriotisme que Pompée se décide à ne pas prolonger une
lutte inutile, et s'enfuit avant la fin de la bataille de Pharsale : il semble bien qu'en réalité Pompée ait cédé à un
accès de découragement ; le poète a pris à coeur de relever
un peu la dignité du vaincu.
Somme toute, lorsque l'on compare la Pharsale aux Commentaires,
on voit que le récit. de Lucain contient sans doute
quelques faits qui ne sont pas dans le De bello ciuili, que
d'autres sont modifiés dans le détail, d'autres encore expliqués
par des intentions différentes de celles que César a alléguées.
Mais en même temps on aperçoit quelques conclusions
qui me semblent importantes. D'abord, ces additions, modifications
ou interprétations,sont beaucoup moins nombreuses
que les omissions pures et simples : Lucain se croit en droit
de taire la vérité gênante bien plutôt que de la déguiser. En
second lieu, presqu'aucune des assertions de Lucain, là où il
est en désaccord avec César, n'est foncièrement invraisemblable.
Enfin, et ceci est à retenir, il n'y en a aucune
qui ne puisse être attribuée à Tite-Live d'une manière au
moins plausible. Si l'on demande : « la vérité historique est-elle,
dans la Pharsale, altérée par l'influence des tendances
politiques?», il est possible qu'il faille répondre « oui ».
Mais si l'on demande : « cette altération est-elle imputable à
Lucain lui-même plutôt qu'à son modèle? », je crois bien
que neuf fois sur dix il faut répondre « non ».
Tel n'est pas l'avis d'Ussani. D'après lui, si Lucain a suivi
assez fidèlement l'opinion de Tite-Live sur Pompée, opinion
sympathique en dépit de quelques réserves, par contre, il
est beaucoup plus hostile à César que ne devait l'être l'historien.
Et Ussani cite à ce propos le mot célèbre de Tite-Live,
que Sénèque nous a transmis: « On peut se demander si la
naissance de César a été pour Rome un bien on un mal ».
Il ne me semble pas que ce mot implique un jugement beaucoup
plus élogieux que celui de Lucain. Lorsque Tite-Live parle
du « bien » que César a pu faire à Rome, il songe évidemment
à ses conquêtes extérieures, à l'annexion de la Gaule : mais Lucain, lui aussi, a salué cette gloire comme il convenait. Quant à la politique intérieure de César, à sa guerre
contre Pompée, à sa dictature, je crois bien que Tite-Live
en pensait autant de mal que Lucain.
J'ai réservé à dessein le rôle prêté par Lucain à Domitius,
parce que la question qui se pose à ce sujet est particulièrement
complexe et difficile. Il semble bien que le poète ait eu
deux motifs pour idéaliser Domitius, qu'il ait vu en lui, non
seulement le lieutenant de Pompée, mais l'ancêtre de Néron.
C'est ce qu'Ussani appelle, non sans emphase, « l'union monstrueuse
du libéralisme et du néronianisme », connubio mostruoso : l'épithète n'est pas d'ailleurs très juste, car les écrivains
officiels, au début du règne de Néron, conciliaient
parfaitement, en théorie du moins, l'amour de la liberté
avec le loyalisme impérial. Mais, si Lucain a eu le dessein
de flatter l'empereur en glorifiant un de ses aïeux, comment
se fait-il qu'il ait passé sous silence la part prise par Domitius
à la défense de Marseille? d'autre part, comment expliquer
qu'on trouve dans le même livre, côte à côte, les invectives
les plus furieuses contre l'empire (et non pas seulement
contre César), et le récit enthousiaste de la mort de
Domitius ? Ce sont là des problèmes bien malaisés à
résoudre. Quoi qu'il en soit des raisons qui ont pu pousser
Lucain à embellir ce personnage, toujours est-il qu'il l'a
embelli, mais pas autant qu'on l'a prétendu.
Domitius, a-t-on dit, n'était qu'un acteur très secondaire
dans ce grand drame, moins important que Scipion, par
exemple. Pourtant, chez Appien, nous voyons César rassurer
ceux qui ont peur de lui en leur citant l'exemple de ce
Domitius à qui il a pardonné : c'est donc que c'était un homme en vue. A Corfinium, Domitius avait voulu fuir, et
c'est alors que ses soldats indignés l'avaient livré à César :
Lucain, dit-on encore, a omis tout cela. Mais ce n'est pas
précisément par lâcheté que Domitius songeait à quitter la
ville ; il avait reçu de Pompée l'ordre formel de le rejoindre (1).
(1) La version suivant laquelle Domitius se serait empoisonné et aurait été sauvé par son médecin SUET., Nero, 2; PLUT., Caes., 346 complique encore la question.
Que s'était-il passé entre lui et ses soldats? nous ne le savons que par César et par Dion Cassius, qui, en cet endroit, suit une version très favorable à César; nous ne pouvons donc pas affirmer que Lucain se soit écarté délibérément du récit deTite-Live. A Pharsale, enfin, ajoute-t-on, Lucain a complètement transformé la mort de Domitius : il le fait périr au centre de l'armée, en combattant, et sous les yeux de César, tandis qu'il fut tué en fuyant et sans que César fût là. Ce seraient, il faut l'avouer, de fortes inexactitudes, si l'on était sûr que Lucain les eût commises. Mais rien n'est moins certain. D'abord, le poète ne nous dit pas le moins du monde où succomba Domitius (1).
(1) Le soin que prend César de mentionner cette mort prouve qu'elle avait une certaine importance.
En second lieu, il est exagéré de
parler de « fuite » ; d'après César lui même, Domitius était de
ceux qui, après la perte du camp, avaient voulu se retrancher
sur la montagne voisine, et c'est en y allant qu'il fut rejoint,
à bout de forces, par les cavaliers césariens; il n'y a là
aucun manque de courage. Enfin, rien ne prouve que César
n'ait pas assisté à cette mort; le texte de Cicéron sur lequel
on s'appuie pour le démontrer ne le dit nullement (1).
(1) Cic., Phil., Il, 71. C'est à propos, non de Domitius, mais des autres victimes d'Antoine, que Cicéron oppose la cruauté de ce dernier à la clémence que César aurait témoignée s'il eût été là.
Ainsi donc, même en ce qui concerne Domitius, c'est-à-dire
sur un point où tout se réunissait pour engager le poète à
modifier la réalité historique, il ne parait pas l'avoir altérée
plus que Tite-Live lui-même n'avait dû le faire.
De tout ce qui précède, il ressort, ce me semble, que, même dans les faits qui touchent à la politique, Lucain s'est montré
beaucoup moins hardi à l'égard de la vérité qu'on n'aurait
pu s'y attendre. L'argumentation d'Ussani, que j'ai combattue
en bien des rencontres, aboutit à ce jugement : le témoignage
de Lucain ne doit être pris au sérieux que lorsque les
faits qu'il est seul à rapporter ne peuvent s'expliquer par
aucune tendance littéraire ou politique. Cette formule, même
si elle était exacte, n'impliquerait pas une condamnation
bien sévère du poète ; elle ferait simplement de son oeuvre
un document à la fois précieux et suspect, pas moins discutable
que les Commentaires, mais pas davantage non plus.
Cependant, sous sa forme négative et restrictive, l'opinion
d'Ussani est vraiment trop peu juste pour Lucain. J'en renverserais
volontiers les termes, et je dirais : partout où nous
ne voyons pas avec évidence la marque d'une intention littéraire
ou d'un parti-pris politique, le témoignage de Lucain
doit être examiné très attentivement, et non pas toujours,
certes, adopté coûte que coûte, mais traité avec autant de
respect que celui des historiens de métier, parce que, dans la
majeure partie des cas, le témoignage de Lucain n'est autre
que celui de Tite-Live.
§3-
Il serait possible de justifier par une contre-épreuve la conclusion que nous venons de formuler: en regard des faits que Lucain passe, à tort ou à raison, pour avoir modifiés, on pourrait mettre ceux qu'il a exactement reproduits. Les passer tous en revue serait un labeur bien long : il faudrait relever presque tous les événements contenus dans la Pharsale, et en montrer la concordance habituelle avec les récits des historiens. Il suffit, ce me semble, d'indiquer certains endroits où la véracité historique de Lucain est plus particulièrement remarquable, parce qu'elle a dû coûter des sacrifices à son imagination de poète ou à son ardeur de polémiste. Qui dit poésie dit création, fiction, et cela, je crois, chez les anciens plus encore que chez nous. Lucain pourrait donc, comme bien d'autres auteurs d épopées semi-historiques, être tenté d'embellir sa matière par des inventions de son crû. Il ne le fait que rarement, et dans ce sens là, dans ce sens là seulement, cela va sans dire, on comprend pourquoi les critiques de l'antiquité lui ont quelquefois refusé le nom de poète (1).
(1) MART., Epigr., XIV, 194.
Ce n'est point stérilité, d'ailleurs : il a
donné la mesure de sa richesse imaginative en concevant
des épisodes comme ceux qui diversifient le tableau de la
bataille de Marseille ou le récit de la marche de Caton en
Afrique. Mais il a le goût et le sens u réel. Il ne répugne
pas à indiquer avec une exactitude rigoureuse les données
topographiques nécessaires à exposer la position relative des
collines et des camps qui entourent Ilerda; ou à dire que
les lignes de Pompée, à Dyrrhachium, embrassent un espace
aussi étendu que la distance entre Rome et Aricie ou entre
Rome et l'embouchure du Tibre. Il nous fournit également
des renseignements chronologiques, non d'une manière
vague ou approximative, mais assez minutieusement pour
qu'on puisse retrouver, sous ses périphrases astronomiques,
la date de tel ou tel fait : il nous apprend, par exemple, que
l'inondation de la Sègre a eu lieu peu après l'entrée du Soleil
dans le signe du Bélier, c'est-à-dire, en style julien, peu
après l'équinoxe de printemps ; que la défaite de Vulteius
se place au moment où le Soleil est encore dans le signe des
Gémeaux, mais va prochainement pénétrer dans celui du
Cancer, c'est-à-dire vers le 19 juin ; que Pompée est parti
de Paphos pour l'Égypte lors de l'équinoxe d'automne, etc.
Il décrit les opérations militaires avec une application
exempte de fantaisie. Quelquefois on a cru le prendre en
défaut, mais une critique plus attentive a fini par lui donner
raison : ainsi, dans le récit du siège de Marseille, Stoffel
et bien d'autres lui ont reproché de n'avoir pas mentionné les deux terrasses des assaillants, mais M. Jullian a montré
que la seconde terrasse n'a existé que dans l'imagination de
commentateurs malavisés du texte de César. En un mot,
qu'il s'agisse de topographie, de chronologie, de stratégie ou
de tactique. Lucain a presque toujours la conscience et le
sérieux d'un technicien bien informé.
Chose remarquable, c'est assez souvent de sa documentation
même que sort son mérite d'artiste. Qu'on se rappelle
l'épisode si frappant du livre IV, les deux armées ennemies
campées sur deux collines voisines, au milieu d'une chaîne
de montagnes dont se hérisse la plaine de l'Èbre ; ou
bien le tableau de la forteresse de Dyrrhachium, qui se dresse,
inexpugnable, sur un roc presque en pleine mer, à peine
rattachée à la côte par une étroite bande de terre, si bien
entourée par les flots que, les jours de grand vent, l'assaut
des lames secoue ses temples et ses maisons et couvre ses
toits d'écume. Ces descriptions, tout à fait vivantes, n'ont
rien de « littéraire » dans le mauvais sens du mot, rien qui
soit inventé à plaisir. Tous les détails en sont vrais, empruntés
à des textes sûrs, et destinés à faire comprendre la situation
des belligérants autant qu'à produire une forte impression
sur le lecteur. C'est la précision rigoureuse qui en fait
le pittoresque.
Historien dans la notation des faits, Lucain l'est aussi dans
la recherche des causes Ici encore la fiction arbitraire est
bannie de cette oeuvre sérieuse et forte. Voyons-le, par
exemple, essayer d'expliquer l'origine du grand fait auquel
est consacré son poème, l'origine de la guerre civile. Plus
d'un poète ancien se serait réfugié dans des inventions mythologiques
ou dans des considérations vagues et superficielles.
Lucain suit une marche plus méthodique. S'il commence
par invoquer la volonté mystérieuse du destin, qui ne
permet pas aux choses humaines une croissance démesurée,
et veut que l'excès de puissance soit toujours suivi d'une chute, il ne s'en tient pas longtemps à cette raison trop
abstraite, trop générale. Il analyse les motifs particuliers qui
ont armé l'un contre l'autre les deux chefs rivaux, et caractérise
avec une sûreté tout à fait pénétrante leurs dispositions
morales et leur situation politique. Puis, passant des
généraux aux soldats, il trace le tableau des vices qui ont
rendu possible cette crise tragique : l'amour du luxe et des
plaisirs, engendré lui-même par une prospérité trop grande ;
le dédain des lois et des principes moraux; la dissolution des
institutions anciennes; l'anarchie; la corruption électorale;
la perturbation financière, qui fait que presque tout le monde
a intérêt à ce que la guerre éclate. C'est donc dans la psychologie, soit individuelle, soit sociale,
qu'il cherche l'explication des faits historiques, et par
là, il se sépare profondément de presque tous les poètes de
son temps, se rapproche au contraire d'un Salluste ou d'un
Thucydide, de ce dernier surtout, car, comme lui, il
s'applique à généraliser ses observations; il présente l'événement
qu'il étudie comme un cas particulier d'une loi universelle, et cette espèce d'élargissement inductif achève
de donner à ses réflexions un aspect tout à fait scientifique.
Dira-t-on qu'il s'échappe quelquefois en imaginations romanesques?
qu'un historien sérieux n'aurait pas accordé
tant d'importance à Julia et à Cornelia? et qu'en attribuant à
la mort de l'une la rupture de César et de Pompée, en nous
montrant Pompée dominé jusqu'à Pharsale par sa passion
pour l'autre, en faisant jouer un tel rôle à l'amour au sein des
agitations politiques, il a voulu embellir les faits bien plutôt
que les expliquer rationnellement? J'estime que ce serait
une erreur. Les causes personnelles, accidentelles même,
ont leur place dans l'histoire à côté des grands mouvements
d'opinion ou d'intérêt. Il serait aussi illogique d'en nier l'efficacité
que de leur imputer, à elles seules, tout ce qui arrive.
Ici, il semble bien que Pompée, tel que nous l'apercevons à travers la biographie de Plutarque par exemple, ait été fort
sensible à l'ascendant de ses épouses successives. L'amour a
certainement pesé sur ses décisions, qui, à leur tour, ont pesé
sur les destinées de Rome. Il est donc on ne peut plus légitime
de mentionner les motifs sentimentaux en même temps
que les motifs politiques. Que Lucain ait présenté ces motifs
sous une forme très émouvante, dans l'apparition de Julia
à Pompée ou dans les adieux de Pompée et de Cornelia,
c'est possible, mais cela ne change rien à la question. Des
épisodes comme ceux-là contribuent puissamment au pathétique
de la Pharsale, mais ce n'est pas le seul désir du pathétique
qui les a suggérés à l'auteur. En mettant l'amour à
côté de l'ambition ou du calcul, en faisant intervenir des
mobiles passionnels dans la conduite de personnages qui,
après tout, étaient des hommes et non pas seulement des
politiciens, Lucain n'a point péché contre la vérité psychologique;
il n'est pas sorti du terrain positif, le seul qui convienne
à un historien.
Ainsi donc, quand il doit noter des détails matériels,
décrire des scènes ou des sites, analyser des sentiments, ou
expliquer les grands faits politiques et militaires, Lucain se
montre toujours avide de réalité précise. Son esprit ne va
pas naturellement à l'imaginaire ou à l'hypothétique, mais au
vrai. Cela se voit encore mieux quand on observe son attitude
dans plusieurs cas où sa passion républicaine pouvait
l'écarter de la vérité, et où il est allé quand même vers elle
par un très méritoire effort.
Nous l'avons vu, par exemple, supprimer certains détails
préjudiciables à la cause pompéienne : mais il en a conservé
d'autres, qu'un pamphlétaire fanatique n'aurait pas manqué
d'omettre. Au livre IV, notamment, il ne dissimule nullement
les torts de Petreius, son opposition acharnée et stupide
à la paix réclamée par ses soldats, sa décision d'enrôler
des esclaves pour « des combats criminels », sa perfidie et sa
cruauté dans le massacre des césariens. Inversement, il y a des faits qui ne sont pas très favorables aux partisans de
César, que celui-ci a racontés, que Tite-Live a dû raconter
aussi, dont Lucain aurait pu s'emparer, et dont il n'a pas
tiré parti pour les besoins de sa cause : tel est l'appel adressé
par les assiégés de Salones à la population servile. Quelquefois
même son impartialité éclate à propos d'événements
considérables. Ainsi, puisque la bataille de Pharsale est à
ses yeux à la fois un malheur et un crime, il aurait pu être
tenté d'en attribuer l'initiative à César, d'autant plus que
César lui-même présente cette bataille comme voulue par
lui autant que par son adversaire. Il n'en a rien fait. S'il
a déchargé Pompée de la responsabilité principale en cette
occurrence, c'est pour la faire retomber sur ses compagnons
d'armes, non sur son ennemi : décidé par l'état-major
pompéien, engagé sur le signal de Pompée, le combat n'est
pas l'oeuvre de César, qui se contente d'accepter, avec
une joie féroce, il est vrai, l'occasion avidement souhaitée.
On pourrait aussi comparer le récit tracé par les deux écrivains
des événements qui ont suivi Pharsale : peut-être
est-ce dans les Commentaires que Pompée a l'attitude, je ne
dis pas la plus émouvante, mais la plus active et résolue, la
plus digne d'un chef de parti, de telle sorte que son ancien
rival nous en donne une idée plus élogieuse que son panégyriste,
ce qui prouve à tout le moins la bonne foi de ce dernier.l'écrivain
Ceci nous amènerait à définir le jugement de Lucain sur
Pompée. On a bien souvent signalé les réserves qui se
mêlent à la louange, mais il importe d'observer que ces
réserves ne se trouvent pas seulement au début du poème.
Que Lucain ait condamné la part prise par Pompée au triumvirat, sa jalousie puérile des succès de César, sa fuite
éperdue à l'approche de l'ennemi; qu'il ait fait juger très sévèrement par Brutus et par Caton son ambition démesurée : cela s'explique sans peine si l'on admet que les premiers
livres de la Pharsale ont été composés avant la rupture
de et de Néron. Mais, jusqu'à la fin de l'oeuvre, un
peu de cette défiance persiste toujours. Lucain a beau nous
dire que Caton, qui autrefois détestait Pompée, est devenu
pompéien depuis la défaite de Pharsale : il s'en faut de
beaucoup que cette conversion soit entière. L' « éloge » de
Pompée par Caton, par Caton qui est évidemment ici le
porte-parole de l'auteur, se résume à peu près ainsi :
« Pompée était loin de valoir nos ancêtres, mais enfin il était
un peu moins mauvais que la plupart de nos contemporains
». Ces restrictions, à cette place, sont fort significatives.
Elles prouvent tout au moins que Lucain n'est pas un
de ces écrivains de parti qui vantent indifféremment tous les
défenseurs de leur cause. Parmi les adversaires de César, il
s'attache à distinguer ceux qui sont mus par une pensée
égoïste et ceux qui n'obéissent qu'à un principe désintéressé.
Il ne met pas Pompée ni Cicéron sur le même rang que Caton
ou Brutus. Ce soin de marquer les nuances, à lui seul, est
une garantie d'objectivité.
Tout cela est relatif, bien entendu. Il serait fort imprudent
de voir dans Lucain le narrateur impassible qu'il ne
pouvait ni ne voulait être. Mais il y aurait un égal excès à
dénier à la Pharsale toute valeur historique, sous prétexte
que c'est une oeuvre d'art et une oeuvre de passion. Il ne me
paraît pas douteux que Lucain ait aimé la vérité presque
autant que ses propres idées. Et, trouvant dans l'histoire de
Tite-Live un document dont le libéralisme concordait avec
ses propres tendances, et dont la bonne foi, universellement
célèbre, rassurait ses scrupules, il a dû s'en tenir aussi près
que possible, s'en assimiler la substance, n'y rien ajouter
ou retrancher d'essentiel. Il n'a pas été un pur historien,
mais il a aimé l'histoire, il l'a comprise, et le plus souvent il l'a respectée. C'en est assez pour donner à son poème une
haute valeur, puisqu'en lui nous apparaît le récit de Tite-Live, embelli, mais non déformé, par la splendeur de la
poésie.
LES SOURCES PHILOSOPHIQUES
1
§ 1.
La question des sources philosophiques de Lucain ne se
pose pas du tout dans les mêmes termes que celle de ses
sources historiques. Pour exprimer ses idées sur l'univers et
sur les dieux, sur la vie future et sur la vertu, le poète n'a
pas eu besoin de consulter docilement ses livres comme
pour raconter les épisodes de la guerre civile. Il serait vain
de chercher dans la Pharsale l'action immmédiate, directe,
de tel ou tel ouvrage de philosophie : on peut seulement
se demander, d'une façon plus générale, sous quelles
influences s'est formée la pensée de l'écrivain, cette pensée
qui, tantôt largement développée, tantôt condensée en
quelques mots, est présente dans toute l'oeuvre, en anime
et vivifie tous les détails.
Même ainsi défini, le problème n'est pas très facile à
résoudre. Il paraît l'être tant qu'on ne l'examine que de
loin. Évidemment, à prendre la Pharsale dans ses grandes
lignes, Lucain est stoïcien, et l'on s'y attend du reste.
Neveu de Sénèque, disciple de Cornutus, ami de Perse,
comment n'aurait-il pas subi l'empreinte du stoïcisme? De
fait il l'a subie : qu'on se rappelle les conseils d'énergie, de
désintéressement, qu'il prodigue à toute occasion; qu'on
relise surtout son admirable portrait de Caton, de ce Caton
qui fut un des « saints » du stoïcisme. Seulement, cette première constatation, d'autant plus aisée à faire qu'elle est
plus superficielle, ne nous permet pas de pénétrer bien avant
dans l'esprit de Lucain. Le stoïcisme a eu des disciples
d'espèce assez différente : les uns d'une fidélité intransigeante,
immuablement attachés aux principes de la secte;
les autres plus disposés à les laisser tempérer par ceux des
écoles rivales. De plus, les grands docteurs du Portique, à
l'inverse d'Épicure, n'ont jamais imposé un dogme arrêté
jusque dans les plus petits détails : à côté des vérités essentielles, ils ont laissé subsister des questions ouvertes, sur
lesquelles les opinions contraires pouvaient se manifester
librement. Dès lors, puisque l'adhésion au stoïcisme n'entraîne
pas d'emblée l'acceptation passive d'une doctrine toute
faite, nous devons rechercher ce qu'a été cette adhésion
pour Lucain. S'est-il strictement enfermé dans les croyances
qu'on lui avait prêchées, ou bien a-t-il été accessible à des
influences étrangères? et d'autre part, là où il y avait dout et choix, là où les maîtres se partageaient, de quel côté
s'est-il rangé? Une fois qu'on a dit qu'il est stoïcien, il reste
à marquer d'abord le degré exact, et aussi la nuance précise,
de son stoïcisme.
Sur le second de ces deux points, ceux qui se sont occupés
de Lucain n'ont rien dit de très net. Sur le premier, ils ont
donné des réponses contradictoires. Les uns, comme OEttl,
Millard, Heitland, se sont appliqués à retrouver dans
la Pharsale la traduction rigoureuse des maximes stoïciennes
: Heitland a même eu la patience de résumer, d'après
Zeller, les principes fondamentaux du système stoïcien, et,
en regard de chacun des articles de cette confession de foi,
il a placé les vers du poète qui peuvent servir à l'illustrer. Ce
parallélisme, on le croira sans peine, est un peu factice.
D'ailleurs, Heitland, aussi bien que OEttl et Millard, finit par
reconnaître qu'il y a chez Lucain des « éléments non stoïques
». Ces éléments paraissent avoir beaucoup frappé
plusieurs critiques français ; ils se sont choqués des disparates
qui en résultent dans un poème en général stoïcien. M. Souriau a durement raillé les contradictions de Lucain,
qu'il se représente comme ballotté entre Zénon et Épicure.
M. Lejay, avec une ironie plus discrète, n'est pas
au fond moins sévère. Pour lui, l'auteur de la Pharsale n'est
ni un stoïcien, ni un épicurien, ni un éclectique, ni un sceptique
; c'est simplement un homme de lettres. « Il a des
croyances successives et même simultanées. C'est qu'il ne
voit guère dans ces doctrines que de belles matières dignes
de tenter un poète. » De ces deux interprétations, laquelle
est la vraie? les sentences philosophiques, si nombreuses
dans la Pharsale, sont-elles les pièces d'une théorie liée (avec,
peut-être, l'intrusion de quelques idées hétérogènes)? ou bien
ne devons-nous y voir que des amplifications de pure virtuosité
littéraire ?
Le sérieux passionné avec lequel toute l'oeuvre est écrite
proteste, je crois, contre cette dernière opinion. D'autre
part, les divergences qu'on relève entre tels et tels passages,
si elles sont réelles, accusent une incohérence de pensée qui
serait invraisemblable chez le sectateur convaincu d'une
doctrine philosophique. Mais sont-elles réelles? c'est la question
capitale qu'il nous faut éclaircir ; et, pour l'éclaircir, il
sera bon, je crois, de la décomposer. Je ne songe pas seulement
à la distinction entre « physique » et « morale», qui
est de rigueur ici comme à propos de tous les philosophes
anciens. Même dans la « physique », il y a plusieurs problèmes
différents, quoiques connexes : voyons successivement
ce que Lucain a pensé de chacun d'eux.
En ce qui concerne la physique à proprement parler, je
veux dire la conception du monde ou de la nature, il me
paraît se conformer absolument aux enseignements du stoïcisme. Il s'y conforme sur des points de détail, tels que
l'existence des antipodes, la position de la terre suspendue
en équilibre et soutenue par l'air, le renouvellement
de la substance des astres par l'air ou par l'eau de l'Océan, le déluge qui a jadis dévasté la terre, l'existence
perpétuelle de certaines eaux, marines ou fluviales,
aussi anciennes que la création elle-même. Il s'y conforme
encore en ce qu'il ne croit pas le monde éternel,
mais destiné à périr dans un embrasement général. Enfin
et surtout, il accepte, pour tout ce qui touche à la vie de
l'univers, les tendances essentielles de la doctrine, celles qui
peuvent se résumer dans les trois mots de panthéisme, de
déterminisme et d'optimisme.
Lucain ne nie pas l'existence des dieux de la mythologie,
quitte d'ailleurs à révoquer en doute certains détails de leur
légende, et, par exemple, à refuser d'admettre qu'ils soient
nés tel jour et en tel lieu comme la tradition le prétend.
Mais ces dieux multiples ne sont que des émanations, des
manifestations du dieu suprême, de l'âme divine répandue
dans le monde. Cette âme, on peut l'appeler, si l'on
veut, « Jupiter » ou « le maître des dieux ». Mais elle ne
doit pas être confondue avec le Jupiter de la fable : le Jupiter
du poète, comme celui de Cléanthe ou de Sénèque, c'est
« tout ce que nous voyons et tout ce qui nous meut » ; son
séjour est partout, « la terre, la mer, l'air, le ciel ». Il
se glisse, en quelque sorte, dans toutes les parties de l'univers. Il est le père de toutes choses; s'il n'a pas
créé la matière, s'il l'a reçue informe et brute lorsque
le feu cosmique a commencé à s'apaiser, c'est lui
qui l'a arrangée, organisée, et qui, à chaque instant, l'anime. C'est lui aussi qui la soumet à l'enchaînement immuable
des causes et des lois auquel lui-même est d'ailleurs le
premier assujetti. Ces « pactes du monde », dont les
stoïciens ont si fréquemment parlé, Lucain les regarde
comme invincibles, au moins en ce qui concerne l'ensemble
de la nature. On a quelquefois prétendu le contraire, en se
fondant sur deux passages où il semble envisager comme
possible l'hypothèse opposée; mais ces deux passages n'ont
pas la portée qu'on leur attribue. Dans le premier, ce n'est
pas Lucain qui parle, mais un de ses personnages, l'astrologue
et pythagoricien Nigidius Figulus. Avant d'expliquer les
présages funestes qu'il lit dans le ciel, il s'écrit : « Ou bien le
monde erre éternellement sans loi et les astres vagabondent
dans une course incertaine, ou bien, s'ils sont mus par la
destinée, une prompte destruction se prépare pour Rome et
pour le genre humain ». Il est aisé de se rendre compte
que Figulus n'admet pas un instant la première supposition ;
elle n'est pour lui qu'une façon de présenter avec plus de force
son idée véritable, quelque chose comme une paraphrase
poétique de la locution familière : « ou je me trompe, ou
bien... ». L'autre passage se trouve au début du IIe livre.
Lucain, cette fois, s'exprime pour son propre compte, et se
plaint que l'humanité puisse prévoir les malheurs à venir.
Cette connaissance anticipée, dit-il en substance, est un mal
dans tous les cas, soit que les causes soient déterminées à
jamais, soit que toutes choses soient soumises à un sort
incertain. Mais il ne faut pas croire que Lucain hésite
lui-même entre l'hypothèse du destin et celle du hasard : il
se borne à déclarer que, dans les deux alternatives, la même
conclusion s'impose. C'est un artifice de dialectique, qui ne
l'empêche pas d'avoir son opinion arrêtée. La seule dérogation
à l'ordre naturel qui soit mentionnée dans le poème,
c'est le lever tardif du jour au moment de la bataille de
Pharsale : le Soleil, plus lent que ne le lui permet la « loi éternelle », répugne à éclairer cette scène horrible. Mais
qui serait assez naïf pour chercher dans cette hyperbole toute
littéraire l'expression d'une doctrine philosophique? Lucain
a pu, tout en se permettant cette figure de rhétorique, continuer
à croire avec les autres stoïciens à l'ordre universel.
Avec eux encore, il croit que cet ordre est bon. Cette confiance
sereine dans la bienveillance de la nature, qui s'épanche
éloquemment chez un Cicéron ou un Sénèque, et
qui contraste si fort avec l'âpre pessimisme de Lucrèce, se
retrouve aussi dans la Pharsale. C'est elle, notamment, qui
aide le poète à sortir des questions douteuses. Ainsi, en étudiant
la géographie de la Gaule, il est amené à décrire les
marées de l'Océan, et à en rechercher la cause : après avoir
émis trois hypothèses, celle d'une action des vents, celle de
l'attraction lunaire, et celle de l'attraction solaire, il avoue
qu'il laisse aux curieux le soin de se prononcer ; il consent,
pour sa part, à ce que la cause véritable reste cachée,
« comme les dieux l'ont voulu ». Pourquoi? si les dieux
n'ont pas cru devoir la révéler aux hommes, c'est que les
hommes n'avaient pas besoin de la connaître. Le sage doit
leur faire crédit, persuadé qu'ils ont tout réglé pour le mieux.
Quelquefois le finalisme du poète est mis à rude épreuve.
Voici, par exemple les Syrtes, cette région mi-terrestre et
mi-aquatique, qui n'est rien et ne peut servir à rien.
Faut-il croire que « la nature » l'ait ainsi créée pour être à
jamais inutile ? c'est la première idée qui vient à l'esprit de
Lucain, mais on sent bien qu'elle ne le satisfait pas. Il
penche plutôt vers une autre explication : les Syrtes seraient
une mer progressivement desséchée par le soleil ; dans
cette seconde hypothèse, la puissance créatrice ne serait pas
coupable. Elle ne l'est pas non plus en ce qui concerne les
serpents dont est infesté le sol de l'Afrique. Elle leur a assigné
un domaine désert, où l'homme n'a que faire de pénétrer
: s'il y vient, et s'il y meurt, c'est sa faute, et non celle de la nature. On reconnaît là une idée chère à la prédication
stoïcienne : l'homme faisant servir à de mauvais usages
ce que la nature n'y a point destiné (1).
(1) SEN. Nat. Quaest., V, 18, 4 (à propos des vents).
Au surplus Lucain se hâte d'ajouter que, si les morsures des serpents sont dangereuses, la Providence a mis le remède à côté du mal en donnant aux Psylles le pouvoir de les guérir. Ainsi il tourne l'objection même en argument pour sa croyance optimiste. Mais il est plus à l'aise, on le comprend, quand il s'agit du Nil et de l'Egypte. S'il se résigne à ne pas connaître ce que les dieux ont caché, la source du fleuve, son cours supérieur et la vraie cause de ses inondations, il lui suffit de constater que ces inondations se produisent au moment où elles peuvent utilement combattre la température caniculaire. « Le Nil vient en aide au monde pour empêcher la terre d'être détruite par le feu ». Pourquoi ? la nature maternelle l'a voulu ainsi ; ainsi le réclame le monde. Ce dernier passage est peut-être celui qui définit le mieux l'attitude de Lucain envers les problèmes cosmologiques. Elle ressemble assez à celle de son oncle Sénèque. Ni l'un ni l'autre ne sont de purs savants, affamés de vérité indiscutable. Ils consentent volontiers à ne pas choisir entre les hypothèses diverses, et, d'ailleurs, sauraient mal le faire. Leur étude de la nature est toute imprégnée de tendances morales, presque religieuses. S'ils contemplent les merveilles du monde, c'est moins pour les expliquer que pour les admirer, et, par cette admiration, ennoblir leur âme et remercier les dieux.
§ 2.
Bien que les pages consacrées par Lucain aux grandes lois
de la nature comptent parmi les plus intéressantes de son poème, parmi les plus directement inspirées du stoïcisme,
elles restent assez peu nombreuses, et, en somme, épisodiques.
La nature de son sujet ne l'amenait qu'incidemment
à parler des phénomènes extérieurs; au contraire, elle
l'obligeait à s'occuper sans cesse de l'humanité, de son histoire,
de sa destinée. C'est comme un monde à part, distinct
du premier, et qui est loin d'inspirer au poète les mêmes
sentiments de confiance heureuse. Son impression est bien
plus trouble, et ses idées paraissent bien moins nettes. Il
nous faut pourtant tâcher de les préciser pour en trouver
l'origine. Quelle est. pour Lucain, la force qui gouverne le
sort des hommes? quel est le degré de sa puissance? quel
est enfin le sens de son action? et, sur ces trois points,
accepte-t-il ou modifie-t-il les enseignements qu'il a reçus?
Voilà ce que nous allons rechercher.
Si l'on ne jetait sur la Pharsale qu'un coup d'oeil superficiel,
on pourrait croire que l'auteur ne sait pas très bien
lui-même ce qu'il pense de la puissance suprême qui nous
régit. Les trois termes de « dieux » (dii, superi, numina),
de « destin » (fata), et de « Fortune » (fortuna), sont employés
par lui à tour de rôle, aussi souvent, ou peu s'en faut, l'un
que l'autre. Or, rigoureusement parlant, ils expriment des
conceptions fort différentes : l'un désigne l'action personnelle
d'êtres intelligents, l'autre le déroulement nécessaire
d'une loi immuable, le dernier l'illogisme capricieux du pur
hasard. Lucain flotte-t-il donc entre ces trois explications
si dissemblables?
Il n'en est rien. A le relire plus attentivement, on s'aperçoit qu'il se
sert indifféremment des trois mots en leur donnant
la même valeur. Quelquefois, l'un remplace l'autre dans une
formule qui se répète, identique de sens, avec ce changement
de pure forme : ainsi, au début du Ve livre, il est dit
que la Fortune a laissé, jusqu'à la campagne d'Épire, les
deux adversaires sur un pied d'égalité;au commencement du livre VI, en parlant de la
même situation, Lucain compare César et Pompée à un couple de gladiateurs mis aux prises par les dieux;il est bien clair que la seconde pensée n'est
qu'une variante de la première.
Plus souvent, et d'une manière plus frappante encore, au
cours de ces redoublements d'expressions dont il est coutumier,
le poète juxtapose l'un des termes à l'autre; et, comme cela a
lieu dans la même phrase, souvent dans le même vers, on ne
peut prétendre que sa doctrine ait changé en si peu de temps.
Voici quelques passages où « destin » et « Fortune» apparaissent
comme synonymes : « Je te suis, ô Fortune (dit César);
arrière les lois ! je me fie au destin ». « Le destin rompt
toutes les barrières de l'honneur, et la Fortune travaille à ce
que l'entreprise de César soit juste ». « Pompée te prie, ô
Fortune, de lui permettre au moins d'abandonner cette terre
que tu lui interdis de garder; c'est à peine si le destin y
consent ». « César a l'habitude de jeter en pleine lutte
son destin ; il aime à éprouver sa Fortune par les plus graves
périls.». « La Fortune va accorder à des mains égyptiennes
ce sang dont elle doit inonder les sénateurs vaincus...
Non, destins, empêchez cela!» . « Les destins s'y epposent
(à ce que César soit pris par les rebelles), et la Fortune le
protège comme un mur ».
Voici maintenant d'autres phrases où « dieux » et « destin »
alternent sans aucune différence appréciable : « La vertu
(dit Caton) peut aller sans crainte où les destins l'entraînent :
la faute en sera aux dieux qui m'auront fait coupable ».
« Les dieux détournèrent presque cette marche prospère
des destins ». « Jamais la sollicitude des dieux (dit
César à ses soldats) ne se rabaisse au point que les destins
s'occupent de votre mort ou de votre vie ».« Si les dieux renversent notre armée (dit Pompée), il faut que la plus
chère moitié de moi-même soit sauve ; si les destins m'accablent,...
que j'aie un lieu où désirer fuir ». «Où donc
est ta confiance en le destin ? (demande Cicéron à Pompée).
Ingrat, as-tu donc peur des dieux? ». Pompée sentit la
perfidie des dieux, et les destins contraires à sa volonté ».
« Fie-toi aux dieux, fie-toi à la longue faveur des destins ». « Quelle que soit l'injustice du destin qui m'a
ravi les membres de Pompée, je pardonne ce crime aux
dieux ».
Et enfin, voici pour la synonymie entre « dieux » et
« Fortune » : « Maintenant (dit César) que la Fortune me
traite avec faveur et que les dieux m'appellent aux plus
hauts sommets... ». « La Fortune sauve bien des coupables,
et les dieux ne savent s'irriter que contre les malheureux
» . « La Fortune, se contentant d'avoir un peu
effrayé César, lui revint tout entière, et, plus empressés que
de coutume à le favoriser, les dieux se firent pardonner ».
De même les soldats de Vulteius sont dépeints comme
offerts en spectacle par les dieux et par la Fortune.
Il y a même des endroits où les termes, « dieux », « destins
» et « Fortune », sont employés tous les trois. Ainsi
les soldats révoltés contre César s'écrient: « Tout ce
que nous faisons, on l'appelle Fortune. Eh bien ! qu'il sache
que son destin, c'est nous. Tu peux espérer tout le secours
des dieux, César : si tes soldats se fâchent, la guerre cessera
». Au moment de la tempête, César se voit aux
prises avec un péril « digne de son destin » ; il s'étonne que
« les dieux » prennent tant de peine pour le détruire, et, un
peu plus loin, brave « la Fortune». A Pharsale, Pompée s'aperçoit que « les dieux et les destins de Rome sont passés
dans l'autre camp », et se résout enfin « à désespérer de sa
Fortune ». Pothin parle ainsi à Ptolémée : « Cette fidélité
tant vantée est punie quand elle vient en aide à ceux
que la Fortune accable : mets-toi du côté des destins et des
dieux ».
Ces exemples suffisent, je crois, pour établir qu'on ne
peut conclure de la différence des expressions à l'incohérence
des conceptions. Lucain n'attribue pas les événements
humains tantôt à une puissance et tantôt à une autre : c'est
toujours la même qu'il reconnaît, bien qu'il ne l'appelle pas
toujours du même nom. La liberté qu'il prend à cet égard ne
doit pas nous surprendre : on la retrouverait jusque dans des
traités philosophiques comme ceux de Sénèque. Dans le De
prouidentia, par exemple, il est question des dieux, de la
Fortune, du destin, et même de la nature. Dans
la Consolation à Marcia, le philosophe décrit longuement le duel de l'âme humaine avec « la Fortune», mais quelquefois
aussi il dit que nos larmes ne peuvent vaincre « la destinée
», et il n'omet pas non plus la « jalousie des dieux».
Si la Consolation à Helvia présente a chaque page le nom
de la « Fortune », on y rencontre aussi une plainte contre la
« cruauté des destins »; on y lit surtout cette définition
remarquable de la puissance suprême : « le créateur, quel
qu'il soit, de l'univers, que ce soit un dieu tout puissant, ou
une raison incorporelle productrice de grandes oeuvres, ou
un souffle divin répandu avec une égale intensité dans les
plus grandes et les plus petites choses, ou un destin enchaînant
toutes les causes en série immuable ». Quand on voit
un aussi conciliant éclectisme chez un philosophe de profession,
comment s'étonner qu'un poète ne se soit pas assujetti
à une terminologie très stricte? Peu importe comment le poète désigne la loi suprême des
choses humaines. Ce qui est essentiel à noter, c'est qu'il croit
à l'existence de cette loi, et à son unité. En croyant à son
existence, il se distingue des épicuriens; en croyant à son
unité, il se sépare du paganisme traditionnel.
On a prétendu qu'il se rapprochait des épicuriens, au
moins une fois, dans son explosion d'amertume indignée à
propos de Pharsale. Il est très vrai qu'avant de commencer
le récit de la bataille, gémissant sur la destruction de la
liberté romaine, il s'écrie ironiquement : «Certes, il n'y a
point de divinité pour nous; un hasard aveugle emporte les
siècles, et nous mentons en disant que Jupiter règne...
Aucun dieu ne s'occupe du sort des mortels. Rien de
plus épicurien que ces paroles, rien de plus contraire à la
thèse stoïcienne de la Providence. Mais sont-elles sincères?
ne sont-elles pas plutôt une hyperbole véhémente, ou encore
un cri de désespoir, arraché par l'intensité de la douleur?
Les gens les plus pieux, sous le coup d'une épreuve
qui leur semble injuste, laissent échapper leur révolte en
une négation qui ne traduit pas du tout leur sentiment réel.
De même ici, ce blasphème momentané, tout à fait isolé dans
l'oeuvre de Lucain, ne prouve pas qu'il adhère du fond de
l'âme à la doctrine épicurienne du hasard (1).
(1) SOURlAU dit que Lucain est épicurien parce que, comme Lucrèce,
il tourne en raillerie l'idée païenne de Jupiter lançant la foudre mème contre
ses propres temples I, 155 : " in sua templa furit". Mais le vers paraît avoir
un autre sens; les templa sont probablement les lieux touchés par la foudre.
D'ailleurs, Sénèque, aussi bien que Lucrèce, s'égaie à la supposition que Jupiter
puisse foudroyer ses sanctuaires (Nat. Quaest., Il, 43. 1).
Il ne partage pas non plus l'opinion de la foule païenne, qui fait intervenir une multitude de divinités distinctes. Les dieux du panthéon gréco romain ne sont mentionnés que rarement, dans des figures de style, périphrases ou comparaisons, purs ornements littéraires, ou bien dans des narrations merveilleuses épisodiques, ou enfin dans des prières que l'auteur prête à ses personnages conformément à la vraisemblance historique (1).
(1) Prières de César, I, 195-203, et IX, 990-999.
Mais, quand il parle pour
son propre compte, jamais il n'attribue à une divinité isolée
un des faits de son récit. Ce qu'il nomme, ce sont les dieux,
pris en bloc, comme émanation collective de l'âme du
monde, ou Jupiter, appellation conventionnelle par laquelle
les stoïciens ont l'habitude de désigner le principe créateur
et ordonnateur de l'univers. Ici encore le poète est en parfaite
communauté d'idées avec son oncle le philosophe :
dans les Questions Naturelles, Sénèque distingue soigneusement
le Jupiter vulgaire, celui des temples et du Capitole,
et le Jupiter des métaphysiciens, gardien et régulateur de
l'univers : on peut, dit-il, l'appeler destin, Providence, nature,
monde, à volonté; il est tout cela.
On ne trouve donc chez Lucain, sur le point que nous
examinons, aucune complaisance réelle ni pour les théories
d'Epicure ni pour les croyances vulgaires, aucune dérogation
aux principes des stoïciens. Comme ses maîtres, il pense qu'il
y a, supérieure à nous et se manifestant dans tout ce qui
nous arrive, une puissance qui nous échappe, dont le mystère
même constitue le tragique de notre destinée.
Cette puissance est-elle absolument souveraine ? ne laisse-t-
elle aucun jeu à la liberté humaine? cette question est une
de celles qui semblent avoir le plus préoccupé les stoïciens.
Chrysippe, au dire de ses lecteurs, avait particulièrement
réussi à concilier le destin et le libre arbitre (1).
(1) Cic., De fato, 18; PLUT., De stoic, repugn.,34; De plac. phil., I, 27.
Sénèque,
dans les Questions Naturelles, promet à Lucilius de lui expliquer
comment cette conciliation est possible. En
attendant, il lui donne, à propos de la foudre et des moyens
d'en conjurer les présages, une application partielle de la
théorie, qui est d'ailleurs quelque peu sophistique. Quoi
qu'il en soit, il semble bien que le problème ait été fort
débattu dans l'école. Voyons comment, pour sa part, Lucain
paraît l'avoir résolu. En général, il se représente l'ordre des causes comme
intangible. La lutte héroïque de ceux qui veulent franchir
le mur de la destinée, et la sombre résignation de ceux qui,
s y étant brisés, ont senti leur impuissance, sont même ce
qu'il exprime avec le plus d'émouvante profondeur.
Cependant, par endroits, il donne à l'activité de l'homme
une marge assez étendue. M. Lejay (1) cite à ce propos
le passage où il regrette que Pompée, à Dyrrhachium, n'ait
pas poursuivi et écrasé César : «Ce jour, ô Rome, aurait pu
être le dernier jour de tes maux ; Pharsale aurait pu être
rayée des destins».
(1) LEJAY cite aussi les paroles de Pompée à Cornelia (VIII, 76-77) Mais, ici, il n'est pas question de
changer les destins; on peut seulement garder, malgré eux, les mèmes sentiments
qu'auparavant, ce qui est tout autre chose.
Je ne sais pas s'il ne s'agit pas simplement
ici d'une possibilité théorique ou logique; les fatalistes,
comme ceux que fait parler Sénèque, auraient beau
jeu à répondre que l'abstention de Pompée était écrite, elle
aussi, dans l'ordre fatal. Je ne veux rien conclure non plus
des vers où les soldats rebelles de César se vantent d'être à
eux seuls, sans l'aide des destins, les auteurs de sa fortune :
cela peut n'être qu'une fanfaronnade de mutins. Mais
voici des exemples plus significatifs.
« Malheureux enragé! dit Pompée à César ; le destin voulait
t'égaler aux Camilles et aux Metellus. et tu te ravales
aux Marius et aux Cinnas ». On peut donc changer sa
destinée ? On peut, tout au moins, la retarder ou l'accélérer;
c'est une des idées qui reviennent le plus souvent
dans la Pharsale. Les Marseillais en résistant à César,
Pompée en ajournant le départ de Cornelia, gagnent du
temps sur le destin ; au contraire, lorsque les soldats d'Afranius
font leur soumission, lorsque Pompée consent à livrer
bataille, ils déclarent qu'ils ne veulent pas « retarder le destin », ce qui prouve qu'ils le pourraient s'ils le voulaient.
Le cours fatal des choses peut, inversement, être rendu plus
rapide : c'est ainsi que César se hâte de poursuivre son
adversaire à Brindes pour empêcher le destin de changer
quoi que ce soit ; de même, à Pharsale, les pompéiens
avancent leur propre ruine et celle de l'État par leur hâte
indiscrète ; enfin le poète, s'adressant à Brutus dans un
mouvement passionné, le conjure de ne pas trop s'exposer,
de ne pas amener trop tôt sur sa tête la fatale bataille de
Philippes. Comme on le peut voir, ce qu'il est possible
de changer, c'est moins la direction du mouvement des
choses que sa vitesse. Elle n'est pas uniforme, en effet :
quelquefois le destin semble suspendre sa marche pour
mieux repartir ensuite ; quelquefois on le dirait pressé
d'en finir. Son allure est donc variable, et l'homme peut
en profiter. S'il ne lui est sans doute pas permis de transformer
les décisions du sort, il lui est loisible d'en rapprocher
ou d'en éloigner l'échéance. Cela suffit à lui conférer
une indépendance relative, bien minime encore ; je la comparerais
volontiers à celle que notre Alfred de Vigny, poète
stoïcien lui aussi et fataliste, reconnaît à l'homme moderne,
un peu moins esclave que celui l'antiquité :"
Vous avez élargi le collier qui nous lie" (1).
(1) Vigny, Les destinées.
On pourrait dire de même que, pour Lucain, l'homme est
un captif qui peut allonger sa chaîne.
Malgré tout, la force du destin reste prépondérante. Et
alors se pose une dernière et très obscure question : vers
quel but ce destin nous entraîne-t-il ? que veut-il faire de
nous? nous est-il propice, indifférent ou hostile? est-il réglé
lui-même par quelque intention morale? C'est peut-être sur
ce point qu'il est le plus difficile de discerner la vraie opinion
du poète. Il semble hésiter entre les croyances populaires, survivances des vieilles mythologies, et les affirmations
du stoïcisme. Quelquefois, emporté par un sentiment
violent, il oublie qu'il a exprimé ailleurs une idée qui se
concilie mal avec son impression actuelle. Il faudrait aussi
distinguer ce qu'il dit en son nom, ce qu'il fait dire à des
personnages qui lui sont sympathiques, et ce qu'il fait
énoncer par les personnages qui lui déplaisent. Toutes ces
causes font que sa conception du rôle du destin, précisément
parce qu'il en parle à maintes reprises, nous apparaît confuse
et incertaine. Voici pourtant ce que je crois y démêler.
D'abord le destin, si on le juge par les actes matériels qui
le manifestent, n'est pas moral. Il est impossible de prendre
la Fortune comme guide. Seules le font les âmes basses et
criminelles comme Ptolémée et Pothin, qui accablent ceux
que le sort a déjà accablés. Mais les coeurs nobles, selon
l'éloge que le poète donne aux Marseillais, consultent, pour
se déterminer, la bonté d'une cause, et non son succès.
Cette idée est très conforme aux maximes des stoïciens,
comme d'ailleurs de beaucoup de moralistes ; elle est même
plus banale qu'étonnante.
Il y a quelque chose de plus particulier. Le destin ne
semble pas s'occuper au même degré de tous les hommes.
On dirait qu'il y en a, qu'il y en a même beaucoup, qui ne
comptent pas pour lui. Non seulement César, répliquant à
ses soldats mutinés, leur lance la célèbre et cynique apostrophe
: « L'humanité ne vit que pour quelques hommes» ;
mais l'auteur lui donne en somme raison, puisqu'il montre
le ciel et le monde tout entiers à la lutte entre César et
Pompée, ces deux êtres privilégiés. La Fortune se plait
à les mettre aux prises ensemble ; elle se donne ce spectacle
de grand luxe, sans songer à toutes les misères que coûtera
à l'humanité ordinaire le duel splendide qui la charme. Elle
n'a du reste, pour décider entre ces héros exceptionnels, aucun principe moral. Elle s'acharne, avec un parti-pris que
rien ne justifie, contre Domitius, Cornelia, Pompée
surtout, et au contraire elle favorise si complaisamment
César qu'elle paraît devenir son esclave. Les vers sont
innombrables où le futur dictateur, affirmant sa foi en son
« étoile », traite la destinée comme s'il avait le droit de la
commander et de la bafouer ; innombrables aussi les
endroits où le poète a l'air d'adopter cette croyance, la plus
déconcertante de toutes, la moins morale et la moins philosophique.
Dans ces conditions, ce ne serait pas assez de parler des
caprices du destin ; il faut dire franchement que le destin est
méchant, cruel, injuste : et Lucain ledit en effet. Il se plaint
sans cesse des rigueurs imméritées du sort. Il déclare
que la Fortune sauve maints coupables, et que les dieux ne
savent s'irriter que contre les malheureux. Il nous dépeint,
ici les dieux altérés de sang, ailleurs la Fortune attirant
des foules d'hommes à une atroce boucherie. Il prête
même à la puissance cachée qui nous gouverne je ne sais
quelle férocité raffinée : elle ne suspend un instant les hostilités
en Espagne que pour mieux frapper ensuite ; elle
éloigne de Pharsale un monstre comme Septimius, mais afin
de faire tomber plus tard Pompée sous ses coups; elle
égare les amis de Pompée et Cicéron lui-même, leur fait
réclamer la bataille, parce qu'elle veut qu'il se mêle toujours à nos malheurs une faute personnelle ; elle dirige les
armes des combattants de façon à les rendre à son gré innocents
ou coupables. Bref elle parait animée contre les
hommes d'une haine patiente et ingénieuse autant qu'implacable.
Cette conception pessimiste de la destinée humaine contraste
singulièrement avec la théorie stoïcienne de la Providence
; elle contraste même avec l'optimisme que Lucain
professe en ce qui concerne la vie de l'univers. Quelques
accents pathétiques, quelques beaux cris de souffrance ou de
révolte qu'elle ait produits, elle ne laisse pas d'être embarrassante.
Voyons si elle est définitive.
Remarquons en premier lieu que la Fortune n'est pas toujours
malveillante. Elle est accessible à la pitié. Elle épargne
à Rome les horreurs d'une guerre étrangère, ou la honte
de voir Pompée exposé de son vivant à la compassion de
son vainqueur. Si elle lui fait élever à la hâte un tombeau
bien insuffisant, est-ce pour qu'il n'en ait pas un meilleur ou
pour qu'il n'en soit pas totalement privé ? le poète n'ose se
prononcer. Elle a même parfois des attentions délicates :
elle donne au vaincu de Pharsale la joie de revoir en songe
sa chère Rome, et elle sauve l'Italie de la tache que jetterait
sur elle le sang du grand Pompée.
Cependant, à ne prendre que ses actions particulières de
tel ou tel moment, il reste vrai qu'elle faitplus de mal que
de bien. Mais c'est que, justement, il ne faut pas regarder tel
ou tel fait : il faut voir l'ensemble. Alors, tout s'explique :
la justice règne, et notre soif de moralité est rassasiée. Il
n'est pas très facile de s'en rendre compte pour ce qui est
de la guerre civile elle-même : la mêlée est trop ardente, et
Lucain s'y intéresse trop passionnément, pour que nous puissions
discerner à travers son récit l'application d'une loi d'immuable équité ; mais il nous la laisse mieux apercevoir
à propos d'événements qui le touchent de moins près.
Ainsi Alexandre a été « un fléau du destin » ; il a dévasté
l'univers : mais à son tour il a été puni par cette même
puissance qui en avait fait son instrument, par «le destin
vengeur du monde ». De même Marius a été envoyé par
les dieux pour servir de ministre à leur colère : mais lui
aussi a expié; le châtiment a même précédé le crime.
Jusque dans la guerre civile, on entrevoit par moments la
sanction tardive de toutes les fautes : c'est la mort de Curion,
à l'occasion de laquelle le poète regrette seulement que les
dieux aiment mieux punir que prévenir les atteintes portées
par les ambitieux à la liberté de Rome; c'est la mort de
Pothin et d'Achillas, vengeance offerte aux mânes de
Pompée ; c'est, dans le lointain, le meurtre de César,
tenu en réserve par les destins pour l'heure où il aura
comblé sa mesure de forfaits.
Ne pourrait on pas aussi rattacher à ce principe des expiations
nécessaires l'idée, souvent exprimée par le poète, que
toute grandeur doit, suivant la loi du destin, être suivie
d'une chute? Pompée est puni par la Fortune de la trop
longue faveur qu'il en a reçue; Rome est déchirée par la
guerre civile parce qu'elle est devenue trop puissante, et
qu'elle n'a pas le droit de dépasser le terme de croissance
fixé par les dieux. Sans doute de telles réflexions, et
certaines expressions poétiques comme « la suite jalouse des destins », rappellent la vieille conception légendaire de la
Némésis. Mais n'est-il pas possible que, tout en la reprenant,
Lucain ait songé à lui donner un sens philosophique?
Les stoïciens aimaient assez à accueillir les superstitions les plus archaïques, et à les interpréter au moyen d'une allégorie
morale. Ici, on peut dire que la prospérité excessive,
autant que le crime, est une dérogation aux règles du
monde. C'est une anomalie, une monstruosité, que la destinée
fait cesser par une brusque remise en place. Et dès
lors le sage ne doit ni s'étonner devant ceux qui paraissent
trop heureux, ni s'indigner devant ceux qui lui paraissent
heureux injustement. Les caprices, les immoralités apparentes
de la Fortune s'expliquent, à condition qu'on lui
laisse le loisir de faire son oeuvre complète. A ceux qui s'en
scandalisent trop vite, Lucain, très bon stoïcien sur ce
point, répondrait volontiers, comme un personnage d'une
comédie moderne, que si l'on croit voir triompher le :mal,
c'est qu'on ne regarde pas assez longtemps (1).
(1) A. DUMAS FILS, L'étrangère.
Tôt ou tard,
l'équilibre universel se rétablit.
Mais, à travers ces revirements, les individus sont sacrifiés?
la justice triomphera, soit : en attendant, les justes
souffrent et meurent! Ici, je crois qu'il faut faire intervenir
dans la philosophie de Lucain la distinction essentiellement
stoïcienne des vrais et des faux biens. S'il ne la formule
pas constamment, parce qu'il parle le langage de la
vie commune et non celui de l'école, il ne l'oublie pas
néanmoins, et il l'énonce éloquemment à trois moments
décisifs de la carrière de Pompée. Au début de la guerre, il le
montre s'applaudissant de n'avoir pas commencé les hostilités
: « Les dieux soient loués de ce que nous avons subi les
premières pertes, de ce que le crime a pris naissance chez nos
ennemis ». A Pharsale, il s'adresse à son héros, et lui
dit de ne pas se plaindre de son sort : « il aurait été pire d'être
vainqueur ». Enfin, au moment ou il va mourir, le vaincu s'exhorte au calme par une méditation empreinte du
plus pur et du plus noble stoïcisme : «Qu'on me déchire,
qu'on me dépèce, je suis heureux quand même ; aucun dieu
ne peut me l'ôter » . La félicité est donc tout intérieure, toute morale. Et non seulement les maux apparents n'enlèvent
rien au sage : ils lui apportent quelque chose, l'occasion
de faire éclater sa vertu. Pompée, après Pharsale,
montre qu'il est supérieur à la Fortune. Cornelia, par son
amour conjugal, « lutte avec le destin ». Caton regarde
les périls de l'Afrique comme autant de bonheurs : « le
courage aime les épreuves ». Même des comparses, tels
que les soldats de Vulteius, se réjouissent d'être placés dans
des circonstances propres à manifester leur énergie. Ce
que le vulgaire appelle « mal » n'est donc pas un mal, ou
plutôt c'est le bien suprême.
Il est à peine besoin de remarquer combien de pareilles
idées sont en harmonie avec les enseignements que Lucain
a reçus de ses maîtres, et notamment de son oncle. Les mots
de Pompée ou de Caton, que je citais tout à l'heure, sont
une illustration des préceptes contenus dans le De prouidentia.
Chez les deux écrivains se retrouve la même façon
haute et fière, de résoudre le problème du mal en niant la
donnée essentielle du problème. Expiation pour le vice ou
épreuve pour la vertu, le mal apparent n'est qu'une condition
du bien (1).
(1) On peut faire remarquer ici l'excuse que le poète accorde aux guerres
civiles en tant qu'elles préparent l'avènement de Néron (1, 33-45). Il serait
peut-être imprudent d'en tenir compte pour expliquer la philosophie de
Lucain, à cause du caractère « officiel » et courtisanesque de ce passage.
Cependant, on y doit noter au moins l'affirmation que le destin fait servir le
mal à des fins qu'il sait bonnes.
Ainsi se rétablit l'équilibre qui semblait rompu entre la nature matérielle et le monde humain : là, le plan providentiel s'offre à tous les yeux ; ici, il est plus masqué, parce que nos passions en contrarient momentanément le cours harmonieux, mais il n'en existe pas moins. L'homme a beau s'agiter : le destin trouve sa voie, et cette voie est bonne. Sur ces deux points capitaux, l'adhésion de Lucain au stoïcisme me paraît indiscutable.
§3.
Nous avons jusqu'ici considéré le destin et l'homme dans
leurs rapports naturels, normaux,en quelque sorte rationnels.
Mais ne peut-il y avoir entre eux une relation à la fois plus
intime et plus mystérieuse? par le moyen de pratiques définies,
certains êtres humains ne peuvent-il parvenir, soit à
connaître d'avance le sort, soit peut-être même à le modifier
?cette question de la divination et de la magie était une
des plus discutées chez les stoïciens : Lucain y est revenu
assez fréquemment pour qu'il vaille la peine de déterminer
quelles sont ses opinions à cet égard, et à quelle école il se
rattache.
Nous ne sommes pas très renseignés là-dessus par la fin
du Ier livre, tout entière consacrée pourtant aux présages qui
annoncent la guerre civile. Là, en effet, le poète trace
une description purement objective, sans donner son avis
personnel, en se conformant à l'opinion courante ; il constate
plus qu'il n'explique ou ne discute S'agit-il d'énumérer
les signes néfastes fournis par les météores célestes, par les
naissances monstrueuses, et par les bruits surnaturels?
il dresse une liste analogue à celles qu'on lisait en si grand
nombre chez les anciens chroniqueurs et chez Tite-Live.Pour
les cérémonies expiatoires, le sacrifice de l'haruspice étrusque
Arruns, l'examen des entrailles de la victime, il suit les indications
des rituels (1), de même qu'il suit celles des traités
astrologiques lorsqu'il fait parler Nigidius Figulus (2).
(1) Luc., 1, 584-638. Il est impossible de savoir à quel rituel le poète a pu s'adresser. Les cérémonies qu'il décrit n'offrent aucune particularité notable.
(2) Luc., 1, 639-612. Pour la théorie astrologique, Lucain s'est sans doute
documenté dans un traité spécial, et ne s'est pas contenté des connaissances
répandues dans tout le public. Si en effet sa science n'était pas fraîchement
acquise, il ne prendrait pas tant de plaisir à l'étaler, comme il le fait ici, sans
aucune utilité, à propos de Saturne et du déluge, du Lion et de l'incendie. On
peut noter que la mention d'un maître absolu de Rome (v. 670) concorde avec
l'horoscope tiré par Figulus pour le futur.
Enfin,
l'épisode ou il dépeint une femme atteinte de délire prophétique est calqué sur des scènes d'hystérie et d'extase que les
historiens avaient souvent eu à enregistrer. Il pourrait
être pour son compte incrédule à la divination, et cependant
parler de ces divers faits presque dans les mêmes termes.
Toutefois, il n'est pas sans intérêt de remarquer l'ordre
dans lequel se succèdent les parties de ce récit. C'est d'abord,
enregistrés tels quels, et comme à l'état brut, les phénomènes
extraordinaires qui effraient le public romain, puis
les prédictions que font à ce propos, l'un après l'autre,
Arruns, Figulus et la matrone en délire. Ces trois prédictions
sont en gradation : elles deviennent de plus enplus précises.
Arruns déclare simplement qu'il se prépare des maux atroces
sans dire lesquels; c'est ce que le poète appelle « envelopper
et cacher les présages dans de nombreux détours ».
Nigidius Figulus, après avoir commencé par des paroles
presque aussi vagues, finit par reconnaître que le fléau
redouté est une guerre, aboutissant à la tyrannie. La
matrone, beaucoup mieux instruite, trace à l'avance le résumé
de la guerre civile : elle voit Pharsale, la mort de Pompée,
les batailles de Libye et d'Espagne, le meurtre de César en
plein sénat, et le combat de Philippes, ou du moins elle
désigne tous ces drames par des noms géographiques facilement
reconnaissables. Tous ces prophètes n'ont donc pas la même netteté dans ce qu'ils annoncent, mais ils n'usent pas
non plus des mêmes moyens pour connaître l'avenir : Arruns
se sert de procédés matériels routiniers, tels que l'inspection
du foie de la victime ; Figulus interroge les astres, qui,
d'après les stoïciens, sont des êtres divins; enfin, la matrone
est directement inspirée par Phébus, qui, ainsi qu'on le sait,
n'est pour Lucain qu'une incarnation ou une émanation de
l'âme du monde. De ce rapprochement, on peut conclure que la vision anticipée des choses est d'autant plus claire et plus
sûre qu'elle est due à une communication plus immédiate
avec la substance divine. Cette conclusion n'a rien qui heurte
les idées les plus répandues chez les anciens, et elle s'accorde
parfaitement avec la doctrine stoïcienne.
Cette idée d'un contact intime entre le dieu suprême et
les humains doués de pouvoir prophétique, est ce qui donne
tant d'intérêt à la partie du livre V où Lucain nous montre
Appius allant consulter l'oracle de Delphes. Cet épisode
n'a pas toujours été bien compris; M. Souriau s'en est fort
égayé notamment, en reprochant au poète d'avoir dépeint la
Sibylle Phémonoé sous un jour presque ridicule : elle a
recours à une ruse de comédie pour ne pas répondre, puis
tombe dans un accès d'hystérie, et finit par une réponse à
double entente, qu'elle aurait pu aussi bien donner tout de
suite. Voilà, je crois, une critique fort peu justifiée :
Lucain s'applique au contraire à serrer de très près la vérité.
Si la prêtresse cherche à se dérober, d'abord en prétextant
que l'oracle est devenu muet, et ensuite en simulant un
faux délire, c'est qu'elle a peur du délire véritable : cette
crainte est très explicable, et on la retrouve fréquemment
signalée par les auteurs anciens. L'inspiration est une
fatigue, une souffrance, parfois une menace de mort. En
montrant la Sibylle épouvantée par l'approche de l'épreuve
cruelle, Lucain ne fait que se conformer à la tradition. Il s'y
conforme encore pour le tableau qu'il trace de la fureur prophétique,
tableau si précis qu'il est aisé d'y reconnaître les
signes caractéristiques d'une crise physiologique : la bouche
écumante, les gémissements, les paroles entrecoupées,
les yeux tantôt terrifiés et tantôt menaçants, le visage
pâle avec des rougeurs brusques, les soubresauts convulsifs qui s'apaisent peu à peu, l'évanouissement final. Il
n'est pas certain que le poète ait eu sous les yeux une scène
de ce genre, mais il en a trouvé la notation exacte chez ses
prédécesseurs, et a eu le mérite de la recueillir fidèlement.
Quant à la parole à double sens par laquelle la prêtresse
annonce à Appius sa mort prochaine, l'histoire des
oracles est pleine de ces réponses ambiguës. Lucain ne procède
donc point ici en peintre fantaisiste : il représente la
consultation de Delphes comme elle a pu se passer, comme
d'autres, du même genre, se sont passées.
Mais, s'il respecte les données traditionnelles relatives à
l'oracle d'Apollon Pythien, il y ajoute quelque chose : un
essai d'explication philosophique. Il se demande comment
un dieu peut consentir à s'enfermer dans une caverne souterraine,
et à supporter le contact des humains ; il se
tire d'affaire en invoquant les principes de physique de son
école : une partie du dieu universel se mêle à la terre pour
la gouverner, et ressort par l'antre de Delphes pour se réunir
à la partie céleste. La solution peut paraître obscure,
mais il y a là une application curieuse d'une méthode qui
est générale chez les stoïciens, et qui consiste à interpréter,
à transposer en langage métaphysique ou scientifique, les
croyances religieuses de la foule, à voir, derrière un miracle,
une loi du monde. Lucain se pose bien d'autres questions
à propos de l'oracle. Il ne sait pas si le dieu de Delphes
lit dans le destin, ou bien s'il crée le destin en le prédisant. Il ne sait pas non plus pourquoi Apollon refuse
de faire connaître à Appius l'issue de la guerre : est-ce que
les destins ne l'ont pas encore décidée, ou est-ce qu'ils
veulent qu'elle soit inconnue pour qu'elle puisse se produire
plus sûrement (1)?
(1) Luc., V, 198-208. On notera au passage qu'en cet endroit Lucain parle des astres comme décidant de la destinée.
Il se borne, sur ces sujets, à dresser des
points d'interrogation, et il ne peut guère en être autrement. Mais sa curiosité même prouve un esprit habitué à
méditer sur les problèmes qu'agitent les philosophes. Où
il est, en revanche, très affirmatif, c'est lorsqu'il signale le
caractère bienfaisant de l'oracle de Delphes. Cet oracle est
largement accessible à tout le monde, comme le sont
en général les bienfaits des dieux, et comme le sage doit
s'efforcer de l'être aussi. Il ne nous refuse que ce qui
peut nous être mauvais : il n'autorise point les voeux insensés
de la passion et de l'égoïsme. Mais il vient en aide
aux justes qui souffrent, leur indique comment ils pourront
détourner une guerre ou guérir un fléau. En un mot, son
silence est le plus grand malheur du siècle de Lucain. Là,
comme en beaucoup d'autres endroits, se manifeste la tendance
optimiste que le poète doit à son éducation stoïcienne.
Un des grands arguments que les stoïciens donnaient en
faveur de la divination était celui-ci : les dieux n'ont pu,
étant bons par nature, refuser aux hommes une connaissance
de l'avenir qui leur est utile. Leur est-elle vraiment utile?
Lucain en doute quelquefois. Lorsque les choses futures
s'annoncent trop sombres pour ne pas être décourageantes,
il supplie les dieux de les cacher à la vue des mortels.
Mais cette impression d'abattement n'est que fugitive : en
thèse générale, il admet, comme ses maîtres, que l'humanité
a intérêt à savoir le sort qui lui est réservé; à ce titre,
l'oracle de Delphes lui paraît une marque éclatante de la
bienveillance céleste.
En somme, on peut dire qu'il étudie cet oracle comme les
phénomènes de la nature. S'il n'en rend pas et n'en peut pas
rendre un compte minutieux, s'il pose à son sujet des questions
vouées à rester sans réponse, il en définit avec certitude
et la cause et la fin. La cause, c'est une émanation de la
substance divine répandue dans tout l'univers. La fin, c'est d'apprendre aux hommes ce qu'il leur est bon de savoir.
Apollon dérive de l'âme du monde, et travaille au bien du
monde. A la fois panthéiste et optimiste, l'explication que
Lucain donne des oracles est en tout point stoïcienne.
En étudiant, après l'épisode de la Sibylle de Delphes,
celui de la sorcière thessalienne Érichtho, nous passons
d'un culte public et officiel à des rites secrets, suspects,
prohibés, ou, pour parler comme les anciens, d'une « religion
» à une « superstition ». Ce récit, dont le curieux pittoresque
a frappé presque tous les critiques, nous apprend-il
quelque chose sur les opinions de Lucain? quelles sont ses
idées au sujet de la sorcellerie? et d'où lui viennent-elles?
Il n'y a pas lieu de rechercher où il a pu se documenter en
ce qui concerne les miracles des magiciennes de Thessalie.
La longue liste de prodiges par laquelle il essaie de faire
ressortir leur puissance, n'est que l'amplification du vers
initial : « tout l'incroyable constitue leur art », amplifification
de pure rhétorique, fabriquée avec des souvenirs
fabuleux, des noms propres géographiques, et surtout
avec les inventions d'une imagination féconde. On sent
que le poète s'est demandé, pour développer sa matière,
quels phénomènes pouvaient être les plus contraires à
l'ordre normal des choses, et qu'il les a accumulés les uns
sur les autres, en se préoccupant seulement d'observer une
certaine gradation (1).
(1) Il commence par rappeler le pouvoir des magiciennes sur les sentiments humains; puis il les montre dominant même la nature matérielle (vents, fleuves, etc.), et jusqu'aux astres, qui, pour les stoïciens, sont les parties les plus divines du monde
Ses connaissances d'école et les réminiscences
de ses lectures ont pu aisément lui suffire pour
écrire ces soixante ou soixante-dix vers.
Je ne crois pas non plus qu'il faille s'arrêter sur la distinction
qu'il semble faire entre la magie et la nécromancie :
cette distinction ne me paraît correspondre à rien de réel. Les sorcières que nous montre la littérature antique, après
lui comme avant, chez Apulée aussi bien que chez Horace,
savent indifféremment user des charmes érotiques, des
incantations adressées à la lune, de l'évocation des morts,
etc. Si Érichtho se cantonne dans une « spécialité » unique,
celle de la magie funèbre, cela vient de ce que ce genre de
pratiques est regardé alors comme le plus effrayant et le plus
mystérieux de tous. Lucain nous le laisse entendre en
disant que la sorcière a répudié les procédés habituels de ses
compagnes comme trop innocents. Il a voulu présenter à
ses lecteurs ce qu'il pouvait concevoir de plus violemment
sacrilège, afin de porter au maximum l'effet d'angoisse et
d'horreur. Il a cédé à une préoccupation de pathétique, non
d'exactitude.
Il traite d'ailleurs les rites de la nécromancie comme ceux
de la magie ordinaire : il utilise pour les décrire les données
de l'érudition courante, celles que la poésie alexandrine et
l'enseignement des grammairiens avaient rendues familières
à tout le monde. Ainsi, dans la mixture préparée par la
sorcière, il fait entrer toutes les substances magiques
célèbres : écume de chien enragé, viscères de lynx, moëlle
de cerf, etc. Ainsi encore, pour définir son chant, il
énumère les cris de tous les animaux qui ont rapport à la
magie, chiens, loups, hiboux et chouettes, serpents, etc.
Le procédé est facile à saisir; il produit, par l'entassement
des détails, une impression assez forte : mais il ne permet
pas de supposer que Lucain, pour dépeindre ce tableau, ait
cherché des renseignements dans un ouvrage sur la
magie. En réalité, le problème qui se pose pour cet épisode
d'Erichtho, ce n'est pas celui de la documentation du poète,
mais bien celui de sa conception personnelle. Que pense-t-il
de la magie ?
Et d'abord y croit-il ? A priori, une crédulité de ce genre
nous paraît aujourd'hui très peu vraisemblable de la part
d'un esprit cultivé, encore moins de la part d'un philosophe.
Mais souvenons-nous des racines profondes que, chez les
anciens, la superstition a toujours gardées, même dans les
âmes en apparence les plus affranchies. Tel homme d'État
sceptique regardait comme un mauvais présage de prendre
son soulier droit pour le gauche. Les ouvrages les plus
sérieux de l'époque impériale, ceux des historiens et des
philosophes, les codes et les correspondances, concourent
à nous montrer tout le monde convaincu de la réalité du
pouvoir magique. Il est plus que probable que Lucain ne
s'est pas soustrait à cette foi unanime.
Ce qui me le fait penser, ce n'est pas la gravité qu'il met
à raconter les opérations surnaturelles d'Érichtho ou des
autres sorcières. Il pourrait, par artifice d'écrivain, simuler
une croyance qu'il n'a pas, mais qu'il juge propre à séduire
ou à frapper ses lecteurs. Mais alors, il la simulerait complètement;
il irait jusqu'au bout de la fiction ; il n'affaiblirait
pas, en les discutant ou en cherchant à les expliquer,
les prodiges dont il attend un puissant effet littéraire. Or
c'est ce qu'il fait. Précisément parce qu'il prend au sérieux
la croyance à la magie, il éprouve le besoin de la justifier à
ses propres yeux, de la concilier avec le reste de sa doctrine :
de là des réflexions, des hésitations, des restrictions, qui
ne sont peut-être pas très adroites au point de vue poétique,
mais qui n'en attestent que mieux sa sincérité.
C'est ainsi qu'après avoir énuméré une partie des miracles
accomplis par les magiciennes de Thessalie, il s'interrompt pour formuler des questions naturellement insolubles.
« Pourquoi les dieux se donnent-ils la peine d'obéir à ces
herbes et à ces chants, et pourquoi n'osent-ils pas les mépriser?cette soumission est-elle imposée ou volontaire? est-ce
la piété des sorcières, sont-ce leurs obscures menaces, qui
leur donnent tant de pouvoir? ont-elles droit sur tous les
dieux, ou seulement sur un dieu déterminé, qui à son tour
peut forcer le monde à faire ce à quoi on l'a forcé lui-même?
» Puis il reprend sa description, mais cette
courte parenthèse suffit à montrer son étonnement en présence
de ces faits merveilleux, trop réels selon lui pour qu'il
puisse les mettre en doute, trop anormaux pour qu'il lui
soit aisé d'en rendre compte d'après ses principes.
De toutes les difficultés que peut soulever la magie, la
plus grave, pour un stoïcien, c'est de l'accorder avec la
toute-puissance de la destinée. Lucain ne nous représente-t-
il pas les sorcières violant à chaque instant l'ordre de la
nature morale ou de la nature physique ? Grâce à elles
naissent des passions amoureuses que le destin n'a pas
voulues ; l'éther n'obéit plus à sa loi, les cascades ne
tombent plus, les fleuves remontent vers leur source.
C'est ce que le poète, en termes énergiques, appelle « faire
violence aux dieux » au « aux destins ». Mais, tout en
proclamant qu'elles ont ce pouvoir, on dirait qu'il a peur de
nous les montrer à l'oeuvre, comme si c'était trop déconcertant
pour son fatalisme philosophique. Érichtho dit bien
qu'elle pourrait ressusciter tous les morts : en fait, elle
n'en évoque qu'un seul, et encore un mort tout récemment
tué, qui n'a pas eu le temps de pénétrer dans les
enfers. Elle a soin aussi, pour rendre l'opération plus
facile, de l'exécuter dans une caverne aussi sombre que le Tartare, où les dieux infernaux puissent sans crainte
envoyer leurs sujets. Par toutes ces précautions, il est
sensible que le poète s'applique à diminuer le plus qu'il peut
toute dérogation aux lois ordinaires du monde. Croyant à la
magie, il n'ose en nier les miracles; croyant au destin, il
réduit ces mêmes miracles à leur strict minimum.
Ce problème le préoccupe si fort qu'il le fait traiter ex
professo par la sorcière elle-même : lorsqu'elle reçoit Sextus
Pompée, avant de consentir à sa prière, elle lui fait une
sorte de leçon, dans laquelle elle définit les limites de son
propre pouvoir. Nul doute qu'elle n'expose ici les idées du
poète, la solution qu'il a trouvée pour mettre en harmonie
ses deux croyances contradictoires. Ce credo se résume en
trois articles. En premier lieu, la magie peut changer une
destinée individuelle : si les astres ont décidé la mort d'un
homme, la magie peut le sauver, et inversement elle peut
couper dans sa fleur la vie qui devrait être la plus longue.
Ce privilège nous semble exorbitant ; mais notons bien
qu'il ne s'agit ici que de hâter ou de retarder un événement
fatal : c'est une chose, nous l'avons vu, que la volonté
humaine peut réaliser à la rigueur par les moyens ordinaires;
il n'est donc pas étonnant que la magie en soit plus
aisément capable. Quand il s'agit d'une destinée collective,
de celle de toute une armée ou de tout un peuple, alors
les magiciennes s'avouent vaincues : la Fortune est plus
puissante qu'elles ; elles doivent s'incliner devant le
déterminisme universel, devant « cet enchaînement de
causes qui descend de la première origine du monde ».
Cette confession est d'autant plus remarquable qu'elle n'est
nullement nécessaire : Sextus n'a pas demandé à la sorcière
de modifier le sort de l'empire romain; mais le poète saisit
l'occasion d'affirmer que, dans les cas graves, la destinée
est toute-puissante. Dans ces cas graves, il est vrai et ceci est le troisième point de la doctrine, la magie permet
au moins de connaître d'avance la décision fatale. Nous
sommes ramenés ainsi à la divination, dont la magie n'est
plus qu'une forme particulière.
Tel est le compromis par lequel Lucain arrive à croire à
la magie tout en la faisant rentrer tant bien que mal dans le
cadre du fatalisme stoïcien. Moyennant ces réserves, on
peut dire qu'il juge la sorcellerie possible, tout à fait d'accord
sur ce point avec presque tous ses contemporains.
Mais, comme les plus éclairés d'entre eux, il la juge
mauvaise et coupable. Il traite fort durement Sextus Pompée,
bien qu'il soit le fils de son héros, et les deux reproches
qu'il lui adresse méritent d'être relevés. Il blâme en lui,
d'abord, une curiosité maladive de l'avenir : c'est bien là
le langage d'un moraliste stoïcien, pour qui l'inquiétude,
comme toute passion, trouble l'âme et doit être réprimée.
Cette frayeur exagérée pousse précisément Sextus à une
seconde faute : elle lui fait mépriser les modes licites de la
divination, et le jette dans les pratiques sinistres de la
nécromancie. Par ce jugement, comme par les épithètes
que Lucain accole souvent aux actes des sorcières, on voit
qu'il condamne formellement leur art, non en tant que vain,
mais en tant que criminel.
Somme toute, il me semble que, sur cette question, les
opinions de Lucain, tout en étant sensiblement analogues à
celles des gens de son époque, n'offrent rien qui soit en
contradiction avec les doctrines stoïciennes. Il admet l'existence
du pouvoir magique, et le stoïcisme ne le lui interdit
pas; mais il en restreint le plus possible l'étendue, il
tâche de le concilier avec la prépondérance du destin, et, en
pratique, il le réduit à n'être guère qu'un procédé de
divination; enfin et surtout, il en blâme énergiquement l'emploi au nom de la morale et de la société. Je ne vois ici
aucune raison de le croire infidèle aux leçons qu'il avait
reçues.
Du rapprochement entre l'épisode de la Sibylle et celui d'Érichthose
dégage une conclusion : c'est que Lucain croit à la
possibilité de connaître l'avenir (1).
(1) A la divination par les oracles ou par la nécromancie, il faut ajouter la
divination par les songes. Les stoïciens l'admettaient. Lucain en parle fort peu:
Julia apparaît à Pompée et lui prédit sa défaite (III, 9-40);— Pompée doit
apparaître à son fils en Sicile (VI, 813-814) ; — enfin Pompée, à la veille de
Pharsale, revoit son triomphe passé (VII, 7-24). Ce dernier passage est le seul
où le poète s'explique un peu sur les rêves ; encore hésite-t-il entre trois explications
: ce rêve peut avoir été produit par un mouvement naturel de l'àme
(nous dirions : une association d'idées) ; il peut être un présage à rebours ; il
peut, enfin, être une faveur de la Fortune apitoyée par le malheur du vaincu.
Dans tout cela, aucune théorie bien ferme.
Il n'approuve pas indistinctement
tous les procédés utilisés dans ce dessein : il y en a
qui lui paraissent très louables, d'autres tout à fait odieux.
Mais l'idée même d'une prévision du sort futur ne lui répugne
pas. Au contraire, dans le IXe livre, son Caton se prononce
en termes très nets contre la divination. Sollicité par
Labienus de consulter l'oracle de Jupiter Hammon, il lui
répond dédaigneusement que ce n'est pas la peine; que le
sage n'a rien à apprendre des dieux, ayant en soi une
lumière naturelle bien préférable. Cette réplique, admirable
de fierté concentrée, est-elle en opposition avec les idées que
le poète a émises antérieurement?
Il ne servirait à rien d'épiloguer sur le fait que c'est Caton
qui parle, et non Lucain : il est trop visible que l'un et l'autre
ne font qu'un. Parmi tous les héros de la Pharsale, Caton est
celui avec lequel l'auteur s'identifie le plus volontiers. Immédiatement
après avoir apporté son entretien avec Labienus,
il va lui décerner les éloges les plus enthousiastes, le titre de
« père de la patrie ». C'est dire à quel prix il met les
opinions d'un sage aussi parfait. On ne peut ici invoquer la
distinction, ailleurs valable, entre l'écrivain et le personnage:
ce que l'un dit, l'autre, certainement, le pense.
Seulement il importe de bien comprendre les paroles de
Caton. S'il refuse d'interroger l'oracle d'Hammon, ce n'est pas qu'il croie ses réponses inexactes, c'est qu'il les juge
superflues. Que peut-on demander au dieu? dit-il en substance;
des règles de morale? mais le sage les trouve dans
sa conscience. Des renseignements sur les faits qui se
préparent, sur l'isssue heureuse ou malheureuse de la guerre?
mais est-ce que le sage a besoin d'en être informé? les
succès et les revers ne peuvent modifier en aucune manière
son attitude; sa vertu est au-dessus de ces contingences.
Nous sommes ici en présence, non plus d'une opinion métaphysique,
mais d'une idée morale, de l'idée morale la plus
essentielle du stoïcisme : le mépris des choses extérieures.
Mais nulle part Caton ne prétend que l'oracle soit incapable
de lui découvrir la vérité. Il ne se soucie pas de l'apprendre,
voilà tout, et il ne s'en soucie pas parce qu'elle se rapporte à
des faits qu'au nom de sa philosophie il proclame indifférents.
Par là se précise et se restreint l'antinomie qu'on a quelquefois
cru apercevoir entre les vers sur l'oracle de Delphes
et ceux qui concernent l'oracle d'Hammon. Lorsque Lucain
célèbre les réponses « utiles » données par Apollon à certains
peuples, il entend cette utilité au sens matériel et commun.
Avec Caton, au contraire, il parle le langage des
philosophes, et non plus des profanes : il ne peut plus être
question du même genre d'utilité, puisqu'iln'y a pas d'autre
bien que la vertu. Entre les deux épisodes, il y a, non
contradiction, mais superposition, et, si l'on y ajoute
l'épisode d'Érichtho, la hiérarchie se dessine nettement.
Sextus Pompée, c'est l'homme vulgaire, qui, dans sa passion
égoïste, recourt aux moyens les plus vils pour connaître
sa propre destinée. Les hommes d'État qui sont
venus consulter l'oracle de Delphes, ce sont les demi sages
qui travaillent honnêtement, mais non philosophiquement,
au bien-être de leurs concitoyens. Caton, enfin,
c'est le stoïcien accompli, qui déclare inutile tout ce qui ne
peut pas le rendre meilleur. Au fond, il en est de la divination selon Lucain comme il en est, d'après les maximes
stoïciennes, des richesses, des honneurs ou du pouvoir : il
est coupable d'en abuser, permis d'en user, et plus sage de
s'en abstenir.
Si maintenant nous essayons de résumer tout ce que le
poète a écrit à ce sujet, et de tenir compte des nuances parfois
délicates que nous avons observées, nous verrons que
son opinion n'est très radicale ni dans un sens ni dans
l'autre. Il ne rejette pas, tant s'en faut, l'art divinatoire : il
ne heurte ni les croyances de ses contemporains ni les
principes de l'école à laquelle il appartient (1).
(1) Les stoïciens ont été inégalement favorables à la divination, Chrysippe beaucoup, Panétius assez peu, Posidonius presque à l'excès. Mais tous l'ont admise, et expliquée comme une conséquence logique de leur fatalisme.
Mais il n'est pas non plus enthousiaste de la divination : il nous la montre recherchée seulement par des esprits ordinaires, tandis que les grandes âmes s'en passent; cela nous indique assez son penchant personnel. Par cette attitude en quelque sorte intermédiaire, il ressemble fort à son maître Sénèque. Dans toutes les matières théologiques, Sénèque est à peu près à égale distance des négations épicuriennes et des dévotions populaires, envers lesquelles bon nombre de stoïciens s'étaient montrés si complaisants. Il célèbre les dieux avec une grande piété : mais il raille l'idée que s'en fait le commun des hommes, et il n'aime pas même qu'on essaie de sauver la mythologie, comme l'avaient tenté ses prédécesseurs, à coups d'exégèse ingénieusement allégorique. Il pense que la Providence gouverne le monde ; il n'est pas de ceux qui, avec Lucrèce, se représentent l'univers abandonné au hasard: mais il ne veut pas qu'on rétrécisse cette idée de l'intervention providentielle, qu'on s'imagine que Castor et Pollux viennent nous sauver dans la tempête, ou que Jupiter lance lui même les traits de la foudre. Et, pour en revenir à la prévision des choses futures, il l'admet en principe, les présages étant fondés sur l'enchaînement nécessaire des causes et des effets : mais il se défie des applications puérilement passionnées qu'en font la plupart des hommes. Tel ou tel événement particulier, la mort de Séjan ou de Germanicus, est-il annoncé par des météores? il n'ose pas le nier, il ose encore moins l'affirmer, tant il lui paraît invraisemblable que les dieux puissent s'occuper de si petits incidents. Il semble bien prendre en pitié ceux qui guettent anxieusement les signes de l'avenir pour tâcher de les conjurer ; il leur rappelle que l'ordre du destin est immuable ; il consent que leurs sacrifices expiatoires puissent diminuer ou éloigner les périls; mais c'est une concession qu'il fait à leur faiblesse. Pour sa part, il met au-dessus de tout le sage qui ne s'inquiète et ne s'effraie de rien : ce sage là, c'est exactement le Caton de Lucain. On pourrait synthétiser à la fois la théorie des Questions Naturelles et celle de la Pharsale en disant que la divination est physiquement possible, mais moralement inutile. C'est ainsi que sur ce problème, si grave pour les âmes de cette époque, Lucain me paraît s'être docilement inspiré du stoïcisme tel qu'il le connaissait par l' intermédiaire de son oncle Sénèque.
§ 4.
Dans l'épisode de la magicienne, que nous examinions
tout à l'heure, Lucain est amené à parler de l'existence des
âmes après la mort. L'ombre du soldat choisi par Érichtho
pour son expérience nécromantique est représentée comme ayant fait un court séjour dans le monde infernal; elle
revient malgré elle à sa « prison » de chair, et raconte
ce qu'elle a vu sur les bords du Styx. En tout cet endroit,
le poète emploie le langage consacré des descriptions
mythologiques : il paraît accepter les données du
paganisme populaire plutôt que celles de l'enseignement
philosophique. En est-il toujours de même? Cette
question de la vie future est une de celles sur lesquelles ses
critiques lui ont reproché le plus de contradictions :
Heitland trace, de ses opinions sur ce point, un tableau
quelque peu confus. Tâchons, s'il se peut, de ressaisir sa
véritable pensée.
Ne nous laissons pas, pour commencer, induire en erreur
par les termes qu'il emploie. Son vocabulaire donne
lieu ici à une remarque analogue à celle que nous avons
faite pour les termes de « destin », « dieux » et « Fortune ».
Le langage poétique, tout comme le langage courant, comporte
une certaine indécision, et l'on pourrait se demander
si le flottement qu'on blâme dans la pensée de Lucain ne
vient pas en partie du flottement de sa phraséologie. Le mot
« mânes », par exemple, est pris dans la Pharsale, en deux
sens bien différents. Souvent il est synonyme de « cendres
» : c'est ainsi que le poète parle des « mânes » des
guerriers romains ensevelis en Thessalie, des « mânes »
des Ptolémées enfermés dans les Pyramides, des « mânes »
d'Hector que César est sur le point de fouler aux pieds,
et, à plusieurs reprises, des « mânes épars » de Pompée.
Quelquefois, au contraire, les « mânes » sont des ombres
ou des revenants : manes est joint à anima par une redondance
poétique ou bien il est dit que les « mânes » de Pompée habitent dans la cour de Ptolémée, voire même
dans le coeur de Pothin.
La même remarque s'impose à propos du mot « ombre ».
Il y a des cas où il paraît bien désigner les cendres, les
restes mortels, comme dans l'épisode de la visite de César
à Troie, ou dans les vers sur « l'ombre ensevelie » de
Pompée. Il y a d'autres passages où l'on a cru à tort
retrouver cette identification : quand l'ombre de Crassus
regrette que Pompée ne soit pas venu en vengeur de ses
cendres lorsque Cordus déclare heureuse l'ombre du
mort au bûcher duquel il emprunte du feu pour brûler les
restes de Pompée, lorsqu'enfin le poète proclame qu'il
ne faut pas avoir peur, en ramenant à Rome ces restes précieux,
de déranger l'ombre du héros, on ne peut pas dire
que l'ombre soit la même chose que les cendres; elle est en
quelque sorte liée aux cendres, elle en dépend peut-être,
mais elle en est distincte. Parfois, cette séparation est plus
nettement accusée : Lucain nous montre l'ombre de Pompée
ne restant pas attachée aux cendres qui gisent en Egypte ;
ou bien, à propos du soldat ressuscité, il distingue en termes
exprès l'ombre et le cadavre. Il est donc certain que,
s'il use quelquefois de mots identiques pour désigner l'âme
et le corps, il ne les confond pas ensemble : ce sont des impropriétés
de langage comme on en rencontre chez beaucoup
d'autres écrivains, et non des incohérences de pensée.
Ce point éclairci, reste une question bien plus importante.
Que devient après la mort cette ombre ou cette âme? continue-t-elle à vivre? où? et comment? Il y a des passages où la réponse que semble donner le
poète n'est autre que celle de la religion gréco-romaine.
J'ai déjà parlé de la description des enfers par le mort ressuscité; une autre peinture du même genre, quoique
plus courte, est faite par Julia lorsqu'elle apparaît en songe
à Pompée ; enfin peut-être faut-il y joindre quelques vers
du livre VII, où Lucain menace César d'être poursuivi par
les ombres de ses victimes jusque dans la nuit du Styx.
De pareils textes valent la peine d'être discutés, car s'ils
exprimaient la vraie croyance de leur auteur, il se trouverait
tout à fait en désaccord avec ses maîtres stoïciens. Ceux-ci,
aussi bien que les épicuriens, traitent de fables poétiques ou
de superstitions de bonnes femmes les contes relatifs à
Cerbère, à l'Achéron et auTartare. Cette énergique négation,
que Sénèque formule dans sa Consolation à Marcia, Lucain avait dû l'entendre répéter plus d'une fois dans son
adolescence, et il serait bien étrange qu'il lui eût été indocile.
Et en effet, sur les trois endroits que je viens de citer,
notons qu'il y en a deux où il use visiblement de fictions
poétiques, et où par conséquent ce qu'il dit ne doit pas être
pris au pied de la lettre. Les détails donnés par Julia à
Pompée font partie d'un rêve : on ne peut donc y chercher
l'expression des opinions personnelles du poète, d'autant
moins que le langage qu'il prête à Pompée aussitôt après
tend précisément à interprétér ce rêve comme une pure
vision, sans cause réelle et sans valeur. De même, dans
l'épisode d'Érichtho, dont la couleur romanesque ou poétique
est si reconnaissable, la croyance aux enfers est un
accessoire obligé de la magie : l'auteur ne peut pas avoir
l'air de douter des traditions mythologiques, sans quoi l'épisode
entier s'écroulerait. Mais, ce qui peut donner à croire
que sa conviction n'est pas bien profonde, c'est qu'il évite d'insister sur le monde infernal comme les poètes anciens
aiment à le faire. Reprenant ce thème si souvent traité
depuis la Nekyia de l' Odyssée, non seulement il n'y ajoute
pas de particularité curieuse et rare, mais même il évite la
description proprement dite. Son héros se borne à dire que,dans les Champs-Élysées comme dans le Tartare, tous les
Romains morts s'inquiètent et s'agitent à l'idée de la guerre
civile, et que Pluton prépare pour le crime du vainqueur
de nouveaux supplices. On voit par là que, même dans
ce lieu commun mythologique, Lucain porte ses préoccupations
nationales et morales, mais qu'au fond cette image
consacrée de la vie future ne l'intéresse pas beaucoup, sans
doute parce qu'elle lui paraît fausse et trop vulgaire.
Reste, il est vrai, l'apostrophe à César au livre VII. Mais
il faut la replacer dans le contexte. Lucain, après avoir blâmé
César de n'avoir pas rendu aux morts de Pharsale les honneurs
funèbres, ajoute qu'après tout, cela n'a pas beaucoup
d'importance : que ce soit la pourriture ou le bûcher qui
dissolve les corps, la nature les reçoit toujours dans son sein
paisible. Voilà une idée toute philosophique, toute opposée
aux préjugés populaires qui attachent tant de prix au
rite de l'inhumation. Le poète continue, sur un ton plus philosophique
encore, en invoquant le feu suprême, le feu cosmique,
qui brûlera également tous les hommes. Enfin, il
affirme à César que malgré son sacrilège, il ne pourra ni
être élevé plus haut dans les airs ni occuper une meilleure
place dans la nuit éternelle : et c'est alors, alors seulement,
que l'épithète de « stygienne », appliquée à la nuit, fait allusion
à la vieille mythologie. C'est sans doute bien peu de
chose, auprès de toutes les formules philosophiques qui
précèdent. S'il fallait interpréter littéralement ce stygia sub
nocte, il faudrait en faire autant pour le in auras qui précède,
et qui semble indiquer une migration de l'âme vers les régions célestes. Il est plus probable que Lucain a usé ici d'une
façon de parler traditionnelle, sans y mettre d'intention bien
précise. Une épithète pareille, en cet endroit, ne signifie pas
plus que, chez les poètes modernes, ne signifient tant d'expressions
restées païennes. Si Lucain ne rompt pas avec la
phraséologie mythologique, cela ne veut pas dire qu'il croie
aux mythes.
Rejette-t-il donc toute croyance à une existence ultérieure?
D'après M. Souriau et M. Lejay, il le ferait par
moments; il inclinerait vers la doctrine épicurienne. Je n'en
suis pas aussi certain, tant me paraissent douteux les passages
invoqués à ce propos. L'un d'eux est la célèbre exclamation
par laquelle Cornelia promet à son époux de le
suivre jusque dans le Tartare, si le Tartare existe : il est
bien clair que cette restriction dubitative ne s'adresse qu'à
la forme sous laquelle l'imagination populaire se représente
la vie future, mais non à la vie future elle-même. On cite
également le dilemme que Pompée emploie pour se rassurer
après avoir vu en songe son ancienne femme, et auquel j'ai
fait allusion un peu plus haut : «ou bien la mort ne laisse
aux âmes aucun sentiment, ou bien la mort elle-même n'est
rien ». La seconde hypothèse est celle de l'anéantissement
complet, mais la première, sous peine de se confondre
avec celle qui lui est opposée, ne peut avoir qu'une signification
: c'est que l'âme subsiste après le trépas, privée de
« sentiment », mais non détruite. Ce texte, ainsi entendu,
va peut-être nous aider à comprendre les deux autres passages
allégués. Lucain, pour maudire Crastinus, le soldat
qui a lancé le premier trait à Pharsale, lui souhaite, non la
mort, mais le sentiment après la mort : c'est donc qu'en
général ce sentiment n'est pas conservé par ceux qui ont
cessé de vivre? Plus loin, Cordus s'excuse auprès du mort
inconnu dont il profane le bûcher pour allumer celui de
Pompée, et le prie de lui pardonner « s'il lui reste, après la mort, quelque sentiment » : c'est donc qu'il n'est pas sûr
que ce sentiment subsiste? Il importe de remarquer ce que
le poète entend par ce mot de sensus : c'est surtout la sensibilité
prise en mauvaise part, la faculté d'être impressionné
par les choses mesquines et désagréables. Il semble bien que
cette faculté puisse être éteinte par la mort sans que l'être
tout entier soit anéanti.
Dira-t-on que nous prêtons à Lucain une distinction trop
ingénieuse? non, car la même façon de voir se retrouve
chez les stoïciens de son époque. Nul ouvrage, à cet égard,
n'est plus instructif que la Consolation à Marcia. Sénèque,
comme Lucain, bien plus que Lucain même, emploie d'abord
des termes qui feraient supposer, si l'on n'y prenait garde,
qu'il croit à la destruction totale de l'être par la mort : « on
ne peut pas être malheureux quand on n'existe pas » .
Mais, quelques pages plus loin, il s'explique mieux : la mort
prématurée est un bien, puisqu'elle permet aux âmes, délivrées
du contact humain, d'aller plus aisément retrouver les
dieux ; et voici que la Consolation se termine sur une vision
splendide, où le fils de Marcia est dépeint entrant dans la
région la plus élevée du monde, accueilli par son ancêtre
Cremutius, et initié par lui aux secrets sublimes de la
nature. Y a-t-il, entre cette conclusion radieuse et les
négations de tout à l'heure, l'antinomie qu on a voulu y
voir? je ne le crois pas. Sénèque prend soin de dire que la
mort n'anéantit en nous que ce qu'il y a de plus infime, le
corps, ou les souillures que le corps nous fait contracter, mais qu'elle laisse intacte, ou plutôt qu'elle
libère, l'âme jusqu'alors captive.
J'ai tenu à résumer ce très éloquent opuscule, parce qu'il
me paraît éclairer d'un jour fort net les opinions de Lucain.
Que la conception exposée par Sénèque soit plus ou moins purement stoïcienne, plus ou moins teintée de platonisme (1),
peu importe : toujours est-il que Lucain se l'est appropriée.
(1) Les ressemblances entre la conception de Platon et celle de Sénèque sont indéniables : toute la question serait de savoir si déjà, parmi les prédécesseurs stoïciens de Sénèque, quelques-uns n'avaient pas fait des emprunts au platonisme. D'autre part, dans cette Consolation à Marcia (26, 6), Sénèque tient à se montrer bon stoïcien : c'est pour cela qu'il parle de la destruction des âmes au moment de l'incendie universel; c'est une opinion de Chrysippe et de Cléanthe. En tout cas, chez Sénèque, la fusion des deux doctrines est accomplie.
Il n'est pas jusqu'à cette comparaison du corps avec un cachot qui ne se retrouve, même dans l'épisode d'Érichtho. Quant à la doctrine essentielle, celle de l'essor des âmes vers le ciel, elle a dicté au poète les admirables vers qui ouvrent le IXe livre, et célèbrent ce qu'on pourrait appeler l'apothéose de Pompée. L'âme du héros, aussitôt après le meurtre, va aux confins de l'air et de l'éther, dans la région sublunaire habitée par les mânes semi-divins ; là elle se repaît d'une lumière pure, contemple les planètes et les étoiles, et méprise la mesquinerie de toutes les choses humaines. Voilà bien, cette fois, la véritable doctrine de Lucain : elle est tout à fait analogue à celle dont son oncle s'inspirait pour consoler ses amis au lendemain de la perte d'êtres chers. Il est vrai qu'arrivé à ce point, Lucain complique un peu les choses : l'âme de Pompée revient près de la terre, voltige au-dessus de l'armée de César, va se fixer enfin dans le coeur de Brutus et de Caton. Quelques critiques ont à ce propos parlé de métempsycose. Hien n'est moins exact. On ne peut appeler de ce nom qu'une théorie d'après laquelle l'àme du mort vient animer un corps jusqu'ici dénué de vie. Lucain a eu l'occasion d'en dire quelques mots en résumant l'enseignement des druides: c'est une croyance qui ne lui déplait pas, mais qui lui demeure étrangère. Les vers qui terminent l'apothéose de Pompée s'expliquent bien plus simplement par le système stoïcien. Toutes les âmes humaines, étant des émanations de l'âme universelle, peuvent par là même communiquer les unes avec les autres. Celle de Pompée, débarrassée de son corps, est allée dans la région éthérée se retremper, se fortifier; elle a fait provision, si je puis dire, de cette substance divine, de cette ignea uirtus, dont est constituée son essence : à son tour, elle va apporter à ses amis restés sur terre un peu de la vigueur qu'elle a ainsi conquise. Par là achève de se caractériser la conception de la vie future dans la Pharsale. Malgré les incertitudes de vocabulaire que nous avons constatées, elle est plus nette qu'on ne l'a dit, et plus cohérente. Lucain se sert quelquefois, par nécessité poétique, des traditions fabuleuses; quelquefois aussi il a recours à des formules dubitatives qui conviennent en pareille matière : mais au fond il pense que les âmes ne meurent pas, qu'elles ne vont pas dans les enfers, qu'elles reviennent prendre contact avec l'âme éternelle et divine du monde. Autrement dit, il n'est ni païen ni épicurien, mais stoïcien, ou, si l'on veut platonico-stoïcien, mais enfin stoïcien de l'école de Sénèque.
§ 5.
Puisque Lucain est si fortement imprégné des idées
stoïciennes en ce qui concerne l'ordre du monde et la destinée
de l'homme, à plus forte raison a-t-il dû s'assimiler ce que le
stoïcisme a de plus essentiel, c'est-à-dire sa morale. Ce serait
une besogne aisée, mais aussi fastidieuse qu'aisée, de relever
dans la Pharsale toutes les sentences qui le montrent docile
aux prédications de l'école. Il me paraît plus important de
pénétrer un peu au delà de ces détails extérieurs, et de
chercher à retrouver chez Lucain les tendances profondes qui animent, par exemple, l'éthique de Sénèque. Ces tendances
me semblent être au nombre de deux principales :
le stoïcisme est une doctrine d'énergie et une doctrine de
désintéressement.
Une doctrine d'énergie doit avant tout déterminer la
source de la vigueur morale qu'elle exige. Pour Lucain,
comme pour tous les stoïciens, cette source réside dans la
conscience et la volonté de l'homme. Le sage, tout d'abord,
s'applique à mettre ses jugements et ses résolutions à l'abri
de l'influence de la Fortune. Voici comment Caton pose les
questions qu'il regarde comme les seules capables d'intéresser
un esprit sérieux : « Vaut-il mieux mourir libre en
combattant que de subir la tyrannie? la Fortune cesse-t-elle d'être menaçante quand on lui oppose la vertu? est-il
suffisant d'avoir un but louable? et le succès est-il incapable
d'accroître le mérite »? A toutes ces questions Caton répond
« oui », et il répond ainsi en consultant son sentiment intérieur,
révélation suprême et infaillible. De cette magnifique
profession de foi se dégagent deux conclusions : la
souveraineté de la conscience, et la séparation absolue entre
le domaine des choses fortuites et celui des actions morales.
C'est sur ce second point que Lucain revient le plus assidûment.
Lorsqu'il veut exalter Caton au-dessus de tous les
héros de l'histoire romaine, il commence par bien établir
son critérium : « S'il est vrai que la gloire ne s'achète que
par les vrais mérites, et que l'on doit regarder la vertu toute
nue, en élirninant le succès... ». Pompée se conforme à
la même règle morale, lorsqu'il invite Cornelia à ne pas
céder aux destins, à engager avec eux au contraire une
lutte où sa piété conjugale ne se laissera pas vaincre :
c'est la conception, tant de fois exprimée par Sénèque, qui
soustrait le monde de l'âme à la tyrannie de la destinée.
Nous touchons ici à une autre théorie, également chère à
Sénèque, celle de l'épreuve : j'en ai déja parlé à l'occasion du problème du mal. Je rappelle donc en deux mots les
plus frappants exemples : la joie orgueilleuse des soldats
de Vulteius à l'idée qu'ils sont appelés à faire leurs preuves
d'héroïsme, et l'âpre et belle formule de Caton, gaudet
patientia duris. Lucain est si intimement persuadé que
l'épreuve est une bonne chose, qu'à ses yeux elle reste telle
même quand elle est fatalement subie, et non librement
embrassée. « Ce qu'il y a de plus beau, dit Caton, c'est de
savoir mourir; ce qu'il y a de mieux ensuite, c'est d'y être
forcé ». C'est dans cette lutte incessante contre les difficultés
du sort que se trempe et se durcit l'arme du sage, la
volonté.
Elle doit lui servir surtout à mépriser les deux choses les
plus redoutées du commun des hommes, la pauvreté et la
mort. Nous sommes toujours, comme on le voit, en plein
courant d'enseignément stoïcien. L'inutilité du luxe, la
bonté d'une vie simple et frugale, Lucain la proclame aussi
haut et presque aussi souvent que Sénèque. A propos des
soldats de Petreius qui se désaltèrent dans l'eau pure du
pauvre pêcheur Amyclas, si tranquille dans sa cabane,
du roi Dejotarus, obligé de se déguiser en esclave pour être
en sûreté du culte sans faste de Jupiter Hammon, du
repas somptueux offert par Cléopâtre à César, il invective
la prodigalité de son temps en termes qui rappellent les
Questions Naturelles ou les tragédies de son oncle. Il
ne flétrit pas moins sévèrement cette crainte de la mort,
que Sénèque avait combattue avec une ardeur parfois
quelque peu emphatique. C'est, dit-il, la pire des craintes,
et il félicite les Gaulois d'en être exemptés par leur croyance
à une vie nouvelle : peu importe que leur opinion soit erronée, s'ils y puisent la sérénité et le courage. Il fait
émettre par un de ses personnages cet axiome indiscuté, que
« la mort n'est pas à redouter pour un homme ». La
même leçon se dégage, très forte et très noble, du récit qu'il
fait des derniers moments de Pompée et des réflexions qu'il
lui prête ; « La destinée heureuse de ta longue vie est
écoulée, se dit le héros; le monde ignore, tant que la mort
ne l'a pas prouvé, si tu sais également supporter le malheur.
Qu'on me déchire, qu'on me dépèce, je suis heureux quand
même; aucun dieu ne peut me l'ôter. Les prospérités de
la vie sont changeantes, mais dans la mort on n'est jamais
misérable ». Accepter la mort est bien : la désirer est
mieux. C'est par ce désir que le centurion Scaeva, un
soudard pourtant, et un césarien, redevient sympathique
aux yeux du poète. Vulteius est possédé du
même amour, ou, pour parler comme lui, de la même
« folie » ; il est tout entier « harcelé par l'aiguillon de la
mort prochaine »; il a découvert que c'est un bonheur de
mourir, et il est persuadé que les dieux font exprès de cacher ce
secret aux hommes : si on le connaissait, on n'aurait plus la
force de vivre. Cette soif de la mort avait été déjà
exprimée par Sénèque, mais ici elle a quelque chose de
plus sombre et de plus farouche. Elle conduit tout naturellement
au suicide, que Lucain, en bon stoïcien, non seulement
admet et justifie, mais exalte, parce qu'il est le
suprême défi de l'homme au destin.
Cette morale, qui impose à la volonté de chacun de si
intenses efforts, risque d'enfermer le sage dans un individualisme
exclusif : mais on sait que le stoïcisme lui propose
en même temps les fins altruistes les plus nobles et les
plus larges. On a dit quelquefois que, chez Sénèque, cet
aspect du stoïcisme est moins frappant, qu'il est « moins préoccupé de l'intérêt de l'humanité que de mieux tremper
l'âme de son sage ». Peut-être est-ce vrai quand on pénètre
au fond des choses; malgré cela, Sénèque est bien éloigné
d'omettre les beaux préceptes de son école sur la caritas
generis humani. Lucain ne les oublie pas non plus. Quand il
se représente la félicité que doit amener sur terre l'apothéose
de Néron, il place au premier rang des biens souhaités la paix
universelle : il espère que le genre humain, mettant bas les
armes, pourra songer à soi-même, que tous les peuples s'aimeront. Au plus fort des guerres civiles, il pousse un
appel désespéré vers la Concorde, salut du monde, vers
l'amour sacré de l'univers. Il souffre de voir les hommes
dépenser tant de peine à s'entre-détruire, alors qu'il leur
serait facile d'en faire un meilleur usage. Il le dit à l'occasion
des travaux de retranchement exécutés en Épire par les
césariens : avec tout l'effort déployé, on aurait pu combler
l'Hellespont, ou creuser le canal de Corinthe, de façon à
abréger la route des navires, ou améliorer quelque autre
partie de la terre. Ces vers sont curieux parce qu'ils nous
montrent, en même temps que la fin des Questions Naturelies, que l'amour de l'humanité ne reste pas, chez les
stoïciens de cette époque, une aspiration vague : il se précise
en dessein pratique et positif, en conception, déjà toute
moderne, d'un progrès industriel ou matériel.
Où s'unissent le mieux l'idéal individuel et l'idéal social
du stoïcisme, c'est dans le célèbre portrait de Caton. Il
est intéressant à plus d'un titre. D'abord il nous atteste que
Lucain partage l'opinion de son école, pour laquelle Caton
est un des sages parfaits, un « saint » véritable, le modèle
humain de la vertu, tandis qu'Hercule en est le modèle
mythique. Si l'on peut extraire des traités de Sénèque
une «imitation » de Caton, l'admirable page où Lucain a sculpté en un vigoureux relief cette grande figure, est comme
l'épilogue poétique de cette imitation. Il faut noter aussi
le soin qu'apporte l'auteur, en élève docile, à reproduire
exactement les formules techniques de son école : « garder
la mesure », «poursuivre son but », « suivre la nature »,
tous les préceptes stoïciens sont ici énoncés dans les termes
consacrés. Mais surtout Lucain réussit merveilleusement
à faire apparaître les deux traits que nous distinguions
tout à l'heure dans la vertu stoïcienne : au point de vue personnel,
le triomphe de la volonté; au point de vue collectif,
le sacrifice de soi. Caton n'a « ni affections ni haines »; sa
force d'âme résiste même à l'amour légitime; il est « dur »,
« immuable », sobre dans ses repas et dans toute sa vie; il
respecte la justice et observe rigidement l'honneur; tout
cela le rend parfait en soi-même. Mais il ne vit pas pour
soi : s'il est vertueux, c'est dans l'intérêt de tous; il déplore les malheurs de tout le genre humain; il
se croit né pour l'univers entier; il donne sa vie à son pays;
il n'est père et mari que pour Rome. Remarquons en passant
que Lucain ne met aucune opposition, aucune différence
même, entre deux devoirs qui, chez nous modernes, sont
souvent en antagonisme, je veux dire le devoir envers la
patrie et le devoir envers l'humanité. Il les mentionne à côté l'un de l'autre comme s'ils étaient identiques, écrit par
exemple patriae impendere uitam, et, au vers suivant, non
sibi sed toli genitum se credere mundo. Très certainement il
pense, avec Cicéron et avec tous les stoïciens, que nos
obligations de bienfaisance fraternelle vont en s'amplifiant
par degrés : de la famille à la cité, de la cité à l'univers,
notre amour s'étend sans cesse. Tous ces sentiments ne se
combattent point, ils s'aident bien plutôt, puisque tous arrachent
l'homme à l'égoïsme, et c'est justement par une
condamnation de l'égoïsme que s'achève le portrait de
Caton.
Cependant, si le devoir de solidarité humaine n'est pas douteux, les applications pratiques par lesquelles il se traduit
n'apparaissent pas toujours incontestables. Dans les
temps troublés, dans les époques de révolution et de guerre
civile, que fera le sage? se lancera-t-il au milieu des agitations
politiques? se renfermera-t-il dans l'étude méditative,
en se contentant de servir ses semblables par ses leçons et
ses exemples? C'est là le problème qui est au fond de la discussion,
si grave et si majestueuse, entre Caton et Brutus au
second livre de la Pharsale. Brutus incline vers l'abstention :
puisque les deux chefs rivaux sont aussi ambitieux l'un que
l'autre, puisqu'à prendre parti entre eux Caton risque de
compromettre sa dignité sans faire à l'État aucun bien réel,
il vaut mieux qu'il se retire dans sa sérénité philosophique,
imitant les astres, dont nulle tempête ne saurait altérer la
paix. Mais Caton, sans se faire d'illusion sur l'issue de la
lutte ni sur la valeur morale des combattants, s'accuserait
d'égoïsme s'il restait seul tranquille dans cette convulsion
universelle : il agira, et entraînera Brutus à l'action.
Ce débat célèbre n'est pas invraisemblable historiquement
: la question que traitent ici les deux héros s'était
posée, impérieuse et irritante, devant bien des gens sensés
d'alors. Elle avait dû aussi être souvent reprise dans les
exercices de l'école : il est à peu près certain qu'il y avait eu
des suasoriae de Caton à Brutus, de Brutus à Caton, d'un
ami à Caton, etc., pour et contre la participation à la guerre
civile. Mais, plus encore que l'écho de la vérité historique ou
des déclamations de rhéteurs, nous trouvons ici celui des controverses
de la casuistique stoïcienne. Le rôle politique du
sage était un des points de doctrine les plus débattus. Les
fondateurs de la secte, Zénon, Cléanthe et Chrysippe, avaient
conseillé à leurs disciples de se mêler à la vie politique, tout
en se confinant pour leur compte dans la plus calme neutralité,
si bien que leurs grands noms pouvaient être aussi justement
invoqués dans les deux sens. Dans les écrits de
Sénèque, on rencontre les deux opinions, selon les dates et les circonstances, peut-être aussi selon les correspondants
auxquels il s'adresse. Quand il voit Serenus trop indolent,
trop découragé, il lui prêche l'action, d'autant plus que
lui-même est très probablement alors au pouvoir, plein de
confiance dans l'avenir. Ailleurs, au contraire, il sacrifie
l'activité politique à la spéculation métaphysique ou morale:
dans les derniers chapitres du De breuitate uitae, dans le De otio, qui est un exposé systématique de la thèse abstentionniste,
et dans quelques-unes des Lettres à Lucilius, c'est-à-dire dans des ouvrages qui (à part le premièr) paraissent
bien être des dernières années de sa vie, de sa période de
disgrâce et de désillusion. Il y a en particulier une lettre
fort curieuse, celle où il réfute l'objection que l'on peut tirer,
contre sa doctrine négative, de l'exemple offert par Caton. Il
lui reproche amèrement de s'être amoindri en intervenant
dans la guerre civile : « Que fais-tu là, Caton? il ne s'agit
plus de la liberté : voilà longtemps qu'elle est morte. Toute
la question est de savoir si c'est César ou Pompée qui sera
maître de l'État : ce conflit ne t'intéresse pas ! » Ce sont
presque, avec moins de déférence, les paroles de Brutus
dans la Pharsale (1), et une telle similitude, à elle seule,
prouve combien ce cas de conscience civique était d'actualité
parmi les stoïciens du temps de Néron.
S'ils le formulent en termes analogues, Sénèque et Lucain
ne le résolvent pas de la même manière. Sénèque blâme
Caton, et Lucain lui donne le beau rôle, non seulement dans
cette discussion (2), mais dans tout son poème.
(1) En particulier, les vers 297-303 (sur les funérailles de la liberté) semble une une réplique du Caton de Lucain au « olim pessumdata est » de Sénèque.
(2) Lucain (II, 325) appelle « excessif» l'amour de la guerre civile que Caton inspire à Brutus ; mais, en supposant que nimios ne soit pas simplement un synonyme poétique de magnos, cette épithète peut s'entendre des conséquences que doit avoir pour Brutus son rôle dans les guerres civiles. Je ne crois pas du tout qu'elle implique un blâme
C'est que le
philosophe, vieilli, aigri peut-être, n'attend plus grand chose de la société et répugne à perdre son temps pour elle : le
poète, plus jeune, plus ardent, plus ouvert à l'espérance, n'a
pas encore cessé de croire à l'efficacité de l'action politique.
S'ils ont agité ensemble ce problème de morale sociale,
Lucain a pu en appeler du Sénèque désabusé de 63 au
Sénèque enthousiaste de 49 ; il a pu remémorer à son oncle
l'optimisme résolu du De tranquitlitate animi. Cet enseignement
donné à Serenus, le poète l'avait reçu aussi dans sa
jeunesse. Il y restait fidèle alors que son maître s'en détournait
sous la pression des circonstances, et il en symbolisait
l'esprit dans la personne de Caton.
Quoi qu'il en soit de cette divergence, peut-être plus apparente
que réelle, elle ne doit pas nous empêcher de
reconnaitre la conformité habituelle, presque constante,
entre les idées de Lucain et celles de son oncle. Qu'il s'agisse
du monde ou de l'homme, du destin ou de la divination, de la
vie ou de la mort, de la morale individuelle ou de la morale
sociale, Lucain nous apparaît toujours dominé par les souvenirs
de son éducation stoïcienne. Il comprend beaucoup plus
intelligemment qu'on ne l'a dit les principes essentiels de la
doctrine, et les reproduit sans toutes les incohérences et
contradictions qu'on lui a souvent reprochées. Je ne dis pas
qu'il soit un écolier anssi scrupuleux que Perse; mais, si l'on
veut bien ne pas s'appesantir plus qu'il ne convient sur
quelques impropriétés de langage, dues à la forme poétique
ou à la rapidité de la composition, on pourra, je crois, ramener
ses idées philosophiques à une origine assez simple : on
reconnaîtra en lui un disciple sincère, souvent éloquent, de
Sénèque, et, par Sénèque, du stoïcisme éclectique romain.
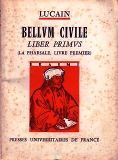
LES SOURCES LITTERAIRES
§ 1.
Si, après avoir étudié les faits et les idées que renferme
la Pharsale, on en examine la forme littéraire, et qu'on
recherche quelles influences elle a subies, on s'aperçoit
d'abord que, du côté de la Grèce, ces influences sont nulles
ou à peu près. Je ne crois pas qu'on puisse citer un seul vers
que Lucain ait directement emprunté à un poète hellénique,
sans que ce vers ait déjà passé par les mains d'un auteur
latin. Lorsqu'il reprend, en l'appliquant à César, la comparaison
homérique du lion furieux, il y a longtemps que
Virgile et bien d'autres l'ont traduite ou imitée. De même
l'association de Minerve et de Mars comme dieux du combat,
qui est rappelée dans le récit de la bataille de Pharsale,
est souvent mentionnée dans l' Iliade, mais les écrivains
latins ne l'ignorent pas non plus. L'action de la poésie
grecque s'est fait sentir sur la Pharsale par l'intermédiaire
des classiques de Rome, mais, d'une action immédiate,
aucune trace ne se découvre.
Il n'y a pas lieu non plus de se demander ce que les auteurs
romains archaïques ont pu fournir à Lucain. Une de ses
expressions, pectora remis pellere, est déjà dans les Annales d'Ennius (1) et ce n'est sans doute pas la seule :
mais une expression de ce genre est devenue certainement
un « cliché » de la langue poétique.
(1) ENN., Ann., VII.
N'oublions pas d'ailleurs
qu'à l'époque de Néron, les vieux écrivains n'ont pas encore
retrouvé la vogue qu'ils auront sous les Antonins. Il est peu
probable que Lucain en ait fait une lecture assidue. La vraie
source de son inspiration doit être cherchée dans des poètes
plus récents, ceux que l'on considérait déjà alors comme
classiques, les poètes du siècle d'Auguste.
Parmi tous ces poètes, c'est assurément à Virgile que
Lucain doit le plus. Il lui doit même beaucoup : ce fait, qui
peut surprendre à première vue, s'explique cependant pour
peu qu'on y réfléchisse.
Sans doute, l'Énéide et la Pharsale ne procèdent pas de la
même conception d'art, l'une baignant dans une atmosphère
héroïque et fabuleuse, où le merveilleux s'épanouit librement,
l'autre exposée au jour crû de l'histoire positive,
presque contemporaine. Sans doute aussi Lucain ne paraît
pas avoir professé pour son devancier une admiration bien
vive : la seule parole qu'il ait prononcée à son sujet, est, à
notre connaissance, une boutade irrévérencieuse (1), dont il
ne faut pas exagérer la hardiesse, mais qui n'en contraste
pas moins avec les déclarations enthousiastes de Stace et
avec les hommages dévots de Silius Italicus.
(1) C'est la phrase conservée par SUÉTONE : « et quantum mihi restat ad Culicem. » La plupart des commentateurs la prennent comme une ironie, et y voient une preuve de la vanité de Lucain. Suivant PLESSIS, elle doit être prise au pied de la lettre, comme un aveu modeste d'infériorité : mais cette interprétation est contredite par le contexte de Suétone. Lucain a bien réellement voulu dire que ses premiers essais n'étaient pas au-dessous du Culex. Seulement il a pu le dire en plaisantant (sa parodie d'un hémistiche de Néron décèle chez lui une verve de gaminerie un peu grosse), et surtout il l'a dit en songeant au Culex, et non à l'Énéide.
Pour tout dire
en un mot, Lucain n'est pas un disciple de Virgile. Mais,
s'il a eu une autre idée que lui de la poésie épique, et s'il
s'est probablement flatté de le dépasser par d'audacieuses
innovations, cela ne veut pas dire qu'il ne l'ait pas connu,
ni même qu'il ne l'ait pas goûté.
Il ne pouvait pas ne pas le connaître. Célèbres presque dès leur apparition, les ouvrages de Virgile avaient pris de
bonne heure dans l'éducation scolaire une place prépondérante
: ils étaient devenus les modèles acceptés, que les
grammairiens commentaient, que les rhéteurs pillaient à
l'occasion, que les apprentis versificateurs s'assimilaient le
plus complètement possible. Un brillant élève comme Lucain,
et surtout un élève tenté par la poésie, devait savoir par
coeur les Géorgiques et l'Énéide, et par suite, au moment de
faire oeuvre personnelle, même s'il voulait réagir contre
l'influence subie, il lui devenait extrêmement difficile de
l'éliminer, tellement elle s'était incorporée à lui. Il était trop
bourré de Virgile pour que des réminiscences virgiliennes ne
lui revinssent pas, quelqu'effort qu'il fît pour s'en défendre.
Mais au surplus rien ne prouve qu'il s'en soit défendu.
Il est fort possible que, tout en ne comprenant pas l'épopée,
dans son ensemble, comme son prédécesseur l'avait comprise,
il ait rendu pleine justice, dans le détail, aux beautés
de l'Enéide. Les goûts littéraires n'ont pas, Dieu merci,
une rigueur systématique. Par exemple Sénèque, qui n'appartient
certainement pas à la même école littéraire que
Virgile, l'admire beaucoup, le cite souvent, et avec complaisance.
Il est probable que les sympathies esthétiques de
Lucain ne devaient pas être très éloignées de celles de son
oncle, avec qui il avait tant de traits communs. On peut
donc, sans trop de témérité, lui attribuer, non pas un culte
superstitieux de Virgile, mais une compréhension respectueuse
et sympathique de ses mérites, une compréhension
qui n'exclut pas l'indépendance, mais qui se traduit par des
imitations intelligentes.
Ces imitations sont en effet nombreuses. Elles se répartissent
normalement entre les trois ouvrages de Virgile, je
veux dire proportionnellementà l'étendue de ces ouvrages.
Il est difficile, on le comprend, de dresser en pareille matière
une statistique rigoureuse, parce que telle analogie signalée
par un critique, et interprétée par lui comme un emprunt
voulu, peut très bien n'ètre qu'une coïncidence fortuite. Cependant, à prendre les choses en gros, on peut dire qu'il
y a dans la Pharsale trois ou quatre réminiscences des Bucoliques,
une quinzaine des Géorgiques, et une cinquantaine
de l' Éneide (1) : or, des Bucoliques, qui ne forment qu'un liber unique, à l'Énéide qui en compte douze, en passant par
les quatre livres des Géorgiques, la gradation est à peu près
la même. On notera que, des deux moitiés de l'Énéide, la
première a beaucoup plus fourni à Lucain que la seconde (2) :
(1) Les notes de l'édition Lemaire, que l'on peut prendre comme spécimen de la critique traditionnelle, mentionnent exactement 4 imitations des Bucoliques, 15 des Géorgiques, 51 de l'Énéide.
(2) D'après l'édition Lemaire, les livres I-VI auraient fourni 38 imitations, et les livres VII XII seulement 13.
mais cette disproportion, qui est de trois contre un environ, cesse d'être étonnante si l'on observe que Lucain, par son goût pour les cérémonies magiques et funèbres, devait être attiré tout spécialement vers les livres IV et VI; et, en effet, c'est dans ceux-là qu'il a puisé le plus. Cette réserve faite, il ne semble pas qu'il ait eu une prédilection marquée pour telle partie plutôt que pour telle autre dans l'oeuvre virgilienne. Il ne paraît pas non plus que son goût pour Virgile se soit modifié au fur et à mesure qu'il composait la Pharsale. Les différents livres de son poème, à part le second, présentent tous un certain nombre d'imitations des Géorgiques et de l'Enéide, un nombre qui n'est naturellement pas identique, mais qui varie assez peu (1).
(1) Voici les chiffres qui se dégagent des notes de l'édition Lemaire : 4 imitations dans le livre 1, 7 dans le IIIe, 11 dans le IV, 6 dans le Ve, 5 dans le VIe, 9 dans le VIIe, 11 dans le VIIIe, 10 dans le IX, et 7 dans le Xe. Encore une fois ces statistiques comportent une bonne part d'arbitraire, et ne valent qu'à titre d'indications approximatives
En somme, d'un bout à l'autre
de son travail, il a eu envers Virgile la même attitude. Mais on ne saurait s'en tenir à ces constatations tout
extérieures. Il faut voir le poète à l'oeuvre, pénétrer plus
avant dans les secrets de son labeur artistique, chercher à
quelles doses, selon les cas, se combinent l'imitation et
l'invention personnelle.
Tout d abord, il y a une série d'emprunts verbaux, formels,
mais isolés. Lucain prend chez Virgile un mot qui lui semble
caractéristique, et le transporte dans son propre vers. C'est,
par exemple, l'épithète de « phrygiens » appliquée aux
Pénates; c'est le terme de « flocons de laine » en
parlant des nuages ; le verbe squalere employé à propos
des champs, et celui de succendere à
propos de la trompette ; la personnification de la Mort ;
l'expression solis iniqui dans une périphrase qui désigne la
zone torride ; l'adjectif « silencieux », tacitus, joint au nom
du ciel ; les locutions toto diuisus orbe, subicere facem, refuso Oceano; la métaphore natare substituée
au terme propre, mergi, pour décrire des plaines inondées ;
enfin l'hyperbole de « royaume », regna, servant à peindre
avec une exagération volontaire un petit domaine rural .
Dans tous les passages que je viens de citer, l'imitation a le double caractère d'être très nette, mais de ne porter que sur
un mot ou un groupe de mots très court.
On peut ranger dans une catégorie toute voisine les fragments
de vers virgiliens qui se rencontrent par-ci par là chez
Lucain, commencements d'hexamètres comme felix qui
potuit; fins d'hexamètres comme caerula uerrunt;
hémistiches à peine modifiés, comme et nos rape in omnia
tecum, qui devient quem ducit in omnia secum. Quelquefois
un vers de Virgile est coupé en deux : par exemple, de iamque
faces et saxa uolant, furor arma ministrat, Lucain a tiré
deux morceaux, l'un presque textuellement semblable au
premier hémistiche, inde faces et saxa uolant, l'autre légèrement
altéré, inuenit arma furor. Il use d'ailleurs avec
discrétion de ce procédé, qui deviendrait vite fatigant et puéril
: il reste très loin de cette fureur de plagiat qui sévit
durant toute l'époque impériale, qui fait de maints poèmes
autant de mosaïques virgiliennes, et qui aboutit au Cento
Nuptiatis d'Ausone.
Même sobriété en ce qui concerne les membres de phrase
refaits d'après Virgile avec un démarquage insignifiant :
c'est encore un des moyens d'imitation en honneur dans la
littérature postclassique. Lucain y recourt une ou deux fois. Mais les passages aussi visiblement
copiés sont chez lui tout à fait exceptionnels.
D'ordinaire, son imitation n'est pas servile ni machinale,
mais toute pénétrée d'activité créatrice. Il transforme ce
qu'il emprunte, et, en cela plus peut-être que partout ailleurs,
affirme son besoin d'originalité.
C'est déjà une première marque d'invention individuelle
que d'adapter à de nouveaux sujets les expressions puisées
ailleurs. Voici, par exemple, la locution cauae cauernae : elle
a passé de Virgile à Lucain; mais Virgile entendait par là les
flancs sonores du cheval de Troie ; Lucain désigne de vraies
« cavernes », les souterrains de la forêt de Marseille. Virgile
avait dépeint les cheveux d'Hector souillés de caillots de
sang, concretos sanguine : Lucain applique une expression
analogue aux flots sur lesquels combattent Romains et Phocéens. Le terme fraudes innectere, qui avait dans l'Énéide un sens tout moral et métaphorique, en prend un beaucoup
plus matériel lorsqu'il s'agit des filets tendus par les matelots
ciliciens. Lorsque Junon lançait contre Vénus l'hyperbole
redondante, magnum et memorabile nomen, elle prononçait
ces mots sur un ton ironique : c'est avec un tout autre
accent que le césarien Vulteius se sert des mêmes adjectifs
pour exalter le courage de ses soldats. L'épithète fulua,
chez Virgile, qualifie le jaspe de l'épée d'Énée; chez Lucain,
les meubles en jaspe de Cléopâtr . Virgile avait parlé
de l'étoile « froide » de Saturne : Lucain transporte ce terme
aux glaces, qui sont sous la dépendancede cette planète. Dans tous ces passages, la réminiscence est incontestable,
mais elle ne s'est pas imposée automatiquement au poète : il
l'a contrôlée et dominée. Faisant servir à des fins nouvelles
les matériaux que sa mémoire lui apportait, il les a, en
quelque sorte, timbrés d'une empreinte bien à lui.
Cette empreinte personnelle apparaît encore mieux lorsqu'il
essaie d'améliorer en les remaniant les vers qu'il prend
à son modèle, de leur donner ce qui leur manque, à son avis,
en fait d'ingéniosité piquante. Quand il décrit l'ombre de
Crassus errant sans vengeance, il est probable
que ce vers lui a été suggéré par ceux où Virgile a représenté
la foule vagabonde des morts non ensevelis : mais l'épithète
de Lucain est bien plus particulière, bien plus curieusement
adaptée au cas spécial du mort dont il parle. Virgile avait
dépeint un attelage emporté qui « n'entend plus les rênes » :
Lucain pourrait dire de même qu'un navire « entend le gouvernail
», mais il préfère, en raffinant un peu, dire qu'il
« entend la main » du pilote. Virgile avait flétri le misérable
qui « vend sa patrie à prix d'or » : Lucain resserre cette
périphrase, y ajoute une antithèse entre Curion et les chefs
des partis, et arrive à cette formule tout à fait saisissante :
« tous ont acheté Rome, lui l'a vendue». Dans l'Énéide,
Panthus annonçait ainsi la chute de Troie : « Il est venu le
jour fatal, le temps nvinciblement marqué pour la Dardanie
» ; Lucain isole la première partie de cette phrase, et en lui
donnant un sens absolu, en renforce la valeur . Anchise montrait à Énée Camille rapportant
les enseignes prises : plus brièvement, Lucain emprunte une
épithète à la langue religieuse pour saluer reduces Camillos. Dans les Géorgiques, Virgile, animant la constellation
de la Grande Ourse, disait qu'elle « craignait de se plonger
dans les flots » : par une personnification analogue, mais
plus concise, Lucain parle, en un endroit, de l'étoile «qui craint le Nord », et ailleurs de celle « qui est à l'abri de la mer ».
Virgile, parmi les divinités égyptiennes, avait mentionné
l'Anubis aboyant : Lucain ne trouve pas cette désignation
assez frappante, et il écrit « des chiens demi-dieux ».
Virgile, enfin, célébrait la « vertu ardente » des héros privilégiés
que les dieux admettent parmi eux : Lucain veut marquer
davantage le dogme stoïcien de la parenté entre l'âme
humaine et le feu divin, et, à une épithète un peu vague, ardens,
il en substitue une beaucoup plus précise, ignea. Il arrive,
comme on le voit, à des expressions qui ne valent peut-être
pas mieux que celles de Virgile, mais qui sont plus conformes
à son goût propre, par leur rapidité, leur hardiesse ou leur
relief.
Parfois aussi il modifie les phrases virgiliennes sous l'empire
d'une autre préoccupation, celle de la grandeur. L'emphase
qu'on lui a tant reprochée, à lui et à son traducteur
Brébeuf, se décèle de cette manière en quelques endroits.
Par exemple, il n'est pas douteux que le tableau de l'attaque
des pompéiens contre Scaeva, au livre VI de la Pharsale,
ait été inspiré par celui de l'assaut livré à Bitias par les
soldats de Turnus; mais Virgile se contentait de dire que
Bitias était trop fort pour être tué par un javelot ordinaire,
et qu'il fallut, pour en venir à bout, une énorme phalarique :
c'est trop peu au gré de Lucain, et, contre son centurion
gigantesque, il appelle à l'aide, non seulement la phalarique
ou la pierre jetée du haut des murs, mais le bélier et la
baliste, ce qui ne va pas sans quelque excès. De même,
lorsqu'il songe aux soldats romains tombés en Thessalie, il
ne lui suffit pas d'évoquer, comme Virgile, le spectacle de
leurs ossements retrouvés par les laboureurs indigènes : il
ajoute : « Quand bien même nous retournerions tous les
sépulcres de nos ancêtres, on laboure encore plus de cendres
dans les sillons de la terre thessalienne ». Il est clair que la simplicité virgilienne lui a paru trop unie : de même que
tout à l'heure il y ajoutait des traits, des sententiae plus
aiguisées, ici il y ajoute des hyperboles plus amples et plus
sonores.
Dans tous les passages que nous avons étudiés jusqu'ici,
l'imitation porte sur les mots ou les tours de phrase, plus
ou moins fidèlement empruntés, plus ou moins heureusement
modifiés. Il y a des cas où, au contraire, Lucain
exprime des idées analogues à celles de Virgile, mais sans
recourir aux mêmes formes de langage. Telle est par exemple
son allusion à la Renommée, beaucoup plus courte d'ailleurs
et beaucoup moins mythologique que la description qu'on
lit dans l'Énéide. La fuite de l'ombre de Julia devant les
embrassements de Pompée rappelle celle de l'ombre de
Creuse, comme aussi la douleur du père qui assiste à la
mort de son fils rappelle celle d'Anna à l'agonie de Didon,
mais sans aucune ressemblance verbale. Le combat d'Hercule
et d'Antée a quelques traits assez voisins de celui d'Hercule
et de Cacus, mais là encore point d'expressions identiques
.
Quant à
la mention des flèches empoisonnées, ou du défilé
funèbre d'une armée autour d'un bûcher, à l'idée du
destin inéluctable malgré toutes les précautions de la prudence
humaine, ou à celle de la parenté entre le sommeil et la mort ou à l'invocation des « divinités vengeresses
», ce sont là des pensées tellement générales, tellement
voisines du lieu commun poétique, qu'on peut à peine
affirmer que Lucain ait songé, en les exprimant, à l'expression
qu'en avait donnée Virgile.
Il en va tout autrement de quelques passages où se trahit
sans aucun doute son désir de reprendre un thème, assez
étendu, déjà traité par son prédécesseur, et de l'enrichir de
traits nouveaux. Ainsi, lorsqu'il place au début de son poème
l'apothéose de Néron, il a à coup sûr dans l'esprit celle
d'Auguste au Itr livre des Géorgiques : la composition
générale du morceau, la grandiloquence des flatteries,
l'abondance des détails mythologiques et astronomiques, le
prouvent d'une façon indéniable. Cette ressemblance des
grandes lignes n'empêche pas l'originalité de l'imitateur de
se retrouver par quelque endroit. Tandis que Virgile offrait
au nouveau dieu le choix entre le rôle de Jupiter et celui de
Neptune, Lucain lui donne à opter entre les fonctions de Jupiter
et celles de Phébus : il y a là sans doute un souvenir de la
dévotion toute particulière que Néron, poète et artiste, devait
professer pour Apollon. De plus, Lucain supplie l'empereur
divinisé de ne pas se placer à un endroit d'où il ne
puisse voir directement sa chère Rome : ce souhait, quelqu'adulatrice
qu'en soit la forme, révèle cependant un certain
sentiment national. Enfin la prévision d'une ère de
paix universelle et de fraternité humaine, qui termine l'apothéose
de Néron, ne se trouve pas dans les Gêorgiques :
il est vrai que Lucain a pu en prendre l'idée dans la
IVe Églogue, mais elle est surtout inspirée par la morale
optimiste et philanthropique du stoïcisme. Il y a dans la
Pharsale une autre apothéose, celle de Pompée : elle rappelle
surtout celle de Daphnis dans la Ve des Bucoliques, mais
elle y ajoute une idée morale, très stoïcienne aussi, celle du
mépris que doivent provoquer chez les héros divinisés les mesquines grandeurs dont se repaît notre vanité terrestre.
Somme toute, dans ces deux passages, Lucain mêle
ensemble des inspirations toutes virgiliennes et d'autres plus
philosophiques, qui se marient du reste très bien aux premières.
Un autre morceau également imité de Virgile est l'énumération
des présages de la tempête au livre V de la Pharsale.
Presque tous les signes qu'indique le matelot Amyclas pour
détourner César de s'embarquer se trouvent déjà dans les
Géorgiques : l'aspect voilé et languissant du soleil, la pâleur
de la lune, l'attitude des divers oiseaux, plongeon, héron et
corneille. Seulement Lucain s'est appliqué à renouveler
les traits qu'il a choisis, en les enrichissant de particularités
curieuses : il note la direction divergente des rayons du
soleil, la démarche chancelante de la corneille et le geste par
lequel elle plonge de temps en temps sa tête dans les vagues
comme pour devancer la pluie. Ce ne sont que de petites
choses, mais c'est par ces inventions de détail que les
rhéteurs enseignaient à rajeunir une matière déjà bien connue.
Lucain use encore du même moyen en dépeignant après
Virgile le délire prophétique de la Sibylle, ce qui était un des
thèmes traditionnels de la poésie gréco-latine. Il conserve
les expressions les plus caractéristiques de son modèle :
comme lui, il compare la fureur de la prêtresse à celle des
Bacchantes; comme lui il décrit sa rage, sa respiration
entrecoupée, ses cheveux dressés d'horreur ;
comme lui il montre le dieu la secouant, la domptant, lui imposant à la fois l'aiguillon et le frein. Ce sont là,
d'ailleurs, autant de traits obligés dans un tableau de ce
genre. Mais il innove de plusieurs manières. D'abord, il
essaie d'expliquer le phénomène de l'inspiration fatidique,
ce que Virgile, moins philosophe et plus respectueux du mystère
religieux, n'avait point essayé de faire. En outre, il
imagine que la Sibylle, avant de vaticiner, essaie par toutes
sortes de ruses de déjouer la curiosité d'Appius, et cette fiction
lui sert, non seulement à reculer la révélation, mais à la faire
paraître plus énigmatique, plus troublante. Enfin, une
fois l'oracle énoncé, Virgile se contentait de mentionner
d'un seul mot le retour de la prêtresse à son état normal :
Lucain étudie bien plus minutieusement cette seconde phase
de la crise, que son devancier avait négligée.
A tout prendre, qu'il s'agisse de mots isolés ou de descriptions
plus vastes, l'imitation que Lucain fait de Virgile a un
aspect très typique. Elle est assez fréquente, sans l'être
autant toutefois que chez certains poètes de l'époque impériale;
mais elle n'est jamais routinière, et, le plus souvent,
elle laisse apparaître une originalité très forte. Le
poète trouve le moyen d'insérer dans ses emprunts même ce
qui lui tient le plus à coeur, je veux dire d'une part ses idées
de philosophe, d'autre part ses artifices de styliste subtil. Il
refrappe à son propre coin, bon ou mauvais, peu
importe, la monnaie virgilienne qu'il veut remettre en
circulation. Bien moins célèbre que Virgile, moins lu, moins pratiqué
dans les écoles, Horace devait forcément beaucoup
moins attirer l'attention de Lucain. C'est à peine si l'on peut
glaner sept ou huit réminiscences de ses oeuvres dans la
Pharsale, et toutes sont assez peu importantes.
Dans ce chiffre, déjà si faible, les Épodes, les Satires, et
les Épîtres entrent pour une part à peu près nulle. Il est probable
que, lorsque Lucain supplie la Fortune d'accorder à
Pompée au moins « le cercueil à bon marché des funérailles
plébéiennes », il reprend et délaie le vilis arca de la
VIlle Satire du Ier livre. Il est possible que l'alliance de
mots par laquelle il définit la fausse entente des triumvirs, concordia discors, provienne d'un vers des Épîtres (où elle a
un tout autre sens, philosophique et non historique) : encore
peut-on se demander si c'est bien chez Horace que Lucain l'a
prise, si ce n'est pas plutôt chez Ovide, qui lui-même l'avait
empruntée à Horace. Quant aux Épodes, on a remarqué
que l'Érichtho de la Pharsale, comme la Canidia d'Horace,
attend que les cadavres aient été mordus par les bêtes avant
de s'en emparer : mais cette analogie peut dériver de ce
que les deux poètes décrivent les coutumes magiques réellement
en usage, et non de ce que le second s'inspire du premier.
Restent les Odes, qui, par la nature des idées et du style, se
prêtaient un peu plus à être imitées par un poète tel que
Lucain. Elles l'ont cependant été fort peu. Je ne crois pas
qu'il y ait lieu de rapprocher l'Auster in sua régna furens de Lucain et le dux inquieti Hadriae d'Horace : l'idée que
l'Auster règne sur l'Adriatique est bien générale, et les mots
ne se ressemblent pas du tout. On peut plus légitimement
comparer les paroles des Marseillais, caelo solum
regnare Tonantem, avec le célèbre commencement de l'ode Caelo Tonantem, ou bien la bravade de Pompée, non
omnis cecidi avec le cri de triomphe d'Horace, non omnis
rnoriar. On voit par ces deux exemples que Lucain traite
Horace comme Virgile, c'est-à-dire qu'il l'imite très librement,
en poète original. Il semble bien qu'il ait voulu aussi
donner parfois aux expressions horatiennes, comme aux
virgiliennes, plus de précision et de finesse. Horace appelait
Rhodes « la brillante » : Lucain trouve sans doute cette
désignation trop sommaire; il la renforce en écrivant claram
sole Rhodon. De même Horace avait parlé de l'assaut
furieux, préparé par Cléopâtre contre le
Capitole : Lucain s'en souvient et rappelle en termes analogues
les projets de la reine; mais il accentue, par un
détail pittoresque, le caractère exotique de l'armée alexandrine;
la fin de son vers oppose curieusement le Capitole
romain au sistre d'Egypte.
C'est le même procédé que nous avons noté plus haut à propos
des emprunts faits aux Géorgiques et à l'Énéide : Lucain
l'applique plus rarement à Horace, parce que celui-ci l'intéresse
moins, mais, quand il le juge utile, il le lui applique
avec autant d'ingénieuse recherche.
§ 3.
Parmi les autres poètes du siècle d'Auguste, Ovide est le seul qui ait exercé sur Lucain une certaine influence. On ne trouve dans la Pharsale aucune réminiscence de Tibulle ni de Properce : au contraire, les souvenirs d'Ovide y sont assez nombreux, moins que ceux de Virgile, mais plus que ceux d'Horace (1).
(1) Ovide a fourni 15 ou 16 imitations, contre 1 ou 8 d'Horace, et 50 environ de Virgile.
Cela se comprend, puisqu'Ovide a été un
des auteurs les plus lus et les plus imités dans les écoles de
rhéteurs. Du reste, Sénèque le philosophe parait avoir eu
pour lui un goût assez vif : il le cite volontiers, et va même
jusqu'à commenter en un sens moral telle page de l'histoire
de Phaéthon. Il est tout naturel que son neveu et disciple
ait eu la même admiration pour un poète avec qui il possédait
plus d'une affinité de talent.
Cette admiration s'est portée de préférence sur les Métamorphoses, et ceci encore est très expIicable. A cause de leur
matière mythologique et de leur allure d'épopée, les Métamorphoses étaient regardées par les anciens comme une
oeuvre beaucoup plus considérable que les poésies amoureuses
de jeunesse ou les élégies de l'exil. Elles devaient
donc attirer davantage l'attention de Lucain, et de fait elles
figurent pour les deux tiers environ dans la liste des imitations
ovidiennes qu'on peut raisonnablement lui attribuer. Les Amours et les Héroïdes lui ont fourni aussi quelques
traits, les Tristes un seul, et les autres poésies pas du
tout.
Si maintenant on examine en elles-mêmes ces diverses
imitations, on voit qu'elles se répartissent en plusieurs
catégories, à peu près de la même manière que nous l'avons
observé en comparant Lucain à Virgile. En premier lieu, il
y a quelques expressions toutes faites, quelques « clichés »,
que Lucain reproduit tels qu'ils les a lus dans Ovide : liuor
edax ou pingues somni, par exemple, sont des formules
qui font partie de la phraséologie poétique courante
depuis que l'auteur des Amours les a employées, et peut-être
même auparavant. Il y a aussi des vers dont le début ou la
fin n'est que la répétition d'un hémistiche des Métamorphoses ou des Tristes. On ne peut douter que Lucain se souvienne d'Ovide, au moins inconsciemment, lorsqu'il commence un
de ses vers par ingentes animo ou par scinditur in partes, ou lorsqu'il le termine par canna intexta palustri ou par tamquam fortuna locorum. De même lorsqu'il
met un substantif et son épithète à des places exactement
correspondantes à celles qu'ils occupent dans des vers
ovidiens. Pour dépeindre l'agitation que les vents semblent communiquer
au ciel, Lucain dit que même les étoiles fixes paraissent ébranlées ; il y a là un souvenir probable du passage
des Métamorphoses où Phaéthon est comparé à l'étoile
qui, sans tomber du ciel serein, a l'air de tomber tout de
même, l'expression
de Lucain est plus rapide et plus forte. Ovide montre la
mer dressant ses flots, s'élevant presque jusqu'au ciel et
atteignant les nuages qu'elle mouille de son écume : Lucain
dit plus brièvement qu'elle est sur le point de se gonfler
jusqu'au niveau des astres; il condense la prolixité un peu
diluée de son devancier.
D'autres rapprochements mettent en lumière, en même
temps qu'une imitation indéniable, une ingéniosité vraiment
originale et parfois très heureuse. Pompée dit, en s'adressant
fictivement à César : te quoque si superi titulis accedere nostris
inserunt; le second hémistiche est textellement pris dans une des
Héroïdes.
Mais, tandis que la phrase d'Ovide est assez ordinaire, Lucain
essaie de la raffiner quelque peu; chez lui, ce n'est plus une
ville, c'est une personne qui est inscrite dans la liste des
titres de victoire.Lorsque la flotte de César est arrêtée par
un calme plat, les matelots se mettent à souhaiter la tempête,
« voeux nouveaux inventés pour une crainte nouvelle » :
cette antithèse rappelle le voeu de Narcisse dans les Métamorphoses . Ovide ayant
appelé Hercule « le vengeur du monde »,
Lucain détourne adroitement cette expression : il l'applique au destin qui délivre l'univers de la tyrannie d'Alexandre.
Chez Ovide, Hécube, après tous ses malheurs, reste muette,
« sa douleur dévore ses cris et ses larmes», Lucain se souvient
de ce beau vers lorsqu'il veut dépeindre le désespoir
refoulé des Romains à la nouvelle de la mort de Pompée;
mais il renverse en quelque sorte les termes; il dit que
« leurs gémissements dévorent leur douleur », o miseri
quorum gemitus edere dolorem. Enfin il est très vraisemblable
que le célèbre début de la Pharsale, plus quam ciuilia
bella, a été suggéré au poète par un vers des Métamorphoses,
mais, s'il en est ainsi, il faut reconnaître que Lucain a singulièrement
modifié le sens de ce mot : chez Ovide, il est
question de Neptune, qui, furieux contre Achille, déploie
une rancune incessante plus quam ciuiliter (c'est-à-dire, sans
doute, avec une violence despotique); de cette locution et
du terme ordinaire bella ciuilia, Lucain a tiré une expression
neuve, vigoureuse et éclatante.
Somme toute, l'imitation d'Ovide ne lui a pas nui. Il a
profité des ressources que lui offrait ce poète élégant et facile,
mais il s'est défié de ce qu'il y avait, dans cette facilité même,
d'un peu trop abondant et d'un peu trop mou. En face
d'Ovide plus encore que de Virgile ou d'Horace, il est resté
créateur, et sa création a consisté surtout à concentrer et
à fortifier.
§4.
La question de savoir si Lucain doit quelque chose à Manilius
est curieuse, comme toutes celles qui se rapportent à ce
poète sur lequel nous sommes si peu et si mal renseignés. Les Astronomiques sont un ouvrage que, dans les premiers
siècles de l'Empire, personne ne cite, et que personne, ou peu
s'en faut, n'imite d'une manière indéniable. Si Lucain faisait
exception, ce serait un témoignage tout à fait précieux pour
l'histoire de Manilius et de son influence. Mais je crains bien
que cela ne soit impossible à démontrer. M. Hosius l'a essayé entre les Astronomiques et la Pharsale, il a dressé une liste
de rapprochements assez nombreux, qui n'ont pas tous à ses
yeux une égale importance, mais qui lui semblent pour la
plupart prouver une imitation directe de Manilius par Lucain. Il est trop clair que la rencontre d'un ou deux mots dans
un hémistiche, sans qu'il y ait aucune parenté d'idée, peut toujours
être fortuite, et qu'on agit plus sagement en se privant
d'arguments de cette espèce.
Il existe d'autres passages dans lesquels la ressemblance
entre Manilius et Lucain est plus accusée, mais sans permettre
d'en rien déduire, parce que les deux poètes ont dû
s'inspirer d'un même écrivain antérieur. M. Hosius en donne
lui-même un exemple typique. Lucain termine un vers par
flammigeros Phoebi conscendere currus, et Manilius par aetherios
iussus conscendere currus. La réminiscence semble
certaine : mais, si l'on songe qu'Ovide a déjà employé la
même formule, conscendere currus, à la fin d'un hexamètre, qu'il ne s'agit plus que de trouver une épithète à
currus, et que deux auteurs ont pu trouver, l'un aetherios,
l'autre flammigeros, sans s'être consultés, la certitude de tout
à l'heure s'évanouit. Le même raisonnement peut s'appliquer
à d autres endroits. Les paroles de Lucain sur Cléopâtre
rappellent celles de Manilius, mais elles rappellent aussi
celles de Properce et d'Ovide. La comparaison de la douleur
avec une flamme qui ronge la moëlle, comparaison
commune à Manilius et à Lucain, peut leur venir de
Catulle; la description des astres qui glissent dans le
ciel peut avoir été empruntée par eux à Virgile.Quant
à la sententia sur Marius et Carthage se consolant entre
eux, comme on la rencontre chez Velleius, il est
probable qu'elle figurait déjà, soit chez Tite-Live, soit chez
quelque poète de l'époque d'Auguste, où Manilius et Lucain
l'ont prise chacun de son côté. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle est fort plausible, et je ne craindrai pas de la reprendre
à propos d'autres vers.
Manilius et Lucain établissent une antithèse entre la victoire
de Pompée sur les pirates et la piraterie exercée plus
tard par son fils Sextus : qui croira que cette antithèse ne
se soit rencontrée que chez eux? elle est invinciblement
suggérée par l'histoire, et, pour s'en priver, il eût fallu que
les écrivains antérieurs ne fussent pas imprégnés de rhétorique
comme ils l'étaient. De même pour les vers métaphoriques
où il est dit que le champ de bataille de Pharsale, lors
de la guerre de Philippes, n'était pas encore sec du sang
répandu : ce n'est que l'expression, sous forme imagée,
d'une association d'idées qui avait dû venir déjà à l'esprit
de plus d'un auteur. De même encore pour le récit des
exploits de plongeurs que les historiens avaient sans
doute retracés avant Manilius ; ou pour la description du
bûcher de Pompée formé par quelques débris de coques de
navires. Tout ce que nous lisons dans les Astronomiques et dans la Pharsale sur ces divers sujets, n'est pas plus de
l'invention de Manilius que de celle de Lucain : il faudrait
remonter bèaucoup plus haut pour découvrir la source véritable,
qui nous échappe aujourd'hui, mais qui n'en a pas
moins existé.
Enfin, à défaut d'influences particulières, n'y a-t-il pas
l'influence de la rhétorique ambiante, du lieu commun, du
« cliché », qui, s'exerçant de la même manière sur Manilius
et sur Lucain, a produit entre eux une certaine analogie
sans que l'un ait eu à pasticher l'autre? En relisant les vers
de Lucain où M. Hosius croit voir des traces de l'imitation
de Manilius, je suis frappé de leur caractère de généralité,
et, si j'ose dire, de banalité. Ce sont des plaintes sur la guerre civile où Rome se détruit elle-même, et où les
plus proches parents se font périr; ce sont des flatteries
à l'empereur, capable à lui seul de donner du génie à ceux
qui le chantent ; c'est une satire contre la cruauté du
conquérant qui verse le sang par plaisir, sans besoin ;
ce sont des allusions aux phénomènes astronomiques ou
aux cataclysmes cosmiques. Toutes ces idées-là font
partie de l'arsenal grand ouvert où les poètes de l'époque
impériale viennent s'équiper à qui mieux mieux. Si elles se
retrouvent, semblables au fond, chez deux écrivains, c'est
fort naturel : il n'y aurait de conséquence à en tirer que si
la forme était d'une très frappante analogie; mais, pour
Manilius et Lucain, elle n'est pas du tout identique.
Rien ne nous force donc à admettre que Lucain ait imité
Manilius : c'est une supposition simplement possible, rien
de plus. Elle se heurte même à deux petites difficultés, qui
ne sont très graves ni l'une ni l'autre, je le confesse, mais
qu'il faut pourtant signaler. Comme Manilius, Lucain parle
quelque part du vieux Romain Curius, qu'on alla chercher
près de sa charrue pour lui confier le pouvoir, mais il
lui donne le titre de consul, comme le fait du reste Ovide,
tandis que Manilius l'appelle dictateur : y a-t-il là l'écho de
deux traditions en léger désaccord? D'un autre côté, en
rappelant le goût des Grecs pour les exercices de la palestre,
Manilius y joint une preuve d'énergie; Lucain les qualifie au
contraire de paresseux à propos de ce même goût, ou du
moins les fait qualifier ainsi par César. Il y a là tout
autre chose qu'une imitation.
Sans vouloir aucunement exagérer l'importance de ces
deux remarques, la faiblesse des arguments de M. Hosius me
paraît suffisante pour infirmer sa thèse. Pas plus chez Lucain que chez n'importe quel autre écrivain de l'Empire,
il n'apparaît de traces incontestables de l'influence de Manilius.
Là où l'on croit la saisir, c'est plutôt celle des auteurs
imités par Manilius lui-même, et surtout celle des traditions
poétiques en honneur dans les écoles romaines. Il n'est pas
absolument impossible que Lucain ait lu les Astronomiques, mais nous n'en savons rien.
On sait que la littérature latine classique compte quelques
petits ouvrages, de date incertaine et d'auteur inconnu.
Lucain les a-t-il mis à contribution?A priori, ce n'est guère
probable. Autant il est naturel qu'il ait souvent imité les
grandes oeuvres déjà consacrées par l'estime publique,
autant on se le représente mal glanant péniblement çà et là
quelques bouts de vers dans des opuscules obscurs. Cependant
la chose n'est pas totalement impossible, et deux de ces
écrits au moins, l' Aetna et la Consolatio ad Liuiam ont pu
être confrontés, non sans intérêt, avec la Pharsale.
Entre la Pharsale et l'Aetna, M. Hosius a noté sept ou huit
similitudes. Aucune, à parler franchement, n'est probante,
et M. Hosius ne s'en cache pas; à plus forte raison, puisque
le fait même de l'imitation est douteux, la question de savoir
lequel des deux poètes aurait imité l'autre, ne peut être
résolue, et l'époque de la composition de l'Aetna reste aussi
indécise après ce parallèle qu'avant. Les deux auteurs sont plus voisins l'un de l'autre,
mais cela s'explique sans recourir à l'hypothèse d'un
emprunt : complere horrea et perdere uultum sont certainement
des expressions toutes faites ; les « pâles royaumes
de Pluton », et la « pluie précieuse » ou le « riche
nuage » de Danaé, sont des clichés mythologiques; enfin
l'idée que les dieux ne peuvent s'abaisser à des besognes
trop inférieures est une de celles que deux poètes philosophes
doivent rencontrer également, quand bien même ils
ne se connaîtraient pas. Ainsi, partout où Lucain et l'auteur
de l'Aetna se ressemblent un tant soit peu, cela semble bien
provenir de leur communauté de culture littéraire et philosophique.
Quant à la Consolatio ad Liuiam, elle ne présente avec la
Pharsale que deux ou trois analogies superficielles.
M. Hosius remarque aussi, après M. Haupt, quelques traits
communs dans la peinture que font les deux poètes du iustitium : mais ces traits leur sont suggérés par la nature meme de ce qu'ils decrivent. J'attacherais peut-être plus
d'importance a une autre reflexion de M. Hosius. L'un des
vers de la Consolatio sur le iustitium a exactement, non pas
le même sens, mais la même coupe qu un vers de la Pharsale.
M. Hosius croit à une imitation, et il ajoute que l'imitateur
doit être l'auteur de la Consolatio, parce que l'épithète
banale et pléonastique mutae a tout à fait le caractère d'une
cheville. Cela n'a rien d'invraisemblable, mais il est bien
possible également que les deux vers en question soient
tous deux calqués sur un vers de même rythme, écrit par
un poète antérieur.
Somme toute, ni l'Aetna, ni la Consolatio, n'ont exercé
d'influence appréciable sur Lucain : il est fort douteux qu'il
ait connu ces petits poèmes ; il est même douteux qu'ils
existassent lorsqu'il écrivait. Cette conclusion toute négative
est la seule qui se dégage de la comparaison.
§ 5.
Entre la Pharsale et les tragédies attribuées à Sénèque, la
comparaison présente un intérêt tout particulier. On peut se
demander si elle n'est pas susceptible d'aider à éclaircir la
question, tant discutée, de l'origine de ces tragédies. Il faut
pour cela observer attentivement les passages qui se correspondent
dans les deux textes, et, chaque fois, chercher
lequel des deux paraît avoir servi de modèle. Est-ce le poète
tragique qui a imité Lucain? alors, il devient difficile d'admettre
que ce poète soit Sénèque lui-même : Sénèque n'a pas
survécu à son neveu; il a pu connaître la Pharsale, mais
dans les derniers mois de sa vie, à un moment où il ne
semble guère avoir pu composer toutes les oeuvres dramatiques
mises sous son nom. Est-ce au contraire Lucain qui s'est inspiré des tragédies? en ce cas l'hypothèse de l'authenticité
devient plus probable. Il y a là, non un critérium certain, mais un indice de vraisemblance, qui n'est pas à
négliger. Malheureusement on ne peut le manier qu'avec
beaucoup de discrétion : s'il est aisé de voir que deux expressions
se ressemblent chez deux poètes différents, il est beaucoup
plus difficile de discerner chez qui elle est originale et
chez qui empruntée, sans compter qu'elle peut n'être originale
chez aucun des deux, mais avoir été empruntée par
tous deux à une source commune.
Il faut commencer par écarter un certain nombre de rapprochements que
les commentateurs ont indiqués, mais dont
on ne peut rien conclure. On a comparé la description de la
grotte d'Érichtho avec celle qu'on lit dans l'Oedipe latin :
elle lui ressemble, certes, mais très vaguement, pas plus
qu'à celle de l'antre de la Sibylle virgilienne. On a
comparé aussi l'allusion que fait Lucain au serment par le
Styx avec celle que présente Hercule furieux : mais il est
déjà question de ce serment dans Virgile, et dans Homère,
et partout. De même, lorsque Lucain parle du navire
Argo, ou des dracontigenae et de la Dircaea cohors, il
est superflu de rappeler Médée, Oedipe, et les Phéniciennes :
il s'agit de légendes extrêmement banales, et il importe
fort peu que deux poètes s'en souviennent également, à
moins qu'il n'y ait entre eux des ressemblances verbales
frappantes, qui, ici, n'existent pas. Avec les clichés de la
mythologie, il faut éliminer aussi ceux de la rhétorique. Au
livre V de la Pharsale, les soldats de César lui reprochent
d'avoir risqué témérairement son existence, alors que le
salut de tant de peuples en dépend : c'est, si l'on veut, la
même idée que dans les paroles d'Antigone à Oedipe : « Te
refuser la vie à toi-même, c'est la refuser à tous »; mais
c'est une idée très générale, un pur lieu commun, qui n'implique pas le moindre rapport de parenté entre les deux
textes visés. Enfin, il est très vrai que Lucain et l'auteur
d'Hippolyte emploient tous deux le mot compensare dans le sens de « abréger une route », que Lucain écrit
auspice Bruto comme l'auteur des Troyennes écrit auspice
Helena : mais ce sont là des mots qui n'ont rien de rare,
et dont deux écrivains peuvent fort bien user sans se copier
l'un l'autre.
Le cas n'est plus le même lorsqu'on est en présence
d'expressions plus caractérisées ou plus étendues. Il y a
notamment un certain nombre de vers de Lucain où se
trouvent rassemblés des mots qui, chez l'auteur tragique,
sont bien dans le même passage, mais un peu plus éloignés
l'un de l'autre. Dans Hercule furieux, Junon dit de son
ennemi Hercule : Nec iu astra lenta ueniet, ut Bacchus, uia,
iter ruina quaeret.
Les deux mots uia et ruina sont plus étroitement rapprochés
dans la célèbre formule de Lucain au sujet de César : gaudens uiam fecis.se ruina. Oedipe, dans la tragédie
latine, proteste ainsi contre les présages : Hoc me delphicae laurus monent,
aliudque nobis maiua indicunt scelus.
Est mains aliquod patre mactato nefas ?
Lucain exprime une pensée analogue au début du livre II,
lorsqu'il rappelle les prodiges par lesquels la nature annonce le sacrilège des guerres civiles : mais ici encore les
deux termes essentiels, indicere et nefas sont plus voisins
chez lui que chez le poète tragique. Ceci est peut-être
une présomption en faveur de l'antériorité de ce dernier. On
peut penser que chacun des vers de Lucain que nous venons
de citer est respectivement une « contamination » des vers
correspondants d'Hercule furieux ou d'Oedipe. L'hypothèse
inverse se comprendrait moins aisément.
D'autres rapprochements encore peuvent autoriser notre
supposition. Lucain et l'auteur d'Oedipe dépeignent également
les Bacchantes sur le sommet du Pinde.
Si l'on met en parallèle le vers des Phéniciennes,
recusantem manum pressere uoltus, avec celui de la
Pharsale, iugulis pressere manum, ce dernier paraît plus
concis. Dans Thyeste, il est question d'une forêt qui,
comme celle de Marseille, est en proie à des incendies spontanés
et mystérieux; l'auteur de Thyeste dit excelsae trabes
ardent sine igne : l'expression de Lucain, non ardenlis incendia
siluae, est plus brève, plus antithétique, et même un peu
plus énigmatique. Dans les Phéniciennes se trouve la
périphrase uitae bona proicere : Lucain dit plus rapidement
uitam proicere. Comparons enfin ce vers de la Pharsale : Quidquid fodit Hiber, quidquid Tagut expuit auri,
avec le passage analogue de Thyeste :
Non quidquid fodit Occidens,
aut unda Tagus aurea
claro deuehit alueo;
une fois de plus les deux textes énoncent la même idée avec
assez de ressemblance verbale pour que l'on doive croire à
un rapport direct entre eux: mais, chez Lucain, la phrase est plus concentrée, débarrassée de ses adjectifs oiseux, aurea, claro; à la place, le verbe original expuit lui donne
plus de pittoresque et de vigueur. En présence de tous
ces passages, deux explications sont logiquement possibles :
ou bien le poète tragique a eu sous les yeux les vers de la
Pharsale, les a imités, mais délayés et par là même affaiblis;
ou bien au contraire c'est Lucain qui a connu les vers tragiques,
qui les a repris en leur donnant plus de force, en
ramassant ce qui était diffus. De ces deux hypothèses,
aucune n'est invraisemblable; cependant la seconde me
paraît plus plausible. Elle s'accorde très bien avec les résultats
de la comparaison faite plus haut entre Lucain et Virgile,
Horace ou Ovide. S'il y a entre les vers de Lucain et
ceux de l'auteur, quel qu'il soit, des tragédies, la même
différence qu'entre ceux de Lucain et ceux des poètes classiques,
c'est, sans doute, parce que les conditions ont été
les mêmes dans les deux cas ; c'est parce que Lucain a eu
devant lui le texte d' Hercule furieux ou des Phéniciennes comme celui de l'Enéide ou des Métamorphoses, et lui a
appliqué les mêmes procédés d'imitation et de remaniement,
afin de revêtir ses emprunts d'une forme plus énergique et
plus nerveuse.
Quelquefois, au lieu de condenser les phrases qu'il imite,
Lucain les surcharge ; mais ce qu'il y ajoute est bien différent
des épithètes banales de remplissage que nous l'avons vu
supprimer tout à l'heure. S'il décrit, comme Sénèque dans
Oedipe, le cheval qui s'affaisse au milieu de sa course, atteint
par l'épidémie, il y joint un détail qui fait image, trernulo
poplite. Amphitryon, dans Hercule furieux, apostrophe
douloureusement « sa vieillesse trop vivace » : Lucain
reprend cette idée, la renforce par une métaphore, la
complique, et arrive à cette formule, " le destin vivace de la
lourde vieillesse". Un peu
plus loin, dans la même pièce, le choeur s'attendrit sur les enfants d'Hercule, sur ces ombres innocentes qui « au premier
seuil de la vie, ont été écrasées par la folie criminelle
de leur père » : dans le tableau des proscriptions, Lucain
montre de même les satellites de Marius qui osent « briser
la destinée naissante de malheureux enfants au premier seuil
de la vie ». Ces additions, un peu pénibles, mais propres
à augmenter la vigueur expressive de la phrase, sont tout à
fait dans le goût de Lucain.
En examinant ce qu'il doit à Virgile, nous avons vu qu'assez
souvent il change la destination des mots et des images qu'il
lui emprunte : il semble bien en avoir fait autant pour deux
passages de Sénèque le Tragique. Le choeur d'Oedipe, parmi
maints autres prodiges effrayants, signale le tremblement
de terre qui a secoué la neige du bois de Cadmus : dans le
Ier livre de la Pharsale,un phénomène du même genre est mentionné
en termes presque identiques, mais, cette fois, il s'agit
des Alpes et de leurs neiges éternelles; le miracle est plus
extraordinaire, plus grandiose, en même temps qu'il s'adapte,
par sa localisation géographique, à l'histoire romaine et
italienne. La nourrice de Médée se demande, en la
voyant furieuse, « où se déchargera le poids de son âme »,
Pompée emploie les
mêmes mots pour dépeindre à ses conseillers son état d'âme,
mais, au lieu de la colère, la métaphore symbolise ici l'inquiétude,
et peut-être avec plus de justesse. Sansdoute il n'est
pas impossible que Lucain ait trouvé du premier coup les
expressions que nous venons d'étudier, et qu'ensuite l'auteur
tragique les ait assez maladroitement transposées : mais je
croirais plus volontiers que Lucain s'en est souvenu pour les
avoir lues ou entendues, se les est appropriées, et les a fait
servir à des idées auxquelles elles lui paraissaient plus exactement
convenir.
Au-dessus de toutes ces analogies de détail, il y a deux
passages considérables qui appellent une confrontation précise
avec deux scènes, l'une d'Agamemnon, l'autre de Médée. Le premier est le tableau de la tempête qui assaille César
sur les côtes de l'Adriatique. A la vérité, rien n'est plus
commun qu'un tel sujet dans la poésie latine, et, que les deux
poètes l'aient traité, cela ne prouve absolument rien; que
même ils aient mentionné tous deux les vents qui soufflent
de tous les points opposés de l'horizon, ou la force particulièrement
dévastatrice du dixième flot, cela ne
signifie rien encore. Mais il y a, dans le cours de leurs descriptions,
plusieurs traits qui se ressemblent trop pour qu'on
puisse admettre une simple coïncidence, et presque toujours,
comme on va le voir, l'expression de Lucain semble une
reprise, avec plus de raffinement, de celle de l'auteur tragique.
Tous deux notent les tourbillons qui vont fouiller les
grandes profondeurs marines : mais l'auteur d'Agamemnon
se contente de dire que la mer est bouleversée jusque dans
ses abîmes, Lucain imagine une périphrase
plus curieuse, il montre l'Aquilon tordant les ondes
et faisant des sables les plus cachés autant de bas-fonds. Le
poète tragique remarque que la nuit n'est pas simple, nec
una nox est, mais redoublée par le brouillard : Lucain, lui
aussi, dit qu'il y a autre chose que la nuit ordinaire du ciel,
non caeli nox illa fuit, mais par là il entend, au lieu du brouillard,
les nuages blêmes, d'une pâleur infernale, qui pèsent
sur l'air ; la peinture est ainsi beaucoup plus forte et hyperbolique. Dans Agamemnon, la description se poursuit
par une comparaison, « on croirait que le noir chaos recouvre
l'univers » : Lucain s'empare de cette idée, mais pour la
rendre avec plus d'intensité, il personnifie la nature, et prétend
que, cette nuit-là, « elle a peur du chaos ». Joignons
à cela que, dans la Pharsale, les mouvements du bateau
sont analysés d'une façon très précise, ce qui n'a pas lieu dans la tragédie, et nous serons amenés à cette conclusion :
la « tempête en mer » est un vieux thème d'école; Sénèque
l'a amplifié avec une prolixité consciencieuse, mais souvent
banale; Lucain l'a traité à son tour, a imité plus d'une
expression, mais a tâché d'y apporter quelque chose d'un
peu rare et d'un peu neuf (1).
(1) Le vers 602, où Lucain montre l'eau ne sachant à quel vent elle doit obéir, peut être rapproché aussi d'un vers d'Agamemnon, mais dans une autre scène (140). Lucain améliore d'ailleurs la phrase de Sénèque en substituant à un verbe incolore " incerta dubitat aqua" un verbe pittoresque " dubium pendet aequor".
Nous arriverons au même résultat si nous considérons le monologue du IVe acte de Médée, une scène importante pour ce qui concerne l'histoire des croyances magiques. Lucain paraît s'en être souvenu en deux endroits du livre VI, d'abord dans les vers où il énumère tous les prodiges réalisés par les sorcières ; ensuite dans ceux où il fait parler Érichtho. Médée, chez Sénèque, se vante d'avoir amené la pluie par un ciel serein, Lucain, avec un peu plus de recherche, dit que les magiciennes peuvent faire venir des nuages même quand Phébus est ardent. Médée se glorifie d'avoir arrêté le cours des fleuves, et nomme, au hasard, le Phase et l'Ister : Lucain y met plus de précision, voire même de pédantisme; il prétend que les sorcières sont capables d'empêcher les inondations du Nil, les sinuosités du Méandre, aussi bien que la rapidité du Rhône et la lenteur de la Saône, accumulant exprès les particularités géographiques les plus spéciales. Médée rappelle les tempêtes qu'elle a excitées, sonuere fluctus, tumuit insanum mare, tacente uento : chez Lucain, la phrase devient uentis cessantibusaequor intumuit; elle est un peu plus rapide, relevée en outre par le rejet du verbe imagé intumuit ; puis, il ajoute que parfois aussi la mer est restée calme malgré le Notus, et que les voiles se sont gonflées contre le vent ; il pousse jusqu'au bout la logique de l'hyperbole. Quant à l'invocation qu'Érichtho prononce en commençant la cérémonie magique, elle ressemble beaucoup à celle de Médée, et l'on ne peut s'en étonner. Toutefois des différences subsistent. La prière de Médée est plus voisine de ce que l'on pourrait appeler la mythologie courante : les suppliciés classiques du Tartare, Ixion, Tantale, Sisyphe, les Danaïdes, y sont tous mentionnés. Lucain a l'air de préférer ce qu'il y a dans la tradition de plus obscur et de plus mystérieux : témoin les allusions à la mort des dieux, à la haine de Proserpine pour sa mère, à un gardien des enfers distinct du chien Cerbère. Il n'oublie pas non plus, même dans cet épisode merveilleux, ses idées philosophiques. La magicienne nomme tout d'abord dans sa supplication les divinités qui punissent le crime, elle nomme aussi le Chaos, et ne se contente pas, comme Médée, de l'appeler « le sombre Chaos » : elle lui donne une épithète qui provient en droite ligne de la cosmologie stoïcienne, « le Chaos avide de confondre les mondes ». C'est ainsi qu'en s'exerçant sur ce lieu commun de la conjuration magique, Lucain donne l'impression à la fois de s'inspirer de Sénèque et de s'en distinguer, là même où il s'en inspire, par une plus grande originalité de pensée ou de style. C'est là, je crois, ce qu'il est permis de retenir des observations qui précèdent. Assurément, il est impossible de démontrer d'une manière indubitable que les tragédies de Sénèque sont antérieures à la Pharsale. Cependant on peut dire au moins ceci : dans les endroits où il y a entre les deux textes des ressemblances de forme certaines, tout se passe comme si celui de l'auteur tragique était venu le premier, comme si Lucain l'avait connu, imité, retouché et raffiné. Cette conclusion, que je ne veux pas donner pour plus rigoureuse qu'elle ne l'est, a néanmoins le double intérêt, d'abord de rendre plus probable l'attribution des tragédies à Sénèque, ensuite de nous faire mieux comprendre le travail artistique de Lucain.
§6.
Si les poètes latins, ou, pour parler plus exactement, si
certains poètes latins ont eu sur Lucain une influence réelle,
quoique limitée, il ne paraît pas devoir grand chose (en tant
qu'écrivain, et abstraction faite des événements et des idées)
aux auteurs en prose. Il les a connus, du moins les plus
grands et les plus classiques; mais la part que leurs ouvrages
ont eue dans la formation du style de la Pharsale est assez
réduite.
Par exemple, il n'est pas douteux qu'il ait lu et pratiqué
comme tous les jeunes gens de son temps, les discours de
Cicéron, mais il serait difficile d'en retrouver des imitations
directes dans son poème. M. Salomon Reinach en a signalé
quelques-unes,qui se rapportent à la seconde Philippique.
C'était déjà l'une des harangues les plus célèbres du grand
orateur, et il n'est nullement étonnant que Lucain l'ait sue
par coeur, qu'il l'ait par conséquent démarquée à l'occasion.
Toutefois, même ici, il convient d'être peu affirmatif. Appeler
Pompée « un homme remarquable et presque divin », comme
le fait Cicéron, ou lui décerner formellement les honneurs de
la déification, comme le fait Lucain, ce n'est pas tout à fait la
même chose. Quant aux beaux vers où Lucain décrit les sentiments
des Romains à la nouvellé de la mort de Pompée, la
tristesse qu'ils sont obligés de refouler en eux-mêmes pour
ne pas irriter le vainqueur, il est légitime d'y trouver une
réminiscence d'un passage de la diuina Philippica (1).
(1) Cic., Phil., II, 26.
Pourtant, il ne faut pas oublier que Tite-Live, lui aussi, connaissait
déjà ce discours, qu'il avait bien pu s'en inspirer, et
qu'il est impossible d'affirmer si c'est par son intermédiaire ou directement que les vers de Lucain procèdent des phrases
cicéroniennes.
Non seulement dans ce passage, mais dans tout le récit
de la guerre civile, le texte de Tite-Live nous est inconnu.
La comparaison des divers auteurs qui l'ont suivi peut bien
permettre, jusqu'à un certain point, de reconstituer la
matière de son récit, mais non les expressions. Nous savons
peut-être ce qu'il a dit, mais non comment il l'a dit. Par
suite, autant il nous est loisible d'affirmer qu'il a été une
source historique de Lucain, autant il est impossible de préciser
dans quelle mesure il a été une de ses sources littéraires.
Je croirais assez volontiers qu'il lui a suggéré quelques
mots, quelques formules, en même temps qu'il lui
fournissait les faits, mais ce n'est et ne peut être qu'une
hypothèse. Il y a des critiques qui ne se résignent pas à cette
incertitude : faute de posséder les livres de Tite-Live qui
correspondaient à la Pharsale, ils s'adressent à ceux que nous
avons conservés, et y cherchent des passages qui aient pu
servir de modèles à Lucain. Certes, il n'est nullement
impossible que Lucain ait lu, dans l'histoire de Tite-Live, le
récit des premiers temps de la république, ou des guerres
avec Carthage, ou des guerres de Grèce, etc. : toutefois, je
me le représente mal feuilletant le vaste ouvrage de l'historien
pour y chercher des traits descriptifs ou des expressions
frappantes. Pour que cela fût croyable, il faudrait qu'on
nous montrât, entre les premières Décades et la Pharsale,
des analogies indéniables, et ce n'est pas le cas. Parmi celles
dont M. Hosius a dressé une liste assez longue, quelques-unes
consistent en l'emploi d'un même mot, et d'un mot
qui n'est pas assez caractéristique pour qu'on puisse s'étonner
de le retrouver chez deux auteurs différents. Les Tarquins
ne savent pas vivre « en simples particuliers », et César ne
sait pas prendre le ton « d'un simple particulier » : de quel
tyran, ou de quel usurpateur, n'en dirait-on pas autant? Des
gens qui règnent en laissant toute l'impopularité, inuidia, à celui dont le nom les couvre, des troupes qui « se
répandent » en masse d'un endroit dans un autre, le
royaume d'Alexandre « déchiré » par ses successeurs :
ces expressions ne sont pas tellement rares que Lucain ait
été incapable de s'en servir s'il ne les avait lues dans les
endroits de Tite-Live où nous les lisons aujourd'hui, sans
compter que Tite-Live lui-même pouvait fort bien les avoir
employées plus d'une fois. Il en va de même pour la réflexion
que font Tite Live au sujet du Tarentin Nicon, et Lucain au
sujet de Curion : Nicon déteste les Romains et est détesté
d'eux à la fois comme citoyen et comme individu; Juba a
contre Curion également une haine à la fois publique et
privée; c'est là une formule antithétique assez banale. Est-il
bien légitime enfin de parler d'imitation lorsque les
deux auteurs décrivent, en termes d'une ressemblance un
peu lointaine, une séance du sénat convoqué illégalement,
les émotions et la résistance de soldats assiégés, la
manoeuvre de la tortue, la situation d'un navire de guerre
attaqué de flanc, ou celle d'une armée décimée par une
épidémie? Si encore, dans les passages de Tite-Live que
l'on cite, il y avait quelque détail très original, quelqu'un
de ces mots qu'on ne rencontre qu'une fois! Mais non; ce
que dit Tite-Live, il a dû le redire lorsqu'il a eu à parler, en
racontant la guerre civile, d'événements analogues, et c'est
là, tout simplement, que Lucain a dû le trouver. Pour
prendre deux exemples, je comprends très bien Tite-Live
narrant le siège de Marseille à peu près comme celui d'Ambracie,
l'épidémie de Dyrrhachium a peu près comme celle
de Syracuse, tandis que je ne vois pas Lucain se reportant
au siège d'Ambracie pour dépeindre celui de Marseille, à
l'épidémie de Syracuse pour dépeindre celle de Dyrrhachium. En résumé, il me paraît très probable que Lucain a
imité, littérairement parlant, les livres de Tite-Live qui,
historiquement, lui étaient nécessaires, mais je ne crois pas
qu'il soit allé chercher des modèles de style dans les autres
livres.
Aux autres historiens, Lucain paraît ne devoir rien ou
presque rien. Il y a lieu cependant de s'arrêter un peu sur
Quinte-Curce, parce qu'à ce sujet il s'est élevé une tentative
assez intéressante. On sait que l'époque de Quinte-Curce est
très douteuse : d'Auguste à Théodose, il n'y a guère d'empereur
sous le règne duquel on n'ait essayé de le placer. Si l'on
pouvait établir que Lucain l'a connu et imité, le problème
serait fort simplifié. C'est sans doute ce qui a conduit
M. Hosius a étudier d'une manière spéciale les rapports entre
la Pharsale et l'Histoire d'Alexandre. Sa conclusion est
que Quinte-Curce est une des sources de Lucain, que par
conséquent il faut le placer avant le règne de Néron, très
probablement sous celui de Claude. Par malheur, ses
arguments sont loin d'être sans réplique.
Il reconnaît tout le. premier que beaucoup de ressemblances
apparentes, auxquelles on pourrait être tenté d'attacher
une grande importance, n'en ont absolument aucune. Il
cite à ce propos le récit du siège de Tyr par Alexandre et
celui du siège de Marseille par César, qui sont d'un parallélisme
curieux, mais non probant. Ici et là. c'est un conquérant
arrêté dans sa course victorieuse par une résistance
inattendue ; il confie le blocus à ses subordonnés ;
ceux-ci échouent; les assiégés font une sortie avec succès,
etc.. Mais tout ce que raconte Lucain est réellement
arrivé; on ne peut donc penser qu'il ait copié Quinte-Curce,
et transporté à César ce qui est vrai d'Alexandre : il n'y a là
qu'une coïncidence historique. Dans la description de la
bataille navale, quelques détails sont identiques, mais
on les retrouve déjà dans un passage du livre XXVI de Tite-Live, et Quinte-Curce est, autant que Lucain, un imitateur
de Tite-Live : cette fois il y a influence d'un modèle
commun. M. Hosius raisonne de même pour les exploits
d'Alexandre chez les Oxydraques et de Scaeva à Dyrrhachium, pour les batailles d'Issus et de Pharsale, pour
les appréciations des deux auteurs sur le caractère d'Alexandre
et sur celui de César. Quant aux opinions philosophiques
et morales de Quinte-Curce, il les déclare trop vagues
pour que leur rapport avec celles de Lucain puisse avoir la
moindre signification.
On ne saurait mieux dire. Mais il est fàcheux que
M. Hosius ne soit pas resté plus fidèle à son principe, qu'il
ait plus d'une fois oublié la nécessité de comparer, non pas
seulement Lucain à Quinte-Curce, mais tous les deux à
d'autres écrivains. S'il l'avait fait, il aurait constaté, je crois,
que presque toujours le poète et l'historien ne se ressemblent
que parce qu'ils puisent à la même source; il aurait vu
s'évanouir toutes les analogies qu'il juge convaincantes,
aussi bien que celles qui lui paraissent sans valeur.
Il tire argument, par exemple, des termes dans lesquels
les deux auteurs définissent, l'un la situation de la Phrygie,
l'autre celle de Dyrrhachium. Il est sûr que ces termes
sont très proches. Mais, puisque les deux pays sont deux presqu'îles
rattachées à la terre ferme par un isthme étroit, n'est-il
pas forcé que, pour expliquer la même chose, on ait eu
recours aux mêmes mots ? d'ailleurs, Tite-Live, dans la
partie perdue de son ouvrage, n'a-t-il pas du décrire la position
de Dyrrhachium et de bien d'autres presqu'îles? et
Lucain et Quinte-Curce n'ont-ils pas pu s'en inspirer, chacun
de son côté? Pareillement, si Lucain et Quinte-Curce s'accordent
à parler des Nasamons comme de naufrageurs de
profession, et des Phéniciens comme des inventeurs de l'écriture, ils ne font que rappeler des faits bien connus,
qu'ils n'avaient nul besoin de s'emprunter l'un à l'autre, car
ils les trouvaient, dirai-je chez Tite Live? non pas même,
mais n'importe où, chez tous les historiens et compilateurs,
dans l'enseignement historico-géographique le plus courant.
Pareillement encore, il est très vrai que la peinture du désert
de Libye dans la Pharsale ne diffère pas beaucoup de celle
du désert de Bactriane chez Quinte-Curce : mais, là aussi,
il s'agit d'objets à peu près semblables et il est fatal que les
traits des deux descriptions concordent en grande partie.
Ces traits sont du reste assez généraux ; il peuvent convenir
à la plupart des solitudes sablonneuses. N'oublions pas
que la peinture des paysages était un des thèmes usités dans
les suasoriae. Comme le Fabianus dont parle Sénèque le
Père, Lucain et Quinte-Curce avaient sûrement eu à traiter
cette matière plus d'une fois, et ils avaient dû le faire à peu
près de la même façon : ils se sont souvenus de leurs devoirs
d'élèves, et voilà tout. Ainsi, tantôt l'influence de Tite-Live,
tantôt celle de l'érudition scolaire, tantôt celle des exercices
de rhétorique, expliquent sans peine les ressemblances qu'on
peut apercevoir dans les détails de géographie donnés par
les deux écrivains. Il en va de même pour celles qui apparaissent dans leur
style. M. Hosius a dressé une liste assez longue d'expressions
de phrases identiques chez Lucain et Quinte-Curce, et il
ajoute que, si tous ses rapprochement ne sont pas également
probants, leur masse ne laisse guère place au doute. C'est,
je crois, s'en exagérer singulièrement la valeur. Il faut
d'abord éliminer quelques passages dans lesquels la ressemblance
qu'a cru découvrir M. Hosius est loin d'être frappante.
Entre l'exclamation du poète devant le sommeil des pompéiens
à Pharsale et l'argument
de Philotas pour sa défense,
c'est tout au plus le tour interrogatif
qui est commun : ni l'idée, ni l'expression n'est la même. La formule de Caton, nec regnum cupiens nec seruire
timens, ne rappelle que fort peu celle des envoyés scythes,
nec seruire ulli possumus nec imperare desideramus ; l'idée
qu'il ne faut pas avoir peur de l'esclavage (parce qu'on peut
toujours s'en affranchir) la rend bien plus originale. Coenus
dit, en parlant au nom des Grecs, qu'ils ont réalisé tout ce
que des hommes peuvent faire, et Lucain dit que le pillage du camp de
Pompée n'a pas rassasié l'avidité démesurée des césariens : rien n'autorise le parallèle de ces deux phrases.
En d'autres endroits, le texte de Lucain ressemble bien
à celui de Quinte Curce, mais tous deux ressemblent aussi à
celui d'un écrivain antérieur. C'est le cas pour la tournure
stare sub ictu oucadere sub ictum fortunae : elle se rencontre
chez Sénèque, sauf le génitif fortunae,qui n'était pas très difficile
à ajouter . C'est le cas aussi pour la formule destinée
à définir la gloire ou la puissance excessive : elle vient
également de Sénèque. La périphrase de Lucain, lymphalo
trepidasse metu, semble être le résultat d'une fusion
entre trepidare metu, qui est deux fois dans Virgile, et lym phalicus pauor, qui est dans Tite-Live : il importe donc
assez peu que Quinte-Curce ait écrit de son côté lymphati trepidare. L'historien parle des conquêtes faites « en courant
» par les Macédoniens, et le poète en dit autant des victoires
de Pompée, mais des expressions analogues figurent
déjà chez Ovide et chez Sénèque le Père. Lucain promet à Néron que toutes les divinités lui céderont la place,
mais est-ce parce que Quinte-Curce met une pareille flatterie
dans la bouche des adulateurs d'Alexandre? n'est-ce pas
plutôt parce qu'il se souvient de l'apothéose des Géorgiques? Il dépeint Cléopâtre rendue plus confiante par
le sentiment de sa beauté : ce qu'il dit fait songer, si l'on
veut, à la femme de Spitamène, mais bien plus à la
Vénus du VIIIe livre de l'Énéide. Enfin l'idée qu'un roi
ne peut avoir de confiance en ceux qui partagent son pouvoir
remonte (au moins) à Ennius : il n'est pas étonnant
dela trouver chez Lucain et chez Quinte-Curce, comme
dans l'Agamemnon de Sénèque. Voilà bien des exemples
où la similitude peut provenir de ce que les deux écrivains
ont emprunté leurs termes, chacun de son côté, à un commun
modèle.
Ailleurs, ce commun modèle ne nous apparaît pas; mais,
outre qu'il peut avoir existé sans être parvenu jusqu'à nous,
les idées énoncées sont assez voisines l'une de l'autre pour
avoir produit, naturellement, presque fatalement, des expressions
qui se ressemblent. Ainsi les deux auteurs doivent user
à peu près des mêmes mots quand ils ont à parler de généraux
vainqueurs avant même d'avoir vu l'ennemi, ou de
blessures que la coagulation du sang a rendues plus douloureuses. Ainsi encore, lorsque Lucain dit que la renommée
de la guerre ébranle les plus lointaines retraites de l'Orient,
et Quinte-Curce que la grandeur de la lutte ébranle les armes
de la Grèce même, un certain parallélisme dans les tours
de phrase n'a rien d'étonnant. Tous deux devront aussi décrire
sensiblement de la même manière des escalades où les soldats ne songent qu'à s'appuyer sur leurs piques sans pouvoir
les lancer. Tous deux devront caractériser par les mêmes
paroles le bonheur des héros qui ont su s'affranchir de la
crainte de la mort. Dans tous ces endroits, il est très explicable
que Lucain et Quinte-Curce semblent se répéter : l'extraordinaire
serait qu'ils différassent beaucoup, disant les
mêmes choses. Mais a-t-on le droit d'en conclure que l'un a
copié l'autre? et surtout peut-on déterminer qui est l'original,
et qui le copiste?
Il y a plus. Non seulement l'opinion qui fait de Quinte-Curce une des sources de Lucain n'a pour elle aucun argument
décisif, mais elle a contre elle de fortes probabilités.
M. Hosius remarque lui-même que la géographie des deux
écrivains présente de notables divergences. Pour Lucain,
l'Hydaspe est un affluent de l'Indus; pour Quinte-Curce, il
n'en est qu'un sous-affluent, se jetant dans l'Acésinès, qui se jette lui-même dans l'Indus. Lucain place sur les rives du
Gange le point jusqu'où Alexandre s'est avancé; Quinte-Curce
ne le fait aller que jusqu'à l'Hypasis. L'historien nous
donne de Jupiter Hammon une idée très fastueuse : l'idole,
ornée de pierreries et d'émeraudes, est promenée sur une
barque dorée, où sont suspendues des patères d'argent;
Lucain proclame au contraire que ce sanctuaire est pauvre,
sans pierres précieuses et sans or. Aurait-il osé, malgré
tout son désir de donner au luxe contemporain une leçon
de modération, aurait-il osé prendre à tel point le contrepied
de la description de Quinte-Curce, s'il l'avait eue sous les
yeux au moment où il dépeignait le temple de l'oasis?
A ces dissemblances, que M. Hosius a reconnues, on peut
en joindre une autre dont il ne paraît pas s'être rendu compte.
On sait que Lucain raconte sur l'héroïsme de Caton pendant
la traversée des sables libyens une anecdote analogue à
celle qu'on lit chez Quinte-Curce à propos d'Alexandre dans les déserts de la Sogdiane : de part et d'autre, le chef d'armée
refuse l'eau qu'on lui apporte, pour ne pas décourager ses
soldats en leur laissant voir qu'il est torturé par la soif.
Ainsi résumées, les deux historiettes paraissent identiques :
elles varient pourtant dans le détail. Chez Quinte-Curce, deux
soldats, qui vont porter de l'eau à leurs enfants, rencontrent
le roi et lui offrent le précieux liquide; il accepte d'abord,
puis, quand il sait à qui cette eau est destinée, il y renonce
au profit de ceux pour qui elle a été recueillie. Dans la Pharsale, le soldat apporte de l'eau à Caton.
Et ce qui est curieux, c'est que le récit d'autres historiens
d'Alexandre est plus voisin de celui de Lucain que celui de
Quinte-Curce. Chez Polyen, chez Arrien, chez Frontin, chez
Plutarque, les soldats ont puisé de l'eau tout exprès
pour leur général, et, chez tous ces écrivains aussi, le refus
d'Alexandre est plus théâtral, plus orgueilleux que chez
Quinte-Curce. Ajoutons que Frontin place la scène, non en
Sogdiane, mais en Afrique, et par là se rapproche un peu
plus de Lucain. De tout cela que conclure? que Lucain a
très probablement connu le trait d'Alexandre que Quinte-Curce relate, mais que ce n'est pas par Quinte-Curce qu'il l'a
connu. Il a pu en être instruit par quelque historien antérieur,
ou même tout simplement par les traditions d'école. On se
rappelle combien l'histoire d'Alexandre a fourni de sujets de
déclamation, et combien les rhéteurs aimaient ces anecdotes
romanesques et sentimentales : l'incident du voyage en Sogdiane
n'est pas de ceux qu'ils laissaient passer inaperçus, et
je croirais volontiers que c'est eux qui l'ont enseigné à Lucain,
lequel s'en est emparé et l'a adapté à son sujet, sans que
Quinte-Curce y soit pour rien.
L'imitation de Quinte-Curce par Lucain est donc plus que
douteuse : elle est peu vraisemblable. Aucune des analogies
qu'on a relevées entre eux n'est telle qu'on ne puisse en rendre raison que par l'hypothèse d'un emprunt direct, et
certains désaccords ne sauraient guère s'expliquer dans cette
hypothèse. Il faut se résigner à regarder les deux auteurs
comme indépendants l'un de l'autre, sans que Quinte-Curce
puisse nous aider à mieux comprendre la méthode poétique
de Lucain, ni Lucain à tirer au clair le problème de l'époque
de Quinte-Curce.
On pourrait s'attendre à trouver dans le style de Lucain
beaucoup d'imitations de Sénèque, dont il connaissait et
admirait certainement les ouvrages. Il y en a fort peu cependant,
ou du moins les ressemblances verbales n'existent que
là où il y a une communauté d'idées. Elles sont amenées par
la force des choses, et non recherchées exprès par le poète.
J'ai déjà signalé la conformité entre la description du
cours du Nil au livre X de la Pharsale et celle qu'a tracée
Sénèque. Ici, c'est le sujet même qui impose le choix des
termes. Pareillement pour passer de la physique à la
morale, on ne peut être surpris de trouver une comparaison
tirée des couples de gladiateurs et appliquée par le philosophe
à l'homme de bien luttant avec la Fortune, par le
poète à Pompée luttant avec César : dans les deux cas, il
s'agit des jeux de la destinée, et, la pensée étant à peu près
analogue, il est naturel que les mots le soient aussi.
Mais les rapprochements purement littéraires entre Sénèque
et Lucain sont assez peu nombreux. On a quelquefois
comparé, à l'antithèse de Sénèque sur la foudre (« on ne
la craint que lorsqu'on lui a échappé »), les vers légèrement
obscurs de Lucain sur Méduse. On a comparé aussi l'épithète
que le poète donne à César, impellens quidquid obstaret,
à une phrase du De beneficiis. On a relevé deux sententiae analogues l'une à l'autre, l'une dans la Pharsale,
libertas libertale perit, l'autre dans le De tranquillitate animi, eius libertatem libertas non tulit. Tous ces rapports sont lointains et probablement fortuits. D'une manière générale,
il ne semble pas que Lucain ait lu les traités de
Sénèque pour y chercher des ornements de pure forme. Son
oncle a été pour lui un prédicateur de morale, non un
modèle de style.
§ 7.
En même temps que les souvenirs de Virgile, d'Horace et
d'Ovide, de Cicéron, de Tite-Live et de Sénèque, et plus
encore que tous ces souvenirs, ceux qui ont le plus puissamment
agi sur le style de Lucain sont ceux de son éducation
oratoire. Ils sont reconnaissables à la fois dans certains
détails et dans le ton général de l'oeuvre.
On se rappelle les paroles fièrement insolentes de Domitius
à César sur le champ de bataille de Pharsale : « Pompée
commande encore : je descends libre et tranquille vers les
eaux du Styx ». Y a-t-il là une réminiscence du fameux
mouvement de Cicéron dans le De oratore à propos de Crassus.
Ou de la péroraison de Vibius Virrius
dans Tite-Live? ou des adieux de Didon à la vie dans
l'Enéide ? des trois ensemble peut-être, mais surtout il est
facile de saisir là un de ces effet déclamatoires, catalogués et
enseignés dans les écoles, que les élèves des rhéteurs se
transmettaient fidèlement de génération en génération, et que
Lucain avait dû pour sa part employer plus d'une fois dans
ses exercices de jeunesse avant de les introduire dans son
poème.Le défi de César à ses soldats révoltés est encore
un de ces « clichés » de discours latin, dont la forme est
aussi retentissante que le fond en est général et vague : César
dit à peu près la même chose que Scipion chez Tite-Live
et Alexandre chez Quinte-Curce; il n'y a pas là, à proprement
parler d'imitation directe; les trois auteurs, ayant à
composer la « harangue d'un général à ses troupes rebelles »,
appliquent consciencieusement les procédés de la rhétorique
qu'on leur a apprise. Ailleurs, c'est la « harangue d'un général au moment du combat », avec l'appel traditionnel au
souvenir de la famille et la prosopopée de la patrie.
La discussion entre Brutus et Caton, au début de la guerre
civile, sur le rôle qu'un vrai sage doit observer au milieu des
troubles, semble composée de deux suasoriae contradictoires
mises en vers : on sait combien les rhéteurs du
Ier siècle empruntaient volontiers leurs sujets à cette période
dramatique de l'histoire romaine. Peut-être faut-il faire
remonter à la même source les conseils de Cotta à Metellus
pour l'engager à se rallier à César, le débat entre Pompée
et ses amis sur le parti à prendre après Pharsale, et celui
des conseillers de Ptolémée sur l'accueil qu'on doit réserver
à Pompée fugitif. Tous ces thèmes d'éloquence délibérative
avaient dû attirer les rhéteurs par le caractère tragique
des événements auxquels ils se rattachaient, par le prétexte
aussi qu'ils offraient aux lieux communs moraux et politiques,
aux amples tirades et aux belles maximes : je ne serais
nullement surpris que Lucain les eût développés lui-même
ou entendu développer par ses camarades, et eût été amené
par ses souvenirs d'adolescence à les reprendre sous .forme
poétique.
Mais, outre ces morceaux à effet, on peut dire que, dans
son ensemble, la Pharsale porte l'empreinte de la rhétorique
contemporaine. Les habitudes les plus chères à Lucain,
celle de reprendre plusieurs fois la même idée en lui donnant
une expression de plus en plus frappante, celle d'insérer
dans le discours ou le récit des sentences de moraliste,
celle de rechercher les termes les plus forts, voire même les
plus hyperboliques, celle de trouver, pour clore ses raisonnements,
des formules antithétiques, celle d'envelopper
la pensée dans des membres de phrase d'une concision qui
va jusqu'à l'obscurité, et qui, encore aujourd'hui, fait le désespoir
des commentateurs, toutes ces habitudes qui caractérisent sa manière d'écrire, sont exactement celles que l'on
enseignait dans les écoles d'alors. Y insister en détail serait
entreprendre une étude complète du style de la Pharsale :
c'est un nouveau sujet, que je ne puis qu'indiquer ici ; mais
je ne voulais pas omettre de signaler cette influence que la
rhétorique a exercée sur Lucain, et qui, précisément parce
qu'elle a été diffuse et presque inconsciente, parce qu'elle
s'est en quelque sorte incorporée aux tendances natives de
son esprit, est peut-être la plus profonde de toutes celles qu'il
a subies.
Après tant de discussions minutieuses et de raisonnements
forcément conjecturaux, il n'est peut-être pas superflu de
résumer les conclusions qui paraissent s'en dégager avec le
plus de vraisemblance.
En ce qui concerne la masse des faits secondaires, historiques,
géographiques, scientifiques, etc,
incidemment
rappelés dans la Pharsale, il ne me semble pas que l'érudition
de Lucain soit très compliquée : elle dérive presque
tout entière de l'enseignement encyclopédique que donnaient
les grammairiens. Cependant il s'est probablement
servi de la description de la Gaule que Tite-Live avait dû
insérer dans son histoire, d'un traité sur l'Afrique dont
nous ne pouvons identifier l'auteur, et de l'ouvrage de
Sénèque sur l'Égypte.
Pour les faits principaux, ceux de la guerre civile, les
choses se sont passées encore plus simplement sans doute.
Tout porte à croire que Lucain n'a eu qu'une source unique,
et que cette source est Tite-Live. Cette opinion, affirmée par
Baier, m'a paru devoir être maintenue malgré toutes les
objections que lui ont faites Westerburg et Ussani, et que j'ai
essayé de dissiper. A coup sûr, il n'est pas impossible que
Lucain ait lu d'autres textes historiques, et surtout certains
des documents contemporains, tels que les Commentaires de
César ou les lettres de Cicéron. Mais rien n'autorise à penser
qu'il y ait cherché des renseignements complémentaires. Son
récit ne procède que de Tite-Live. Ce n'est pas à dire qu'il soit un décalque fidèle de celui de
cet écrivain. Sans parler de quelques bévues imputables à
une rédaction hâtive, il a probablement altéré les faits que
lui fournissait son auteur, tantôt par passion de polémiste,
tantôt par préoccupation d'artiste. Ces altérations sont
d'ailleurs moins graves qu'on ne l'a souvent dit : elles ne
suffisent pas pour ôter à la Pharsale sa très réelle valeur de
poème historique.
Les idées métaphysiques et morales n'offrent pas non
plus chez Lucain toute l'incohérence qu'on lui a quelquefois
reprochée. S'il y a quelque confusion dans ses opinions sur
les dieux et le destin, quelque incertitude dans ses croyances
sur la vie future, le fond de sa pensée se ramène bien au
stoïcisme, du moins à ce stoïcisme élargi et assoupli qu'on
enseignait alors, et qui apparaît notamment dans les traités
de Sénèque.
Enfin, au point de vue purement littéraire, on relève chez
Lucain des imitations de Virgile, d'Horace, d'Ovide, de
Cicéron, de Tite-Live, de Sénèque (plus dans ses tragédies
que dans ses écrits philosophiques). Celles de Manilius et de
Quinte-Curce, que Hosius a cru y découvrir, demeurent indémontrées.
Toutes ces influences sont du reste assez peu
considérables, moins que celle, plus générale et plus habituelle,
de la rhétorique du temps.
Les vues que je viens d'exposer, et qui me sont suggérées
par l'étude du poème, ont en outre l'avantage de s'accorder
avec les conditions dans lesquelles Lucain s'est trouvé placé.
Il est naturel qu'un jeune poète, voulant composer une
épopée sur la guerre civile, soit allé tout droit à la plus
célèbre des histoires où cette guerre était racontée, sans
chercher à droite et à gauche des renseignements qu'il
jugeait inutiles. Il est naturel qu'un disciple et un neveu de
Sénèque, sans être plus rigoureusement stoïcien que son
maître, ni plus pédantesquement doctrinaire, se soit souvenu
des belles théories qu'il lui avait entendu prêcher sur
l'épreuve, sur l'honneur, sur la vertu, sur la mort. Il est
naturel qu'un brillant élève des écoles, à peine sorti de cet
enseignement, ait continué à faire ce qu'on lui avait appris, ait imité de préférence les poètes déjà classiques qu'on lui
avait fait lire, et appliqué les procédés de style auxquels on
l'avait exercé. Ce critérium de vraisemblance psychologique
ne serait pas suffisant à lui seul pour trancher les questions
que j'ai discutées : mais il vient se surajouter aux conclusions
que j'ai cru pouvoir tirer de l'examen des réalités
philologiques et historiques, et il leur communique, si je ne
me trompe, un haut degré de probabilité.
Mais, dira-t-on, si les faits viennent deTite-Live, les idées
de Sénèque, et le style des rhéteurs, que reste-t-il à Lucain?
n'est-il donc qu'un pur copiste? je suis très loin de le penser.
Remarquons d'abord, ce qui n'est pas indifférent, que
toutes les influences qui ont agi sur lui ont un caractère
essentiellement romain. L'historien qu'il a suivi est celui
qui, par son impartialité relative et par sa ferveur patriotique,
comme par sa célébrité universelle, pouvait mériter
le mieux l'épithète de « national ». La philosophie dont il a
magnifié les préceptes n'est pas une doctrine de spéculation
grecque : c'est un stoïcisme latinisé, éclectique et pratique,
celui qui anime presque tous les moralistes de Rome. Les
poètes qu'il a imités sont des poètes latins; les artifices
oratoires qu'il a transportés dans la poésie sont ceux
qu'enseignaient les professeurs latins. Non seulement par le
choix de son sujet, mais par les sources de son inspiration,
il justifie ce qu'il a dit de son oeuvre, et ce que Stace devait
en dire plus tard, romana carmina, carmen togatum.
Il est donc bien romain. Et il est, dans une très large
mesure, original. Il l'est par l'art qu'il met à combiner les
trois éléments que notre analyse dissociait tout à l'heure,
l'histoire, la morale, et l'éloquence. Il l'est surtout par la
sincérité avec laquelle il a « senti » chacun d'eux Le récit
de Tite-Live n'a pas été pour lui, comme pour tel de ses
contemporains, une matière commode à mettre en vers,
mais une mine intarissable de méditations et d'émotions :
son âme de citoyen en a revécu toute l'horreur et la tristesse. Pareillement la morale stoïcienne aurait pu rester dans son
esprit une sorte de catéchisme verbal, qu'on apprend, qu'on
répéte, qu'on amplifie, mais qui n'agit point : bien au contraire,
il y a cru, il l'a admirée, il l'a aimée, avec la bonne
foi la plus enthousiaste. Même ces imitations littéraires,
même ces effets oratoires, que tant d'autres alors pratiquaient
d'une façon mécanique, lui y a mis de la conviction, de la
passion, de la vie, parce qu'il a vu là, dans une hyperbole
ou dans une antithèse, le moyen d'exprimer ce qui lui
tenait le plus au coeur. Tout ce qui, pour un imitateur vulgaire,
aurait été un lourd poids mort, s'est transformé, animé,
au contact de sa sensibilité frémissante L'histoire de Tite-Live, la morale de Sénèque, l'éloquence des rhéteurs, ont
été, dans toute la force étymologique du terme, des
« sources » véritables : en tombant dans une âme profonde
et concentrée, au lieu de s'éparpiller en maigres filets d'eau,
ces sources ont fait naître un beau fleuve impétueux.
LA COMPOSITION DE LA PHARSALE
Il n'est guère possible d'étudier de près la Pharsale sans
essayer de se faire une opinion sur la manière dont elle a été
composée. Comme la question a suscité beaucoup de controverses,
je ne crois pas inutile de faire connaître la solution
qui me paraît la plus vraisemblable.
Et d'abord, puisque le poème est inachevé, quelles étaient
les limites que Lucain lui avait assignées dans son intention?
comptait-il aller jusqu'à la fin de la guerre d'Alexandrie? ou
jusqu'au meurtre de César? ou jusqu'à Philippes?ou jusqu à
Actium? Toutes ces hypothèses ont été soutenues. Le plus
récent historien de la poésie latine, M. Plessis, serait porté à
croire que Lucain a progressivement agrandi son dessein
primitif. Je ne veux pas entrer dans une discussion détaillée
de ces conjectures : je me bornerai à quelques remarques
très simples.
En premier lieu, dans celui de ses deux exordes qui est le
plus court et le plus récent, le poète dit qu'il va chanter la
guerre « plus que civile » qui a eu lieu dans les plaines
d'Émathie : cela suppose que Pharsale est l'événement
central de son récit, ce qui s'expliquerait mal s'il avait eu le
projet de poursuivre jusqu'à Actium. Le célèbre vers Pharsalia
nostra conduit à la même conclusion.
En outre, dans la pensée de Lucain, la scène de nécromancie
correspond sans nul doute à ce qu'est dans l'Énéide la descente aux enfers. Elle est placée, comme la descente, au livre VI. Donc cet endroit marque très probablement le
milieu du poème, qui, par conséquent, devait avoir 12 livres,
et non 10 ni 24, comme on l'a quelquefois supposé.
Si l'on admet ce chiffre de 12 livres, et que l'on jette un
coup d'oeil sur les periochae de Tite-Live, on voit que, proportionnellement
à la partie déjà traitée, celle qui restait à
traiter devait correspondre à un livre et demi ou deux livres
de l'historien. Lucain aurait probablement ornis quelques-uns
des événementsracontés dans les livres CXIII et CXIV : la
guerre de Pharnace, la révolte de Dolabella. Mais il n'aurait
sûrement pas laissé dans l'ombre la bataille de Thapsus et le
suicide de Caton. C'est à cette date, à celle du quadruple
triomphe de César, que j'arrêterais le plan projeté par lui.
Peut-être faudrait-il y comprendre encore la seconde guerre
d'Espagne et Munda, mais je crois difficile d'aller plus
loin.
Autre question, plus délicate : dans quel ordre ont été
composés les divers livres de la Pharsale et la biographie de
Vacea, le seul document que nous ayons en la matière, dit
simplement que Lucain avait écrit trois livres de son ouvrage
avant sa rupture avec Néron. La plupart des critiques ont
pensé que ces trois livres étaient les trois premiers, et même,
s'appuyant sur cette base pourtant bien douteuse, ils ont cru
pouvoir retrouver, entre I-III et IV-X, des divergences d'opinion
qui, pour ma part, ne me frappent aucunement. Selon
Ussani, les tres libri de Vacea seraient 1, VII et IX. Je proposerais
plutôt d'y voir II, VII et VIII, et voici pourquoi.
1° Si III a été composé avant la rupture avec Néron, je ne
m'explique pas que le rôle de Domitius dans la défense de
Marseille soit passé sous silence. Et inversement, si VII a
été composé après la rupture, je ne m'explique pas que le
même Domitius ait à Pharsale une aussi belle mort.
2° Les livres II et VII présentent des caractères que n'ont
pas les autres : ils contiennent moins de récits proprement
historiques, plus de discours, plus de digressions.
3° Ils présentent aussi des erreurs que Lucain a dû commettre
parce qu'il ne connaissait pas encore très bien son
sujet : erreur sur le vent favorable pour aller de Brindes à Dyrrhachium [corrigée plus tard au livre III], erreur
sur l'époque du départ de Pompée, erreur sur le rôle
de Cicéron à Pharsale. Les autres livres, pour lesquels il
avait eu le temps de se documenter davantage, sont beaucoup
plus exacts.
4° La controverse entre Caton et Brutus, au livre II, où les
deux personnages parlent assez sévèrement des guerres
civiles, se comprend mieux si l'auteur, à ce moment-là, est
encore modéré en politique, que s'il est déjà entré dans une
conjuration.
5° Au livre VIII, en souhaitant le retour des cendres de
Pompée, Lucain semble dire que ce retour est possible maintenant
que Rome est libre et heureuse : ce langage est
plus à sa place chez un courtisan de Néron que chez un
mécontent.
6° Les sujets traités dans II, VII et VIII, sont de ceux qui
ont dû attirer tout de suite l'imagination ardente de Lucain;
ils forment une progression continue; ce sont les trois étapes
de la ruine de Pompée : sa fuite, sa défaite, sa mort. Lucain
a dû être pressé de les traiter, et ensuite il est revenu sur les
parties intermédiaires.
Restent deux objections possibles à mon hypothèse, tirées
l'une de la dédicace à Néron, l'autre des explosions de fureur
anti-césarienne qui interrompent la description de la bataille
de Pharsale. Mais la dédicace a dû être composée à part,
et le livre VII a dû être retouché après la rupture avec Néron.
L'apostrophe à Brutus, notamment, a fort bien pu être alors
composée pour remplacer l'épisode de Domitius.
En résumé, je crois que Lucain avait l'intention de composer
une épopée en 12 livres, allant jusqu'à la fin de la
2 ème guerre d'Afrique, qu'il a d'abord écrit les livres II. VII et VIII et qu'après sa disgrâce il a remanié trois livres et écrit les sept autres.
FIN DE L'OUVRAGE
![]()