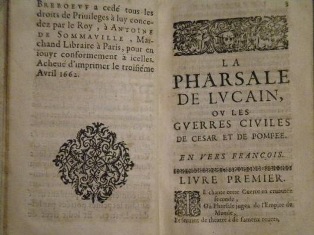
LA PHARSALE
de
Lucain
TRADUCTION DE MARMONTEL, revue et complété par M. H. DURAND.
Précédée d'une étude faite par M. CHAPENTIER
1865
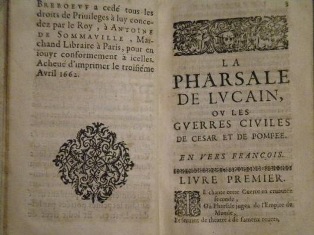
Livre I, Livre II, Livre III, Livre IV, Livre V, Livre VI, Livre VII, Livre VIII, Livre IX, Livre X.
![]()
Parmi les traductions de Lucain, celle de Marmontel est peut-être la mieux écrite ; c'est ce qui nous l'a fait choisir de préférence à toute autre pour notre collection. Elle avait besoin, il est vrai, d'être retouchée au point de vue du sens et de l'exactitude, et complétée dans une foule de passages. Marmontel, sous-prétexte d'atténuer les défauts du modèle, avait pris trop de licences avec son auteur, et s'était permis, dans l'intérêt du bon goût, des suppressions inadmissibles. Nous avons dû songer à réparer ces lacunes et à faire dans le travail, d'ailleurs si estimable de Marmontel, les changements reconnus nécessaires; en un mot, à rendre au poète latin sa vraie physionomie. Nous ne pouvions confier ce travail de retouche et de remaniement qu'à un latiniste homme de goût. M. H. Durand a bien voulu se charger de cette tache délicate : la manière dont il s'en est acquitté nous permet d'offrir avec confiance à nos lecteurs cette traduction renouvelée.
FELIX LEMAISTRE.
L'éloquence romaine périt avec la république ; pacifiée
par Auguste, elle ne pouvait survivre à la liberté :
on le conçoit sans peine; on conçoit moins facilement
que la poésie qui, sous ce prince, avait été comme le
dédommagement de l'éloquence et la plus brillante
décoration du naissant empire, ait, après lui, presque
complètement disparu. En effet, pour vivre, la poésie
n'a pas précisément besoin de l'air et de la lumière
de la liberté; le demi-jour, les rayons voilés du soleil
monarchique lui sont plutôt favorables que contraires.
Comment donc expliquer, à partir d'Auguste, son rapide
déclin?
Les premiers empereurs ne lui furent pas, je le
sais, très bienveillants. Portés encore, jusqu'à un certain
point, à l'histoire, à l'éloquence même qu'ils cultivent, ils sont indifférents et quelquefois hostiles à
la poésie. Si Caligula, dans un caprice libéral, permet
de remettre en lumière les ouvrages de Labienus, de Cassius Severus, de Gremutius Cordus, proscrits par Tibère, il fait enlever des bibliothèques les ouvrages de
Virgile. La poésie n'avait donc rien à attendre ni de
Tibère, ni de Caligula, ni de Claude; mais ne pouvait-elle
vivre de sa propre vie et se suffire à elle-même? Elle
n'a pas besoin, en effet, d'un théâtre et des applaudissements
du Forum, et elle avait, sous la tyrannie, cet
avantage de ne point porter ombrage. Il y avait donc
encore, ce semble, place pour elle; mais si elle n'a pas
comme l'éloquence, besoin de secours étrangers; si elle
peut naître d'elle-même et se développer par sa propre
vertu, encore lui faut-il une inspiration, légère ou profonde,
gaie ou sérieuse. Or, on ne voit pas d'où, sous les
successeurs d'Auguste, lui serait venue cette inspiration.
Rappelons-nous, en effet, quel avait été, même au
temps d'Auguste, le caractère de la poésie latine. Elle
ne jaillit point du sol même de l'Italie; elle n'a pas,
comme le dit le poète, été discrètement détournée des
sources grecques; elle en a été tout entière amenée et
à grands flots répandue sur le Parnasse latin. Là, toutefois,
mêlée à la veine nationale, elle s'y avive et s'y colore
de teintes éclatantes et profondes : Horace donne à
la poésie lyrique un sentiment philosophique et rêveur
qui le fait dissemblable, sinon rival de Pindare. Entré
plus avant encore dans cette voie de méditation et de
mélancolie, Virgile trouve dans son âme des richesse
nouvelles : marqué à un double sceau, il est tout à 1a
fois le prêtre de la théologie ancienne, qu'il emprunte
à Platon, et le précurseur du spiritualisme chrétien
dont il a de merveilleuses divinations. Cette rêverie philosophique nouvelle et cette vive sensibilité qui sont
au milieu des imitations grecques, le cachet original,
le charme particulier d'Horace et de Virgile, ne pouvaient pourtant suppléer entièrement à cette inspiration
primitive que seule la poésie grecque possède.
Quoi que fît, en effet, le génie de ces deux grands
poètes, il ne parvint pas à donner à la poésie latine la
spontanéité et la vigueur natives qu'elle n'avait pas.
Fleur brillante et étrangère, transportée sous un ciel
moins ami que le ciel grec où la poésie s'était d'elle-même
développée et épanouie en tant de genres et sous
des formes si heureuses, la poésie latine ne put, si habilement
cultivée qu'elle eût été, s'acclimater entièrement
à Rome et y produire des fruits spontanés et vivaces; la
terre lui manquait, et semblable à ces fleurs délicates
et vives que le poète nous représente se penchant et
s'affaissant sur elles-mêmes à la première atteinte de la
pluie :
la poésie romaine, quand elle n'eut plus pour la soutenir
et la réchauffer la douce influence d'Auguste et de Mécène,
languit et mourut.
Cependant, entre les différents genres de la poésie latine,
il y en avait un qui, plus que les autres, mieux que
la poésie lyrique surtout et l'épopée, continuerait, on le
pouvait croire, à fleurir sous l'empire : l'élégie. Ces molles
harmonies de Tibulle, de Properce et d'Ovide, si bien
d'accord avec la corruption des moeurs romaines, comment
n'ont-elles pas éveillé, inspiré d'autres chantres
des faciles amours? N'était-ce pas là, sous l'empire, une
source qui ne devait pas tarir? On le croirait d'abord;
mais telle était alors la corruption des moeurs : l'imagination,
même dans ses plus grandes licences, aurait langui auprès de la réalité. Quand Ovide, quand Properce chantent
leurs amours, on sent, si rmatérielle, si extérieure en
quelque sorte, que soit leur inspiration, qu'au fond
cependant l'âme y est encore pour quelque chose; il y a
passion, il n'y a pas orgie. Il n'en est plus ainsi au temps
de Tibère et de Caligula. Les Romains ont l'ivresse et
les monstruosités de la débauche; ils n'ont plus les délicatesses du plaisir; l'élégie leur serait fade et insipide;
la vue du sang répandu dans le cirque peut seule ranimer
et assaisonner en eux la volupté. Point d'amour
donc; partant, point de poésie. Sous Tibère, la poésie est
réduite au timide apologue ou à des pièces de concours.
La plupart des poètes versifiaient pour la cour ou sur la
naissance des princes, pour les prix du mois d'août.
D'où reviendra donc à la poésie l'inspiration qu'elle
a perdue? De quelle source vive et profonde sortiront,
s'élèveront les vapeurs nouvelles et puissantes qui la
pourront raviver et féconder? Cette source, elle s'est
ouverte, elle a coulé, elle s'est épandue, elle a grossi
dans son cours, à l'ombre même et dans le silence de
l'empire. On le sait : au moment où périssait la république,
pour la rappeler, autant que faire se pouvait, et
protester contre le despotisme qui la remplaçait, une
secte philosophique, depuis assez longtemps déjà introduite
à Rome, y grandit, s'y développa avec une singulière
énergie. Le stoïcisme fut, à défaut de la liberté
politique, la nouvelle liberté de Rome. Il s'unit, pour
le consoler, pour le nourrir et le fortifier, au patriotisme
qui, éteint dans le peuple, survivait dans les grandes
âmes. Voilà la veine nouvelle d'où jaillira, sous l'empire,
pure et profonde, la poésie latine. Ennemi de l'héroïde,
de l'élégie, de toute fade poésie, le stoïcisme amènera les vers à leur destination première : la liberté,
la vertu, ce seront là les grands sujets de ses méditations
ou de ses chante. Il ne brigue pas les frivoles honneurs
de la lecture publique ou des couronnes apollinaires;
il dédaigne cette littérature de la table des princes et
leurs jeux poétiques après boire et pendant la digestion.
Naisse donc un esprit généreux, une imagination vive,
un poète enfin épris de ce double enthousiasme de
patriotisme et de philosophie stoïcienne, et la poésie
latine pourra reparaître et trouver des accents nouveaux
et puissants. Déjà le stoïcisme, proprement dit, a eu son
poëte dans Perse : la liberté aura le sien, qui, par une
singulière rencontre, viendra d'où on le devait moins
attendre. En effet, ce chantre de la liberté, ce disciple
aussi du stoïcisme, vous le cherchez sans doute dans
l'école des dëelamateurs, sous le portique des philosophes.
Il en devrait, ce semble, être ainsi; mais non :
le poëte de la liberté et du stoïcisme, c'est la cour de
Néron qui le verra paraître, c'est là qu'il s'élève, là qu'il
grandit.
Sur la fin du règne d'Auguste, un rhéteur espagnol,
:déjà célèbre à Cordoue, sa patrie, vint s'établir à
Rome : c'était Sénèque le rhéteur. Sénèque avait trois
fils : Novatus, qui plus tard prit d'un avocat célèbre qui
l'adopta le nom de Junius Gallion; Sénèque, qui fut le
philosophe, et Marcus Ànnaeus Mela, qui épousa Acilia. fille d'Acilius Lucanus, et eut un fils qui naquit à Cordoue en
l'an 38; ce fils fut Mareus Annaeus Lucain. Déjà
quelque peu célèbre par lui-même, Mela dut à son fils
d'être plus illustre. A l'âge de huit mois, Lucain fut
amené à Rome, où, sous la direction et les auspices de Sénèque le philosophe, son oncle, il fit ses études, parut
et fut élevé à la cour. Devenu gouverneur de Néron,
Sénèque plaça son neveu auprès du jeune prince. Entre
Néron et Lucain, l'amitié fut vive d'abord, mais courte.
Néron avait des prétentions à la poésie, et Lucain n'avait
pas moins de vanité que le prince n'avait d'amour propre.
Cependant, Lucain se prêta d'abord assez complaisamment
aux succès et même à;la supériorité du
prince ; mais cette abnégation ne pouvait durer longtemps.
Elle ne résista pas à une lutte dans laquelle le
prince et le poëte se disputèrent le prix de la poésie.
Lucain chanta la Descente d'Orphée aux enfers, et Néron
la métamorphose de Niobé : Lucain remporta le
prix, « sans qu'il soit aisé, remarque M. Villemain, de
concevoir l'audace des juges. ».Le triomphe de Lucain
blessa vivement Néron; défense fut faite à Lucain, non seulement
de lire ses ouvrages en public
et sur le
théâtre, mais même, s'il en fallait croire Xiphilin, de
composer des vers. Ce fut sans doute alors qu'obligé de
renoncer aux lectures, Lucain renonça aussi aux poèmes
particuliers qui jusque-là avaient fait sa gloire, et se
consacra tout entier à son grand travail de la Pharsale. Commencée sous les auspices de Néron, elle s'acheva
comme une protestation et une vengeance.
Lucain ne s'en tint pas là : doublement aigri contre
Néron, comme poëte interdit des lectures publiques et
comme partisan de la liberté, il entra dans la conspiration
de Pison. Arrêté et interrogé, il fit d'abord bonne
contenance; mais bientôt, cédant à une promesse de la
vie, il dénonça sa mère! Il ne lui en fallut pas moins
quitter la vie, digne de pitié encore peut-être, si plus de
courage eût honoré ses derniers moments; mais loin de
là : il ne cessa, dit Tacite, de dénoncer des complices au
hasard, espérant que ces révélations lui vaudraient la
pitié de Néron. Convaincu enfin qu'il ne lui restait plus
qu'à mourir, il se fit ouvrir les veines, et expira en
récitant et en corrigeant
quelques vers de sa Pharsale. Il avait vingt-sept ans, et était désigné consul pour l'année
suivante.
Ces vers dont, à ses derniers moments, s'enchantait
Lucain, lui ont-ils donné l'immortalité qu'il s'en
promettait? On l'a cru longtemps; longtemps on a
regardé la Pharsale comme un poëme épique; mais de
nos jours sa gloire a été remise en questiqn. On a fait de
l'épopée quelque chose d'extraordinaire, de providentiel
en quelque sorte, une création exceptionnelle, un
don réservé à quelques âges privilégiés de l'humanité.
Une épopée, ce n'est pas seulement le génie qui la fait,
ce sont les siècles qui la préparent et l'achèvent. D'après
cette poétique nouvelle, l'Iliade et la Divine Comédie sont
les deux seules véritables épopées : j'oubliais Shakespeare, dont l'oeuvre dramatique serait aussi une épopée,
mais l'Enéide n'en est pas une, et « le doux maître » du
Dante vient ainsi après son élève; jugez si les autres
poèmes, la Jérusalem délivrée, le Paradis perdu, et à plus
forte raison la Pharsale, peuvent dès lors prétendre à
être des épopées. Mais laissons de côté- ces récentes et
quelque peu contestables théories qui font de l'épopée
une encyclopédie humanitaire, où les peuples viennent
lentement déposer leur science, leur foi, leurs croyances,
leurs moeurs et leur civilisation : produit et résumé
d'une civilisation complète, espèce de cristallisation
mystérieuse qui se forme silencieusement et par couches
séculaires dans la conscience et l'imagination des peuples.
Prenons plus simplement le poëme épique, et
jugeant Lucain d'après les règles de l'ancienne critique,
voyons quels sont les reproches que l'on peut adresser
à la Pharsale et les mérites qu'on lui doit reconnaître.
Lucain, a-t-on dit, a mal choisi et le héros et le sujet
de son poëme : le sujet était trop rapproché de lui pour
se prêter à ces fictions qui sont la condition et le charme
de l'épopée, et Pompée n'était pas un personnage
épique. Pompée, je le sais, a beaucoup perdu de nos jours.
Pour nous, il n'est plus qu'un général heureux, mais
médiocre. Dans la guerre contre Mitliridaté, il n'a eu
qu'à recueillir les fruits des efforts de Lucullus. La
guerre des pirates, non moins pompeusement célébrée,
n'offrait pas plus de difficultés, et en vérité ne méritait
pas plus d'admiration. Quelle merveille qu'avec un
nombre aussi grand de vaisseaux, d'hommes, d'habiles
lieutenants, il ait vaincu trente mille brigands! Tous
ses exploits étaient de grandes actions plutôt que de grands événements. Le citoyen en lui n'a pas été plus
épargné que le général. Si la constitution de la république
a été ébranlée; si César a pu prétendre à la dictature,
c'est que Pompée lui en avait frayé le chemin.
N'ëtait-ee pas en faveur de Pompée qu'avait été portée
cette loi Manilia qui lui conférait des pouvoirs absolus,
exemple dangereux, dont plus tard devait profiter
César? Pompée n'avait-il pas, avec César et Crassus,
formé le premier triumvirat, c'est-à-dire la première
coalition de citoyens ambitieux contre la république?
Enfin cette guerre civile elle-même, ne l'avait-il pas, par
ses prétentions, rendue aussi inévitable, que César par
son ambition? Et une fois déclarée, ne s'était-il pas
montré aussi indécis, aussi imprévoyant à la poursuivre,
à se défendre, lui et son parti, qu'il avait été présomptueux
avant qu'elle eût éclaté? Tel est, et j'adoucis les traits, Pompée aux yeux de la critique moderne.
Ce n'est pas ainsi que le voyaient et que le représentent
les historiens anciens. Ils rappellent que, citoyen
non moins soumis à la loi qu'il avait été habile capitaine,
Pompée, à son retour d'Asie, au moment où l'enthousiasme
pour lui était au plus haut point, avait, en
mettant le pied dans l'Italie, congédié son armée et
s'était rendu à Rome en simple citoyen, bien qu'alors il
eût pu disposer du peuple des villes qui le suivait en
foule. Il est vrai, il se lia avec Crassus et César; mais
la faute n'en fut-elle pas au sénat qui, dans ses défiances, paya par des humiliations les services de Pompée
et le réduisit à chercher des alliances auxquelles
se refusaient sa décence et sa dignité naturelles. Ce
fut surtout Caton, dit Plutarque, qui, en engageant le sénat à ne pas accorder à Pompée quelques satisfactions
de vanité, le jeta dans les bras de César. Quant à la guerre
civile, peut-être eût-il pu, non pas l'éviter, mais s'y
mieux préparer, en prenant conseil de son expérience,
et non de la légèreté des jeunes patriciens qui encombraient son camp, plutôt qu'ils ne le fortifiaient; car
Pompée, il ne le faut point oublier, avait une habileté
peu commune dans l'art de la guerre : là, comme ailleurs,
un bonheur constant ne suppose pas seulement la
supériorité : il la prouve. Dans cette lutte suprême de
Pharsale, il a succombé, il est vrai; mais n'a-t-il pas été
trahi par la fortune, au moins autant qu'il lui a manqué?
A la distance où nous sommes de ces grands événements, il nous est difficile de les bien juger : notre
opinion est fondée sur ce que nous croyons savoir, et les
démarches que nous condamnons, légèrement peut-être,
étaient sans doute décidées par des motifs que nous
ignorons. Tel était donc Pompée pour les Romains :
citoyen respectant les lois, ambitieux du pouvoir, il est
vrai, mais aimant mieux se le faire donner que le
prendre, ce qui est bien quelque chose; habile autant
qu'heureux général; le représentant, malgré ses torts,
de la liberté, et le soutien vaincu, mais glorieux encore,
de la république.
César a gagné auprès de nous tout ce qu'a perdu
Pompée. César, ce n'est pas seulement le génie complet
de la guerre et de la paix, le citoyen magnanime et le
prévoyant politique qui venait relever de leur abaissement
les classes déshéritées du peuple romain, rendre
aux alliés leurs droits méconnus, fonder sur l'égalité un
nouvel ordre social et inaugurer pour le monde tout
entier une ère de paix et de prospérité; César, c'est l'homme même de l'humanité. Ce n'est pas sous ces
traits brillants qu'il apparaissait aux Romains. Je ne
parle pas de ses vices, qui lui furent plus utiles, que contraires,
de même que les vertus privées de Pompée lui
furent une infériorité plutôt qu'un avantage; je ne veux
voir que l'homme public. Eh bien ! qu'était César pour les
Romains? Pour eux, dès sa jeunesse, César est un
citoyen dangereux, perdu de dettes et de débauches, et
se faisant de ses désordres un double instrument d'ambition.
Complice secret de Catilina, il a la main dans
tous les complots qui se trament contre la république.
Tribun factieux, impérieux consul, pour faire passer une
loi agraire, il n'hésite pas à employer la violence contre
son collègue Bibulus et va jusqu'à menacer les jours de
Caton. S'il dompte les Gaules, c'est pour asservir sa
patrie. Malgré la défense du sénat, il franchit la limite
sacrée du Rubicon, entre dans Rome, où sa présence
répand la consternation, pille le trésor public, inaugurant
ainsi par un double sacrilège la guerre civile. Cette
guerre, a-t-il véritablement cherché à l'éviter? Il le prétend;
mais Cicéron, mais Suétone affirment le contraire.
En un mot, citoyen longtemps factieux, général rebelle,
vainqueur sacrilège de sa patrie et de la liberté, tel est
sur César le jugement des anciens. Du moins, dira-t-on,
on ne saurait le nier : César fut le plus clément des
vainqueurs. Oui, clément, il le fut souvent; mais quelquefois
aussi il fut cruel et impitoyable, suivant les
conjonctures : sa clémence était autant calculée que
naturelle; et eût-elle été aussi entière, aussi désintéressée
qu'on l'a faite, cette clémence, était-elle donc si
magnanime? « César, dit Montesquieu, pardonna à tout
le monde; mais il me semble que la modération que l'on montre après qu'on a tout usurpé ne mérite pas de
grands éloges. »
Quanta ses projets humanitaires; les historiens anciens
sont beaucoup moins explicites que les historiens
modernes, qui lui prêtent les idées de notre temps et
leurs propres pensées. On fait un peu de ses projets ce
qu'Antoine fit de son testament : on y met tout ce qu'on
veut. Lui-même, César, il n'en a point parlé : il ne
réclame pas pour le monde entier; il réclame pour son
consulat, sa province, son armée, pour César, en un
mot; dans ses propositions de paix, il ne stipule que
pour lui-même, et non pour le peuple.
Je l'admets toutefois : dans le ressentiment qu'ils
avaient gardé de la perte de la liberté, les Romains ont
pu juger avec trop de rigueur l'homme qui l'avait renversée
et voir sous un jour trop favorable celui qui
l'avait défendue; je ne veux point absoudre en tout
Pompée et le faire, pour le génie politique et guerrier,
l'égal de César; je veux seulement montrer comment, dans l'imagination et l'âme des meilleurs citoyens, la
république et Pompée restaient un culte, un grand et
cher souvenir, et comment en choisissant l'une pour
sujet, l'autre pour héros de son poëme, Lucain ne
s'est pas trompé. Ajoutons que ce qu'on avait jusque-là
connu de l'Empire ne pouvait guère que raviver les regrets
pour la république. Ni Tibère, ni Caligula, ni
Claude, ni Néron n'étaient des maîtres bien agréables;
et quant au changement même de la république en gouvernement
ou plutôt en domination d'un seul, sans examiner
ici cette difficile question, je crois pouvoir dire que, dans la révolution qui avait détruit l'ancienne
constitution de Rome, les Romains ne voyaient pas ce
que depuis on y a vu, l'égalité, mais bien la servitude,
sous le niveau du despotisme. Flétrir ce despotisme,
ressusciter la lutte où le patriotisme l'avait combattu,
prendre, si je puis ainsi parler, la revanche de Pharsale,
c'était donc une généreuse tentative. Était-ce également
un heureux sujet épique, et n'allait-il pas contre cette
illusion d'optique, cette magie et cette majesté du lointain favorables à l'épopée? C'est la seconde critique faite
à Lucain.
Elle date de loin, cette critique. Un contemporain, un
rival de Lucain disait déjà : « Quiconque entreprendra
de traiter un sujet aussi important que celui de la
guerre civile succombera infailliblement sous le faix,
s'il ne s'y est préparé par de sérieuses études. Il ne s'agit
pas, en effet, de renfermer dans ses vers le récit exact
des événements, il faut y arriver par de longs détours,
par l'intervention des dieux; il faut que le génie, toujours
libre dans son essor, se précipite à travers le torrent
de la fiction. » Et à l'appui de cette théorie,
Pétrone, joignant l'exemple au précepte, essayait, sur
la guerre civile, un poëme où il fait figurer toutes les
vieilles divinités de l'Olympe. Nous le reconnaissons :
Lucain n'a pu, ni voulu introduire le merveilleux dans
son poëme, et Voltaire l'en justifie parfaitement : « Virgile
et Homère avaient fort bien fait d'amener les divinités
sur la. scène. Lucain a fait tout aussi bien de
s'en passer. Jupiter, Mars, Vénus étaient des embellissements
nécessaires aux actions d'Énée et d'Agamemnon
: on savait peu de choses de ces héros fabuleux;
les faibles commencements de l'empire romain avaient besoin d'être relevés par l'intervention des
dieux; mais César, Pompée, Caton, Labienus vivaient
dans un autre siècle qu'Énée : les guerres civiles de Rome
étaient trop sérieuses pour ces jeux d'imagination. La
proximité des temps, la notoriété publique de la guerre
civile, le siècle éclairé, politique et peu superstitieux de
Lucain, la solidité de son sujet, ôtaient à son génie
toute liberté d'invention fabuleuse. » Voltaire a eu le
tort de.ne point suivre le sage conseil qu'il donne ici et
d'introduire dans la Henriade ce ressort du merveilleux
dont, avec raison, il félicite Lucain d'avoir su sepasser.
Le merveilleux consacré et classique manque donc,
j'en conviens, dans le poëme de Lucain; mais il y est
remplacé par un autre genre d'intérêt : « A défaut des
dieux homériques qui n'interviennent plus dans l'action,
Lucain, dit M. Villemain, reçoit de son temps une
croyance vague aux visions, aux apparitions, aux prodiges
: c'est le spectre de la Patrie apparaissant éplorée
à l'autre rive du fleuve que va passer César; c'est Marius
levant sa tête au-dessus de son tombeau brisé, et
mettant les laboureurs en fuite; c'est l'ombre de Julie
troublant de ses prédictions fatales le sommeil de Pompée;
c'est enfin cette évocation pleine de terreur et de mélancolie
que fait d'un cadavre, ramassé dans la foule des
morts, cette magicienne que Sextus Pompée va consulter
dans les forêts de Thessalie. » Voilà le merveilleux dans
la Pharsale, merveilleux nouveau et approprié au temps
où écrivait Lucain. On ne croyait plus alors à l'Olympe,
Lucain se passe donc de la mythologie; mais on croyait
à la magie, aussi Lucain ne s'en fait-il pas faute; on
croyait aux oracles, quoi qu'il dise, et chez lui la
pythonisse n'est pas muette. Relèverons-nous, après ces critiques générales, le
reproche fait à Lucain de manquer et d'exactitude historique
et d'unité? Lucain, nous le reconnaissons, n'a
pas retracé tous les événements de la guerre civile : la
Pharsale n'est pas une chronique; il n'a pas « maigre
historien suivi l'ordre des temps; » il s'est transporté
au coeur même des événements , in mediam rem, et a
couru, pour ainsi dire, le plus vite qu'il a pu, au
champ de bataille de Pharsale. Mais s'il n'a ni indiqué,
ni raconté tous les détails de ce duel sanglant, il n'a
du moins oublié aucune des causes principales qui
l'avaient amené, ni omis aucun des grands faits qui en
avaient préparé, suspendu ou précipité le dénoûment.
Qu'importerait d'ailleurs dans la Pharsale cette absence
d'exactitude aussi bien que de merveilleux? L'intérêt
du poëme et sa grandeur ne sont pas là. Nous
l'avons dit, le véritable, le seul sujet, l'âme même de la
Pharsale, c'est la liberté. Sujet réel de la Pharsale, la
liberté en est aussi le véritable héros. Regardons-y bien,
en effet : dans la Pharsale, à proprement parler, Pompée
est moins le principal personnage qu'il n'est un symbole,
le symbole de la liberté. Aussi n'est-il pas le seul
acteur de ce drame sévère : à côté de lui, il y a Caton.
Si la liberté est représentée par Pompée, le stoïcisme
l'est par Caton, ou plutôt stoïcisme et liberté se confondent
pour animer et ennoblir les chants du poëte. Il
est si vrai que Pompée, c'est-à-dire la liberté, n'est pas
le seul héros du poëme, que Pompée mort, l'action n'est :
pas terminée. C'est qu'en effet, quoique vaincue à Pharsale,
la liberté n'a pas entièrement désarmé. Il lui reste
Caton, et avec Caton le stoïcisme qui ne continuera pas seulement la lutte dans les sables de l'Afrique, mais qui
puisant, dans sa défaite même, une énergie de ressentiment
sera, en face de l'empire, l'éternelle protestation du
droit contre la violence. Ce sentiment toujours présent
de regrets et d'espérances, qrai, pour les Romains, faisait
l'intérêt du poëme de Lucain, en est encore aujourd'hui
et en restera le charme le plus puissant, la durable
et véritable grandeur.
Toutefois, nous ne prétendons pas tout absoudre dans
Lucain ; et avant tout, il a ce défaut des écrivains de
décadence, poètes et prosateurs, de ne savoir point s'arrêter
dans un développement, de toujours viser au
sublime. Grande aliquid, dit Perse; c'est aussi la prétention
de Lucain; et si quelquefois il y touche à ce
sublime, il ne sait pas s'y tenir; il le dépasse et tombe
dans le faux et l'exagération. Rencontre-t-il un trait
heureux, il 1'émousse en l'épuisant. Il a peint par cet
hémistiche admirable la consternation qu'a jetée dans
Rome l'annonce de l'entrée de César :
Erravit sine voce doler,
il se gardera bien d'en rester là.. Deux comparaisons,
composées de vingt vers chacune, lui suffisent à peine
pour y noyer et éteindre cette: vive pensée. On sait avec
quelle facilité malheureuse il a paraphrasé ces simples
paroles de César Quid times? Caesarem vehis, au pêcheur
Amyclas, qui hésitait à commettre sa fragile barque
aux vagues soulevées. Le défaut d'amplification était,
du reste, nous l'avons dit, le défaut du temps, et, en
particulier pour Lucain, un défaut de famille.
Dans Sénèque, la nourrice de Médée lui montre que, dans le malheur qui l'accable, il ne lui reste aucun espoir;
Médée répond :
Medea superest,
mot sublime, et auquel elle aurait dû s'arrêter; mais
elle ajoute :
Hic mare et terras vides
Ferrumque et ignes, el Deos, et Fulmina.
Corneille a imité ce passage :
Votre pays vous haït, votre époux est sans foi :
Dans un si grand revers que vous reste-t-il? — Moi!
Moi, dis-je, et c'est assez.
Et voyez la contagion du mauvais goût! Corneille
aussi, à l'exemple de Sénèque, va gâter ce trait ;
— Quoi! vous seule, madame?
— Oui, tu vois en moi seule et le fer et la flamme,
Et la terre et la mer, et l'enfer et les cieux,
Et le sceptre des rois et la foudre des dieux !
Outre ce vice capital, l'intempérance dans le développement,
Lucain a d'autres et plus graves défauts, et
où se marque plus particulièrement l'influence mauvaise
de son temps : la manie et l'abus de l'érudition.
Des descriptions géographiques, scientifiques, astronomiques
même, tiennent dans le poëme une place considérable
; elles interrompent malencontreusement la
narration et brisent l'intérêt. Le style lui-même ne rachète
pas ces vices. La période poétique de Lucain ne
manque pas, il est vrai, d'une certaine harmonie, mais
elle manque de souplesse et de variété. Habile dans la manière dont il brise ses vers, il est en même temps
monotone. Il n'a pas ce mouvement nombreux, ces cadences
savantes et nuancées tout à la fois qui enchantent
l'oreille et attachent l'esprit à la narration. Son coloris
est éclatant, mais uniforme; il ne connaît pas l'art et la
magie des demi-teintes.
Les défauts dans la Pharsale sont donc nombreux ;
mais les beautés, et des beautés de premier ordre, n'y
sont pas rares : Lucain a un éclat d'expression, un relief
de couleur, une énergie et parfois une profondeur
de pensée qui trahissent le génie. Il excelle dans les
portraits, les caractères et les discours. Je ne parlerai
point de ce parallèle de César et de Pompée qui ouvre
si heureusement le poëme et en éclaire la suite d'un
jour si vif; mais qu'y a-t-il au-dessus du portrait de
Caton, et de cet autre portrait de Pompée, si bien placé,
en forme d'oraison funèbre, dans la bouche de Caton?
Les traits dont il a peint Cornélie n'ont point été surpassés
par Corneille, qui les lui a empruntés. Quant à
ses discours, on sait que Quintilien l'a mis au nombre des orateurs plutôt qu'au nombre des poëtes, éloge et critique tout ensemble. Oui, par le trait, par le mouvement,
par la chaleur de la pensée, Lucain est orateur;
mais ce n'est pas assez pour le poëte. Le poëte doit s'oublier
pour donner à ceux qu'il fait parler le langage et
les sentiments convenables, soit à leur caractère, soit
à leur situation; or, à ce point de vue, Lucain est loin
d'être irréprochable; car il prête à tous ses héros sa
propre éloquence, éloquence forte, mais souvent outrée,
déclamatoire : c'est, avec l'inspiration qu'il en reçoit, le
vice que lui donne le stoïcisme : il étend sur tout sa
teinte sombre et monotone.
On a beaucoup vanté la réponse de Caton à Labienus,
qui lui conseille de consulter l'oracle de Jupiter Amrnon ;
je ne saurais partager cette admiration. On voit dans
cette réponse la faiblesse du stoïcisme, à côté de sa
grandeur, sa grandeur dans sa morale, sa faiblesse dans
sa théologie. J'approuve Caton quand, exprimant les
plus nobles sentiments de la conscience et de la raison,
il aime mieux mourir libre en combattant que d'avoir
le spectacle de la tyrannie; quand il proclame le droit
supérieur à la violence, et la vertu, même malheureuse,
préférable au succès; mais je ne le saurais approuver,
quand il dit « que Dieu réside partout où est la terre,
la mer, l'air et le ciel; que Jupiter c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, » théologie panthéiste, et qui
se peut résumer en ceci ; que le sage, c'est-à-dire le
vrai stoïcien, n'a pas besoin de consulter les dieux, parce
qu'il a en lui-même, dès que les choses dans ce bas
monde ne vont pas à son gré, la ressource de se tuer, et
cela en vertu d'une science que le ciel met en nous : Alors que du néant nous passons jusqu'à l'être. Ici, du reste, il faut le dire, Lucain ne fait que paraphraser
Sénèque : « Le sage, qui est assez sage pour ne
tenir pas à la vie, se moque de tout, des dieux, des
hommes et des choses. » Combien j'aime bien mieux
Lucain faisant parler les douleurs touchantes de Cornélie,
que paraphrasant les vagues doctrines de la philosophie
stoïcienne! Il y a dans les accents de l'épouse de
Pompée une émotion naturelle et profonde ; on y sent
un coeur de femme et d'épouse ; Caton au contraire est
parfois déclamateur.
Ne médisons pas cependant du stoïcisme : il a donné
à Rome, avec ses derniers grands citoyens, une littérature
tout entière, littérature moins pure, moins belle
que celle du siècle d'Auguste, mais plus nationale et
plus originale : Perse, Sénèque, Tacite, Juvénal se sont
inspirés du stoïcisme; il est, avec le regret douloureux
de la liberté, l'unité en même temps que l'âme du
poëme sur la guerre civile. «En se livrant sans réserve
à cette inspiration, Lucain, on l'a dit heureusement, a
marqué sa place au-dessous de tous les grands poètes,
mais au-dessus de tous les versificateurs.» On juge trop de Lucain par Brébeuf, qui a encore enchéri sur lui
pour l'emphase et l'exagération : Lucain vaut beaucoup
mieux que son traducteur. Sans doute, Corneille avait
tort de ne le point distinguer de Virgile ; mais, après
tout, malgré les défauts de son propre génie et le mauvais
goût de son siècle, il y a, chez Lucain, une passion,
c'est-à-dire une éloquence, une flamme, la vie du style
et de la pensée. Par la double inspiration du stoïcisme
et de la liberté, il est arrivé à une grandeur réelle :
poëte incomplet, mais poëte, et auquel s'attache cet
intérêt particulier d'avoir été prématurément enlevé à
l'achèvement de son oeuvre : Lucain n'est-ce pas un
peu l'André Chénier latin ?
J.-P. CHARPENTIER
![]()
Exposition du sujet, la guerre civile entre César et Pompée. — Reproches que le poëte adresse aux Romains, à propos de cette fureur qui les arme les uns contre les autres, quand ils ont tant de raisons d'entreprendre d'autres guerres. II faut se consoler pourtant de ces malheurs, et s'en réjouir si les destins n'ont pas trouvé d'autre voie pour amener le règne de Néron. — Apothéose anticipée de Néron; basse flatterie. — Énumération des causes particulières ou générales de la guerre civile. — Portraits de Pompée, de César. — César arrive sur les bords du Rubicon, qui marque la limite de son gouvernement. L'image de la patrie désolée se dresse devant lui et le conjure de ne pas avancer plus loin avec son armée. César, après un moment d'hésitation, passe le fleuve. — Prise d'Ariminum pendant la nuit. Les habitants, réveillés par le bruit des trompettes, voient leur ville envahie par une armée, et déplorent en silence leur malheureux sort. — Au point du jour, les tribuns, forcés de s'enfuir de Rome, arrivent au camp de César; l'un deux, Curïon, excite César à presser la guerre. — César, enflammé par ce discours, harangue ses soldats et leur parle de marcher sur Rome. Il accable Pompée et le sénat d'invectives, et se promet la faveur des dieux, qui doivent protéger la justice de sa cause. — L'armée se rend à ce discours, et un chef de cohorte, Lélius, proteste qu'il suivra partout César; que s'il faut égorger pour lui frère, père, épouse, s'il faut détruire Rome, il est tout prêt : toute l'armée fait le même serment. — César rappelle ses légions dispersées dans diverses parties de la Gaule ; énumération de ses forces. — César, à la tête de toutes ses légions rassemblées, envahit l'Italie, et répand de tous côtés une si grande terreur, que le sénat et Pompée lui-même s'enfuient de Rome. — Signes et présages des calamités prochaines. — Tableau de la désolation de Rome et de l'Italie. — Autres prodiges sinistres. — On consulte les devins toscans; Aruns et Figulus sont interrogés, lis ordonnent de purifier les murs de Rome par des lustrations solennelles; description de cette cérémonie expiatoire. Aruns égorge une victime, considère ses entrailles, et n'y découvre que des malheurs; Figulus les annonce. — Fureur prophétique d'une dame romaine qui, inspirée par Apollon, prédit les principaux événements de la guerre civile.
Je chante les guerres plus que civiles dont la Thessalie fut le théâtre; le crime prenant force de loi, un peuple puissant tournant ses mains victorieuses contre ses entrailles, deux camps unis par les liens du sang. l'Empire déchiré, toutes les forces du monde ébranlé servant à un crime commun, aigle contre aigle, Romain contre Romain. 0 citoyens, quelle fureur! quel amour insensé des combats! est-ce à vous d'assouvir la haine des nations dans le sang de votre patrie? La superbe Babylone s'enorgueillit de nos trophées ; l'ombre errante de Crassus demande vengeance ; et vous cherchez des combats qui n'auront jamais de triomphes! Hélas! quelles conquêtes n'aurait pu payer le sang versé par des mains romaines? Des régions où naît le jour jusqu'aux bords où la nuit s'ensevelit avec les étoiles, des lieux brûlants que le midi embrase, aux contrées brumeuses où ne règne jamais le doux printemps, où la mer de Scythie est emprisonnée sous les glaces, le Sère, l'Arménien barbare, les peuples, s'il en est, qui voient naître le Nil, tout serait dompté. Alors si telle est ton ardeur pour une guerre détestable, maîtresse du monde entier, ô Rome, tourne tes mains contre toi-même. Mais as-tu manqué d'ennemis? Les villes d'Italie s'écroulent sous leurs toits brisés ; leurs murailles ruinées ne sont plus que des débris épars ; les maisons n'ont plus de gardien qui les protège; l'habitant solitaire est errant dans leur vaste enceinte; l'Hespérie dès longtemps inculte est couverte de ronces; les mains du laboureur manquent aux champs qui les demandent. Ce n'est pas toi, farouche Pyrrhus, ce n'est pas toi, fier Annibal, qui nous as causé tant de maux : le fer étranger ne nous fit jamais de si profondes blessures ; ces coups partent d'une main domestique. Si les destins n'ont pu frayer à l'arrivée de Néron d'autres chemins, s'il faut payer cher les royautés éternelles des dieux, si l'Olympe n'obéit à Jupiter qu'après la guerre des géants terribles, cessons de nous plaindre, ô dieux; j'aime le crime et le sacrilège payés d'un tel prix. Que Pharsale emplisse de carnage ses plaines odieuses, que les mânes des Carthaginois s'abreuvent de notre sang, que les dernières batailles se heurtent sous les murs funestes de Munda ; à ces destins ajoute, César, Pérouse affamée (1), Mutine (2)aux abois, nos flottes détruites à Leucade (3), et la guerre des esclaves aux pieds brûlants de l'Etna (4). Rome doit cependant beaucoup aux guerres civiles, puisque tout fut fait pour toi. Quand s'achèvera ton séjour ici-bas, tu monteras plein de jours vers les astres, le palais de l'Olympe, ta demeure préférée, te recevra avec allégresse. Soit que tu veuilles tenir le sceptre, soit que, monté sur le char étincelant de Phébus, tu préfères éclairer la terre de tes feux errants,, qui charment le monde, toute divinité te cédera sa place, et la nature te laissera choisir ta royauté. Mais tu ne prendras pour demeure ni les régions du nord, ni les régions brûlées des feux de Sirius et d'où ton astre jetterait sur Rome d'obliques rayons. Si tu pèses sur un point extrême du vaste Éther, l'axe du ciel gémira sous le faix. Garde au centre l'équilibre du monde. Que ce point du ciel soit serein, qu'aucune nuée ne cache César. Qu'alors le genre humain pose les armes, que toutes les nations s'aiment d'un commun amour, et que la paix, descendue sur la terre, ferme les portes de fer du belliqueux Janus. Mais tu es déjà un dieu pour moi.
1 Pérouse, en latin Perusia, et en italien Perugia, ville toscane, et l'une des douze villes bâties par les Étrusques à leur arrivée en Italie. Octave, qui fut depuis Auguste, assiégea Lucius Antonius, frère du triumvir, et le réduisit par la famine. Voyez Appien, Guerres civiles, liv. 111 et V.
2 Aujourd'hui Modène, ville des Boïens, dans la Gaule Cispadane. Antoine y tint Décimus Brutus assiégé; mais, vaincu dans la bataille de Modène par les consuls Hirtius et Pansa qui y périrent, il fut chassé d'Italie par Octave. Voyez Appien, Guerres civiles, liv. 111, ch. XLIX et suiv.
3 Promontoire d'Épire, auprès duquel Octave César défit Antoine et Cléopâtre, à la bataille d'Actiuin. Voyez Florus, liv. II, ch. II, et Virgile, Enéide, liv. VIII, v. 676.
4 Il ne s'agit point ici, comme on l'a cru de la guerre des esclaves, commandés par Etmus le Syrien, dont Plutarque parle dans ses Vies, mais de celle que Sexlus Pompée fit ensuite au parti de César, à la tête d'une armée d'esclaves qu'il avait enrôlés.
Puisse le poëte te recevoir dans son sein, il n'invoquera pas le dieu de Cyrrha, il n'appellera pas
Bacchus loin de Nysa. C'est assez de toi pour inspirer les chants
d'un Romain.
Je veux remonter à la source de nos malheurs; c'est m'ouvrir
une carrière immense.
Quelle est la cause qui entraîna ce peuple aux fureurs des
combats, et qui chassa la paix de la terre? L'envieuse fatalité;
l'arrêt porté par le destin, que rien d'élevé ne soit stable; la
chute qu'entraîne un trop pesant fardeau; Rome que sa grandeur
accable.
Ainsi, lorsque les siècles accumulés amèneront l'instant de la
dissolution du monde, tout rentrera dans l'ancien chaos, les
astres confondus se heurteront contre les astres, la mer engloutira
les étoiles, la terre refusera d'embrasser la mer et la chassera
de son lit, Phoebé s'avancera contre son frère, dédaignant
l'oblique chemin où marchent ses coursiers, et demandera pour
elle l'empire du jour; l'ébranlement universel de la machine en
détruira l'ordre et l'accord.
L'excessive grandeur s'écroule sur elle-même : c'est le terme
que les dieux ont mis à la prospérité. La fortune n'a voulu confier à aucune nation du monde le soin de sa haine contre
les Romains : c'est toi, Rome, c'est toi qu'elle a rendue, sous
trois tyrans, l'instrument de ta ruine; c'est leur concorde impie (1) qui t'a perdue. Fatale alliance des chefs ! aveugle ambition !
pourquoi unir vos forces et vous disputer l'univers en butte à
vos coups?
Non, tant que la terre contiendra la mer; que l'air balancera
la terre, que Phoebus se lassera à rouler son char et que la nuit
suivra le jour à travers les mêmes signes, jamais il n'y aura de
sincère accord dans le partage du rang suprême. L'autorité ne
veut, point de compagne. N'en cherchons pas les exemples loin
de nous; le fondateur des murs les souilla du sang d'un frère.
Et ce n'était pas l'empire du monde qu'on se disputait avec tant
de fureur; un étroit asile divisa ses maîtres.
On vit quelque temps subsister entre Pompée et César une
paix simulée et contrainte. Crassus, au milieu de ces deux
rivaux, tenait la guerre comme en suspens.
Tel l'isthme étroit soutient seul le choc des deux mers qu'il
sépare; que la terre se retire, la mer Egée va se briser contre
la mer d'Ionie.
1 Il s'agit ici du premier triumvirat dans lequel César, Pompée et Crassus se partagèrent la république.
Ainsi la mort déplorable de Crassus en souillant de sang romain les murs assyriens de Carres, nous a livrés à nos propres fureurs. La victoire des Parthes a déchaîné nos haines. Heureux Arsacides ! dans cette journée vos succès ont passé votre attente : vous avez donné la guerre civile aux vaincus. L'empire est partagé par le fer, et la fortune d'un peuple puissant, qui embrasse la terre, les mers, le monde entier, ne peut contenir l'ambition de deux hommes. 0 Julie! seul gage de leur alliance, tu n'es plus. Les flambeaux de ton hymen, allumés sous le plus noir auspice, se sont éteints dans le tombeau. O toi! que les cruelles Parques ont enlevée au monde! si le destin t'eût laissé vivre, tu aurais pu, à l'exemple des Sabines, te précipiter entre ton père et ton époux, les retenir, les désarmer, joindre leurs mains dans tes mains pacifiques. Ta mort affranchit Pompée et César des liens de la foi jurée : rien ne s'oppose plus à cette jalousie impatiente, à cette, émulation de gloire, qui les presse de ses aiguillons. Toi, Pompée, tu crains que l'éclat de tes anciens travaux ne soit obscurci par de nouveaux exploits, et que la conquête des Gaules n'efface tes triomphes sur les pirates : cette longue suite de prospérités et d'honneurs te remplit l'âme d'orgueil, et ta fortune ne peut se résoudre à partager le premier rang. César ne veut rien qui le domine ; Pompée ne veut rien qui l'égale. Lequel des deux partis fut le plus juste? on ne peut le dire sans crime. Chacun a pour lui un puissant suffrage. Les dieux se déclarent pour le vainqueur, mais Caton s'attache au vaincu. Les forces ne sont pas égales. Pompée, sur le déclin des ans, amolli par le long usage des dignités pacifiques, avait oublié la guerre au sein du repos, tout occupé de sa renommée, soigneux de plaire à la multitude, poussé par le vent de la faveur populaire, et flatté de recueillir les applaudissements de son théâtre, il se reposait, sur son ancienne fortune, sans se préparer des forces nouvelles : il lui restait l'ombre d'un grand nom. Tel, au milieu d'une fertile campagne, un chêne superbe, chargé des dépouilles des peuples et des trophées des guerriers. Il ne tient à la terre que par de faibles racines; son poids seul l'y attache encore. Il n'étend plus dans les airs que des branches dépouillées, c'est de son bois, non de son feuillage, qu'il couvre les lieux d'alentour. Mais quoiqu'il chancelle, prêt à tomber sous le premier effort des vents, quoiqu'il s'élève autour de lui des forêts d'arbres robustes, c'est lui seul qu'on révère. Au nom, à la gloire d'un grand capitaine, César joignait une valeur qui ne souffrait ni repos, ni relâche, et qui ne voyait de honte qu'à ne pas vaincre dans les combats. Ardent, infatigable, où l'ambition, où le ressentiment l'appelle, c'est là qu'il vole le fer à la main. Jamais le sang ne lui coûte à répandre. Hâter ses succès, les poursuivre, saisir et presser la fortune, abattre tout ce qui s'oppose à son élévation, et s'applaudir de s'être ouvert un chemin à travers des ruines : telle était l'âme de César. Ainsi la foudre que le choc des vents fait jaillir des nuages, brille et remplit l'air d'un bruit qui fait trembler le monde. Elle sillonne le jour, répand la terreur au sein des peuples pâlissants que sa flamme éblouit, frappe et détruit ses propres temples, perce les corps les plus durs, marque sa chute et son retour par un vaste ravage, et rassemble ses feux dispersés. Aux intérêts cachés de ces deux rivaux, se joignaient les semences publiques de discorde qui ont toujours perdu les États florissants. Dès que Rome triomphante se fut enrichie des dépouilles du monde vaincu, que la prospérité eut corrompu les moeurs, et que le brigandage eut amené le luxe, plus de bornes dans nos richesses, dans nos palais : notre goût dédaigna la frugalité de nos pères; les hommes disputèrent, aux femmes des parures à peine décentes pour elles. La pauvreté, mère féconde des héros, sevit bannie : et l'univers entier fournit ce qui fait la perte des nations! Ce fut à qui étendrait le plus loin les limites de ses domaines : on vit les champs autrefois sillonnés par la pesante charrue des Camilles, les champs que la bêche antique des Curius avait défrichés, former de vastes campagnes, sous des possesseurs inconnus. Ce n'était plus ce peuple fait pour goûter une paix innocente et se reposer sur ses armes victorieuses dans le sein de la liberté. Alors on vit naître les haines promptes à s'allùmer. Le crime ne coûta plus rien, conseillé par l'indigence. On mit l'honneur suprême à se rendre plus puissant que sa patrie, même le fer à la main. De là le droit mesuré sur la force, les lois du sénat et du peuple violées, les tribuns avec les consuls se disputant la tyrannie, les faisceaux enlevés à prix d'argent, le peuple achetant la faveur du peuple; la brigue, cette peste publique, renouvelant tous les ans dans le champ de Mars l'enchère des dignités vénales, l'usure dévorante, les pactes ruineux, la bonne foi chancelante et la guerre devenue pour beaucoup un besoin. Déjà César avait franchi le sommet glacé des Alpes, l'esprit violemment agité, le coeur plein de la guerre future. A peine fut-il arrivé aux bords étroits du Rubicon (1), une grande ombre lui apparut : c'était l'image de la patrie ! elle brillait dans l'ombre de la nuit. Elle était tremblante et consternée. De son front couronné de tours, ses cheveux blancs tombaient épars.
1 Le Rubicon, ainsi nommé à
cause des pierres rouges qui se trouvent dans son lit et sur ses bords, séparait l'Italie de la Gaule Cisalpine, ou
Gallia Togata." La politique n'avait point permis qu'il y eût des
armées auprès de Rome, mais elle n'avait pas souffert non plus que
l'Italie fût entièrement dégarnie de troupes; cela fit qu'on tint des troupes considérables dans la Gaule Cisalpine, c'est-à-dire dans le
pays qui est depuis le Rubicon, petit fleuve de la Romagne, jusqu'aux
Alpes. Mais pour assurer la ville de Rome contre ces troupes, on fit
le célèbre sénatus-consulle que l'on voit encore gravé sur le chemin
de Rimini à Césène, par lequel on dévouait aux dieux infernaux, et
l'on déclarait sacrilège et parricide quiconque avec une légion, avec
une armée ou avec une cohorte passerait le Rubicon." Montesquieu,
ch. vi.
Lucain raconte en poête ce passage du Rubicon, et dépasse la vérité
historique; cependant il ne fait que donner une forme plus vive
et plus saisissante à ce qui se passa réellement : " A ce moment,
dit Plutarque, frappé tout à coup des réflexions que lui suggérait
l'approche du danger, et qui lui montrèrent de plus près la grandeur
et l'audace, de son entreprise, il s'arrêta; et, fixé longtemps
à la même place, il pesa, dans un profond silence, les différentes résolutions
qui s'offraient à son esprit, balança tour-à-tour les partis
contraires, et changea plusieurs fois, d'avis. Il en conféra longtemps
avec ceux de ses amis qui l'accompagnaient, parmi lesquels était
Asinius Pollion ; il se représenla tous les maux dont le passage de ce
fleuve allait être suivi, et tous les jugements qu'on portcrail de lui
dans la postérité. Enfin, n'écoutant plus que sa passion, et rejetant
tous les conseils de la raison, pour se précipiter aveuglément dans
l'avenir, il prononça ce mot si ordinaire à ceux qui se livrent à des
aventures difficiles et hasardeuses : « Le sort en est jeté, etc. » Vie de César, ch. xxxvii.
Debout devant lui, les bras nus, elle prononce ces paroles entrecoupées de gémissements : « Où allez-vous, soldats, où portez-vous mes enseignes? Si vous respectez les lois, si vous êtes citoyens, arrêtez! un pas de plus serait un crime. » A ces mots, le coeur de César est saisi d'horreur; ses cheveux se dressent sur sa tête, et la langueur dont il est abattu enchaîne ses pas au rivage. Mais bientôt : « O Jupiter! s'écria-t-il, ô toi que mes aïeux ont adoré dans Albe naissante, et qui, du haut du Capitole, veilles aujourd'hui sur la reine du monde ; et vous, dieux tutélaires des Troyens, qu'Énée apporta dans l'Ausonie; et toi, Romulus, qui, enlevé au ciel, devins l'objet de notre culte; et toi, Vesta, qui vois sur tes autels brûler sans cesse le feu sacré; et toi, Rome, qui fus toujours une divinité pour moi, favorisez mon entreprise. Non, Rome, ne crois pas voir César te poursuivre, armé du flambeau des Furies. Vainqueur sur la terre et sur les mers, il est encore à toi, si tu le veux ; il est ton soldat, il le sera partout. Celui-là seul sera criminel qui fera de César l'ennemi de Rome. » A ces mots, sans plus différer, il fit passer le fleuve à ses troupes. Tel dans les déserts ardents de la poudreuse Lybie, un lion, dès qu'il aperçoit le chasseur, s'arrête, paraît hésiter, et rassemble toute sa fureur. Sitôt qu'il s'est battu les flancs de sa queue, qu'il a dressé sa crinière, et que le bruit sourd du rugissement a retenti dans sa gueule profonde; soit que le Maure léger lui darde sa lance ou lui présente la pointe de l'épieu, il se précipite lui-même, sans crainte, au-devant du fer. Le Rubicon aux flots rouges, faible dans sa source, roule à peine ses eaux défaillantes sous les signes brûlants de l'été; il serpente au fond des vallées, et sépare les champs de la Gaule, des campagne de l'Italie. Mais l'hiver lui donnait alors des forces : trois mois de pluies avaient grossi ses ondes, et les neiges des Alpes, fondues par l'humide haleine du vent du midi, l'enflaient encore de leurs torrents. Pour soutenir le poids des eaux, la cavalerie s'élance la première, et dans son oblique passage, elle oppose une digue à leur cours. L'impétuosité du fleuve, alors suspendue, permet aux bataillons de s'ouvrir un chemin facile à travers les ondes obéissantes. Déjà César a franchi le fleuve, il touche à la rive opposée; et dès qu'il a mis un pied rebelle dans cette Italie interdite à ses voeux : « C'est ici, dit-il, c'est ici que je laisse la paix et les lois déjà violées. Fortune! je m'abandonne à toi ! Plus de lien qui me retienne. J'ai pris pour arbitre le sort, et la guerre sera mon juge. » A l'instant son ardeur infatigable presse les pas de ses guerriers à travers les ombres de la nuit ; il va, plus rapide que la pierre lancée par la fronde du Baléare ou que la flèche du Parthe fuyard. Et le soleil à peine avait effacé les étoiles, lorsque César entra menaçant dans les murailles d'Ariminum. Le jour se lève, ce triste jour qui doit éclairer les premiers troubles de la guerre ; mais soit que les dieux ou l'Auster orageux eussent assemblé les nuages, leur voile funèbre obscurcit les airs. Cependant les soldats de César s'étant emparés de la place publique, il ordonne que ses étendards y soient arborés ; et à l'instant même le bruyant clairon, la trompette éclatante donnent le signal d'une guerre impie. Le peuple s'éveille; les citoyens arrachés au sommeil, se saisissent des armes suspendues autour de leurs dieux domestiques, des boucliers rompus, des lances émoussées, des glaives dévorés par la rouille, tels que les offre une longue paix. Mais lorsqu'ils reconnaissent les aigles romaines, qu'ils aperçoivent la haute taille de César au milieu de ses soldats, la frayeur enchaîne les membres glacés, et ce n'est qu'au fond de leurs coeurs qu'une douleur muette ose former ces plaintes : « 0 murs trop voisins des Gaulois, à combien de maux votre situation nous condamne ! Tous les peuples jouissent d'une profonde paix, et nous, si des furieux courent aux armes, nous sommes leur première proie, cette enceinte est leur premier camp. Pourquoi le sort ne nous a-t-il pas fait habiter des cabanes errantes sous le char brûlant du soleil, sous les astres glacés de l'Ourse, plutôt que de nous donner à garder les barrières de l'Italie? Les premiers, nous avons vu les Gaulois y pénétrer, les Cimbres (1) s'y répandre, les Carthaginois fondre du haut des Alpes; les courses et les fureurs des Teutons désoler ces bords ; toutes les fois que la Fortune insulte Rome, c'est ici le chemin de la guerre. »
1 Ils'agit de l'invasion des Cimbres, qui, après avoir détruit trois armées romaines, furent exterminés par C. Marius, ainsi que les Teutons.
Tels sont les gémissements étouffés de ce peuple, la crainte même n'ose paraître, et la douleur n'a point de voix. Le silence de ces murs est égal au silence des forêts, quand les frimats font taire les oiseaux et à celui de la mer, quand le calme enchaîne les ondes immobiles. La lumière du jour avait dissipé les froides ombres de la nuit, et César balançait encore; mais bientôt la Discorde armée de nouveaux feux, vient irriter ses ressentiments et le délivrer du frein de la honte. La Fortune elle-même travaille à légitimer ses projets et à justifier sa révolte. Rome incertaine entre l'obéissance et la révolte a vu le sénat, toujours menaçant au seul nom des Gracques, chasser les tribuns au mépris des lois. Les tribuns se réfugient sous les drapeaux déjà déployés de César, et Curion (1), audacieux et vendu, les accompagne; Curion qui fut jadis la voix du peuple, Curion qui osa soulever le peuple contre l'autorité menaçante des grands ; il trouve César agité de pensées diverses et lui parle en ces mots : « Tant qu'on a permis à ma voix de s'élever en ta faveur, César, nous avons prolongé, en dépit du sénat, le commandement qu'il t'envie. Alors j'avais le droit de paraître à la tribune et d'entraîner vers toi la multitude flottante des Romains. Mais depuis que la force a fait taire les lois, on nous chasse du sein de nos dieux, et tu nous vois exilés volontaires. C'est à toi, c'est à ta victoire de rendre à Rome ses citoyens. Hâte toi, César, tout chancelle; les partis n'ont ni fermeté, ni vigueur. Quand tout est prêt, pourquoi différer? Les dangers ne sont-ils pas les mêmes que tu as bravés tant de fois? Et combien plus grand en est le prix! La Gaule, un coin de la terre, t'a coûté dix ans de guerre ; ose livrer quelques combats, dont le succès est facile et sûr, Rome est à toi et le monde avec elle. Ne crois pas que ton retour soit décoré des honneurs du triomphe, le Capitule n'attend pas tes lauriers; la dévorante envie te refuse tout, à peine te pardonnera-t-elle d'avoir dompté les nations : le gendre a résolu d'éloigner le beau-père, tu ne peux partager le monde, tu peux le posséder seul. »
1 Curion avait été d'abord partisan de Pompée; mais César l'avait gagné à prix d'argent. Vendidit urbem,dil notre auteur, au dernier vers de son livre IV. I.ucain (liv. IV, v. 811 et suiv.) le représente comme un des plus grands hommes que Rome ait portés dans son sein. Velleius Paterculus (liv. II, ch. XLVIII) en porte le même jugement. Il mourut misérablement en Afrique. Voyez Phars, Liv. IV. Ce fut lui qui, par son éloquence et ses brigues, prolongea pendant dix années un commandement que César n'avait reçu que pour deux.
Tel on voit le coursier d'Élide, impatient de quitter la barrière,
où, tête baissée il agite son frein, devenir plus fougueux
encore aux cris de la foule ; tel, à la voix de Curion, César qui
déjà respirait la guerre, s'enflamme d'une nouvelle ardeur. Il
commande, et ses soldats armés accourent en foule aux drapeaux.
Il apaise d'un regard leurs mouvements tumultueux, et
de la main leur imposant silence : « Compagnons de mes travaux,
leur dit-il, vous qui depuis dix ans n'avez cessé de vaincre
avec moi, exposés à des périls sans nombre, voilà donc le prix
de notre sang versé dans les plaines glacées du nord, de nos blessures,
de nos trépas et des hivers passés sous les Alpes. Si le
Carthaginois les traversait, causerait-il plus de trouble dans Rome? On grossit les cohortes de nouveaux soldats ; partout les
forêts tombent et se changent en vaisseaux; l'ordre est donné
de poursuivre César sur la terre et sur les mers. Que serait-ce,
si vaincu moi-même, j'avais laissé le champ de bataille couvert
de mes drapeaux; si je fuyais devant les féroces Gaulois? Lors
même que la fortune me seconde, que les dieux m'appellent au
comble de la gloire, on ose me défier! Qu'il vienne ce chef
amolli par les délices de la paix, qu'il vienne avec ses soldats
faits à la hâte, ses milices revêtues de la toge, ce Marcellus
qui harangue sans cesse, et ces Catons, noms imposants et
vains. De quel droit des clients à gage le rassasient-ils depuis
tant d'années d'une autorité sans bornes ? De quel droit a-t-il
triomphé avant l'âge fixé par les lois? De quel droit prétend-il
ne déposer jamais les dignités une fois usurpées? Parlerai-je
des lois supprimées dans tout l'univers, de la famine appelée à
Rome pour servir son ambition? N'avons-nous pas vu ses cohortes
répandre l'effroi dans le Forum? Une enceinte de glaives
menaçants, appareil inconnu jusqu'alors, investir le tribunal
épouvanté ! Les soldats s'ouvrir un passage à travers l'assemblée
des juges, et les satellites de Pompée environner Milon avant qu'il
fût jugé? A présent, pour ne pas languir dans une obscure vieillesse, il nous suscite une guerre coupable, accoutumé qu'il est à
porter les armes contre son pays. Sylla, son maître, l'instruisit au
crime ; il ira plus loin que Sylla. Comme les tigres, lorsque sur
les pas de leurs mères ils ont bu dans les forêts d'Hyrcanie le
sang des troupeaux égorgés, ne dépouillent jamais leur férocité,
ainsi, Pompée, accoutumé à lécher le sang dont dégouttait le
glaive de Sylla, la même soif te tourmente encore, et depuis
que tes lèvres ont goûté ce breuvage affreux, ton coeur est insatiable.
Cependant quel sera le terme de ta puissance et de tes
forfaits? Que du moins l'exemple de Sylla t'apprenne à descendre
du trône. Après avoir défait les pirates vagabonds de
Cilicie, après avoir réduit Mithridate à joindre le fer au poison,
pour se délivrer du fardeau d'une guerre qui l'accablait, veux-tu
couronner tes exploits par la ruine de César? Pour quel crime?
pour n'avoir pas obéi quand tu lui ordonnais de déposer ses
aigles victorieuses. Mais si l'on m'arrache le prix de mes travaux,
qu'on récompense du moins ces guerriers. Ils ont longtemps
combattu sans moi; qu'ils triomphent sans moi, j'y consens, et
qu'un autre paraisse à leur tête le jour du triomphe. Où traîneront-
ils après la guerre leur vieillesse languissante? Quelle retraite
auront-ils en quittant les drapeaux-? Quels champs donnerez-vous aux vétérans, quel asile aux vieillards? 0 Pompée,
leur préfères-tu tes colonies de pirates? C'en est trop, levez
ces étendards dès longtemps victorieux, marchons, et servons nous
des forces que nous ne devons qu'à nous-mêmes. A qui
se présente les armes à la main, refuser ce qui lui est dû, c'est
accorder tout ; et ne craignez pas que les dieux nous manquent,
ce n'est point au pillage, ce n'est pas à l'empire que je cours;
nous allons chasser de Rome les maîtres superbes qu'elle est
prête à servir. »
Il dit. Un long murmure, un frémissement sourd répandu
dans la foule exprima les mouvements divers dont les esprits
étaient combattus. La piété, l'amour du pays ne laissaient pas
que d'attendrir ces âmes endurcies au carnage et aveuglées par
le succès; mais leur ardeur pour les combats, leur respect pour
César les entraîne.
Alors Lélius, premier centurion, couronné du chêne qui
atteste qu'on a sauvé un citoyen dans les combats, s'écrie :
« Arbitre suprême des destins de Rome, s'il est permis à la vérité
de te parler par ma voix, nous nous plaignons que ta patience
ait si longtemps enchaîné nos mains. As-tu cessé de
compter sur nous? Quoi! tandis que le sang qui coule dans nos
veines échauffe encore notre courage, tu souffriras l'avilissement de la toge et la tyrannie du sénat ! Est-ce donc un malheur si
grand que de vaincre dans la guerre civile? Mène-nous chez les
Scythes barbares ; sur les bords inhospitaliers des Syrtes ; dans
les sables brûlants de la Lybie dévorée de feux, je te suivrai.
Cette main, pour laisser après toi l'univers subjugué, n'a-t-elle
pas enchaîné sous la rame les vagues irritées de l'Océan? N'a-t-
elle pas dompté le Rhin fougueux et fendu ses eaux écumantes
? Dès que tu commandes, rien ne m'arrête, je dois pouvoir
tout ce que tu veux. Celui que tes trompettes m'annoncent
pour ennemi n'est plus un citoyen pour moi. Je le jure par ces
drapeaux qu'ont signalés dix ans de victoires; je le jure par tous
les triomphes que tu as remportés sur les nations : si tu m'ordonnes
de plonger mon épée dans le sein de mon frère, dans
la gorge de mon père, dans les flancs de ma femme au terme
de l'enfantement, quoique frémissant, j'obéirai. Faut-il dépouiller
les autels? embraser les temples? de notre camp la flamme ira
dévorer l'autel de Junon Monéta. Veux-tu camper sur les bords
du Tibre toscan? j'irai moi-même, sans trembler, tracer ton
camp dans les campagnes de Rome. Nomme les murs que tu
veux raser, cette ville fût-elle Rome, mes bras vont pousser le
bélier qui en dispersera les débris. » A ce discours, toutes les cohortes applaudirent, et leurs
mains élevées s'offrirent à César, quoi qu'il fallût exécuter. Le
bruit de l'acclamation fut égal au bruit des forêts de la Thrace,
lorsque l'impétueux Borée se précipite et mugit contre les rocs
du mont Ossa, et que les chênes courbés jusqu'à leurs racines
relèvent leurs branches fracassées avec un long gémissement.
Dès que César voit ses soldats embrasser avec joie le parti
de la guerre et les destins l'entraîner, pour ne pas laisser ralentir
sa fortune, il se hâte de rassembler les légions répandues
dans les campagnes de la Gaule et d'investir Rome de toutes
parts.
On quitte les tentes plantées aux bords du Léman profond,
et les camps assis sur les roches escarpées des Vosges pour
contenir le belliqueux Lingon aux armes peintes. Ceux-ci
quittent les bords de l'Isère qui longtemps conduit dans son lit,
tombe dans un fleuve d'une renommée plus grande et ne porte pas
son nom aux rives de l'Océan. Les blonds Ruthènes sont affranchis
d'une longue occupation. Le paisible Atax se réjouit de ne
plus porter les barques romaines, et le Var d'être devenu la
limite de l'Italie. On quitte le port qui, sous le nom sacré d'Hercule,
resserre la mer entre ses rochers creux. Le Corus et le Zéphyr ne peuvent rien sur lui. Circius trouble seul ses rivages
et défend la station de Monoecum.
La même joie se répandit sur ce rivage que la terre et la mer
semblent se disputer quand le vaste Océan l'inonde et l'abandonne
tour à tour. Est-ce l'Océan lui-même qui de l'extrémité
de l'axe roule ses vagues et les ramène? Est-ce le retour périodique
de l'astre de la nuit qui les foule sur son passage? Est-ce
le soleil qui les attire pour alimenter ses flammes? Est-ce lui
qui pompe la mer et qui l'élève jusqu'aux cieux? Sondez ce
mystère, vous qu'agite le soin d'observer le travail du monde.
Pour moi, à qui les dieux t'ont cachée, cause puissante de ce
grand mouvement, je veux l'ignorer toujours.
On voit flotter les enseignes et dans les campagnes de Reims,
et sur les rives de l'Atur, où l'habitant de Tarbes voit la mer
doucement expirer dans un golfe arrondi. Le Santon salue avec
allégresse le départ de l'ennemi; le Biturge, le Suesson qui manie
lestement ses longues armes ; le Leuque et le Rhémois habiles
à darder le javelot; le Séquane qui excelle à faire tournoyer les
coursiers; le Belge, habile conducteur du char armé d'éperons;
l'Arveme, issu du sang troyen et qui se prétend notre frère; le Nervien rebelle, que souille encore le sang de Cotta; le Vangion
vêtu des larges braies du Sarmate; le farouche Batave qu'excite
le bruit des clairons d'airain ; l'habitant des rives de Ferrante
Cinga, celui du Rhône, qui entraîne l'Arare dans ses flots rapides
; ceux qui habitent le cime des Gévennes, suspendue sur
des roches chenues, et toi aussi, Trévire, tu te réjouis de voir
la guerre changer de théâtre.
Vous respirez en liberté, Liguriens tondus, jadis préférés aux
Comates chevelus ; et vous peuples, qui répandez le sang humain
sur les autels de Teutatès, de Taranis, et d'Hésus, divinités plus
cruelles que la Diane de Tauride ; vous recommencez vos chants,
bardes, qui consacrez par des louanges immortelles la mémoire
des hommes vaillants frappés dans les combats. Et vous,
Druides, vous reprenez vos rites barbares, vos sanglants sacrifices
que la guerre avait abolis. Vous seuls avez le privilège de
choisir entre tous les dieux ceux qu'on doit adorer, ceux qu'on
doit méconnaître. Vous célébrez vos mystères dans des forêts
ténébreuses ; vous prétendez que les ombres ne vont point peupler
les demeures tranquilles de l'Érèbe. les sombres royaumes
de Pluton ; mais nos esprits dans un monde nouveau vont animer de nouveaux corps. La mort, à vous en croire, n'est que
le milieu d'une longue vie. Cette opinion fût-elle un mensonge,
heureux les peuples qu'il console, ils ne sont point tourmentés par la crainte du trépas; de là cette ardeur qui brave le fer, ce
courage qui embrasse la mort, cette honte attachée aux soins
d'une vie qui doit renaître.
Ainsi la Gaule a vu les aigles romaines se retirer vers l'Italie ;
les légions mêmes destinées à fermer aux Germains la barrière
de l'empire abandonnent les bords du Rhin et laissent le monde
en proie aux nations.
Les forces immenses de César rassemblées autour de lui
l'ayant mis en état de tout entreprendre, il se répand dans
l'Italie et s'empare des villes voisines de Rome. Au juste effroi
que son approche inspire, la Renommée ajoute ses rumeurs. Elle
annonce au peuple leur ruine infaillible, et devançant la guerre
qui s'approche à grands pas, ses voix innombrables sont occupées
à semer l'épouvante. On dit que des corps détachés ravagent
les fertiles campagnes de l'Ombrie ; qu'une aile de l'armée
s'étend jusqu'aux bords où le Nar coule dans le Tibre; que
César lui-même à la tête de ses bataillons s'avance sur plusieurs colonnes environné de tous ses aigles. On croit le voir,
non tel qu'autrefois, mais pareil à un géant terrible, plus sauvage
et plus féroce que les barbares qu'il a domptés ; on croit le
voir traînant après lui tous ces peuples répandus entre les Alpes
et le Rhin, qui, arrachés du sein de leur patrie, viennent, aux
yeux des Romains immobiles, saccager Rome et venger César.
Ainsi chacun par sa frayeur grossit le bruit de l'alarme
publique, et sans chercher de preuves à leurs maux, ils craignent
tous ceux qu'ils imaginent.
Ce n'est pas seulement le vulgaire qui se sent frappé d'une
aveugle terreur, le sénat, les pères conscrits cherchent leur
salut dans la fuite ; et par un décret ils chargent les consuls des
funestes apprêts de la guerre. Alors ne sachant de quel côté
la retraite est plus sûre ou le danger plus pressant, ils vont
où la frayeur les emporte : ils se jettent au milieu d'une multitude
éperdue et rompent ces longues colonnes de fugitifs dont
le tumulte retarde les pas. Il semble que la flamme ait gagné
leurs toits ou que leurs maisons chancelantes menacent de s'écrouler
sur eux. C'est ainsi qu'une foule égarée traverse Rome
à pas précipités, comme si l'unique espoir qui reste à ces malheureux
était de quitter leur patrie. Tel quand l'impétueux Auster repousse la mer écumante loin
des écueils de la Lybie, et qu'on entend les mâts gémissants se
briser sous l'effort des voiles, le pilote et le nocher s'élancent
dans les flots du haut de la poupe qu'ils abandonnent, et sans
attendre que le vaisseau soit entr'ouvert, chacun se fait à lui-même
un naufrage. Tels les Romains abandonnant leurs murs
fuyaient au-devant de la guerre.
Aucun n'est retenu, ni par la voix d'un père accablé de vieillesse,
ni par les larmes d'une épouse, ni par ses lares qu'il n'a
pas même le temps d'implorer; aucun ne s'arrête sur le seuil
de sa demeure, aucun n'ose attacher ses regards sur cette ville
chérie qu'il voit peut-être pour la dernière fois. La foule s'enfuit
sans que rien puisse l'arrêter.
Oh! qu'aisément les dieux nous élèvent au comble du bonheur !
que malaisément ils nous y soutiennent! Cette ville habitée par un peuple innombrable, où se rendaient en foule les nations
vaincues, et qui semblait pouvoir contenir le genre humain
assemblé, des mains lâches et tremblantes la laissent en proie
à César, l'abandonnent à son approche. Que sur des bords
étrangers le soldat romain soit investi par un ennemi qui le
presse, un simple retranchement le met à couvert des surprises de la nuit; un rempart de gazon fait à la hâte lui assure sous
la tente un sommeil paisible. Et toi, Rome, au premier bruit
de la guerre te voilà déserte ; on n'ose se confier pour une seule
nuit à tes murs. Pardonnons-leur ces frayeurs mortelles; Pompée
fuyait, qui n'eût pas tremblé ? Pour ne laisser même aux
esprits consternés aucun espoir dans l'avenir, le sort manifesta
sa colère par les plus terribles présages. Les dieux firent éclater
au ciel, sur la terre et sur les mers mille prodiges effrayants.
On vit dans la nuit obscure des astres inconnus, le ciel embrasé
d'obliques lueurs traversant le vide et l'immensité des
airs ; l'astre qui change les empires, la comète déployer sa
redoutable chevelure. Au milieu d'une sérénité trompeuse, on
vit sous mille formes diverses se succéder les éclairs étincelants,
tantôt semblables à un javelot, tantôt à la lumière éparse
d'une torche. La foudre, sans nuage et sans bruit, partit des
régions du nord et tomba sur le Capitole. Les moindres étoiles
accoutumées à briller durant les heures muettes de la nuit, apparurent
au grand jour. La lune, dont le disque réfléchissait
alors la pleine image du soleil, pâlit, comme frappée de l'ombre de la terre. Le soleil lui-même, au plus haut de sa course, enveloppant
son char d'une noire vapeur, plongea le monde dans des
ténèbres et fit désespérer du jour. Moins sombre fut la nuit qui
enveloppa Mycène, la ville de Thyeste, quand le soleil recuula
d'horreur vers son berceau. Vulcain courroucé ouvrit les gueules de
l'Etna ; mais au lieu de lancer sa flamme vers le ciel, il inclina
sa cime béante, et répandit sa lave du côté de l'Italie. Charybe roula
une mer de sang; les chiens de Sylla poussèrent des hululements
lamentables. Le feu de Vesta ravi aux autels se parta en
s'élevant, comme la flamme du bûcher des enfants d'Oedipe.
La terre s'ébranle sur sa base, et du sommet chancelant des
Alpes s'écroulent des monceaux de neiges. Thétys couvre de
ses eaux grandissantes les sommets de l'Atlas et ceux de Calppe.
Les dieux indigètes pleurent, et les lares expriment par leur
sueur l'état où Rome est réduite. Les offrandes des dieux tonmbent
dans le temple. Les oiseaux sinistres souillent le jour, les
bêtes sauvages quittent les forêts et font hardiment de Rome
leur repaire. La langue des bêtes fait entendre des paroles
humaines; les femmes enfantent des monstres, et la mère est épouvantée
de l'enfant qu'elle a mis au jour. Les sinistres prédictions de la prêtresse de Cumes se répandent dans le peuple.
Les ministres sacrés de Bellone et de Cybèle errants et furieux,
les membres déchirés, les cheveux épars, glacent les peuples
pair leurs cris lugubres. Les urnes funéraires gémissent; un
bruit horrible d'armes et de voix se fait entendre dans les forêts
inaccessibles; les fantômes hantent les villes; les peuples voisins
le Rome abandonnent les campagnes ; l'effroyable Érinnis courrait autour des murs, secouant sa torche allumée et sa chevelure
de serpents. Telle l'Euménide excitait la Thébaine Agave
ou conduisit le glaive du cruel Lycurgue; telle par la volonté
de Junon, Mégère épouvantait Hercule que Pluton n'a pu faire
pâlir. On entendit le son des trompettes, et un bruit égal aux
rumeurs des combattants dans la fureur de la mêlée. L'ombre
de Sylla sortit de la terre et rendit d'effrayants oracles; les
laboureurs épouvantés virent au bord de l'Anio Marius briser
la tombe, et lever sa tête du sein des morts.
On crut devoir, selon l'antique usage, recourir aux devins
d'Etrurie (1).
1 Les Romains tenaient des Étrusques leurs cérémonies et leurs sacrifices. Dans les grandes calamités ils consultaient les devins toscans, et remontaient pour ainsi dire à la source de la science et de la religion.
Àrons, le plus âgé d'entre eux, retiré dans les murs solitaires de Luca, lisait l'avenir dans les directions de la foudre, dans le vol des oiseaux, dans les entrailles des victimes. D'abord, il demande qu'on jette dans les flammes le fruit monstrueux que la nature égarée forme dans un sein qu'elle condamne à la stérilité. Il ordonne aux citoyens tremblants d'environner les murs de Rome, et de les purifier par des lustrations tandis que les sacrificateurs en parcourent les dehors, accompagnés de la troupe inférieure des prêtres vêtus de la robe gabienne. Après eux, marche à la tête des vestales, le front ceint des bandelettes sacrées, la prêtresse qui seule a droit de voir Minerve Troyenne. Sur leurs pas, s'avancent les dépositaires des oracles (1) et des livres des Sibylles, qui, tous les ans, vont laver la statue de Cybèle dans les faibles eaux de l'Almon.
1 C'étaient quinze prêtres qui avaient la charge de garder les livres Sibyllins, et le pouvoir d'y chercher l'avenir.
Ensuite venaient les augures, gardiens des oiseaux sacrés, et
les chefs qui président dans les fêtes aux sacrifices des festins;
et les prêtres d'Apollon et ceux de Mars qui portaient à leur
cou les boucliers mystérieux, et le grand prêtre de Jupiter
qu'on distinguait au voile attaché sur sa tète majestueuse.
Tandis qu'ils suivent à pas lents les vastes détours de l'enceinte
de Rome, Arons ramassa les feux de la foudre, et la terre
les reçoit dans son sein avec un triste et profond murmure. Il
consacre le lieu où il les a cachés; il fait amener au pied des autels un taureau superbe et commence les libations. La victime,
impatiente, se débat longtemps pour se dérober au sacrifice; mais les prêtres se jetant sur ses cornes menaçantes, lui
font plier le genou et présentent sa gorge au couteau. Cependant,
au lieu d'un sang vermeil, un noir poison coule de sa
plaie; Arons lui-même en pâlit d'horreur; il observe la colère
des dieux dans les entrailles de la victime, et la couleur l'en
épouvante; il les voit couvertes de taches livides et souillées
d'un sang corrompu. Le foie nage dans cette liqueur impure,
le poumon est flétri, le coeur abattu, l'enveloppe des intestins
déchirée et sanglante, et, ce qu'on ne vit jamais en vain dans les
flancs des animaux, du côté funeste, les fibres enflées palpitent,
du côté propice elles sont lâches et sans vigueur.
Dès qu'Arons a reconnu à ces marques les présages de nos
calamités, il s'écrie : « O dieux! dois-je révéler au monde tout
ce que vous me laissez voir? Non, Jupiter, ce n'est pas à toi que
je viens de sacrifier, j'ai trouvé l'enfer dans les flancs de ce taureau. Nous craignons d'horribles malheurs, mais nos malheurs
passeront nos craintes. Fasse le ciel que ces signes nous soient
favorables, que l'art de lire au sein des victimes soit trompeur,
et que Tagès qui l'inventa nous en ait imposé lui-même. »
C'est ainsi que le vieillard étrusque enveloppa ses prédictions
d'un nuage mystérieux. Mais Figulus (1), qu'une longue étude avait
admis aux secrets des dieux, à qui les sages de Memphis l'auraient
cédé dans la connaissance des étoiles et dans celle des
nombres qui règlent les mouvements célestes, Figulus éleva sa
voix : « Ou la voûte céleste, dil-iî, se meut au hasard, et les astres
vagabonds errent au ciel sans règle et sans guide : ou, si le destin
préside à leur cours, l'univers est menacé d'un fléau terrible.
La terre va-t-elle ouvrir ses abîmes? Les cités seront-elles
englouties? Verrons-nous les campagnes stériles? les airs infectés?
les eaux empoisonnées?
1 Cicéron, Aulu-Gelle et Eusèbe parlent d'un certain Nigidius Figulus, pythagoricien, qui reçut, ce nom de Figulus pour avoir dit, à son retour de Grèce, qu'il y avait appris que le monde tournait avec autant de vitesse que la roue d'un potier.
Quelle plaie, grands dieux! quelle désolation prépare votre colère? De combien de victimes un seul jour verra la perte ! Si l'étoile funeste de Saturne dominait au ciel, le Verseau inonderait la terre d'un déluge semblable à celui de Deucalion, et l'univers entier disparaîtrait sous les eaux débordées. Si le soleil frappait le Lion de sa lumière, c'est d'un incendie universel que la terre serait menacée; l'air lui-même s'enflammerait sous le char du dieu du jour. Ni l'un ni l'autre n'est à craindre. Mais toi qui embrases le Scorpion à la queue menaçante, terrible Mars, que nous réserves-tu? L'étoile clémente de Jupiter est à son couchant, l'astre favorable de Vénus luit à peine, le rapide fils de Maïa languit; Mars, c'est toi seul qui occupes le ciel. Pourquoi les astres ont-ils abandonné leur carrière, pour errer sans lumière dans le ciel? Pourquoi Orion qui porte un glaive, brille-il d'un si vif éclat? La rage des combats va s'allumer; le glaive confond tous les droits; des crimes qui devraient être inconnus à la terre obtiennent le nom de vertus. Cette fureur sera de longue durée. Pourquoi demander aux dieux qu'elle cesse? La paix nous amène un tyran ! Prolonge tes malheurs, ô Rome! traîne-toi d'âge en âge à travers des ruines. Il n'y a plus de liberté pour toi qu'au sein de la guerre civile. Ces présages avaient jeté l'épouvante dans le peuple. De plus terribles l'accablent encore. Telle des sommets du Pinde descend la bacchante pleine des fureurs du dieu d'Ogygie, telle à travers la ville consternée s'élance une matrone révélant par ces mots le Dieu qui l'oppresse « Où vais-je, ô Péan ! sur quelle terre au delà des cieux suis-je entraînée? Je vois le Pangée et ses cimes blanches de neiges, et les vastes plaines de Philippes au pied de l'Hémus. Phébus, dis moi, quelle est cette vision insensée? Quels sont ces traits, quelles cohortes romaines en viennent aux mains ? Quoi ! une guerre et nul ennemi? Où suis-je ailleurs emportée? Me voici aux portes de l'Orient où la mer change de couleur dans le Nil des Lagides. Ce cadavre mutilé qui gît sur la rive du fleuve, je le reconnais. Je suis transportée aux Syrtes trompeuses, dans la brûlante Lybie, où la cruelle Érynnis a jeté les débris de Pharsale. Maintenant je suis emportée par dessus les cimes nuageuses des Alpes, plus haut que les Pyrénées dont le sommet se perd dans les airs. Maintenant je reviens dans ma patrie. La guerre impie s'achève au sein du sénat. Les partis se relèvent, je parcours de nouveau l'univers. Montre-moi de nouvelles terres, de nouvelles mers, Phébus, j'ai déjà vu Philippes. » Elle dit, et tombe épuisée sous le dernier effort de sa fureur.
Le poëte se plaint aux dieux de ce qu'ils découvrent aux humains les calamités
qui les menacent. — Abattement de Rome. — Douleur et gémissements des
femmes. — Plaintes des soldats. — Tristesse des vieillards qui se rappellent les
temps de Marius et les terribles vengeances de Sylla. — M. Brutus, au milieu de
la nuit, va trouver Caton : son discours. — Réponse de Caton. — Au retour
du jour, Marcia, autrefois cédée par Caton à Hortensius, vient frapper à la
porte de son premier époux : son discours. -— Caton la reprend, sans nulle
cérémonie nuptiale. — Portrait de Calon, ses moeurs et son caractère. —
Pompée sort de Rome et se retire à Capoue, qui devient le siège de la guerre.
— Description de l'Apennin. — Marche de César ; sa vigueur militaire, et les
dispositions diverses des villes d'Italie. — Fuite de Libon, de Thermus, de Sylla,
de Varus, de Lentulus et de Scipion, lieutenants de Pompée. — Domitius veut
défendre Corfinium; il exhorte ses compagnons : discours de César aux siens. —
Il se rend maître de la ville ; Domitius lui est livré par la perfidie de ses soldats.
Malgré sa fierté, César lui accorde la vie. —
Pompée harangue ses soldats pour
sonder leurs dispositions. — Pompée voyant son discours froidement accueilli,
se défie de son armée, et va s'enfermer dans Brindes. — Description et histoire
de cette ville. — Pompée ne comptant plus sur l'Italie, envoie son fils aîné dans
l'Orient, et les consuls en Épire, pour y chercher des secours. — Diligence de
César : il tient déjà Pompée assiégé dans Brindes, et tâche de fermer le port avec
des digues. — Pompée rompt ces digues, et s'enfuit avec sa flotte. — Tristes
réflexion du pocte sur cette fuite, et plaintes pathétiques.
Déjà la colère des dieux s'est manifestée, la nature a donné le signal de la discorde, elle a interrompu son cours; et, par un pressentiment de l'avenir, elle s'est plongée elle-même dans ce désordre qui engendre les monstres. C'est le présage de nos forfaits. Pourquoi donc, ô roi de l'Olympe, avoir ajouté aux malheurs des hommes cette prévoyance qui leur découvre dans de cruels présages les calamités futures? Soit que dans le développement du chaos ta main féconde ait lié les causes par des noeuds indissolubles, que tu te sois imposé à toi-même une première loi et que tout soit soumis à cet. ordre immuable ; soit qu'il n'y ait rien de prescrit et qu'un aveugle hasard opère seul dans la nature ce flux et ce reflux d'événements qui changent la face du monde : fais que nos maux arrivent soudain ; que l'avenir soit inconnu à l'homme ; qu'il puisse du moins espérer en tremblant. Dès qu'on connut par ces prodiges à quel prix les oracles des dieux devaient se vérifier, le lugubre justitium règne dans la ville, les dignités se cachèrent sous le plus humble vêtement; on ne vit plus la pourpre entourée de faisceaux, les citoyens étouffèrent leurs plaintes, la douleur morne et sans voix erra dans cette ville immense. Ainsi, aux premiers instants qui suivent la mort, le silence règne dans une demeure avant que les premiers accents de la désolation aient éclaté, avant qu'une mère, les cheveux épars, jette de lamentables cris dans les bras de ses esclaves; tandis qu'elle presse le sein de son fils, que la chaleur de la vie abandonne, qu'elle baise cette face livide et ces yeux plongés dans le sommeil de la mort; ce n'est pas encore de la douleur, c'est de l'effroi. Attachée à ce corps, éperdue, elle mesure l'étendue de son malheur. Les femmes ont dépouillé leur parure, leur foule éplorée assiège les temples : les unes arrosent de larmes les statues des dieux, les autres se prosternent contre terre et répandent, égarées, leur chevelure sur le seuil sacré; ce n'est plus par des voeux timides, c'est par de longs hurlements qu'elles invoquent le ciel ; le temple de Jupiter n'est pas le seul qu'elles remplissent ; elles se partagent les dieux ; pas un autel n'est négligé par elles, pas un dieu ne sera jaloux. « C'est à présent, s'écria l'une d'entre elles, en meurtrissant son visage baigné de pleurs, c'est à présent, ô misérables mères qu'il faut se frapper le sein et s'arracher les cheveux. N'attendez pas, pour vous désoler, que nos malheurs soient à leur comble; pleurez, tandis que la fortune est encore incertaine entre nos tyrans. Dès que l'un d'eux sera vainqueur, il faudra marquer de la joie. » C'est ainsi qu'elles irritent et stimulent leur douleur. Les hommes eux-mêmes, en allant se ranger sous les drapeaux des deux partis, chargeaient de justes plaintes la cruauté des dieux. « Malheureux, disaient-ils, que n'avons-nous plutôt vécu dans les temps de Cannes et de Trébie? Dieux! ce n'est point la paix que nous vous demandons : jetez la colère dans le coeur des peuples, soulevez contre nous les nations barbares; que le monde conjuré coure aux armes; que les bataillons des Mèdes descendent de Suse, que l'Ister barbare cesse d'enchaîner le .Massagète, que des extrémités du Nord l'Elbe lâche contre nous les blonds Suèves, que le Rhin soulève sa source indomptée ! Rendez-nous, grands dieux! tous nos ennemis à la fois, mais détournez la guerre civile. Que le Dace d'un côté, de l'autre le Gète nous menace ; allez combattre l'Ibère, tournez vos drapeaux contre les flèches des hordes orientales ; Rome, tu n'auras pas un bras qui ne combatte. Ou si vous avez résolu, grands dieux! d'anéantir le nom romain, faites tomber en pluie de feu les airs embrasés par la foudre; frappez en même temps et les deux chefs et les deux partis; n'attendez pas qu'ils méritent vos coups. Est-ce pour décider lequel des deux nous opprimera qu'il en doit coûter tant de crimes? A peine, hélas! eût-il fallu s'y résoudre pour nous affranchir de tous les deux. » C'est ainsi que leur piété impuissante se répandait en inutiles plaintes. Les vieillards accablés de douleur se plaignaient d'avoir trop vécu et maudissaient leurs jours condamnés à la guerre civile. L'un d'eux, pour donner un exemple récent des maux que l'on 'avait à craindre : « O mes amis! dit-il, l'orage qui nous menace est le même qui s'éleva sur Rome lorsque Marius, vainqueur des Teutons et des Numides, se réfugia dans des marais et que les roseaux de Miniurne couvrirent sa tête triomphante; cette tête dont la Fortune leur confiait le dépôt fatal. Découvert et chargé de chaînes, le vieillard languit longtemps enseveli dans les horreurs d'un cachot. Destiné à mourir consul, à mourir tranquille au milieu des ruines de sa patrie, il portait d'avance la peine de ses crimes ; mais la mort se détourne de lui. En vain un ennemi lient sa vie odieuse entre ses mains ; le premier qui veut le frapper recule saisi de frayeur. Sa main tremblante laisse tomber le glaive. Il a vu à travers les ténèbres de la prison une lumière resplendissante; il a vu les terribles dieux des forfaits; il a vu Marius dans tout l'éclat de sa grandeur future; il l'a entendu et il a tremblé. Ce n'est pas à toi de frapper cette tête, le cruel doit au destin des morts sans nombre avant la sienne. Bannis une vaine fureur. Cimbres, si vous voulez être vengés, conservez avec soin les jours de ce vieillard. Ce n'est point la faveur des dieux, c'est leur colère qui veille sur lui. Marius suffît au dessein qu'ils ont formé de perdre Rome. En vain l'Océan furieux le jette sur une plage ennemie; errant sur les bords inhabités de ces Numides qu'il a vaincus, des cabanes.désertes lui servent d'asile; il foule aux pieds les cendres des armées puniques ; Carthage et Marius se consolent .mutuellement de leur ruine, et tous deux abattus pardonnent aux dieux. Mais au premier retour de la fortune, il allume en son coeur une haine africaine; il lâche des armées d'esclaves et brise les fers dont ils sont chargés : aucun n'est admis sous ses drapeaux, qu'il n'ait déjà fait l'apprentissage du crime et qu'il n'apporte dans son camp l'exemple de quelques forfaits. « O destin! quel jour! quel horrible jour que celui où Marius entra victorieux dans Rome! avec quelle rapidité la mort étendit ses ravages! La noblesse tombe confondue avec le peuple; le glaive destructeur vole au hasard et frappe toute poitrine. Le sang séjourne dans les temples, les pavés en sont inondés et glissants. Nulle pitié, nul égard pour l'âge; on n'a pas honte de hâter la mort des vieillards au déclin de l'âge, ni de trancher la vie des enfants qui viennent d'ouvrir les yeux à la lumière. Hélas! si jeunes encore, par quel crime ont-ils mérité de mourir? Ils sont mortels, c'est assez. Impitoyable fureur ! Sans perdre le temps à chercher les criminels, on égorge en foule tout ce qui se présente. La main des meurtriers plutôt que de rester oisive fait tomber des têtes dont les traits même leur sont inconnus. Il n'est qu'un espoir de salut, c'est d'attacher ses lèvres tremblantes à cette main souillée de sang. Ah ! peuple indigne de tes ancêtres devrais-tu, même à l'aspect de mille glaives qui s'avancent sous les étendards de la mort, devrais-tu consentir à racheter des siècles de vie à ce prix? Et c'est pour traîner dans l'opprobre le peu de jours que Marius te laisse et que Sylla vient l'arracher! « Dans ce massacre universel comment donner des larmes à chaque citoyen? Reçois nos regrets, ô Bébius! ô toi dont une foule d'assassins déchirent les entrailles et se disputent les membres fumants ! Et toi, prophète éloquent de nos malheurs, Antoine, dont la tête dégouttante encore de sang et couverte de cheveux blancs est apportée dans un festin sur la table de Marius! Les deux Crassus sont égorgés par Fimbria; le sang des tribuns arrose leur siège; ils ne t'épargnent pas même, ô Scévola, ils t'égorgent devant le sanctuaire de la déesse, devant les feux encore allumés sur l'autel ; mais ta vieillesse épuisée ne verse que peu de sang, insuffisant pour éteindre la flamme. A tant d'horreurs succéda le septième consulat de Marius; et par là finit cet homme accablé de toutes les rigueurs de la mauvaise fortune, comblé de toutes les faveurs de la bonne, et qui avait mesuré dans l'une et dans l'autre jusqu'où peut aller le sort d'un mortel. « Que de cadavres sont tombés sous les murs de Sacriportus ! Que de mourants entassés près de la porte Colline, quand la capitale du monde, et avec elle la souveraineté, parut changer de place, quand le Samnite espéra porter à.Rome un coup plus terrible que celui des Fourches Caudines ! « Sylla qui voulut nous venger, mit le comble à nos pertes immenses : il épuisa le peu de sang qui restait à la patrie. En coupant des membres corrompus, l'impitoyable médecin suivit trop loin les progrès du mal. Il ne périt que des coupables, mais dans un temps où il n'y avait plus que des coupables à sauver, « Sous lui, les haines sont déchaînées, la colère se livre à ses emportements, dégagée du frein des lois. On ne sacrifiait pas tout à Sylla, chacun s'immolait ses victimes. D'un seul mot, le vainqueur a tout ordonné. On vit l'esclave plonger dans les entrailles de son maître le fer sacrilège, le frère vendre le sang du frère, les fils, dégouttants du meurtre de leur père, se disputer sa tête. Les tombeaux sont remplis de fugitifs ; les vivants y sont confondus avec les morts; les antres des bêtes féroces ne peuvent contenir la foule des fugitifs : l'un attache à son cou le lacet fatal et meurt étranglé ; l'autre se précipite de tout son poids contre terre; ils dérobent ainsi leur mort au sanguinaire vainqueur; celui-ci élève lui-même son bûcher; il n'attend pas qu'il ait versé tout son sang, il s'élance et, tandis qu'il le peut, s'empare avidement de la flamme funèbre. Rome consternée reconnaît les têtes de ses plus illustres citoyens portées au bout d'une pique et entassées sur la place publique : là se révèlent tous les crimes cachés. La Thrace ne vit pas tant de cadavres pendre aux étables d'Augias, ni la Lybie aux portes d'Antée; la Grèce désolée ne pleura pas tant de victimes égorgées dans la cour du palais de Pise. « Quand les chairs sont pourries, quand les visages n'offrent plus que des traits méconnaissables, les infortunés pères vont recueillir ces restes et les dérobent par un pieux larcin. Moi-même, impatient de rendre aux mânes de mon frère les devoirs de la sépulture, il me souvient qu'avant de porter sa tête sur le bûcher, je parcourus ce champ de carnage, ouvrage de la paix de Sylla, pour découvrir parmi tant de corps mutilés celui auquel s'adapterait cetle tôle défigurée? Dirai-je par quelles cruautés la mort de Catulus (1) fut vengée sur le frère de Marius! et quels maux souffrit avant d'expirer cette malheureuse victime! Mânes qu'on voulut apaiser vous en fûtes effrayés vous-mêmes! Nous l'avons vu ce corps défiguré, dont chaque membre était une plaie; percé de coups, dépouillé par lambeaux; il n'avait pas encore reçu le coup mortel, et, par un excès inouï de cruauté, l'on prenait soin de ménager sa vie.
1 Catulus Lutalius, celui que Marius avait eu pour collègue dans le consulat, et qui avait partagé avec lui les honneurs du triomphe, employa ses amis pour intercéder auprès de Marius; mais ils n'en purent tirer que cette parole : « Il faut qu'il meure, » Calulus s'enferma dans sa chambre, et y fit allumer un grand brasier dont la vapeur l'étouffa.
Ses mains tombent sous le tranchant du glaive, sa langue arrachée palpite encore et, toute muette qu'elle est, frappe l'air; l'un lui tranche les oreilles, l'autre le nez ; celui-ci arrache de leurs orbites ces yeux qui ont assisté au supplice de tous les membres. On ne croira jamais qu'une seule tête ait pu suffire à tant de tourments. Les débris d'un cadavre écrasé sous les ruines sont moins brisés, les corps des malheureux qui ont péri dans un naufrage arrivent moins déchirés sur le sable. Et quel soin prenez-vous de rendre Marius méconnaissable aux yeux de Sylla? Pour se repaître de son supplice, il eût fallu qu'il reconnût ses traits. Preneste, la ville de la Fortune, voit tous ses habitants moissonnés par le glaive, tout un peuple tombe d'un seul coup. La fleur de l'Italie, la seule jeunesse qui lui restait fut massacrée dans le Champ de Mars, au sein de cette malheureuse Rome qu'elle inonda de son sang. Que tant de victimes périssent à la fois par la famine, par un naufrage, sous un écroulement imprévu, dans les horreurs de la peste ou de Ia guerre, il y en eut des exemples; mais d'une exécution pareille, il n'y en eut jamais. A peine à travers les flots de ce peuple qu'on égorge, les mains meurtrières peuvent se mouvoir; à peine ceux qui reçoivent le coup mortel peuvent tomber ; leurs corps pressés se soutiennent l'un l'autre, et dans leur chute ils deviennent eux-mêmes les instruments du carnage : les morts étouffent les vivants. « Sylla, du haut du temple, tranquille spectateur de cette scène n'a pas même le remords d'avoir proscrit tant de milliers de citoyens. Le gouffre de Tyrrhène reçoit les cadavres qu'on y entasse. Les premiers tombent dans le fleuve ; les derniers tombent sur une couche de corps; les barques rapides s'y arrêtent; le fleuve coupé par cette digue affreuse d'un côté s'écoule dans la mer, de l'autre s'enfle et reste suspendu. Les flots de sang se font un passage à travers la campagne et viennent en longs ruisseaux grossir les ondes amoncelées. Déjà le fleuve surmonte ses bords et y rejette les cadavres. Enfin se précipitant avec violence dans la mer de Tyrrhêne, il fend les eaux par un torrent de sang. « C'est ainsi que Sylla a mérité d'être appelé le salut de la patrie, l'heureux Sylla; c'est ainsi qu'il s'est fait élever un tombeau dans le Champ de Mars. Voilà ce qui nous reste à éprouver une seconde fois : tel sera le cours de celte guerre et tel en sera le succès. Et plût aux dieux que nos craintes ne fussent pas plus grandes ! Hélas! il y va de bien plus pour l'univers. Marius et les siens exilés de leur patrie ne demandaient que leur retour. Sylla vainqueur ne voulait qu'anéantir les faclions ennemies. César el Pompée ont .d'autres desseins. Non contents d'un pouvoir partagé, ils combattent pour le rang suprême : aucun d'eux ne daignerait susciter la guerre civile pour être ce que fut Sylla. » Ainsi la vieillesse consternée pleurait sur le passé et tremblait pour l'avenir. Mais cette frayeur n'eut point d'accès dans la grande âme de Brutus. Brutus (1), au milieu de la désolation publique, ne mêla point ses larmes aux larmes du peuple.
1 Marcus Brutus, dont il est ici question, descendait de ce Junius Brutus qui chassa les Tarquins, et par sa mère Servilie de Scrvilius Ahala, qui tua Spurius Mélius. Il était aussi neveu de Caton d'Utique, dont Servilie sa mère était la soeur utérine. Ce fut le même qui conspira contre César, dont il était peut-être le lîls, et se tua ensuite à Philippes. Voyez sa Vie dans Plularque.
Dans le silence de la
nuit, tandis que la grande Ourse roule son char oblique, il va
frapper au seuil de l'humble demeure de Caton, son oncle; il le
trouve veillant, l'âme agitée des dangers de Rome et du sort du
monde, sans crainte pour lui-même. Brutus l'aborde et lui dit :
« 0 vous, l'unique gage de la vertu dès longtemps bannie de la
terre, vous que le tourbillon de la fortune ne peut détacher de
son parti, sage Caton, soyez mon guide, affermissez mon esprit
chancelant, donnez votre force à mon âme. Que d'autres servent
Pompée ou César ; Caton est le chef que Brutus veut suivre.
Resterez-vous au sein de la paix, seul, immobile au milieu des
secousses qui ébranlent le monde ? ou voulez-vous absoudre la
guerre en vous associant aux forfaits et aux malheurs qu'elle
produira ? Chacun dans cette guerre criminelle ne prend les
armes que pour soi : l'un craint sa maison souillée et les lois
redoutables pendant la paix; l'autre veut écarter, le fer à la
main, l'indigence qui le presse et s'enrichir des dépouilles du monde bouleversé, nul n'obéit à la fureur, tous ont un intérêt
qui les pousse. Vous seul aimerez-vous la guerre pour elle-même?
Et que vous servira d'avoir été si longtemps incorruptible
au milieu d'un monde corrompu? Est-ce là le prix de tant
de constance ? Les autres sont coupables avant la guerre, toi
seul tu deviendras coupable par la guerre. Dieux ! ne permettez
pas que des armes parricides souillent ces mains pures, qu'un
trait lancé par ces bras se mêle au nuage épais des dards, et
qu'une si haute vertu coure un si grand hasard. Sur vous seul
retomberait la honte de cette guerre. Et qui ne se vanterait de
mourir de la main de Caton quoique frappé d'une autre main?
Non, le calme est votre partage, comme il est le partage des
astres : inébranlables dans leur cours, ils remplissent leur vaste
carrière, tandis que les régions de l'air sont embrasées par la
foudre. La terre est en butte au choc des tempêtes; l'Olympe
repose au-dessus des nuages. Tel est l'ordre immuable de la
nature. La discorde,agite les petites choses; les grandes jouissent
d'une profonde paix. Quelle joie pour César d'apprendre
qu'un citoyen tel que vous aurait pris les armes ! Rangez-vous
du parti de son rival, peu lui importe : Caton se déclare assez pour lui, s'il se déclare pour la guerre civile. Déjà une partie
du sénat, les patriciens, les.consuls eux-mêmes demandent à
servir sous Pompée. Qu'on voie Caton subir le même joug, il n'y
a plus au monde que César qui soit libre. Ah ! si c'est pour les
lois, pour la patrie, pour la liberté que vous voulez combattre,
voyez dans Brutus, non l'ennemi de César, non l'ennemi de
Pompée, mais après la guerre, l'ennemi du vainqueur. » Il dit,
et du sein de Caton comme du fond d'un sanctuaire se firent
entendre ces paroles sacrées :
« Oui, Brutus, la guerre civile est le plus grand des crimes,
mais ma vertu suit sans trembler la fatalité qui m'entraîne. Si
les dieux me rendent coupable, ce sera le crime des dieux. Et
qui peut voir, exempt de crainte, la ruine de l'univers? Quand
l'inaccessible éther s'écroule, quand la terre chancelle, quand le
monde se confond et s'affaisse, qui peut rester les bras croisés?
Quoi ! des nations inconnues s'engagent dans nos querelles ; des
rois nés sous d'autres étoiles, séparés de nous par de vastes
mers, suivent l'aigle romaine aux combats, et seul je resterais
oisif! Loin de moi, grands dieux, cette cruelle indifférence!
Rome dont la chute ébranlerait le Dace et le Gète, Rome ne
peut tomber sans m'écraser. Un père à qui la mort vient enlever ses enfants les accompagne jusqu'à la sépulture, sa douleur
même l'y engage; ses mains portent les noirs flambeaux
qui vont embraser leur bûcher. Ainsi, Rome, je ne me détacherai
de toi qu'après t'avoir embrassée mourante. Liberté! je
suivrai ton nom et ton pâle fantôme. Soumettons-nous, les dieux
inexorables demandent Rome entière en sacrifice; ne leur dérobons
pas une seule goutte de sang. Ah ! que ne puis-je offrir
aux dieux du ciel et des enfers cette tête chargée de tous les
crimes de ma patrie et condamnée à les expier ! Décius se dévoua
et périt au milieu d'une armée ennemie ; que ces deux armées
me percent de leurs traits; que les hordes barbares du Rhin
épuisent sur moi leurs coups. J'irai, le sein découvert, au-devant
de toutes les lances, et je recevrai seul tous les coups de
la guerre : heureux si mon sang est la rançon du monde, si
mon trépas suffit pour expier les crimes de la corruption romaine !
Eh ! pourquoi faire périr des peuples dociles au joug et disposés
à fléchir sous un maître cruel? C'est moi seul qu'il faut perdre,
moi qui m'obstine à défendre inutilement nos lois et notre
liberté. Mon sang versé rendra la paix et le repos à l'Italie.
Après moi, qui voudra régner n'aura pas besoin de recourir aux armes. Allons, suivons le parti que: Rome autorise. Si la
fortune seconde Pompée, il n'est pas sûr qu'il en abuse pour
usurper l'empire du monde. Combattons sous lui, peut-être
n'osera-t-il s'attribuer à lui seul les fruits de la victoire. »
Telle fut la réponse de Caton, et l'âme du jeune Brutus embrasée
d'un feu nouveau, ne respira plus que la guerre civile.
Alors, comme le soleil chassait les froides ténèbres, on entendit
frapper à la porte : c'était la pieuse Marcia qui venait de
rendre à Hortensius, son époux, les devoirs de la sépulture.
Vierge, elle fut jadis unie à un plus noble époux ; mais bientôt
Caton, après avoir eu d'elle trois gages d'un saint hyménée,
l'avait cédée à son ami, afin qu'elle portât dans une maison
nouvelle les fruits de sa fécondité, et que son sang maternel fût
le lien de deux familles. Mais à peine l'urne funèbre a-t-elle
recueilli les cendres d'Hortensius, qu'elle revient, la pâleur sur
le visage, les joues déchirées, les cheveux épars, le sein meurtri,
la tête couverte de la poussière du tombeau. Elle eût vainement
employé d'autres charmes pour plaire à Caton. Dans sa
douleur elle lui parle en ces mots :
« Tant que mon âge et mes forces m'ont permis d'être mère,
ô Caton, j'ai fait ce que vous avez voulu : j'ai subi la loi d'un double hyménée. A présent que mes entrailles épuisées ne sauraient
plus enfanter, je reviens à vous, dans l'espoir de n'être
plus livrée à personne. Rendez-moi les chastes noeuds de mon
premier hymen, rendez-moi le nom, le seul nom de votre épouse ;
qu'on puisse écrire sur mon tombeau : Mania, femme de Caton.;
et que l'avenir n'ait pas lieu de douter si vous m'aviez cédée ou
bannie. Ce n'est point à vos prospérités que je viens m'associer;
c'est de vos peines, de vos travaux que je veux être la compagne.
Laissez-moi vous suivre dans les camps. Eh ! pourquoi
resterais-je en sûreté au sein de la paix? Pourquoi Cornélie verrait-
elle de plus près que moi la guerre civile ? »
Ces paroles fléchirent. Caton, et quoique le moment fût peu
favorable aux fêtes nuptiales, il consentit à renouer des noeuds
sacrés; mais à la face du ciel et sans l'appareil d'une pompe
vaine.
Le vestibule de sa maison n'est point couronné de guirlandes ;
la blanche bandelette ne retombe pas sur les portes; on n'allume
pas les flambeaux de l'hymen; le lit nuptial n'est point
élevé sur des marches d'ivoire; une trame d'or ne brille pas
dans les étoffes dont il est couvert. La matrone qui ceint d'une
couronne de tours le front de l'épouse, n'empêche pas Marcia
de franchir sans y toucher le seuil de la porte. Sa tête n'est point ornée de ce tissu de pourpre qui tombe sur les yeux timides
d'une jeune vierge dévouée à l'hymen et qui sert de voile
à la timide pudeur. Une ceinture ne retient pas les plis de son
manteau orné de pierreries; un simple collier pare son cou. Une
étroite tunique est attachée à ses épaules et presse ses bras
nus. Telle qu'elle est et sans déposer le deuil lugubre qui la
couvre, elle embrasse son époux comme elle embrasserait ses
enfants. Les jeux profanes, la folle ivresse ne sont point appelés
à ce grave hyménée; les parents mêmes n'y sont point conviés.
Marcia et Caton s'unissent dans le silence et sous l'auspice de
Brutus.
Caton, dès le premier signal de la guerre, avait laissé croître
sa barbe hérissée, et ses cheveux blancs ombrageaient son front.
Ce front sévère n'admit point la joie ; Caton ne daigna pas même
écarter ses longs cheveux de son visage austère et vénérable.
Également insensible à l'amour et à la haine, tout occupé à
gémir sur les malheurs de l'humanité, il s'interdit le lit nuptial,
et la sévérité de sa vertu résista même aux plaisirs légitimes.
Telles furent les moeurs de Caton, telle fut, sa secte rigide : se
borner, suivre les lois de la nature; vivre et mourir pour son pays ; se croire fait, non pour soi-même, mais pour le monde
entier; n'avoir, au lieu de festins, que l'aliment nécessaire à la
vie; au lieu de palais, qu'un abri contre les hivers; au lieu de
riches vêtements, que l'étoffe grossière dont se couvre le peuple ;
borner l'usage de l'amour au soin de perpétuer son espèce;
n'être époux et père que pour le bien de sa patrie ; se faire un
culte de la justice ; de l'honnêteté une inflexible loi ; du bien général
un intérêt unique, tel fut cet homme ; et dans tout le cours de
sa vie jamais la volupté, idole d'elle-même, ne surprit un seul
mouvement de son âme, n'eut part dans aucune de ses actions.
Cependant Pompée à la tête d'une multitude tremblante avait
gagné les murs de Capoue (1), fondée par un colon dardanien. Il
y établit le siège de la guerre, et pour s'opposer aux entreprises
de César, il envoya des corps détachés vers ces collines ombragées
d'où l'Apennin s'élève et où la terre se gonfle et monte
le plus près de l'Olympe.
1 Capoue, fondée, à ce que l'on croit, par Capys, Troyen dont il est parlé au IIe livre de l'Enéide :
Ses flancs s'étendent et se resserrent entre les deux mers. D'un côté, Pise, qui voit se briser sur ses rives la mer Tyrrhénienne; de l'autre, Ancône, battue par les flots dalmatiques. Dans ses vastes sources, la montagne recèle d'immenses fleuves qu'elle répand pour diviser la double mer. D'un côté se précipite le Métaure fugitif et l'impétueux Crustume, le Senna et le Sapis que l'Isaure enfle de ses eaux, et l'Aufidus dont la rapidité fend les ondes adriatiques ; et l'Éridan (1), celui de tous les fleuves dont la source est la plus profonde, l'Éridan qui roule au sein des mers les forêts brisées sur son passage, l'Éridan qui semble épuiser toutes les eaux de l'Italie. L'Éridan fut le premier des fleuves, dit la fable, dont le peuplier couronna les bords.
1 L'Ëridan est aujourd'hui le Pô. Virgile l'appelle le roi des fleuves : c'est beaucoup dire, même pour l'Europe, car le Danube est plus grand. Du reste, Lucain se trompe quand il le fait sortir de l'Apennin, ainsi que quelques-uns des fleuves nommés plus haut. Le Pô prend sa source dans les Alpes, au-dessus de Verceil. Le Pô reçoit des fleuves navigables et des lacs immenses, ce qui fait dire à notre poëte qu'il épuise foules les eaux de l'Italie
Ce fut dans son sein que tomba Phaéton, lorsque ayant pris en main les rênes brûlantes des coursiers du dieu du jour, il s'écarta de la route prescrite. La terre était embrasée jusque dans ses entrailles, tous les fleuves étaient desséchés; l'Éridan lui seul fut capable d'éteindre les flammes du char du soleil. Ce fleuve égalerait le Nil, si, comme le Nil, il pouvait s'étendre et se reposer sur de vastes plaines; il égalerait le Danube, si le Danube, en parcourant le monde, ne se grossissait des torrents qu'il rencontre et qu'il entraîne avec lui dans l'Euxin. Les eaux qui coulent sur la pente opposée forment le Tibre et le Rutube (1) escarpé
1 Le Rutube se jette dans le Tibre, selon Vibius. Pline parle d'un fleuve du même nom qui coule en Ligurie.
puis coulent le Vulturne rapide, et le
Sarne nébuleux, et le Liris qui coule à l'ombre des forêts de
Marice, et le Siler qui arrose les fertiles champs de Salerne, et le Macre qui roule sur des écueils jusqu'au port de Luna,
voisin de sa source, sans pouvoir porter une barque légère.
Où se dresse le plus haut dans l'air la croupe de l'Apennin,
le mont voit à ses pieds la Gaule et touche le versant des Alpes.
Fécond pour le Marse et l'Ombrien, sillonné par la charrue sabellienne,
il embrasse de ses roches couvertes de pins tous les
peuples indigènes du Latium et ne quitte l'Hespérie que lorsqu'il
s'est fermé aux ondes de Sylla, et qu'il a étendu ses rocs jusqu'au
temple de Junon Lacinienne. Il allait au delà, mais l'Océan,
pesant sur lui, l'a rompu. Les flots ont repoussé la terre. Un détroit
s'est formé dans la terre profonde. Pélore, dernière colline
de cette chaîne, est restée en Sicile.
César qui respire la guerre et qui ne se plaît à marcher que
par des chemins arrosés de sang, gémit de trouver l'Italie ouverte.
Il se flattait que Pompée lui disputerait le passage et
que des débris marqueraient ses pas. On lui ouvre les portes,
il voudrait les rompre ; le laboureur tremblant lui laisse envahir
ses campagnes; c'est par le fer, c'est par la flamme qu'il
eût voulu les ravager. Il rougit de suivre une route permise
et de paraître encore citoyen.
Les villes d'Italie incertaines et partagées entre la crainte et le devoir, n'attendent pour se livrer à lui que les approches
de la guerre ; cependant on élève d'épais remparts, on creuse
des fossés, on prépare sur le haut des tours de lourdes masses
de rochers et des machines à lancer les traits pour accabler
les assiégeants. Le peuple penche du côté de Pompée, et la fidélité
balance l'effroi.
Ainsi lorsque le bruyant Auster s'est emparé de l'Océan,
toutes les vagues lui obéissent. Si la terre alors, entrouverte
d'un second coup du trident d'Éole, lance l'Eurus sur les flots
agités, quoique poussés par un vent nouveau, c'est au premier
qu'ils cèdent encore; et. tandis que l'Eurus domine au ciel et
commande aux nuages, le seul Auster règne sur les eaux.
Mais, il était facile à la Terreur de changer les esprits, et
leur fidélité était flottante comme la fortune. Bientôt la fuite
de Libon laissa l'Étrurie sans défense. Thermus abandonna
l'Ombrie. Sylla qui n'eut dans les guerres civiles ni le courage,
ni le bonheur de son père, prit la fuite au nom de César; à
peine quelques escadrons menacent les murs d'Auximon, Varus
en sort épouvanté, jette l'alarme dans les villes voisines et
s'échappe à travers les forêts. Lentuius chassé d'Asculum et suivi de près dans sa fuite, voit ses cohortes dispersées le laisser
seul avec ses drapeaux et se tourner du côté du vainqueur. Toi-même,
Scipion (1), tu vas bientôt livrer les murs de Lucère confiés
à tes soins, ces murs défendus par la plus vaillante jeunesse.
Enlevée à César dans le temps où l'on redoutait les Parthes, elle
vint réparer dans le camp de Pompée ses pertes dans les Gaules.
En attendant l'heure de nouveaux combats, il avait donné à son
beau-père le droit de faire couler ce sang romain. Corfinium
et sa haute enceinte de murs t'occupent, belliqueux Domitius (2),
à tes clairons obéissent les recrues opposées autrefois au condamné
Milon. Domitius voyant à travers un nuage de poussière
les rayons du soleil réfléchis. sur les armures : « A moi,
compagnons! s'écria-t-il, courez au fleuve, coupez le pont.
Dieux ! faites que ce torrent lui-même enfle ses eaux pour le
briser; que ce soit ici le terme de la guerre.; qu'ici du moins
l'ardeur de l'ennemi se ralentisse et se consume en longs efforts.
1 Ce Scipion était fils de Scipion Nasica; mais il était passé par adoption dans la famille des Melellus,d'où il fut appelé Metellus Scipion. Il était beau-père de Pompée, qui, peu de temps avant la guerre civile, avait épousé sa fille Cornélie. Voyez Plularque, Vie de Pompée, ch. LVIII.
2 L. Domitius Énobarbus, nommé pour succéder à César dans le gouvernement de la Gaule, s'était retiré à Corfinium, ville des Péligniens, avec vingt cohortes. Il paraît certain que ce Domitius n'était rien moins que brave et belliqueux, mais que Lucain veut faire sa cour à Néron, qui tirait de lui sa naissance (Voyez Suétone, Vie de Néron, ch. i). C'est par le même esprit de flatterie qu'il lui donne le commandement de l'aile droite à Pharsale, et lui prête une belle conduite
Retardons ses progrès rapides, ce sera pour nous une victoire
que d'avoir les premiers arrêté César. » Il n'en dit pas davantage,
et les cohortes à sa voix accourent au fleuve : il n'est plus temps. César qui s'avance et qui voit de loin qu'on veut lui
couper le passage, s'écrie, enflammé de colère : « Hé quoi!
lâches, ce n'est pas assez des murs ténébreux qui vous couvrent,
si des fleuves ne nous séparent. Le Gange même, le Gange débordé
serait une faible barrière. César a passé le Rubicon ; il
n'est plus de fleuve qui l'arrête. Marchez! que la cavalerie s'élance
! que l'infanterie se précipite sur ce pont qui va s'écrouler ! »
A peine il a donné l'ordre, on lâche la bride aux légers coursiers,
la plaine fuit sous leurs pas rapides ; les bras nerveux des archers
font voler au delà du fleuve une grêle de dards. Le pont est abandonné;
César s'en empare et chasse l'ennemi jusque dans ses
murs. Il fait construire des machines assez fortes pour lancer
d'énormes fardeaux, et des toits sous lesquels ses soldats soient
à couvert au pied des murailles. Mais, ô crime! ô trahison! les
portes s'ouvrent, et les soldats de Domitius le traînent captif aux
pieds de César, aux pieds d'un citoyen superbe. Domitius, loin
de laisser abattre par le malheur la noble fierté de son âme,
présente à la mort un front menaçant. César sait bien qu'il la
désire et qu'il ne craint que le pardon. « Vis malgré toi, lui
dit-il, et vois le jour que César te laisse. Sois pour les vaincus l'exemple et le gage de ma clémence. Tu es libre, tu peux tenter
de nouveau contre moi le sort des armes, et s'il me livre jamais
en tes mains, je te dispense du retour. » A ces mots il ordonne
que ses liens soient rompus.Quelle honte la fortune eût épargnée à ce Romain, s'il eût
obtenu le trépas ! Le dernier supplice pour un citoyen fut de
s'entendre pardonner d'avoir suivi Pompée et le sénat sous les
drapeaux de la patrie.
Domitius dissimule et renferme sa rage, mais en lui-même :
« Malheureux! dit-il, irai-je cacher ma honte au sein de Rome,
à l'ombre de la paix? Fuirai-je les dangers de la guerre, moi
qui rougis de voir le jour? Précipitons-nous à travers mille
morts! courons au terme d'une vie odieuse! échappons au
bienfait de César ! »
Ignorant le malheur de son lieutenant, Pompée se préparait
à le soutenir. Résolu de marcher le jour suivant, il crut devoir
éprouver le zèle de ses troupes, et d'une voix qui imprimait
le respect : « Vengeurs des forfaits, leur dit-il, défenseurs
de la bonne cause, seule armée de vrais Romains,
vous à qui le sénat a donné à soutenir, non l'ambition d'un
homme, mais la liberté de tous, faites des voeux pour le combat. Le fer et le feu ravagent l'Hespérie ; les Gaulois descendent
furieux du sommet des Alpes; le sang romain a déjà
souillé le glaive impie de César. Grâces aux dieux, c'est nous
qui avons reçu les premiers outrages de la guerre; c'est sur
l'agresseur que le crime en retombe; et Rome qui me confie
ses droits nous en demande le châtiment. Ce n'est point un
juste ennemi que nous allons combattre, c'est un citoyen rebelle
que nous allons punir; et son attentat mérite aussi peu le
nom de guerre, que le complot de Catilina, lorsque, avec Lentulus
et Céthégus ses complices, il résolut d'embraser Rome.
O César! quelle rage t'aveugle! toi, que les destins appelaient
au rang desMétellus et des Camille, tu préfères grossir le
nombre des Marius et des Cinna? Viens donc périr comme Lépide
a péri sous les coups de Catulus ! comme Carbon (1), qui subit
la hache du licteur et qu'ensevelit un tombeau sicilien;
comme Sertorius, qui, exilé, souleva le farouche Espagnol!
Mais je rougis de t'associer même à ces noms. Je rougis que
Rome occupe mes mains à terrasser un furieux.
1 Carbon, l'un des chefs du parti de Marius, fut défait, pris et mis à mort en Sicile par Pompée. « On trouva que ce jeune chef insultait avec une sorte d'inhumanité au malheur de Carbon. Si sa mort était nécessaire, comme elle pouvait l'être, il fallait le faire mourir aussitôt qu'il eût été arrêté, et l'odieux en serait retombé sur celui qui l'avait ordonné. Au contraire, Pompée fit traîner devant lui, chargé de chaînes, un Romain illustre, trois fois honoré du consulat; du haut de son tribunal, il le jugea lui-même en présence d'une foule nombreuse, qui faisait éclater sa douleur et son indignation. » (Plularque, Vie de Pompée, ch. ix.)
Que n'est-il
revenu vainqueur des Parthes, ce Crassus qui nous délivra de
Spartacus : tu périrais sous ses armes. Mais puisque les dieux veulent que ta défaite s'ajoute à mes autres trophées, tu vas
éprouver si les ans ont énervé mon bras ou glacé le sang dans
mes veines ; si, pour avoir souffert la paix, nous sommes
effrayés de la guerre. Laissez, laissez dire à César que Pompée
est amolli par le repos ; l'âge n'a rien d'effrayant dans un capitaine
; consolez-vous de marcher sous un vieux chef, contre
de vieux soldats. Je suis monté au plus haut point de grandeur
auquel un citoyen puisse être élevé par un peuple libre.
Au-dessus de moi, je n'ai laissé que la place d'un tyran;
celui qui dans l'État veut me surpasser n'aspire plus au rang
de citoyen. Voici les deux consuls, voici toute une armée de
généraux : César triomphera-t-il du sénat? La Fortune, tout,
aveugle qu'elle soit, aurait honte de balancer. Et de quoi s'enorgueillit
cet audacieux? Est-ce d'avoir employé dix ans à conquérir
la Gaule? Est-ce d'avoir abandonné honteusement les
bords du Rhin? Est-ce d'avoir été chassé du rivage britannique
et d'avoir attribué son mauvais succès aux obstacles d'une mer
inconstante et pleine d'écueils ? Son audace triomphe-t-elle de
voir Rome entière sous les armes s'éloigner du sein de ses dieux?
Insensé ! on ne te fuit pas, on me suit ! on me suit, moi qui dans deux mois ai purgé la mer des pirates ; moi qui, plus heureux
que Sylla, ai vu ce.Mithrridate, qu'on ne pouvait dompter, et qui
retardait les destins de Rome, errant dans les déserts du Bosphore
et de la Scythie, et réduit à se donner la mort. Le monde
entier est plein de moi. Toutes les contrées que le soleil éclaire
sont remplies de mes trophées. Le Nord m'a vu triompher sur
les rives glacées du Phase; je connais les cieux brûlants de
l'Egypte et Syene, où nul objet ne projette son ombre; l'Occident
redoute ma puissance; je fais trembler ce fleuve, le plus
reculé de tous, l'Hespérien Bétis qui frappe de ses flots la mer
fugitive. Tout me connaît : et l'Arabe vaincu, et l'Héniochien
belliqueux, et la Colchide, fameuse par sa toison ravie ; mes drapeaux font trembler la Cappadoce, le Juif adorateur d'un Dieu
mystérieux, et la molle Sophène. Arméniens, Ciliciens farouches,
habitants du Taurus, j'ai tout dompté. Que te reste-t-il,
César? la guerre civile! »
Cette harangue ne fut point suivie de l'acclamation des
cohortes : elles ne demandèrent point le signal du combat qu'on
leur promettait. Pompée lui-même intimidé par ce silence, crut
devoir s'éloigner plutôt que de courir les risques d'un combat avec une armée déjà vaincue au seul bruit du nom de César.
Tel qu'un taureau chassé du troupeau à la première rencontre
va se cacher au fond des forêts, exilé dans les champs
déserts, il essaye ses cornes contre les troncs des arbres, et
ne revient au pâturage que lorsque son front s'est armé et que
ses muscles ont grossi. Vainqueur alors, c'est à son tour de
conduire à sa suite les troupeaux, en dépit du berger : tel
Pompée, inférieur à César, lui abandonne l'Italie et se retire à
travers les campagnes de la Pouille dans les murs de Brindes.
Cette ville fut jadis habitée par des Crétois, que les vaisseaux
athéniens déposèrent sur nos bords, quand leurs voiles
menteuses annoncèrent la défaite de Thésée. Elle est située
vers, la pointe de l'Italie, au bord de la mer Adriatique, sur
une langue de terre qui s'avance et se courbe en croissant,
comme pour embrasser les flots. Ce serait un port mal assuré,
s'il n'était couvert par une île dont les rochers brisent l'effort
des tempêtes. Des deux côtés du port, la nature a élevé deux
chaînes de montagnes qui repoussent la mer, et qui défendent
aux vents orageux de troubler l'asile des vaisseaux, que des
câbles tremblants y retiennent à l'ancre. De là on gagne librement la pleine mer, soit qu'on fasse voile vers l'île de Corcyre,
soit que du côté de l'Illyrie on veuille arriver au port
d'Épidaure, tourné vers les flots ioniens. C'est le refuge des nochers,
lorsque tous les flots de la mer Adriatique sont soulevés,
que les nuages enveloppent les montagnes de l'Épire et que
l'île calabraise de Sason disparait sous les vagues écumantes.
Là, Pompée qui ne pouvait plus compter sur l'Italie ni transporter
la guerre chez le sauvage Espagnol dont il était séparé
par la chaîne immense des Alpes, dit à l'aîné de ses enfants :
« Va, mon fils, parcours le monde, soulève le Nil et l'Euphrate,
arme tous les peuples à qui le nom de Pompée est connu,
toutes les villes où mes exploits ont rendu Rome recommandable
: que les pirates de Cilicie abandonnent les champs que
je leur ai donnés et se répandent sur les mers. Appelle à mon
secours Ptolémée, dont je suis l'appui, et Tigrane qui me doit
sa couronne, et Pharnace ; n'oublie ni les habitants vagabonds
de l'une et de l'autre Arménie, ni les nations féroces qui occupent
les bords de l'Euxin, ni celles qui couvrent les sommets
du Riphée, ni celles dont les chariots voyagent sur les glaces
du Palus Méotide. Allume la guerre dans tout l'Orient, que tout
ce que j'ai vaincu sur la terre embrasse ma défense et que mes triomphes viennent grossir mon camp. Vous, consuls, qui signez
de vos noms les fastes romains, au premier souffle de Borée,
passez en Épire: allez ramasser de nouvelles forces dans les
champs de la Grèce et de la Macédoine, tandis que l'hiver nous
laisse respirer. »Il commande, tous lui obéissent et détachent
les vaisseaux profonds.
Cependant, César trop ardent pour laisser reposer ses armes,
de peur de donner au sort le temps de changer, presse Pompée
et le suit pas à pas. Tout autre serait content d'avoir, d'une première
course, pris tant de villes, forcé tant de remparts, conquis
sans obstacle cette reine du monde, cette Rome, le plus haut
prix de la victoire. Mais César qui ne perd jamais un instant et
qui compte n'avoir rien fait tant qu'il lui reste à faire, César
s'attache avec fureur à son rival. Quoiqu'il possède toute l'Italie,
si Pompée en occupe le rivage extrême, il lui semble qu'elle leur
soit commune, et sa haine ne peut l'y souffrir. Il veut lui interdire
les mers, et pour lui couper le passage, il entreprend d'élever
devant le port une barrière de rochers. Ces immenses travaux
sont perdus : les rochers tombent, la mer avide les dévore,
et des montagnes entassées sont englouties sous le sable. Ainsi quand la cime de l'Éryx tomberait dans la mer Egée, les rocs
engloutis ne dépasseraient pas la surface des flots. Ainsi le
Gaudrus disparaîtrait dans les gouffres de l'immobile Averne.
César voyant que ces masses énormes ne trouvaient pas de fond
qui les soutînt, prit le parti de faire abattre des forets et de lier
les arbres l'un à l'autre par de longues chaînes. L'orgueilleux
Xerxès, autrefois, dit-on, se fit sur les flots une route semblable,
il joignit l'Europe avec l'Asie, rapprocha Abydos et Sestos par
un pont de vaisseaux, et traversa le Bosphore à la tête de son
armée tandis que ses voiles passaient au travers du mont Athos.
Ainsi les forêts enchaînées et flottantes ferment l'embouchure du
port. Les travaux s'avancent, les remparts s'élèvent, et les hautes
tours tremblent sur les eaux.
Pompée, étonné de voir une terre nouvelle s'élever entre la
mer et lui, cherche avec un mortel effroi le moyen de s'ouvrir
un passage et d'étendre la guerre sur des bords éloignés. Il fait
avancer contre la digue des navires armés que les vents poussent
à pleines voiles : les pierres, les dards, les torches allumées
volent au milieu des ténèbres, les ouvrages s'écroulent et la
mer est ouverte. Pompée, à la faveur de la nuit, saisit enfin l'instant de s'échapper : il défend que le son de là trompette, le
cri des matelots fassent retentir le rivage, et que l'on donne le
signal du départ. La Vierge était à son déclin, le soleil entrait
dans le signe de la Balance, lorsque les nefs quittent silencieusement
ces bords. On n'entendit pas une seule voix dans le moment
qu'on dressa les mâts, qu'on leva l'ancre, et qu'on mit à
la voile. Les pilotes glacés de crainte, gardèrent un profond
silence; les matelots suspendus aux cordages furent même
attentifs à ne pas les agiter, de peur que le bruit excité dans l'air ne décelât l'évasion de la.flotte.
O Fortune! il te demande comme une faveur, de lui permettre
d'abandonner l'Italie, puisque tu lui défends de la conserver.
A peine encore les destins y consentent; l'onde, entr'ouverte
et refoulée par tant de vaisseaux, fit entendre un long mugissement.
Alors les soldats de César à qui cette ville infidèle, changeant
avec la fortune, avait ouvert ses portes et livré ses murs,
gagnent l'embouchure du port par les deux bouts de son enceinte,
et frémissent de voir que la flotte ennemie s'est échappée
et vogue en pleine mer. O honte! la fuite de Pompée est pour
César une faible victoire. Le passage des nefs était plus étroit, que celui qui sépare
l'Eubée de la Béotie; deux vaisseaux s'y arrêtent; des mains
de fer prêtes pour cet usage les attirent au bord, et là, pour la
première fois, les flots de la mer sont rougis du sang de la
guerre civile. Le reste de la flotte s'éloigne et abandonne ces
deux vaisseaux. Ainsi quand le navire thessalien se dirigeait
vers le Phase, la terre vomit à la surface des eaux les rocs de
Cyane. Argo, privé de sa poupe, échappa aux écueils, et le rocher
impuissant frappa vainement la mer.
Déjà les couleurs dont brille l'Orient annoncent le retour de
l'aurore ; sa lumière, teinte d'un rouge vermeil, commence à
effacer les étoiles voisines : la pléiade commence à pâlir, l'Ourse,
languissante se plonge dans Fazur du ciel, et Lucifer lui-même
se dérobe à l'éclat du jour. Toi, Pompée,- tu vogues en pleine
mer, mais tu n'as plus avec toi cette Fortune qui t'accompagnait,
lorsque tu forçais les pirates à te céder l'empire des
mers; lasse de tes triomphes, elle t'abandonne. Chassé du sein
de ta patrie avec ton épouse et tes enfants, chargé de tes
dieux domestiques et traînant la guerre après toi, grand encore
dans ton exil, tu vois les peuples marcher à ta suite, le destin semble chercher des régions éloignées pour y eonsommer ta
ruine, non que les dieux veuillent te refuser un tombeau dans
les murs qui t'ont vu naitre ; mais en condamnant l'Égyptse à
porter l'opprobre de ta mort, ils ont fait grâce à l'Italie. Ils
ordonnent à la Fortune d'aller cacher son crime sous un ciel
étranger : ils veulent épargner à Rome la douleur de voir ses
campagnes souillées du sang de Pompée.
 ---obole dit "à la tête de Pompée.
---obole dit "à la tête de Pompée.Navigation de Pompée en Épire. Le fantôme de Julie vient s'offrir à lui pendant
son sommeil, et lui présage ses malheurs. — Pompée aborde à Dvirachium.
—
César, après avoir envoyé Curion en Sicile et en Sardaigne pour chercher
des vivres, se dirige sur Rome et y entre au milieu de la terreur et de l'abattement.
— Il convoque le sénat sans droit. — Il veut s'emparer du trésor
public; le tribun Métellus veut l'en empêcher. — Le tribun cède après un
discours de Cotta. — Le temple de Saturne est dépouillé. — Énumération des
peuples qui entrent dans la querelle de Pompée. — César sort de Rome et passe
les Alpes. — Résistance de Marseille et discours de ses députés à César. —
Réponse de César. — Il marche vers Marseille pour en faire le siège; premiers
travaux. — Description de la forêt sacrée de Marseille que César fait abattre. —
César, impatient de tout retard, se rend en Espagne, et laisse à ses lieutenants la
continuation du siège : travaux et combats. — Les Marseillais font une sortie nocturne, et brûlent les machines de l'ennemi. — Les Romains veulent tenter la
fortune sur mer; description des deux flottes. — Combat naval, dans lequel les
Marseillais sont vaincus; longue et poétique description de la mêlée, de ses
accidents terribles et bizarres.
Tandis que l'Auster enflait la voile et poussait la flotte vers
la pleine mer, tous les yeux étaient tournés du côté de la mer
d'Ionie; Pompée seul ne put détacher ses regards du rivage de
l'Italie. Il voit s'évanouir les ports de la patrie, les côtes qu'il salue pour la dernière fois et les montagnes qui s'effacent au
sein des nuages.
Épuisé de fatigues, le héros enfin succombe, et se livre au
sommeil; Alors une image pleine d'horreur se présente à ses
yeux. La pâle Julie sort du sein béant de la terre, et telle
qu'une furie, lui apparaît debout sur son bûcher : « Chassée de l'Elysée dans le Tartare, la guerre civile m'a bannie de l'asile
des âmes justes au noir séjour des maries criminels. J'ai vu les
Euménides s'armer de torches pour les secouer sur vos armes.
Le nocher du brûlant Achéron prépare des barques sans nombre.
On agrandit les cachots des enfers. Les Furies suffisent à
peine à châtier tant de criminels : les mains des Parques se
lassent à trancher les jours de tant de victimes. Il t'en souvient,
Pompée; le temps de notre hymen a été celui de tes
triomphes. Tu as changé de fortune en changeant d'épouse.
Elle est née pour le malheur de tous ses maris, cette Cornélie,
femme sans pudeur, qui n'a pas rougi d'entrer dans mon
lit, quand mon bûcher fumait encore. Qu'elle soit donc sans
cesse attachée à tes pas, et sur les mers et dans les camps,
pourvu que je trouble ton sommeil auprès d'elle et que je dérobe
à ton amour tous les moments que tu lui destines. Que César occupe tes jours et Julie tes nuits. Le Léthé qui donne
l'oubli ne t'a point effacé de ma mémoire. Les dieux des enfers
m'ont permis de te poursuivre. Tu me verras, au signal du
combat, m'élancer entre les deux armées. Mon ombre ne souffrira
jamais que tu cesses d'être le gendre de César. Tu crois
en vain trancher avec l'épée des noeuds sacrés; la guerre civile
va te rendre à moi. » A ces mots l'ombre se dérobe aux embrassements
de son époux tremblant.
Il s'éveille. Les menaces du ciel et des enfers, loin de l'abattre,
l'élèvent au-dessus de lui-même. Il voit sa perte, et il y court.
« Pourquoi, dit-il, m'effrayer d'un vain songe? Ou la mort n'est
rien, ou elle ne doit laisser aucun sentiment de la vie. »
Déjà le soleil à son déclin se plongeait au sein de l'onde et
nous cachait de son globe enflammé ce que la lune nous dérobe
du sien, lorsqu'elle approche de sa plénitude ou qu'elle commence
à s'en éloigner. Ce fut alors que la côte d'Illyrie offrit
un asile sûr, un accès facile aux vaisseaux de Pompée. On ploie
les voiles, on baisse les mâts, et l'on aborde à l'aide des rames.
Dès que César, à qui les vents enlevaient sa proie, se trouva
seul aux bords de l'Italie, loin de se réjouir d'en avoir chassé son rival, il gémit de voir qu'il lui eût échappé. Aucun succès ne
flatte cette âme impatiente : la victoire elle-même est trop
achetée, s'il faut l'attendre. Mais oubliant pour un temps la
guerre, et tout occupé des soins de la paix, il cherche à se concilier
la légère faveur du peuple : il sait que la disette ou l'abondance
décide le plus souvent de sa haine ou de son amour ;
que celui qui nourrit son oisiveté en est le maître, et qu'il n'est
point de crainte qui retienne un peuple affamé. Il charge Curion
d'aller dans les villes de la Sicile, dans ces lieux où la mer engloutit
ou bien déchira la terre, et s'en fit un rivage. Là, déployant
sa fureur, l'Océan lutte sans cesse pour empêcher que
les monts, jadis séparés, se rejoignent aujourd'hui. César répand
aussi la guerre sur les rives de la Sardaigne. Ces deux îles sont
renommées par la richesse de leurs moissons; nulle autre contrée
de la terre n'a tant de fois répandu l'abondance dans
l'Italie et rempli les greniers de Rome. A peine la Lybie est-elle
plus fertile dans les années mêmes où les vents du Midi
permettent à Borée d'assembler les nuages vers le milieu de
Faxe du monde et d'y verser des pluies abondantes. Acquitté de ce premier soin, César marche à Rome en vainqueur.
Ses légions le suivent, mais désarmées, et portent sur le
front le présage de la paix.
Dieux ! s'il revenait dans sa patrie vainqueur seulement des
peuples de la Gaule et du Nord, quel triomphe pour lui, quelle
pompe! Le Rhin, l'Océan lui-même enchaînés, la Gaule captive
derrière son char, ainsi que le Breton aux cheveux blonds! Que
de gloire il a perdu en abusant de la victoire! Les habitants des
villes n'accourent point sur sa route avec une joie tumultueuse;
sa vue leur inspire une muette terreur. En aucun lieu le peuple
ne se précipite au-devant de ses pas. César s'applaudit cependant
de leur inspirer tant de crainte; à peine eût-il préféré leur amour.
Déjà il a passé la haute citadelle d'Anxur (1), l'humide chemin
qui partage les marais Pontins, et la forêt consacrée à la Diane
de Scythie, et la route des faisceaux latins vers Albe-la-Haute (2);
déjà, il découvre d'une roche élevée, cette Rome qu'il n'a pas
vue depuis la guerre des Gaules. Il s'étonne lui-même de
l'état où il l'a réduite, et il lui adresse ces mots : « Est-il possible,
ô séjour des dieux, que l'on abandonne tes murs sans y
être forcé par la guerre!
1 Anxur, aujourd'hui Terracine, ville bâtie sur une roche escarpée.
2 Chaque année, les consuls allaient offrir un sacrifice à Jupiter, dans Albe-la-Longue, au temps des Féries latines.
Et quelle ville méritera qu'on la défende? Heureusement ce n'est ni le Parthe, ni le Dace uni au Gète, ni le Sarmate secondé du Pannonien qui te menace : la Fortune n'oppose qu'un citoyen qui t'aime au chef timide qui n'ose te garder. Bénis la guerre civile » Bientôt César entre dans Rome où règne l'épouvante; on s'attend qu'il va la livrer aux flammes comme une ville prise d'assaut, ensevelir les dieux sous les ruines. On ne doute pas qu'il ne veuille tout ce qu'il peut; il n'est rien qu'on ne craigne; on ne feint même pas de le voir avec joie et de faire des voeux pour lui : à peine la haine peut-elle s'exhaler. Les sénateurs, du fond de leur retraite, se rendent au temple d'Apollon. C'est la première fois qu'un" citoyen ose convoquer le sénat. On n'y voit point briller les insignes des consuls, point de préteurs, point de chaises curules ; César est tout, et c'est pour entendre la volonté d'un homme que le sénat est assemblé. Les pères conscrits prennent place, résolus de consentir à tout, soit qu'il demande un trône ou des autels, l'exil ou la mort du sénat lui-même. Grâces aux dieux, César eut honte d'exiger ce que Rome n'eût pas eu honte de permettre. Cependant, la liberté indignée osa se révolter encore et tenter par l'organe d'un citoyen si les lois pourraient résister à la force. Le fougueux Métellus voyant qu'on allait enlever le trésor du temple de Saturne, accourut, se fit un passage à travers le cortège de César, et se présenta sur le seuil du temple qu'on allait ouvrir. L'avarice est donc la seule passion qui brave le fer et la mort ! On foule aux pieds les lois sans que personne s'arme pour elles; et le plus vil de tous les biens, For, excite un soulèvement. Métellus s'oppose au pillage du temple, et, d'une voix haute, s'adressant à César : « Tu n'ouvriras ces portes, lui dit-il, qu'après m'avoir percé le sein, et tu n'emporteras les dépouilles du temple que souillé du sang inviolable d'un tribun. Non, les dieux ne laisseront pas impunément souiller cette dignité sainte ; les Euménides l'ont vengée de l'impiété de Crassus. Tire ce glaive ! et frappe sans rougir! Tu n'as point à craindre les yeux du peuple ; nous sommes seuls, Rome est déserte. Que veux-tu? Livrer la patrie en proie à tes soldats? Il te reste encore tant de provinces, tant de villes à ruiner ! Qu'as-tu besoin des trésors de la paix? n'as-tu pas tous ceux de la guerre? » Ce discours alluma la colère du vainqueur. « Tu te flattes en vain, lui dit-il, d'obtenir de moi une mort honorable; non, Métellus, ma main ne sera point souillée d'un sang aussi vil que le tien. Il n'est point d'honneur qui te rende digne de mon ressentiment. C'est donc à toi qu'est confiée la défense de la liberté? Certes, le temps a bien changé les choses, si les lois aiment mieux s'appuyer sur Métellus que de fléchir devant César ! » Alors impatient de voir que le tribun ne quittait point la porte du temple, il regardait les glaives de ses soldats rangés autour de lui et allait oublier le caractère pacifique dont il s'était revêtu, si Cotta n'eût dissuadé Métellus d'une résistance imprudente. « Sous l'autorité d'un seul, dit-il, la liberté se détruit par la liberté même ; vous en conserverez l'ombre, si, en cédant à la nécessité, vous semblez vouloir tout ce qu'elle exige. Vaincus, nous avons subi tant de lois injustes! La seule excuse que peut avoir une si lâche obéissance, c'est l'impuissance de résister. Qu'ils se hâtent d'emporter loin de nous ces trésors, fatales semences de guerre! La ruine de l'État regarde et intéresse un peuple libre ; la misère d'un peuple esclave lui est moins onéreuse qu'à ses tyrans. » Métellus s'éloigne à ces mots, et la roche Tarpéienne retentissant du bruit des portes annonce à Rome que le temple est ouvert. Du .fond de ce temple fut alors tiré ce dépôt si longtemps inviolable des revenus du peuple romain : le tribut des Carthaginois, celui de Persée et de Philippe, tout l'or que Pyrrhus fugitif laissa dans tes mains, ô Rome ! cet or, au prix duquel Fabricius avait refusé de te trahir ; ce qu'avait épargné la frugalité de nos pères; ce que l'opulente Asie avait payé de tributs aux Romains; ce que Métellus avait rapporté de l'île de Crète et Caton des bords lointains de Chypre, enfin tes dépouilles de l'Orient captif et les richesses de tant de rois étalées tout récemment encore dans les triomphes de Pompée, tout fut envahi; le temple fut livré à la plus affreuse rapine,!et dès lors, exemple inouï! César fut plus riche que Rome. Cependant la fortune de Pompée soulevait les nations destinées à la même chute que lui. La Grèce qui voyait de plus près la guerre s'empressa d'y contribuer. Des campagnes de la Phocide, de Cyrrha, et des deux sommets du Parnasse, des champs de Béotie que borde le Céphise prophétique, des environs de Thèbes où coule Dircé, de l'Élide qu'arrose l'Alphée, avant de traverser la mer, on voit les peuples accourir. L'Arcadien quitte le Ménale : le Thessalien, l'OEta, tombeau d'Hercule. Le Thesprote et le Dryope accourent ; les Selles, descendus des montagnes de l'Épire, fuient leurs chênes désormais silencieux; quoique épuisée de soldats, Athènes arme encore quelques vaisseaux dans le port de Phoebus, et trois navires semblent partir pour une nouvelle Salamine. La Crète antique et aimée de Jupiter vient au combat avec ses cent peuples; Gnosse savante à vider le carquois, Gortyne dont la flèche le dispute à celle des Parthes. On voit venir l'habitant de la dardanienne Oricon, et l'Athamas errant et dispersé dans les profondeurs des forêts, Échélée, au nom antique, témoin de la mort de Cadmus et de sa métamorphose, l'habitant de Colchos et d'Absyrte, battue de l'écume des flots adriatiques, et ceux qui cultivent les campagnes du Pénée, et dont les mains laborieuses poussent la charrue thessalienne dans les champs de l'hémonienne Iolcos, Iolcos d'où partit le premier navire qui fendit la mer, quand le grossier Argo mêla des nations inconnues, viola leur rivage, et pour la première fois mit les mortels aux prises avec les vents, les ondes furieuses, et leur apporta un nouveau genre de mort. On déserte l'Hémus de Thrace, et Pholoé, berceau fantastique des Centaures, et le Strymon, qui envoie jusqu'aux tièdes rives du Nil l'oiseau de ses bords, et la barbare Coné, où l'Ister aux cent bouches perd dans la mer ses ondes glacées dont il arrose l'île de Peucé; et la Mysie, et Idalis que féconde l'eau fraîche du Caïque, et Arisbé, aux maigres sillons, et l'habitant de Pitané, et Gélène qui maudit tes présents, ô Pallas! et la victoire d'Apollon; et les bords ou le rapide Marsyas, courant en ligne droite, rencontre le Méandre vagabond, se mêle à lui et remonte vers sa source; et la terre qui laisse le Pactole sortir de ses mines d'or, et les guérets qu'arrose l'Hermus aussi riche que le Pactole. Les Troyens eux-mêmes, avec leurs tristes présages, accourent sous ces drapeaux, dans ce camp condamné à périr, rien ne les retient, ni la fable de Troie, ni César qui se prétend issu du Phrygien Iule. Voici venir les peuples de Syrie ; on déserte l'Oronte et Ninive l'Heureuse (tel est son nom), et Damas battue des vents, et Gaza, et l'Idumée, riche en palmiers, et la capricieuse Tyr, et Sidon, riche en pourpre; sans faire de détour sur la mer, les vaisseaux de ces ports voguent vers le théâtre de la guerre, conduits sûrement par Cynosure. Les premiers, s'il en faut croire la Renommée, les Phéniciens osèrent figurer par des signes grossiers la parole désormais fixée; Memphis ne savait pas encore tisser l'écorce née sur les rives du fleuve ; des oiseaux, des bêtes gravés sur la pierre conservaient seuls son mystérieux langage. On abandonne les bois du Taurus, Tarse, fille de Persée (1), l'antre de Corycie aux roches rongées par l'eau; Mallos (2) et la lointaine Ega résonnent du bruit des navires, et le Cilicien, renonçant au métier de pirate, accourt sur un vaisseau régulier. Le bruit de la guerre remue les peuples les plus reculés de l'Orient, et sur les rives du Gange qui, seul de tous les fleuves, ose déboucher dans l'Océan en face du berceau du Soleil et lance ses flots contre l'Eurus qui les repousse; c'est là que le héros de Pella, s'arrêtant, s'avoua vaincu par l'immense univers. Le même signal retentit sur l'Indus, ce fleuve qui se jetant au sein des mers par deux bouches profondes ne s'aperçoit pas dans sa rapidité que l'Hidaspe se mêle à ses eaux. En même temps s'unissent pour marcher aux combats, les peuples qui boivent sur ces bords la douce liqueur qu'un roseau distille (3); et ceux qui teignent leur chevelure dans le jaune safran (4)et qui sèment de pierreries le long tissu dont ils s'enveloppent ; et ceux qui dressent eux-mêmes leurs bûchers (5) et se jettent vivants au milieu des flammes.
1 Tarse, en Cilicie, patrie de saint Paul, sur le Cydnus. On n'est pas d'accord sur son origine et sur l'épithète Persea que lui donne ici notre auteur.
2 Ville de Cilicie, qui plus tard fut appelée Antioche.
3 C'est la canne à sucre, que les anciens ne cuisaient pas au feu comme nous, mais dont ils exprimaient le suc pour le boire élendu dans de l'eau.
4 Les Calhéens, peuples de l'Inde. Ils teignaient le menton, les habits et les cheveux de leurs enfants. Voyez Strabon, livre XV.
5 Ce sont les gymnosophistes et les brachmanes, philosophes de l'Inde, qui, rassasiés de la vie, se jettent au milieu des flammes (Voyez Strabon, liv. XV; Philostrate, liv. 111). Le supplice volontaire de Calanus est célèbre par la relation de Quinte-Curce. Voir aussi Plularque, Vie d'Alexandre.
0 quelle gloire n'est-ce pas pour eux de disposer ainsi d'eux-mêmes, et, rassasiés de la vie, d'en donner les restes aux dieux ! Viennent les farouches Cappadociens, et les hôtes du sauvage Amanus, et l'Arménien répandu le long du Niphate, qui roule des rocs ; les Coastres quittent leurs forêts qui touchent aux nuages ; Arabes, vous passez dans un monde inconnu et vous vous étonnez que l'ombre des bois ne se dessine plus à votre gauche. La fureur romaine soulève le lointain Horète et les chefs Carmanes, dont l'horizon incliné vers l'Auster ne voit pas l'Ourse se plonger entièrement dans les flots ; au sein des nuits courtes, le rapide Bouvier ne brille qu'un instant ; et la terre d'Ethiopie qui ne verrait à cette région du ciel aucune constellation, si, incliné sur son jarret, le Taureau agenouillé ne laissait voir l'extrémité de son pied; et les lieux où le vaste Euphrate lève sa tête près du Tigre rapide; la Perse les fait naître tous deux d'une même source, et si la terre mêlait leurs eaux, on ne saurait quel nom donner à leur cours. Débordé dans les plaines, le fertile Euphrate remplit en ces lieux le même rôle que le Nil égyptien; quant au Tigre, soudainement engouffré dans la terre profonde, il cache sa source mystérieuse, et renaissant par une source nouvelle, il ne refuse pas à la mer le tribut de son onde. Entre César et les drapeaux ennemis, le Parthe belliqueux balance hésitant, il lui suffit d'avoir fait deux rivaux. Les hordes errantes de Scythie trempent leurs flèches dans le poison, comme font les habitants du Bactre glacé (1)et des forêts immenses d'Hyrcanie. De là, l'Hénioque (2), issu de Lacédémone, cavalier terrible et redoutable; le Sarmate et le Mosque cruel, son voisin, et l'habitant de Golchos où le Phase roule l'or de ses ondes, et l'Halys fatal à Crésus; là, où tombant du Riphée, le Tanaïs donne à ses rives le nom de deux univers : limite commune entre l'Europe et l'Asie ;.il sépare ces deux contrées, et selon qu'il fléchit à droite ou à gauche, agrandit chaque région.
1 Les peuples de la Bactriane, ainsi nommée du fleuve qui l'arrose.
2 Peuples du Caucase, et bons cavaliers. On les dit descendus d'Amphytus et de Telechius, Lacédémoniens, écuyers de Castor et de Pollux
On s'arme aux lieux où l'Euxin, mer torrentueuse, chassant les ondes méotides, ravit leur gloire aux colonnes d'Hercule, et refuse à Gadès l'honneur de recevoir seule l'Océan. Puis ce sont les nations d'Essédonie, et vous, Arimaspes, qui rattachez vos chevelures avec un noeud d'or; et le vaillant habitant d'Aria, et le Massagète, ennemi du Sarmate, qui dans ses longues guerres apaise sa faim par la chair du cheval qui le porte, et le Gélon rapide comme l'oiseau. Non, quand Cyrus amenait ses bataillons des rives de l'Aurore, ni quand Xerxès comptait ses soldats par les traits qu'ils lançaient, ni quand le vengeur de Ménélas, de son frère outragé, sillonnait la mer écumante sous ses flottes, jamais on ne vit tant de rois sous un seul chef; jamais on ne vit s'assembler des nations si différentes de moeurs, de costumes et de langage. La Fortune a soulevé tous ces peuples pour les mêler à cette ruine immense, pour faire à Pompée de dignes funérailles. Hammon, le dieu cornu, ne se lassa pas d'envoyer au combat ses bandes africaines, depuis le pays Maurique, à l'occident, et les arides sables de Lybie, jusqu'aux Syrtes parétonniennes, à l'orient de ces rivages. Pour que l'heureux César reçût tout ensemble, Pharsale lui donne à vaincre l'univers entier d'un seul coup. Dès que César est sorti des murs de Rome consternée, il semble donner à ses légions des ailes pour franchir les Alpes nuageuses. Mais tandis que les autres nations frémissent au nom de César, Marseille, colonie de Phocée, ose rester fidèle à son alliance, garde la foi jurée; et toute grecque qu'elle est, préfère le parti le plus juste au plus heureux. Cependant elle veut essayer par un langage pacifique de fléchir la fureur indomptable de César et la dureté de cette âme superbe. Ses députés s'avancent, l'olive de Minerve dans les mains, au-devant de César et de ses légious. « Romains, dirent-ils, vos annales attestent que, dans les guerres du dehors, Marseille a, dans tous les temps, partagé les travaux et les dangers de Rome; aujourd'hui même, si tu veux, César, chercher dans l'univers de nouveaux triomphes, nos mains vont s'armer et te sont dévouées : mais si dans les combats où vous courez, Rome, ennemie d'elle-même, va se baigner dans son propre sang, nous n'avons à vous offrir que des larmes et un asile. Les coups que Rome va se porter nous seront sacrés. Si les dieux s'armaient contre les dieux, ou si les géants leur déclaraient la guerre, la piété des humains serait insensée d'oser vouloir les secourir par des voeux ou par des armes ; et ce n'est qu'au bruit du tonnerre que l'homme, aveugle sur le destin des dieux, saurait que Jupiter règne encore aux cieux. Ajoutez que des peuples sans nombre accourent de toutes parts, et que ce monde corrompu n'a pas assez le crime en horreur pour que vos guerres domestiques manquent de glaives. Et plût aux dieux que la terre entière pensât comme nous, qu'elle refusât de seconder vos haines, et que nul étranger ne voulût se mêler à vos combattants ! Est-il un fils à qui les armes ne tombassent des mains à la rencontre de son père ? Est-il dès frères capables de lancer le javelot contre leur frère? La guerre est finie, si vous êtes privés du secours de ceux à qui elle est permise. Pour nous, la seule grâce que nous vous demandons, c'est de laisser loin de nos remparts ces drapeaux, ces aigles terribles, de daigner vous fier à nos murs, et de consentir que nos portes soient ouvertes à César et fermées à la guerre. Qu'il reste sur la terre un asile inaccessible et sûr où Pompée et toi, si jamais le malheur de Rome vous touche et vous dispose à un accord, vous puissiez venir désarmés. Du reste, qui peut t'engager, quand la guerre t'appelle en Espagne, à suspendre ici ta marche rapide? Nous ne sommes d'aucun poids dans la balance des destins du monde. Depuis que ce peuple, exilé de son ancienne patrie, a quitté les murs de Phocée livrés aux flammes, quels ont été nos exploits? Enfermés dans d'étroites murailles, et sur un rivage étranger, notre bonne foi seule nous rend illustres. Si tu prétends assiéger nos murs et briser nos portes, nous sommes résolus à braver le fer et la flamme, et la soif et la faim. Si tu nous prives du secours des eaux, nous creuserons, nous lécherons la terre; que le pain nous manque, nous nous réduirons aux aliments les plus immondes. Ce peuple aura le courage de souffrir pour sa liberté tous les maux que supporta Sagonte assiégée par Annibal. Les enfants arrachés des bras de leurs mères, presseront en vain leurs mamelles taries et desséchées par la faim et seront jetés dans les flammes : l'épouse demandera la mort à son époux chéri, les frères se perceront l'un l'autre, et cette guerre domestique leur fera moins d'horreur que celle où tu veux nous forcer. » Ainsi parlèrent les.guerriers grecs; et César dont la colère enflammait les regards, la laisse éclater en ces mots : « Ces Grecs comptent vainement sur la rapidité de ma course. Tout impatient que je suis de me rendre aux extrémités de la terre, j'aurai le temps de raser ces murs. Réjouissez-vous, soldats, le sort met sur votre passage de quoi exercer votre valeur. Comme les vents ont besoin d'obstacles pour ramasser leurs forces dissipées et comme la flamme a besoin d'aliment, ainsi nous avons besoin d'ennemis. Tout ce qui cède nous dérobe la gloire de vaincre que la révolte nous offrirait. Marseille (1) consent à m'ouvrir ses portes, si j'ai la bassesse de m'y présenter seul et sans armes. C'est peu de m'exclure, elle veut m'enfermer. Croit-elle se dérober à la guerre qui embrase le monde?
1 Au retour de la guerre d'Espagne, César réduisit Marseille, qui s'obstinait dans le parti de Pompée. Ces Grecs qui avaient toujours eu le monopole du commerce de la Gaule, étaient jaloux, sans doute, de la faveur avec laquelle César traitait les barbares Gaulois, quoiqu'il eût précédemment accordé des privilèges commerciaux aux Marseillais. Marseille était une colonie grecque, non de la Phocide, comme on l'a cru à tort, mais de Phocée, en Asie Mineure. Elle se déclara contre César, à l'instigation de Domitius qui s'y était rendu après avoir reçu la vie de César, à Corfinium. « Malheureuse ville que Marseille ! s'écrie Florus; elle veut la paix, et la crainte de la guerre attire la guerre sur elle. »
Vous serez punis d'avoir osé prétendre à la paix ! et vous apprendrez que du temps de César, il n'y a point d'asile plus sûr au monde que la guerre sous mes drapeaux. » Il dit, et marche vers les murs de Marseille, où nul ne tremble. Il trouve les portes fermées et les remparts couverts d'une armée nombreuse et résolue. Non loin de la ville est une colline dont le sommet aplani forme un terrain spacieux. Cette hauteur, où il est facile à César de se retrancher par une longue enceinte, lui présente un camp avantageux et sur. Du côté opposé à cette colline, et à la même hauteur, s'élève un fort qui protège la ville, et dans l'intervalle sont des champs cultivés. César trouve digne de lui le vaste projet de combler le vallon et de joindre les deux éminences. D'abord, pour investir la ville du côté de la terre, il fait pratiquer un long retranchement du haut de son camp jusqu'à la mer. Un rempart de gazon couvert d'épais créneaux, doit embrasser la ville et lui couper les eaux et les vivres qui lui viennent des champs voisins. Ce sera pour la ville grecque un honneur immortel, un fait mémorable dans tous les âges, d'avoir soutenu sans abattement les approches de la guerre, d'en avoir suspendu le cours; et tandis que l'impétueux César entraînait tout sur son passage, de n'avoir seule été vaincue que par un siège pénible et lent. Quelle gloire, en effet, de résister aux destins, et de retarder si longtemps la Fortune impatiente de donner un maître à l'univers ! Les forêts tombent de toutes parts et sont dépouillées de leurs chênes; car il fallait que, le milieu du rempart n'étant comblé que de légers faisceaux couverts d'une couche de terre, les deux bords fussent contenus par des pieux et des poutres solidement unies, de peur que ce terrain mal affermi ne s'écroulât sous le poids des tours. Non loin de la ville était un bois sacré, dès longtemps inviolé, dont les branches entrelacées écartant les rayons du jour, enfermaient sous leur épaisse voûte un air ténébreux et de froides ombres. Ce lieu n'était point habité par les Pans rustiques ni par les Sylvains et les nymphes des bois. Mais il cachait un culte barbare et d'affreux sacrifices. Les autels, les arbres y dégouttaient de sang humain ; et, s'il faut ajouter foi à la superstitieuse antiquité, les oiseaux n'osaient s'arrêter sur ces branches ni les bêtes féroces y chercher un repaire ; la foudre qui jaillit des nuages évitait d'y tomber, les vents craignaient de l'effleurer. Aucun souffle n'agite leurs feuilles; les arbres frémissent d'eux-mêmes. Des sources sombres versent une onde impure; les mornes statues des dieux, ébauches grossières, sont faites de troncs informes ; la pâleur d'un bois vermoulu inspire l'épouvante. L'homme ne tremble pas ainsi devant les dieux qui lui sont familiers. Plus l'objet de son culte lui est inconnu, plus il est formidable. Les antres de la forêt rendaient, disait-on, de longs mugissements ; les arbres déracinés et couchés par terre se relevaient d'eux-mêmes ; la forêt offrait, sans se consumer, l'image d'un vaste incendie; et des dragons de leurs longs replis embrassaient les chênes. Les peuples n'en approchaient jamais. Ils ont fui devant les dieux. Quand Phébus est au milieu de sa course, ou que la nuit sombre enveloppe le ciel, le prêtre lui-même redoute ces approches et craint de surprendre le maître du lieu. Ce fut cette forêt que César ordonna d'abattre, elle était voisine de son camp, et comme la guerre l'avait épargnée, elle restait seule, épaisse et touffue, au milieu des monts dépouillés. A cet ordre, les plus courageux tremblent. La majesté du lieu les avait remplis d'un saint respect, et dès qu'ils frapperaient ces arbres sacrés, il leur semblait déjà voir les haches vengeresses retourner sur eux-mêmes. César voyant frémir les cohortes dont la terreur enchaînait les mains, ose le premier se saisir de la hache, la brandit, frappe, et l'enfonce dans un chêne qui touchait aux cieux. Alors leur montrant le fer plongé dans ce bois profané : « Si quelqu'un de vous, dit-il, regarde comme un crime d'abattre la forêt, m'en voilà chargé, c'est sur moi qu'il retombe. » Tous obéissent à l'instant, non que l'exemple les rassure, mais la crainte de César l'emporte sur celle des dieux. Aussitôt les ormes, les chênes noueux, l'arbre de Dodone, l'aune, ami des eaux, les cyprès, arbres réservés aux funérailles des patriciens, virent pour la première fois tomber leur longue chevelure, et entre leurs cimes il se fit un passage à la clarté du jour. Toute la forêt tombe sur elle-même, mais en tombant elle se soutient et son épaisseur résiste à sa chute. A cette vue tous les peuples de la Gaule gémirent, mais captive dans ses murailles, Marseille s'en applaudit. Qui peut se persuader, en effet, que les dieux se laissent braver impunément? et cependant combien de coupables la Fortune n'a-t-elle pas sauvés! Il semble que le courroux du ciel n'ait le droit de tomber que sur les misérables. Quand les bois furent assez abattus, on tira des campagnes voisines des chariots pour les enlever; le laboureur consterné vit dételer ses taureaux, et, obligé d'abandonner son champ, il pleura la perte de l'année. César trop impatient pour se consumer dans les longueurs d'un siège, tourne ses pas du côté de l'Espagne et ordonne à la guerre de le suivre vers cette extrémité du monde. Le rempart s'élève sur de solides palissades, et reçoit deux tours de la même hauteur que les murs de la citadelle. Ces tours ne sont point attachées à terre, mais elles roulent sur des essieux obéissant à une force cachée. Les assiégés,du haut de leur fort, voyant ces massess'ébranler, en attribuèrent la cause à quelque violente secoussequ'avaient donnée à la terre les vents enfermés dans son sein ; et ils s'étonnèrent que leurs murailles n'en fussent pas ébranlées ; mais tout à coup, du haut de ces tours mouvantes, tombe sur eux une grêle de dards. De leur côté, volent sur les Romains des traits plus terribles encore ; car ce n'est point à force de bras que leurs javelots sont lancés : décochés par le ressort dé la baliste, ils partent avec la rapidité de la foudre, et au lieu de s'arrêter dans la plaie, ils s'ouvrent une large voie à travers l'armure et les os fracassés, y laissent la mort et volent au delà avec la force de la donner encore. Cette machine formidable lance des pierres d'un poids énorme, et qui, pareilles à des rochers déracinés par le temps et détachés par un orage, brisent tout ce qu'elles rencontrent. C'est peu d'écraser les corps sous leur chute, elles en dispersent au loin les membres ensanglantés. Mais à mesure que les assiégeants s'approchaient des murs, à couvert sous la tortue, les traits qui de loin auraient pu les atteindre, passaient au-dessus de leurs tètes; et il n'était pas facile aux ennemis de changer la direction de la machine qui les lançait. Mais la pesanteur des rochers leur suffit pour accabler tout ce qui s'approche; et ils se contentent de les rouler à force de bras du haut des murailles. Tant que les boucliers des Romains sont unis et qu'ils se soutiennent l'un l'autre, ils repoussent les traits qui les frappent, comme un toit repousse la grêle qui, sans le briser, le fait retentir. Mais sitôt que la force du soldat épuisée laisse rompre cette espèce de voûte, chaque bouclier seul est trop faible pour soutenir tous les coups qu'il reçoit. Alors on fait avancer le mantelet couvert de terre, sous cet abri, sous ce front couvert, on se prépare à battre les murs et à les ruiner par la basç. Bientôt le bélier dont le balancement redouble les forces, frappe et tente de détacher ces longues couches de pierre qu'un dur ciment tient enchaînées et que leur poids même affermit. Mais le toit qui protège les Romains, chargé d'un déluge de feu, ébranlé par les masses qu'on y fait tomber et par les poutres qui, du haut des murs, travaillent sans cesse à l'abattre, ce toit tout à coup s'embrase et s'écroule, et, accablés d'un travail inutile, les soldats regagnent leur camp. Les assiégés n'avaient d'abord espéré que de défendre leurs murailles, ils osent risquer une attaque au dehors. Une jeunesse intrépide sort à la faveur de la nuit : elle n'a pour armes ni la lance, ni l'arc terrible, ses mains ne portent que la flamme cachée à l'ombre des boucliers. L'incendie se déclare : un vent impétueux le répand sur tous les travaux de César. Le chêne vert a beau résister, les progrès du feu n'en sont pas moins rapides ; partout où les flambeaux s'attachent, le feu s'élance sur sa proie, et des tourbillons de flamme se mêlent dans l'air à d'immenses colonnes de fumée. Non-seulement les bois entassés, mais les rochers eux-mêmes sont, embrasés et réduits en poudre. Tout le rempart s'écroule en même temps, et dans ses débris dispersés, la masse en parait agrandi Les Romains, sans ressource du côté de la terre, tentent la fortune sur mer. Déjà Brutus sur le vaisseau Prétorien, semblable à une forteresse, avait abordé aux îles Stéchades, accompagné d'une flotte que le Rhône avait vu construire et qu'il avait portée à son embouchure. On y joint des navires faits à la hâte, non de bois peints et décorés, mais de chênes grossièrement taillés, et tels qu'ils tombaient des montagnes; du reste, fortement unis et formant un plancher solide et commode pour le combat. Marseille, de son côté, s'est résolue à courir avec toutes ses forces le hasard d'un combat. Les vieillards eux-mêmes ont pris les armes et viennent se ranger parmi les jeunes citoyens. Non-seulement les vaisseaux en état de servir, mais ceux qui dans le port tombaient en ruine et qu'on a réparés, sont chargés de combattants. Le soleil matinal répandait sur la face «des eaux ses rayons brisés par .les ondes. Le ciel était sans nuage, les vents en silence laissaient régner dans l'air le calme et la sérénité, et la mer semblait s'aplanir pour la bataille. Alors chaque navire quitte sa place, et d'un mouvement égal, s'avancent des deux côtés ceux de Marseille et ceux des Romains. D'abord, la rame les ébranle, et bientôt à coups redoublés elle les soulève et les fait mouvoir. La flotte des Romains était rangée en forme de croissant. Les solides galères et les navires à quatre rangs de rames forment un demi-cercle de bâtiments innombrables. Cette force redoutable fait face à la pleine mer. Au centre du croissant rentrent les vaisseaux liburniens, fiers de leur double rang de rames. Au-dessus de tous s'élevait la poupe du vaisseau de Brutus. Six rangs de rameurs lui faisaient tracer un sillon vaste au sein de l'onde, et ses rames les plus élevées s'étendaient au loin sur la mer. Dès que les flottes ne sont plus séparées que par l'espace qu'un vaisseau peut parcourir d'un seul coup d'aviron, mille voix remplissent les airs, et l'on n'entend plus à travers ces clameurs ni le bruit des rames, ni le son des trompettes. On voit les rameurs balayer les flots et renversés sur les bancs se frapper la poitrine de leurs rames. Les proues se heurtent à grand bruit, les vaisseaux virent de bord, mille traits lancés se croisent dans l'air, bientôt la mer en est couverte. Déjà les deux flottes se déploient et les vaisseaux divisés se donnent un champ libre pour le combat. Alors, comme dans l'Océan, si le flux et le vent sont opposés, la mer avance et le flot recule ; de même les vaisseaux ennemis sillonnent l'onde en sens contraire, la masse d'eau que l'un chasse est à l'instant repoussée par l'autre. Mais les vaisseaux de Marseille étaient plus propres à l'attaque, plus légers à la fuite, plus faciles à ramener par de rapides évolutions, enfin plus dociles à l'action du gouvernail. Ceux des Romains, au contraire, avaient pour eux l'avantage d'une assiette solide, et l'on y pouvait combattre comme sur la terre ferme. Brutus dit donc à son pilote assis sur la poupe : « Pourquoi laisser les deux flottes se disperser sur les eaux, est-ce d'adresse que tu veux combattre? Engage la bataille, et que nos vaisseaux présentent le flanc à la proue ennemie. » Le pilote obéit et présente son vaisseau en travers de l'ennemi. Dès lors chaque vaisseau qui, de sa proue, heurte le flanc des vaisseaux de Brutus, y reste attaché, vaincu par le choc, et retenu captif par le fer qu'il enfonce. D'autres sont arrêtés par des griffes d'airain, ou liés par de longues chaînes. Les rames se tiennent enlacées, et les deux flottes couvrant la mer forment un champ de bataille immobile. Ce n'est plus le javelot, ce n'est plus la flèche qu'on lance; on se joint, on combat l'épée à la main. Chacun du haut de son bord se penche au-devant du fer ennemi ; les morts tombent hors du bord qu'ils défendent. Les eaux sont couvertes d'une écume de sang, la mer profonde en est épaissie, et les cadavres suspendus entre les flancs des vaisseaux, rendent impuissants les efforts que fait l'un des deux pour attirer l'autre. Parmi les combattants, les uns qui respirent encore en tombant, boivent leur sang avec l'onde âmère; d'autres luttant contre une mort lente, sont tout à coup ensevelis avec leur vaisseau qui s'entr'ouvre. Les traits qui volent en vain ne tombent pas de même, et s'ils ont manqué leur première victime, il s'en trouve mille à frapper sur les eaux. L'une de nos galères, environnée de celles de Marseille, avait déployé ses forces sur ses deux bords et les défendait en même temps avec une égale intrépidité. Ce fut là que le brave Catus, combattant du haut de la poupe et voulant enlever le pavillon ennemi, reçoit deux flèches opposées, qui se croisent en lui perçant le coeur. D'abord son sang hésite, incertain par quelle plaie il va s'écouler; mais repoussant à la fois les deux flèches, il s'ouvre à grands flots l'un et l'autre passage, et semble, en divisant l'àme de ce guerrier, payer un double tribut à la mort. Dans ce combat s'était engagé ie malheureux Télon, celui des Phocéens qui maîtrisait le mieux un navire dans la tempête. Jamais pilote n'a mieux prévu les variations de l'air annoncées par le soleil ou par le croissant de la lune; toujours ses voiles étaient disposées pour le vent qui allait se lever. Il avait brisé du fer de sa proue le flanc du vaisseau qu'il attaquait. Mais un javelot lui perça le sein; et le dernier effort de sa main défaillante fut de détourner son vaisseau. Giarée va pour le remplacer et saute sur sa poupe. Le trait mortel le cloue au moment qu'il s'élance, l'attache et le tient suspendu au navire. Il y avait deux jumeaux, la gloire de leur féconde mère. Les mêmes flancs les avaient conçus pour des destins bien différents. La cruelle mort distingua ces frères que leurs parents confondaient tous les jours. Hélas! cette douce erreur est détruite : l'un d'eux a péri, et celui qui leur reste, éternel objet de leurs larmes, nourrit sans cesse leur douleur en leur offrant l'image de celui qui n'est plus. Ce malheureux jeune homme, voyant les rames de son vaisseau entrelacées avec celles d'un vaisseau romain, osa porter la main sur le bord ennemi : un fer pesant tombe sur sa main et la coupe (1), mais sans lâcher prise, elle se roidit, attachée au bois qu'elle a saisi. Le malheur ne fit qu'irriter le courage du guerrier mutilé.
1 Ce trait d'héroïsme, dont notre poète fait ici honneur à un Marseillais, Suétone, Vie de César, ch. LXVIII ; Valère-Maxime, liv, 111, ch. ii ; Plutarque, Vie de César, ch. XVII, l'attribuent à un soldat de César, dans ce même combat naval devant Marseille.
De l'intrépide main qui lui reste, il veut reprendre celle qu'il a perdue ; mais
un nouveau coup lui détache le bras et la main dont il combattait.
Alors, sans bouclier, sans armes, il ne va point se
cacher au fond du vaisseau; mais de son corps exposé aux
coups, il fait un rempart à son frère. Percé de flèches, il se
tient debout, et après le coup qui suffit à sa mort, il en reçoit
mille, qui tous seraient mortels, et qu'il épargne à ses amis.
Enfin, comme il sent que son âme va s'échapper par tant de
plaies, il la ramasse et la retient dans ce corps défaillant; il
emploie tout le sang qui lui reste à tendre un moment les ressorts
de ses membres, et consumant dans un dernier effort tout
ce qu'il a de vie et de force, il se précipite sur le bord ennemi
pour nuire au moins par le poids de sa chute.
Ce vaisseau, comblé de cadavres, regorgeant de sang, brisé
par les coups redoublés des proues, s'entr'ouvre enfin de toutes
parts. L'eau perce à travers ses flancs fracassés, et, dès qu'il
est plein jusqu'aux bords, il s'engloutit, et dans son tourbillon
il enveloppe les flots qui l'entourent. L'onde recule, l'abîme
s'ouvre, la mer retombe et le remplit.
Dans ce jour, le sort des combats étala sur la mer ses prodiges.
Le fer recourbé que les Romains jetaient sur une galère ennemie atteignit un guerrier nommé Licidas, et il l'entraînait
dans les flots. Ses compagnons veulent le retenir ; les jambes
qu'ils saisissent leur restent ; le haut du corps en est détaché :
son sang ne s'écoule pas avec lenteur, comme par une plaie,
mais il jaillit à la fois par tous ses canaux brisés, et le mouvement
de l'âme qui circule de veine en veine est tout à coup
interrompu. Jamais la source de la vie n'eut pour s'épancher
une voie aussi vaste. La moitié du corps, qui n'avait que des
membres épuisés de sang et d'esprit, fut à l'instant la proie de
la mort; mais celle où le poumon respire, où le coeur répand
la chaleur, lutta longtemps avant que de subir le sort de l'autre
moitié de lui-même.
Tandis qu'une troupe, obstinée à la défense de son vaisseau,
se presse en foule sur le bord qu'on attaque et laisse sans défense
le flanc qui n'a point d'ennemis, le navire penché du côté
qu'elle appesantit, se renverse, et couvre d'une voûte profonde
et la mer et les combattants. Leurs bras ne peuvent se déployer
et ils périssent comme enfermés dans une étroite prison.
Alors on ne voit partout que l'affreuse image d'une mort
sanglante. Tandis qu'un jeune homme se sauve à la nage, deux
vaisseaux qui vont se heurter le percent du bec de leurs proues ; et ses os brisés par ce choc terrible n'empêchent pas l'airain
de retentir. De ses entrailles écrasées, de la bouche le sang
jaillit au loin dans les airs; et lorsque les deux vaisseaux s'éloignent,
son corps transpercé tombe au sein des eaux. Une
foule de malheureux prêts à périr et se débattant contre la
mort tâchent d'aborder une de leurs galères ; mais dès qu'ils
veulent s'y attacher, comme elle chancelle et va périr sous une
charge trop pesante, du haut du bord, un fer impie coupe les
bras sans pitié. Ces bras suppliants restent suspendus, les corps
s'en détachent et tombent dans l'abîme, car l'eau ne peut plus
soutenir le poids de ces corps mutilés.
Déjà les combattants ont épuisé leurs traits, mais leur fureur
invente des armes. Les uns chargent l'ennemi à coups de rames,
les autres saisissent les antennes et les lancent à force de bras.
Les rameurs arrachent leurs bancs et les font voler d'un bord
à l'autre. On brise le vaisseau pour combattre. Ceux-ci foulant
aux pieds les morts, les dépouillent du fer dont ils sont percés;
ceux-là blessés d'un trait mortel, le retirent de la plaie et la
ferment d'une main pour que le sang retenu dans les veines donne à l'autre main plus de force ; qu'il s'écoule après que le
javelot est parti, c'est assez.
Mais rien ne fît dans ce combat autant de ravage que le feu,
cet ennemi de l'Océan. La poix brûlante, le soufre, la ciré enflammée
répandent l'incendie avec elles. L'onde ne peut vaincre
la flamme et des vaisseaux brisés dans le combat, un feu dévorant
poursuit et consume les débris épars sur les eaux. L'un ouvre
son navire aux ondes, pour éteindre l'incendie, l'autre pour
éviter d'être submergé, s'accroche aux poutres brûlantes. De
mille genres de mort, le seul que l'on craigne est celui dont on
se voit périr. Le naufrage même n'éteint pas la valeur. On voit
ceux qui nagent encore ramasser les traits répandus sur la
mer et les fournir à leurs compagnons qui combattent sur les
vaisseaux, ou, d'une main mal assurée s'efforcer de les lancer
eux-mêmes. Si le fer manque, l'onde y supplée, l'ennemi s'attache
avec fureur à son ennemi, leurs bras et leurs mains s'entrelacent
et chacun d'eux s'enfonce avec joie pour submerger
l'autre avec lui.
Il y avait dans ce combat, parmi les Phocéens, un homme
exercé à retenir son haleine sous les eaux; soit qu'il fallût aller dégager l'ancre qui ne cède plus au câble, ou chercher au fond
de la mer ce que le sable avait dévoré. Dès que ce plongeur
redoutable avait noyé son adversaire, il revenait sur l'eau
triomphant. Mais à la fin croyant remonter sans obstacle, sa
tête rencontre le fond d'une galère et il reste englouti.
On en vit s'attacher aux rames d'un vaisseau ennemi pour
retarder sa fuite; on en vit même se suspendre en mourant à
la poupe de leur navire pour rompre le choc d'un navire opposé.
Leur plus grand souci était que leur mort ne fût pas perdue.
Un Phocéen, nommé Ligdamus, instruit dans l'art des Baléares,
fait partir de sa fronde un plomb rapide. Tyrrhénus qui
commandait du haut de sa poupe en est atteint : le plomb mortel
lui brise les tempes, et ses yeux dont tous les liens sont rompus,
tombent, chassés de leurs orbites par des flots de sang ; immobile
et dans l'étonnement de ne plus voir la lumière, il prend
ces ténèbres pour celles de la mort, mais bientôt se sentant plein
de vie : « Compagnons, dit-il, employez-moi comme une machine
à lancer les traits. Allons, Tyrrhénus, abandonnons ce
reste de vie aux fureurs de la guerre, et de mon cadavre tirons encore cet avantage de l'exposer aux coups destinés aux vivants.
» Il dit, et ses traits aveuglément lancés, ne laissent pas
de porter atteinte. Argus, jeune homme d'une naissance illustre,
en est frappé à l'endroit où le ventre se courbe vers les entrailles
; et en tombant sur le fer il l'enfonce.
Sur le même vaisseau et à l'extrémité opposée était le malheureux
père d'Argus, guerrier illustre dans sa jeunesse, et qui
ne le cédait en valeur à aucun des Phocéens. Mais ici, courbé
sous le poids des ans et tout consumé de vieillesse, c'était un
exemple et non pas un soldat.
Témoin de la mort de son fils, il se traîne à pas chancelants,
et, de chute en chute, le long du navire, il arrive jusqu'à la
poupe et il y trouve son fils expirant. On ne voit point ses larmes
couler ni ses mains frapper sa poitrine; mais, comme il tend
les bras, tout son corps se roidit, ses yeux se couvent d'épaisses
ténèbres ; il regarde son fils et il ne le reconnaît plus.
Celui-ci, dès qu'il aperçoit son père, soulève sa tête penchée
sur son cou languissant. Il veut parler, la voix lui manque,
seulement sa bouche muette demande à son père un dernier
baiser et invite sa main à lui fermer les yeux. Dès que le vieîllard est revenu à lui-même et que la cruelle douleur a repris
des forces : « Je ne perdrai point, dit-il, le moment que me
laissent les dieux cruels; je percerai ce coeur vieilli. Argus,
pardonne à ton père de fuir tes embrassements et les derniers
soupirs de ta bouche. Le sang bout encore dans tes blessures;
tu respires, tu peux me survivre encore. » A ces mots, quoique
son épée fût tout entière plongée dans son sein, il se hâte de se
précipiter dans les flots, impatient de précéder son fils ; il n'ose
se confier à une seule mort.
La victoire n'est plus douteuse, le sort des combats s'est
déclaré. La plupart des vaisseaux de Marseille sont abîmés sous
les eaux, le reste ayant changé de matelots, reçoit et porte les
vainqueurs ; un petit nombre gagnent la mer et cherchent leur
salut dans la fuite.
Quelle fut au dedans des murs la désolation des familles! De
quels cris les mères éplorées firent retentir le rivage! On vit
des épouses éperdues, qui, dans les cadavres flottants sur le
bord, croyant reconnaître des traits souillés de sang, embrassaient
le corps d'un ennemi qu'elles prenaient pour celui d'un
époux. On vit de misérables pères se disputer près des bûchers
un corps mutilé. Cependant Brutus triomphant sur les mers (1) s'applaudit d'avoir,
le premier, joint à l'éclat des armes de César l'honneur d'une
victoire navale.
1 Tous les détails de ce siège et du combat naval qui le termina, sauf sa partie poétique, se trouvent dans les Commentaires de César. Voyez Guerre civile, liv. II, ch. I-XVI.
Guerre d'Espagne contre Pétréius et Afranius, lîeutenants de Pompée; description
de leur camp auprès d'Hilerda. — César essaye en vain de s'emparer
d'une éminenec au-dessus d'Hilerda. — Pluies terribles qui menacent de noyer
le camp de César. — César passe le Sicoris au moyen d'un pont jeté sur ce fleuve ;
Pétréius lève son camp et veut se rendre dans le pays des Celtibériens. — César
le poursuit et l'atteint. — Les deux armées, campées l'une près de l'autre et
séparées par un étroit retranchement, le franchissent et s'embrassent. — Pétréius
trouble cette paix et pousse aux armes ses soldats. — Son discours aux Pompéiens.
— Massacre qui suit cet intervalle de paix dans le camp de Pétréius. —
Les Pompéiens cherchent à regagner les hauteurs d'Hilerda; César les enferme
sur des collines où ils manquent d'eau. — Dévorés de soif et désespérés, ils
veulent combattre; mais César leur refuse la bataille. —Tableau de la situation
des Pompéiens privés d'eau. — Les chefs se rendent : discours d'Afrauius à
César. — César fait grâce aux Pompéiens. — Antoine, lieutenant de César, est
pressé par la famine au milieu de son camp, dans une île de l'Adriatique. — Il
cherche un moyen d'échapper en fuyant par mer, et de rejoindre ceux de son
parti. — Des chaînes lâches, cachées sous les eaux par l'ordre du chef des Pompéiens,
retiennent un des vaisseaux d'Antoine.— Vultéius, commandant du navire,
exhorte ses soldats à se tuer les uns les autres plutôt que de se rendre. — Ils
s'égorgent les uns les autres. — Eloge de cette action. — Curion passe en Afrique
et campe sur des roches ruineuses qu'on appelait le royaume d'Antée. —
Description
du combat de ce géaut contre Hercule. — Forces des Pompéiens en Afrique,
sous le commandement de Varus et de Juba. — Ressentiment de Juba contre
Curion. — Curion attaque Varus et le défait.— Défaite des Césariens par les Numides
; Curion se fait tuer. — Épilogue sur cette mort de Curion.
César, aux confins de l'univers, commence une guerre qui
coûta peu de sang, mais qui devait être d'un grand poids dans
la fortune des deux partis. A la tête des troupes de Pompée, en Espagne, marchaient Afranius et Pétréius ses lieutenants. Rivaux
et compagnons de gloire, ils partageaient d'intelligence le commandement
de l'armée, et veillaient tour à tour à la garde du
camp. Aux légions romaines qu'ils commandaient, s'étaient
joints l'infatigable Astur, le Véton léger et ceux des Celtes qui,
transfuges de la Gaule, avaient mêlé leur nom à celui des
Ibères.
Sur une colline fertile et d'une pente facile et douce est située
l'antique Hilerda. Au pied de ses murs, le Sicoris, l'un des plus
beaux fleuves de ces contrées, promène ses tranquilles eaux.
Un pont de pierre embrasse le fleuve de son arc immense et
résiste aux torrents de l'hiver. Près de la ville et sur une hauteur
est situé le camp de Pompée : celui de César occupe une
éminence égale, le fleuve sépare les deux camps.
De là s'étend une vaste plaine où l'oeil s'égare dans le lointain
et que tu termines, rapide Cinga ! Mais tu n'as pas la gloire
de garder ton nom jusqu'à la mer et d'y porter le tribut de ton
onde. L'Èbre qui préside à ces campagnes te reçoit et t'enlève
ton nom.
Le premier jour se passa sans combattre : on l'employa des
deux côtés à étaler ses forces et ses innombrables enseignes aux yeux de l'ennemi. Les deux partis, à l'aspect l'un de l'autre,
frémirent du crime qu'ils allaient commettre. La honte suspendit
les armes dans leurs mains; ils donnèrent un jour au respect
des lois et à l'amour de la patrie.
Sur le déclin de ce jour, César, pour tromper l'ennemi et
lui dérober ses travaux, range en avant ses deux premières
lignes et emploie l'autre à creuser à la hâte un fossé autour de
son camp.
Aux premiers rayons du soleil il commande que l'on se porte
en courant sur une hauteur qui sépare la ville du camp de Pompée.
Au même instant l'ennemi que persuadent la honte et la
crainte s'en empare et s'y établit avant lui. Ce poste est disputé
le fer à la main. La valeur le promet aux uns, l'avantage du lieu
l'assure aux autres. Les soldats chargés de leurs armes gravissent
les rochers; on les voit prêts à tomber en arrière, se
soutenir et se pousser l'un l'autre à l'aide de leurs boucliers.
Loin de pouvoir lancer le javelot, chacun d'eux s'en fait un
appui pour affermir ses pas chancelants; ils saisissent de l'autre
main les pointes du roc, les racines des arbres, et ne se servent
de leur épée que pour se frayer un chemin. César qui les voit
sur le point d'être précipités fait avancer sa cavalerie qui, tournant à gauche, protège leur flanc IIs se retirent ainsi sans que
l'on ose les poursuivre. Le vainqueur se voit avec dépit dérober
sa victoire.
Jusque-là on n'avait eu à courir que le danger des armes;
mais dès lors ce fut la guerre des éléments qu'on eut à soutenir.
L'aride souffle des Aquilons tenait suspendues dans l'air condensé
les froides vapeurs de la terre. Les montagnes étaient
chargées de neige, les plaines brûlées par les frimats, et dans
toutes les régions du couchant l'on voyait la terre endurcie par
la sécheresse d'un long hiver.
Mais lorsque le soleil, de retour dans le Bélier, eut égalé le
jour et la nuit, et que le jour eut repris l'avantage, à peine
Diane traçait dans le ciel le premier trait de son croissant,
qu'elle imposa silence à Borée, et le vent de l'Aurore échauffa
les airs. Ce vent chasse vers l'Occident tous les nuages de ses
climats, et les vapeurs que l'Arabie exhale et celles qui s'élèvent
du Gange, et celles qu'attire le soleil naissant et qui défendent
l'Indien des traits brûlants de sa lumière; enfin tout ce
que les vents ont amassé sur les bords où le jour se lève, se
précipite et s'accumule vers les régions du couchant. Là, comme le ciel se joint à l'Océan, les nuages, arrêtés parles
bornes, du monde, se roulent sur eux-mêmes en épais tourbillons
; l'étroit espace qui sépare le ciel de la terre et qu'occupe
un air ténébreux, contient à peine ce monceau de nues. Affaissées
par le poids du ciel, elles s'épaississent en pluie et se
répandent à longs flots. Les foudres qu'elles lancent à coups
redoublés sont éteintes aussitôt qu'allumées; l'arc coloré qui
embrasse les airs et dont une pâle clarté distingue à peine les
faibles nuances, boit l'Océan, grossit les nuages des flots qu'il
pompe et qu'il élève, et rend au ciel cette mer flottante qui s'en
épanche incessamment. Des neiges que n'avait jamais pu fondre
le soleil, coulent du haut des Pyrénées, les rochers de glace
sont amollis; et alors les sources des fleuves n'ont plus où s'épancher,
tant leur lit se trouve rempli des eaux qui tombent des
deux rives. Le camp de César est inondé; le flot bat et soulève
les tentes. Le retranchement est changé en un lac, on ne sait
plus où ravir les troupeaux; les sillons noyés ne produisent
aucun herbage. Le laboureur répandu dans les campagnes désolées,
s'égare, et ne reconnaît plus les chemins cachés sous
les eaux. Compagne inséparable des grandes calamités, l'horrible famine
approche : le soldat, sans être assiégé, manque de tout : heureux
d'acheter un peu de pain au prix de tout ce qu'il possède!
0 rage insatiable du gain! l'or trouve encore parmi ces affamés,
des vendeurs.
Déjà les collines, les hauteurs se cachent sous les eaux, déjà
les fleuves confondus ne forment plus qu'un immense abîme.
Les rochers y sont engloutis; les bêtes féroces chassées de leurs
antres, nagent en vain : elles sont submergées avec les cavernes
qui leur servaient d'asile. Les torrents enlèvent et roulent avec
eux les chevaux encore frémissants. L'impétuosité des eaux de
la terre repousse celles de l'Océan. La nuit qui couvre ces contrées,
ne laisse pas paraître les rayons du soleil, et les ténèbres
dont le ciel est couvert, font un chaos de la nature entière.
Telle cette partie du monde qu'accable un climat neigeux et
d'éternels hivers. Point d'astres dans son ciel, aucune production
sous cette zone glacée. Ses rigueurs tempèrent les feux de
la zone moyenne.
Dieu de l'Olympe, père du monde, et toi, dieu qui portes le
trident, achevez! Que les nuages du ciel et les vagues de l'Océan
s'unissent; que ces torrents, au lieu de s'écouler soient refoulés par les mers; que la terre ébranlée ouvre aux fleuves une route
nouvelle; que le Rhône, que le Rhin viennent inonder les plaines
de l'Èbre; que les fleuves détournent leurs ondes; versez ici
les neiges de la Thrace, les étangs, les lacs, tous les marais de
l'univers, et puissent-ils délivrer la terre des malheurs de la
guerre civile.
Mais ce fut assez pour la Fortune d'avoir causé à César quelques
moments d'effroi : elle revint plus complaisante encore,
et les dieux, comme pour s'excuser, redoublèrent pour lui de
faveur.
Le ciel s'épure et s'éclaircit ; le soleil, vainqueur des nuages,
les dissipe dans l'air en légers flocons; les éléments ont repris
leur place, et les eaux longtemps suspendues sont retombées
dans leur lit. Les forêts relèvent leur cime touffue; le sommet
des collines perce au-dessus des eaux, et le soleil, rendu à la
terre, en durcit la surface.
Dès que le Sicoris a découvert les champs et repris ses bords,
des barques faites de saules blanchissants et revêtues de la
dépouille des taureaux; traversent le fleuve docile tout enflé qu'il
est. Ainsi le Vénète passe le Pô débordé, et le Breton l'Océan.
Ainsi, lorsque le Nil couvre les plajncs de l'Egypte, l'humide papyrus porte l'habitant de Memphis. Les soldats de César vont
au delà du fleuve abattre des forêts pour élever un pont. Mais
dans la crainte d'un nouveau débordement. César ne veut pas
que le pont se termine aux deux rives. Il le prolonge au loin
dans la campagne, et ouvrant au fleuve divers canaux, il l'affaiblit
en le divisant, comme pour le punir d'avoir enflé ses eaux.
Pétréius, qui voit que tout réussit au gré de l'ennemi, et que
lui-même n'a rien à attendre des habitants de ces contrées,
abandonne les hauteurs d'Hilerda, et va chercher au fond de
l'Occident, des nations féroces qui ne respirent que la guerre.
Dès que César s'est aperçu que la colline est abandonnée et
le camp désert, il fait courir aux armes, et sans aller chercher
ni le pont, ni un gué facile, il commande qu'on passe à la nage;
et cette route que le soldat n'eût osé prendre dans sa fuite, il
la suit pour voler aux combats. Puis ils réchauffent, en le couvrant
de leurs armes, leur corps humide, et se délassent de
cette course glacée, jusqu'à ce que l'ombre décroissante laisse
reparaître le jour naissant. Déjà la cavalerie atteint l'arrière-garde,
incertaine entre la fuite et le combat. Deux collines
pierreuses s'élèvent au sein d'une profonde vallée : plus loin
se prolongé une chaîne escarpée dont les détours cachent des
routes inattaquables. Que l'ennemi s'en empare, la guerre va s'engager dans une contrée impraticable. César le voit : « Courez
sans ordre, dit-il aux siens, arrêtez la victoire qui nous
échappe; précédez l'ennemi dans sa fuite; présentez-lui un
front menaçant ; qu'il soit forcé de voir la mort en face et de
périr par d'honorables coups. » Il dit, et devance l'ennemi que
les montagnes vont lui dérober.
Les deux armées campent en présence, seulement séparées
par un étroit retranchement. Dès qu'elles se virent de près et
que de l'un à l'autre camp pères, frères, enfants purent se
reconnaître, ils sentirent le crime de la guerre civile. D'abord,
la crainte leur imposa silence, et chacun d'eux ne salua les
siens que d'un signe de tête ou d'un mouvement de l'épée. Mais
bientôt leur amour devenu plus pressant leur fait oublier la
discipline; ils osent franchir le fossé, et courent s'embrasser.
L'un prononce le nom de son hôte; celui-ci, d'un parent. Il
n'était pas Romain celui qui ne reconnaissait pas un ennemi.
Ils se rappellent leur enfance, leurs liaisons, leur ancienne amitié;
leurs armes sont baignées de pleurs; des sanglots interrompent leurs embrassements, et quoique leurs mains n'aient
pas encore trempé dans le sang, ils se reprochent avec effroi
celui qu'ils auraient pu répandre.
Insensés! pourquoi frapper vos poitrines? pourquoi gémir et
répandre d'inutiles pleurs? pourquoi jurer qu'on vous fait violence,
et que vous ne servez le crime qu'à regret? Est-ce à vous
de craindre celui que vous seuls rendez redoutable? Que ses
trompettes donnent le signal; fermez l'oreille à ces sons funestes.
Qu'il déploie ses étendards; ne bougez pas: vous allez
voir la furie des guerres civiles tomber d'elle-même, et César:
simple citoyen redevenir l'ami de Pompée. 0 toi, qui embrasses
l'univers et l'enchaînes de tes liens : toi, le salut et l'amour du
monde, viens à nous, Concorde éternelle : voici le moment qui
décide du sort des siècles à venir : le crime est dévoilé : ce
peuple coupable n'a plus d'excusé: chacun a reconnu ses frères.
Voeux.impuissants! destins inexorables! une courte trêve redouble
nos maux.
La paix régnait dans les deux camps ; ils étaient confondus ensemble,
les soldats se livrant à la joie, avaient élevé des tables
de gazon, et faisaient des libations de vin. Assis autour des
mêmes foyers, ou couchés sous les mêmes tentes, ils dérobaient cette nuit au sommeil, et la passaient à se raconter leurs marches
et leurs premiers exploits. C'est au milieu de ces récits
guerriers, dans l'instant même que ces malheureux se donnent
une foi mutuelle, et se jurent une amitié qui va rendre leurs
crimes désormais plus horribles; c'est là que le sort les attend.
Pétréius instruit que la paix est jurée, qu'il est trahi et livré à
César, réveille ceux qui lui sont dévoués; et suivi de cette
odieuse escorte, il accourt et chasse de son camp les soldats de
César qu'il trouve désarmés. Il tranche lui-même à coups d'épée
les noeuds de leurs embrassements; la fureur lui inspire ce
belliqueux langage :
« Soldat infidèle à la patrie, et déserteur de ses drapeaux,
si le sénat ne peut obtenir de vous d'attendre que César soit
vaincu, attendez du moins qu'il soit vainqueur. Il vous reste
une épée et du sang dans les veines, le sort de la guerre est encore
incertain, et vous irez tomber aux pieds d'un maître! et
vous irez porter ses étendards condamnés! Il faudra supplier
César de daigner vous accepter pour esclaves ! Ne lui demanderez-vous pas aussi la grâce de vos chefs? Non, jamais notre
vie ne sera le prix d'une lâche trahison. Ce n'est pas de nos
jours qu'il s'agit, et que doit décider la guerre civile. Votre paix n'est qu'une trahison. Ce ne serait pas la peine d'arracher
le fer des entrailles de la terre, d'élever des remparts, d'aguerrir
des coursiers, d'armer et de lancer des flottes qui couvrent
l'Océan, si l'on pouvait sans honte acheter la paix au prix de la
liberté. Un coupable serment suffit pour attacher vos ennemis
au parti du crime et vous, parce que votre cause est juste, une
foi qui vous lie est plus vile à vos yeux! Mais, direz-vous, on
nous permet d'espérer notre pardon. 0 ruine entière de la pudeur!
ô Pompée! dans ce moment même, hélas! ignorant ton
malheur, tu lèves des armées par toute la terre, tu fais avancer
des extrémités du monde les rois ligués pour ta défense, et l'on
traite ici de ta grâce! et peut-être on la promet! » Ces mots
ébranlent tous les esprits, et l'ardeur des forfaits se ranime.
Ainsi quand les bêtes féroces dans la prison qui les enferme,
oubliant les forêts, semblent s'être adoucies; qu'elles ont quitté
leur face menaçante, et appris à souffrir l'empire de l'homme
qu'un peu de sang par hasard touche leurs lèvres altérées; leur rage, leur fureur se réveille, leur gosier s'enfle avide du
sang qu'elles viennent de goûter; elles brûlent de s'assouvir,
et leur rage respecte à peine leur maître pâlissant. On court à tous les crimes. Tout ce qu'une rencontre subite, ménagée par
la haine des dieux, eût pu produire de plus atroce dans la nuit
d'une mêlée, fut commis au nom du devoir. Autour de ces tables
et sur ces mêmes lits où les soldats s'embrassaient, ils s'égorgent.
Ils gémissent d'abord de tirer l'épée; mais sitôt que cette
arme ennemie de toute justice est dans leur main, tout ce
qu'ils frappent leur est odieux; et leur courage chancelant
s'affermit dans le meurtre. Le camp est rempli de tumulte, les
crimes l'inondent; on tranche la tête à ses proches, et de peur
que le parricide ne reste perdu, on en fait trophée aux yeux
des chefs; on triomphe de son forfait. Pour toi, César, dans ce
carnage de ton armée, tu reconnais les dieux. Jamais la fortune
ne te sourit plus dans les plaines de Thessalie, ni sur la mer qui
baigne Marseille, ni sur les eaux de Pharos. Grâce à l'impiété
sacrilège de tes ennemis, ta cause est devenue la plus juste (1).
Les lieutenants de Pompée n'osent laisser dans un camp si
voisin de l'ennemi des cohortes souillées d'un crime odieux. Ils
prennent le parti de la fuite et regagnent les hauteurs d'Hilerda.
1 Par la mort des soldats et des officiers de son armée que Petreius fit massacrer dans son camp. Ce sont les Pompéiens qui les premiers ont rompu l'alliance entre les deux armées.
La cavalerie de César qui les environne leur interdit la plaine, et les cerne sur l'aride sommet des collines. Là, comme il sait qu'elles vont manquer d'eau, il entoure leur camp d'un fossé profond, dont il défend le bord escarpé, sans leur permettre de s'étendre jusqu'au fleuve, ni d'embrasser dans leur enceinte aucune des sources d'alentour. Aux approches de la mort qui les menace, leur crainte se change en fureur. D'abord ils tuent les chevaux, secours inutile dans un camp assiégé, ils renoncent même à la fuite; et, n'ayant plus d'espoir de s'échapper, ils courent se jeter eux-mêmes sur le fer de l'ennemi. Dès que César les voit se dévouer à un trépas inévitable : « Soldats, dit-il, retenez vos traits, détournez vos lances, évitez de verser le sang. Celui qui défie la mort, ne la reçoit guère sans la donner. Voici des guerriers désespérés, à qui la lumière est odieuse, et qui, prodigues de leur vie, ne veulent périr qu'à nos dépens. Ils ne sentiront pas les coups ; ils vont se précipiter sur vos glaives, et mourir contents, s'ils versent votre sang. Attendez que leur fureur s'apaise, que leur impétuosité se ralentisse,' et qu'ils aient perdu l'envie de mourir. (1)» Ce fut ainsi que César laissa ses ennemis s'épuiser en menaces, et leur refusa le combat jusqu'au moment où le soleil plongé dans l'onde céda le ciel aux astres de la nuit.
1 Le commentateur de Lemaire propose un sens un peu différent du nôtre. Perdant velle mori : « Que cette volonté qu'ils ont de mourir leur soit inutile, ne leur serve à rien. » Ce sens est fort plausible, mais l'autre paraît plus naturel et plus simple.
Les assiégés n'ayant plus le moyen de recevoir ni de donner la mort, leur première ardeur tombe peu à peu, et leurs esprits
s'amortissent.
Tel un combattant percé d'un coup mortel, n'en est que plus
impétueux, dans le moment que la blessure est vive et la douleur
aiguë, et que le sang qui bouillonne encore, donne à ses
nerfs plus de ressort; mais si son ennemi, après l'avoir frappé,
suspend ses coups, il le voit bientôt qui chancelle; un froid
mortel se répand dans ses veines, la force diminue, la langueur
lui succède, et sa colère et son courage s'épuisent avec son
sang.
, Déjà l'eau manquait dans le camp de Pompée. Outre la charrue
et les durs noyaux, le fer des armes fut employé à déchirer le
sein de la terre, dans l'espoir d'y trouver quelque source. On
creusa un puits dont la profondeur s'étendait du haut de la colline
au niveau de la plaine. Le pâle chercheur d'or des mines
d'Asturies (1) ne pénètre pas si avant, ni si loin de la clarté des
cieux. Cependant on n'entendit point le bruit des fleuves souterrains
; on ne vit point de source jaillir des roches qu'on avait
percées, ni une goutte de rosée distiller des parois de l'abîme,
ni des filets d'eau circuler à travers les lits de gravier.
1 L'Espagne ancienne était célèbre pour ses mines d'or.
On retire enfin de ces cavernes profondes une jeunesse toute couverte de sueur, qui vient de s'épuiser en vain à briser des rochers que les métaux durcissent. La pénible recherche des eaux leur a rendu plus intolérable l'aridité de l'air qu'ils respirent. Ils n'osent pas même employer le secours des aliments pour réparer leurs forces défaillantes. Ils fuient les tables : pour eux la faim est un soulagement. S'ils aperçoivent quelque humidité sur la terre amollie, ils arrachent à deux mains la glèbe, et ils la pressent sur leurs lèvres desséchées. S'ils trouvent une eau croupissante et couverte d'un noir limon, toute l'armée s'y précipite et se dispute ce breuvage impur. Le soldat expirant boit des eaux dont il n'eût pas voulu pour prolonger sa vie. Ils épuisent la mamelle des troupeaux, et au lieu de lait, ils en tirent du sang. Ils broient les plantes et les feuilles des arbres; et pressant la moelle des bois encore verts, ils en expriment le suc. Heureuses les armées détruites pour avoir bu des eaux qu'un ennemi barbare empoisonnait en s'éloignant ! 0 César, tu peux sans mystère mêler aux fleuves d'alentour ce qu'il y a de plus immonde, de plus infect dans la nature, les plantes même les plus vénéneuses que l'on recueille sur le Dicté; cette jeunesse, sûre d'en mourir, va s'en abreuver. La flamme dévore leurs entrailles; leur langue aride et raboteuse se durcit dans leur bouche embrasée; leurs veines sont taries; leur poumon qu'aucune liqueur n'arrose, laisse à peine un étroit passage au flux et au reflux de l'air; leur haleine brûlante déchire leur palais que la sécheresse a fendu. Leur bouche haletante, dans l'ardeur de la soif, aspire avidement les vapeurs de la nuit. Ils rappellent ces pluies abondantes dont ils ont vu naguère la campagne inondée, et leurs yeux restent sans cesse attachés aux nuages arides. Ce qui redouble leur supplice, c'est de se voir, non sous le ciel brûlant de Méroé (1) ou du Cancer, dans les champs que laboure le Garamante au corps nu (2), mais entre l'impétueux Ibère et le tranquille Sicoris ; de voir couler ces fleuves sous leurs yeux, et de périr de soif à leur vue.
1 Méroé est une île du Nil.
2 Les Garamantes sont un peuple d'Afrique, dans le voisinage de Cyrènes, et qui touche à l'Ethiopie ; il tire son nom de Garamas, fils d'Apollon. Le poête les représente comme nus à cause de la chaleur.
Les chefs cèdent enfin à la nécessité : Afranius, détestant la
guerre, se résout à demander la paix. Il s'avance lui-même en
suppliant, traînant aux pieds de César ses cohortes mourantes.
Il parait devant le vainqueur, mais avec une majesté que le
malheur n'a point abattue. Son maintien rappelle sa première
fortune et son désastre présent. On reconnaît en lui un vaincu,
mais un chef, et il demande grâce avec un visage intrépide.
« Si le sort, dit-il, m'eût fait succomber sous un ennemi sans
vertu, ma mort eût prévenu ma honte, et cette main m'eût délivré. Nous venons, César, te demander la vie, parce que nous
te croyons digne de nous l'accorder. Ce n'est ni l'esprit de faction
ni la haine qui nous a mis les armes à la main. La guerre
civile nous a trouvés à la tête de ces légions ; nous lui sommes
restés fidèles tant que nous l'avons pu. C'en est fait, nous ne
retardons plus tes destins, nous t'abandonnons les bords du
Couchant, nous te laissons le chemin de l'Orient, nous te délivrons
du danger d'avoir derrière toi tout l'univers armé. Cette
guerre ne t'a pas coûté beaucoup de sang ni de fatigues. Pardonne
à tes ennemis ta victoire, leur seul crime. Nous demandons
peu de chose : nous sommes épuisés, donne-nous le repos.
Laisse-nous passer loin de la guerre la vie que tu nous accordes.
Suppose nos légions détruites et couchées dans la poussière.
Il ne serait pas digne de toi d'associer nos armes avec les
tiennes, et de partager ton triomphe avec de malheureux captifs.
Nous avons rempli nos destins ; pour toute grâce, n'oblige
pas les vaincus à vaincre avec toi. »
Il dit; César qui l'écoutait avec un visage serein, fut généreux
et facile à fléchir. Il fit grâce à ses ennemis, et les dispensa
de la guerre. Dès que la paix est acceptée, les soldats
accourent aux fleuves ouverts maintenant devant eux; ils se
couchent sur le rivage, et troublent ces eaux dont ils peuvent enfin s'abreuver. Il en est qui s'étouffent par trop d'avidité,
sans pouvoir éteindre la soif qui les dévore. Le feu qui les consume
ne cède pas encore: il épuiserait, pour s'éteindre, le
fleuve entier. Peu à peu les forces leur reviennent, l'armée se
ranime.
0 prodigue débauche ! ô faste insensé de l'opulence ! désir
ambitieux des mets les plus rares ! vaine gloire des somptueux
festins ! venez apprendre avec quoi l'homme soutient et prolonge
sa vie, à quoi la nature a réduit ses besoins. Pour ranimer
ces malheureux, il n'a pas fallu un vin fameux recueilli
sous un consul inconnu et versé dans l'or ou dans la myrrhe.
Ils puisent la vie au sein d'une onde pure. Hélas ! telle est la
condition de tous les peuples qui font la guerre : un fleuve et
Cérès, c'est assez pour eux.
Dès ce moment le soldat pose les armes et les abandonne au
vainqueur. Il est sans crainte dès qu'il est sans défense. Exempt
de crime et libre de soins, il va se répandre dans les villes d'où
la guerre l'avait tiré. Oh! qu'en jouissant des douceurs de la
paix, il se repentit d'avoir lancé le javelot, souffert la soif, et
demandé aux dieux de coupables succès! Ceux même que la victoire seconde, ont encore tant de dangers, tant de travaux à
soutenir, avant de fixer la fortune inconstante; ils ont tant de
sang à répandre (1) dans toute la terre, et César à suivre à travers
tant de hasards.
Heureux celui qui voyant le monde sur le penchant de sa
ruine, sait en quel lieu passer une tranquille nuit! il se délasse
et dort en sûreté, sans craindre que le son de la trompette
interrompe son sommeil. Il rêve à sa femme, à ses enfants, à
son foyer rustique, à ses champs qui ne sont pas la proie des
étrangers.
Un autre avantage de leur retraite, c'est de ne plus tenir à
aucun parti dont l'intérêt les agite. Pompée les a défendus, César
les a sauvés : ainsi dégagés, ils sont tranquilles spectateurs de
la guerre civile.
Cependant la fortune ne fut pas la même partout, elle osa se
déclarer un moment contre César aux lieux où la mer Adriatique
bat les murs de Salone, où le tiède Iader coule au-devant
des zéphyrs.
1 Il restait encore à César la guerre de Macédoine, celle d'Alexandrie ou d'Egypte, celle d'Afrique, et la seconde guerre d'Espagne contre les fils de Pompée.
Antoine, comptant sur la foi des belliqueux Curètes, avait choisi leur plage pour y établir son camp : inaccessible aux dangers de la guerre, s'il avait pu en écarter la faim, contre laquelle il n'est point de rempart. Cette île ne produisait ni pâturages, ni moissons; et les soldats réduits à brouter l'herbe, après en avoir dépouillé la campagne, n'avaient plus pour nourriture que les gazons secs du retranchement, lorsqu'ils aperçurent sur le rivage opposé un corps de troupes que Bazilus amenait à leur secours. Antoine (1) inventa pour fuir un nouveau moyen de traverser les eaux. Au lieu de vaisseaux construits selon l'usage, à la haute poupe, à la carène allongée, il établit sur deux files de tonnes vides, liées ensemble par de longues chaînes, une vaste rangée de poutres. Le rameur n'y est point exposé aux traits de l'ennemi : à couvert, dans les intervalles des bois qui forment ce pont flottant, ils ne sillonnent que les eaux enfermées au milieu des barques, et donnent ainsi le merveilleux spectacle d'une machine qui vogue sans voiles, et sans secours extérieur.
1 C'est C. Anlonius, et non M. Antonius, qui se trouvait alors à Brindes, attendant le moment de faire passer en Macédoine les légions de César.
On
observa le flux et le reflux, et dans l'instant que la mer se
reployant sur elle-même, abandonnait le rivage, on lança ce
navire immense avec deux galères pour l'accompagner. Ces
vaisseaux s'avancent, et au milieu s'élève une forteresse mouvante,
dont le sommet couronné de créneaux se balance sur les
flots. Octave qui gardait ce passage, ne voulut pas attaquer d'abord;
il retint l'ardeur de sa flotte, et il attendit que sa proie,
attirée par l'espoir d'un trajet facile, vînt se livrer tout entière
à lui. Le calme trompeur qui régnait sur la mer invitait ses
ennemis à s'engager dans leur folle entreprise.
Ainsi tant que le chasseur n'a pas enfermé le cerf qu'épouvante
la plume odorante (1), tant qu'il ne l'a pas investi de ses
filets, il impose silence à ses légers molosses, et les relient
muets à la chaîne.
1 On faisait brûler ces plumes, et leur odeur faisait fuir les cerfs. Voyez, sur cet appareil, Gratius, poème de la Chasse, v. 7 5 et suiv.; Sénèque le Tragique, Hippolyte, v. 46. Voyez encore Pline, Hist. Nat., liv. XXI, ch. xxxix.
Aucun d'eux ne court à la forêt, si ce n'est
celui qui, le museau baissé, démêle et reconnaît la trace, qui
sait se taire en découvrant la proie, et n'indiquer le lieu où elle
repose que par un léger tremblement. On s'entasse en toute
hâte sur ces lourdes machines. On fuit la terre sur ces radeaux
en bois, à l'heure où les dernières lueurs du jour combattent
contre la nuit croissante.
Un Cilicien de la flotte d'Octave mit en usage un vieil artifice
des pirates de son pays, pour tendre à l'ennemi des pièges
sous les eaux. Il laisse la surface libre, mais au-dessous il tient
suspendues des chaînes lâches, dont les deux bouts sont attachés
au rivage. Ni le premier, ni le second navire ne s'y arrête ; mais le troisième est retenu au passage, et les chaînes se reployant,
l'attirent parmi les écueils.
Près de là une voûte de rochers suspendus et menaçants couvre
la mer, ô merveille,! d'une forêt sombre. C'est dans ces
antres ténébreux que la vague ensevelit souvent les débris des
vaisseaux brisés par l'aquilon, et les corps de ceux qui ont péri
sur les eaux. La mer repoussée par les rochers, les laisse à découvert;
et lorsque ces cavernes profondes vomissent les eaux
mugissantes, les tourbillons d'écume qui s'élancent des gouffres
de Charybde n'ont rien de plus effrayant. C'est vers l'entrée de
ce gouffre que fut attiré le navire qui portait les Opitergiens, et
dans l'instant il est environné d'un côté par les vaisseaux qui se
détachent du rivage, de l'autre par une multitude de combattants,
dont le rochers et les bords sont couverts.
Vulteius qui commandait ce navire, s'aperçut des pièges
qu'on lui avait tendus. Mais ayant tenté vainement de rompre
les chaînes à coups de hache, il se résolut au combat, sans aucun
espoir de salut, sans savoir même de quel côté il ferait face
à l'ennemi. Cependant tout ce que peut la valeur assiégée et
environnée de périls, fut exécuté dans ce moment terrible. Un
seul navire avec une cohorte, investi d'un nombre infini de
vaisseaux et de combattants, se défendit et soutint leur attaque.
Le choc, il est vrai, ne fut pas long ; la faible lumière qui l'éclairait fit place aux ombres de la nuit; la paix régna dans
les ténèbres.
La troupe consternée aux approches d'une mort inévitable,
s'abandonnait au désespoir, quand Vulteius d'une voix magnanime
relève en ces mots les esprits : « Romains, nous n'avons
plus pour être libres que le court espace d'une nuit : emplovez
donc ce peu d'instants à voir, dans cette extrémité, quel est le
parti à prendre. La vie n'est jamais trop courte quand il en
reste assez pour choisir sa mort. Et ne croyez pas qu'il y ait
moins de gloire à prévenir la mort, quand on la voit de près;
nul homme, en abrégeant ses jours, ne sait le temps qu'il eût
pu vivre. Il faut le même courage pour renoncer à des moments
ou à des années : l'honneur consiste à disposer de soi et à
prévenir ses destins. On n'est jamais forcé à vouloir mourir.
La fuite nous est interdite; nous sommes environnés d'ennemis
prêts à nous égorger. Décidons-nous; loin d'ici la crainte;
cédons à la nécessité, en hommes libres, non en esclaves. Ce
n'est pourtant pas dans l'obscurité qu'il faut périr; et comme
des troupes qui dans les ténèbres s'accablent de traits lancés au
hasard. Sur un champ de bataille et dans un tas de morts, le
plus beau trépas se perd dans la foule, la vertu y reste ensevelie
et sans honneur, il n'en sera pas ainsi de la nôtre. Les dieux ont voulu l'exposer sur ce théâtre aux yeux de nos amis et de
nos ennemis. Ce rivage, cette mer, les rochers de l'île que nous
avons quittée seront couverts de spectateurs. De l'un et de
l'autre rivage, les deux partis vont nous contempler. 0 Fortune!
tu te prépares à faire de nous je ne sais quel exemple
grand et mémorable. Tout ce que la fidélité, le dévouement des
troupes a laissé de monuments illustres dans tous les siècles,
cette brave jeunesse va l'effacer. Oui, César, c'est faire peu
pour toi, nous le savons, que de nous immoler nous-mêmes;
mais assiégés comme nous le sommes, nous n'avons pas de plus
grand témoignage à te donner de notre amour. Le sort envieux
a sans doute beaucoup retranché de notre gloire en ne permettant
pas que nos vieillards et nos enfants se soient trouvés pris
avec nous, mais que l'ennemi sache du moins qu'il est des
hommes qu'on ne peut dompter; qu'il apprenne à craindre des
furieux résolus et prompts à mourir; qu'il bénisse le ciel de
n'en avoir retenu dans ses pièges qu'un petit nombre. Il essayera
de nous tenter en parlant de paix et d'accord; il tâchera
de nous corrompre par l'offre d'une vie honteuse. Ah! plût aux
dieux qu'il nous fit grâce, et que le salut nous fût assuré ! notre
mort en serait bien plus belle, et en nous voyant déchirer
nous-mêmes nos entrailles, on ne croirait pas que ce fût la ressource du désespoir. Il faut, amis, il faut mériter par un
courage sans exemple, que César, entre tant de milliers d'hommes qui lui restent, regarde la perte de ce.petit nombre
comme un désastre pour lui. Oui, quand le sort m'offrirait le
moyen de m'échapper, je refuserais. Romains, j'ai rejeté la
vie. Mon coeur n'est plus aiguillonné que du désir d'un beau
trépas. Ce désir va jusqu'à la fureur. Il n'y a que ceux qui
touchent à leur terme, qui sentent combien il est doux de mourir.
Les dieux le cachent à ceux qu'ils condamnent à vivre,
afin qu'ils se résignent à vivre. »
Ce fut ainsi que l'ardeur du héros releva l'âme de ses soldats,
et ces mêmes hommes qui avant de l'entendre, mesuraient
d'un oeil mouillé de larmes le cours de l'Ourse, désirèrent ce
jour terrible.
La nuit alors n'était pas lente à se cacher dans l'Océan : le
soleil allait sortir du signe brillant des enfants de Leda, il s'approchait
du Cancer, et il voyait en se levant les flèches du
Centaure (1) se plonger dans l'onde. La lumière du jour découvrit
les Istriens sur le rivage, et sur la mer la flotte des Grecs,
jointe aux Liburniens belliqueux.
1 Chiron, c'est-à-dire le Sagittaire.
D'abord on suspendit l'attaque,
pour voir si Vulteius et les siens se laisseraient désarmer, et si, en retardant leur mort, on leur ferait aimer la vie. Mais
cette jeunesse héroïque se tînt ferme en son dévouement, fière
d'avoir renoncé au jour, et sûre de sortir du combat avec gloire,
en s'immolant de ses propres mains. Rien ne peut plus ébranler
ces âmes déterminées au suprême effort. Une poignée d'hommes
soutient les assauts d'une multitude répandue sur la mer et sur
le rivage : tant on est fort quand on sait mourir !
Enfin las de verser du sang et croyant avoir assez vendu leur
vie, ils abandonnent l'ennemi, et leur fureur se tourne contre
eux-mêmes. Vulteius, le premier, se découvrant le sein et tendant la gorge au coup mortel : « Qui de vous, amis, leur dit-il,
est digne de plonger sa main dans mon sang et de prouver par;
là qu'il veut mourir? » Il n'eut pas besoin d'en dire davantage;
cent glaives lui percent le sein. Il loue tous ceux qui le frappent,
mais à celui qui a donné l'exemple, il prête à son tour
sa main reconnaissante et le tue avant d'expirer. Tout le reste
s'égorge à l'envi, et dans un seul parti, s'exercent toutes les
fureurs de la guerre. Ainsi s'égorgeaient devant Thèbes cette
foule d'hommes armés que vit naître Cadmus, des dents terribles
qu'il avait semées,présage fatal pour les fils d'OEdipe. Ainsi
périrent au bord du Phase, ces enfants de la dent vigilante du dragon, que Médée, par des enchantements nouveaux, dont elle-même
pâlit d'effroi, força de s'immoler entre eux et d'engraisser
de leur sang les sillons qui venaient de les engendrer. Tel
fut le massacre de cette jeunesse intrépide qui a juré de périr.
Il ne leur coûte rien de mourir. En recevant le trépas, ils le
donnent. Aucun des glaives ne frappe en vain quoique poussé
d'une main défaillante. Ce n'est pas le fer qui s'enfonce, c'est
le sein qui frappe le fer, c'est la gorge qui va au-devant de
l'épée et qui la force de s'y plonger. Quoique le frère le présente
à son frère, le père à son fils, dans ce carnage affreux,
leurs coups n'en sont pas moins assurés ; tout ce qu'ils donnent
à la tendresse c'est de ne pas les redoubler. On les voit traîner
leurs entrailles déchirées sur le navire et rougir la mer de leur
sang. Ils regardent avec mépris la lumière qui leur échappe;
ils tournent contre l'ennemi un front superbe, et ils s'applaudissent
de sentir la mort. Le navire n'est bientôt plus qu'un monceau
de cadavres que les vainqueurs honorent du bûcher; saisis
d'étonnement de voir que la nature ait produit un homme capable
d'inspirer une semblable résolution.
Jamais la Renommée n'a rien publié dans l'univers avec tant d'éclat et de gloire ; mais les nations, même après cet exemple,
sont trop timides pour concevoir combien il est aisé de s'affranchir
de l'esclavage. On craint le glaive dans là main des
tyrans : la liberté tremble sous les armes qui l'oppriment.
L'homme ne sait pas que le fer ne lui a été donné que pour se
sauver de la servitude. O mort! que n'es-tu refusée aux lâches!
Que n'es-tu réservée à la vertu !
La guerre n'était pas moins vive aux champs de la Libye.
L'audacieux Curion avait mouillé au rivage de Lilibée (1), et de là,
secondé par l'Aquilon, il avait passé en Afrique et abordé entre
Clupée et les ruines de Carthage (2), lieu que nos armes ont rendu
fameux.
1 Lilybée était un promontoire de Sicile en face de l'Afrique, comme le cap Pélore est en face de l'Italie, et celui de Pachinum en face de la Grèce.
2 Carthage, à cette époque, n'était plus qu'à moitié ruinée. Les Romains l'avaient un peu relevée depuis la troisième guerre punique. « Aklybée (en langue du pays Aklybia), autrefois Clupea, appartient aujourd'hui au royaume de Tunis. C'était un bon port. Les Romains s'y fortifièrent lors de la première guerre punique, et en firent une place d'armes. » Lepernay, Pharsale.
Il va d'abord camper loin de la mer écumante, sur la rive du Bagrada, qui traverse lentement des sables arides. Bientôt il gagne des hauteurs, et les rochers rongés de toutes parts, que l'antiquité, digne de foi, dit avoir été le royaume d'Antée. Voici ce qu'un rustique habitant du pays en avait appris de ses pères et lui raconta : « La terre ayant enfanté les géants n'était pas épuisée. Elle conçut dans les antres de Libye le formidable Antée. Elle en eut plus d'orgueil que d'avoir produit Typhon, Tityes, ou le farouche Briarée, et il fut heureux pour le ciel qu'il ne fût pas né dans les champs de Phlégra (1). Pour surcroît à ses forces immenses, dès que son corps touchait la terre, il prenait une nouvelle vigueur. Il avait cet antre pour demeure, une roche élevée lui servait de toit. Les lions pris à la chasse étaient sa pâture; il se couchait non sur la dépouille des bêtes fauves, ni sur les débris des forêts, mais sur le sein nu de sa mère.
1 Ville de Macédoine; il y avait aussi une ville du même nom dans la Campanie, près de Puteoli, Pouzzoles
C'est là qu'il
se fortifiait. D'abord tout périt sous ses coups, et les habitants
des campagnes de l'Afrique et les étrangers que les flots jetaient
sur ce bord. Longtemps même la valeur du géant dédaigna le
secours de la Terre. Quoique debout, il était invincible. Enfin
le bruit de ses fureurs attire en Libye le magnanime Alcide,
Alcide qui purgeait de monstres la terre et la mer. Le héros
dépouille la peau du lion de Némée; le géant celle d'un lion de
Libye. L'un, selon l'usage des jeux olympiques, arrose d'huile
ses membres nerveux ; l'autre, ne se croyant pas assez fort, s'il
ne touchait que du pied sa mère, se couvre d'un sable brûlant
et secourable. Leurs bras et leurs mains s'entrelacent de mille
noeuds. Longtemps leurs pesantes mains attaquent vainement
leurs robustes cous. Leur tète reste inébranlable, leur front superbe n'est point incliné. Chacun d'eux s'étonne de trouver son égal. Alcide en ménageant ses forces au début de la lutte épuise
celles du géant. Il le voit hors d'haleine et couvert d'une sueur
glacée : il lui secoue la tête, il presse sa poitrine contre la sienne
et frappe de coups obliques ses jambes mal assurées.
Déjà se croyant vainqueur, il enveloppe ses reins qui fléchissent,
étreint ses flancs, et du pied forçant ses jambes à s'écarter, il
le jette étendu sur le sol. La Terre altérée boit la sueur de son
fils; et il sent ses veines se remplir d'un sang qui le vivifie. Ses
muscles se tendent, ses nerfs se roidissent, son corps renouvelé
se dégage des noeuds dont l'enveloppe Alcide. Alcide est interdit
de voir qu'il ait repris tant de vigueur. Jadis, dans sa
jeunesse, aux marais d'Argos, l'hydre et ses têtes menaçantes
l'avaient beaucoup moins étonné. Ils luttent, l'un avec ses forces,
l'autre avec celles de la Terre, et le combat est douteux. Jamais
la cruelle marâtre ne conçut de plus justes espérances.
Elle voit la sueur inonder ce corps infatigable, et ce dos qui,
sans fléchir, a soutenu le poids du ciel. Dès que le fils de Jupiter
veut de nouveau serrer Antée entre ses bras, celui ci se laisse
tomber de lui-même et se relève plus vigoureux : tout ce que la
Terre a de vie et de force passe dans le corps de son fils. Elle se lasse à lutter contre un homme. Alcide enfin s'étant aperçu
du secours qu'Antée puisait dans la Terre : Debout, lui dit-il;
tu ne toucheras plus le sol et je t'empêcherai bien de t'étendre
à terre. Tu périras écrasé contre mon sein. C'est là que tu vas
tomber. A ces mots, il enlève le géant dont les pieds s'attachent
au sol ; la Terre séparée de son fils ne peut lui redonner la vie.
Alcide le tient par le milieu du corps, et quoiqu'il le sentit
glacé, il fut longtemps sans oser le rendre à sa mère.
« L'antiquité, admiratrice d'elle-même et gardienne du passé,
a tiré de là le nom qui reste à ces montagnes. Mais la gloire de
Scipion les rendit encore plus célèbres lorsqu'il força les Africains
à quitter les citadelles italiennes et à repasser les mers.
Ce fut là d'abord qu'il établit son camp, et ce fut aussi le premier
théâtre de nos victoires en Afrique. Voici les restes du
retranchement. Ici fut la première conquête des Romains. »
Curion flatté de ce présage, comme si le bonheur de nos
armes était attaché à ce lieu, et comme si la fortune de Scipion
l'y attendait lui-même fait dresser dans ce poste heureux un
camp qui ne devait pas l'être. Il donne quelque trêve à ses
troupes, et avec des forces trop inégales, il ose défier un superbe
ennemi. Toute la puissance de Rome en Afrique était alors dans les
mains de Varus. Celui-ci, bien qu'il se confiât en ce qu'il
avait de milice romaine, ne laissa pas d'appeler à lui toutes
les forces du roi ; de Libye et des extrémités du monde, tous
les peuples soumis à Juba s'avançaient sous les drapeaux de
leur roi. Jamais prince ne posséda un plus vaste empire.
Dans sa.plus grande longueur, il a pour bornes à l'occident
l'Atlas, voisin de Gadès (1), au midi, Ammon, voisin des Syrtes.
1 Il faut remarquer que l'auteur
prend ses points cardinaux dans le royaume dont il fait la description.
La Mauritanie, soumise à Juba, fut partagée, l'an 42 avant Jésus-
Christ, en deux royaumes : la Mauritanie Césarienne, bornée à l'est
par le fleuve Ampsagus, à l'ouest par le fleuve Mulucha; villes : Igigilis et
Césarée; et la Mauritanie Tingitane, depuis le fleuve Mulucha
jusqu'à la mer Atlantique; capitale Tingis.
Le petit Atlas est sur la côte d'Afrique, en face de Cadix, dont il
est séparé par le détroit de Gibraltar.
Iloccupait l'espace de la zone brûlante, et pour enceinte il avait
l'Océan. Les peuples qui suivent Juba sont l'habitant du mont
Atlas, le Numide errant, le Gétule prêt à s'élancer sur des
coursiers sans frein, le Maure dont la couleur est celle des peuples
de l'Inde, le Nasamon qui vit dans les sables stériles, le
Garaman brûlé par le soleil, le Marmaride léger à la course,
le Mazax dont le dard le dispute à la flèche du Mède, le Massyle
qui monte des chevaux nus, et les fait obéir à une simple
baguette qui remplace le frein ; tous les peuples chasseurs des
déserts de l'Afrique, qui abandonnent leurs cabanes pour courir
après les lions, et qui, ne se confiant point à leurs flèches,
provoquent ces animaux terribles et les enveloppent de leurs
vêtements. Juba ne défendait pas seulement la cause de Pompée ; il vengeait
la sienne. La même année qu'en allumant la guerre civile
Curion s'était rendu coupable envers les hommes et les
dieux, il avait voulu, par une loi du peuple, chasser Juba du
trône de ses pères, et arracher la Libye a un tyran à l'heure où
il te livrait, ô Rome, à la tyrannie; et Juba, plein de son ressentiment,
regarde cette guerre comme le plus beau droit du
sceptre qu'il a conservé. Curion tremble au bruit de son approche.
Les troupes qu'il commande ne sont pas de celles qu'il a éprouvées sur les bords du Rhin, et qui, dévouées à César,
ne connaissent que ses enseignes. Ce sont les troupes infidèles
qui ont livré Corfinium, aussi peu attachées au chef qu'elles
suivent qu'à celui qu'elles ont quitté, et pour qui, sans zèle et
sans choix, il est égal de servir l'un ou l'autre. Mais les voyant
déserter la nuit les barrières du camp, Curion se dit à lui-même
: « Rien ne cache mieux la frayeur que l'audace. Je veux
présenter le combat, et tandis qu'elles sont à moi, faire avancer
mes troupes dans la plaine. C'est dans le repos que les esprits
changent. Dès que le glaive, une fois tiré, allume la fureur,
et que le casque couvre la honte, qui songe alors à balancer
ou le talent des chefs, ou le droit des partis ? On obéit à celui qui commande, on sert la cause où l'on est engagé. Le soldat
ressemble au gladiateur dans l'arène; pour l'irriter, il suffit
qu'on lui oppose son égaL »
En se parlant ainsi, Curion déploie son armée en pleine campagne
; et la fortune, par un succès léger, semble vouloir l'aveugler
sur le revers qui l'attend car il chasse devant lui
l'armée de Varus, et le carnage qu'il en fait ne cesse qu'au
camp.
Juba instruit de la défaite funeste de Varus, s'applaudit de
voir dépendre de lui seul l'événement de cette guerre. II accourt
sans bruit avec son armée, et le silence qu'il fait garder
dérobe sa marche à l'ennemi. Sa seule crainte est d'en inspirer,
et que les Romains ne l'évitent. Il détache en avant Saburra
son lieutenant, avec une troupe légère, pour engager une première
attaque, et pour attirer l'ennemi. Saburra doit laisser
croire qu'il commande seul, que Juba ne vient point, et que ce
corps de troupes est tout ce qu'il envoie. Cependant Juba se
tient caché dans une vallée profonde, avec toutes ses forces. Tel
l'ichneumon (1) rusé agite sa queue trompeuse devant l'aspic égyptien,
et provoque sa colère par cette ombre insaisissable, puis
obliquement s'élance sur le reptile, le mord à la gorge au-dessous du poison ; alors la bête pernicieuse lance le venin, qui coule
inutilement de sa gueule.
1 Le crocodile a la vue faible et
les yeux placés de côté; ce qui favorise le stratagème de son ennemi. Pline dit qu'il y a guerre mortelle entre l'ichneumon et le crocodile.
Voyez Pline, Hist. Nat., liv. VIII, ch. xxiv.
L'artifice lui réussit. Curion dédaignant
de s'instruire des forces secrètes des Africains, oblige sa
cavalerie à sortir la nuit de son camp, et à se répandre au loin
dans un pays inconnu. Ce fut en vain qu'on l'exhorte à se défier
d'un ennemi chez qui l'art de la guerre n'était que pièges, sa
destinée l'entraînait à la mort, et l'auteur de la guerre civile en
devait être la victime. Par un chemin escarpé, il conduit son
armée sur les rochers élevés. Sitôt que le Numide, de ces hauteurs,
aperçoit les Romains, il s'éloigne selon sa coutume, et
feint de reculer, afin d'engager l'ennemi à descendre dans la
plaine. Curion, qui prend pour une fuite cette retraite simulée,
se précipite en vainqueur sur ses pas. L'artifice alors se découvre,
et, cessant de fuir, les Africains, répandus sur les collines
d'alentour, enveloppent l'armée romaine. Le chef et les
soldats se voyant perdus, restent glacés d'étonnement. Le lâche
n'ose penser à la fuite, ni le valeureux au combat; car au lieu
devoir leurs chevaux émus au son de la trompette, dresser
l'oreille, agiter leurs crins, ronger le mors qui les déchire, et d'un pied rebelle frappant la terre, et brisant les cailloux, s'indigner
du repos; on les voit la tête baissée, le corps tout fumant
de sueur, la langue pendante, la bouche embrasée du feu de
leur haleine. Leurs flancs s'élèvent et s'abaissent avec un violent
effort, et une écume sèche et brûlante couvre leurs mors
ensanglantés. En vain le fouet ou l'aiguillon les presse, en
vain l'éperon leur déchire le flanc, aucun ne s'emporte, aucun
ne prend sa course; ils n'ont pas même la force de doubler le
pas, et le peu qu'ils avancent, ne sert qu'à exposer de plus
près leur guide aux coups de l'ennemi.
Mais dès que le Numide eut lâché ses coursiers sur les Romains,
la terre s'ébranle et résonne; un tourbillon de poussière, pareil
à ceux que soulève le vent de Thrace, forme dans l'air un
nuage épais, et dérobe aux yeux la lumière. Comme leur choc
impétueux tombait sur de l'infanterie, ce funeste et sanglant
combat ne fut pas douteux un moment; il ne dura que le temps
d'égorger; car les Romains n'avaient la liberté ni d'avancer, ni
de combattre de près ou de loin, de front ou sur les flancs. Il
tombe sur eux une grêle de flèches, dont le poids seul les eût
accablés, sans parler des plaies et du sang versé. Les bataillons romains se pressent dans un cercle étroit. Si quelqu'un, poussé
par la crainte, se précipite au milieu des siens, il peut à peine
se tourner sans péril au milieu des épées de ses compagnons.
A mesure que les premiers reculent, le bataillon s'épaissit.
Faute d'espace, ils ne peuvent plus agir, ni remuer leurs armes :
leurs bras se froissent en se heurtant; le choc des cuirasses
écrase le fer et le sein qui le porte. Le Maure ne put jouir du
spectacle de sa victoire : il ne vit ni des flots de sang, ni un
vaste champ de carnage : il ne vit qu'un monceau de cadavres,
debout tant ils sont pressés.
Mânes des Carthaginois, ombre d'Annibal, ombre maudite de
Carthage, accourez : ce sacrifice est digne de vous. Voilà le
sang dont vous êtes avides : venez vous en rassasier, et ne demandez
plus vengeance. Grands dieux! se peut-il que le massacre
des Romains en Libye soit un triomphe pour Pompée, un
triomphe pour le sénat? Ah! qu'il serait bien moins affreux que
l'Afrique eût vaincu pour elle!
Dès que la poussière abattue par le sang ne s'éleva plus en
nuage, et que Curion vit ses troupes étendues autour de lui, il
ne put ni survivre à son malheur, ni penser à la fuite. Il a recours à une mort prompte, et, courageux par nécessité, il se
perce, et tombe au milieu des cadavres de ses soldats.
Malheureux! de quoi t'ont servi tant de troubles excités
du haut de la tribune, lorsque, porte-drapeau du peuple, tu lui
donnais des armes? et ta révolte contre le sénat? et ton ardeur
à soulever le beau-père contre le gendre? Tu meurs avant
que Pharsale ait décidé de leur sort. Tu n'auras pas même le
plaisir de contempler les horreurs de la guerre civile. Tribuns
puissants, ainsi vous expiez les malheurs de votre patrie;
ainsi vos armes parricides sont lavées dans votre sang. Oh ! que
Rome serait heureuse et ses citoyens fortunés, si les dieux
défendaient notre liberté avec autant de soin qu'ils la vengent!
Te voilà, superbe cadavre, en proie aux vautours de
Libve. Curion n'obtient pas même un bûcher. Nous te rendons
pourtant ce juste témoignage, ô malheureux jeune homme
(car à quoi bon dissimuler ce que la renommée attesterait sans
nous?); tant que tu suivis les sentiers du devoir, jamais Rome
n'avait vu un meilleur citoyen, une plus belle âme, un plus
zélé défenseur des lois; et si l'ambition, le luxe, le dangereux
appât des richesses ont pu l'égarer, que Rome en accuse la
corruption du siècle dont tu n'as fait que suivre le torrent. Le changement de Curion, ébloui par les riches dépouilles de la
Gaule, et corrompu par l'or de César, entraîna la chute de
Rome. Il est vrai : nous avons senti sur notre gorge l'épée du
tout-puissant Sylla, du farouche Marius, du cruel Cinna et de
toute la maison des Césars ; mais qui d'entre eux fut aussi puissant
que Curion? Ils achetèrent Rome : Curion la vendit.
Au commencement de l'hiver le sénat est convoqué en Épire. — Discours du consul Lentulus, qui propose de donner à Pompée la conduite de la guerre civile. — Le sénat choisît Pompée, et décerne des honneurs et des récompenses aux rois et aux peuples qui ont bien mérité de la république. — On se prépare an combat. — Appius consulte l'oracle de Delphes sur l'issue de la guerre et sur son propre sort. — Détails géographiques et réflexions philosophiques sur le temple et sur l'oracle d'Apollon. — Appius fait ouvrir le temple, et le prêtre fait entrer dans le sanctuaire la jeune Phémonoé, qui veut se soustraire à l'obligation de répondre. — Appius découvre sa ruse, et la force de parler. Elle parle, mais le dieu n'est pas entré dans son sein. — Elle monte enfin sur le trépied, et prédit, sous l'inspiration du dieu, mais en termes obscurs, le résultat de la guerre civile. — Elle meurt quand le dieu s'est retiré d'elle. — Révolte dans l'armée de César. — Plaintes et menaces des soldats. — César se présente hardiment aux séditieux. — Son discours. — Les chefs de la révolte sont punis, et l'armée rentre dans le devoir. — César envoie son armée à Brindes pour rallier sa flotte ; lui-même se rend seul à Rome, où il se fait donner la dictature et le consulat. — Vaine représentation des comices populaires. Plaintes du poête sur la profanation du consulat. Célébration des fériés latines. — César arrive à Brindes, où il veut mettre sa flotte en mer, malgré les tempêtes. — Son discours à ce sujet. — Le vent tombe et la flotte court le risque de rester en pleine mer; mais enfin elle touche la côte d'Épire. — Les deux rivaux sont en présence. — César presse Antoine de lui amener le reste de son armée demeurée à Brindes. — Son impatience. Il sort pendant la nuit de son camp, et va réveiller un pauvre batelier nommé Amyclas, auquel il ordonne de le passer en Italie. — Amyclas y consent. — En voyant la force de la tempête, le batelier se trouble. — César le rassure. — Description de la tempête. - Paroles de César. — Il arrive sain et sauf en Épire. — Plaintes de son armée, qui lui reproche sa téméraire entreprise. — Antoine arrive avec le reste de sa flotte. — Pompée, voyant arriver l'instant de la bataille, envoie son épouse à Lesbos : son discours. — Réponse de Cornélie.— Leur triste séparation.
C'était ainsi qu'entre les deux chefs, affaiblis l'un et l'autre
par des pertes sanglantes, la fortune, partageant les bons et les mauvais succès, leur ménageait des forces égales pour les champs
de la Thessalie.
L'Hémus était couvert de la neige de l'hiver, les Pléiades descendaient
des voûtes glacées de l'Olympe, et ce jour qui change
le titre de nos fastes, la fête de Janus approchait.
Les consuls, dont l'année expire, en emploient les derniers
moments à rassembler en Épire les membres du sénat, que les
fonctions de la guerre ont tenu dispersé. Un indigne toit, refuge
des voyageurs, reçut les sénateurs de Rome. Des murs étrangers
entendirent les conseils de cet ordre auguste. Ce n'est pas
un camp, c'est le sénat lui-même : ses haches, ses faisceaux,
sa majesté l'annoncent; la réunion de cette assemblée vénérable
apprend au peuple qu'il n'y a pas un parti de Pompée, mais un
parti où se trouve Pompée.
Dès que les Pères sont rangés dans un grave et triste silence,
le consul Lentulus se lève du siège éminent qu'il occupe, et il
leur adresse ces mots : « Si vous avez tous dans le coeur l'antique
vertu de vos pères et un courage digne du sang de ces
illustres Romains, n'examinez ni quel lieu vous rassemble, ni à
quelle distance vous siégez de notre ville captive. Voyez la
patrie partout où vous êtes; et avant d'exercer l'autorité suprême,
décidez d'abord, Pères conscrits, ce que l'univers reconaait, que c'est en vous que le sénat réside. Que le sort nous
envoie sous les astres glacés du nord, ou sous le ciel du midi
aux brûlantes vapeurs où les jours et les nuits ne cessent pas
d'être égaux, nous serons partout le centre de l'État, et le droit
de le gouverner nous accompagnera sans cesse. Quand les torches
gauloises mirent le Capitole en cendre, Véies, où se rendit Camille,
devint Rome dans ce moment. Le siège du sénat peut
changer, son pouvoir est immuable. César s'est emparé de nos
murs désolés, de nos maisons abandonnées; les lois sont
muettes, le Forum en deuil est fermé, la Curie ne voit plus dans
son enceinte que le rebut du sénat et de Rome; tous ceux que
l'exil n'a pas écartés sont ici. Exempts de crimes et vieillis
ensemble dans le calme d'une longue paix, il a fallu pour nous
disperser toutes les fureurs de la guerre. Mais ce corps est vivant
et ses membres se réunissent. Les forces du monde entier,
voilà ce que les dieux nous donnent en échange de l'Italie perdue.
La mer d'Illyrie vient de submerger une partie des rebelles
; Curion, l'âme du sénat de César, est couché sur les
bords poudreux de l'Afrique. Levez vos étendards; précipitez
le cours de nos destins; secondez les dieux par votre espoir :
que le succès vous inspire au moins la confiance que vous inspirait, même dans le malheur, la justice de votre cause. Notre
consulat expire avec l'année; mais vous, dont l'autorité n'a
point de terme, délibérez, Pères conscrits, et décernez le commandement
à Pompée. »
Au nom de Pompée, tout le sénat répondit par des acclamations,
et chargea ce grand homme du soin de son salut et des destins
de la patrie. Ensuite on distribua des honneurs aux rois et aux peuples qui, par leur zèle, s'en étaient rendus dignes. On combla
de présents la reine de la mer, Rhodes, consacrée à Phébus (1);
la jeunesse inculte du Taygète glacé (2); l'antique Athènes est
nommée avec éloge ; Marseille vaut à la Phocide le don de sa
liberté. On célèbre Sadales, et le vaillant Cotys, et le fidèle Déjotarus (3),
et Rhascupolis (4), roi d'une région glacée.
1 Rhodes est une île de la mer appelée autrefois Carpathienne. Le poête dit qu'elle est chère à Phébus à cause de Rhodes, jeune vierge, qui lui donna sou nom et qui fut aimée du dieu de la lumière. Aussi dit-on que, même dans les jours les plus sombres, cette île reçoit au moins un regard du soleil. Voyez Pindare, Olympiq. VII, et Horace, liv. I, Od. vii.
2 C'est le peuple de Lacédémone, ville située au pied du monl Taygète, et sur les bords de l'Eurotas, en Laconie.
3 Roi de Galatie qui avait amené à Pompée six cents cavaliers. Il reste un plaidoyer de Cicéron en faveur de ce roi.
4 Il était roi de Macédoine, et avait envoyé deux cents cavaliers.
Un décret confirme
à Juba la possession du royaume de Libye; et toi, Ptolémée,
ô fatalité! toi, digne chef d'un peuple perfide, toi la
honte de la Fortune et le crime des dieux, on couronne ton
front du diadème d'Alexandre; on arme ta main de ce glaive
qui doit frapper ton peuple. Ton peuple!... plaise au ciel que
tu ne frappes que lui! L'héritage de Lagus sera payé par l'assassinat
de Pompée. C'est ainsi qu'on dérobe un sceptre à Cléopâtre,
un crime à César. Après l'assemblée, le sénat prend les armes; et tandis que
les peuples et les chefs, se livrent au sort de la guerre, le timide
Appius est le seul qui n'ose en courir les hasards. Appius, pour
s'assurer des événements, consulte les dieux et se fait ouvrir
le sanctuaire de l'oracle de Delphes, fermé depuis longtemps
aux mortels.
Au milieu du monde, et à distance égale des rives de l'aurore
et des bords du couchant s'élève le double sommet du
Parnasse, célèbre par les deux cultes de Bacchus et d'Apollon,
dont les Ménades thébaines confondent la divinité dans les fêtes triennales
de Delphes. Ce fut la seule des montagnes qui dans
le déluge domina sur les eaux, et qui servit de borne entre le
ciel et l'onde; encore ne laissait-elle voir que la cime de ses
rochers : ses flancs se cachaient dans l'abîme. Ce fut là qu'Apollon,
jeune encore, essaya ses premières flèches contre Python,
Apollon vengeur de sa mère exilée du ciel, et pressée des douleurs
de l'enfantement.
C'était alors le règne de Thémis : Delphes en rendait les oracles.
Mais Apollon, voyant ces cavernes profondes exhaler un
souffle prophétique et se remplir d'un esprit divin, s'y enferma
lui-même, et caché dans ces antres, il y devint prophète. Quelle divinité se cache si mystérieusement? Quel est celui
dés dieux qui possède les secrets du sombre avenir, qui prévoit
l'ordre éternel des choses, et qui du ciel daigne descendre dans
les entrailles de la terre, y souffrir l'approche de l'homme, et
se communiquer à lui? Grande et puissante divinité sans
doute, soit qu'elle ne fasse qu'annoncer ce qui doit être, soit
qu'elle ordonne ce qu'elle annonce, et que sa volonté devienne
le destin ! Peut-être qu'enfermée dans le sein de la terre qu'elle
gouverne, soutien de ce monde qui se balance dans le vide des
airs, l'essence universelle, Jupiter, s'échappe par les antres de
Cyrrha, et va se réunir au roi du ciel et de la foudre.
Dès que cet esprit s'est emparé du chaste sein de la prêtresse,
le bruit de l'impulsion divine retentit au fond de son coeur, et le
souffle prophétique s'exhale de sa bouche, comme la flamme
s'élance à flots pressés du sommet brûlant de l'Etna, comme
Typhée embrasse les rochers de Campanie frémissant sous le
poids éternel d'Inarime, son tombeau. Jamais le dieu ne se
refuse aux mortels : il répond à qui l'interroge; mais ce qu'il
annonce est irrévocable : il n'est pas même permis de demander
qu'il change. Il rejette les voeux du crime; les sourdes
prières des méchants ne pénètrent point jusqu'à lui; mais favorable aux justes, il leur apprit souvent, comme aux Tyriens, à
changer de patrie; il leur apprit, comme aux Athéniens à Salamine,
à vaincre un ennemi puissant; il enseigne les moyens de
faire cesser, en apaisant les dieux, la stérilité des campagnes,
ou la contagion de l'air.
Le plus grand malheur de notre siècle fut la perte de cet
oracle, lorsque les rois, qu'effrayait l'avenir, imposèrent silence
aux dieux. Les prêtresses de Delphes, loin de s'affliger de ce long
repos, en jouissent au fond de leur temple interdit. Car une mort
soudaine est pour le mortel qui visite le dieu la peine ou le prix
de l'enthousiasme. Dans l'accès de la fureur divine, tous les
ressorts du corps humain s'ébranlent, et les efforts du dieu qui
l'obsède dégagent l'âme de ses liens fragiles.
Ainsi les voûtes de l'antre étaient muettes et les trépieds dès
longtemps immobiles, lorsque Appius, pour approfondir les secrets
du destin de Rome, va réveiller ces profondeurs. Il ordonne
au ministre d'Apollon d'ouvrir le temple et de livrer au dieu la
Pythonisse pâlissante.
La chaste Phémonoé, libre de soin, se promenait, alors à
l'ombre des forêts, au bord des ondes de Caslalie. Le pontife la
saisit, l'entraîne et la précipite jusqu'au vestibule du temple. Mais tremblant de toucher le seuil redoutable, elle a recours à
la feinte pour dissuader Appius du désir de l'interroger. Inutile
artifice.
« O Romain! quelle funeste espérance de vérité t'entraîne?
Cet antre est dès longtemps muet, ses gouffres se taisent et le
dieu n'y réside plus : soit que l'esprit qui l'animait ait abandonné
ces lieux, soit que depuis que les torches des barbares ont mis
Delphes en cendres, Apollon ne daigne plus s'y cacher parmi
les ruines; soit que le ciel le fasse taire et qu'il juge que c'est
assez des vers de l'antique Sibylle pour vous révéler vos destins ;
soit que ce dieu, qui dans tous les temps a banni de son temple
les coupables, ne trouve plus dans nos jours malheureux de
bouche assez pure pour lui servir d'organe. »
Appius démêla l'artifice de la prêtresse; et, par ses menaces,
il lui fit avouer que le dieu était encore présent. Alors elle
ceignit son front des bandelettes entrelacées, se mit un voile
blanc sur la tête, entrelaça de lauriers ses cheveux épars et flottants.
Le ministre, qui la voit hésiter et pâlir, la pousse dans
l'intérieur du temple. Mais frémissant de pénétrer jusque dans
le sanctuaire, elle se tint sous la première voûte, et par un
froid enthousiasme imitant l'inspiration, elle rendit un faux oracle : ruse offensante pour Appius, mais plus encore pour
Apollon et les sacrés trépieds. Ce n'était point cette sainte fureur
qui annonce que le dieu possède sa prêtresse; ce n'était
point ce murmure confus d'une voix étouffée et tremblante, ces
paroles obscures et entrecoupées, ni ces sons effrayants dont
l'éclat eût rempli la vaste profondeur de l'antre. On ne vit point
ses cheveux hérissés secouer le laurier qui couronnait sa tête;
les voûtes du temple ne tremblèrent point, la forêt d'alentour
demeura immobile; tout annonça que la Pythie avait craint de
se livrer au dieu qu'elle faisait parler.
Appius qui ne voit pas les trépieds émus, s'irrite, et dit à la
prêtresse :« Impie, ta mort va me venger, et venger les dieux
dont tu te joues, si à l'instant même tu ne consens à t'enfoncer
dans l'antre prophétique, et si, interrogée sur le sort d'une
guerre dont l'univers est menacé, tu ne cesses de me parler en
ton nom. » La vierge épouvantée s'enfuit vers le trépied. D'abord
son sein se remplit à regret du dieu. Elle hésite. Tout ce
que l'antre recelait de cet esprit, qui depuis tant de siècles ne
s'en était point exhalé, la pénètre et se répand en elle avec un
impétueux effort. Jamais Apollon ne s'était emparé si pleinement
du corps d'une mortelle. L'âme, unie à ce corps fragile en est chassée : le dieu la force à le lui céder. Éperdue et hors d'elle-même,
la Pythie errait dans son antre, roulant sa tête échevelée,
et secouant sur son front hérissé les bandelettes sacrées, les lauriers
de Phébus. Elle renverse les trépieds qu'elle rencontre sur
son passage, le feu divin bouillonne dans ses veines ; elle porte
dans son sein Apollon furieux ; et tandis qu'il emploie à l'irriter
ses fouets invisibles, ses aiguillons de flamme, il lui met un frein
qui la dompte, et il s'en faut bien qu'il lui laisse prédire tout ce
qu'il lui laisse prévoir. Les âges se présentent en foule, et ce
long amas d'événements accable ses faibles esprits : tant ce tableau
de l'avenir est vaste, et tant les siècles accumulés s'empressent
de paraître au jour. Les destins semblent lutter au
passage, et se disputer la voix qui doit les annoncer. Rien n'échappe
à la science de la Pythie, ni le premier jour du monde,
ni le dernier, ni l'étendue de l'Océan, ni le nombre de ses grains
de sable. Mais telle qu'on vit autrefois dans l'antre d'Eubée, la
Sibylle de Cume, dédaignant de répondre à la foule des peuples
qui l'interrogeaient, se borner aux destins de Rome, les détacher
de l'avenir, et les tracer d'une main superbe; telle Phémonoé,
se bornant à prédire le sort d'Appius, le cherche longtemps,
et le démêle à peine dans la multitude innombrable des grands destins qui lui sont offerts. L'écume alors découle de ses
lèvres; elle s'exhale en gémissements; bientôt elle éclate en murmures aigus; ses tristes hurlements font retentir les voûtes
de l'antre sacré, et succombant au dieu qui la domine, elle prononce
enfin ces mots : « Romain, je le vois échapper aux coups
menaçants de cette guerre. Seul à l'abri de ces grands revers, au
fond d'un vallon de l'Eubée, tu jouiras d'un plein repos. » Elle
supprima tout le reste, et Apollon lui ferma la bouche.
Trépieds dépositaires des destins, confidents des secrets du
monde; et toi, Paean gardien de la vérité, toi, à qui le ciel n'a pas voulu cacher un seul jour du sombre avenir, pourquoi
craindre de révéler le décret de notre ruine, la mort des rois,
le massacre des chefs, le carnage de tant de peuples de qui le
sang va se mêler avec des flots de sang romain? Est-ce que les
dieux n'ont pas encore résolu ces grands attentats? Est-ce que
les astres qui balancent à condamner la tête de Pompée tiennent
les destins en suspens? Ou bien veux-tu par ton silence
favoriser le crime vengeur du crime, l'expiation des forfaits et
le retour du pouvoir légitime aux mains vengeresses des Brutus?
La Pythie heurte de son sein les portes du temple et s'élance.
Comme elle n'a pas tout révélé, sa fureur n'est point épuisée; le dieu qu'elle n'a pu chasser, la possède encore. Sous
sa puissance, elle roule des yeux furibonds, et son regard se
perd dans l'espace du ciel. Tantôt son visage est glacé, tantôt
menaçant et terrible; il n'est pas deux instants le même, tour
à tour couvert d'une pâleur livide et d'une brûlante rougeur.
Mais sa pâleur n'est pas celle que cause l'effroi; elle est effrayante
elle-même. Son sein soulevé par de violents soupirs, ressemble
aux vagues qui se balancent avec bruit longtemps après que le
fougueux Borée a fait enfler les eaux de l'Océan. Et tandis qu'elle
repasse, de cette lumière céleste qui l'éclairait sur le sort du
monde, à la clarté faible et commune qui conduit les mortels,
elle se sent enveloppée de ténèbres : Apollon verse le Léthé
dans son âme et en efface les secrets de l'avenir. La vérité
chassée du sein de la Pythie se retire vers les trépieds; et à
peine Phémonoé a repris ses sens, qu'elle tombe.
Mais toi, Appius, trompé par l'oracle ambigu, tu n'es pas
effrayé par la mort qui est proche ; tu ne songes qu'à t'établir
aux champs de l'Eubée, dans les murs de Chalcis, et loin des
troubles qui partagent le monde. Insensé! quel est ton espoir?
et quel autre dieu que la mort peut te garantir du choc de cette
guerre et te mettre à l'abri des maux dont tout l'univers gémit? Oui, tu reposeras en paix, mais le tombeau sera ton asile; il t'attend aux bords écartés d'Eubée, là où Caryste resserre les
gorges de l'Océan, où Rhamnis adore les divinités qui châtient
l'orgueil, où la mer bouillonne dans son gouffre rapide, où
l'Euripe perfide entraîne les vaisseaux de Chalcis vers l'Aulide (1) funeste aux flottes.
1 Depuis la guerre de Troie, l'Aulide passait pour retenir les vaisseaux dans ses ports.
Cependant César revenait vainqueur des plaines de l'Ibérie
et portait ses aigles triomphantes en de nouveaux climats; lorsqu'au
milieu de ses prospérités il vit le moment où les dieux
en allaient rompre à jamais le cours. Ce chef, que la guerre
n'avait pu dompter, fut prêt à perdre, au milieu de son camp,
le fruit de tous ses attentats. Le soldat, longtemps fidèle, mais
rassasié de sang, avait résolu de l'abandonner, soit que le silence
des trompettes eût donné aux esprits le temps de se calmer
et que l'épée refroidie dans le fourreau se refusât aux horreurs
de la guerre, soit que l'avarice des troupes demandant
un plus haut salaire leur eût fait répudier et le chef et sa cause
et mettre à prix leurs glaives déjà souillés de sang.
Jamais César mieux que dans cette crise n'avait éprouvé combien
peu solide et peu stable était le faîte des grandeurs, d'où il
voyait à ses pieds le monde, et quels faibles appuis étayaient son pouvoir. Semblable à un corps mutilé dont on a retranché les
membres et réduit presque à son épée, lui qui venait de voir
marcher tant de peuples sous ses drapeaux, il apprit que les
glaives une fois tirés, appartenaient aux soldats et non pas au
chef. Ce n'est pas un murmure timide ni un ressentiment caché
au fond des coeurs : cette crainte qui réprime les mouvements
séditieux d'une populace irritée, et qui la fait trembler devant
ceux qui devant elle auraient tremblé; la crainte de se trouver
seul révolté contre le tyran n'arrête pas ici les mutins ; toute
l'armée avec la même audace a secoué le frein de l'obéissance ;
et quand le crime est celui du grand nombre, il est sûr de
l'impunité. Les soldats se répandirent en menaces. « Laisse-nous,
César, dirent-ils, laisse-nous enfin nous soustraire à cette rage
impie. Tu ne cherches par mer et par terre que des mains pour
nous égorger. Tu nous abandonnes comme une vile proie au
premier ennemi qui se présente. La Gaule t'a enlevé une
partie de nos légions ; une autre partie a succombé aux durs
travaux de la guerre d'Espagne; une autre est couchée dans
l'Hespérie : dans tous les pays du monde nous te faisons
vaincre en périssant. Que nous revient-il d'avoir arrosé de
notre sang les campagnes du Nord et fait couler le Rhône et
le Rhin sous tes lois ? Pour récompense de tant de guerres, tu
nous donnes la guerre civile ! Quand nous t'avons livré notre patrie, après en avoir chassé le sénat, de quel temple nous as-tu
permis le pillage? Il n'est point de forfaits que nous n'ayons
commis : nos armes, nos mains sont criminelles; notre pauvreté
seule nous déclare innocents. Où tendent tes armes? et
quand diras-tu c'est assez, si pour toi c'est trop peu de Rome?
Vois nos cheveux blanchis; vois nos mains épuisées, nos bras
amaigris; le peu de vie qui nous reste se consume dans les combats.
Permets à des vieillards d'aller mourir en paix. Que te
demandons-nous enfin? De ne pas tomber expirants sur le revers
d'une tranchée; de chercher une main qui nous ferme les
yeux; d'expirer sur le sein d'une épouse, arrosés de ses larmes
et sûrs d'avoir chacun notre bûcher. Laisse la maladie terminer
notre vieillesse; qu'il y ait sous César une autre mort que celle
que donne le fer. Sous quels appas crois-tu nous cacher les forfaits
auxquels tu nous destines? Et de tous les crimes de la guerre
civile, ne savons-nous pas quel est celui qui serait payé le plus
cher? Tu nous as vus dans les combats; tu sais de quoi nous
sommes capables. Faut-il encore t'apprendre qu'il n'est rien de
sacré pour nous? pas un lien, pas un devoir qui nous retienne?
Sur le Rhin, César fut notre chef; il est ici notre complice. Le
crime rend égaux tous ceux qu'il souille. Et à quoi bon nous sacrifier pour un ingrat qui méconnaît la valeur et le zèle? Tout
ce que nous faisons, il l'attribue au destin. Qu'il sache que
c'est nous qui sommes pour lui le destin. Tu as beau te flatter,
César, que tous les dieux te seront soumis, la révolte de tes
soldats irrités te dicte la paix. »
Après ce discours, ils commencent à se répandre dans le
camp, et profèrent des cris de mort contre César. Justes dieux,
faites qu'ils persistent ! puisqu'il n'y a plus dans les coeurs ni
piété ni bonne foi, et que la perte des moeurs est notre unique
ressource ; faites que la révolte termine la guerre civile.
Quel chef n'eût pas été effrayé d'une semblable rébellion ?
Mais César, qui se fait une joie de suivre sa destinée à travers
des précipices, et d'exercer sa fortune à vaincre les plus grands
périls, César se présente, et sans attendre que l'emportement
des soldats s'apaise, il se hâte de les surprendre dans
l'excès de leur fureur. Si son armée lui eût demandé le pillage
des villes, des temples, du Capitole même; si elle eût voulu
qu'on lui livrât les mères et les femmes des sénateurs, César y
eût consenti : tout ce qui est violent et cruel lui convient ;
c'est le droit, c'est le prix de la guerre. Il ne craint de trouver
dans les âmes que la raison et l'équité. Quoi ! César, tu n'as point de honte de chérir une guerre que tes soldats détestent !
Ils seront plutôt que toi rassasiés de sang ! Le droit de l'épée
leur est odieux ; et toi seul, par toutes les voies, tu suis tes
violents projets ! Commence à te lasser du crime ; consens à te
voir désarmé. Qu'espères-tu, cruel? A quoi veux-tu forcer ces
soldats qui te résistent? C'est la guerre civile qui t'échappe.
César parut appuyé sur le retranchement, avec un visage
intrépide; et inaccessible à la crainte, il mérita de l'inspirer.
Il parle, et adresse aux soldats ces mots dictés par la colère.
« Celui qu'absent vous menaciez de l'oeil et de la main, soldats,
il est présent : le voici sans défense, et le sein découvert,
il s'expose à vos coups. Si vous voulez finir la guerre, frappez ;
c'est ici qu'en fuyant il faut laisser vos épées. Une sédition qui
n'ose rien de grand, n'annonce que des lâches, qui sont las de
marcher sous un chef invincible, et ne demandent qu'à s'enfuir.
Retirez-vous, et me laissez accomplir sans vous mes destins.
Bientôt ces armes trouveront des mains dignes de les porter.
A peine vous aurai-je chassés, que la fortune va m'offrir
autant de soldats qu'il vaquera de glaives. Pompée trouve dans
sa fuite des peuples nombreux empressés à le suivre ; et à moi
la victoire ne me donnerait pas une foule d'hommes obscurs, pour recueillir les fruits d'une guerre dont le succès est décidé.
On les verra, sans avoir reçu de blessures, chargés des dépouilles
qui devaient être le prix de vos travaux, suivre mes
chars couverts de lauriers. Et vous, vieillards blanchis sous
mes enseignes, et dont la guerre a épuisé le sang, confondus
avec la populace de Rome, vous serez, comme elle, spectateurs
oisifs de mon entrée triomphante. Vous flattez-vous, par votre
fuite, de retarder le cours de mes succès ? Si tous les fleuves
menaçaient l'Océan de lui dérober le tribut de leurs eaux,
l'Océan ne serait pas plus diminué qu'il n'est aujourd'hui gonflé
par eux. Croyez-vous avoir donné quelque poids à ma fortune
? Non, non, les dieux ne s'abaissent pas jusqu'à s'occuper
de votre salut ou de votre perte. Le monde est subordonné au
destin des grands, et le genre humain ne vit que pour un petit
nombre d'hommes. Les mêmes soldats qui sous moi ont fait
trembler le couchant et le nord, seraient en fuite sous Pompée.
Labiénus était un héros dans mes armées, à présent c'est un vil
transfuge qui parcourt la terre et les mers avec le chef qu'il m'a
préféré. Et ne croyez pas que je vous sache gré d'être moins
parjures que lui, en ne portant les armes ni pour ni contre moi.
Celui qui abandonne mes drapeaux, qu'il suive ou non les drapeaux
de Pompée, ne sera jamais un des miens. Ah ! je reconnais la protection des dieux, ils ne veulent pas m'exposer à de
nouveaux combats avant d'avoir changé d'armée. Et de quel
poids ils me soulagent en me donnant lieu de désarmer, et de
renvoyer sans aucun salaire, des hommes qui devaient tout attendre
de moi, et que la dépouille du monde aurait à peine récompensés
! C'est pour moi désormais que je ferai la guerre.
Sortez de mon camp, quirites; laissez porter mes drapeaux à
des hommes. Je ne retiens que le petit nombre des auteurs de
la trahison, et je les retiens, non pour me servir, mais pour
subir la peine de leur crime. A genoux, perfides, dit-il à ceux-ci;
prosternez-vous, et tendez la tête au fer vengeur. Et vous,
jeune milice qu'on n'a point corrompue, et qui dès à présent
faites la force de mes armés, regardez le supplice des traîtres :
apprenez à frapper, apprenez à mourir. »
Toute l'armée immobile tremble à sa voix menaçante. Cette
multitude craint un homme, qu'il dépend d'elle de rendre son
égal. Il semble qu'il commande aux épées, et que le fer dans
la main des soldats lui obéisse en dépit d'eux. Un moment il
craignit que les troupes ne s'opposassent au châtiment qu'il ordonnait
; mais leur soumission passa son espérance. Il ne demandait
que leurs glaives, ils lui présentèrent leur sein. César n'avait garde de vouloir perdre des hommes endurcis au crime :
il n'en fit mourir qu'un petit nombre. Leur sang fut le sceau de
la paix: et la révolte fut apaisée.
César ordonne à ses troupes de se rendre à Brundusium en
dix jours, et d'y rassembler tous les vaisseaux répandus dans
les eaux de l'Hydrus et de l'antique Taras, sur les rivages de
Leuca, dans les marais Salapiens (1), à l'abri des montagnes de
Sépus, aux lieux où'le Garganus fertile, exposé à Borée du
côté de la Dalrnatie, à l'Àusterdu coté de la Calabre, s'allonge
sur les ondes adriatiques sur cette côte de l'Italie.
1 Il y avait en Apulie une ville de ce nom, célèbre par les amours d'Annibal avec une femme du pays. Voyez Pline, liv. III, ch. ii.
Cependant
il marche vers Rome. Quoique sans escorte, il est sans peur,
Rome avait appris à fléchir devant la toge. Il se montre facile
et bon envers le peuple qui l'implore ; mais il se nomme dictateur
lui-même, et marque nos fastes par son consulat. Et
quel titre eût mieux désigné l'an du désastre de Pharsale?
Pour que rien ne manque au droit des armes, il réunit dans ses
mains les haches et l'épée, les aigles et les faisceaux; et sous
le vain nom d'empereur, il s'attribue tout le pouvoir d'un
maître. Ce fut pour lui qu'on inventa tous ces titres menteurs
dont nous avons flatté l'orgueil de nos tyrans. On feint, pour son élection, de tenir les comices, d'assembler les tribus, et de
recueillir les noms dans l'urne mensongère. Mais il défend de
consulter le ciel. Il a beau tonner, l'oracle est sourd; il donne
même pour un heureux auspice le vol du sinistre hibou. Dès lors
tomba sans force et sans honneur cette dignité consulaire si
révérée chez nos aïeux. Le consulat ne servit plus qu'à distinguer
l'année dans nos fastes. Un consul d'un mois lui donne
son nom. On ne laissa pas de célébrer avec la pompe accoutumée
la fête de Jupiter Latin (1); et Rome qu'il avait si mal protégée,
ne lui en offre pas moins ses sacrifices et ses voeux dans
une nuit resplendissante.
1 Les nouveaux consuls devaien la célébrer tous les quatre ans, aux flambeaux, sur le mont Albain, en mémoire de l'alliance renouvelée entre Tarquin le Superbe et les Latins. (Voyez Macrobe, Saturnales, liv. I, ch. xvi.) Les divinités honorées dans ces fêtes étaient Vesta, le Feu éternel, et le Jupiter Latial.
César, après cette solennité, prend sa course à travers les
campagnes de la Pouille, que le laboureur fugitif a livrées aux
ronces et aux herbes sauvages. Il les traverse avec la rapidité
de la flamme du ciel ou d'une tigresse qui a perdu ses petits.
En arrivant à Brundusium, fondée par les fils de Minos, qui
lui donnèrent la forme du croissant, il trouve la mer fermée par
les vents fougueux du nord, et sa flotte épouvantée par les constellations
orageuses. Il parut honteux à César de perdre le
temps de la guerre dans une lâche, oisiveté et de se tenir enfermé
dans un port tandis que la mer était praticable même
pour des vaisseaux moins heureux que les siens. Pour encourager ses soldats qui n'étaient point faits à ces dangers, il leur
dit : « Si les vents d'hiver s'emparent du ciel et de l'onde avec
plus de force, ils y régnent aussi avec plus de constance que les
vents du printemps qui suivent les caprices de cette perfide
saison. Nous n'avons pas à suivre les détours d'une plage sinueuse,
notre route est droite et ne demande que le souffle de
l'Aquilon. Que ce vent se lève et fasse ployer nos mâts, il va
nous porter sur les bords de la Grèce, sans donner aux vaisseaux
ennemis le temps de surprendre nos voiles paresseuses.
Hâtons-nous de rompre les liens qui nous enchaînent sur ces
bords. Ce temps orageux nous est favorable, nous le perdons dans
le repos. »
Le soleil s'était plongé dans l'onde; les premières étoiles se
montraient au ciel, et les corps éclairés par la lune commençaient
à jeter leur ombre, quand toute la flotte à la fois dénoue
ses câbles et déploie ses voiles. Le nocher courbe les vergues,
les tourne auvent qui vient de gauche, et tend les hautes voiles
dont les plis recueillent les souffles qui bientôt vont l'abandonner.
A peine un souffle léger commence à soulever les voiles,
quand tout à coup elles s'affaissent et retombent sur les mâts.
Le navire quitte la terre, et le vent qui l'a poussé peut à peine le suivre. Les flots sont enchaînés dans un calme profond. L'eau
des marais est moins dormante. On croit voir la surface immobile
du Bosphore scythique, quand l'hiver suspend le cours
du Danube, que la glace couvre le vaste sein de l'onde, et que
l'Hellespont, impraticable aux voiles, offre un chemin solide aux
coursiers de la Thrace et aux chars sur lesquels les peuples de
î'Hémus vont chercher de plus doux climats. Au silence affreux
de ces eaux languissantes, on dirait que la nature engourdie a
perdu ses forces et que l'élément liquide a oublié son mouvement.
On ne voit pas même frémir la surface des eaux ni trembler
l'image du soleil qui s'y réfléchit.
La flotte ainsi retenue était exposée à mille dangers. Les
galères ennemies pouvaient l'environner et l'assaillir en sillonnant
l'onde à la rame. La faim, plus redoutable encore, pouvait
l'assiéger dans ce long repos. Ce nouveau genre de périls produit
des voeux non moins étranges : on va jusqu'à souhaiter que
les vents se déchaînent et que les flots s'irritent, pourvu qu'ils
se dégagent de ce morne engourdissement. On veut bien retrouver
une mer furieuse, pourvu que ce soit une mer. Pas de
nuage au ciel, pas un murmure sur la mer. Dans les airs, sur
les eaux, une triste langueur ne laisse pas même espérer un naufrage. Mais quand la nuit fît place à la lumière, un nuage
obscurcit le soleil naissant : la mer s'ébranle dans ses profondeurs.
Les monts acrocérauniens semblent s'agiter aux yeux
des matelots, la flotte commence à se mouvoir, et à la faveur
des vents et des ondes, elle aborde auprès des sables de Paleste.
Le premier champ de bataille où Pompée et César furent en
présence, est environné par le tranquille Apsus et le rapide
Genuse. L'Apsus, alimenté par l'eau d'un marais, porte de légères
barques. Le Genuse est gonflé par les neiges que fond le
soleil ou bien accru par les pluies; mais ni l'un ni l'autre ne
fait de longs détours. Ils n'ont à parcourir qu'un très petit espace
depuis leur source jusqu'à la mer. Ce fut dans ces lieux
que la fortune mit aux prises deux fameux rivaux. Ce malheureux
monde espérait qu'en se voyant à si peu de distance, ils
détesteraient leurs fureurs; car de l'un à l'autre camp l'on pouvait
distinguer les traits du visage et les sons de la voix; et
César depuis la mort de sa fille et de son petit-fils, ne vit jamais
de si près son gendre, si ce n'est, hélas ! sur les sables du Nil.
Quelque ardeur que César eût pour les combats, ce qu'il
avait laissé de son année en Italie, l'obligea de suspendre le cours de ses fureurs. Ces troupes avaient à leur tête l'audacieux
Antoine, qui, dans cette guerre, méditait déjà le combat de Leucade.
César, impatient, l'appelle avec prières, avec menaces :
« O toi! la cause des malheurs du monde, pourquoi tenir en
suspens les dieux et les destins ? La rapidité de ma course a
tout accompli; cette guerre que j'ai poussée par les plus grands
succès, n'attend que toi pour l'achever. Est-ce en Libye que
je t'ai laissé? Sommes-nous séparés par les écueils des Syrtes?
Personne avant toi n'a-t-il osé franchir cet étroit passage? Et
te fais-je courir des dangers inconnus? Lâche! César ne te demande
pas de le devancer, mais de le suivre. Je te trace la
route : j'aborde le premier sur une plage étrangère, au milieu
de mes ennemis. Et toi, tu crains mon camp! Je parle en vain,
mes voeux se perdent à travers les vents et les eaux. Le moment
de remplir mes destins m'échappe. Ah! du moins, cesse de retenir
mes troupes, qui ne demandent qu'à passer les mers. Si je
connais bien ces braves guerriers, ils voudraient, fût-ce par un
naufrage, se jeter aux bords où je suis. Laisse parler ma douleur,
le monde n'est pas également partagé entre nous ; le sénat
tout entier me dispute l'Épire : l'Italie est à toi. » Trois et quatre
fois il l'appelle ainsi : voeux stériles. Les dieux sont propices à César, mais César fait défaut aux dieux. Alors il prend la résolution
de risquer lui-même, au milieu de la nuit, le passage
qu'Antoine et les siens n'osent tenter. Il a souvent éprouvé que
le ciel favorise les téméraires; et cette mer que redoutent les
flottes, il espère la franchir sur un frêle esquif.
Le calme de la nuit a dissipé les soins accablants des combats.
Cette foule de malheureux à qui leur humble fortune permet le
sommeil, goûtent les douceurs du repos. Tout le camp est
nuit. César, dans son inquiétude, marche au milieu de ce vaste
silence, et va faire lui-même ce que n'eût point osé un esclave.
Il n'emmène personne, et ne veut pour compagne que sa fortune.
Il s'avance au delà des tentes, et sautant par dessus les
gardes endormis, il gémit de voir qu'on puisse les surprendre.
Il suit les détours du rivage, et rencontre une barque attachée
aux rocs rongés par la vague. Non loin de là, le tranquille
conducteur, le maître de la barque avait sa cabane. Le bois n'en
compose pas l'humble structure; mais le stérile jonc entrelacé
au roseau des marais. Une barque renversée protège son flanc
nu. César frappe à coups redoublés; Amyclas se lève du lit
d'algue où il reposait paisiblement. « Qui frappe ? dit-il. Est-ce
quelqu'un qui a fait naufrage ou que son malheur oblige à chercher
refuge dans ma cabane?» En disant ces mots, il découvre
un câble sous un monceau de cendre chaude, et son souffle en
tire une flamme étincelante. Que lui fait la guerre? il sait que
les cabanes ne sont point un appas pour la guerre civile. O doux
avantage de la pauvreté, ô sûreté d'un humble asile présent des
dieux dont les mortels n'ont pas encore senti le prix. Quel est
le rempart, quel est le temple où César eût frappé sans y jeter
l'effroi ? Amyclas ouvre, et César lui dit : « Forme des voeux,
étends tes espérances au delà de ta condition : mes bienfaits
passeront encore tes espérances si tu fais ee que j'attends de
toi, si tu me portes au bord de l'Italie. Tu ne seras plus réduit
à tirer ta subsistance de ta barque, et à traîner ta vieillesse indigente
dans un dur travail. Confie-toi aux soins d'un dieu qui
vient dans ton chétif asile verser tout à coup l'abondance. » Ce
langage ne convenait pas au vêtement plébéien que César avait
pris ; mais il ne pouvait parler en homme du commun. Le pauvre
Amyclas lui répond : « Bien des signes défendent de s'exposer
cette nuit sur la mer. Le soleil n'a pas plongé avec lui dans la mer des nuages étincelants, et ses rayons n'étaient pas d'accord ; épars dans leur lumière, les uns appelaient le Notus, les autres
Borée; le milieu de son disque languissait, dans son morne déclin,
et sa.pâle lumière souffrait le regard de l'homme. La lune
ne montrait pas à son lever son mince et lumineux croissant.
Son globe semblait rongé et la pureté de sa forme altérée ; elle
n'allongeait pas ses cornes en ligne droite, et son rouge éclat
annonçait le vent; ensuite, pâle et livide, elle a caché sous les
nuages son front sinistre. Je n'aime pas non plus le bruit des
forêts agitées, le choc des vagues sur la rive, les bonds capricieux
du dauphin qui semble provoquer l'orage, le plongeon
cherchant la terre, le héron osant s'élancer dans les airs, confiant
dans son aile qui sait nager ; la corneille cachant sa tête
sous les flots, comme pour devancer la pluie, et mesurant d'un
pas inquiet le rivage; pourtant si de grands intérêts vous appellent
sur l'autre bord, vous pouvez disposer de moi. Je vous
passerai, ou les vents et les flots ne l'auront pas souffert. » A
ces mots il détache la barque et livre la voile aux vents. Leur
violence précipite les astres qui sillonnent le vide des airs;
elle ébranle les astres mêmes qui sont attachés au sommet des
cieux ! D'épaisses ténèbres couvrent le sein des eaux, la vague, à
longs replis s'élève el bouillonne, la mer ne sait plus à quel
vent obéir, et la tourmente annonce qu'elle a conçu les vents
dans son sein. « Voyez-vous, dit Amyclas, quel horrible temps
nous menace? Le Zéphyr, l'Eurus, tous les vents vont se déchaîner
: la barque est ballottée par la mer ; le Notus règne au
ciel ; les murmures de la mer présagent le Corus. Nous n'avons
pas même l'espoir d'aller échouer aux côtes d'Italie. Le seul
qui nous reste est de regagner le bord d'où nous sommes partis.
Laissez-moi retourner en arrière, de peur que le port, qui est
encore assez proche, ne soit trop loin de nous dans un moment.
»
Certain de dompter les périls, César répond : « Méprise les
menaces de la mer et livre ta voile au vent déchaîné. Le ciel
te défend de gagner l'Italie, et moi je le veux : marche. Ta
terreur n'a qu'une excuse : tu ignores qui tu conduis. C'est un
homme que les dieux n'abandonnent jamais, et que la fortune
trahit quand elle ne prévient pas ses voeux. Affronte sans pâlir
la tempête, je te protège. Le désordre des deux et des flots
n'atteint pas notre barque. Elle porte César, et ce fardeau la
défendra de l'orage. La fureur des vents ne durera guère. Cette barque sera utile à la mer. Fuis le rivage voisin; persuade-toi
que nous sommes aux ports de Calabre quand nous n'aurons
plus d'autre asile à espérer. Tu ignores la cause de ce bouleversement;
en troublant le ciel et la mer, la fortune essaye ce
qu'elle peut sur moi. » Il achevait à peine, un tourbillon rapide
ébranle la poupe, rompt les cordages, enlève et fait voltiger la
voile au-dessus du fragile mât. La barque gémit sous le coup.
Alors tous les périls ensemble fondent sur le héros, tous les vents
viennent l'assaillir. Ce fut toi, Corus, qui le premier, élevas ta
tête du sein de la mer Atlantique. Le volume immense des
flots soulevés t'obéissait, et allait se briser contre le rivage,
quand le froid Borée s'élance et les repousse : la mer entre
vous suspendue, ne sait auquel des deux céder. Mais vient l'Aquilon
furieux, qui emporte les flots roulés sur eux-mêmes, et
laisse le sable à découvert. Aucun de ces vents ne parvient à
pousser jusqu'au bord les vagues qu'il entraîne; elles se brisent
contre les vagues que pousse le vent opposé; et quand les vents
s'apaiseraient soudain, les flots se heurteraient encore. Il
semble que des fougueux enfants d'Éole, aucun ne soit resté dans ses antres profonds. Chacun d'eux défend ses rivages ; et
grâce à leurs efforts contraires, la mer se contient dans son lit.
Jamais les rochers qui la bordent n'avaient vu ses eaux s'élever
avec tant de fureur et de violence. On croit revoir le temps où
le Dieu souverain du ciel, las de lancer la foudre sur la terre,
remit nos crimes à punir au Trident du dieu des eaux, et lui
céda pour quelques jours une partie de son empire. La mer
alors ne reconnut d'autres limites que les cieux. Peu s'en fallut
qu'il n'en fût de même dans cette nuit, dont les ténèbres rappelaient
la nuit des enfers. L'air s'affaisse, la mer s'élance, et le
flot va dans les nuages se grossir de nouvelles eaux. Cette horreur
profonde n'est pas même éclairée par les terribles feux de
la foudre; ils sont éteints aussitôt qu'allumés dans l'humide
épaisseur de l'air. Au bruit du tonnerre et des flots, au choc
des vents et des tempêtes, les voûtes du ciel sont ébranlées, et
du monde chancelant sur son axe les deux pôles semblent fléchir.
La nature bouleversée frémit de rentrer dans le chaos.
On eût dit que les éléments avaient rompu leur alliance, et
qu'on allait revoir ce ténébreux désordre où étaient confondus
les cieux et les enfers. Le seul espoir de salut qui reste à César, c'est de voir qu'il
n'a pas encore péri dans ce combat des éléments. Quand la
barque est portée sur la croupe des flots, le pâle matelot voit
l'abîme au-dessous de lui; et lorsque la barque se précipite dans
le vaste sillon des ondes, à peine la cime du mât parait-eile
au-dessus des eaux. Tantôt les voiles sont dans les nuages, et
tantôt la carène touche au sable de la mer, car toute la masse
des eaux divisée en monceaux d'écume, laisse leur intervalle
à sec.
Le nocher tremblant a bientôt épuisé toutes les ressources
de l'art. Il ne sait plus auquel des vents il doit résister ou
obéir. Heureusement leur discorde même rendait leurs efforts
inutiles. Les flots qui auraient renversé la barque trouvaient
un obstacle dans les flots contraires. Si une vague la fait pencher,
une autre vague la relève; ils ne craignent ni les bas-fonds
de Sasone, ni les roches tarpéiennes, ni les rives trompeuses
d'Ambracie ; les hautes cimes des Acrocérauniens les effrayent
seules.
César reconnut enfin des dangers dignes de son courage.
« Hé quoi ! dit-il, est-ce pour les dieux un si grand travail que
de perdre un homme? et faut-il soulever les mers pour submerger un fragile esquif? Si je dois trouver sous les eaux la
mort que j'affrontais dans les combats, je la reçois d'un visage
intrépide, telle que le ciel me l'envoie; et quoique ma fin prématurée
interrompe de grands desseins, j'ai assez fait pour ma
gloire. J'ai dompté les peuples du Nord, la crainte a mis à mes
pieds les armes de mes ennemis ; Rome m'a vu au-dessus de
Pompée; vainqueur, j'ai forcé le peuple à m'accorder les faisceaux
longtemps refusés. L'État n'a point de dignité dont les
titres ne me décorent. O Fortune, seule confidente de mes
voeux, fais que personne que toi ne sache que César au comble
des honneurs, César dictateur et consul, est mort comme un
homme privé ! Non, grands dieux ! je ne veux point de funérailles;
retenez au milieu des flots les débris de mon corps déchiré.
Je renonce aux honneurs du bûcher et de la sépulture,
pourvu qu'on me craigne sans cesse, et que sans cesse on
tremble de me voir reparaître de tous les bouts de l'univers. »
Comme il parlait ainsi, ô prodige incroyable ! une vague énorme
enlève la barque, et au lieu de l'engloutir, la dépose au bord
de l'Épire, sur une plage unie et sans écueils. En touchant la
terre, il recouvre à la fois ses conquêtes et sa fortune, et tant
de villes qu'il avait prises, et tant d'États qu'il avait soumis. Mais alors le jour commençait à luire, et le retour de César
dans son camp ne fut pas inaperçu comme sa fuite. Ses soldats
l'environnent les yeux en larmes, et lui adressent des plaintes
dont il n'est pas offensé : « Cruel, lui dirent-ils, où t'emportait
une audace si téméraire; et à quoi nous réservais-tu, nous
dont la vie est si peu de chose, quand tu donnais à la mer en
furie le corps de César à déchirer ? Non, ce n'est pas vertu,
c'est inhumanité, d'exposer une vie d'où dépend celle de tant
de peuples, et de dévouer à la mort le chef que s'est donné le
monde. Est-ce qu'aucun des tiens n'a mérité de ne pas te
survivre? Quoi, tandis que la mer t'emportait, tu nous laissais
plongés dans un lâche sommeil ! nous ne pouvons y penser
sans honte. Ce qui t'avait déterminé, c'est que tu trouvais trop
cruel d'exposer un autre que toi à une mer si furieuse. L'excès
du malheur peut engager les hommes dans les entreprises les
plus hardies, dans les périls les plus évidents ; mais toi, vainqueur
et maître du monde, te rendre le jouet de la fureur des
eaux, n'est-ce pas défier les dieux ? C'est sans doute un gage
bien certain de la faveur du ciel, et du soin que prend de toi
la Fortune, que de te voir reporté par les flots sur le bord que
tu avais quitté; mais est-ce à te sauver d'un naufrage que tu dois employer le secours des dieux, ce secours qui doit t'élever
à l'empire du monde?»
Dans le moment même, le soleil achevant de chasser les
ombres de la nuit, amène un jour serein, et les vents, calmés
par sa présence, laissent la mer apaiser ses flots. Dès qu'Antoine
et les siens les virent aplanis et que Borée épurant les airs
allait seul dominer sur l'onde, ils levèrent l'ancre; et, la rame en cadence, secondant la voile, la flotte s'avançait rangée, sur la
mer, comme une armée dans une vaste plaine; mais la nuit
qui fut orageuse, ne permit pas aux vaisseaux de se tenir ensemble
et dans l'ordre qu'ils avaient pris.
Telle, quand les grues chassées par l'hiver quittent le Strymon
pour voler sur le Nil aux tièdes ondes, la phalange qu'elles forment
dans l'air prend mille figures diverses. Mais si un vent trop
violent frappe leurs ailes étendues, elles se dispersent et se rallient
par groupes confusément épars; et la lettre qu'elles traçaient
se dissipe comme un nuage.
Le vent devenu plus fort au lever du soleil, prit la flotte en
poupe, et rendant inutile l'effort qu'elle fit pour aborder à Lisse,
la poussa dans le port de Nymphée. L'Auster avait chassé l'Aquilon de cette plage, et, succédant à Borée, en avait fait un
port.
Pompée voyant que César avait rassemblé toutes ses forces
et qu'ils touchaient au moment fatal d'une bataille sanglante et
décisive, résolut de mettre en sûreté sa femme, dont la présence
le fait trembler. Il envoie Cornélie à Lesbos, loin du
tumulte des armes. Ah! qu'un saint amour a de pouvoir sur
deux âmes vertueuses! Oui, Pompée, le danger de ton épouse
te rendait timide et tremblant à l'approche des combats. Ce
fut elle qui te fit craindre de t'exposer au même coup du sort
qui menaçait Rome et le monde. Ton âme est préparée à de
tristes adieux, mais ta voix s'y refuse encore. Tu te plais même
à les différer, à dérober quelques instants au sort cruel.
Ce fut vers la fin de la nuit, quand le sommeil quittait leurs
yeux et que Cornélie pressait contre son sein le coeur troublé de
son époux, ce fut alors qu'elle s'aperçut que, se refusant à ses
chastes baisers, il détournait en soupirant son visage inondé de
larmes. Frappée jusqu'au fond de l'âme, elle n'ose paraître l'avoir
surpris versant des pleurs ; mais il lui dit en gémissant : « Épouse
plus chère pour moi que la vie, je ne dis pas aujourd'hui, que la
vie m'est odieuse, mais dans mes jours les plus heureux, voici le moment fatal que j'ai trop et trop peu différé. César avec toutes
ses forces vient me présenter le combat. Il faut s'y résoudre. Pour
vous, Lesbos est un sûr asile. Épargnez-vous d'inutiles prières.
Je me suis déjà refusé moi-même. Vous n'aurez pas longtemps
à souffrir de mon absence ; tout va bientôt se décider. Quand
les choses sont à leur comble, la chute en est rapide ; c'est assez
pour vous du bruit de mes dangers sans en être témoin vous-même.
Si vous pouviez en soutenir la vue, j'aurais mal connu
votre coeur. J'aurais honte à la veille du combat de passer
avec vous de douces nuits; j'aurais honte si les trompettes qui
donneront l'alarme et le signal au monde me surprenaient entre
vos bras. Pompée aurait trop à rougir d'être seul heureux au milieu
des calamités de la guerre. Allez m'attendre loin des périls qui
menacent tant de peuples et tant de rois. Soyez assez loin pour
ne pas ressentir tout le poids de ma chute. Si je péris dans ma
défaite, que la meilleure partie de moi-même me survive, et si
le malheur m'oblige à fuir, pressé par un cruel vainqueur, qu'il
me reste au moins un refuge. »
La faible Cornélie eut à peine la force de l'entendre et de soutenir
l'excès de sa douleur. D'abord frappée comme de la foudre,
elle perdit l'usage de ses sens. Enfin, dès que sa voix put se faire entendre : « 0 Pompée, je ne me plains, dit-elle, ni des dieux ni
du sort. Ce n'est ni leur rigueur, ni celle de la mort qui rompt
les noeuds d'un saint amour. C'est mon époux lui-même qui me
chasse comme une femme répudiée; c'est la loi du divorce que je
parais subir. Oui, hàtons-nous de nous séparer à l'approche de
l'ennemi, apaisons par là ton beau-père. O Pompée! est-ce
ainsi que ma foi t'est connue? Crois-tu qu'il y ait pour moi au
monde d'autre sûreté que la tienne? Mon sort n'est-il pas dès longtemps inséparable du tien? Tu veux, cruel, qu'en m'éloignant
de toi, je laisse ma tête exposée à la foudre et à cette ruine
effroyable dont l'univers est menacé! Tu parles d'un asile assuré
pour moi, dans le moment même où je t'entends faire des voeux
peur cesser de vivre! Quelque résolue que je sois à ne pas me
voir l'esclave de tes ennemis et à te suivre dans la nuit du tombeau,
ne vois-tu pas qu'en m'éloignant de toi tu me forces à te
survivre, au moins le temps d'apprendre ton trépas? Tu fais
plus, tu m'accoutumes à souffrir la vie ; tu as la cruauté de
m'apprendre à vaincre ma douleur! Pardonne, je crains d'y
résister et de supporter la lumière. Que si les dieux daignent
m'entendre, si le succès répond à mes souhaits, veux-tu que
ta femme soit la dernière à se réjouir du bonheur de tes armes?
Tu seras vainqueur! et moi, errante et désolée sur le rivage de Lesbos, je frémirai de voir arriver le vaisseau qui m'en portera
la nouvelle! Que dis-je? ta victoire même pourra-t-elle
me rassurer? n'aurai-je pas à craindre encore que, dans un lieu
isolé, sans défense, César en fuyant ne vienne m'enlever? Le
rivage qui servira d'exil à la femme du grand Pompée, ne sera
que trop célèbre. Qui ne saura que c'est à Lesbos que tu auras
voulu me cacher? Ah ! je t'en conjure, pour ma dernière grâce,
si le sort des armes ne te laisse d'autre ressource que îa fuite,
en cherchant ton salut sur les mers, éloigne-toi des bords où
je serai et choisis un plus sûr asile. » En parlant ainsi, elle se
lève éperdue; et pour ne pas prolonger le tourment de son
départ, elle s'arrache des bras de Pompée et se refuse la douceur
de le presser encore une fois dans les siens. Ce dernier
fruit d'un si constant amour fut perdu pour l'un et pour l'autre,
ïls abrègent leurs plaintes, ils étouffent leurs soupirs, et aucun
des deux en s'éloignant n'a la force de dire adieu. Ce fut le plus
triste jour de leur vie, car leur âme endurcie au malheur soutint
courageusement tout le reste.
Cornélie tombe entre les bras de ses esclaves. Ses esclaves la
portent jusqu'au bord de la mer. Mais là, se jetant sur le sable,
elle embrasse en pleurant ce rivage. On l'entraîne enfin sur le vaisseau. Hélas ! ce n'était pas ainsi qu'elle avait quitté sa patrie,
dont César s'était emparé. Fidèle compagne de Pompée, tu t'en
vas seule; tu le laisses; lui-même il t'oblige à le fuir. Oh ! quelle
nuit va suivre son départ! Pour la première fois, seule, et sans
époux, dans un lit baigné de ses larmes, peut-elle y trouver le
repos qu'elle goûtait à ses côtés! Combien de fois dans le sommeil
ses mains errantes et trempées, croyant l'embrasser, n'embrassèrent
qu'une ombre! Combien de fois, oubliant sa fuite,
elle le chercha vainement! Car malgré le feu secret qui la dévore,
elle n'ose s'agiter dans tout son lit, et lui garde sa place.
Elle ne prévoit que les maux de l'absence. Ah ! malheureuse
Cornélie ! d'autres malheurs t'attendent, les dieux ne vont que
trop presser l'instant qui doit te réunir à Pompée!
Les deux rivaux sont en présence. — César appelle de tous ses voeux l'heure fatale qui va décider de sa fortune. — Ne pouvant forcer Pompée d'en venir à une bataille, il lève son camp, et marche sur Dyrrachium (aujourd'hui Durazzo); mais Pompée l'a prévenu. — Fortification de cette ville. — Pompée campe sur une hauteur qui protège la ville. César, pour assiéger son ennemi , trace au loin l'enceinte d'un immense retranchement. — Description de ces travaux. — Cause première de la contagion. — Elle désole le camp de Pompée ; la famine, celui de César. — Pompée résout aussitôt de forcer les barrières dont l'a su envelopper son ennemi. — Attaque du fort Minutîum. — Un centurion, du nom de Scéva, soutient seul le choc. — Eloge du guerrier. — Il harangue ses compagnons qu'il ramène au combat. — Sa bravoure, ses blessures, son stratagème, sa mort. — Nouvelle attaque de Pompée dirigée sur les forts voisins de la mer : il en chasse l'ennemi. — Efforts impuissants de César, qui est accouru au secours des siens. — Pompée pouvait accabler son rival : trop généreux, il laisse échapper la victoire; regrets du poète. — César passe en Thessalie. — Pompée l'y suit, et refuse de se rendre à l'avis de ceux de ses amis qui l'engagent à revenir à Rome. — Description de la Thessalie : les monts Ossa, Pélion, Othrys, Pinde, Olympe. — La vallée de Tempe, les champs de Phylacée, Ptélée, Dotion, Trachine, Mélibée, Larisse, Argos, Thèbes; les fleuves Éas, Inachus, Achéloüs, Évène, etc. — Habitants : Bébrices, Lélèges, Dolopes, Centaures. — Art de fondre les métaux; monnaie. — Campé sur cette terre, chaque parti s'agite dans l'attente du combat. — Sextus, le plus jeune des deux fils de Pompée, veut connaître l'arrêt du destin; il va consulter une enchanteresse. — Art magique des Hémonides ou femmes de l'Héinus. — Discours de Sextus à l'enchanteresse. — Réponse d'Érichtho. — L'antre de 'enchanteresse. — Charmes magiques. — Un cadavre répond à sa voix. — Destins de Pompée. — Le cadavre est rendu au bûcher. - Sextus, guidé par Érichtbo, rentre au camp de son père.
Dès que les chefs, résolus d'en venir à une bataille, se furent
établis sur les hauteurs voisines, et que les dieux tinrent dans la lice ces deux rivaux qu'ils voulaient voir aux mains, César
dédaigna de s'occuper à prendre les villes de la Grèce. Il ne
veut plus devoir à sa fortune d'autre victoire que sur Pompée.
Tous ses voeux ne tendent qu'à voir l'heure fatale qui entraînera
la chute de l'un des deux partis. Il aime à penser qu'un
seul coup du sort anéantira l'un ou l'autre.
Trois fois il déploie son armée sur les collines qu'il occupe,
et fait lever ses étendards, signal menaçant des combats, pour
annoncer qu'il est toujours prêt à consommer le malheur de
Rome. Mais rien ne peut attirer Pompée, il refuse la bataille et
ne se confit que dans les retranchements de son camp; César
quitte le sien, et à travers les bois, il cache sa route, et s'avance
d'un pas rapide vers les murs de Dyrrachium, qu'il espère enlever
d'assaut. Pompée, qui suit le rivage de la mer, le devance,
et va s'établir sur une éminencc appelée Pétra, d'où il
protège la ville. Cette ville, fondée par les Corinthiens, est par
elle-même imprenable. Ce qui la défend n'est pas l'ouvrage de
ses fondateurs : ce n'est point un rempart élevé par l'industrie
et les efforts de l'homme. Les travaux des humains, quelque
hardis et solides qu'ils soient, cèdent sans peine au ravage des
guerres et des ans qui renversent tout. La force de cette place
est telle que le fer ne peut l'ébranler : c'est l'assiette du lieu, c'est la nature même. Elle est environnée d'une mer profonde,
et de rochers où se brisent les flots. Sans une colline étroite
qui la joint à la terre, Dyrrachium serait une île. Des écueils
formidables aux matelots sont les fondements de ses murs;.et
lorsque la mer d'Ionie est soulevée par le rapide vent du midi
la vague ébranle les maisons et les temples, l'écume s'élance
jusqu'au faîte des toits.
L'impatience et l'ardeur de César le détournèrent d'une entreprise
douteuse et lente. Il résolut d'assiéger lui-même ses
ennemis à leur insu, en s'emparant des hauteurs d'alentour, et
en élevant au loin un rempart dont l'enceinte embrasserait leur
camp. Il mesure des yeux la campagne ; il ne se contente pas d'y
construire à la hâte un fragile mur de gazon; il fait tirer d'énormes
rochers des entrailles de la terre, il fait démolir et transporter
les murailles des villes voisines, et de leurs débris il bâtit un
rempart à l'épreuve du bélier, et des efforts de l'art destructeur
de la guerre. Les montagnes sont aplanies, les abîmes comblés,
et l'ouvrage de César se prolonge à travers les hauteurs et les
précipices. Un fossé profond règne au pied du rempart, et sur
les sommets les plus escarpés on établit des forts. Dans une
vaste enceinte, il enferme des champs cultivés, des déserts stériles
et de vastes forcis dont il enveloppe les fauves habitants. Ni les moissons, ni les pâturages ne manquent à Pompée; et
dans les limites que César lui trace, il a la liberté de changer
de camp. On voit des fleuves commencer, poursuivre et finir
leur cours dans cet enclos immense ; et César ne saurait parcourir
toute l'étendue de ses travaux sans se reposer dans sa
course. Que la Fable nous vante à présent les murs de Troie
qu'elle attribue aux dieux; que le Parthe fuyard admire les murs
de Babylone environnés d'une brique fragile; autant de pays
qu'en abreuve le Tigre et le rapide Oronte, autant en contient
le royaume assyrien, autant en renferme cet enclos, construit
subitement et dans le tumulte des armes. Tant de travaux, qui
sont perdus, auraient suffi pour combler le Bosphore et réunir
les bords de l'Hellespont, pour couper l'isthme de Corinthe, et
pour épargner aux vaisseaux le tour pénible et dangereux du
promontoire de Malée, ou pour changer utilement la face de tel
autre lieu de la terre, quelque obstacle que la nature eût opposé
aux efforts de l'art.
Le guerre s'enferme en champ clos. Ici s'amasse tout le
sang qui doit bientôt inonder le monde, ici sont rassemblées
toutes les victimes que la Thessalie et l'Afrique doivent dans
peu voir égorger. Toute la rage de la guerre civile fermente retenue
dans cette arène étroite. Les premiers travaux avaient trompé la vigilance de Pompée.
Tel au milieu des champs de la Sicile, le laboureur repose en
sûreté, et n'entend pas le mugissement des flots contre les
rochers de Pelore;. tels les Bretons de la Calédonie, au centre
de leur île, ne sont point frappés du bruit de l'Océan qui
se brise contre leurs bords. Mais lorsque Pompée aperçoit le
terrain investi d'un immense rempart, il quitte le camp de Pétra,
et répand son armée sur plusieurs éminences, pour engager
César à diviser ses troupes, et pour le fatiguer en lui donnant
sans cesse toute son enceinte à garder. De son côté, il se retranche
; et du terrain que César lui laisse, il se réserve un espace
égal à celui qui sépare le Capitole altier de l'humble bois
d'Aricie où Diane est adorée, égal au cours du Tibre, depuis
les murs de Rome jusqu'à sa chute dans la mer, s'il ne faisait
aucun détour.
On n'entend point le son des trompettes ; les traits se croisent
dans les airs; mais c'est de plein gré que le soldat les
lance ; et des Romains, pour s'exercer, percent le coeur à des
Romains. Un soin plus pressant que celui de la guerre occupe
les chefs, et leur ôte l'envie de mesurer leurs armes. La terre
épuisée ne donnait plus d'herbages ; les prairies foulées aux pieds
des chevaux, et endurcies sous leurs pas rapides sont dépouillées de leur vert gazon. Ces coursiers belliqueux périssaient de
langueur dans les campagnes dépouillées : leurs jarrets tremblants
fléchissaient ; ils s'abattaient au milieu de leur course, ou
devant des crèches pleines d'un chaume aride, ils tombaient
mourants de faiblesse, la bouche ouverte, et demandant en vain
un herbage frais qui leur rendît la vie.
La corruption dissout les cadavres infects. L'air croupissant
se remplit de mortelles exhalaisons, qui, condensées en nuage,
couvrirent le camp de Pompée. Telle est la vapeur infernale qui
s'élève des rochers fumants de Nésis, ou des cavernes d'où Tiphon
exhale sa rage et souffle la mort. Les soldats tombent en
langueur; l'eau, plus facile encore et plus prompte que l'air à
contracter un mélange impur, porte dans les entrailles contractées
un poison dévorant. La peau se sèche et se noircit,
les yeux sortent de leurs orbites enflammés, un rouge ardent
colore les joues; la tête, lasse et appesantie, refuse de se soutenir.
Le ravage que fait le mal est à chaque instant plus rapide.
Il n'y a plus aucun intervalle de la pleine vie à la mort.
Dès qu'on se sent frappé, on expire. La contagion se nourrit
et s'accroît par le nombre de ses victimes ; les vivants sont
confondus avec les morts, et l'unique sépulture accordée à ces
malheureux, c'est de les traîner hors des tentes. Cependant ces souffrances eurent un terme quand le vent de
la mer s'éleva derrière le camp, que l'aquilon purifia l'air, et
que des vaisseaux apportèrent des grains étrangers.
L'ennemi, libre sur des collines spacieuses, n'avait à souffrir
ni de la corruption d'une eau dormante, ni de la pesante inertie
d'un air infect. Mais il était tourmenté d'une famine aussi cruelle
que s'il eût été resserré par le siège le plus étroit. Avant que
les épis ne soient élevés sur leur tige grandissante, on voit
les hommes, pressés par la faim, disputer la pâture aux animaux, brouter la feuille des buissons, et mordre à l'écoree des
arbres. On les voit déraciner les plantes dont la nature leur est
inconnue, et qui peuvent être des poisons mortels. Tout ce que
le feu peut amollir, tout ce qui cède à une dent avide, tout ce
qui peut passer dans les viscères, même en déchirant le palais,
des mets jusqu'alors inconnus à l'homme, les soldats se les arrachent
; et ils ne laissent pas de tenir assiégé un ennemi chez
qui tout abonde.
Dès que Pompée vit le moment de forcer les barrières qui
l'environnaient et de se rendre la terre libre, il ne prit pas,
comme pour s'échapper, une heure où la nuit l'eût couvert de
ses ombres; il dédaigne une fuite dérobée à César et un chemin
frayé sans le secours des armes. Il veut sortir, mais à travers de vastes ruines, sur les débris, du rempart et des tours,
s'ouvrir un passage au milieu des glaives et par le carnage et
par la mort. Il choisit pour l'attaque un endroit du rempart qui,
depuis, s'est appelé le fort Minutius (1)et qu'environne un bois
épais sur une colline escarpée.
1 Du nom du Romain qui défendit ce poste. Est-ce le même que Scéva? (Voyez la note suivante.) Suétone {César, eh. LXVIII) l'appelle Cassius Scaeva, et Valère-Maxime (liv. III, ch. ii,) Cassius Scaeva.
Il y fait marcher son armée en silence et sans qu'il s'élève aucun nuage de poussière qui le trahisse, et soudain il arrive au pied du rempart. A l'instant toutes ses trompettes sonnent, toutes ses aigles brillent, et sans donner au fer le temps de hâter leur défaite, la frayeur et la surprise les ont déjà vaincus. Leur plus grand effort de courage est de tomber, percés de coups, dans le poste où ils sont placés. La flèche qui vole sur les murs n'y rencontre plus de victimes. Des nuages de traits se perdent dans les airs. Alors les torches de bitume portent le feu de toutes parts. Les tours embrasées chancellent et menacent de s'écrouler; le boulevard retentit des coups redoublés du bélier qui l'ébranle. Déjà sur le haut du rempart on voyait les aigles du sénat arborées : l'univers rentrait dans ses droits. Mais ce poste que mille légions n'auraient pas gardé, que César et sa fortune eussent peut-être mal défendu, un seul homme le dispute à l'ennemi; tant qu'il est vivant et qu'il a les armes à la main, la victoire n'est pas décidée. Ce brave s'appelait Scaeva (1). Il avait langui dans la foule obscure des légions, jusqu'à la conquête des Gaules, où il avait obtenu, par son courage et au prix de son sang, le cep de vigne du centurion : homme voué à tous les forfaits, et qui ne savait pas que contre son pays la valeur est un crime.
1 Florus (liv. IV) palie de la bravoure du centurion Scéva. César (de Bell, civ. lib. III) porte à deux cent vingt le nombre de traits qui percèrent le bouclier du guerrier. Suivent les récompenses de sa valeur : il reçut des mains de César deux mille sesterces ; il fut promu au grade de primipile. La cohorte dont il faisait partie, et qui avait secondé son courage, eut à l'avenir double paie, double ration de vivres, double vêtement. Suivant l'histoire, il survécut à ses blessures.
Sitôt qu'il vit ses compagnons
renoncer au combat et chercher leur salut dans la
fuite : « Romains ! s'écrie-t-il, où vous porte une terreur impie,
une frayeur inconnue dans les armées de César? Vils fugitifs!
troupeau d'esclaves! quoi! sans verser une goutte de sang
vous présentez le dos à la mort? Quoi! vous supporterez la
honte de n'être pas au nombre de ces braves qu'on entasse sur
le même bûcher, qu'on cherche dans la foule des morts? Si le
zèle ne peut vous retenir, que l'indignation vous retienne ! De
tous les postes que l'ennemi pouvait attaquer, c'est le nôtre
qu'il a choisi. Non! ce jour ne passera point sans coûter du
sang à Pompée. Il eût été plus heureux pour moi de mourir aux
yeux de César ; mais si la fortune m'envie un témoin si cher,
j'emporterai chez les morts les éloges de son rival. Que les traits
s'émoussent sur l'airain qui nous couvre et que la pointe des
épées se brise dans notre sein. Déjà la poussière s'élève et se
répand, déjà le bruit de ces ruines retentit jusqu'aux oreilles de César. Il nous entend. Amis ! la victoire est à nous ! Le voilà ;
tandis que nous mourons, il vient nous venger! »
Jamais le premier son de la trompette au moment d'une
bataille n'excita plus d'ardeur que la voix de Scaeva. Ses compagnons,
frappés de son audace, l'admirent et brûlent, de le
suivre; impatients de voir par eux-mêmes, si, enfermé dans
un lieu étroit, accablé par le nombre, un homme vaillant peut
gagner plus que le trépas. Pour Scaeva, du haut du rempart
qui s'écroule, il commence par rouler les cadavres dont les tours
sont déjà comblées; et à mesure que les ennemis se succèdent,
il les accable sous le poids des morts. Les ruines, les débris,
les masses de bois et de pierre, tout devient une arme entre
ses mains. Il va jusqu'à menacer les assaillants de sa propre
chute. Tantôt il les repousse à coups de pieux et de leviers, tantôt
il tranche à coups d'épée les mains qu'il voit s'attacher aux
murs. Aux uns il écrase la tête sous la pierre, et, à travers les
débris des os qu'il enfonce, le cerveau rejaillit au loin; à
d'autres, il présente des torches allumées; leurs cheveux s'enflamment,
leur visage brûle, et leurs yeux en sont dévorés.
Dès que la foule des morts entassés et qui s'accumulent sans
cesse a égalé la hauteur du mur, Scaeva se précipite au milieu
des armes avec la rapidité d'un léopard qui s'élance sur les épieux. Pressé par d'épais bataillons, enveloppé par une armée
entière, partout où il jette les yeux, il porte la mort. Déjà son
glaive est émoussé par le sang qui s'y fige: il ne blesse plus, il
meurtrit et il brise. Tous les traits de l'ennemi s'adressent à lui
seul. Toutes les mains sont sûres, tous les dards vont au but, et
les dieux se donnent le spectacle nouveau d'un combat entre un
seul homme et la guerre. Son épais bouclier retentit de coups
redoublés. Son casque brisé meurtrit sa tête, et son sein se fait
une armure des traits dont il est hérissé. Cessez, insensés, de
prétendre à lui percer le coeur : le dard, le javelot n'y peuvent
plus atteindre ; il faut l'écraser sous la phalarique tournoyant
sous l'effort du câble, et sous les débris des remparts ; c'est au
bélier pesant, c'est à la baliste à renverser ce nouveau mur qui
protège César et résiste à Pompée. Scéva ne daigne plus se couvrir
de ses armes, et, soit pour ne pas laisser oisive la main qui
porterait le bouclier, soit pour éviter le reproche d'avoir voulu
prolonger sa vie, il s'abandonne sans défense à tous les coups
des assaillants. Enfin accablé sous le poids des flèches dont il
est couvert, comme il sent que ses genoux fléchissent, il ne
songe plus qu'à choisir un ennemi sur qui tomber. Tel l'éléphant dans les champs de Libye, percé de lances et
de dards, qui n'ont pu pénétrer à travers sa dure enveloppe,
les secoue en ridant sa peau ou les brise en repliant sa trompe.
Ainsi tant de traits, tant de blessures ne peuvent accomplir une
seule mort.
Voilà cependant qu'un Cretois tend son arc et vise Scaeva :
sa flèche part, et trop fidèle aux voeux de celui qui l'a décochée,
atteint Scaeva et lui perce l'oeil gauche. Scaeva rompant tous les
liens qui attachent le globe sanglant et arrachant d'une intrépide
main la flèche et l'oeil qu'elle tient suspendu, les foule aux
pieds l'un et l'autre. Ainsi, une ourse de Pannonie, furieuse de
se sentir blessée du dard qu'un chasseur lui a lancé, se replie
sur sa blessure, pour arracher le trait qui la suit en tournant
avec elle.
Le front de Scaeva avait perdu sa férocité, une pluie de sang
inondait son visage; les cris de joie des vainqueurs remplissaient
l'air, à peine eussent-ils marqué plus d'allégresse si le
sang plébéien qu'ils voyaient couler eût été celui de César.
Mais Scaeva tenant sa douleur renfermée au fond de son âme :
« Citoyens, » dit-il d'un air plein de douceur et comme ayant perdu courage, « citoyens, je vous demande grâce, détournez de
moi le fer homicide ; il n'est pas besoin pour m'ôter la vie de
me lancer de nouveaux traits; il vous suffit d'arracher de mon
sein ceux dont il est déjà percé. Emportez-moi vivant dans le
camp de Pompée ; faites cette offrande à votre chef, il vaut mieux
pour lui que l'exemple de Scaeva montre à renoncer à César,
qu'à mourir d'une mort honorable. »
Le malheureux Aulus ajoute foi à ce langage plein d'artifice,
et sans s'apercevoir que Scaeva tient son épée par la pointe, il
se courbe pour l'enlever et l'emporter avec ses armes. Soudain,
aussi prompt que la foudre, le glaive de Scaeva est plongé
dans son sein. La force revient à Scaeva, et ranimé par ce
nouvel exploit : « Ainsi périsse, dit-il, quiconque osera croire
avoir réduit Scaeva. Si Pompée veut obtenir la paix de cette
épée, qu'il rende les armes à César, qu'il prosterne devant
lui ses aigles. Lâches! me croyez-vous timide et tremblant
comme vous à l'aspect de la mort? Sachez que le parti de Pompée
et du sénat vous est moins cher qu'à moi l'honneur de
mourir. » Comme il disait ces mots, un tourbillon de poussière
annonce que César arrive avec ses cohortes ; son approche
épargne à Pompée le plus accablant des affronts, la honte d'avoir
cédé à un seul homme et d'avoir vu son armée entière reculer devant Scaeva. Celui-ci que la chaleur du combat avait
soutenu, tombe en défaillance dès que le combat cesse. Ses
compagnons l'environnent en foule et le reçoivent. C'est à qui
sera chargé de ce glorieux fardeau. Il leur semble qu'une divinité
se cache dans ce corps mutilé : ils adorent en lui la vivante
image de la plus sublime vertu. Chacun s'empresse de
retirer les flèches de ses blessures; et les temples des dieux,
les autels de Mars sont ornés de tes armes, ô Scaeva ! O nom
glorieux à jamais, si devant lui avait fui l'Espagnol indompté,
ou le Cantabre au court javelot, ou le Teuton à la longue pique !
O Scoeva! tu ne suspendras point aux murs du Capitole les
monuments de la victoire. Rome ne retentira point du bruit de
ton triomphe. Malheureux! fallait-il employer tant de vertu à
le donner un maître!
Pompée repoussé sur ce point ne veut, pas de trêve : il repousse
un lâche sommeil ; telle la mer, quand les vents furieux
l'agitent et qu'elle se brise contre ses écueils, ou que minant les
flancs d'une haute montagne, elle en prépare la chute prochaine
dans les flots. Il embarque une partie de ses troupes, leur fait
tourner les forts les plus voisins, enlève ces postes par une double
attaque, et reculant les bornes de son camp, se déploie dans la campagne et s'applaudit de pouvoir changer de position. Tel
l'Éridan, lorsqu'il enfle ses eaux, surmonte les digues qui protègent
ses bords et se répand au loin dans les campagnes ravagées.
S'il rencontre dans son cours quelque endroit faible qui n'ait
pu soutenir l'effort de ses rapides flots, il sort tout entier de sa
couche profonde et à travers des terres inconnues va se creuser
un nouveau lit. Les laboureurs des champs inondés s'en éloignent,
et de nouveaux possesseurs s'emparent du fond que le
fleuve a quitté.
A peine César est averti par la lumière allumée sur une
tour, il accourt, et trouve ses remparts renversés, la poussière
même abattue, et le même silence qui régnerait parmi des
ruines antiques. Le calme du lieu, la tranquillité de Pompée, le
sommeil qu'on ose goûter après avoir vaincu César, l'enflamment
de fureur. Il court, dût-il hâter sa perte, troubler ce repos insultant.
Plein de menaces, il se jette sur Torquatus. Celui-ci
découvre César qui s'avance; et aussitôt, avec la même célérité
qu'un nocher habile replie ses voiles et les dérobe à la tempête
qui le menace, ce guerrier prudent se retire à l'abri d'un moindre
rempart, et va regagner le camp de Pompée pour ramasser toutes
ses forces, et se former dans un espace étroit. Dès que Pompée voit que César a passé la première enceinte, il fait descendre
toutes ses troupes des collines qu'elles occupent, les déploie autour
de César, et l'investit de son armée entière. Lorsque l'Etna,
où s'agite Encelade, ouvre tout à coup ses cavernes brûlantes, et
se répand lui-même en torrents de feu dans les campagnes d'alentour,
l'habitant de ces campagnes en est moins effravé que
ne le fut le soldat de César à cette irruption soudaine. Vaincu,
même avant le combat, par la seule poussière qu'il voyait s'élever,
dans le trouble et l'aveuglement de sa frayeur il voulait
fuir, il se précipitait au-devant de l'ennemi, et, saisi d'épouvante,
il courait à sa perte.
Il dépendait de Pompée d'étouffer dans le sang jusqu'aux semences
de la guerre civile. Il retint ses glaives altérés de carnage.
Rome aujourd'hui serait heureuse, libre, maîtresse d'elle-même,
et rétablie dans tous ses droits, si l'impitoyable Sylla se
fût. trouve; à la place du généreux Pompée ; et c'est un malheur
à jamais déplorable que César ait dû son salut à ce qui mettait
le comble à ses crimes, à l'injustice d'être en guerre avec un
gendre qui l'aime. Sort cruel ! L'Afrique n'eût pas vu le désastre
d'Utique, ni l'Espagne celui de Munda; le Nil, souillé
d'un meurtre abominable, n'eût pas promené sur ses ondes un
cadavre plus sacré que ses rois égyptiens; Juba n'eût pas couvert le sable de Libye de son cadavre dépouillé ; le sang d'un
Scipion n'eût pas apaisé les mânes des Carthaginois ; et l'univers
n'eût pas pleuré la mort du vertueux Caton. O Rome ! ce
jour pouvait être le dernier jour de tes malheurs. Pharsale pouvait
s'effacer du livre de tes destinées.
César abandonne un pays où le sort des armes lui a été contraire;
et avec les débris de son armée, il passe dans la Thessalie.
Les amis de Pompée firent tous leurs efforts (1) pour le détourner
du dessein de suivre César, et pour l'engager à retourner à
Rome, et à regagner l'Italie où il n'avait plus d'ennemis.
1 César, vaincu, venait de quitter une contrée où les dieux s'étaient déclarés contre lui. César, néanmoins, ne convient pas que sa défaite fût aussi complète que le prétendaît son rival ; il reproche à ce dernier la jactance avec laquelle il venait d'en annoncer la nouvelle aux provinces. Nous ne déciderons point si ce fut une faute ou non de la part de Pompée, d'avoir suivi son rival en Thessalie : l'événement a prononcé ; mais ne serait-il pas plus juste d'imputer la défaite prochaine de ce chef aux dispositions mêmes que faisaient paraître ses prétendus amis, plus pressés, comme le dit César, de venir à Rome se partager les dignités, les faveurs du pouvoir, que de poursuivie les conséquences d'une première, mais incomplète victoire? « Non, leur dit-il, je ne veux point, à l'exemple de César, paraître en armes au sein de ma patrie. Jamais Rome ne me verra qu'après que j'aurai licencié mon année... » Voilà du moins, de la part du chef, des motifs puisés dans les sentiments d'une politique généreuse; mais la générosité n'est pas une vertu à l'usage de tous.
« Non, leur dit-il, je ne veux point, à l'exemple de César, porter la guerre'au sein de ma patrie; et Rome ne me reverra qu'après que j'aurai renvoyé mes armées. Lorsque ces troubles se sont élevés, il ne tenait qu'à moi de garder l'Italie, si j'avais voulu faire des places de Rome un champ de bataille, voir assiéger les temples de nos dieux et ensanglanter le Forum. Pourvu que j'éloigne la guerre, je consens à passer au delà des Scythes, dans les climats glacés du Nord, ou à suivre César à travers les régions brûlantes du Midi. Moi, Rome, troubler ton repos après ma victoire, moi qui, pour t'épargner les horreurs des combats, ai pu me résoudre à te fuir ! Ah ! que plutôt, pour ta sûreté, César se flatte que tu es à lui ! » Après ce discours, il prit sa route vers les contrées de l'Orient; et par des chemins qu'il se fraya lui-même, à travers les montagnes qui séparent l'Illyrie et la Macédoine, il arriva dans la Thessalie, où la Fortune avait marqué le théâtre de la guerre. La Thessalie, du côté où le soleil se lève environné des frimas de l'hiver, est ombragée par le mont Ossa ; mais lorsque l'été promène le char de Phébus au milieu et au plus haut du ciel, c'est le mont Pélion qui s'oppose aux premiers traits de sa lumière. Au midi s'élève l'Othrix couronné d'épaisses forêts, qui défendent cette contrée de la rage du Lion. Le Pinde lui sert de barrière contre le Zéphyre et l'Iapix; et les peuples qui vers le nord habitent au pied de l'Olympe, sont à couvert des Aquilons, et ne savent pas que les étoiles de l'Ourse brillent toute la nuit au ciel. Les plaines que ces monts environnent étaient jadis cachées sous les eaux avant qu'à travers le vallon de Tempe les fleuves se fussent ouvert un passage pour se jeter au sein des mers. Ils ne formaient qu'un lac immense ; leurs eaux s'accumulaient au lieu de s'écouler. Mais quand le bras d'Hercule eut séparé l'Ossa de l'Olympe, et queNérée entendit la chute de ces torrents nouveaux, alors sortit des eaux cette Pharsale que les dieux auraient dû laisser à jamais submergée. On vit paraître les champs de Philacé (1), où régna le premier des Grecs qui descendit au rivage troyen; et ceux de Pléléos, et ceux de Dotion, qui depuis ont été célèbres par le malheur de Thamiris, le rival des Muses; et Trachine, et Mélibée, que protègent les flèches d'Hercule ; et Larisse, autrefois puissante; et ces campagnes où la charrue laboure maintenant la noble Argos; et celle Thèbes fabuleuse, dont on nous montre encore la place, Thèbes où la malheureuse Agave ensevelit la tête de Panthée, de ce fils qu'elle-même elle avait immolé dans un accès de ses fureurs.
1 Il s'agit de Protésilas, fils d'Iphileus et frère d'Alcimede, mère de Jason : il fut roi de cette partie de la Thessalie où se trouvaient les villes de Phylacée, d'Antrone, d'Itone et de Ptélée. L'oracle avait prédit que celui qui aborderait le premier au rivage de Troie l'arroserait de son sang. Protésilas réclama ce périlleux honneur, et il fut tué en effet; mais par qui? Homère ne le dit point. Sa femme, Léodamie, qu'il avait quittée le lendemain de ses noces, se tua de désespoir dès qu'elle apprit sa mort : les Grecs lui élevèrent un tombeau aux champs de la Troade. Voyez Homère, Iliade, liv. II, v. 205 ; Ovide, Mêtam., liv. XII ; Strabon ; Hyg., Fab. C11I ; Pline, Hist. Nal„ liv. IV, ch. xii ; Lucien, Dial. des Morts, XII.
Les eaux de ce marais immense s'écoulèrent donc par divers
canaux, et formèrent autant de fleuves; le pur et faible AEas
qui, de son humble lit, coule au couchant dans la mer d'Ionie;
et l'Inachus, père d'Isis, qui n'est pas plus fort que l'AEas; et
l'Achéloüs, qui se vit au moment d'être l'époux de Déjanire; et
l'Évène, qui fut teint du sang de Nessus et qui traverse Calydon,
patrie de Méléagre; et le Sperchius qui va se briser dans
les flots du golfe maliaque; et l'Amphrisé, dont les claires eaux
arrosent les prairies où Apollon, berger, garda les troupeaux; et
l'Anaurus, d'où jamais ne s'élève aucun nuage humide et que les vents n'osent troubler; et nombre de fleuves inconnus à l'Océan
qui rendent au Pénée le tribut de leur onde. L'Apidane se jette
à flots précipités dans l'Énipe, qui ne devient rapide qu'en s'unissant
à lui ; l'Asope reçoit dans son sein le Phénix et le Mêlas ;
seul le Titarèse se joint au Pénée, mais sans se confondre avec
lui, et glisse sur sa surface comme sur le sable de son lit; on
croit qu'il prend sa source dans les marais du Styx ; fier de son
origine, il dédaigne de mêler ses eaux avec celles d'un fleuve
obscur et conserve la vénération des dieux.
Dès que ces fleuves écoulés laissèrent à sec les campagnes, le
sillon fertile s'ouvrit sous le soc du Bébryce; bientôt sous la
main du Lélège pénétra la charrue. Les Éolides, les Dolopes
brisèrent le sol, avec eux les Magnètes, célèbres par leurs coursiers,
les Minyens, par leurs rames. C'est dans les antres de
Thessalie que la nue fécondée par les embrassements d'Ixion
engendra les centaures. Toi, Monychus, qui brisais les durs rochers
du mont Pholoé; toi, fier Rhétûs, qui du haut de l'OEta
lançais des chênes arrachés du sommet de cette montagne et
que Borée à peine aurait déracinés ; et Pholus, qui se glorifiait
d'être l'hôte du grand Alcide ; et toi, Nessus, perfide ravisseur,
que perça la flèche empoisonnée; et toi, sage Chiron, qu'on voit briller au ciel vers le pôle glacé de l'Ourse, l'arc tendu vers le
Scorpion. Cette même terre a produit toutes les semences de
guerre : ce fut là que du sein du roc, frappé du trident de Neptune, s'élança le coursier thessalien, présage des combats ; ce
fut là qu'il reçut de la main du Lapithe, le premier frein qui
le dompta, qu'il rongea le mors pour la première fois, et couvrit
d'écume les rênes. Ce fut des rives de Pagase que le premier
vaisseau qui jamais ait fendu les ondes, emporta l'homme
audacieux loin de la terre, son élément, sur l'abîme inconnu des
mers. Ce fut encore un roi de Thessalie, Itonus, qui apprit aux
humains à fondre les métaux dans d'immenses fournaises, à façonner
leur masse brute sous les coups des marteaux brûlants,
à réduire l'or en monnaie, à calculer la valeur des richesses :
secret fatal qui fut pour les peuples une source de malheurs et
de crimes. La Thessalie avait aussi engendré le monstrueux
Python qui rampa vers les cavernes de Delphes, c'est pourquoi
les jeux pythiens demandent les lauriers de Thessalie, et ces
deux enfants d'Aloée, dont l'impiété seconda la révolte des Titans,
lorsque sur Pélion, qui touchait presque au ciel, Ossa fut
encore entassé et ferma la route des astres.
A peine les deux chefs sont campés dans ces champs proscrits par les dieux, le pressentiment du combat agite l'une et
l'autre armée. Tout annonce que le moment d'une action décisive,
ce moment si grave et si terrible, approche, les esprits
faibles et timides tremblent d'y toucher de si près et ne voient
que désastres dans l'avenir. D'autres, mais c'est le petit nombre,
s'armant de force contre l'événement, portent dans les
hasards un courage mêlé d'espérance et de crainte. Du nombre
des lâches était Sextus, l'indigne fils du grand Pompée, qui,
dans la suite, échappé des combats et vagabond sur les mers
de Sicile, fit le métier infâme de pirate et obscurcit la gloire
que son illustre père avait acquise sur ces mers.
L'effroi dont il était saisi dans l'attente de l'avenir lui fit
chercher à le connaître. Mais ce ne fut ni Delphes, ni Délos, ni
Dodone qu'il consulta : Dodone, nourrice féconde des premiers
mortels. Il ne chercha point un devin qui sût lire les destinées
dans les entrailles des victimes, dans le vol des oiseaux, dans
les feux de la foudre, ni observer le cours des étoiles comme les
savants Chaldéens. S'il est encore quelque moyen caché, mais
innocent, d'interroger le sort, ce n'est pas celui qu'il emploie;
c'est un art abhorré du ciel, c'est la magie qu'il met en usage.
Il porte ses voeux aux autels lugubres des Furies; il évoque les
ombres et les dieux des enfers. Ce malheureux se persuade que les dieux du ciel ne sont pas assez clairvoyants. Ce qui achève
de le décider dans son délire, c'est le voisinage des peuples de
l'Hémus. L'art des femmes de cette contrée passe toute croyance.
C'est l'assemblage de tout ce qu'on peut imaginer et feindre de
plus monstrueux. La Thessalie leur fournit des plantes vénéneuses
en abondance et ses rochers comprennent le mystère
infernal de leurs enchantements. Partout on y rencontre de quoi
faire violence aux dieux. Il y croît des herbes que Médée chercha
vainement dans la Colchide.
Ces dieux qui ne daignent pas écouter les voeux'du reste des
mortels, obéissent aux enchantements de la Thessalienne maudite.
Ses accents magiques pénètrent seuls au fond des demeures
célestes. Les immortels n'y peuvent résister, le soin
même du monde, les révolutions du ciel ne peuvent les en distraire.
Quand le murmure d'une Hémonide a frappé les astres.
Babylone et la majestueuse Memphis ouvrent en vain tous les
sanctuaires de leurs mages antiques; il n'est point d'autel qu'un
dieu n'abandonnât pour celui de l'enchanteresse. Ses charmes
inspirent l'amour à des coeurs qui jamais n'auraient été sensibles.
Par elle, de sages vieillards brûlent d'une flamme insensée
: cette vertu n'appartient pas seulement aux breuvages funestes, ou à l'épaisse caruncule ravie sur le front de la
jeune cavale que doit aussitôt aimer sa mère, sans filtre ni
poison, ses paroles suffisent pour jeter les esprits dans un délire
affreux. Deux époux, que ni le penchant, ni le devoir, ni
la douce puissance de la beauté n'attire, un noeud magique
les enchaîne, et rien ne peut les en dégager. A la voix d'une
Thessalienne, l'ordre des choses est renversé, les lois de la
nature sont interrompues; le monde, emporté par son cours
rapide, reste tout à coup immobile, et le Dieu qui imprime
le mouvement aux sphères est tout étonné de sentir que leurs
pôles sont arrêtés. Par ces mêmes enchantements, la terre est
inondée, le soleil obscurci ; le ciel tonne à l'insu de Jupiter.
L'Hémonide, en secouant ses cheveux, remplit l'air de noires
vapeurs et répand au loin les orages; la mer s'irrite quoique
les vents se taisent ; les flots sont retenus dans un calme profond,
quoique les vents soient déchaînés ; les airs et les eaux
se combattent, les vaisseaux voguent contre les vents; les torrents
qui tombent du haut des rochers demeurent suspendus
au milieu de leur chute ; les fleuves remontent vers leur
source; l'été ne soulève plus-le Nil; le Méandre court droit vers
son embouchure ; l'Arare presse le Rhône paresseux ; le sommet des monts s'aplanit; l'Olympe s'abaisse au-dessous des nuages;
les neiges de Scythie fondent au milieu de l'hiver sans que le
soleil y darde ses rayons; la mer repoussée loin du rivage, résiste
au poids de l'astre qui la presse; la terre est ébranlée sur
son axe incliné, sa masse pesante est poussée hors du centre
de son repos et laisse à découvert le ciel qui l'environne.
Tous les animaux dévorants ennemis de l'homme tremblent
devant l'enchanteresse : leur sang et leur venin lui servent à
composer ses poisons. Le tigre altéré et le fier lion lèchent ses
mains et la caressent. La froide couleuvre rampe à ses pieds et
se déploie sur la neige; la vipère se replie autour d'elle et l'enveloppe
de ses noeuds ; les serpents savent que de sa bouche le
souffle humain leur est mortel.
Quel pénible soin pour les dieux que d'obéir à ces enchantements!
Qu'ont-ils à craindre s'il les méprisent? Quelle est la
loi qui les enchaîne? Est-ce de force ou de plein gré qu'ils cèdent?
Est-ce par un culte qui nous est inconnu que l'Hémonide
se les concilie, ou bien sont-ils intimidés des menaces qu'elle
leur fait? A-t-elle cet empire sur tous les dieux, ou ne l'a-t-elle que sur un seul qui peut sur le monde ce qu'elle peut sur lui? Les étoiles se détachent de la voûte azurée; la lune, en
pleine sérénité, se colore d'un rouge obscur, comme quand
l'ombre de la terre lui dérobe l'aspect de l'astre dont elle emprunte
ses rayons : le tourment que lui cause le charme ne
cesse qu'au moment où elle descend du ciel et vient aux pieds
de la Thessalienne écumer sur l'herbe qui la reçoit.
La farouche Érichtho avait abandonné, comme trop doux
encore, les rils criminels, les noirs enchantements usités parmi
ses compagnes; elle avait porté les secrets de son art à un plus
haut degré d'horreur. Elle s'était interdit la demeure des vivants,
et pour être plus chère aux dieux des morts, elle habitait
parmi des tombeaux dans l'asile même des ombres chassées de
leurs couches. Ni l'air qu'elle respire, ni le ciel dont elle jouit,
ne l'empêchent d'entendre ce qui se passe chez les mânes et
dans le conseil infernal. Sur le visage de cette femme impie,
qu'un jour serein n'éclaira jamais, une maigreur hideuseuse
joint à la pâleur de la mort. Ses cheveux mêlés sur sa tête sont
noués comme des serpents. C'est lorsque la nuit est la plus
noire et le ciel le plus orageux qu'elle sort des tombes désertes
et qu'elle court dans les champs déserts pour aspirer les feux
de la foudre. Ses pas imprimés sur la terre brûlent le germe des moissons fécondes. Elle souffle, et l'air qu'elle respire en
est empoisonné. Elle ne daigne pas adresser aux dieux du ciel
des voeux suppliants : aux premiers accents de sa voix, ils se
hâtent de l'exaucer sans jamais lui donner le temps de redoubler
le chant magique. Ses autels ne sont éclaires que par des
torches funéraires, et son encens ne fume que sur des brasiers
qu'elle a pris aux bûchers des morts. Elle ensevelit des vivants
que l'àme anime encore; le destin leur devait de longues années;
la mort s'en empare à regret. Recommençant à rebours
la cérémonie des funérailles, elle rappelle les morts de la tombe
et leur fait quitter leur couche. Elle va dérober les os brûlants
encore d'un fils, et les flambeaux que des parents ont portés
aux funérailles, et les débris à demi-consumés du lit où le mort
reposait, et les lambeaux de ses voiles funèbres, et ses cendres
qui exhalent l'odeur de la chair. Mais a-l-on conservé dans la
pierre ces corps dont le principe humide est tari, et dont la
substance est durcie et desséchée, elle exerce sa fureur sur eux,
plonge ses mains dans leurs yeux, arrache leurs prunelles glacées,
ronge la pâle dépouille de leurs mains décharnées: elle
rompt avec ses dents le noeud fatal et le lacet des pendus; dévore les cadavres, ronge la croix, déchire les chairs battues
par l'orage ou brûlées par les feux du soleil. Elle arrache les
clous des mains des crucifiés, boit le sang corrompu qui dégoutte
de leurs plaies, et si la chair résiste aux morsures, elle
s'y suspend. Si on laisse étendu sur la terre un mort privé de
sépulture, elle accourt avant les oiseaux, avant les bêtes féroces;
mais elle n'a garde d'employer ses mains ou le fer à déchirer
sa proie; elle attend que les loups la dévorent, et c'est de leur
gosier avide qu'elle se plaît à l'arracher. Le meurtre ne lui
coûte rien, sitôt qu'elle a besoin d'un sang qui fume encore et
qui jaillisse de la plaie, ou qu'elle veut pour ses sacrifices, pour
ses rites funèbres une chair vive et un coeur palpitant. Elle déchire
les entrailles d'une mère et en arrache un fruit prématuré
pour l'offrir à ses dieux sur un autel brûlant. S'il lui faut des
ombres plus terribles, elle choisit parmi les vivants et fait des
mânes à son gré. Toute mort est à son usage : de la joue éteinte
des adolescents, elle enlève le duvet tendre; de celui qui meurt
dans la virilité, ce sont les cheveux qu'elle ravit. Elle assiste à
la mort de ses proches, et.sans pitié pour ce qu'elle a de plus
cher, elle se jette sur le mourant, feint de lui donner le dernier
baiser et lui tranche la tète, ou lui entrouvre la bouche, et d'une dent impie lui mordant la langue déjà glacée et presque
attachée au palais, elle murmure sur ses lèvres éteintes et lui
confie les noirs secrets qu'elle fait passer aux enfers.
Dès que la Renommée a fait connaître au fils de Pompée cette
exécrable enchanteresse, il se met en marche au milieu de la
nuit, à l'heure même où le soleil est à son midi sous notre hémisphère;
et il traverse d'affreux déserts. Ses amis, ministres
assidus de tous ses vices, après avoir longtemps erré parmi les
tombeaux entr'ouverls et sur les débris des bûchers, aperçurent
de loin Erichtho assise dans le creux d'un rocher, du coté où le
mont Hémus s'abaisse et se joint aux plaines de Pharsale. Elle
essayait des paroles inconnues aux magiciens et aux dieux
mêmes de la magie, et composait de nouveaux charmes pour
des sortilèges nouveaux; car dans la crainte que le dieu vagabond
qui préside aux armes n'entraînât les Romains en de nouveaux
climats, et que la Thessalie ne fût privée de tout le sang
qui s'allait répandre, elle jetait sur les champs de Philippes,
qu'elle arrosait de ses poisons, un charme assez fort pour y fixer
la guerre : à elle cet ample carnage, à elle de disposer à son gré
de tout le sang de l'univers. Elle s'applaudit d'avance de pouvoir
mettre en pièces les cadavres des rois égorgés ; amasser les
cendres de l'Italie entière; recueillir les ossements de tant d'illustres morts et commander à de si grandes ombres. Son plus
ardent désir, sa seule inquiétude est de savoir ce qu'on lui laissera
du corps de Pompée jeté sur le sable ou du cadavre de
César. Le lâche Sextus l'aborde et lui parle le premier en ces
termes :
« O toi! la gloire des Hémonidea, toi, qui peux révéler ou
changer l'avenir, je te conjure de me laisser voir sans nuage
quelle sera l'issue de cette guerre. Celui qui t'implore n'est pas
le moins considérable d'entre les Romains. Le nom de Pompée
est assez illustre : tu vois son fils, et l'héritier de sa ruine ou
du trône du monde. Mon esprit, dans l'incertitude, est saisi d'un, mortel effroi, et je me sens plus de courage pour soutenir
un malheur certain. Ote aux hasards le droit de me surprendre
et de m'accabler tout à coup ; force les dieux à s'expliquer, ou,
sans leur faire violence, tire la vérité de la nuit des tombeaux;
ouvre-moi le séjour des mânes et contrains la mort à t'apprendre
quelles seront ses victimes. Ce soin n'a rien qui t'humilie, et
l'événement qui se prépare est digne que tu cherches à découvrir, ne fût-ce que pour toi, ce qu'en décidera le sort. »
La Thessalienne impie s'applaudit de voir son nom devenu
célèbre. « Jeune homme, répondit-elle, s'il ne s'agissait que de
quelques destins obscurs, il me serait facile d'obtenir des dieux, en dépit d'eux-mêmes, tout ce que tu demanderais. Il est accordé
à mon art de prolonger une vie dont les astres pressent
la fin ou de traneher des jours qu'ils veulent prolonger jusque
dans l'extrême vieillesse. Mais les événements publics forment
une chaîne qui, dès l'origine du inonde, les tient liés et indépendants.
Si l'on y veut changer quelque chose, l'ordre universel
en est ébranlé, et tout l'univers s'en ressent. Alors, nous,
magiciens de Thessalie, nous avouons que la Fortune est plus
forte que nous. Si tu te contentes de prévoir l'avenir, mille
routes faciles te seront ouvertes pour arriver à la vérité. La
terre, les airs, le chaos, les mers, les campagnes, les rochers
de Rodope, tout va parler. Mais puisqu'un carnage récent nous
fournit des morts en abondance, enlevons-en un qui n'ait pas
perdu toute la chaleur de la vie et dont les organes encore
flexibles forment des sons à pleine voix : n'attendons pas que
ses fibres desséchées par le soleil ne puissent plus nous rendre
que des accents faibles et confus. »
Elle dit, et redoublant par ses charmes les ténèbres de la
nuit, elle s'enveloppe la tête d'un nuage impur et va courant
sur un champ de morts qui n'étaient point ensevelis. A son
aspect, les loups prennent la fuite, les oiseaux détachent leurs griffes de la proie, même avant d'y avoir goûté. Cependant la
Thessalienne, parmi ces cadavres glacés, en choisit un, dont le
poumon, n'ayant reçu aucune atteinte, lui rende les sons de la
voix. Elle en trouve plusieurs, et son choix suspendu tient une
foule de morts dans l'attente : lequel d'entre eux va revoir la
clarté? Si elle eût voulu relever à la fois toutes ces troupes
égorgées et les renvoyer aux combats, les lois de la mort auraient
fléchi, et par un prodige de son art puissant, un peuple
rappelé des rivages du Styx aurait reparu sous les armes.
A la fin, elle choisit parmi ces morts un interprète des destinées;
et traînant à travers des rochers aigus, ce malheureux
condamné à revivre, elle va le cacher au fond d'une montagne
consacrée à ses mystères ténébreux. Cette caverne se
prolonge et descend presque jusqu'aux enfers. Une sombre forêt
la couvre de ses rameaux courbés vers la terre et dont aucun
jamais ne se dirigea vers le ciel : l'if au noir feuillage la rend
impénétrable au jour. Au dedans croupissent d'immobiles ténèbres,
et l'intérieur de l'antre est revêtu d'une humide moisissure
qu'engendre une éternelle nuit. Jamais ce lieu ne fut éclairé
que d'une lumière magique : l'air n'est pas plus pesant et plus
noir au fond de l'antre du Ténare, sur les confins de ce monde et de l'empire des morts. Aussi les dieux des enfers ne craignent-ils
pas d'envoyer les mânes dans la caverne d'Érichtlio, car
quoiqu'elle fasse violence aux destins, l'ombre qu'elle évoque
peut douter elle-même si elle sort des enfers ou si elle y entre.
L'enchanteresse était vêtue comme les Furies, d'un voile peint
de couleurs bizarres. Elle découvre son visage et rejette sa chevelure
de vipères entrelacées; et voyant que les compagnons
de Sextus et Sextus lui-même, tremblants à son aspect, avaient
la pâleur sur le front et les yeux fixés à terre : « Revenez, leur
dit-elle, de la frayeur dont vous êtes atteints; ce corps va reprendre
la vie, et ses traits vont se rétablir dans un état si
naturel, que les plus timides pourront sans crainte le voir et
l'entendre parler. Je vous pardonnerais de trembler si je vous
faisais voir les noires eaux du Styx et les bords où le Phlégéton
roule ses ondes enflammées; si je paraissais moi-même au milieu
des Furies, si je vous montrais Cerbère secouant sous ma
main sa crinière de serpents, et les géants enchaînés par le
milieu du corps et frémissants de rage; mais ici, lâches que
vous êtes, que craignez-vous devant des mânes, tremblants eux-mêmes
devant moi? »
Alors faisant au cadavre de nouvelles blessures, elle versa
dans ses veines un sang nouveau plein de chaleur. Elle a eu soin d'y mêler des flots de l'écume lunaire. Elle y mêle toutes
les horreurs de la nature : l'écume du chien qui a fonde en
horreur, les entrailles du lynx, les vertèbres noueuses de l'hyène,
la moelle du cerf nourri de serpents, le rémora qui retient le
navire, malgré le souffle de l'Eurus gonflant la voile, les yeux
du dragon, la pierre sonore que l'aigle couve et réchauffe, le
serpent ailé des Arabes, la vipère de la mer Rouge, la membrane
du céraste encore vivant, la cendre du Phénix sur l'autel
de l'Orient. Ayant aussi mêlé les vils poisons et les poisons
fameux, elle ajoute des herbes magiques, souillées dans leur
germe par sa bouche impure, et tous les venins qu'elle-même
a créés.
Alors sa voix plus puissante que tous les philtres se fait
entendre aux dieux des morts. Ce n'est d'abord qu'un murmure
confus et qui n'a rien de la voix humaine. C'est à la fois l'aboiement
du chien, le hurlement du loup, le cri lugubre du hibou,
le sifflement des serpents : il tient aussi du gémissement des
ondes qui se brisent contre un écueil, du mugissement des vemts
dans les forêts, et du bruit du tonnerre en déchirant la nue. Tous ces sons divers n'en font qu'un. Elle y ajoute le chant magique
et ces paroles qui pénètrent jusque dans le fond des enfers.
« Euménides, dit-elle, et vous, crimes et tourments du Tartare;
et toi, Chaos, toujours avide d'engloutir des mondes sans
nombre ; et toi, monarque des enfers, que tourmente sans cesse
ton immortalité; effroyable Styx; et vous, Champs-Elysées,
que moi ni mes compagnes nous ne verrons jamais; toi, Proserpine,
qui, pour l'enfer, as quitté le ciel et ta mère ; toi, qu'on
adore là-bas, sous le nom d'Hécate, et par qui les mânes et moi
nous communiquons en secret; et toi, gardien des portes de
l'enfer, toi, qui jettes à Cerbère nos entrailles pour l'apaiser;
et vous, Parques, qui allez reprendre un fil que vous avez
coupé; et toi, nocher de l'onde infernale, qui, sans doute, es
las de repasser de l'un à l'autre bord les ombres que j'évoque;
noires divinités, écoutez ma prière, et si ma bouche est assez
impure, assez criminelle pour vous implorer, si jamais elle ne
vous nomma sans s'être remplie de sang humain, si j'ai égorgé
tant de fois sur vos autels et la mère et l'enfant qu'elle avait
dans ses flancs, si j'ai rempli les vases de vos sacrifices des
membres déchirés de tant d'innocents qui auraient vécu, soyez
propices à mes voeux. Je ne demande point une ombre dès
longtemps enfermée dans vos cachots et accoutumée aux ténèbres. A peine celle que j'évoque a-t-elle quitté la lumière, elle
descend, elle est encore à l'entrée du noir séjour, et la rappeler
par mes charmes, ce ne sera point l'obliger à passer deux fois
chez les morts. Souffrez donc, si la guerre civile est de quelque
prix à vos yeux, que l'ombre d'un soldat qui, dans le parti de
Pompée, se signalait il y a quelques instants, instruise le fils
de ce héros et. lui annonce le sort de leurs armes. »
Après qu'elle a proféré ces paroles, elle relève la tête, la
bouche écumante. et voit debout devant ses yeux l'ombre du
mort étendu à ses pieds qui, tremblante elle-même à la vue de
ce corps livide el glacé, le considère et frémit de rentrer dans
cette odieuse prison. Ces veines rompues, ce sein déchiré, ces
plaies profondes l'épouvantent. Le malheureux! on lui enlève
le plus grand bienfait de la mort, l'avantage de ne plus mourir.
Érichtho s'étonne que l'enfer soif si lent à lui obéir. Elle
s'irrite contre la mort, et d'un fouet de couleuvres vivantes,
elle frappe à coups redoublés le cadavre encore immobile. Alors,
par les mêmes fentes de la terre ouverte à sa voix, elle hurle
après les mânes et trouble le silence de l'éternelle nuit.
« 0 Tisiphone! et toi, Mégère, vous demeurez tranquilles à
ma voix! Vous ne chassez pas avec vos fouets vengeurs cette
âme rebelle à travers les noirs espaces de l'Érèbe! Tremblez, chiennes d'enfer ! que je ne vous appelle par les noms que vous
méritez! que je ne vous traîne hors des enfers, à la clarté des
cieux. et que je ne vous y retienne! Je vous poursuivrai à travers
les bûchers et les funérailles dont je vous défendrai l'approche ;
je vous chasserai des tombeaux; je vous écarterai des urnes. Et
toi, Hécate, je souillerai, je rendrai livide et sanglante la face
que tu prends pour te montrer aux dieux du ciel ; je te forcerai
à garder celle que tu as dans les enfers. Toi, Proserpine, je dirai
à quel indigne appât tu t'es laissé prendre et retenir dans
les royaumes sombres ; par quel incestueux amour tu t'es livrée
au morne roi des morts, et que ta mère, après ton infamie, n'a
pas voulu te rappeler. Pour toi, le plus injuste, le plus méchant
des dieux, tremble que je n'entr'ouvre les voûtes infernales!
Oui, j'y ferai pénétrer le jour ! Tu seras tout à coup frappé de
sa lumière M'obéirez-vous? ou faut-il que j'appelle celui
dont la terre n'entend jamais prononcer le nom sans frémir;
celui qui d'un oeil assuré regarde en face la Gorgone; celui qui
châtie Érinnys tremblante sous ses fouets sanglants; celui qui
siège au-dessous de vous et aussi loin que vous l'êtes du ciel,
dans les abîmes du Tartare, dont vos yeux mêmes n'ont jamais
mesuré la profondeur; le seul enfin de tous les dieux qui, après
avoir juré par le Styx, peut être impunément parjure? » A peine elle achevait, une chaleur soudaine pénètre le sang
du cadavre; et ce sang commence à couler dans toutes les veines
du eorps. Dans son sein glacé jusqu'alors, les fibres tremblantes
palpitent, et la vie rendue à ce corps qui en avait oublié l'usage,
en s'y glissant, se mêle avec la mort. Les muscles ont
repris leur vigueur, les nerfs leur ressort ; le cadavre ne se lève
point peu à peu. et en s'appuyant sur ses membres, il est reupoussé par la terre, et il se dresse tout à la fois. Ses yeux omverts
sont immobiles : ce n'est pas le visage d'un homme vivant,
mais d'un homme qui va mourir; la roideur de la mort et sa
pâleur lui restent. Il paraît stupide d'étonnement de se voir
rendu au monde. Mais ancun son ne sort de sa bouche, l'usage
de la voix et de la langue ne lui est rendu que pour répondre
à la Thessalienne : « Révèle-moi, lui dit-elle, ce que je veux savoir,
et sois sûr de ta récompense; car si tu me dis vrai, je
t'exempte à jamais d'obéir aux évocations de l'Hémus. Je composerai ton bûcher, je charmerai ta tombe de telle sorte que
ton ombre ne sera plus obsédée par les enchantements. Tu revis pour la dernière fois, et ni les paroles, ni les herbes magiques ne troubleront pour toi le sommeil du Léthé quand je
t'aurai rendu la mort. Les oraclesdes dieux du ciel ne montrent l'avenir qu'à travers un nuage; mais celui qui cherche la vérité
chez les dieux des enfers, s'en va sûr de l'avoir trouvée. Ce sont
les oracles de la mort que l'homme courageux consulte : ne
ménage donc pas celui qui t'ose interroger ; ne déguise rien, je
t'en conjure; nomme les choses et les lieux et que la voix qui
t'est rendue soit la voix même des destins. »
Elle finit par un nouveau charme, qui a la vertu d'instruire
une ombre de tout ce qu'elle veut qui lui soit révélé. Alors le
cadavre accablé de tristesse et le visage baigné de pleurs, lui
répondit : « Quand tu m'as rappelé, du séjour du silence, je
n'ai pas eu le temps d'examiner le travail des Parques; mais
ce que j'ai pu savoir des ombres, c'est qu'une discorde effroyable agite celles des Romains, et que la fureur qui les anime
trouble le repos des enfers. Les uns ont quitté les ombrages
de l'Elysée, les autres ayant brisé leurs fers se sont échappés
du Tartare, et c'est par eux que l'on a su ce que les destins
préparaient. Les ombres heureuses paraissent consternées;
j'ai vu les deux Décius, victimes expiatoires de la patrie;
j'ai vu Camille et Curius pleurer sur le malheur de Rome. Sylla
se plaint, de toi, ô Fortune. Scipion donne des larmes à son malheureux fils qui va périr clans la Libye ; le vieux Caton, l'ennemi
de Carthage, prévoit, en gémissant, le sort de son neveu qui ne vivra point sous un maître. Toi seul, ô Brulus! ô généreux
consul! qui chassas nos premiers tyrans, toi seul entre les
justes, tu montres de la joie. Le farouche Catilina, les cruels
Marius, Céthégus aux bras nus, rompent leurs chaînes et bondissent
de joie. J'ai vu se réjouir aussi les Drusus, ces hardis
partisans du peuple, et les Gracques, ces fiers tribuns dont le
zèle ne connut aucun frein. Des mains chargées d'éternelles
chaînes font retentir d'applaudissements les noirs cachots de
Pluton. La foule coupable demande qu'on lui ouvre le champ
des justes. Le monarque du sombre empire fait élargir les prisons
du Tartare; il fait préparer des rochers aigus et des chaînes
de diamant, et des tortures pour les vainqueurs. O jeune
homme ! emporte avec toi la consolation de savoir que les mânes
heureux attendent Pompée et ses amis, et que dans le lieu le
plus serein des enfers, on garde une place à ton père. Qu'il
n'envie point à son rival la gloire de lui survivre. Bientôt viendra
l'heure où les deux partis seront confondus chez les morts.
Hâtez-vous de mourir! et d'un humble bûcher descendez parmi
nous avec de grandes âmes, foulant aux pieds la fortune de
ces dieux de Rome. Ce qu'on agite à présent entre les deux
chefs, c'est de savoir lequel périra sur le Nil, lequel périra sur
le Tibre. Pompée et César ne se disputent que le lieu de leurs funérailles. Pour toi, Sextus, ne cherche pas à l'éclairer sur
ton sort, les Parques l'accompliront sans que je te l'annonce.
Pompée t'apprendra ce que tu dois savoir dans les champs Siciliens
: il est pour toi le plus sûr des oracles. Mais, hélas! il
ne saura lui-même où t'envoyer, d'où t'éloigner, quel climat, quel rivage tu dois chercher à fuir. Malheureux, craignez l'Europe,
l'Asie et l'Afrique; la fortune disperse vos tombeaux
comme vos triomphes. O malheureuse famille! vous n'avez pas
dans l'univers d'asile plus sûr que les champs de Pharsale.»
Après que ce corps ranimé eut fait ce qui lui était prescrit,
il se tint muet, immobile; et la tristesse sur le visage, le fantôme
redemandait la mort; mais pour la lui rendre, il fallut un
nouvel enchantement, de nouvelles herbes, car les destins ayant
exercé leurs droits ne pouvaient plus rien sur sa vie. Érichtho
compose un bûcher magique où ce corps vivant va se placer
lui-même. Elle, y met le feu, se retire et l'y laisse mourir pour
ne ressusciter jamais.
Elle accompagne Sextus jusqu'au camp de son père ; et
comme la lumière naissante commençait à éclairer le ciel,
pour donner le temps au fils de Pompée et aux siens de regagner
leurs tentes, elle ordonne à la nuit de repousser le jour et
de les couvrir de ses ombres.
Le soleil levant semble vouloir dérober sa clarté aux champs de Pharsale- — Songe de Pompée avant la bataille ; souvenir de ses triomphes, des acclamations du peuple romain. — Plaintes et regrets du poète. -— On demande la bataille dans le camp de Pompée : on accuse sa lenteur, sa timidité. — Cicéron vient lui demander, au nom du sénat et de l'armée, de marcher à l'ennemi : paroles de l'orateur. — Réflexions du poëte. — Réponse de Pompée : il cède à regret à la volonté de tous. — On donne l'ordre du combat. — lmpatiente fureur des soldats. — Apprêts de la bataille. — Signes effrayants ; pronostics.— Un devin de Padoue annonce ce qui se passe en Thessalïe.— Réflexions du poëte! Pompée, dans la postérité, réunira tous les voeux. —Description de l'armée de Pompée qui s'avance au combat. — César, s'applaudit de l'occasion, souhaitée tant de fois de tout décider par le fer. — Son audace, toutefois, doute un moment du succès. — Il harangue ses soldats..— Joie dans le camp de César. — Pompée, qui s'efforce de dissimuler ses craintes, se montre à cheval sur le front de son armée, son discours à ses soldats.—Les phalanges, des deux côtés, s'avancent animées d'une égale fureur. — Le poëte gémit sur le désastre qui s'annonce ; ses résultats déplorables pour Rome, pour tout l'univers. — Bientôt les deux armées sont en présence, et les traits sont prêts à partir.— Crastinus, le premier; lance son javelot. — Description de la bataille. — La cavalerie de Pompée enveloppe les légions de César; mais elle cède à leurs efforts — César presse, anime ses soldats; il est partout; il indique lui-même où il faut frapper. — Brutus. — Mort de Domitius. — Déroute complète : regrets du poëte. — Pompée est réduit à fuir. — Il arrive à Larisse : accueil qu'il y reçoit. .— Nouvelle harangue de César à ses soldats après la bataillé ; il les envoie piller le camp des vaincus. — Leur sommeil; leurs terreurs.—César contemple sa fortune dans cet océan de sang. — Reproches amers du poète. —Tableau diï champ de carnage. — La Thessalie, terre trop funeste aux Romains.
Jamais, obéissant à 1'éternelle loi, le soïeil n'avait été si lent
à se lever du sein de l'onde;
jamais avec un front si pâle il
n'avait commencé sa course ni poussé avec moins d'ardeur ses coursiers vers le haut des cieux. Il aurait voulu s'éclipser pour
ne pas luire sur la Thessalie, et il attira d'épais nuages dans
lesquels il s'enveloppa.
Mais la nuit, la dernière nuit des prospérités de Pompée
avait charmé, par une douce erreur, les soins cruels qui agitaient
son sommeil. Il crut se voir assis sur les degrés de son
théâtre, environné d'un peuple innombrable qui élevait son nom
jusqu'au ciel et qui remplissait l'enceinte d'applaudissements
redoublés. Il le voyait, ce peuple, tel que dans ces beaux jours
où jeune encore, vainqueur des nations qu'entoure l'Ibère rapide,
et de tous les peuples qu'avait armés le rebelle Sertorius,
maître et pacificateur de l'Occident, il rentra victorieux dans
Rome, et qu'aussi vénérable sous la robe blanche que s'il eût
été revêtu de la pourpre, il parut, simple chevalier, au milieu
des applaudissements du sénat. Soit que son âme inquiète de
l'avenir se rejetât sur le passé et cherchât dans ses jours heureux
de quoi dissiper ses alarmes, soit que le sommeil qui toujours
enveloppe et déguise la vérité sous dès apparences contraires,
lui fit de la publique joie le présage de la douleur; soit
que ne devant plus revoir sa patrie, ô Pompée, le sort voulût
encore une fois te la montrer, du moins, en songe. Vous qui veillez autour de lui, respectez son rêve, que la trompette ne
frappe l'air d'aucun son ; le silence de la nuit prochaine sera
cruel pour ce héros, et le jour ne va lui offrir qu'une guerre
affreuse et funeste. Ah ! si les peuples avaient de pareils songes
et une nuit si fortunée! O Pompée! ce serait pour Rome et pour
toi un bienfait des dieux, qu'un seul jour, où même assuré de
votre ruine, vous pussiez vous donner l'un à l'autre un dernier
gage de votre amour. Tu as quitté Rome avec l'espérance de
venir mourir dans son sein; et Rome qui n'a jamais fait pour
toi que des voeux bientôt exaucés, n'a pu attendre du sort
qu'il lui enviat jusqu'aux cendres de son bien-aimé. Sur ton
tombeau, les jeunes et les vieux confondant leur deuil, les enfants
mêmes auraient versé des larmes; les femmes romaines,
les cheveux épars, se seraient déchiré le sein comme aux funérailles
de Brutus ; et lors même qu'ils trembleront devant
un injuste vainqueur, que ce soit César en personne qui leur
annonce ta mort, ils pleureront; mais, hélas! en pleurant ils
porteront au Capitole l'encens et les lauriers du vainqueur.
Malheureux! dont les gémissements ont dévoré la douleur, et
ils ne t'ont pas moins pleuré dans l'amphithéâtre où ton rival
occupe ta place. Le soleil avait effacé l'éclat des astres, un murmure confus
s'éleva dans le camp, et toute l'armée en tumulte cédant à la
fatalité qui entraînait l'aveugle univers, demanda hautement le
signal du combat. Cette foule de malheureux, dont le plus grand
nombre ne doit pas voir la fin du jour, environnent les tentes
du général, et enflammés d'une ardeur insensée pressent l'heure
fatale qui s'avance et qui leur apporte la mort. Une rage cruelle
s'empare des esprits, chacun veut voir décider son sort et celui
du monde. On accuse Pompée d'être lent et timide, trop patient
avec son beau-père. On dit qu'il se plaît à régner, qu'il aime à
voir sous ses drapeaux tant de nations rassemblées, qu'il craint
la paix. Les rois, les peuples de l'Orient se plaignent qu'on
prolonge la guerre et qu'on les retienne loin de leur pays. O
dieux! quand vous voulez nous perdre, vous disposez tout pour
que noire malheur soit notre ouvrage et devienne notre crime :
nous courons à notre ruine, nous cherchons les combats où
nous devons périr. C'est dans le camp de Pompée qu'on fait
des voeux pour Pharsale!
Le plus éloquent des Romains, Tullius, qui, sous la toge
consulaire, avait fait trembler le fier Catilina devant ses pacifiques
faisceaux, Tullius fut chargé de porter la parole. Plein d'aversion pour une guerre qui l'éloignait de la tribune et impatient
du long silence que lui imposaient les combats, il appuya
de toute son éloquence la témérité d'une mauvaise cause.
« La Fortune, dit-il à Pompée, ne vous demande pour prix
de sa longue faveur, que de vouloir en user encore. Les grands
de Rome, les rois de la terre, le monde à vos pieds, nous vous
conjurons tous de nous laisser vaincre César. César est-il fait
pour tenir si longtemps tout l'univers en armes? Il est honteux
pour les nations que Pompée qui les a vaincues avec tant de
rapidité soit si lent à vaincre avec elles. Qu'est devenue cette
ardeur, cette foi dans les destins? Ingrat! craignez-vous que
les dieux ne se rangent du parti du crime? N'osez-vous leur
fier la cause du sénat? Vos légions, n'en doutez pas, enlèveront
d'elles-mêmes leurs étendards et s'élanceront au combat. Rougissez
de vaincre par contrainte. Si vous ne commandez ici
qu'au nom du sénat, si c'est pour nous que se fait la guerre,
dès que nous demandons la bataille c'est à vous de la livrer.
Pourquoi détourner de César tant de glaives qui le menacent?
Voyez déjà partir les traits de mille mains impatientes. A peine
chacun se contient dans l'attente du signal. Hâtez-vous, avant
que vos trompettes ne le donnent malgré vous. Le sénat veut
savoir si vous voyez en lui vos soldats ou votre escorte. » Pompée gémit profondément, il vit le piège de la fortune et
que les destins s'opposaient à la sagesse de ses conseils. « Si
c'est, dit-il, le voeu de tous et l'intérêt de la cause commune,
que Pompée dans ce moment cesse d'être chef et devienne soldat,
j'y consens. Que la Fortune se hâte d'envelopper tous les
peuples dans la même ruine, et que ce soit ici le tombeau d'une
partie nombreuse du genre humain. Cependant, Rome, je t'atteste
que l'on m'impose ce jour de la destruction. Tu pouvais
soutenir la guerre sans qu'il t'en eût coûté du sang ; tu pouvais
voir, sans tirer l'épée, César vaincu et pris lui-même, réduit à
souscrire à la paix dont il a violé les lois. Les insensés! quelle
est leur ardeur pour le crime! Ils ont peur qu'une guerre civile
ne soit pas assez meurtrière? Ne voit-on pas que nous avons
enlevé à l'ennemi des pays immenses; que nous l'avons chassé
de toutes les mers; que nous avons réduit ses troupes affamées
à ravager les moissons en herbes ; qu'il en est au point de
désirer périr par le glaive plutôt que par la faim et qu'un
même champ de bataille soit couvert de ses combattants confondus
avec les miens? Ne voit-on pas que cette guerre est déjà
très avancée par les succès qui ont aguerri notre jeune milice
au point de ne pas craindre le signal du combat? Si toutefois
je dois attribuer cette impatience au courage; car la crainte même du péril fait souvent qu'on s'y précipite. L'homme courageux
est celui qui brave le danger s'il le faut, et qui l'évite
s'il est possible. Et nous, c'est dans la plus heureuse situation
des choses que nous voulons tout abandonner au caprice de la
Fortune! Il y va du sort du monde, et on le livre au hasard
d'un moment? Ces peuples aiment mieux me voir les mener au
carnage que leur assurer la victoire. Fortune! tu m'as donné
le destin de Rome à gouverner, je te le remets plus grand que
je ne l'ai reçu. Veille sur lui dans les horreurs de la mêlée. Cette
guerre ne sera ni à ma gloire, ni à ma honte. César, tes voeux
impies l'emportent : combien ce jour coûtera de crimes et de
malheurs au monde! Que de trônes vont tomber! Quel déluge
de sang romain va troubler les eaux de l'Énipe! Ah! plût aux
dieux, si cette tête n'est plus utile à ma patrie, que la première
flèche qu'on lancera vînt la frapper! car la victoire sera pour
moi sans charme. Ou la défaite de César me dévoue à la haine
du peuple, ou le nom de Pompée, après cette bataille, ne sera
qu'un objet de compassion ; et dans ce désastre, le malheur au
vaincu et le crime au vainqueur. »
Il dit, permet le combat, et l'impatiente fureur des troupes
n'eut plus de barrièra. Tel un pilote vaincu par la violence des vents abandonne le gouvernail et se laisse emporter, immobile
fardeau, sur la poupe, que son art ne dirige plus.
Le tumulte et le bruit régnent dans tout le camp ; des mouvements
opposés suspendent et précipitent tour à tour les battements
de ces coeurs féroces; plusieurs portent sur le visage
la pâleur de la mort qui les attend, et sur leur front se peint
leur destinée. C'en est fait : les armes vont régler le destin du
monde et décider pour l'avenir du sort de Rome. Chacun oublie
ses propres dangers, frappé d'un objet plus terrible. Quand
l'Océan couvre le rivage, quand la vague inonde la cime des
monts, que le soleil quitte le ciel, et que le ciel heurte la terre,
dans cette ruine universelle, comment craindre pour soi-même?
Rome et Pompée les occupent tous : ce n'est pas pour soi, c'est
pour eux que chacun tremble.
Pour être plus sûr de ses coups, on aiguise la lance sur la
pierre, on prépare l'épée, on renouvelle la corde de l'arc, on
remplit le carquois de flèches acérées. On ajuste les mors et
les rênes, on se munit d'éperons. Ainsi quand les géants attaquèrent
les dieux (s'il est permis de comparer les travaux des
hommes à ceux des immortels), le glaive de Mars fut remis
brûlant sur les enclumes de Sicile, le trident de Neptune rougit dans la fournaise, Apollon fît tremper de nouveau les flèches
dont il avait blessé Python, Pallas étala sur son égide les cheveux
de la Gorgone, et le Cyclope forgea de nouvelles foudres
à Jupiter.
La Fortune ne manqua pas d'annoncer par divers prodiges
les revers qu'elle préparait : dès que les troupes de Pompée entrèrent
dans la Thessalie, tout le ciel, pour les arrêter, s'arma
de foudres et d'éclairs, de colonnes de feu, de tourbillons de
flammes. On croyait voir voler des torches allumées ; la nuée
éclatait dans les yeux des soldats, et les éclairs qui en jaillissaient
leur faisaient baisser la paupière. La foudre consuma les
aigrettes des casques, fondit la lame des épées, fit couler la pointe
des dards, et le fer même qui n'en fut pas dissous fut pénétré
d'une vapeur de soufre. Les enseignes furent couvertes d'un
nuage d'essaims d'abeilles ; la main qui les avait plantées dans
la terre ne pouvait plus les en arracher ; une rosée de larmes
baignait les étendards, qui seront jusqu'à Pharsale les étendards
de la patrie. Un taureau amené aux autels pour y être immolé,
s'échappe et s'enfuit à travers les champs de Thessalie. Pompée
ne trouve point de victime pour ses malheureux sacrifices.
Mais toi, César, quels sont les dieux que tu invoques? Les noires déités du Styx, les Euménides, les forfaits, les fureurs,
tous des dieux du crime ? Car tu sacrifiais à l'heure où, furieux
tu courais à ce combat impie.
Plusieurs crurent voir ie sommet du Pinde et de l'Olympe se
heurter, l'Hémus se changer en abîmes, un rapide fleuve de sang
traverser le lac Boebéis, qui baigne les pieds de l'Ossa.
On crut entendre, la nuit, dans les airs, les cris des combattants
et le fracas des armes. Les soldats sont épouvantés de
se distinguer clairement l'un l'autre au milieu des ténèbres, et
de voir en plein jour la lumière pâlir, une noire vapeur envelopper
leur tête, et les simulacres de leurs parents voltiger devant
leurs yeux. Ce qui les rassure, c'est de penser que ces
prodiges sont eux-mêmes les présages de leurs forfaits : car ils
savent bien qu'ils ont à verser le sang de leurs frères et de
leurs pères; et le trouble et l'égarement qui précède ces parricides
leur répond qu'ils seront commis.
Et pourquoi s'étonner que des hommes qui voyaient la lumière
pour la dernière fois fussent frappés du pressentiment
d'une mort si prochaine, s'il est vrai que l'âme humaine sache
prévoir le malheur ? Les Romains mêmes qui se trouvaient
alors aux rives de Gadès ou sur l'Araxe ou sur d'autres bords éloignés furent saisis d'une noire tristesse. Ils ignorent la cause
de leur abattement, ils se reprochent de s'affliger : ils ne savent
pas ce qu'ils vont perdre en Thessalie. S'il faut en croire la
renommée, assis sur le mont Euganin, aux lieux où jaillit en
fumant l'Aponus, où le Timave répand ses ondes, un augure
s'écria : « Voilà le jour suprême; le sort du monde se décide ;
Pompée et César heurtent leurs glaives sacrilèges; » soit qu'il
eût tiré ses présages des éclats du tonnerre et des traits de
la foudre, soit qu'il eût observé la Discorde qui s'élevait parmi
les astres, ou l'obscure pâleur du soleil et l'éclipsé de sa lumière.
Il est vrai du moins que la nature marqua ce jour par
des caractères que nul autre jour n'avait eus; et si les hommes
avaient tous eu le don d'expliquer les signes du ciel, de tous les
lieux du monde on aurait vu Pharsale.
0 combien supérieur au reste des mortels un peuple que la
Fortune donne en spectacle à l'univers, et dont tout le ciel est
occupé à prédire la destinée! Dans l'avenir le plus éloigné, chez
la postérité la plus reculée, soit que la seule renommée transmette
ces événements, soit que ce pénible fruit de mes veilles
contribue à sauver les grands noms de l'oubli ; en lisant le récit
de cette guerre, la crainte, l'espoir, le doute impatient se saisiront de tous les coeurs ; on attendra l'événement comme s'il
était à venir. On ne croira pas lire des disgrâces passées; et
c'est toi, Pompée, qui réuniras les voeux des races futures.
Bientôt les troupes resplendissantes aux rayons naissants du
soleil descendent dans la plaine, et les collines étincellent de
la lumière qu'y répand l'acier des armes. Ce ne fut pas au hasard
que celte malheureuse armée s'étendit et se développa;
Pompée en régla l'ordre et le mouvement. C'est toi, Lentulus,
qui commandais l'aile gauche avec la première légion,
qui est aussi la plus brave et qu'appuie la quatrième; à loi,
vaillant et malheureux Domitius, la droite de l'armée ; Scipion
comme un solide rempart est au centre avec toutes les forces
qu'il avait amenées de Cilicie : il n'était là que soldat, il fut
bientôt chef en Libye. Sur l'humide bord de l'Énipe étaient
placés les montagnards de Cappadoce et les cavaliers du Pont
aux rênes flottantes; plus loin, était rangée cette foule de rois,
de Tétrarques dont la pourpre s'abaisse devant le fer latin.
D'ici devaient partir les flèches des Numides et des Cretois, de
là celles des Syriens. D'un côté marchaient les Gaulois sanguinaires
et aguerris contre César; de l'autre s'avançait le belliqueux
Ibère qui agite son étroit bouclier. Dérobe les nations au vainqueur, Pompée, et dans le sang du monde entier efface
tous tes triomphes.
Ce jour-là, César détachait une partie de son armée pour enlever
les moissons. Tout à coup il voit l'ennemi descendre dans
la plaine, il voit le moment souhaité mille fois de tout décider
par le fer. Dès longtemps dévoré d'ambition, brûlant d'arriver
à l'empire, il se reprochait comme un crime le peu de lenteur
et de délai que la guerre civile avait souffert. Mais lorsqu'il
se vit avec Pompée sur le bord du précipice, et qu'il sentit
que sa grandeur chancelante et prête à tomber dépendait de
cette journée, son ardeur se ralentit; il douta un moment du
succès de ses armes; si la fortune lui faisait tout espérer, celle
de Pompée lui donnait tout à craindre. Mais renfermant ce
trouble au dedans de lui-même, il ne fait voir à son armée que
la noble assurance qu'il lui veut inspirer.
« Soldats, dit-il, vainqueurs du monde, auteurs de mes prospérités,
la voilà, cette occasion que vous avez tant de fois demandée.
Nous n'avons plus de voeux à faire, et notre sort dépend
de nos épées. Vous tenez dans vos mains César, sa fortune et sa
gloire. C'est ce grand jour, il m'en souvient, que vous m'avez
promis au bord du Rubicon; ce fut pour lui que nous prîmes les armes. C'est de lui que nous attendons ces triomphes qu'on nous
refuse; c'est lui qui vous rendra vos enfants, vos foyers et les
terres dont le partage doit récompenser vos travaux. C'est lui
qui va prouver par le témoignage du sort quel est le parti le
plus juste, et déclarer coupable le vaincu. Si c'est pour moi que
vous avez porté la flamme et le fer dans le sein de votre patrie,
combattez aujourd'hui pour absoudre vos épées, changez
l'arbitre du combat, aucune main n'est pure. Ce n'est plus de
moi qu'il s'agit : c'est de vous, c'est vous, Romains, que je conjure
de vouloir être un peuple libre et souverain de l'univers.
Pour moi, je borne mon ambition au repos d'une vie privée, à
me voir dans Rome simple citoyen, vêtu de la robe du peuple.
Oui, pourvu que vous soyez tout, je consens à n'être plus rien.
Régnez aux dépens de ma gloire. Reprenez ce pouvoir suprême;
il vous coûtera peu de sang. Devant vous est une jeunesse recrutée
dans les écoles de la Grèce, et qui ne connaît de combats
que ses jeux, une foule de nations barbares qui ne s'entendent
pas entre elles, dont la mollesse asiatique soutient à peine le
poids des armes, et qui vont prendre l'épouvante au premier signal
de la bataille, au premier cri des combattants. Ce qu'il peut
y avoir de nos citoyens dans cette armée, est peu de chose. C'est de cent peuples étrangers, tous ennemis du nom romain, que
se fera le plus grand carnage. Fondez sur ces peuples timides,
écrasez l'orgueil de leurs rois ; d'un seul coup terrassez toutes
les puissances du monde, et faites voir que ces nations que
Pompée, avec tant de faste, a promenées après son char, ne
valaient pas ensemble les honneurs d'un seul triomphe. Du
reste, pensez-vous qu'aucun de ces étrangers voulût donner une
goulte de son sang pour ranger l'Italie sous les lois de Pompée?
Pensez-vous que l'Arménien s'intéresse à voir la puissance romaine
aux mains de l'un ou de l'autre chef? Ils détestent Rome
et tous les Romains, et ceux de leurs maîtres qu'ils ont vus de
plus près sont ceux qu'ils abhorrent le plus. Pour moi, grâces
au ciel, je vois mes intérêts entre les mains de mes amis, de
ceux qui dans' la guerre des Gaules m'ont eu pour témoin de
leurs exploits. En est-il un seul dont l'épée ne me soit connue?
en est-il un dont je ne sois presque assuré de distinguer le javelot
sifflant dans les airs? Si j'en crois des signes auxquels
jamais je ne me suis trompé, si j'en crois ces visages terribles,
et ces yeux menaçants, amis, la victoire est à nous. Je vois
couler des flots de sang, je vois les rois foulés aux pieds, le
sénat lui-même épars sur la poussière, et dans un immense carnage
les peuples nageant confondus. Mais je retarde nos destins, je vous occupe à m'écouter quand vous brûlez de combattre.
Pardonnez-moi ce retard. Vous me voyez tressaillir de joie
et de l'espoir que vous m'inspirez. Jamais les dieux ne m'ont
promis de si grandes choses et ne sont venus si près de moi. Je
touche au terme de mes voeux, je n'ai qu'un pas à faire pour y
atteindre. Ce combat livré, la guerre est finie, et alors c'est moi
qui donnerai tout ce que ces peuples et ces rois possèdent. O
Thessalie, de quels intérêts les destins le rendent l'arbitre !
mais si ce jour porte avec lui les récompenses de la guerre, il
en prépare aussi les châtiments. Amis, si nous sommes vaincus,
voyez les chaînes de César, les instruments de son supplice ;
voyez sa tête exposée sur la tribune, et tous ses membres dispersés;
voyez surtout l'exécution sanglante qui vous attend au
champ de Mars. Pompée a pris les leçons de Sylla, et c'est pour
vous que cet exemple m'épouvante; mon sort à moi est décidé,
et ma main seule me l'assure. Ceux de vous qui, dans le combat, regarderaient en arrière, me verraient me plonger mon
épée dans le sein. O dieux, dont les malheurs de Rome attirent
les regards, accordez la victoire à celui qui en usera le mieux,
et qui, désarmé par la clémence, ne fera point un crime aux
vaincus d'avoir porté les armes contre lui ! Romains, vous savez
si Pompée, lorsqu'il nous a tenus enfermés dans un lieu où la valeur ne pouvait agir, vous savez s'il nous a fait grâce, s'il a
ménagé notre sang. Loin de l'imiter, je vous conjure d'épargner
tout ce qui fuira devant vous ; dans un fuyard ne voyez plus
qu'un citoyen. Mais tant qu'on vous résistera, que rien ne vous
retienne, pas même la vue d'un père dans les rangs ennemis;
sous les armes, il n'est plus de force respectable. Frappez sans
voir quel est le sang où votre main va se plonger. L'ennemi regardera
comme un sacrilège le meurtre d'un inconnu. Allons,
rasez ce retranchement, comblez le fossé qui l'entoure, afin de
sortir tous ensemble sans vous rompre et vous désunir. Ne ménagez
pas votre camp ; ce soir vous camperez sur le champ de
bataille, dans cette enceinte où vos ennemis viennent périr sous
vos coups. »
A peine il achevait de parler, chacun va prendre son poste,
et se met sous les armes. Ils ont avidement saisi ses paroles
comme autant d'oracles ; et foulant aux pieds les débris de leur
camp , ils se répandent dans la plaine, troupe sans discipline,
et s'abandonnent à leurs destins. Si cette armée eût été composée
de rivaux de Pompée et de prétendants à l'empire, ils
n'auraient pas volé au combat avec plus d'ardeur.
Dès que Pompée les voit marcher droit vers lui, et qu'il n'y a plus moyen de différer la bataille, mais que les dieux en ont
eux-mêmes marqué le jour, la frayeur dont il est saisi le glace
jusqu'au fond de l'âme ; et cette faiblesse, dans un si grand
homme, est un présage malheureux. Mais il dissimule sa crainte,
et se montrant à son armée monté sur un coursier superbe :
« Votre valeur, dit-il, ne demandait qu'une bataille, terme des
guerres civiles, nous y touchons; déployez toutes vos forces;
c'est le dernier de nos travaux. Le sort des nations sera décidé
dans une heure. Que celui qui aime sa patrie et ses dieux, qui
veut revoir sa femme, ses enfants, sa famille, les cherche l'épée
à la main. C'est au milieu de ce champ de bataille que
le ciel a mis tout ce qui vous est cher. La bonne cause a les
dieux pour elle. C'est leur main qui conduira vos traits dans le
coeur de César. C'est de son sang qu'ils cimenteront l'autorité
des lois romaines. S'ils avaient résolu de donner l'empire à
César, ils m'auraient épargné le malheur de vieillir; ce n'est ni
pour Rome ni pour le monde une marque de leur colère que
d'avoir prolongé mes jours. Tout ce qui assure la victoire se
réunit en notre faveur. Une foule d'hommes illustres sont venus
partager nos périls; nous comptons parmi nos soldats les
descendants de ces anciens Romains, dont nous révérons les images. Si les destins rendaient au monde les Curius, les Camilles,
les Décius, tous ces héros de la patrie qui se sont dévoués
pour elle, ils seraient de notre côté. Tous les peuples de
l'Orient, des cités, des États sans nombre, des forces telles que
la guerre n'en a jamais tant rassemblé, se réunissent sous nos
drapeaux. Tout l'univers sert notre cause. Tous ceux qu'embrassent
les signes célestes, depuis le midi jusqu'au nord, tous
nous avons pris les armes. Il suffit que les ailes de notre armée se
déploient, pour envelopper l'ennemi ; César n'a pas de quoi nous
faire face; et tandis qu'un petit nombre des nôtres va combattre,
le reste n'aura qu'à pousser des clameurs pour épouvanter
l'ennemi. Voyez du haut des murs vos mères éplorées et les
cheveux épars se pencher vers vous, et vous tendant les bras,
vous exhorter à les défendre ; voyez ces vieux sénateurs, que
leur grand âge empêche de nous suivre, incliner à vos pieds
leurs têtes vénérables et couvertes de cheveux blancs. Voyez
Rome entière à genoux, et qui tremble d'avoir un maître. Représentez-
vous la race vivante et la race future qui vous demandent
l'une à mourir libre, et l'autre à ne pas naître esclave.
Après de si grands intérêts, si Pompée osait vous parler des
siens, et que la majesté du commandement lui permît de s'abaisser
à la prière, vous le verriez lui-même suppliant à vos pieds avec sa femme et ses enfants. Oui, Romains, si vous
n'êtes vainqueurs, Pompée est exilé, proscrit, le jouet de César
et votre propre honte. C'est tout l'honneur de ma vieillesse et
de ma mort que je vous conjure de sauver. Ne me réduisez pas,
sur le bord de la tombe, au malheur d'apprendre à servir. »
A ce triste discours, tous les coeurs sont enflammés de zèle.
La vertu romaine se ranime; la mort n'a plus rien d'effrayant,
puisque Pompée l'affronte. Les deux partis s'avancent donc
avec une fureur égale, l'un dans la crainte d'avoir un maître,
l'autre dans l'espoir de le devenir.
Leurs mains meurtrières vont causer au monde des pertes
que jamais le temps ni la paix ne pourront réparer. Dans ce carnage
seront enveloppées même les nations futures. Dans l'avenir
la puissance romaine sera mise au nombre des fables : de
tant de villes florissantes, Gabies, Veïes, Cora, Albe, et les pénates
de Laurente, à peine l'Italie conservera-t-elle quelques
ruines qu'on cherchera sous la poussière ; nos campagnes ne
seront plus qu'un immense désert, où le sénat viendra, la nuit,
pour les rites obligatoires imposés par Numa. Ce n'est pas le
temps destructeur qui a dévoré ces villes, réduit en poudre ces
monuments. Non, tant de villes que nous voyons désertes sont le fruit de la guerre civile. Dans quel épuisement n'a-t-elle
pas laissé le genre humain! Tout ce que la nature a fait depuis
pour le renouveler n'a pas suffi pour repeupler nos villes. Rome
seule nous contient tous; l'Hespérie n'est cultivée que par des
esclaves ; les toits de nos pères peuvent accomplir leur chute
imminente, ils n'écraseront personne; au lieu de citoyens,
Rome n'a plus que la lie du monde; et cette calamité l'a réduite
au point de ne pouvoir, un siècle après, avoir une guerre
civile (1).
1 Plularque (Vie de Jules César) : « Dans le dénombrement des citoyens qu'on fit après la guerre civile, au lieu de trois cent vingt mille chefs de famille qui étaient à Rome, il ne s'en trouva plus que cent oinquante mille, sans compter les pertes du reste de l'Italie et des autres provinces romaines. »
Cannes, Allia, noms funestes, les revers que vous rappelez
sont peu de chose auprès de celui-ci. Rome vous a inscrits
dans ses fastes; mais Pharsale n'y sera point nommée.
O cruelles destinées! L'air empoisonné, la peste, la faim, l'incendie,
les tremblements de terre qui ébranlent les cités, il
n'est point de fléau dont le monde n'eût pu réparer les ravages
avec le sang que ce jour vit couler. La fortune, ô Rome! semble
avoir voulu étaler à tes yeux tous les dons qu'elle t'avait faits,
et rassembler dans un même champ les peuples et les rois
qu'elle t'avait soumis, pour te faire voir en tombant toute la
hauteur de ta chute, et contempler dans tes ruines l'étendue de
ta grandeur. Elle semble n'avoir élevé si rapidement ta puissansee que pour la renverser avec plus d'éclat. Tous les ans la
guerre avait étendu tes conquêtes et ton empire ; les deux pôles
du monde avaient vu la victoire suivre tes aigles. Il ne te restait
plus à soumettre qu'un coin de l'Orient, alors la nuit, le
jour, l'air ne tournaient plus que pour toi, les astres n'éclairaient
plus que des provinces romaines. Mais un jour fait rétrograder
tes destins, et seul il détruit l'ouvrage de tant d'années.
Ce jour affreux est cause que l'Indien ne redoute plus nos faisceaux;
que le Scythe et le Sarmate errant n'ont point vu la
charrue de nos consuls leur tracer l'enceinte des villes où ils
devaient se renfermer, et que le Parthe jouit impuni de la défaite
de Crassus. Le même jour a vu la liberté, épouvantée de
la guerre civile, s'éloigner de nous, et se retirer au delà du
Tigre et du Rhin. Le Scythe, le Germain en jouissent ; et nous
qui tant de fois l'avons redemandée à la hache du bourreau,
nous avons beau la rappeler, elle ne daigne pas même tourner
les yeux vers l'Italie. Plût aux dieux que Rome ne l'eût
jamais connue, depuis le jour où Romulus, docile aux présages
indiqués par le vol du vautour, éleva ses remparts dans
le bois infâme, jusqu'au jour du désastre de Pharsale! O Fortune, tu nous réduis à nous plaindre de Brutus ! Pourquoi avons-nous si longtemps vécu sous le juste empire des lois, et
vu ces années qui portent le nom de nos consuls? Plus heureux
l'Arabe et le Mède, et tous les peuples de l'Orient, de ne connaître
que la tyrannie ! De toutes les nations qui servent sous
un maître, Rome est la plus malheureuse, puisqu'elle a honte
de servir. Non, il n'est point de dieu qui veille sur les hommes.
C'est le hasard qui préside à tout; et nous mentons en attribuant
le soin du monde à Jupiter. Quoi ! la foudre en main, il
sera du haut des deux tranquille spectateur des crimes de
Pharsale! Il lancera ses traits vengeurs sur Pholoé, sur l'OEta
et sur le Rodope qui n'ont jamais pu l'irriter; il exercera son
courroux sur de hauts pins, sur de vieux chênes, et laissera à
Cassius le soin de frapper César! Il refusa, dit-on, la lumière
du jour au festin de Thyeste; il répandit sur Àrgos une soudaine
et profonde nuit ; et ces champs qui vont être couverts
de mille parricides, où le père, le fils, le frère vont s'égorger,
il peut souffrir que le jour les éclaire! Non, les dieux sont insensibles
au sort des malheureux humains. Mais autant qu'on
peut être vengé des immortels, nous le serons : la guerre civile
placera nos tyrans à côté d'eux sur les autels. Il y aura des
mânes couronnés de lumière; ils auront la foudre à la main ;
et dans les temples de ses dieux Rome jurera par des ombres. Quand les deux armées eurent franchi l'espace qui les séparait,
et qu'il ne resta plus qu'un étroit intervalle, chacun tachait
de reconnaître l'ennemi qui lui faisait face, de voir à qui s'adressait
le javelot qu'il allait lancer, de quelle main partirait
celui dont il était menacé lui-même. Le père se trouve en présence
du fils, le frère en présence du frère, sans qu'ils osent
changer de place. Cependant une soudaine horreur les saisit ;
et au fond de leur coeur, où frémit la nature, leur sang se retire
glacé. On vit les cohortes, le bras tendu, suspendre immobile
le javelot, prêt à partir.
Que les dieux te punissent, non par le trépas, qui est la peine
commune à tous, mais en te laissant, après la vie, le sentiment
et le remords, ô Crastinus, toi dont la lance en partant donna
le signal du carnage (1), et la première rougit la Thessalie de sang
romain.
1 Ce que le poète raconte de Crastinus est d'accord avec l'histoire. Florus (liv. IV) : « Crastinus engagea le combat en lançant le premier son javelot. » César (Guerre civ., liv. III).
O rage impatiente! quoi, César même retient ses
traits, et une autre main que la sienne donne l'exemple! Alors
les trompettes sonnent la charge, le son perçant des clairons
fend les airs, un bruit effroyable s'élève jusqu'aux cieux et va
frapper la voûte lointaine de l'Olympe qui ne connaît ni les
nuages, ni les fracas de la foudre; les vallons de l'Hémus, les cavernes du Pélion. les rochers du Pinde, de l'OEta et du Pangée
en retentissent; et ce cri de fureur, mille fois redoublé, revient
plus effrayant encore aux oreilles des combattants. Des flèches
innombrables volent des deux côtés; les unes désirent frapper,
les autres en tombant ne percent que la terre, et les mains qui
les ont lancées sont encore innocentes, tout marche au hasard
et la fortune fait à son gré des coupables. Mais le fer volant
n'exécute que la moindre partie du carnage. L'épée seule est
assez meurtrière pour assouvir la rage des deux partis; elle
conduit la main qui l'enfonce dans le flanc fraternel.
Du côté de Pompée, les rangs pressés se tiennent à couvert
de leurs boucliers unis ensemble. Cette armée reste immobile,
ayant à peine assez d'espace pour remuer ses armes, et le glaive
est oisif dans la main du soldat qui en craint la blessure. Mais
ceux de César, comme des forcenés, se précipitent sur ces
masses profondes. Ils s'efforcent de rompre ces épais bataillons,
et malgré l'airain qui les couvre, l'épée et la lance pénètrent,
et la pointe homicide va jusque sous l'armure se tremper dans
le sang et porter la mort. L'une des deux armées livre le combat,
et l'autre le soutient. D'un côté l'épée, est immobile et
froide, de l'autre elle, est fumante et trempée de sang. La fortune ne balance pas longtemps d'aussi grands intérêts, et le
torrent du destin entraîne de vastes ruines. Mais la cavalerie
de Pompée, secondée de ses alliés, se déploie sur l'une des ailes
pour attaquer en flanc et pour envelopper l'aile opposée de
l'armée ennemie. Ce fut là qu'on vit toutes les nations étrangères réunir leurs forces contre les Romains. De toutes parts
volent les flèches, les cailloux, les torches et les globes de
plomb qui, par leur rapidité, deviennent brûlants dans les airs.
Là, les Syriens, les Modes, les Arabes sans ordre et sans frein
décochent leurs dards sans viser au but; c'est vers le ciel qu'ils
les dirigent, et ils font pleuvoir sur l'ennemi une grêle de traits
mortels. Mais ces traits, lancés par des mains étrangères, se
trempent sans crime dans le sang romain; l'atrocité de la
guerre civile n'est attachée qu'à nos propres armes. Cependant
l'air paraît tissu de flèches, et l'épais nuage qu'elles forment
pèse sur la plaine.
César craignant que sa première ligne ne s'ébranlât sous le
choc, fait avancer d'un pas oblique, et derrière ses étendards,
six cohortes qui tout à coup, sans déranger le front de son
armée, chargent la cavalerie de Pompée déjà éparse dans la
plaine, et rompue par escadrons. Tous les alliés de Pompée renonçant au combat et perdant toute honte, prirent la fuite
comme des lâches, et firent voir qu'il ne fallait jamais confier
à des étrangers le sort des guerres civiles.
Dès qu'on vit les chevaux mortellement blessés jeter à bas
leurs maîtres, et se rouler sur eux ou les fouler aux pieds, toute
la cavalerie éperdue tourne le dos, et les premiers rangs, repliés
l'un sur l'autre en tumulte, se précipitent sur les derniers,
qu'ils rompent eux-mêmes en fuyant. Dès lors la déroute est
entière ; c'est un massacre, et non pas un combat. D'un côté,
on tendait là gorge, de l'autre, on enfonçait le fer. Une armée
suffit à peine à frapper tout ce qui dans l'autre se présente à
ses coups. Et plût aux dieux, Pharsale, que ce sang étranger fût
le seul qui engraissât tes plaines, et que des flots d'un sang plus
précieux ne dussent.pas les inonder! Qu'il te suffise d'être couverte
des ossements de ces Barbares, ou, si tu aimes mieux
que tes champs soient engraissés du meurtre des Latins, épargne
au moins tant d'autres peuples; laisse vivre les Galates, les
Syriens, les Cappadociens, les Gaulois et les Ibères relégués aux
confins du monde, et les Arméniens et les Ciliciens; après la
guerre civile, Ces nations seront le peuple Romain.
L'alarme une fois donnée, la terreur se répand, et les destins
déclarés pour César ont pris le cours le plus rapide. On arrive au centre des forces de Pompée, au milieu de ses légions. C'est
ici que s'arrête la guerre, et que la fortune de César hésite au
moins quelques instants. Ce n'est plus cet amas de peuples et
de rois qui ont si mal défendu Pompée, c'est Rome et le Sénat
qui combattent. Ici les frères, les pères, les enfants se joignent ;
ici se rassemblent la fureur, la rage et tous les crimes de
César. O ma pensée, écarte loin de toi ce moment affreux de la
guerre ! que les ténèbres l'ensevelissent ; que l'avenir n'apprenne
pas de moi à que! excès peut se porter la fureur des guerres civiles.
Ah! périssent plutôt mes larmes, périssent mes plaintes.
Oui, Rome, je veux taire ce que tu as fait dans cette bataille.
On y voit César animant la fureur du peuple pour ne rien perdre
de ses forfaits, voler autour des bataillons, et verser encore
un nouveau feu dans les esprits échauffés au carrnage; son oeil
observe et distingue, parmi cette forêt de glaives, ceux qui se
sont plongés tout entiers dans le sang, et ceux dont la pointe
seule en est rougie, et l'épée qui tremble dans la main, et celle
qui frappe sans hésiter, et les traits lancés mollement, et ceux
qui partent d'un vol rapide, et ceux d'entre les soldats qui
combattent avec joie, et ceux qui ne font qu'obéir et qui sont
cruels à regret, et qui changent de visage, en voyant tomber à leurs pieds les citoyens percés de coups. Il parcourt les cadavres
épars dans cette vaste plaine; il ferme lui-même les plaies
de ceux des siens qui respirent encore et qui perdent leur sang;
il est partout, il erre au fond de la mêlée, comme on nous
peint Bellone secouant son fouet, ou Mars au milieu des
Thraces qu'il irrite, Mars aiguillonnant ses coursiers que la vue
de l'Égide épouvante.
Ce n'est plus qu'un chaos de meurtres et de crimes, un vaste
et long mugissement. A cette immense et lugubre plainte se
mêle le bruit des épées et le fracas des armes des combattants
qui tombent, et qui du sein frappent la terre. L'épée brise l'épée.
Dans ce tumulte, on voit César ramassant lui-même les glaives
et les traits qu'il tend à ses soldats, en leur criant de frapper au
visage. Il presse, excite ses troupes; il les pousse en avant, et
du bois de sa lance il réveille le soldat engourdi. Il défend de
toucher les plébéiens ; c'est au sénat qu'il veut qu'on s'attache.
Il sait trop où réside la vie de l'État, l'âme des lois; il sait
par quel endroit il faut attaquer Rome et quels seront les coups
mortels pour la patrie et pour la liberté. L'ordre consulaire
tombe confondu avec celui des chevaliers; le fer tranche les
têtes sacrées. On égorge les Lépidus, les Métellus, les Corvinus,
les Torquatus, ces défenseurs des lois et les plus grands des hommes après toi, Pompée. O Brutus! ô toi, le dernier de ce
nom à jamais illustre, toi, l'honneur de la république et l'unique
espoir du sénat, ici, le visage caché sous le casque d'un légionnaire,
inconnu aux yeux de l'ennemi, quelle épée tu tiens dans
ta main vengeresseI Ah! garde-toi de te jeter en téméraire au
milieu de ces bataillons. La Thessalie sera ton tombeau; mais il
n'est pas temps, ménage-toi jusqu'à Philippes. Ici tu chercherais
en vain à percer le coeur de César. Il n'est pas encore arrivé au
comble de la tyrannie; il faut, pour mériter de mourir de la
main, qu'il franchisse les bornes de la grandeur humaine, qu'il
vive et qu'il règne pour être une victime digne de Brutus (1).
1 Plutarque (Vie de
Brutus) : « Pompée avait fait mourir le père de Brutus; mais estimant
qu'il fallait préférer les affections publiques aux affections privées,
et se persuadant que la cause qui avait fait prendre les armes
à Pompée, était meilleure et plus juste que celle de César, Brutus se
rangea du côté de Pompée. Néanmoins, chaque fois qu'il le rencontrait,
il ne le daignait pas seulement saluer, pensant que ce serait à
lui un grand péché que de parler au meurtrier de son père. » —
« César recommande à ses capitaines et chefs de cohorte de se bien
garder de tuer Brutus : « Amenez-le-moi, dit-il, s'il se rend volontairement ; mais s'il se met en défense pour n'être pas pris, laissez-le
aller sans lui faire aucun mal. » On dit qu'il en agissait ainsi pour
l'amour de Servilia, mère de Brutus. » Ibid.)
— « Parmi ceux à
qui César fit grâce et qu'il reçut à son amitié, était Brutus, celui qui
le tua... lequel s'étant venu rendre à lui, il en fut fort joyeux. » (Vie de
César.) Dans d'autres sentiments que ceux de notre poëte, (Vell. Patereulus
(liv. II, ch. LII) dit, au sujet du meurtre de César par Brutus : "
Dieux immortels ! quel prix préservait Brutus à l'affection du vainqueur,
à sa bonté !"
Là périt l'élite de la noblesse romaine; les cadavres des Pères Conscrits sont entassés avec ceux du peuple. Dans le massacre de tant d'hommes illustres, on distingua la mort de ce vaillant Domitius, que sa fatale destinée traînait de défaite en défaite. On eût dit que sa présence était partout funeste aux armes de Pompée; tant de fois vaincu par César, il a du moins l'avantage de mourir libre. Percé de coups, il succombe, avec la joie de n'avoir pas une seconde grâce à recevoir. César qui le voit se rouler dans son sang, l'insulte et lui dit : "Eh bien ! Domitius, mon successeur (1), tu désertes les drapeaux de Pompée, et la guerre se fera sans toi. »
1 Domitius avait été nommé son successeur dans le gouvernement de la Gaule.
Un souffle de vie qui reste à Domitius,
lui suffit pour se faire entendre; sa bouche expirante s'entr'ouvre,
et il répond à César : « En descendant chez les morts,
libre, irréprochable et fidèle à Pompée, j'ai la consolation,
César, de te laisser, non pas jouissant du fruit de tes forfaits,
mais encore incertain de ton sort et au-dessous de ton rival. Il
m'est permis, en mourant, d'espérer que Pompée et les siens
obtiendront des dieux ton supplice et notre vengeance. » En
achevant ces mots, la vie l'abandonne, et les ténèbres éternelles
s'appesantissent sur ses yeux.
Dans ces funérailles du monde j'aurais honte de donner des
larmes à ces morts innombrables, d'observer d'un oeil curieux
chacun des mourants, et de dire comment et de quels coups
tel ou tel est frappé ; quel soldat, foule aux pieds ses propres
entrailles éparses sur le sol; quel autre rejette avec le souffle
vital le trait enfoncé dans sa gorge; qui tombe sous le coup;
qui reste encore debout, quand tombent ses membres mutilés;
quelles poitrines sont percées par le dard ou clouées sur le sol
par la flèche; quelle veine rompue laisse le sang jaillir dans l'air
et arroser les armes de l'ennemi ; qui perce le sein de son frère, lui tranche la tête et la jette au loin, pour le dépouiller comme
un inconnu ; qui déchire le visage de son père, de peur qu'on
n'aperçoive que c'est son père qu'il égorge : aucun de ces excès
de rage, aucun de ces genres de mort n'est digne d'occuper nos
plaintes, et ce n'est pas sur quelques hommes que nous devons
gémir. Pharsale ne ressemble point à tant d'autres batailles funestes.
Là, Rome ne comptait ses pertes que par le nombre des
soldats; ici, elle compte par le nombre des peuples; là c'était
la mort des citoyens ; ici, c'est la mort d'une nation entière. Au
lieu du sang de quelques provinces, Achaïe, Pont, Assyrie, c'est
tout le sang des nations qui coule, et celui des Romains se mêlant
à ses flots, les grossit et presse leur cours. Ce combat seul
excède les pertes qu'un siècle pouvait soutenir; ses coups s'étendent
au delà des vivants; le monde à naître en est frappé
lui-même, et le glaive y range au nombre des vaincus cette longue
suite d'esclaves qui, dans tous les âges, serviront nos tyrans.
O Romains! comment vos enfants, comment vos neveux ont-ils
mérité de naître pour la servitude? Est-ce nous qui avons
combattu lâchement à Pharsale? est-ce nous qui avons reculé
devant les glaives de César? Hélas! ce joug mérité par la lâcheté
de nos aïeux s'est appesanti sur nos têtes. O Fortune ! en
donnant un maître aux fils des vaincus, que ne leur laissais-tu
la guerre! Déjà Pompée a reconnu que les dieux et les destins de Rome
ont changé de camp, mais à peine sa défaite le force-t-elle à renoncer
à sa fortune. Il s'arrête sur une éminence d'où il découvre
ce qu'il n'a pu voir dans le tumulte du combat, toutes
ses légions rompues et dispersées dans les campagnes. Il voit
combien de têtes il a fallu abattre avant d'arriver à la sienne;
combien d'hommes ont péri pour un seul ; combien de sang sa
ruine a couté. Mais loin de s'applaudir, comme il arrive aux
malheureux, d'entraîner tout dans son naufrage et d'envelopper
dans sa perte tant de peuples et tant de rois, pour obtenir que
le plus grand nombre de ses défenseurs lui survive, il se résout
encore à adresser des voeux aux dieux cruels qui l'ont trahi ;
et pour toute consolation, il leur demande le salut du monde.
« Grands dieux! dit-il, épargnez ces peuples! Pompée peut
être malheureux sans que Rome et l'univers périssent. Si vous
voulez me frapper encore, j'ai une femme, j'ai des enfants,
otages livrés aux destins. N'est-ce pas assez de moi et des
miens pour assouvir la guerre civile ? Notre perte, sans celle
des nations, sera-t-elle trop peu pour vous? O Fortune! pourquoi
t'obstiner à tout détruire? rien au monde n'est plus à
moi. »
Il dit, et parcourant ses troupes battues et dispersées, il les rappelle du combat où elles courent à une mort certaine. Il dit
hautement que c'en est trop pour lui. II ne manquait à ce héros
ni la volonté, ni la force de se jeter au milieu des glaives, la
gorge et le sein découverts ; mais il craignait qu'en le voyant
tomber son armée ne pût se résoudre à la fuite et, que le monde
tombât sur le corps de son général. Peut-être voulait-il dérober
sa mort aux yeux de César; mais en vain : le malheureux,
dans quelque lieu qu'il meure, sa tête sera livrée à son beau-père
qui en repaîtra ses regards. Toi-même contribues à sa
fuite, ô Cornélie ! il doit te voir encore, le sort veut qu'il meure
près de toi, près de toi, absente à Pharsale.
Le coursier que monte Pompée l'éloigné du combat ; le héros
se retire, mais sans appréhender les traits qui volent après lui ;
et conservant dans le malheur extrême une âme plus forte que
le malheur, il ne lui échappe ni larmes, ni gémissements, c'est
une douleur vénérable qui lui laisse toute sa majesté, une douleur
telle, Pompée, que tu la devais aux calamités de Rome.
Pharsale ne t'a point vu changer de visage; et autant l'infidèle
Fortune t'a vu au-dessus d'elle durant le cours de tes triomphes,
autant tu lui es supérieur encore au comble de l'adversité. Tu
t'en vas libre et délivré du poids d'une grandeur qui t'accablait. C'est à présent que tu peux tout à loisir te rappeler tes jours
prospères. Cette espérance qui ne devait jamais se remplir,
t'abandonne, et l'ambition de ce que tu voulais être ne t'empêche
plus de voir tout ce que tu as été.
Fuis, Pompée, fuis les sanglants combats, et prends les dieux
à témoin que désormais, si l'on poursuit la guerre, ce n'est
plus pour toi. Le reste de cette bataille, après ta fuite, doit
aussi peu s'imputer à toi, que les nouveaux revers que Rome
éprouvera dans l'Afrique, à Munda, sur le Nil. Le nom de Pompée
volant de bouche en bouche, ne sera plus dans l'univers le
cri d'alarme, le signal des batailles; les deux champions désormais
seront César et la Liberté : la guerre entre eux est implacable
; et le Sénat, en ton absence, prouvera en mourant que
ce n'est pas pour toi, mais pour lui qu'il a combattu. O Pompée,
n'es-tu pas heureux de l'éloigner par l'exil de ce carnage?
de n'avoir pas sous les yeux ces forfaits, et de ne pas voir ces
cohortes écumant de rage ? Regarde ces fleuves dont les eaux
sont rougies et fumantes, et porte compassion à César. De quel
coeur le malheureux va rentrer dans Rome, après ce coupable
succès! Compare son sort avec le lien; et l'abandon, l'exil chez
des peuples barbares, le complot même d'un roi perfide et son
exécrable attentat, tout ce qui te reste à souffrir te paraîtra une
faveur des dieux. Tout cela vaut mieux qu'une telle victoire. Défends aux peuples de te donner des larmes, apprends à l'univers
à respecter en toi les revers comme les succès ; aborde
les rois d'un visage tranquille, et qui n'ait rien d'un suppliant ;
parcours les villes que tu as possédées, les royaumes que tu as
donnés, l'Egypte, la Libye; et choisis la terre où tu veux
mourir.
Larisse (1) la première, témoin de ta chute, voit cette tête auguste,
dont le malheur n'a point abattu la fierté.
1 C'était la seule ville de Thessalie qui, à l'arrivée de César, ne se fût pas rendue à lui.
Dans cette
ville, qui lui est fidèle encore, les citoyens se répandent en foule,
et volent au-devant de lui comme s'il était triomphant. Ils lui
apportent en pleurant leurs richesses ; ils lui ouvrent leurs maisons
et leurs temples; ils demandent à partager ses périls : il
lui reste encore, disent-ils, assez de la splendeur de son nom, et
Pompée, tout malheureux qu'il est, ne se voit inférieur qu'à
lui-même. Il ne tient qu'à lui de ramener les nations au combat,
de lutter de nouveau contre les destinées. « Que me servirait,
dit-il, dans l'état où je suis, ce zèle généreux que vous
me témoignez? Peuples, donnez-vous au vainqueur. » O César!
dans le moment même que sur des monceaux de morts, tu
achèves de déchirer les entrailles de ta patrie, ton gendre te
cède l'univers ; mais bientôt il s'éloigne sur son coursier, accompagné
des gémissements et des larmes d'un peuple qui reproche aux dieux leur rigueur. C'est là, Pompée, que tu l'éprouves
dans toute sa pureté, cet amour du monde, que tu as
dans tous les temps recherché avec tant de soin ; c'est à présent
que tu en goûtes les fruits : l'homme heureux ne sait pas si on
l'aime.
Lorsque César croit avoir fait couler assez de sang latin dans
la Thessalie, pour laisser reposer le glaive dans les mains de
ses soldats, il laisse la vie au reste de l'armée, comme à une
multitude vile qui périrait inutilement. Mais de peur que le
camp ne rassemble les fugitifs, et que le calme de la nuit ne
fasse cesser l'épouvante, il se hâte de s'emparer des retranchements
ennemis, tandis que la fortune le seconde et que la
terreur lui livre le vaincu. Il ne craint pas que ses soldats, lassés
de la bataille, soient rebutés de ce nouvel ordre ; il n'a pas
même besoin d'une longue harangue pour les mener au butin.
« Compagnons, dit-il, la victoire est complète : il ne reste plus
qu'à payer votre sang; car je n'appelle pas. vous donner, ce
que chacun va se donner lui-même. Voici un camp ouvert
et abandonné, qui regorge de trésors : là, se.trouve amassé tout
l'or de l'Italie; sous ces tentes sont accumulées toutes les richesses
de l'Orient. La fortune de vingt rois et celle de Pompée
réunies attendent des maîtres. Hâtez-vous de prévenir ceux que vous chassez devant vous. Ne laissez pas aux vaincus le temps
de vous enlever leurs dépouilles. »
Il n'en fallut pas davantage pour engager ces furieux, que
dévorait la soif de l'or, à se précipiter à travers les débris des
armes, et sur les corps sanglants des sénateurs et des chefs
qu'ils foulaient aux pieds. Quelle
tranchée ou quel rempart arrêterait
ces hommes, qui courent à leur proie, et au salaire de
leurs forfaits? Ils brûlent de savoir à quel prix ils se sont rendus
coupables. Ils trouvèrent à la vérité de grandes richesses
dont on avait dépouillé le monde, pour fournir aux frais de la
guerre; mais ce n'était pas assez pour assouvir leur cupidité;
et en ravissant tout l'or qu'ont produit les mines de l'Ibère,
tout celui qu'a produit le Tage, et que l'Arimaspe a laissé sur
ses bords, le soldat se plaint que c'est peu pour récompenser
tant de crimes. César a promis, s'il était vainqueur, de leur
livrer le Capitole, et de mettre Rome entière au pillage; il les
trompe en ne leur donnant que le camp à saccager.
Des cohortes impies dorment sous les tentes des sénateurs;
de vils soldats occupent les couches des rois ; le soldat parricide
repose sur le lit de son père et de ses frères. Mais leur repos
est un affreux délire, leur sommeil un accès de fureur. Les malheureux roulent dans leur esprit toutes les horreurs de
Pharsale. Le crime atroce veille au fond de leur âme. Ils se
battent en songe, et leur main serre la poignée du glaive qu'elle
croit tenir. On dirait que ces campagnes gémissent, que cette
terre coupable enfante des ombres, que l'air est souillé par les
mânes, et que l'effroyable nuit des enfers s'est répandue dans
le ciel. La victoire tourmente et punit les vainqueurs. Le sommeil
ne leur fait entendre que le sifflement des serpents des
Furies, ne leur fait voir que leurs flambeaux. L'ombre des citoyens
qu'ils viennent d'égorger, leur apparaît ; chacun a sur
lui sa victime qui le presse. L'un reconnaît les traits d'un vieillard,
l'autre ceux d'un jeune homme. L'un est poursuivi par le
cadavre de son frère, l'autre a son père dans le coeur; et tous
ces spectres réunis assiègent l'âme de César. Le Pélopide Oreste,
Penthée dans sa fureur, Agave revenue de son délire, n'étaient
pas plus effrayés à l'aspect des Euménides vengeresses. Tous
les glaives qu'a vu tirer Pharsale, tous ceux que le jour de la
vengeance verra briller dans le Sénat, César les voit cette nuit
en songe, il se sent déchiré par les fouets vengeurs des furies.
Ah! si, du vivant de Pompée tel est pour lui le tourment des remords,
s'il a déjà tout l'enfer dans le coeur, quel sera bientôt son
supplice ! Mais enfin délivré des tourments du sommeil, dès que la lumière
du jour éclaire les, champs de Pharsale, il y promène ses
regards que n'effraient pas ces spectacles d'horreurs. Il voit les
fleuves qui roulent du sang, des tas de cadavres amoncelés jusqu'au
sommet des collines, ces morts en pourriture, il compte
les peuples de Pompée; il fait préparer pour le festin (1) un lieu
d'où il pourra reconnaître le visage des victimes; joyeux, il ne
voit plus l'Émathie, les cadavres lui cachent la vue de la plaine.
1 Remarquons ici, pour être juste, que tout cela n'est qu'une satire amère dirigée contre le destructeur de la liberté de Rome. L'histoire ne le confirme point ; elle fait plus, elle le dément, et César, il faut le dire, était trop adroit, trop politique pour en user ainsi : c'eût été se rendre odieux au monde.
Il reconnaît dans le sang sa fortune et ses dieux. Il va jusqu'à leur refuser les honneurs de la sépulture (1).
1 Ce fait est démenti par Appien. Vell. Paterculus (liv. Il, ch. LII) dit, contrairement au poète : « Quoi de plus admirable, de plus éclatant, de plus glorieux que cette victoire ! La patrie n'eut à pleurer que des citoyens tués en combattant. Mais une fureur obstinée rendit la clémence inutile, les vaincus trouvant moins de plaisir à recevoir la vie, que les vainqueurs à la donner. » (Trad. de Després.)
L'exemple même d'Annibal, qui avait rendu ces devoirs funèbres au consul, ne le touche point. Il excepte ses concitoyens d'un droit commun à tous les hommes. Cruel, nous ne demandons pas autant de bûchers qu'il y a de morts, mais un seul qui consume à la fois tous ces peuples. Fais seulement entasser sur eux les forets de l'OEta ou du Pinde: et si tu veux encore ajouter au malheur de Pompée, qu'il en découvre la flamme du milieu des mers. Quelle vengeance veux-tu tirer des morts? 11est égal pour eux que ce soit l'air ou le feu qui les consume. Tout ce qui périt est reçu dans le sein paisible de la nature, et les corps subissent d'eux-mêmes la loi de leur dissolution. Si ce n'est pas aujourd'hui qu'ils brûlent, ce sera quand la terre et les eaux brûleront, dans cet embrasement du monde, où la poussière de nos ossements et la cendre des globes célestes se mêleront dans un même bûcher. Les mânes de tes ennemis et les tiens n'auront qu'un même asile; tu ne t'élèveras pas plus haut vers le ciel; tu n'auras pas une meilleure place que les vaincus dans l'éternelle nuit. La mort n'est point esclave de la fortune. La terre engloutit tout ce qu'elle engendre, et celui des morts qui n'a point d'urne, repose sous la voûte du ciel. Mais, toi qui punis tant de nations en les privant de la sépulture, d'où vient que tu t'éloignes? que ne demeures-tu dans ces champs empestés? Bois, si tu l'oses, ces eaux sanglantes ; respire cet air, si tu le peux. Ces cadavres te forcent à leur céder Pharsale. Le champ de bataille leur reste : ils en ont chassé le vainqueur. L'odeur de cette proie immense attire, les loups de la Thrace et les lions de Pholoé. L'air impur qui sème la contagion appelle toutes les bêtes à l'odorat subtil. Les ours quittent leurs tanières, les chiens sinistres, leurs toits domestiques. Les oiseaux voraces qui avaient suivi les camps des deux armées, se rassemblent. Et vous, voyageurs ailés, qui fuyez pour le Nil, la Thrace et ses frimas, vous retardez votre course vers les tièdes rives du Sud. Jamais de si épaisses nuées d'aigles et de vautours n'avaient pressé l'air de leurs ailes, ni obscurci la lumière du ciel. Des légions d'oiseaux ravisseurs s'élancent des forêts voisines, et une rosée de sang distille de tous les arbres où s'est réposé leur ongle sanglant; souvent même sur les enseignes et sur la tête des vainqueurs, ils laissent tomber du haut des airs des lambeaux sanglants, dont leurs griffes se lassent de porter le poids, et pourtant il ne reste de ce peuple d'autres débris que les os décharnés. Les bêtes ne suffisent pas à cette pâture, elles dédaignent de fouiller les entrailles, et d'épuiser le coeur sous leur lèvre avide ; elles savourent les membres ; une foule de cadavres gisent abandonnés. Le soleil, la pluie, le temps, les mêlent, en pleine dissolution, aux champs Émathiens. 0 malheureuse Thessalie ! par quel crime as-tu irrité tes dieux, pour être chargée de tant d'horreurs ? Combien de siècles s'écouleront, avant que l'avenir te pardonne les malheurs de cette guerre ? Peux-tu produire des moissons qui ne soient pas empoisonnées, et souillées de taches de sang? Le soc peut-il ouvrir ton sein, sans troubler le repos des mânes? Hélas ! avant que tes campagnes Inondées de sang soient desséchées, une nouvelle guerre va les en arroser. Quand Rome rassemblerait les cendres que renferment tous ses tombeaux, cet amas n'égalerait point les monceaux de cendres romaines, que sillonne ici la charrue, ni les tas d'ossements blanchis que brise le fer du laboureur. Jamais aucun vaisseau n'eût osé aborder à ce rivage malheureux; jamais le soc n'eût soulevé, cette abominable terre; les peuples auraient abandonné ces champs habités par les mânes; aucun pasteur n'eût laissé paître à ses troupeaux des herbages engraissés de sang ; et pareille à ces contrées que les feux brûlants du soleil, ou que les glaces d'un éternel hiver rendent inhabitables, la Thessalie serait déserte, si ces campagnes étaient les seules que la guerre civile eût souillées. Mais les dieux n'ont pas voulu donner au reste de la terre le droit de les détester; ils égalent tous les climats en les chargeant des mêmes crimes, et Munda, Mutine, Actium, nouveaux théâtres de nos malheurs, feront pardonner aux champs de Philippes.

Fuite de Pompée; il franchit les vallons de Tempé : il s'épouvante du bruit
qui se fait sur ses pas. — Sa pensée se reporte vers l'époque de ses triomphes :
sa félicité passée s'est changée en opprobre. — Il arrive aux bords de la mer;
il se jette dans une barque et fait voile vers Lesbos. — Cornélie; ses mortelles
inquiétudes. — Le navire aborde, Cornélîe s'élance aussitôt et tombe en défaillance.
— Enfin, elle reprend ses sens. — Discours du héros. — Cornéiie laisse
tomber quelques plaintes entrecoupées de saogUds. — Pompée est attendri : tous
les assistants fondent en pleurs. — Bon accueil du peuple de Mitylène. —Offres
de service ; Pompée refuse et remet à la voile. — On voit s'éloigner avec douleur
Cornélîe : son éloge. — Navigation de Pompée; ses entretiens avec le
pilote. — Il est rejoint par son fils, par la foule des grands qui lui est restée
fidéle. — Discours qu'il adresse à Déjotarus, en lui prescrivant d'aller au fond
de l'Asie chercher de nouveaux secours. -— Déjotarus part. — Pompée poursuit
sa course; il arrive à Syédra; il y délibère sur le parti qu'il doit prendre : son
discours aux grands assemblés. — On improuve son dessein. — Lentulus ouvre
un second avis : son discours. — Il entraîne tous les esprits. — On décide d'aller
en Egypte. — Enfin, on touche au rivage de Péluse. — Effroi de Ptolémée à la
nouvelle de l'arrivée de Pompée. — Son conseil délibère. — Achorée rappelle
les bienfaits de Pompée; mais Pothin ose proposer le meurtre du héros : son
discours. — On applaudit au crime. — Apostrophe véhémente du poète à Ptolémée.
— Le héros s'apprête à descendre : une barque s'avance au devant de lui,
chargée de ses assassins : on l'invite à y descendre. — Pompée cède à ses
funestes destins : il préfère la mort à la crainte. — Reproches de Cornélie. —
Sa prière n'est point écoutée. — Septimius, Achillas. — Le héros tombe frappé.
— Cornélîe est témoin de l'affreux spectacle : ses douleurs. — Le vaisseau
s'éloigne emportant Cornéile. — La tête de son époux est mise au bout d'une
lance et présentée à Ptolémée. — Funérailles de Pompée. — Cordus. — Discours
des généraux romains. -— Apostrophe du poëte à Cordus : il le rassure contre le
châtiment qu'il redoute. — L'exiguïté du tombeau de Pompée ne nuira point à
sa mémoire. — L'Egypte redira, au sujet de sa sépulture, les merveilles que la
Crète raconte du tombeau de Jupiter.
À travers les bois de Tempé, au delà de l'étroit passage ouvert
par Alcide, gagnant les gorges désertes de la forêt d'Hémonie, Pompée excite son coursier déjà excédé de fatigue, et
s'efforce par de longs détours de dérober les traces de sa fuite
au vainqueur: Le bruit des vents dans les forêts, le pas de ses
compagnons l'épouvante, le met hors de lui. Quoique déchu de
sa grandeur, il sait de quel prix est encore sa vie; et ne doute
pas que César ne payât sa tête aussi cher qu'il payerait celle de
César. Mais il a beau chercher des routes solitaires, c'est un
nom trop célèbre que celui de Pompée. Les peuples d'alentour,
qui accourent à son camp, et à qui la renommée n'a pas encore
annoncé sa défaite, le rencontrent, s'étonnent, ne peuvent concevoir
un renversement si rapide dans la fortune de ce grand
homme, et ont peine à le croire lui-même, quand il leur dit
ses désastres. Dans l'état où il est réduit, les témoins l'importunent;
il aimerait mieux être inconnu partout, et pouvoir
traverser le monde en sûreté à la faveur d'un nom obscur.
Mais la Fortune punit de ses propres bienfaits les malheureux
qu'elle abandonne; elle surcharge l'adversité du poids d'une
renommée éclatante, et insulte au bonheur passé. A présent,
Pompée reconnaît que ses prospérités ont été trop rapides, il se
plaint de l'éclat de ses premiers triomphes sous les drapeaux de Sylla; aujourd'hui, les flottes battues à Coryce et les trophées
du Pont pèsent à sa grandeur déchue. C'est ainsi que le malheur
d'avoir trop vécu a obscurci la gloire de tant de grands hommes.
Si le dernier jour du bonheur n'est pas aussi le dernier de la
vie, et si la mort ne prévient les revers, la félicité passée se
change en opprobre. Et qui jamais, après cet exemple, osera
se livrer à la prospérité sans avoir préparé sa mort ?
Arrivé au bord où le Pénée, rougi du sang versé dans les
champs de Pharsale, se précipite dans la mer, Pompée se jette
dans une barque à peine assez solide pour aller sur un fleuve,
et trop fragile pour résister au choc des vents et des flots. C'est
sur ce faible esquif que s'échappe, passager tremblant, celui
dont les flottes couvrent encore les mers de Corcyre et de Leucade,
celui que la Liburnie et la Cilicie reconnaissent pour leur
vainqueur. Il ordonne qu'on fasse voile vers le rivage de Lesbos,
vers cette île dépositaire de ce qu'il a de plus cher au monde,
c'est là, Cornélie, que tu vivais cachée, et dans une inquiétude
aussi cruelle que si tu avais été au milieu des champs de Pharsale.
De noirs présages t'agitent sans cesse, ton sommeil est
troublé par de violentes frayeurs; tes nuits se passent en Thessalie,
et dès que le jour chasse les ténèbres, errante sur la cime
des rochers qui bordent la mer, les yeux attachés sur les flots,
tu es la première à découvrir dans le lointain les voiles flottantes
d'un vaisseau qui s'avance; mais tu n'oses demander des
nouvelles de ton époux. Tu vois une barque voguer vers toi
voiles déployées; tu ne sais pas ce qu'elle t'apporte, mais dans
un moment toutes tes craintes vont se réaliser. 0 Cornélie, celui
qui vient t'annoncer le malheur de nos armes, la défaite et
la fuite de ton époux, c'est ton époux lui-même. Pourquoi dérober
ces instants au deuil. Il n'est plus temps de craindre; il
est temps de pleurer.
Le navire aborde; Cornélie s'élance, et. reconnaît Pompée ;
elle voit le crime des dieux marqué sur le front pâle du héros,
sur cette face vénérable qu'il couvre de ses cheveux blancs, et
sur ses vêtements tout souillés de poussière. A cette vue, elle
chancelle, l'infortunée; un nuage répandu sur ses yeux lui dérobe
la lumière du ciel, l'excès de la douleur lui ôte le sentiment,
tout son corps tombe en défaillance, son coeur reste longtemps immobile et glacé, et la mort qu'elle a invoquée
semble avoir exaucé ses voeux.
Pompée descend du navire attaché par un câble au rivage,
et s'avance sur cette plage solitaire. A son approche, les fidèles
servantes de Cornélie retiennent leurs cris, et ne se permettent
d'accuser le ciel que par des gémissements étouffés. Elles s'efforcent en vain de relever leur maîtresse évanouie sur la terre.
Mais son époux l'embrasse, et pressant sur son sein son corps
saisi d'un froid mortel, lui rend la chaleur et la vie. Cornélie, dont
le sang recommence à couler, reconnaît la main qui la presse, et
ses yeux ont la force de soutenir la tristesse profonde qu'elle voit
peinte sur son visage. Il lui.défend de se laisser abattre par l'infortune,
et réprime en ces mots l'excès de sa douleur. « Femme
de Pompée, oubliez-vous de quels aïeux vous êtes née ? Est-ce
à une âme si courageuse de succomber sous les premiers revers?
Voici le moment d'éterniser la mémoire de vos vertus. La magnanimité
de votre sexe n'est point attachée au maintien des
lois ni aux travaux des armes ; le malheur d'un époux en est
l'unique épreuve. Élevez, affermissez votre âme; que votre
piété envers moi combatte et surmonte le sort. Aimez votre
époux d'autant plus qu'il est vaincu. C'est à présent surtout que
je fais votre gloire. Les faisceaux, le sénat, une foule de rois,
tout s'éloigne. Commencez à vous regarder comme mon unique
compagne, et à me tenir lieu de tout. Il serait honteux, votre
mari vivant, de montrer une douleur extrême. Réservez vos
larmes pour mon trépas, ce sera le dernier gage de votre foi.
Jusque-là, vous n'avez rien perdu; je respire; ma fortune seule
a péri, et si c'est elle que vous pleurez, c'est elle que vous avez
aimée. » A ce reproche de son époux, Cornélie soulève à peine sa tête
languissante, et son coeur laisse échapper ces plaintes entrecoupées
de sanglots. « 0 née pour le malheur de ceux à qui
mon sort se lie. que ne suis-je entrée dans le lit de César! J'ai
coûté deux fois des larmes au monde. Celles qui présidèrent à
mon hyménée furent Érinnys et les,ombres des Crassus. Vouée
à ces mânes, j'ai porté dans le camp de la guerre civile les destins
de l'Assyrie. J'ai entraîné tous les peuples dans ta ruine, j'ai
éloigné tous les dieux du plus juste parti. 0 mon illustre époux!
héros dont je n'étais pas digne! quoi, le sort a eu le droit de
t'opprimer! Pourquoi formai-je les noeuds impies qui t'allaient
rendre malheureux? Reçois ma mort, que je demande en expiation
de mon crime : et pour te rendre la mer plus facile, les
rois plus fidèles, l'univers plus soumis, jette dans les flots la
compagne; plus heureuse si elle s'était dévouée avant les malheurs
de tes armes pour en obtenir le succès, qu'elle te serve
au moins à expier tous les maux qu'elle cause au monde.
0 Julie! ombre que j'irritais, où que tu sois, te voilà vengée de
mon hymen par les malheurs de la guerre civile. Viens jouir
encore de mon supplice, et, apaisée par le trépas de ton odieuse
rivale, pardonne à ton époux. » A ces mots, elle tomba une seconde fois dans les bras de
Pompée, et sa douleur arracha des larmes à tous les yeux. La
grande âme de Pompée en fut elle-même attendrie ; et ce héros
qui d'un oeil sec avait vu les champs de Pharsale, versa des
larmes à Lesbos.
Alors le peuple deMitylène (1) accourant en foule au rivage, lui
dit : « Si notre île fait à jamais sa gloire d'avoir eu en dépôt la
digne moitié d'un'si grand homme, daignez aussi, Pompée,
nous vous en conjurons, daignez vous-même, ne fût-ce qu'une
nuit, prendre pour asile nos murs, et vous reposer au sein de
nos dieux domestiques, sur la foi sainte et inviolable d'un peuple
qui vous est dévoué.
1 Mitylène est la capitale de Lesbos. Cette cité fut une des plus peuplées et des plus puissantes des îles de la Grèce. Les lettres y furent en honneur dès les premiers temps historiques. Il s'y donnait tous les ans des combats où les poêtes se disputaient le prix de la poésie. Elle est la patrie de Pittacus, d'Alcée, de Sapho, de Théophraste : Épicure et Aristote y enseignèrent la philosophie. Entre autres magnifiques édifices, Mitylène avait un théâtre si beau, que Pompée en fit prendre le modèle pour en construire un semblable à Rome. On retrouve aujourd'hui encore à Castro, qui s'est élevée sur les ruines de Mitylène, les restes de monuments magnifiques qui attestent l'antique splendeur de la ville de Mitylène.
Faites de Lesbos un lieu mémorable
qu'on vienne voir dans tous les siècles, et qui excite la vénération
de tous les voyageurs romains. Vous n'avez pas de refuge
plus assuré dans votre fuite; toute autre ville peut espérer
de trouver grâce auprès du vainqueur; Lesbos ne peut plus
s'attendre qu'à sa haine. D'ailleurs César n'a point de flottes,
et nous sommes entourés de mers. Les sénateurs, sachant où
vous êtes, viendront vous retrouver; il faut un lieu connu pour
rallier vos forces. Nos richesses, les trésors mêmes de nos temples
vous sont offerts ; et que ce soit sur mer ou sur terre que
vous veuilliez employer notre brave jeunesse, elle est prête à
vous suivre; disposez de Lesbos et de tout ce qui est en son
pouvoir. Enfin, épargnez à un peuple qui croit avoir bien mérité
de vous, l'humiliation de laisser croire que vous n'avez
compté sur lui que lorsque vous étiez heureux, et que vous avez
douté de sa foi dès que le sort vous a été contraire. » Pompée
ne fut point insensible à la joie de trouver dans les Lesbiens un
zèle si pur et si noble; il s'applaudit pour l'humanité de voir
que l'honneur et la foi n'étaient pas encore exilés du monde.
« Non, leur dit-il, il n'est aucun lieu de la terre qui me soit
plus cher que Lesbos. Je n'en veux qu'un témoignage : c'est à
Lesbos que j'ai confié toutes les affections de mon âme; c'est
ici que j'ai retrouvé ma maison, mes dieux, une seconde Rome :
aussi, dans ma fuite, n'ai-je pas cherché à gagner un autre
rivage; et quoique vous eussiez à craindre les ressentiments de
César, je n'ai pas hésité à vous livrer en moi le moyen le plus
sûr d'apaiser sa colère. Mais c'est assez de vous avoir rendus
coupables une fois; je dois poursuivre ma fortune dans tout
l'univers. Adieu, Lesbos, peuple à jamais heureux d'avoir acquis
par ta vertu une renommée éternelle; soit que ton exemple
engage les nations et les rois à me secourir, soit que tu aies la
gloire d'être le seul qui dans mon malheur me soit resté fidèle,
car j'ai résolu d'éprouver en quels lieux de la terre la justice
règne, et en quels lieux le crime fait la loi. Dieu, qui veilles sur mes destins (s'il en est encore un seul qui me protège), reçois
le dernier de mes voeux : fais-moi trouver partout des peuples
comme le peuple de Lesbos, qui, tout malheureux que je suis,
aiment mieux s'exposer à la colère de César que d'insulter à
ma disgrâce, ou d'attenter à ma liberté. »
Il dit, et il fit porter la triste Cornélie sur le vaisseau qui
l'attendait. A la désolation de ce peuple, on eût dit qu'on le
forçait, lui-même à quitter ses pénates et sa patrie. On n'entendait
sur le rivage que des gémissements et des plaintes; on ne
voyait que des mains élevées vers le ciel, et quoique le malheur
de Pompée eût affligé tous les coeurs, c'était moins ce héros
qu'on plaignait que celle avec qui ce peuple était accoutumé à
vivre comme avec une de ses citoyennes, et qu'il voyait avec
douleur s'éloigner. Quand même elle irait joindre un époux triomphant,
les femmes de Lesbos en lui disant adieu auraient peine
à retenir leurs larmes : tant sa pudeur, sa dignité, la modestie
répandue sur son chaste visage lui ont attiré leur amour. Ce
qui les a le plus touchées, c'est que loin de se rendre incommode
à ses hôtes, et loin d'humilier même les plus petits, elle
a vécu à Mitylène dans le temps des prospérités et de la gloire
de Pompée comme s'il eût été vaincu.
Le soleil était à demi plongé sous l'horizon ; et s'il est vrai
qu'il y ait des peuples pour lesquels il se lève en se couchant
pour nous, chacun des deux mondes ne voyait alors que la
moitié de son globe de flamme. La nuit vient, et les soucis
cruels et vigilants dont l'âme de Pompée est remplie, lui font
parcourir de la pensée les villes et les peuples alliés des Romains,
les cours de l'Orient, leurs moeurs, leur différent génie,
et ces régions du midi qu'une chaleur intolérable défend seule
contre César. Souvent l'âme accablée de ces pénibles soins, et
rebutée de l'affligeante image que lui présente l'avenir, il écarte,
pour respirer, ces idées tumultueuses; et l'abattement de ses
esprits, qu'un trouble si violent épuise, lui laisse un moment
de relâche. Il questionne alors le pilote sur tous les astres;
comment on reconnaît les rivages; quel moyen le ciel lui donne
de mesurer l'espace parcouru de la mer; quel astre lui montre
la Syrie ; quels feux du Chariot le font se diriger vers la Libye. L'observateur habile du taciturne Olympe lui répond: «Nous ne
suivons pas ces astres qui lentement déclinent dans le ciel étoile
et abusent le pauvre matelot. Non. L'axe sans couchant qui ne
se plonge jamais dans les ondes et qu'éclaire le double Arctos,
voilà notre guide. Ce point se dresse-t-il au sommet de l'horizon,
la petite Ourse domine-t-elle l'extrémité des antennes,
nous marchons vers le Bosphore et la mer de Scythie. Mais que
l'Arctophylax descende de la cime du mât et que Cynosure se penche à la surface des mers, le vaisseau marche vers la Syrie,
de là vous parvenez au Canope, content d'errer sous le ciel
austral; poussez à gauche, au delà de Pharos, le navire touchera
les Syrles. Mais ordonnez où je dois tourner ma voile, incliner
mes vergues. » Pompée encore irrésolu répond : « N'importe
où, sur la mer sans fin : le plus loin, le plus loin possible des
bords thessaliens ; loin des mers et du ciel d'Italie. Le reste au
gré des vents. Naguère confiée à Lesbos, maintenant Cornélie
est avec moi ; tout à l'heure je savais quel rivage désirer : maintenant,
que la fortune me choisisse un port. »
Alors le pilote, au lieu de présenter la pleine voile au vent
l'incline; le navire penche vers la gauche , afin de diriger sa
route entre les écueils de la côte d'Asie et du rivage de Chio.
On relâche les agrès de la proue, on tend ceux de la poupe.
La mer ressentit le mouvement de la voile, et la proue annonça
par le bruit des ondes qu'il s'y traçait un sillon nouveau. Tel
et avec moins d'adresse, dans la course des chars, un écuyer
habile, obligeant ses coursiers à décrire le tour le plus étroit
du cirque, effleure la borne et l'évite.
Le soleil revient éclairer la terre, et sa lumière efface les astres de la nuit. Bientôt tout ce qui est échappé au naufrage de
Thessalie se rassemble auprès de Pompée. Son fils fut le premier
qui, du rivage de Lesbos, suivit ses traces sur les mers.
Après lui vinrent une foule fidèle de patriciens ; car même depuis
sa ruine et la défaite de son armée, la Fortune ne put l'empêcher
d'avoir des esclaves couronnés ; et dans sa déroute, il
traînait après lui tous les rois de la terre, tous les sceptres de
l'Orient. Déjotarus, ayant découvert ça et là les signes épars
de sa fuite, venait enfin de le joindre; Pompée l'envoie au
fond de l'Asie lui chercher de nouveaux secours. « O le plus
fidèle de tous les rois, lui dit-il, j'ai perdu tout ce qui sur
la terre était au pouvoir des Romains; mais il me reste à
éprouver le zèle des peuples du Tigre et de l'Euphrate, où ne
s'étend point encore la domination de César. Allez en mon nom
soulever l'Orient et le Nord ; pénétrez jusque dans le fond des
États du Mède et du Scythe; allez dans un monde qu'un autre
soleil éclaire; rendez au superbe Arsacide ces paroles que je
lui adresse : Si l'ancienne alliance que nous avons jurée, moi
par Jupiter Latin, vous par le culte de vos mages, subsiste
encore entre Rome et vous, Parthes, remplissez vos carquois,
tendez vos arcs, souvenez-vous qu'en chassant devant moi les peuples du Caucase, je vous laissai la liberté d'errer en paix
dans vos campagnes, sans vous réduire à chercher dans les
murs de Babyione un asile contre moi. J'avais déjà franchi les
bornes du vaste empire de Cyrus; et vers le fond de la Chaldée,
je touchais aux bords où l'Hydaspe et le Gange vont se jeter au
sein des mers. Cependant lorsque la victoire me soumettait
tout l'Orient, je voulus bien excepter le Parthe du nombre des
peuples que je rangeais sous les lois de Rome, et leur roi fut le
seul que je traitai d'égal. Ce n'est pas une fois seulement que
les Arsacides m'ont dû la conservation de leur empire; et,
après la sanglante défaite de Crassus en Assyrie, quel autre que
moi eût apaisé le ressentiment des Romains engagés par tant
de bienfaits ? O Parthes ! voici le moment de passer l'Euphrate
qui devait à jamais vous servir de barrière. Courez sur cette
rive que vous interdit le fondateur de Zeugma. Venez vaincre en
faveur de Pompée; et Rome elle-même consent à être vaincue
à ce prix. »
Quelque difficile que fût ce message, Déjotarus voulut bien
s'en charger. Il dépose les marques de la royauté et part sous
l'habit d'un esclave. Dans les périls, on voit souvent pour sa
sûreté, un roi se donner l'apparence d'un homme indigent ; tant il est vrai que la vie du pauvre est plus tranquille que celle
des maîtres du monde.
Pompée ayant jeté Déjotarus sur le rivage de l'Asie, poursuit
sa route, entre les écueils d'Icare. Il laisse derrière lui Éphèse
et Colophon à la rade paisible; et à la faveur d'un vent lé»er,
que l'île de Cos lui envoie, il passe devant Gnide, rase l'île de
Rhodes, dorée par le soleil, coupe le golfe de Telmesse, et la
côte de Pamphilie se présente devant lui; mais n'y voyant pas
encore d'asile assuré, il gagne l'humble ville de Phaselis, où
il n'a point à craindre le peu d'habitants que la guerre y a laissés,
et qui, tous ensemble, n'égalent pas le nombre des Romains
qu'il a sur son vaisseau. Il s'avance et passe à la vue du mont
Taurus, d'où tombent les eaux du Dipsante. Pompée eût-il jamais
pu croire, dans le temps qu'il chassait de ces mers les pirates
de Cilicie, qu'un jour, exposé sur un faible navire, il aurait
besoin d'y trouver lui-même un passage tranquille ? Une
grande partie du sénat se rallie auprès de son chef fugitif; enfin
il arrive au port de Syédra, où le Sélinus accueille et renvoie
les navires. Là, sa voix, qu'une douleur profonde avait
tenue longtemps muette, rompt enfin le silence, et il parle en
ces mots :
« Compagnons de mes travaux et de ma fuite, vous qui êtes Rome pour moi, quoique nous soyons assemblés sur une plage
solitaire, sur les bords de la Cilicie, où je me vois sans secours
et sans armes abandonné de tout l'univers; j'ose former
de nouveaux desseins pour changer la face des choses.
Rappelez toutes les forces de vos grandes âmes. Je n'ai pas péri
tout entier à Pharsale, et mon malheur ne m'a point tellement
abattu, que je ne puisse relever ma tête et me dégager du milieu
des ruines où l'on me croit enseveli. Marius errant et caché
entre les débris de Carthage ne s'est-il pas relevé de sa chute?Ne l'a-t-on pas revu dans Rome précédé des faisceaux ? Ne
l'a-t-on pas vu encore une fois inscrire son nom dans nos fastes?
Et si la main de la Fortune s'est moins appesantie sur moi que
sur lui, me tiendra-t-elle terrassé? J'ai mille vaisseaux sur les
mers de la Grèce, mille chefs sont sous mes drapeaux ; Pharsale
a plutôt dispersé que renversé mes forces. La seule réputation
que mes anciens travaux m'ont faite dans tout l'univers
et un nom longtemps cher au monde suffiraient pour me
soutenir. Ce que je vous laisse à examiner, c'est à qui nous
aurons recours : de l'Egyptien, du Parthe ou du Numide, et
sur les forces et la fidélité duquel on peut le plus compter. Pour
moi, je vais vous confier mes inquiétudes secrètes et quelle serait
ma résolution. L'enfance du roi d'Egypte m'est suspecte; pour lutter contre le malheur, le zèle a besoin d'un courage
affermi par toute la vigueur de l'âge. Juba n'a pas oublie son
origine. D'un autre côté, l'artificieuse duplicité du Maure m'épouvante.
Ce peuple a hérité de la haine de Carthage contre les
Romains. Le Numide qui occupe le trône a dans le coeur tout
l'orgueil d'Annibal, qui par sa souche oblique souille de son
sang ses aïeux Numides. Il n'est déjà que trop fier d'avoir vu
Varus suppliant et d'avoir protégé nos armes. Le parti le plus
sûr est donc de nous retirer vers l'Orient. L'immense Euphrate partage
le monde en deux empires; et les portes Caspiennes
servent de barrières à ces vastes contrées qu'un autre ciel
éclaire et qu'entoure un Océan d'une autre couleur que le
nôtre. Vaincre et dominer sont les plaisirs de ces peuples fiers :
leurs coursiers sont superbes; leur arc est terrible, dès l'enfance
et jusque dans la vieillesse ils le tendent avec vigueur ;
le trait décoché par leur main porte une mort inévitable; ils
furent les seuls qui arrêtèrent l'impétuosité d'Alexandre; ils
soumirent Bactres et Babylone, le Mède et l'Assyrien; nos javelots
les intimident peu; et depuis le malheur de Crassus, ils
savent trop qu'avec les carquois des Scythes, leurs aïeux, ils
peuvent défier nos armes. C'est peu pour eux d'aiguiser leurs flèches, ils savent les empoisonner : la plus légère blessure en
est fatale, et dès que la pointe pénètre jusqu'au sang, elle y
laisse la mort. Et que ne puis-je moins compter sur la valeur
des Arsacides? Leurs destins qui balancent les nôtres ne leur
inspirent que trop d'audace, et la faveur des dieux ne les a que
trop secondés. Je ferai donc sortir ces peuples des régions où
naît le jour, je les ferai marcher vers nos climats et y porter
la guerre. Je lancerai l'Orient hors de ses retraites. S'ils me
manquent de foi, s'ils trahissent l'alliance jurée, au delà des
bornes du monde habité, je consommerai mon naufrage; on ne
me verra point implorer les rois que j'ai faits, mais sur cette
terre éloignée j'aurai la consolation de mourir sans coûter un
nouveau crime à César, sans rien devoir à sa pitié. Cependant,
plus je me rappelle ma vie passée, plus j'ose croire que mon
nom est respecté dans l'Orient. Quelle gloire nos armes n'ont elles
pas acquise au-dessus de l'Euxin, aux bords du Tanaïs,
alors que je me montrai à tout l'Orient? En quelle partie du
monde avons-nous eu des succès plus rapides? des triomphes
plus éclatants? 0 Rorne! fais des voeux pour le dessein que je
médite. Et que peuvent jamais les dieux t'accorder de plus favorable,
que d'engager le Parthe dans tes guerres civiles, d'y consumer ses forces redoutables et de l'envelopper dans tes
malheurs? Si le Parthe et César croisant leur glaive en viennent
aux mains, quel que soit le vainqueur, il faut que la Fortune
ou me venge ou venge Crassus !»
Au murmure qui s'éleva dans l'assemblée, il fut facile à
Pompée de juger qu'on désapprouvait son dessein. Lentulus se
distingua dans ce conseil par la chaleur de son zèle et la majesté
de sa douleur. Il se lève et il fait entendre ces paroles
dignes d'un homme, naguère consul :
« Hé quoi, Pompée, le malheur de Thessalie a-t-il jusque-là
consterné votre âme? un jour a-t-il tout renversé? Pharsale a-t-elle vu périr jusqu'au dernier espoir de la république? La
plaie enfla est-elle si profonde, et le mal est-il incurable au
point qu'il ne vous reste d'autre ressource que d'aller implorer
le Parthe, et vous prosterner à ses pieds? Pourquoi, transfuge
de ce monde, aller chercher un ciel nouveau, des astres
inconnus, une terre étrangère ? Voulez-vous, esclave du Parthe,
vous ranger sous ses lois, vous soumettre à son culte, aller avec
les Chaldéens adorer le feu de leurs foyers? Vous, qui prétendez
n'avoir pris les armes que pour l'amour de la liberté, pourquoi,
si vous pouvez endurer l'esclavage, en avoir imposé à ce
malheureux univers? Le Parthe, qui frémit d'effroi quand il apprit que Rome vous avait mis à la tête de ses armées ; le
Parthe, qui vous a vu des forêts de l'Hircanie et du rivage de
l'Inde traîner les rois captifs après vous ; le Parthe vous verra,
triste rebut du sort, humilié, tremblant, consterné devant lui !
Quels projets son orgueil ne va-t-il pas fonder sur notre puissance
abattue, en se comparant avec Rome, qu'il croira voir
en vous suppliante à ses pieds? Et que lui direz-vous qui soit
digne de votre courage et du rang que vous occupez? Le barbare
ignore votre langue, il faudra que vos larmes, les larmes
de Pompée implorent sa compassion. Qu'il vous l'accorde;
quelle honte pour Rome d'avoir besoin du Parthe pour venger
ses malheurs? Est-ce pour subir cet affront qu'elle vous a fait
notre chef? Pourquoi répandre chez ces barbares le bruit de vos
calamités ? Pourquoi leur découvrir des plaies qu'il eût fallu tenir
cachées ? Pourquoi leur apprendre à franchir les barrières
de leur empire? La seule consolation de Rome, dans son malheur,
était d'écarter tous les rois, et de ne servir qu'un citoyen ;
et vous, traversant l'univers, vous voulez attirer jusqu'au sein
de Rome des peuples qui ne demandent qu'à la déchirer ! Vous
reviendrez des bords de l'Euphrate, à la suite des étendards que
le Parthe enleva au malheureux Crassus ! Le seul de tous les
rois qui, dans le temps que la fortune ne se déclarait point encore, s'e.st exempté de cette guerre, osera-t-il, instruit de la victoire
et des forces de César, s'associer à vos disgrâces et marcher
contre lui? N'en attendez pas ce courage. Les peuples nés
dans les frimats du Nord sont belliqueux et indomptables ; mais
ceux du Levant sont amollis par la douceur de leur climat. Ces
robes longues et flottantes dont les hommes y sont vêtus, annoncent-elles des guerriers? Dans les campagnes de la Médie,
dans les champs du Sarmate, dans les vastes plaines qu'arrose
le Tigre, le Parthe ayant la liberté de fuir et de se rallier, est
un ennemi invincible; mais dans un pays hérissé de montagnes,
lui fera-t-on gravir des rochers escarpés? Surpris, attaqué dans
la nuit, quel usage ses mains feront-elles de son arc? S'il faut
passer à la nage un fleuve rapide et profond, est-il accoutumé à
vaincre l'impétueux courant des eaux? Et dans les chaleurs de
l'été, au milieu des flots de poussière, couvert de sang et de sueur,
soutiendra-t-il sous un soleil brûlant tout le poids d'un jour de
bataille? Il ne connaît ni le bélier, ni aucune machine de guerre.
Une tranchée à combler est un travail au-dessus de ses forces ;
poursuit-il l'ennemi, tout ce qui s'oppose au vol d'une flèche
est un rempart contre lui. De légers combats, une guerre fugitive,
des escadrons volants, des soldats plus propres à quitter leur poste qu'à chasser l'ennemi du sien : voilà le Parthe; il
est réduit au lâche expédient d'empoisonner ses flèches ; il
n'ose approcher l'ennemi; mais du plus loin qu'il peut l'atteindre,
il tend son arc, et laisse au vent le soin de diriger ses
coups. L'épée impose la vaillance, et c'est l'arme de tous les
peuples vraiment belliqueux. Voyez les Parthes dans les combats
: désarmés dès la première charge, sitôt que leur carquois
est vide, ils sont obligés de s'enfuir ; leurs bras n'ont aucune
vigueur : toute leur confiance est au venin dans lequel ils
trempent leurs flèches. Et vous, Pompée, vous comptez sur un
peuple, à qui, dans les combats, le fer ne peut suffire! Un si
honteux secours vaut-il que vous alliez mourir loin de votre
patrie, à l'autre bout de l'univers? qu'une terre barbare vous
couvre, et qu'on vous y accorde une pierre étroite et sans
gloire, grâce encore digne d'envie, dans un pays où Crassus est
privé de la sépulture? Toutefois votre sort n'est pas le plus
malheureux ; car le trépas est le dernier des maux, et il n'a rien
d'effrayant pour des hommes de courage? Mais que deviendra
Cornélie? Ce n'est pas la mort qui l'attend chez les Parthes.
Ignorez-vous comment ces peuples dissolus traitent les plaisirs
de l'amour? Leur usage est l'instinct des bêtes. Un même lit
reçoit des épouses sans nombres; les lois, les noeuds de l'hyménée y sont souillés par ce mélange impur; ses mystères les
plus secrets y sont célébrés sans pudeur, en présence de mille
femmes. Cette cour plongée dans l'ivresse et dans les délices
des festins, ne s'interdit aucun excès de licence et de volupté.
Les nuits se passent entre ces rivales à rallumer sans cesse les
désirs d'un homme, et à les combler tour à tour. Les soeurs,
les mères, noms sacrés, partagent la couche des rois. La fable
d'OEdipe, quelque involontaire que fût son crime, le rendit horrible
aux nations; combien de fois, avec pleine lumière, un
pareil commerce a donné des héritiers aux Arsacides ! que ne
se permet pas un roi, qui se croit permis de donner des enfants
à sa mère! L'illustre fille des Scipions sera donc la millième
femme destinée au lit d'un barbare, et la plus exposée sans
doute aux outrages d'un amour qu'elle irritera par sa fière
sévérité, et par le nom de ses époux ; car un nouvel attrait pour
les désirs du Parthe ce sera de savoir que votre femme fut celle
de Crassus. C'est une captive qui lui est échappée dans la défaite
des Romains, et qu'il croira que le sort lui ramène. Rappelez-
vous, Pompée, ce carnage affreux de nos légions dans
l'Assyrie; et vous rougirez, non-seulement d'implorer le secours
de ce roi funeste, mais d'avoir, à toute chose, préféré la guerre civile. Et quel plus grand crime aux yeux des nations
dans le gendre et dans le beau-père, que d'avoir laissé, pour
se détruire entre eux, Crassus et les siens sans vengeance! Il
fallait que Rome, avec toutes ses forces et tous ses chefs, fondît,
à la fois sur Bactres; et que, de peur de n'avoir pas assez
d'armes pour l'accabler, laissant l'empire à découvert du côté
du Germain et du Dace, elle abandonnât ses frontières, jusqu'à
ce que la perfide Suze et Babylone eussent caché sous leurs
ruines les tombeaux de nos guerriers. 0 fortune, c'est la guerre
avec l'Assyrie que nous te demandons. Si Pharsale a consommé
la guerre civile, que le vainqueur marche contre le Parthe :
c'est le seul peuple de l'univers dont nous puissions voir avec
joie César triomphant. Vous, Pompée, dès le moment que vous
aurez passé l'Araxe glacé, attendez-vous à voir le morne fantôme
du vieux Crassus, tout percé des flèches du Parthe, vous
apparaître et vous parler ainsi : O toi, qu'après ma mort mon
ombre errante regardait comme le vengeur de l'outrage fait à ma
cendre; tu viens ici parler d'alliance et de paix! alors à chaque
pas, vous trouverez des monuments de la honte de Rome. Les
villes vous offriront les têtes de nos chefs qu'on y a portées
en triomphe: l'Euphrate vous rappellera tous ces morts, dont
il a roulé les cadavres ; le Tigre, tous ceux qu'il a engloutis. sous la terre, et qu'il a revomis en reprenant son cours. Si
vous pouvez aller à travers ces objets, implorer l'amitié du
Parthe, allez donc implorer celle de César jusque sur le champ de
Pharsale. Mais pourquoi ne pas préférer des peuples amis des
Romains ? Si le Numide vous est suspect, si la mauvaise foi de
Juba nous effraye, cherchons un asile en Egypte, dans l'héritage
de Lagus. D'un côté, les écueils des Syrtes ; de l'autre, les
sept bouches du Nil, dont les eaux repoussent la mer, défendent
l'Egypte. Cette terre fertile est contente des richesses
qu'elle produit, elle n'attend rien ni du commerce du monde,
ni de l'influence du ciel : elle a mis toute sa confiance dans le
Nil. Ptolémée, encore enfant, vous doit le sceptre qu'il possède,
le royaume et le roi sont sous votre tutelle; qui peut craindre
un fantôme de roi? Son âge est l'âge de l'innocence; ce n'est
pas dans de vieilles cours qu'il faut chercher la justice, la bonne
foi, le respect des dieux : l'habitude de tout pouvoir fait perdre
la honte de tout oser; et on distingue les jeunes rois à la douceur
de leur empire. »
Ces paroles de Lentulus entraînèrent tous les esprits. Son
avis l'emporta sur celui de Pompée, tant l'extrémité du péril
rétablit d'égalité entre les hommes. Ils quittent la côte de Cilicie
et vont aborder à l'île de Chypre, séjour favori de la
déesse à qui la mer de Paphos a donné le jour (si l'on peut
croire que les dieux soient nés, et s'il est possible que jamais
aucun d'eux ait commencé d'être).
Pompée quitte ces rivages, mesure les roches de Chypre,
tournées vers l'Auster, et se laisse entraîner par l'oblique courant
de la vaste mer. Sans jeter l'ancre au pied du phare,
cher aux matelots, il lutte contre le vent et touche à grand peine
aux rives basses de l'Egypte, aux lieux où le Nil divisé s'épand
près de Peluse par la septième et la plus large de ses bouches.
C'était le temps où la Balance ne tient qu'un moment en équilibre
les heures du jour et celles de la nuit, et va rendre aux
nuits de l'automne l'avantage que le Bélier a donné aux jours du
printemps. Le jeune roi était sur le mont Casius. Pompée s'y
dirige. Ni le soleil, ni les voiles ne languissent. Déjà le cavalier
en sentinelle sur le rivage, accouru à la hâte, avait jeté l'alarme
en apprenant la venue de Pompée. A peine avait-on le temps
de tenir conseil ; cependant tous les infâmes courtisans de Ptolémée
s'assemblent dans le palais d'Alexandre. Il se trouve
parmi eux un homme juste, un vieillard dont les ans ont mûri
la sagesse, éteint les passions. Achorée est son nom, Memphis
l'a vu naître, Memphis qui du haut de ses murs observe les
progrès du Nil lorsqu'il inonde les campagnes, Memphis si fier de ses dieux ! Ce sage avait vu plusieurs fois, dans le cours d'un
long sacerdoce, s'accomplir le nombre des révolutions lunaires
que doit vivre le boeuf Apis. Il fut le premier qui donna sa voix
dans le conseil ; il rappela les bienfaits de Pompée, son amitié
pour le père du roi et la sainteté de leur alliance; mais Pothin,
plus habile à démêler le caractère d'un mauvais prince, et plus
instruit dans l'art de le persuader, osa proposer le meurtre de
Pompée. « Ptolémée, dit-il, la justice et le droit tiennent souvent
lieu de crime; et si la foi qu'on garde à ceux que trahit
la fortune obtient des éloges, elle attire des châtiments. Rangez-vous du parti des dieux et du sort; honorez les heureux, et
repoussez les misérables. Il y a moins de distance entre les
astres et la terre, entre le feu et l'eau de la mer qu'entre l'utile
et le juste. Toute la force des sceptres s'anéantit dès qu'on
pèse leurs droits au poids de l'équité. La pudeur et l'honnêteté
renversent les empires. L'autorité ne se soutient que par la
liberté du crime et par l'usage illimité du glaive. Le droit d'user
de violence ne se conserve qu'en s'exerçant. Que celui qui veut
être juste descende du trône. L'absolu pouvoir ne peut jamais
s'accorder avec la vertu, et qui rougit de tout violer aura sans
cesse tout à craindre. Punissez Pompée d'avoir méprisé la faiblesse
de votre âge, et d'avoir pensé que tout vaincu qu'il est, nous n'oserions lui fermer nos ports. Si vous êtes las de régner,
ce n'est pas à lui qu'il faut livrer l'héritage de vos pères; vous
avez une soeur à qui vous le devez; rappelez-la au trône d'où
vous l'avez bannie. Mettons l'Egypte à couvert des armes romaines;
tout ce qui n'aura point été au vaincu sera épargné par
le vainqueur. Chassé du monde entier, perdu sans ressource,
Pompée cherche avec qui tomber. Les mânes des Romains
qu'il a fait périr le poursuivent. Ce n'est pas seulement son
beau-père qu'il fuit, il fuit les regards du sénat, dont le plus
grand nombre est la proie des vautours de la Thessalie; il
craint les nations qu'il a laissées nageant ensemble dans les
flots de leur sang; il craint cette foule de rois qu'il a entraînés
dans son naufrage. Chargé du crime de la Thessalie, rebuté
partout, il se jette dans le seul pays qu'il n'ait pas encore ruiné,
et c'est ce qui le rend plus coupable envers vous. Pourquoi,
Pompée, venir souiller et rendre suspecte à César cette Egypte
qui s'est tenue en paix? Pourquoi la choisir pour le lieu de ta
chute, et y transporter les destins de Pharsale et ton propre
malheur? Nous avons déjà un crime à expier par ta mort :
c'est de te devoir le sceptre, et d'avoir fait des voeux pour toi. Ce glaive que le sort nous force de tirer était destiné, non
pas à toi, mais au vaincu. C'est toi, Pompée, qu'il va percer ;
nous aurions voulu que ce fût ton beau-père; nous sommes emportés
par le torrent qui entraîne l'univers. Tu offres ta tète au
glaive, pouvons-nous ne pas frapper? Malheureux! quelle confiance
te livre à nous ? Ne vois-tu pas un peuple sans armes
occupé à cultiver ses campagnes encore humides, aussitôt que
le Nil a retiré ses eaux? Il faut, savoir mesurer ses forces, et
avouer son impuissance. Êtes-vous, Ptolémée, un assez ferme
appui pour un homme dont la ruine écrase Rome elle-même?
Irons-nous remuer les cendres de Pharsale, et attirer la guerre
sur nos bords? Avant le combat de Thessalie, nous n'avons
embrassé aucun parti; et à présent nous suivrions des drapeaux
que le monde entier abandonne ! Nous oserions défier un
vainqueur dont la puissance et la destinée se déclarent impérieusement!
Il est honteux d'abandonner celui qui tombe dans
l'infortune, mais ce n'est qu'autant qu'on l'a suivi dans la prospérité;
et personne n'attend, pour choisir ses amis, l'instant où
ils sont malheureux. »
Tout le conseil applaudit au crime, et le roi, encore dans
l'enfance, fut flatté de voir que ses ministres lui déféraient
l'honneur, nouveau pour lui, de décider ce grand coup. Achillas
est chargé de l'exécution. Aux lieux où la plage perfide se prolonge en laissant le Casius, où les sables égyptiens montrent
que les Syrtes y sont unies, il monte avec ses satellites sur
une barque qui les contient à peine. 0 dieux! c'est l'Egypte,
c'est la barbare Memphis, c'est la foule énervée des habitants
de Canope qui a cette audace ! Est-ce ainsi que la fatalité
des guerres civiles accable le monde? que Rome succombe?
L'Egypte compte pour quelque chose dans ces désastres ? Un
glaive égyptien contribue à notre perte? Discorde civile, sois
fidèle à tes promesses, interdis du moins le parricide aux mains
étrangères; arme celles d'un parent. La tête de Pompée ne
vaut-elle pas un crime de César? Quoi! Ptolémée, tu ne crains
point d'être accablé sous sa chute? Le ciel tonne, et toi, être
impur, moitié d'homme, tu oses porter ici tes mains profanes !
Respecte en lui non le vainqueur du monde, non celui que le
Capitole a vu trois fois traînant les rois après son char, non le
vengeur de Rome et du sénat, non le gendre de César enfin ;
mais ce qui doit suffire à un roi, respecte un Romain dans
Pompée. Quels fruits attends-tu de ce parricide ? Tu ne sais
plus, prince cruel, ce que tu vas devenir; tu n'as plus aucun
droit au sceptre de l'Egypte, c'est de Pompée que tu le tiens;
sa mort te laisse sans appui. Le héros avait refusé les voiles au vent, et la rame poussait
son vaisseau vers ce détestable rivage; alors s'avance au-devant
de lui la barque qui porte ses assassins. Ils rassurent en l'abordant
que l'Egypte lui est ouverte ; mais accusant les bancs de
sable qui rendent l'abord difficile aux vaisseaux étrangers, ils
l'invitent à descendre de son navire dans leur barque. Si les
lois de la destinée et l'irrévocable décret de sa mort ne l'eussent
pas entraîné vers les bords où il devait périr, il lui eût été facile
de prévoir le complot tramé contre lui, car s'il y avait eu
de la bonne foi dans l'accueil qu'on lui faisait, si un zèle sincère
eut ouvert le palais de Ptolémée à son bienfaiteur, ce roi lui-même,
avec toute sa flotte, ne fût-il pas venu le recevoir? Mais
Pompée cède à son mauvais destin ; il descend dans la barque,
il laisse ses vaisseaux, il préfère la mort à la crainte.
Cornélie allait se précipiter avec son époux sur la barque
ennemie, d'autant plus résolue à ne le pas quitter qu'elle avait
un pressentiment de sa perte. « Demeurez, lui dit-il, épouse téméraire,
et vous, mon fils, je vous en conjure; éloignez-vous du
rivage, attendez mon sort. Ce n'est qu'au péril de ma tête que
je veux éprouver la foi de cette cour. » Il dit, mais sourde à sa prière, Cornélie éperdue lui tendait
les bras. « Où vas-tu sans moi, cruel? lui-dit-elle, veux-tu
m'abandonner une seconde fois comme aux jours funestes de
Thessalie? Jamais, tu le sais, nous ne nous séparons que sous
de malheureux auspices. Ah ! si tu voulais m'écarter de tous les
bords où tu descends, pourquoi venir me chercher à Lesbos ?
Que ne m'y laissais-tu cachée? Quoi! n'est-ce donc que sur les
mers que tu me permets de t'accompagner? »
Quoique ses plaintes ne soient pas écoutées, Cornélie n'en
demeure pas moins sur le bord du vaisseau, penchée et prête
à s'élancer ; et dans l'égarement où la frayeur la jette, elle ne
peut ni détourner ses yeux de la barque, ni les fixer sur son
époux. La flotte de Pompée se tient à l'ancre dans l'inquiétude,
et dans l'attente du succès. Elle craignait non la violence ou la
trahison de Ptolémée, mais que Pompée ne s'abaissât jusqu'à la
prière, et ne fléchît devant un sceptre que lui-même il avait
donné.
Comme le héros se prépare à descendre, Septime vient le saluer;
Septime, soldat romain, qui avait servi sous ses enseignes, et qui depuis, rougissez, dieux du ciel ! avait quitté les
aigles pour les drapeaux d'un roi dont il était le satellite : homme
cruel, violent, atroce, et plus affamé de carnage que les bêtes féroces. O Fortune, qui n'eût pas cru que tu avais voulu épargner
le sang des peuples en dérobant cette main meurtrière à la
guerre civile, et en l'éloignant de Pharsale; mais, non, tu as
disposé les glaives, de sorte qu'aucun pays du monde ne manque
d'être souillé de sang, et que Rome t'offre partout des meurtriers
et des victimes. O honte éternelle pour les vainqueurs !
ô souvenir dont à jamais rougissent les dieux ! Ce fut de l'épée
d'un Romain qu'un roi se servit pour ce meurtre! ce fut, Pompée,
sous l'un de tes glaives que Ptolémée fit tomber ta tête !
Quelle sera chez la postérité la mémoire de ce perfide? et comment
appeler l'attentat de Septime, si l'on donne le nom de
Pompée touchait à sa dernière heure; emporté dans la barque,
il était tombé au pouvoir de ses ennemis. Les assassins tirent
l'épée, et le héros voyant le fer levé sur lui, s'enveloppe le visage
de sa robe ; il s'indigne d'offrir au sort sa tête nue ; il ferme
les yeux, et retient son haleine, de peur qu'il ne lui échappe en
mourant quelques plaintes ou quelques larmes qui ternissent
l'éclat immortel de son nom. Mais sitôt que le perfide Achillas
lui à enfoncé l'épée dans le sein, il se laisse tomber sous le
coup sans pousser un gémissement. Plein de mépris pour le crime, immobile, il veut que sa mort témoigne de sa grandeur
et il roule ces pensées dans son coeur : « Tout l'univers a les
yeux sur toi ; l'avenir même est attentif à ce qui se passe dans
cette barque et juge la foi de l'Egypte; prends soin de ta
gloire, Pompée. Ta longue vie s'est écoulée dans les prospérités;
le monde ignore, à moins que ta mort ne le prouve, si tu
sais soutenir les revers. Ne conçois ni honte ni regret de périr
sous les coups d'un lâche : de quelque main que tu sois frappé,
crois que c'est la main de César. Qu'ils déchirent mon corps,
qu'ils dispersent mes membres; je suis heureux, grands dieux :
ma vertu me reste, et il n'est au pouvoir d'aucun de vous de
m'enlever ce bien. Le malheur n'est attaché qu'à la vie; le
trépas va m'en délivrer. Cornélie et mon fils Sextus sont témoins
de ce meurtre... O ma douleur, garde-toi d'éclater; s'ils admirent
C'est ainsi que Pompée mourant maîtrise son âme, et la défend
de tout ce qui peut la troubler. Mais Cornélie qui a moins
de courage pour voir mourir son époux qu'elle n'en aurait
pour mourir elle-même, remplit l'air de ses cris douloureux.
« O mon époux ! dit-elle, c'est moi qui t'assassine : le détour que
tu as fait pour venir à Lesbos a donné à César le temps de te devancer sur le Nil; car quel autre que lui eût ordonné ce
crime ? Qui que tu sois, toi que le ciel envoie pour arracher la
vie à mon époux, soit que tu serves la rage de César ou que tu
assouvisses la tienne, tu ne sais pas où ta main doit frapper
pour déchirer l'âme de Pompée. Tu te hâtes de lui donner le
coup mortel! c'est tout ce qu'un vaincu demande. Que ma mort
précède la sienne, et qu'il en soit témoin : voilà son vrai supplice.
Si la guerre est son crime, je n'en suis pas exempte : je
suis la seule Romaine qu'on ait vue suivre son époux et sur les
mers et dans les camps : aucun de ses dangers ne m'a intimidée;
j'ai fait ce que les rois n'ont osé faire, j'ai tendu les bras
au proscrit. Est-ce donc ainsi que ta femme, ô Pompée, a mérité
d'être laissée sur un vaisseau, loin des dangers que tu courais?
Homme injuste, tu m'as fait l'outrage de ménager ma vie
en exposant la tienne. Je trouverai la mort sans qu'un roi me
l'envoie. Laissez-moi, matelots, me jeter dans les flots, ou me
servir de l'un de ces cordages. Pompée n'a-t-il pas un ami qui
daigne me plonger son épée dans le sein ? Ce qu'un tel service
aura de cruel sera imputé à César. Mais quoi ! vous m'empêchez
de finir mes déplorables jours ? O mon époux, tu respires
encore, et Cornélie n'est déjà plus libre ! on me défend de me donner la mort ; on me garde pour le vainqueur ! » A peine
a-t-elle achevé ces mots, qu'elle tombe dans les bras des siens;
et le vaisseau plein d'épouvante gagne la haute mer.
Pompée en expirant avait conservé sur son visage vénérable
l'empreinte de la majesté; on n'y voyait que de l'indignation
contre les dieux, l'effort même de l'agonie n'avait point altéré
ses traits : c'est le témoignage de ceux qui virent sa tête
séparée du tronc; Septime ajoutant le sacrilège au parricide,
avait arraché le voile qui couvrait la face auguste du héros
expirant. Il saisit cette tête palpitante, la tranche et la place
toute livide sur les bancs des rameurs. Les nerfs, les veines,
les vertèbres noueuses se brisent sous ses coups; il n'avait
pas l'art de faire voler une tête d'un seul coup. Dès que la
tête tombe séparée du tronc, les soldats égyptiens s'en disputent
la possession. Romain dégénéré, ministre subalterne du
crime, cette tête sacrée que tranche ton glaive impie, un autre
que toi la portera. O honte! ô destinée ! pour te reconnaître,
Pompée, le sacrilège enfant presse cette chevelure auguste, objet
du respect des rois, ornement d'un front généreux. Tandis que
la face vit encore, que des sanglots crispent convulsivement sa
bouche, que son regard devient fixe, on porte sur une lance égyptienne cette tête qui commandait la guerre, agitait les lois,
le champ de mars, le forum; ô fortune romaine, c'est sous ses
traits que tu aimais à te voir toi-même. C'est peu de chose
pour le tyran : il veut perpétuer la mémoire du crime. A l'aide
d'un art impie, on enlève le sang desséché autour de la tête,
on vide la cervelle, on sèche la peau , et quand toute l'humeur
souillée est épuisée, on verse le suc qui conserve et raffermit
la face.
Dernier rejeton de la race de Lagus, prince indigne du jour
que tu vas perdre et du sceptre qui va passer aux mains
de ton impudique soeur ; quoi ! tandis qu'Alexandre a sur
le Nil un vaste et superbe tombeau, que des pyramides immenses
couvrent les cendres des Ptolémées, et d'une foule de
rois qui ont été la honte du trône ; le corps de Pompée est le
jouet des flots, et poussé d'écueil en écueil, se brise contre le
rivage ! T'en eût-il coûté tant de soins de le conserver tout entier,
ne fût-ce que pour l'offrir aux yeux de son beau-père ?
Vôilà donc ce que réservait à Pompée cette fortune qui élevait
si haut ses destins, et de quel coup elle devait le frapper au
comble des grandeurs humaines! La cruelle assemble en un seul jour tous les maux dont elle l'a exempté durant le cours
d'une longue vie. Il n'est plus ce héros qui ne connut jamais
le mélange des succès et des revers. Heureux, aucun dieu ne le
troubla ; malheureux, aucun ne lui fit grâce. Leur main suspendue
sur lui ne l'a frappé qu'une fois ; le voilà jeté sur le sable,
brisé par les écueils, et le misérable jouet des eaux qui se mêlent
avec son sang. Son corps est si défiguré, que la seule marque à
laquelle il soit reconnaissable est d'être séparé de sa tête. Le
sort voulut bien cependant lui accorder en secret une humble
sépulture ; soit pour qu'il n'en fût pas absolument privé, soit
pour qu'il n'en obtînt pas une plus honorable.
De sa retraite, Cordus accourt tremblant vers la mer. Questeur,
il avait quitté le rivage de Cypre, misérable compagnon
de la fuite de Pompée. Il ose s'avancer à travers les ombres;
la pitié refoule la crainte dans son coeur, il va chercher le cadavre
au milieu des flots, et attire à la rive les restes de Pompée.
La lune répandait à peine à travers les nuages une triste et
faible clarté; mais à la lueur de ses rayons, le cadavre flottant
sur les eaux blanchissantes frappe les yeux du vieillard;
il le serre étroitement entre ses bras, et le dispute à la mer
qui l'entraîne. Mais trop faible pour l'enlever, il attend que la vague le pousse, et secondé par elle, il l'amène au bord;
lorsqu'il le voit étendu sur le sable, il se jette lui-même sur
le sein de Pompée, arrose de larmes toutes ses blessures, et se
plaint au ciel en ces mots : « O Fortune ! ce Pompée, qui te
fut si cher, ne te demande point l'encens et les parfums que
Rome brûlerait sur son bûcher; il ne demande point que sa
pompe funèbre rappelle ses anciens triomphes ; que des chants
lugubres retentissent à son passage; que les citoyens, avec un
saint respect, le portent comme leur père, et qu'une armée en
deuil, et la lance baissée, environne son cercueil. Accorde seulement
à ce héros la sépulture d'un homme du peuple, et un
bûcher simple, où son corps mutilé se consume sans parfum.
Donne à l'infortuné un peu de bois et un pauvre homme pour
l'allumer. C'est bien assez, grands dieux! de le priver des larmes
de Cornélie. Si elle était ici je la verrais étendue sur le sable,
et les cheveux épars, auprès du corps de son époux qu'elle
presserait dans ses bras ; mais quoiqu'elle ne soit pas encore
bien éloignée, elle ne peut se joindre à moi pour lui rendre les
derniers devoirs. »
Comme il parlait ainsi, il découvrit de loin le bûcher d'un
jeune homme, qui, négligé par ses amis, brûlait sans qu'aucun d'eux veillât auprès de lui. Il en va dérober la flamme, et dérobant
au cadavre quelques bois à demi brûlés : « Qui que tu
sois, dit-il, ombre délaissée et sans doute peu chère aux tiens,
mais moins malheureuse que celle de Pompée, pardonne à une
main étrangère de violer ton bûcher. S'il reste encore quelque
sentiment au delà de la vie, cède toi-même ta place, et loin de
te plaindre qu'on te dérobe une partie de ce bûcher, tu aurais
honte d'en jouir, tandis que les mânes errants de Pompée en
seraient privés. »
Il dit, remplit sa robe de cendre ardente, et revient auprès
du cadavre, qui presque emporté par les flots, pendait sur le
bord. Il écarte la surface du sable, ramasse les débris épars
d'une barque brisée, et les dépose sur cet étroit espace. La noble
dépouille n'est pas couverte de branches de chêne, ses
membres ne s'élèvent pas sur un amas de bois; le,feu est
allumé autour de son corps, et non pas dessous. Cordus se
prosterne : « O grand homme, dit-il, ô toi qui fis la gloire du
nom Romain, s'il est plus triste pour toi d'être réduit à ces indignes
funérailles que d'être le jouet des flots, puisse ton ombre
détourner les yeux des devoirs que je te vais rendre. L'iniquité
du sort autorise les soins que je prends pour empêcher que tu ne sois en proie aux animaux dévorants du ciel, de l'onde et de
la terre, ou exposé aux outrages de la haine de César. Contente-
toi, s'il est possible, de cet indigne bûcher; une main romaine
te l'élève. Si le ciel me permet jamais de retourner dans
l'Italie, tes cendres sacrées ne resteront point dans ce profane
lieu. Cornélie les recevra de ma main, et les déposera dans
une urne. En attendant, laissons sur ce rivage quelque marque
qui enseigne le lieu de ta sépulture, et si quelqu'un veut
apaiser tes mânes et les honorer dignement, qu'il sache où retrouver
tes cendres, de ce tronc mutilé qu'il sache où rapporter
la tête. » Ainsi parlait le vieillard; et de son souffle, il
excitait la flamme et le corps du héros se consumait lentement
dans le feu qu'alimente sa substance.
Dès que le jour commence à luire, dès que les astres pâlissent,
Cordus, tremblant d'être surpris, s'éloigne et va se cacher. Malheureux,
quel châtiment crains-tu? Ce crime fera éternellement
répéter ton nom par l'infatigable renommée ! César, l'impie César
te rendra grâce pour la sépulture rendue à son gendre. Va donc
sans peur, avoue ces funérailles et réclame la tête; mais sa
piélé ne lui permet pas de laisser les funérailles imparfaites. Il revient, retire des flammes le corps à demi consumé, et l'ensevelit
sous le sable. De peur que le vent n'en disperse les
cendres, il les couvre d'une pierre; et pour qu'un matelot ne
l'ébranle pas en y attachant son câble, sur un pieu à demi brûlé,
il grave ces mots : Ici repose le grand Pompée.
O Fortune! voilà ce que tu veux qu'on appelle le tombeau de
Pompée, asile misérable où César aime mieux le voir que privé
de sépulture. Main téméraire, pourquoi ce tombeau, pourquoi
cette prison aux mânes errants de Pompée? La terre entière
est leur asile, jusqu'aux lieux où les rives du monde pendent
sur l'Océan. Le nom romain, l'empire entier, telle est la mesure
du tombeau de Pompée. Enfouis cette pierre, témoignage accusateur
du crime des dieux. L'OEta tout entier est le tombeau
d'Hercule, Bacchus a toutes les hauteurs de Nysa, et Pompée
n'a dans l'Egypte qu'une pierre? Il peut occuper tous les domaines
de Ptolémée. Àh ! que du moins aucune marque n'indique
sa sépulture. Alors toute l'Egypte lui sera consacrée;
et incertains du lieu où il repose, les peuples ne fouleront
qu'avec respect la terre qui peut le couvrir. Si tu veux, Cordus
graver un nom si sacré sur la pierre, ajoutes-y tous ses hauts faits. Joins-y la révolte du cruel Lépide, les guerres alpestres.
Sertorius vaincu après le rappel du consul., le char de triomphe
où il monta simple chevalier, le commerce du monde assuré,
les Ciliciens chassés de la mer; joins-y les barbares vaincus,
ainsi que tant de nations nomades et tous les royaumes de
l'Orient et du Nord. Dis que toujours au retour de la guerre il
reprit la toge du citoyen, que satisfait de trois triomphes, il fit
hommage à la patrie de ses mille trophées. Quel tombeau contiendra
tant de hauts faits? Un misérable bûcher, c'est tout ce
qu'obtient Pompée, sans titres, sans la liste de ses aïeux. Ce
nom que Rome lisait au fronton de tous ses temples et sur les
arcs décorés des dépouilles des nations, ce nom est à peine gravé
plus haut que le sable, sur une pierre que l'étranger ne peut lire
sans se baisser, et que le Romain passerait inaperçue s'il n'était prévenu. Égyple ! terre souillée par nos guerres civiles, que la
prêtresse de Cumes était bien inspirée quand elle défendait au
soldat romain de toucher à la rive du Nil, à ses bords gonflés
par l'été. Terre cruelle, quel malheur te voue pour un pareil
crime? Que le Nil fasse retourner ses eaux aux lieux qui le
voient naître, que tes campagnes stériles appellent en vain les
pluies d'hiver; qu'elles se changent en poussière plus impalpable que celle de l'Ethiopie. Tandis que Rome reçoit dans ses
temples ton Isis et tes chiens demi-dieux, et ton sistre qui
commande le deuil, et cet Osiris dont les pleurs trahissent la
nature mortelle, tu laisses les mânes de Pompée dans la poussière!
Mais toi, Rome, qui as consacré des temples à ton tyran,
tu n'as pas encore daigné faire apporter dans tes murs les restes
de ton défenseur ! Son ombre est encore exilée ! Tu as pu
craindre autrefois d'irriter son vainqueur; mais aujourd'hui qui
peut t'empêcher de remplir un devoir si juste? Et si ta mer n'a
point submergé le tombeau de Pompée, qui craindra de profaner
ses cendres, qui ne prendra soin de les recueillir dans une
urne digne de lui? Que Rome commande ce crime et m'ordonne
de les recueillir dans mon sein! Heureux, s'il m'était donné
d'aller les arracher à la terre pour les rendre à l'Italie et profaner
la sépulture du héros ! Un jour peut-être, Rome demandant
aux dieux la fin d'une disette, d'un vent meurtrier, d'un
incendie sans mesure, d'un tremblement de terre, par le conseil
des dieux. Pompée, tu reviendras dans Rome, ta conquête, et le
grand prêtre portera ta cendre.
Et quel voyageur se rendant à Syène, brûlée par le Cancer, visitera la stérile Thèbes, sous la pléiade pluvieuse; quel marchand
traversant les eaux profondes et dormantes de la mer
Rouge, abordera aux ports des Arabes, sans visiter aussi la
pierre vénérable de ton tombeau et
ton auguste cendre, ô
Pompée, confondue peut-être avec le sable du désert; sans
apaiser tes mânes dont la majesté égaie celle de Jupiter Casien ?
L'indignité de ce tombeau ne nuira pointa ta mémoire; tes
cendres placées dans nos temples et enfermées dans un vase
d'or, imprimeraient moins de respect. Cette pierre, battue par
la mer de Libye, a quelque chose de plus auguste, de plus imposant
que des autels. Souvent, tel qui refuse son encens aux
dieux du Capitole, adore le monceau de terre où sont cachés les
débris de la foudre. Ce sera même dans l'avenir un avantage
pour toi, Pompée, de n'avoir pas eu pour tombeau un marbre
superbe et durable. Dans peu, cet amas de poussière sera dissipé;
dans peu, la pierre où ton nom est gravé sera ensevelie;
il ne restera plus aucun vestige de ta mort, et ce que l'Egypte
racontera de ta sépulture paraîtra peut-être aussi fabuleux que
ce que la Crète raconte de celle de Jupiter.
Apothéose de Pompée. — Caton devient l'appui de la patrie chancelante; il
ranime les courages, se rend à Corcyre, recueille les débris de Pharsale et passe
en Afrique. — Plaintes amères de Cornélie en s'éloignaut du rivage de l'Egypte,
où ses yeux ont vu brûler la dépouille de son infortuné époux. — Son discours
au fils de Pompée. — Son affliction, son désespoir. — Elle et Sextus rejoignent
Catou. — Cnéius, le fils aîné de Pompée, a reconnu du rivage les compagnons
de son père. — Sou frère est avec eux. — Il demande où est son père. — Sextus
lui raconte le sanglant sacrifice. — Fureurs de Cnéius contre les assassins du
héros. — Il veut venger sur-le-champ sa mort. — Honneurs funèbres rendus
dans le camp à la mémoire du héros. — Hommage de Caton. — Cependant la
discorde frémit dans le camp; Tarchondimotus donne le signal de la désertion.
— Reproches amers de Caton. — Discours du chef des Ciliciens qui veut se
justifier. — Les Romains eux-mêmes sont entraînés dans la révolte. — Harangue
de Caton qui les ramène au devoir. — Politique de Caton pour tenir occupés les
soldats. — Il décide d'aller aux confins du pays des Maures, dans les États de
Juba. — Description des Syrtes. — Il tente le trajet par mer. — Une tempête
le force d'y renoncer. — Il résout de faire le tour des Syrtes à travers les sables
de la Libye. — Discours qu'il adresse à ses soldats avant de se mettre en marche.
— Description de l'Afrique, et en particulier de la Libye. — Hordes sauvages.
— Le Nasamon, le Garamante. — Tempête élevée sur le sable. — L'armée est
près de s'ensevelir sous des monceaux de poussière. — Une étouffante chaleur
succède : un soldat découvre un imperceptible filet d'eau; il recueille quelques
gouttes qu'il vient offrir à Caton. — Reproches sévères du héros. — On arrive
au temple d'Ammon : description du site ; notions astronomiques ou sphériques.—
Discours de Labienus à Caton pour l'engagea à consulter le dieu. — Réponse de
Caton. -— Fermeté, constance du héros. — Caton est le dieu digne des autels de Rome.—Caton, pour donner l'exemple à ses soldats, s'abreuve à une source
peut-être empoisonnée. — Pourquoi la Libye est-elle peuplée de serpents? —
Fable de Méduse. — Persée vainqueur de la Gorgone.
— Son retour, ou plutôt
son vol au travers de la Libye. — Cette contrée arrosée du sang que distille la
tête de Méduse. — De là le germe, l'origine des reptiles. — Dénombrement et
caractère de chacun.— Mort du jeune Aulus; ses fureurs. — Sabellus succombe
à son tour, mordu par un seps. — Symptômes de son mal. — Autres victimes
Nasidius périt de l'atteinte du prester ; Tullus, de celle de l'hémorrhoïs : éloge du
jeune guerrier. — Lévus meurt, à son tour, mordu par l'aspic. —Le jaculus. —Murrus perce un basilic du fer de sa lance. — Il est forcé aussitôt de se couper
le bras. — Plaintes des guerriers; leurs regrets, leurs voeux. — Fermeté d'âme
de Caton. — Histoire des Psylles : la nature les a rendus invulnérables. — Services
qu'ils rendent aux Romains. — Enfin le désert est franchi : arrivée à
Leptis. — César, après la bataille de Pharsale, était passé en Phrygie : il visite les
ruines de Troie. — Le poëte promet à César l'immortalité. — Prière de César
aux dieux de ses pères. — Il regagne sa flotte et fait voile pour l'Egypte. — On
lui présente la tête de Pompée. — Sa feinte indignation en recevant ce présent.
— Nul ne croit à ses regrets.
Les mânes de Pompée ne restèrent point ensevelis dans la
poussière de l'Egypte. Un peu de cendre ne saurait retenir une
si grande ombre. Ils se détachent de son corps à demi-consumé,
fuient l'indigne bûcher et s'élancent vers les régions éthérées.
C'est entre le ciel étoile et l'air ténébreux qui enveloppe la
terre qu'habitent les demi-dieux. Cette incorruptible vertu qui
dans le cours de leur vie mortelle a conservé leur âme innocente,
l'élève au ciel dans les sphères éternelles. Ce n'est point
l'encens qui parfume les morts, ni l'urne d'or qui enferme leur
cendre qui les fait arriver dans ce lieu fortuné. Dès que Pompée
y est parvenu, qu'il s'est pénétré de la vraie lumière et qu'il a
contemplé tous ces globes étincelants, dont les uns roulent sur
nos têtes, et les autres sont fixes aux deux pôles des cieux; il
regarde le jour d'ici-bas comme une lueur qui se perd au sein
d'une profonde nuit et sourit de l'outrage fait à sa dépouille. De là, il plane sur tes champs de la Thessalie, sur les drapeaux
sanglants de César et sur les mers où sont encore répandues
toutes ses flottes. Ce génie vengeur du crime se repose au sein
du vertueux Brutus et va se fixer dans l'âme de l'inflexible Caton.
Tandis que le sort de la guerre était en suspens et qu'on
pouvait douter quel maître la victoire allait donner au monde,
Caton avait haï Pompée, quoiqu'il eût suivi ses drapeaux sous
les auspices de la patrie et à l'exemple du sénat ; mais depuis
le malheur de Pharsale, toute l'âme de Caton s'était livrée au
vaincu. Il embrassa la patrie désolée et sans appui; il réchauffa
les coeurs des peuples, que la frayeur avait glacés; il remit
l'épée dans les mains tremblantes qui l'avaient laissé tomber
et soutint la guerre civile, sans désir de régner, sans crainte
de servir. Caton ne fit rien, sous les armes, pour sa propre
cause, et depuis la mort de Pompée son parti fut uniquement le
parti de la liberté. Les forces en étaient dispersées et la rapidité
du vainqueur pouvait les enlever; Caton se hâte de les recueillir.
Il se rend à Corcyre, et sur mille vaisseaux, il emporte
avec lui les débris de Pharsale. Sur cette flotte immense dont
la mer, trop étroite, est couverte, qui croirait voir une armée
en fuite? Il se dirige vers la dorienne Malée, vers Ténare, qui communique au séjour des morts. De là, il aborde à Cythère,
et Borée qui enfle ses voiles lui fait raser l'île de Crète dont le
rivage paraît s'enfuir. Phycunte ose lui fermer son port, il
l'assiège et lui inflige le châtiment du pillage. Bientôt à la faveur
d'un vent paisible, quittant la haute mer, il gagne la côte
de Palinure (car l'Àusonie n'est pas la seule où ce pilote des
Troyens ait laissé son nom, la Libye a des témoignages qu'il se
plaisait dans ses tranquilles ports). Là, des vaisseaux qu'on découvre
de loin et qui voguent à pleines voiles, tiennent les esprits
dans le doute : apportent-ils des ennemis ou des compagnons
d'infortune? L'activité du vainqueur fait tout craindre,
dans chaque navire on tremble de voir César; mais ceux-ci ne
sont pleins que de deuil, de gémissements et de maux capables
d'arracher des larmes, même à l'inflexible Caton.
Cornélie ayant engagé inutilement Sextus et sa flotte à retarder
leur fuite pour voir si le corps de Pompée poussé vers le
rivage de l'Egypte ne serait pas ramené par les flots, et la
flamme d'un bûcher lui annonçant de loin une humble sépulture
: « O ciel ! dit-elle, je n'étais donc pas digne d'allumer le
bûcher de mon époux, de tomber moi-même sur son corps glacé,
de le serrer entre mes bras, d'arroser ses plaies de mes larmes, de le placer au-dessus des flammes, d'y brûler mes cheveux arrachés
de ma main et de recueillir dans les plis de ma robe ses
cendres brûlantes encore pour distribuer dans nos temples tout ce
qui resterait de lui. Son corps brûle dénué de tous les honneurs
funèbres : c'est peut-être un Égyptien qui rend à ses mânes ce
devoir odieux! Ombre de Crassus! réjouis-toi d'être privée de
la sépulture! celle qu'on accorde à Pompée est un nouveau
trait de la haine des dieux. Quoi! mon malheur est donc partout
le même? jamais il ne me sera permis d'ensevelir mes
époux et jamais je ne pleurerai sur une urne pleine de leurs
cendres! Que dis-tu, Cornélie? te faut-il un tombeau pour
entretenir ta douleur? ton coeur n'est-il pas tout rempli de
Pompée? son image n'est-elle pas gravée au fond de ton âme?
Àh ! que celle qui veut survivre à son époux cherche des cendres
qui la consolent. Cependant cette faible lueur que j'aperçois
de loin, Pompée, c'est la flamme de ton bûcher, c'est quelque
chose de toi encore! Hélas! ce feu se dérobe à moi, la fumée
qui emporte Pompée s'évanouit dans l'air aux rayons du
soleil naissant. Les vents contraires à mes voeux enflent la
voile qui m'éloigne. Les lieux témoins de ses victoires, le Capitole
même où il a triomphé me seraient moins chers que ces bords : Pompée heureux est oublié de moi, je le veux tel
que le Nil le possède. Je ne me plaindrai point de rester sur
une terre coupable; le crime a consacré ces lieux. Sextus,
c'est à toi de tenter le sort des combats. Porte par tout l'univers
les étendards de ton père; écoute ce qu'il m'a chargée
de dire à ses enfants : « Dès que mon heure sera venue et que
j'aurai fermé les yeux, mes fils, prenez tous deux en mains les
flambeaux de la guerre civile; et tant qu'il restera sur la terre
quelque rejeton de ma race, qu'il ne soit pas permis aux Césars
de régner. Soulevez au bruit de mon nom tout ce qu'il peut y
avoir au monde de rois indépendants et de cités libres. Voilà le
parti que je vous laisse, les armes que je vous remets. Quiconque
portera sur les mers le nom de Pompée, y trouvera des
flottes. Il n'est aucun peuple qui ne consente à suivre mon héritier
dans les combats. Conservez seulement une âme indomptable
et n'oubliez jamais quel père vous vengez. Il n'y a sous
le ciel qu'un seul homme à qui vous puissiez obéir s'il prend la
défense de la liberté : c'est Caton. » C'en est fait, Pompée, j'ai
acquitté ma foi, j'ai accompli ta volonté dernière. Ton piège a
réussi. Je n'ai pas voulu emporter au tombeau tes paroles. Je suis
libre enfin de te suivre à travers l'éternelle nuit et aux enfers, s'il y a des enfers. J'ignore combien durera cette mort lente; mais
si mon âme tarde à rompre ses liens, si elle a pu te voir expirer
sans voler après toi, elle en sera cruellement punie. Consumée
par la tristesse, étouffée par les sanglots, c'est avec mes larmes
qu'il faut qu'elle s'écoule. Je n'aurai recours ni au fer, ni au
lien fatal, ni au précipice. Il serait honteux pour moi de ne
pouvoir mourir de ma seule douleur. » En parlant ainsi, elle
s'enveloppe la tête de lugubres voiles, et se dévouant aux ténèbres,
elle se jette au fond du vaisseau. Là, elle embrasse
étroitement la peine qui la dévore, s'abreuve et jouit de ses
larmes, et sa chère douleur lui tient lieu d'époux. Ni le mugissement
des flots, ni le bruit des vents à travers les cordages, ni
le cri d'effroi qui s'élève dans le vaisseau prêt à périr, rien ne
l'émeut. Elle attend la mort, déjà étendue comme dans un cercueil,
et au milieu de la tempête, elle fait pour elle-même des
voeux contraires aux voeux des matelots.
Ce fut d'abord au rivage de Chypre, que la poussa la mer
écumante. Mais bientôt s'élève du côté de l'aurore un vent plus
doux, qui la conduit aux bords de la Libye, vers le camp même
de Caton.
L'aîné des enfants de Pompée, plongé dans une tristesse
morne, l'esprit frappé du noir pressentiment qui annonce les grands malheurs, reconnaît du haut du rivage les compagnons
de son père, et voyant son frère avec eux, il s'élance sur leur
vaisseau : « Sextus, lui dit-il, où est mon père? l'appui de
Rome, le chef des nations est-il vivant? ou Rome, en le perdant,
a-t-elle tout perdu? Son frère lui répond : « Que vous
êtes heureux d'avoir abordé loin de l'Egypte, et de n'avoir que
la douleur d'entendre le crime dont mes yeux ont été les témoins!
Pompée est mort, et ce n'est ni par le glaive de César,
ni par une main digne de ce grand parricide. L'infâme roi du
Nil en est l'auteur. Pompée s'était livré à lui sous la garde des
dieux garants de l'hospitalité, et sur la foi de ses bienfaits
prodigués à cette indigne race. Il est mort victime d'un roi
qu'il avait couronné, j'ai vu de lâches meurtriers déchirer le
sein de mon père, et ne pouvant me persuader que le tyran
de l'Egypte eût pris sur lui cet attentat, je croyais que César
nous y avait devancés. Mais j'ai été moins saisi d'horreur
de voir assassiner ce vieillard auguste, que de voir sa tête
portée en triomphe au palais du tyran. Sans doute il attend le
vainqueur pour la lui offrir, et il la garde pour attester son
crime. A l'égard du corps du héros, nous ignorons s'il est en
proie aux oiseaux du ciel et aux chiens voraces de l'Egypte, ou si c'était lui que consumait dans le silence de la nuit un bûcher
que nous avons vu allumé sur le rivage. Quelque injure que ce
corps ait reçue, je pardonne ce crime aux dieux, je les accuse
pour ce qu'ils ont conservé. »
Cnéius à ce récit ne répandit point sa douleur en gémissements
et en larmes; mais sa piété se changeant en fureur :
« Éloignez les vaisseaux du rivage, lancez-les sur les mers ; que
la flotte, à force de rames, lutte et vogue contre les vents.
Chefs, suivez-moi. La guerre n'eut jamais une plus digne
cause. Allons ensevelir les cendres de ce héros; allons rassasier
Pompée du sang d'un vil meurtrier. Quoi! je ne démolirai
point les temples, les palais, les tombeaux de l'Egypte? je
ne plongerai pas le cadavre d'Alexandre dans le lac qui baigne
ses murs? je ne ferai pas traîner dans le Nil les membres d'Amasis
et de ses successeurs, arrachés du fond de leurs pyramides?
Oui, mon père, je vengerai sur eux tes mânes privés de
la sépulture ; je renverserai les statues de leur Isis, je déchirerai
le voile de lin de leur Osiris; c'est sur leurs débris enflammés
que je ferai brûler la tête de Pompée, et le boeuf Apis, tout
sacré qu'il est, sera immolé sur son tombeau. Pour punir cette
odieuse terre, je dévasterai ses campagnes. Le Nil aura beau s'y répandre, nul ne cultivera ses dons. O mon père, tu posséderas
seul l'Egypte, après en avoir vu chasser les hommes et les
dieux. » Il dit, et veut que la flotte s'élance sur le sein des
mers irritées. Mais Caton, témoin de sa fureur, en la louant,
sut l'apaiser.
Cependant le bruit de la mort de Pompée s'étant répandu
dans le camp, tout le rivage retentit de gémissements et de
plaintes. La terre n'avait jamais vu d'exemple d'un si grand
deuil ; jamais tant de peuples ensemble n'avaient pleuré la
mort d'un seul homme. Mais lorsqu'on vit Cornélie, les yeux
épuisés de larmes, le visage couvert de ses cheveux épars, sortir
du fond du vaisseau, alors les cris et les sanglots redoublèrent.
Dès qu'elle est descendue sur une terre amie, elle ramasse
les vêtements et les riches dépouilles de Pompée, ses armes,
ses robes de pourpre, cette parure triomphale que le Capitole
avait vue trois fois, elle les fait brûler sur un bûcher funèbre.
Malheureuse! voilà les cendres qui lui- restent de son époux. Sa
piété servit d'exemple à celle de toute l'armée, et le rivage fut
bientôt couvert de bûchers, consacrés aux mânes de ceux qui
avaient péri dans la Thessalie. Tel quand le laboureur appulien
s'apprête à répandre la semence dans ses champs que les troupeaux
ont dépouillés, et à renouveler les herbes d'hiver, il réchauffe la terre avec le feu, et le Garganus , et le Vultur, et les
pâturages du Matinum brillent des mêmes feux. Mais les regrets de
cette multitude, et les reproches qu'elle faisait aux dieux touchèrent
moins vivement l'ombre de Pompée que les paroles de
Caton; courtes paroles, mais qui partaient d'un coeur plein de
la vérité.
« Un citoyen est mort, dit-il, qui, sans approcher de l'austère
équité de nos pères, était cependant un exemple utile dans un
temps où les droits les plus saints sont méconnus. Puissant, il respecta
la liberté. Le peuple eût consenti à l'avoir pour maître, et
il vécut en homme privé; il gouvernait le sénat, mais le sénat
régnait. Il ne s'attribua rien par le droit de la guerre; ce qu'il
voulait qu'on lui accordât, il voulait qu'on fût libre de le lui
refuser. Il posséda d'excessives richesses, mais il en donna plus
à l'État qu'il n'en réserva pour lui. Prompt à saisir le glaive,
il savait, le quitter. Il a préféré les armes à la toge, mais dans
les camps mêmes il a chéri la paix. Chef des armées, il aimait
le pouvoir suprême, il aimait à le déposer. Sa maison fut
chaste, fermée au luxe, incorruptible à la prospérité. Son nom
fut illustre et révéré chez les nations, glorieux pour ftome. Sous
Marius et Sylla, la liberté réelle avait péri ; avec Pompée, l'ombre même s'évanouit. On n'aura plus honte de régner ; plus de
vestiges de république, plus d'apparence de sénat. Heureux,
toi qui trouvas la mort après ta défaite, à qui le crime de Pharos
offrit le glaive qu'il t'eût fallu chercher; tu aurais pu peut-être
vivre sujet de César. Savoir mourir est le premier bien d'un
homme de coeur ; le second, d'y être forcé. O Fortune! s'il faut
que Rome subisse le joug d'un tyran, fais pour moi de Juba un
nouveau Ptolémée? Qu'il me garde pour César, j'y consens,
pourvu qu'il commence par me trancher la tête. »
L'ombre généreuse de Pompée entendit ces paroles, et ce fut
pour lui un plus grand honneur que si la tribune,romaine eût
retenti de ses louanges.
Cependant la discorde s'élève dans le camp. Le soldat, découragé
par la mort de Pompée, demande à quitter les armes ;
et Tarchondimotus donne le signal de la désertion. Caton qui
le vit prêt à s'échapper avec sa flotte, accourut au rivage et le
flétrit par ces reproches : « Cilicien qui jamais n'as renoncé
au brigandage, vas-tu de nouveau infester les mers? Pompée
n'est plus, tu redeviens pirate. ». En disant ces mots, il regardait
tous ces séditieux en tumulte. L'un d'eux alors, sans dissimuler
la résolution de s'enfuir : « Pardonne, Caton, lui dit-il, c'est pour Pompée que nous avons pris les armes et non pour
la guerre civile. Celui que l'univers préférait à la paix ne vit
plus; sa cause devient étrangère pour nous. Permets-nous d'aller
revoir nos dieux domestiques, notre foyer désert, nos chers enfants.
Quel sera le terme de cette guerre, si Pharsale, si la mort
même de Pompée n'en est pas la fin? Le temps de vivre est passé
pour nous; laisse-nous chercher une mort tranquille et assurer
à notre vieillesse un tombeau. A peine la guerre civile promet-elle
là sépulture à ses chefs. Les vaincus sont-ils condamnés à
subir le joug d'un barbare? Est-ce au pouvoir du Scythe ou de
l'Arménien que la fortune nous fait tomber? Non : c'est au pouvoir
d'un simple citoyen. Celui qui, du vivant de Pompée, fut
le second, est aujourd'hui le premier pour nous. Fidèles à la
mémoire de Pompée, nous lui rendons cet honneur insigne de
souffrir après lui le maître que le sort nous donne, mais de
n'avoir plus de chef de notre choix. O Pompée ! tu seras le seul
que nous aurons suivi dans les combats, après toi, c'est au
destin que nous nous laisserons conduire. Tout est soumis, tout
est livré à la fortune de César. Sa victoire a dissipé nos forces.
Les malheureux n'ont point d'amis, tous les coeurs leur sont
fermés. César est donc dans l'univers le seul assez puissant pour être le refuge et le salut des vaincus. Sous Pompée, la guerre
civile était pour nous un devoir; à présent elle serait un crime.
Toi, Caton, si c'est le parti des lois et de la patrie que tu veux
suivre, imite-nous, et viens te ranger sous les drapeaux d'un
consul romain. »
En parlant ainsi, il s'élance sur la poupe, et une bruyante
jeunesse s'y jette en foule sur ses pas. C'en était fait de Rome,
et sur tout le rivage s'agitait la foule avide d'un maître. Ces
paroles sortent de la poitrine sacrée de Caton :
« Et vous aussi, Romains, vous n'avez combattu que pour
le choix d'un maître! C'est donc le drapeau de Pompée et
non celui de Rome que vous avez suivi ? Quoi ! dès l'instant
que vous cessez de travailler à vous donner des chaînes, que
vous vivez pour vous et non plus pour un chef, qu'en mourant,
du moins, vous n'avez plus à craindre d'avoir acquis au prix de
votre sang l'empire du monde à un homme, et que vous êtes
sûrs, si vous venez à vaincre, de n'avoir vaincu que pour vous,
vous vous rebutez de la guerre! votre tête à peine est délivrée
du joug, qu'elle veut le reprendre, et vous ne pouvez plus vous
passer d'un roi ! Ah ! c'est à présent, si vous êtes des hommes,
qu'il est digne de vous d'affronter les dangers. Pompée lui-même
pouvait abuser de votre sang ; désormais c'est pour la patrie que vous refusez de tirer l'épée et de braver la mort quand la liberté
est près de vous. De trois tyrans, un seul vous reste, et vous aurez
la honte de souffrir que l'Égyptien, que le Parthe avec son
arc ait plus fait pour vos lois que vous-mêmes ! Allez ! coeurs dégradés,
rendez le crime de Ptolémée inutile ! On n'aura garde
de vous accuser d'avoir trempé vos mains dans le sang ; César
croira bien plutôt que c'est vous qui, les premiers, avez tourné
le dos dans la déroute de Pharsale. Allez en toute sûreté vous
présenter à César, il est juste qu'il vous laisse la vie, puisque vous
vous rendez à lui sans avoir soutenu ni siège, ni combat. O vils
esclaves! en perdant votre maître vous courez vers son héritier!
Que ne méritez-vous de lui plus que la vie et le pardon?
Vous avez en vos mains la fille de Mctellus, la femme et les fils
de Pompée; traînez-les aux pieds de César, renchérissez sur le
présent que Ptolémée lui prépare. Celui qui portera ma tète au
tyran peut en attendre aussi un prix considérable, et cette récompense
vous prouvera du moins qu'il était bon de suivre mes
drapeaux. Prenez courage, et par un illustre crime signalez vous
aux yeux de César. La fuite seule ne serait qu'une lâcheté!
» Il dit, et ces paroles ramènent au rivage les vaisseaux
qui gagnaient la mer. Tels on voit des essaims d'abeilles en quittant les cellules
où elles sont écloses oublier leur premier asile, et au lieu
d'entrelacer leurs ailes, voler sans guide et chacune à son gré;
les fleurs n'ont plus d'attraits pour elles; elles dédaignent d'y
goûter. Mais si le son de l'airain phrygien se fait entendre, saisies
d'étonnement, elles suspendent leur essor; l'ardeur du travail,
l'amour des fleurs, le désir d'en extraire le miel se réveille
en elles; et le pasteur rassuré, tranquille sur le gazon du mont
Hybla, se réjouit d'avoir conservé la richesse de sa cabane. De
même, la voix de Caton leur inspire le courage de souffrir tous
les maux d'une juste guerre.
Dès lors, il se proposa de tenir sans cesse occupés aux durs
exercices des armes une multitude d'hommes qui n'avaient
point, appris à supporter le repos.
Il commença par les fatiguer sur les sables de ce rivage, et le
siège de Cyrènes fut le premier de leurs travaux. Quoique cette
ville eût d'abord été fermée au parti de Caton, il n'en tira aucune
vengeance : sa victoire est la seule peine qu'il fait subir
aux vaincus.
De là, il veut, aller vers les confins du Maure, se joindre avec
le roi Juba. Les Syrtes s'opposent à son passage; mais quel
que soit l'obstacle, sa vertu courageuse espère le surmonter.
Quand la nature donna au monde sa première forme, elle laissa les Syrtes indécises entre la terre et l'onde; car elles ne
sont absolument ni sous les eaux, ni au-dessus. Limite incertaine,
élément douteux, et des deux, côtés inaccessible, c'est
une mer interrompue par des écueils, c'est une terre sillonnée
par les courants d'une mer profonde. La nature a laissé inutile
cette partie d'elle-même. Peut-être aussi qu'autrefois les Syrtes
étaient pleinement inondées; mais le rapide soleil qui nourrit
dans la mer ses dévorantes flammes, épuise sans cesse les
eaux qui sont le plus près de la zone brûlante, et la mer lui
dispute encore les terres qu'il veut dessécher. Le temps viendra
cependant que les Syrtes seront une terre ferme, car dès à présent
même, le fond n'en est couvert que d'une légère surface
d'eau; et cette mer qui doit tarir un jour commence à disparaître.
Dès que la rame, en siltonnant les ondes, a lancé la flotte
loin du port, le vent du midi se lève environné de nuages et
déchaîné contre ses propres domaines. Ce vent soulève la mer,
et la chasse loin des sables de la Libye, dont il lui fait un rivage
nouveau. Malheur aux vaisseaux dont il saisit la voile : malgré
tout l'effort des cordages, il la fait voler par-dessus la proue, et la tient enflée au delà. Que le nocher la ploie et l'attache aux
antennes. Prévoyance inutile; les antennes mêmes se brisent,
et le mât reste dépouillé. Plus heureux sont les vaisseaux que
la tempête emporte en pleine mer et qui luttent contre les flots
ordinaires. Ceux des vaisseaux qui ont perdu leurs mâts, échappés
à la fureur du vent, deviennent le jouet de l'onde, et sont
jetés sur les écueils. Là, tandis que la proue appuie sur le
sable, la poupe est suspendue et flotte sur les eaux; et le navire,
entre deux périls, a d'un côté la terre qui menace de le
briser, de l'autre, la vague irritée qui s'efforce de l'engloutir.
C'est alors que l'onde plus violemment agitée se brise contre
l'obstacle qu'elle rencontre. Quoique repoussé par l'Auster, le
flot ne peut vaincre ces amas de sable. Sur la face de la mer
s'élève au loin une montagne de poussière que l'onde ne peut
entamer. Le malheureux matelot reste immobile, sa carène
est engagée dans le sol, il ne voit plus de rivage. C'est ainsi
que s'égare une partie de la flotte. Le plus grand nombre des
vaisseaux, guidés par de sages pilotes, et sûrs de leur route
avec des matelots à qui ce rivage est connu, vont aborder au
marais dormant de Triton. Le dieu dont la trompe fait retentir tous les rivages de la mer, se plaît, dit-on, dans ce lac paisible,
qui n'est pas moins cher à Pallas. Quand cette déesse fut née
de la tête de Jupiter, elle vint sur la terre, et ce fut en Lybie
(de tous les climats, c'est le plus près du ciel, comme le prouve
sa chaleur), ce fut là qu'elle descendit. Elle se vit pour la première
fois dans le cristal de ces tranquilles eaux; son pied se
posa sur leur rive ; et ce lieu fut si agréable à la déesse, qu'elle
en prit elle-même le nom de Tritonide.
Non loin de là serpente le Léthé taciturne : on dit qu'il puise
l'oubli aux sources infernales. Sur ces mêmes bords fleurissait
le jardin des Hespérides, qui, sous la garde d'un vigilant dragon,
portait jadis des fruits dorés; aujourd'hui il est pauvre et
dépouillé de son feuillage. Que l'envie dispute à l'antiquité ses
prodiges, et à la poésie son merveilleux; elle fut, oui, elle fut
cette forêt aux rameaux chargés d'or et de jaunes bourgeons.
Le soin en était confié à une troupe de jeunes vierges : et un
dragon, dont jamais le sommeil n'appesantit la paupière, embrassant
la tige des arbres, gardait ce jardin précieux. Ce fut
Aicide qui en enleva les fruits, devenus sa conquête, et qui laissant
la forêt dépouillée de ses trésors, les apporta au tyran d'Argos.
La flotte, repoussée de ces bords et chassée des Syrtes, ne s'exposa point au delà des Garamantes ; mais sous le fils aîné
de Pompée, elle se tint dans les ports de la côte la plus riche
de la Libye. Mais la vertu de Caton ne pouvant demeurer oisive,
il ose se frayer une route par des régions inconnues; et
se confiant à ses armes, il veut tourner du côté de la terre les
Syrtes qu'il n'a pu franchir. L'hiver même l'y détermine, car
il lui interdit la mer : les pluies qu'il fait espérer, rassurent
ceux que les chaleurs effrayent; ni le soleil, ni les frimas ne
rendent la roule difficile dans cette saison, et sous le ciel de
Libye, la chaleur et le froid mutuellement se tempèrent,
Caton, avant de s'engager dans ces stériles sables, tient ce
discours à son armée. « O vous qui en suivant mes drapeaux
ne demandez qu'à mourir libres, el la tête haute, tenez vos âmes
préparées aux grands efforts de la vertu et aux grands travaux.
Nous allons traverser des déserts brûlés par l'ardeur dévorante
du .soleil, où l'on trouve à peine quelques sources d'eau, et qui
sont peuplés de serpents venimeux. Le voyage est pénible,
mais il mène au secours des lois et de la patrie expirante. Que
ceux-là viennent avec moi, à travers les sables infranchissables
ceux qui n'ont pas fait voeu d'échapper, ceux pour qui c'est
assez d'aller; car je ne veux tromper personne, ni engager une foule timide à me suivre en cachant ma crainte au fond
du coeur. Je ne veux pour compagnons que ceux dont le courage
s'accroît dans les dangers, et qui, sur ma foi, ne connaissent
rien de plus beau ni de plus romain que de souffrir les plus
grands maux. Mais si quelqu'un a besoin qu'on lui réponde de
son salut, s'il tient aux douceurs de la vie, qu'il s'en aille chercher
un maître par un chemin plus facile. Dès que j'aurai mis
le pied sur le sable, que le soleil darde sur moi ses feux, que
des serpents gonflés de venin m'environnent; je veux éprouver
le premier tous les périls qui vous menaceront. Si quelqu'un
me voit boire avant lui, qu'il se plaigne de souffrir la soif;
qu'il se plaigne de la chaleur s'il me voit chercher un ombrage;
qu'il tombe sans haleine s'il me voit aller à cheval à la tête de
mes cohortes, ou si on distingue à quelque marque le chef entre
les soldats. Les serpents, la soif, la chaleur, l'aridité de ces
vastes plaine sont des délices pour la vertu. C'est dans les
dures extrémités que la patience triomphe. L'honneur a plus
de charme étant payé d'un plus haut prix. Il fallait tous les
maux de la Libye pour excuser notre fuite. »
Ainsi Caton remplit tous les coeurs du feu de sa vertu, et de
l'amour des travaux pénibles. A l'instant même il prend sa route sur ce rivage qu'il ne doit plus revoir; et la Libye, où ce
grand homme va être enseveli dans un humble tombeau, s'empare
sans pâlir de sa destinée.
Si l'on en croit l'opinion commune, l'Afrique est la troisième
partie du monde; mais, par ses vents et son ciel, elle fait partie
de l'Europe. Car le Nil n'est pas plus éloigné que le Tanaïs
de cette pointe de Gadès, où l'Europe se sépare de la Libye,
où les rivages fléchissent pour faire place à l'Océan. L'Asie à,
elle seule forme un plus vaste monde. Elle partage avec l'une
les climats du Midi, les climats du Nord avec l'autre; et tandis
qu'elles deux s'unissent pour embrasser l'Occident, tout l'Orient
est occupé par elle.
La Libye n'est fertile que sur sa rive occidentale, encore n'at-elle point de sources qui l'arrosent; quelquefois les aquilons
vont répandre en pluie les nuages du Nord, et la sérénité de
notre ciel fait la richesse de cette terre. Elle ne produit rien de
pernicieux : ni l'or, ni le fer ne germent dans son sein. Innocente
et pure, elle ne contient que les éléments de la végétation. Ce
qu'a de plus précieux le Maure, ce sont ses forets de citronniers,
dont même il ignore l'usage. Pour, lui, le feuillage et l'ombre de
ces bois en faisaient toute la valeur. Ce furent nos mains qui portèrent la hache dans ces forêts inconnues, quand notre luxe
alla chercher aux extrémités du monde des tables pour nos festins. Mais la côte qui embrasse les Syrtes, placée sous un ciel
trop ardent, et voisine de la brûlante zone, étouffe sous un
sable aride les dons de Cérès et de Bacehus. Aucune racine n'y
: trouve à s'attacher : cette terre a perdu les germes de la vie;
le ciel ne prend aucun soin de lui rendre la fécondité. La nature
y languit dans un stérile engourdissement, et l'influence
des saisons ne se fait point sentir à ces sables arides. Seulement
il y naît çà et là quelques plantes sauvages dont le Nazamon
se nourrit, Ce peuple dur et farouche habite nu aux environs
des Syrtes ; il fait son butin des débris des vaisseaux qui
sont jetés sur les écueils. Du haut des sables du rivage, ces brigands
attendent leur proie, et sans que jamais aucun vaisseau
arrive au port, ils connaissent les richesses. C'est ainsi que,
par des naufrages, le Nazamon est en commerce avec l'univers.
Telle est la route que l'austère vertu ordonne à Caton de
suivre. C'est là qu'une jeunesse; qui se croyait en sûreté du
côté des vents et des tempêtes, retrouva tous les périls, toutes
les frayeurs de la mer ; car le vent du midi est bien plus furieux
sur ce rivage que sur les flots et il y fait bien plus de ravages. La Libye n'a point de montagne qui s'oppose à sa violence, ni
de rocher qui rompe et qui dissipe ses tourbillons impétueux.
Il n'y rencontre point de forêts sur lesquelles ses efforts se
brisent, et où il se lasse à tordre et à déraciner des chênes
antiques. Sa course est libre dans ces vastes plaines, et il y
exerce sans obstacle toute la rage qu'Éole inspire à ses enfants.
Il ne mêle point de nuages chargés de pluie aux tourbillons
de sable dont il obscurcit l'air. C'est une colonne de poussière
qu'il élève et tient suspendue, sans en laisser échapper ni
retomber le sommet. Le malheureux Nazamon voit le sol qu'il
habite enlevé, et ses cabanes renversées; le toit qui couvre le
Garamante vole dispersé dans les airs. La flamme ne lance
pas plus haut l'étincelle qu'elle fait éclater; et autant qu'on
voit s'élever les flots de fumée qui éclipsent le jour, autant s'élèvent
vers le ciel ces noirs tourbillons de poussière. Cette tempête
qui assaillit les Romains fut plus violente que jamais. Le
soldat ne peut plus se tenir debout, le sable même qu'il foule
aux pieds s'échappe et fuit sous ses pas chancelants. On aurait
vu la terre ébranlée si la Libye eût été formée de durs rochers
qui, dans leurs flancs, eussent emprisonné ce vent furieux. Mais
comme le moindre souffle bouleverse ses sables mobiles, elle doit de rester stable à ce qu'elle ne résiste pas, et elle demeure fixe
en ses profondeurs grâce aux ondulations de sa surface. Un
tourbillon rapide emporte et roule dans les airs les casques, les
boucliers, les lances. Qui sait même à quelle distance il les fit
voler; si ce ne fut pas un prodige de voir ces armes tomber du
ciel; et si on ne reçut pas comme un présent des dieux cette
dépouille des hommes? Ainsi peut-être un vent du midi ou du
nord avait arraché à quelque peuple de l'Ausonie ces boucliers
qui tombèrent aux pieds des autels de Numa, et que l'élite de la
jeunesse patricienne porte dans nos solennités. Toute l'armée
s'étend sur la terre dont la surface est bouleversée; et le soldat,
de peur d'être enlevé, ramassant les plis de sa robe, se tient,
non seulement couché, mais des deux mains ancré sur le sable,
à peine encore est-ce assez d'efforts; et dès qu'il se croit affermi,
des flots de sable l'ensevelissent. C'est pour lui un travail à
chaque instant nouveau, que de s'en dégager, et forcé enfin de
se lever debout, il se trouve encore investi par un monceau de
poussière.
Dès que le vent s'est apaisé et que les nuages de sable qui
obscurcissaient l'air se dissipent, l'armée romaine ne voit plus dans cette solitude immense aucune trace de sa route et n'a
plus pour indices des lieux que les astres qu'on a pour guides
sur la vaste plaine des mers. L'horizon de la Libye laissa même
au dessous de lui nombre d'étoiles qui, vers le pôle, dirigent les
matelots. La sérénité d'un ciel brûlant est pour le soldat un
nouveau supplice. Son corps est trempé de sueur et sa bouche
embrasée d'une soif dévorante. Alors on découvre de loin un
filet d'eau qui filtre à peine à travers le sable. Un soldat creusant
cette faible source y puise un peu d'eau dans son casque
et va l'offrir au général. Ils avaient tous la gorge desséchée
d'une brûlante poussière, et cette eau dans les mains de Caton
excitait l'envie de toute l'armée. Mais Caton, au soldat qui la
lui présentait : « Quoi! dit-il, me crois-tu le seul sans vertu
parmi tant d'hommes de courage, et m'as-tu vu si amolli, si peu
capable de soutenir ces premières chaleurs? Homme indigne,
tu mériterais que, pour te punir, je te fisse boire cette eau en
présence de tous ces gens qui éprouvent la soif. » Alors, avec
indignation, il jette le casque par terre, et l'eau répandue leur
suffit à tous.
On approchait de ce temple élevé dans les déserts du grossier
Garamante et le seul qui fût en Libye: Il est consacré à Jupiter, mais le dieu n'y est pas représenté la foudre à la main, comme
sur nos autels : il a des cornes de bélier, on l'appelle Ammon.
La structure de ce temple n'étale point une profane magnificence;
ni le rubis, ni l'or de l'Orient n'éclatent dans les offrandes
qu'on y suspend ; et quoique seul adoré des peuples de l'Ethiopie,
de l'Arabie, et de l'Inde, ce dieu est pauvre, son temple
est pur; il y garde inviolablement la simplicité de son premier
culte; et depuis tant de siècles, il se défend encore de l'or des
Romains.
Une forêt, la seule verdoyante dans toute la Libye, atteste
qn'un dieu y réside; car les sables qui s'étendent depuis les
murs brûlants de Bérénice, jusqu'à la ville de Leptis, n'ont
jamais produit un feuillage; et la forêt d'Ammon est une merveille
unique dans ces climats. Une fontaine qui coule près
du temple est la cause de ce prodige. Le limon qui se mêle au
sable qu'elle arrose le lie en l'humectant. La forêt cependant
n'est pas assez touffue pour faire obstacle aux traits du jour
lorsqu'il se balance au plus haut du ciel. L'arbre à peine alors
en défend sa tige, tant les rayons qui l'environnent chassent
l'ombre vers le centre et l'abrègent de tous côtés. On a reconnu
que c'est là que le cercle du solstice touche à celui des signes
du ciel. Ici leur marche n'est pas oblique ; le Scorpion monte et descend en équilibre avec le Taureau ; le Bélier ne cède pas
ses heures à la Balance; Astrée ne commande pas aux Poissons
de descendre avec lenteur; Chiron reste égal aux Gémeaux, et
le brûlant Cancer au pluvieux Capricorne; le Lion ne s'élève
pas plus haut que le Verseau. Vous tous, peuples séparés de
nous par les feux de la Libye, votre ombre se projette vers le
Sud; la nôtre sur le Nord. À vos yeux. Cynosure se meut
lentement; le Chariot parait se plonger dans la mer; aucun astre
ne luit sur vos fronts qui ne se couche dans l'Océan, et les
constellations, dans leur fuite, semblent entraîner tout dans le
ciel.
Les peuples de l'Orient assiégeaient les portes du temple et
demandaient à consulter l'oracle de Jupiter au front de Bélier.
La foule s'ouvrit avec respect devant le général romain. Les
amis de Caton le conjuraient d'éprouver la vérité de cet oracle,
si célèbre dans l'univers, et de juger s'il méritait sa renommée
antique. Labiénus était celui qui le pressait le plus d'interroger
le ciel sur les événements cachés dans l'avenir. « Le hasard,
disait-il, ou notre bon destin fait trouver sur notre passage
l'oracle du plus grand des dieux; il peut nous conduire au delà
des Syrtes, et nous éclairer sur les succès divers que cette guerre doit avoir; car à qui les dieux confieraient-ils plus intimement
leurs secrets, qu'à la sainteté de Caton? Votre vie a
toujours eu pour règle leur suprême loi. Un dieu vous éclaire
et vous guide. Voici pour vous une occasion de communiquer
avec Jupiter. Demandez-lui quel sera le sort de l'odieux César
et le destin de Rome? si les peuples rentrés dans leurs droits
verront leur liberté et leurs lois rétablies, ou si le fruit de la
guerre civile sera perdu? Remplissez-vous de l'esprit divin,
et passionné pour l'austère vertu, demandez aux dieux en
quoi elle consiste; demandez-leur la règle de l'honnêteté. »
Caton, plein de la divinité qui résidait au fond de son âme,
prononça ces paroles dignes de l'antre prophétique : « Que,
veux-tu, Labiénus, que je demande? Si j'aime mieux mourir
libre, les armes à la main, que de vivre sous un tyran; si cette
vie n'est rien; si la plus longue diffère de la plus courte; s'il y
a quelque force au monde qui puisse nuire à l'homme de bien ;
si la Fortune perd ses menaces quand elle s'attaque à la
Vertu; s'il suffit de vouloir ce qui est louable, et si le succès
ajoute à ce qui est honnête? Nous savons tout cela; Ammon
ne le graverait pas plus profondément dans nos coeurs. Tous
nous tenons aux dieux; et que leur oracle se taise, ce n'est pas moins leur volonté que nous accomplissons. La divinité n'a
pas besoin de paroles ; celui qui nous a fait naître nous dit,
quand nous naissons, tout ce que nous devons savoir. Il n'a
point choisi des sables stériles pour ne s'y communiquer qu'à
un petit nombre d'hommes ; ce n'est point dans cette poussière
qu'il a enfoui la vérité. La divinité a-t-elle d'autre demeure
que la terre, l'onde, le ciel, et le coeur de l'homme juste?
Pourquoi chercher si loin des dieux? Jupiter est tout ce que tu
vois, tout ce que tu sens en toi-même? Que ceux qui, dans un
avenir douteux, portent une âme irrésolue, aillent interroger
le sort ; pour moi, ce n'est point la certitude des oracles qui
me rassure, mais la certitude de la mort. Timide ou courageux,
il faut que l'homme meure. Voilà ce que Jupiter a dit, et
c'est assez. »
Telle fut la réponse de Caton; et sans chercher à affaiblir la
foi qu'on avait à ce temple, il s'éloigne, laissant aux peuples
leur Ammon, qu'il n'a pas voulu éprouver.
Il marche à la tête de ses troupes une lance à la main. Dans
les travaux qu'ils ont à soutenir, son exemple est l'ordre
qu'il donne. On ne le voit ni porté sur les épaules de ses
braves, ni traîné sur un char. Forcé de céder au sommeil, il
plaint le peu de moments qu'il ne peut lui refuser. Si, après
une longue marche, on trouve une eau salutaire, il est le dernier à soulager sa soif; il se tient sur le bord et fait boire avant
lui jusqu'aux valets de son armée.
Si la plus grande gloire est due au plus vraiment homme de
bien, et si l'on considère la vertu en elle-même, sans aucun égard
aux succès, ceux de nos ancêtres que nous vantons le plus, ne
sont, près de Caton, que des hommes heureux. Qui jamais ou par
ses victoires ou par le sang répandu, a mérité un si grand nom?
J'aimerais mieux avoir fait cette marche triomphante autour
des Syrtes, à travers la Libye, que de monter trois fois au Capitole
sur le char de Pompée, ou que de marcher, comme
Marius, sur la tête de Jugurtha. Le voici, Rome, le voici, le vrai père de la patrie, le héros digne de tes autels, celui par qui,
dans aucun temps, tu n'auras honte de jurer; celui dont un
jour, si jamais ta tête se relève libre du joug, tu feras sûrement
un Dieu.
A mesure qu'on avançait sous cette zone que la nature a
interdite aux humains, les rayons du soleil devenaient plus
ardents, les sources d'eau beaucoup plus rares. Cependant on
rencontra au milieu des sables une fontaine abondante, mais si
remplie de serpents, qu'elle avait peine à les contenir. Le froid
aspic se dressait sur ses bords, et la dipsade brûlante au milieu
des eaux n'y pouvait éteindre sa soif. Caton, qui vit que son armée allait périr, si elle s'abstenait de boire à cette source :
« Amis, dit-il, votre frayeur est vaine, la morsure des serpents
est venimeuse; le poison que leur dent distille est mortel, quand
il se mêle avec le sang; leur morsure est funeste, mais l'eau
dans laquelle ils nagent ne l'est pas. » En disant ces mots, il
puise de cette eau peut-être empoisonnée, et dans tous les sables
de la Libye, cette fontaine fut la seule dont il voulut boire
le premier.
D'où vient que l'air de la Libye si fertile en venins mortels
peuple ces climats de serpents? Quels germes la nature a-t-elle
déposés dans son sein? Ce n'est pas à nous d'en, chercher la
cause ; mais une fable répandue à ce sujet dans l'univers a tenu
lieu de la vérité.
Aux confins de la Libye, aux lieux où la terre brûlante reçoit
l'Océan qui bouillonne sous les rayons du couchant, régnent
les tristes campagnes de Méduse, fille de Phorcys. Là, point de
forêts ombrageant la terre, point de sucs dans les sillons; mais
d'âpres rochers, nés du regard de la déesse. C'est dans son
corps que la nature malfaisante enfanta pour la première fois
ces cruels fléaux. C'est de sa bouche que.les serpents dardèrent
leurs langues en sifflant, et flottant sur ses épaules comme les cheveux d'une femme, fouettèrent le cou de Méduse enivrée.
Sur le devant de son front se dressent des couleuvres, et leur
affreux venin coule sous le peigne. Méduse a cela de terrible,
qu'on peut la regarder sans effroi. Car, qui jamais eut le temps
de craindre la gueule et la face du monstre? Qui donc, l'ayant
regardée en face, s'est senti mourir? Elle hâte la mort hésitante
et prévient la crainte. L'âme demeure dans les membres
pétrifiés, et les mânes captifs s'engourdissent sous les os. La
chevelure des Euménides n'excite que la fureur; Cerbère, aux
accents d'Orphée, adoucit ses sifflements. Hercule, vainqueur
de l'hydre, soutint impunément ses regards. La monstrueuse
Méduse fit trembler Phorcys, son père, la seconde divinité des
eaux, et Céto, sa mère, et ses soeurs elles-mêmes, les Gorgones.
Elle menaça le ciel et la mer d'un engourdissement
soudain, et put envelopper le ciel et la terre. Devant elle les
oiseaux tombent soudain du ciel, masse pesante. Les bêtes sauvages
font corps avec les rochers, et les nations voisines de
l'Ethiopie prennent la rigidité du marbre. Nul être animé ne
soutient son regard. Les serpents de Gorgone se rejettent en
arrière pour éviter sa face. Elle change en roc le Titan Atlas
debout près des colonnes hespériennes. Quand les dieux redoutaient les fils de Phlégra. aux pieds de serpents, c'est elle qui
les changea en montagnes; et Gorgone, placée sur la poitrine
de Pallas, termina cette guerre redoutée des dieux.
Quand le fils de Danaé et de la pluie d'or, Persée, s'avança, porté sur les ailes que lui prêta Mercure, auteur de la lyre et
de la palestre onctueuse; quand iL parut, armé de la faux de
Cyllène, cette faux, toute teinte du sang d'un autre monstre, du
gardien de la génisse, aimée de Jupiter, alors la chaste Pallas
porta secours à son frère ailé, et en retour, exigea qu'il lui promît
la tête du monstre. Arrivé aux confins de la Libye, elle lui
dit de regarder vers l'Orient, en détournant la tête des royaumes
de la Gorgone. Elle remit dans sa main gauche un bouclier d'or
étincelant, où comme dans un miroir, il devait voir la face
pétrifiante de Méduse. Le sommeil qui la livrerait à la mort ne
l'occupe jamais tout entière. La plupart des vipères dont elle
est coiffée veillent, et défendent sa tête comme un rempart. Les
autres pendent, languissantes, sur sa face et ses yeux obscurcis.
Pallas dirige elle-même le bras tremblant de son frère; celui-ci
tourne le dos, et sa faux tranche la tête hérissée de serpents. Quel horrible aspect présente le front de la Gorgone, tranché
par le croissant du fer! Quel venin elle vomit de sa gueule!
Combien de morts furent causées par ses derniers regards!
Pallas même ne peut la regarder. Persée, tout détourné qu'il
était, eût été pétrifié, si Pallas n'eût étalé son épaisse chevelure
et couvert ses yeux de ses couleuvres. Meurtrier de la Gorgone,
Persée remonte en volant vers le ciel !
Déjà mesurant sa route et pressé de fendre les airs par le
plus court chemin, il allait traverser les villes de l'Europe.
Pallas lui dit de respecter ces terres fertiles, d'épargner leurs
peuples. Quel mortel, en effet, n'eût levé les yeux vers cet
oiseau démesuré? Le souffle du zéphyr le détourne vers la
Libye, dont les terres incultes sont faites pour être brûlées
par les astres. Le soleil, dans son cours, presse et brûle ce
sol. Aucune région ne jette sur le ciel une plus profonde nuit
et n'arrête plus le cours de la lune; quand cet astre, renonçant
à ses détours, suit les signes réguliers et ne fuit l'ombre
écliplique ni vers le Notus, ni vers Borée. Cependant, cette
terre stérile, ces sillons qui ne produisent rien de bon, reçoivent
le poison qui dégoutte de la tète de Méduse et cette funeste rosée de sang que la chaleur empoisonne davantage, et
son sable poudreux s'en nourrit.
Le premier monstre qui leva la tête de cette poudre empoisonnée,
ce fut l'aspic somnifère, au cou gonflé. Un sang plus
abondant, une goutte de poison plus épaisse tomba sur lui.
Nul serpent n'en reçut davantage. Avide de chaleur, il ne va
pas de lui-même dans les régions froides, et parcourt jusqu'au
Nil les sables du désert. Mais quand rougirons-nous d'un honteux
commerce! Nous allons chercher ces reptiles de Libve
pour nos morts raffinées; l'aspic est un objet de commerce!
L'hoemorrhoïs, autre serpent qui ne laisse pas aux malheureux
une goutte de leur sang, déroule ses anneaux écailieux. Puis,
c'est le chersydre destiné aux plaines des Syrtes perfides, et
le chélydre qui laisse une trace fumante, et le cendhris qui
glisse toujours tout droit et dont le ventre est tacheté comme
l'ophite thébain; l'hammodyte, dont la couleur ressemble, à
s'y méprendre, à celle du sable; et le céraste vagabond et tortueux;
et le scytale, qui seul, durant les frimas épars, s'apprête
à jeter sa dépouille ; et la brûlante dipsade; et le terrible
amphisboene aux deux tètes; et le natrix, fléau des ondes; et le jaculus ailé; et le paréas dont la queue marque sa route; et
l'avide prester, qui ouvre sa gueule écumante et béante; et le
seps venimeux, qui dissout les chairs et les os; et celui dont le
sifflement fait trembler toutes ces bêtes terribles, celui qui tue
avant de mordre; le basilic, terreur des autres serpents, roi
des déserts poudreux.
Vous aussi, qui rampez dans les campagnes, dieux inoffensifs,
dragons aux reflets d'or, l'ardente Afrique vous fait venimeux.
Fendant l'air de vos ailes, vous suivez les troupeaux, et
dans vos replis vous étouffez les puissants taureaux. La masse
de l'éléphant ne le défend pas contre vous : vous faites tout
périr, et pour tuer vous n'avez pas besoin de poison.
Parmi ces fléaux, Caton, avec ses durs soldats, mesure la
route aride : il voit périr les siens de blessures invisibles. Aulus,
du sang tyrrhéaien, jeune porte-enseigne, marche sur une
dipsade qui le mord par derrière en redressant la tête. A peine
sent-il la douleur de cette blessure. Sa face n'est point altérée
par l'injure de la mort. La plaie n'a rien de menaçant. Le
poison subtil se glisse insensiblement, un feu rongeur dévore ses
os, et ses entrailles en sont consumées. Ses intestins se dessèchent, sa langue brûle dans son palais aride; point de sueur sur
ses membres accablés de fatigue, point de larmes dans ses yeux.
Ni l'honneur de l'empire, ni la voix de Caton que son supplice
afflige, rien ne retient ce guerrier dévoré de soif : il jette son
enseigne, et furieux, cherche dans la campagne l'onde que réclame
le poison qui le dévore. Jetez-le dans le Tanaïs, dans le
Rhône, ou le Pô, il brûlerait encore. En vain on lui donnerait
à boire toute l'onde du Nil débordé. La Libye ajoute aux horreurs
de son trépas; et dans ces climats torrides la dipsade n'a
pas tout l'honneur de sa mort. Il fouille profondément les entrailles
du sable poudreux, puis revient aux Syrtes et boit les
flots de la mer. Il aime ces flots saïés, mais ils ne peuvent le
désaltérer. Il ne sent pas la mort qui le tue, le poison qui le
consume. Il croit qu'il a soif, et ouvrant avec son épée ses
veines enflées, il inonde sa bouche de son sang.
Caton ordonne de lever les drapeaux. Il ne veut pas que l'on
sache ce que fait faire la soif. Mais une mort plus douloureuse
se présente à lui. Un seps subtil mord Sabellus à la cuisse. Celui-ci l'arrache, si fort qu'il tienne de sa dent recourbée, et le
cloue sur le sable avec son javelot. Le seps est de petite taille,
mais c'est le plus mortel des reptiles. Autour de la morsure, la peau se retire et découvre les os pâlissants. Puis la blessure
gagne, s'agrandit, et couvre le corps d'une seule plaie. Les
membres nagent dans le pus; les mollets tombent; le jarret se
dépouille, les muscles des cuisses se fondent, l'aine distille une
noire humeur, la peau du ventre éclate, les intestins se répandent;
mais le corps ne rend pas tout ce qu'il devrait contenir.
Le cruel venin consume ses membres, il les contracte et les
resserre. Les liens des nerfs, les jointures des flancs, les cavités
de la poitrine, tout ce que cachent les fibres vitales, l'homme
enfin tout entier se découvre sous l'action du fléau fatal. La mort
profane dévoile la nature : les épaules, les bras robustes se fondent;
la tête et le col se dissolvent; moins vite se fond la neige
au souffle tiède de l'Auster, moins vite la cire exposée au soleil.
Que parlai-je d'un corps ruisselant et liquéfié? La flamme en
fait autant. Mais quel bûcher a jamais consumé les os! Le poison
les détruit, il les réduit en poussière avec la moelle : il ne
reste aucune trace de ce rapide trépas. De tous les reptiles qui
infestent le Cinyphe, à toi la palme, ô seps malfaisant! Tous
enlèvent la vie; toi, tu fais disparaître jusqu'au cadavre. A cette mort liquéfiante succède un autre genre de mort.
Nasidius, habitant des campagnes Marsiennes, est atteint par
la dent enflammée d'un prester. Une rougeur de feu allume son
visage; sa peau se tend, ses traits s'effacent, une tumeur couvre et
confond toutes les formes de son corps. Ses membres, gonflés
de pus, dépassent la taille humaine. Le poison les agrandit; il
disparaît englouti sous cette masse épaisse. Sa cuirasse ne peut
contenir le progrès de ses chairs tuméfiées. L'onde écumantc
dilate moins sa surface dans l'airain chauffé par la flamme, et
la voile déploie ses plis moins vastes au souffle du Corus. Déjà
ce globe informe ne contient plus ses membres : son corps
n'offre plus qu'une masse confuse. Objet d'horreur pour les oiseaux
de proie, dangereux aux bêtes fauves qui déchireront
sa chair, ses compagnons n'osent le livrer au bûcher; ils abandonnent
son cadavre dont le volume ne cesse de croître.
Les fléaux libyens préparent de plus affreux spectacles.
L'hoemorrhoïs (1) imprime sa dent cruelle dans le jeune Tullus,
guerrier généreux, admirateur de Caton.
1 C'est un reptile dont la morsure fait couler le sang par toutes les ouvertures du corps.
Comme on voit, au
théâtre, jaillir de toutes les statues la pluie odorante du safran,
ainsi de tous ses membres en même temps s'échappe, au lieu
de sang, un vermeil poison. Ses larmes sont de sang, tous les pores ouverts aux humeurs laissent couler du sang ; sa bouche
le vomit ainsi que ses narines dilatées; sa sueur est rouge;
tous ses membres coulent à pleines veines, son corps n'est bientôt qu'une plaie.
Quant à toi, malheureux Lévus, mordu par l'aspic des rives
du Nil, tout ton sang est figé dans tes veines. Nulle douleur
n'accompagne la morsure. Un brouillard glacé, avant-coureur
de la mort, t'envahit, et le sommeil t'envoie rejoindre les ombres
de tes compagnons. Moins prompte est la mort que verse
dans la coupe le magicien arabe, cueillant sur sa tige funeste
l'herbe mensongère qui imite l'encens. Ailleurs, un jaculus (1) (c'est le nom que l'Africain lui donne) se tortille sur le tronc
stérile d'un chêne, s'élance, frappe Paulus à la tète et transperce
ses deux tempes. Ici le poison n'a que faire. La blessure
seule donne la mort. Auprès de lui, la fronde ne lance la pierre
qu'avec lenteur; la flèche du Scythe fait languissamment siffler
les airs. Que sert à l'infortuné Murrus de percer un basilic (2) avec
son javelot?
1 Le jaculus se cache sur les arbres, d'où il s'élance, comme un trait, sur tout ce qui l'approche.
2 Suivant Pline, le basilic fait mourir les arbustes même qui ont senti le poison de son souffle. Le poëte le dit si redoutable, que les serpents fuient à son aspect : d'après l'étymologie de son nom, il règne, toujours suivant le poête, dans la solitude des sables. Néanmoins, il est reconnu aujourd'hui pour n'être qu'une espèce de lézard stupide, craintif, et par conséquent inoffensif. On le nomme roi, parce que ce prétendu serpent a sur la tête des éminences ou taches blanches en forme de couronne.
Le poison rapide court sur sa pique et attaque sa main. Il tire son glaive, la coupe, et la sépare du bras ; et contemplant cette image déplorable de son trépas, il demeure vivant, tandis que sa main est frappée de mort. Qui croirait le scorpion maître de nos destins et assez fort pour donner la mort? Il menace de ses noeuds et frappe directement. Au ciel brille le glorieux témoignage de la défaite d'Orion. Qui craindrait, salpuga, défouler aux pieds ta retraite? Et pourtant les Parques t'ont donné des droits sur leurs fuseaux. Ainsi, ni le jour serein, ni la nuit obscure ne leur laissent un repos tranquille. Infortunés! la terre où ils se couchent leur est suspecte! Ils n'ont pour lit ni chaume, ni feuillage, ils se roulent sur le sable exposés à mille morts. La chaleur de leur corps attire les serpents que saisit la fraîcheur des nuits. Ce qui les désespère, c'est que n'ayant pour guide que le ciel, ils ne connaissent de leur route ni la mesure, ni le terme : « 0 dieux! s'écriaient-ils souvent, rendez-nous les combats que nous fuyons, rendez-nous les champs de Pharsale. Pourquoi faire périr indignement des hommes de courage qui ont juré de mourir les armes à la main? Ici. c'est le dispe (1) et le céraste (2) qui font la guerre civile et qui combattent pour César.
1 Le dipsas, ou dipse, ou la dypsade est un reptile dont la morsure cause une soif que rien ne peut assouvir.
2 Ce reptile a sur la tête deux éminences courbées en formes de croissant ou de cornes.
Qu'on
nous mène plutôt sous la zone torride, sous le char du soleil,
nous y périrons, mais victimes des astres du ciel, non des reptiles
de la terre. Ce n'est pas de toi, Afrique, ce n'est pas de toi, Nature, que nous nous plaignons. En livrant cette terre
aux serpents, tu l'avais interdite aux hommes. Tu la rendis
stérile en dons de Cérés pour les en écarter et pour les garantir
des poisons qu'elle engendre. C'est nous qui sommes venus malgré
toi habiter parmi les serpents. Qu'il nous voit bien punis,
celui des dieux qui, pour rendre ces champs de la mort inaccessibles
aux humains, a placé d'un côté les écueils des Syrtes,
et de l'autre la zone brûlante; qu'il nous voit bien punis d'avoir
enfreint ses lois! Peut-être approchons-nous des barrières
du monde et allons-nous pénétrer dans les retraites les plus
cachées, les plus profondes de la nature. De plus grands maux
peut-être nous y sont réservés. N'est-ce point là que l'élément
du feu se mêle en pétillant avec celui des eaux et que le ciel pèse
sur la nature? Car nous ne connaissons rien au delà des sables
de la Libye, et nous regretterons peut-être ce désert rempli de
serpents; en eux du moins la vie existe. Hélas! nous ne demandons
point à revoir les champs de notre patrie;lie doux
climat de l'Europe; le beau ciel de l'Asie est trop loin de nous.
Mais l'Afrique, où est-elle? où l'avons-nous laissée? Quand
nous avons quitté Cyrène, le froid de l'hiver s'y faisait sentir.
Dans le peu de chemin que nous avons fait, l'ordre des saisons est-il renversé? Nous avons sans doute passé le milieu du ciel,
nous avançons vers l'autre pôle, nous tournons hors de la terre,
peut-être Rome en ce moment est-elle sous nos pieds? Ah!
pour toute consolation de nos peines nous demandons que nos
ennemis, que César lui-même osent nous poursuivre par où
nous les fuyons! »
Ainsi leur dure patience se soulage par des plaintes. Ce qui
leur fait supporter ces travaux, c'est la vertu de leur chef qui,
couché comme eux sur le sable, défie à toute heure la Fortune.
Il partage seul tous les maux qui désolent son armée. Partout
où il est appelé, il y vole, et il y apporte plus que la vie : la
force de souffrir la mort. En expirant devant lui, on n'oserait
laisser échapper une plainte. Et quel pouvoir auraient les plus
grands maux sur l'âme de celui qui sait les vaincre, même dans
l'âme des autres, et dont le seul aspect leur apprend que la
douleur ne peut rien? La Fortune, enfîn, lasse d'éprouver ces
malheureux, leur offrit un secours longtemps attendu.
Il v a parmi les Marmarides un peuple qu'on nomme les
Psylles (1). C'est le seul dans toute la Libye pour qui les serpents
ne soient point à craindre.
1 Ancien peuple de la Lybie, voisin des Nasamons et des Garamantes, au sud de la Grande Syrte, dont ils étaient séparés par un vaste désert : le désert de Sort. On ignore néanmoins leur véritable situation. On dit, ainsi que le raconte le poëte, qu'invulnérables eux-mêmes, ils savaient guérir par leur salive ou par le simple attouchement la morsure des serpents. Pline rapporte qu'il transpirait du corps des Psylles une odeur qui les en préservait. Celse dit simplement que ces peuples étaient dans l'usage de sucer les plaies qu'avaient faites les bêtes venimeuses, et d'en extraire ainsi le poison, Hérodote assure qu'ils furent tous détruits par la vapeur brûlante du vent du midi. Aulu-Gelle ajoute qu'ayant manqué d'eau pendant une année entière, ils avaient pris les armes, résolus à taire la guerre au Notus, et que c'était ainsi qu'ils succombèrent tous, ou, au moins, tous ceux qui firent partie de l'expédition. Pline prétend qu'ils furent exterminés par les Nasamons, qui s'emparèrent de leur territoire. Néanmoins, il en subsistait encore du temps de notre poète, et l'on rapporte qu'Auguste en envoya plusieurs auprès de Cléopâtre, dès qu'il apprit que cette reine s'était fait piquer par un aspic : ce fut sans résultat. Voyez Hérodote, liv. IV, ch. CLXXIII; Straboin , liv. XVII; Diod., liv. LI, ch. xiv; Paus., liv. IX, ch. xxviii.
Il joint contre eux la vertu des herbes à la force des enchantements, et il semble avoir fait un pacte avec la mort. Ce peuple est si persuadé que son sang est incorruptible au venin, qu'aussitôt que ses enfants viennent au jour, il les expose à la morsure de l'aspic, pour éprouver si en eux ce sang n'a point souffert de mélange adultère. Ainsi l'oiseau de Jupiter, dès qu'il a fait éclore ses petits au tendre duvet, les présente au soleil levant; et ceux dont l'oeil fixe a la force de soutenir l'éclat de ses rayons sont réservés pour être les ministres de l'Olympe : mais ceux que la lumière blesse sont abandonnés. L'épreuve de la naissance est la même parmi les Psylles, ils ne reconnaissent pour leur enfant que celui qui, sans être effrayé, joue avec les serpents qu'on lui met dans les mains. Le don que ce peuple a de les enchanter, ne lui est pas seulement utile à lui-même, il l'emploie encore au salut de ses hôtes, il veille à leur défense; et sa pitié est l'unique refuge de l'étranger dans ces climats. Ce fut elle qui sauva l'armée de Caton. Ce peuple suivait sa marche, et lorsque le chef ordonnait de dresser les tentes, les Psylles prenaient soin de purifier le camp par des chants magiques qui mettent en fuite les serpents. Ils brûlent à l'en tour des herbes odorantes. Dans cette flamme pétille Fhyèble, suinte le galbanum exotique, le tamarin au triste feuillage, le coslus oriental, la souveraine panacée, la centaurée thessalienne, le peucedanum, le thapson d'Éris, le mélèse et l'abrotonum, dont la fumée tue le reptile, et la corne du cerf né loin d'ici. Ainsi le soldat passait des nuits tranquilles ; mais si durant le jour, l'un d'eux reçoit une atteinte mortelle, c'est alors que le Psylle use des charmes les plus forts. Alors commence la lutte du Psylle et du poison qu'il arrête. D'abord sur le membre atteint, il fait une trace avec sa salive qui retient le virus et refoule le mal dans la plaie. Puis, avec un continuel murmure, il marmotte dans sa bouche écumante mille chants magiques; l'activité du poison l'empêche de reprendre haleine; la mort prête à venir ne souffre pas qu'il se taise une minute. Souvent le mal qui a pénétré jusque dans la moelle, fuit devant les paroles enchantées. Mais s'il tarde à les entendre et refuse de sortir aux ordres du Psylle, celui-ci se penche sur le hlessé, suce sa plaie livide, aspire le venin, l'exprime avec ses dents, crache la mort, et reconnaît au goût le serpent qu'il a vaincu. Soulagée par leur secours, l'armée s'avançait à travers ces campagnes; et la lune avait déjà renouvelé, perdu et repris sa clarté depuis qu'elle voyait Caton errer dans ces sables stériles. Cependant, la terre sous leurs pas commençait à s'affermir, et le sol d'Afrique redevient de la terre. Déjà même on voyait de loin s'élever des arbres peu touffus encore, déjà l'on découvrait quelques cabanes couvertes de chaume. Quelle joie pour ces malheureux, lorsque pour présage d'un plus heureux climat, ils virent pour la première fois de fiers lions venir à leur rencontre. Leptis était la ville la plus prochaine; et ce fut dans ce séjour tranquille qu'ils passèrent un hiver exempt des chaleurs du Midi et des frimats du Nord. Dès que César rassasié de sang se fut éloigné de Pharsale, il écarta tous les autres soins pour s'attacher à poursuivre son gendre. Vainement il a suivi sur la terre ses traces vagabondes ; guidé par la renommée, il le cherche sur les eaux. Il rase les gorges de Thrace; il voit ce rivage, rendu fameux par l'amour et la tour d'Hero, sur sa rive sinistre; et cette mer à qui Hellé ravit son nom. Nulle part l'Asie n'est séparée de l'Europe par un canal plus étroit, bien que la mer resserre ses courants entre Byzance et Chalcédoine, riche en pourpre; bien que la Propontide entraînant l'Euxin, se précipite par une bouche étroite. César gagne la côte de Sigée et ces bords dont la renommée le remplit d'admiration. Il parcourt les rives du Simois et le promontoire de Rhoeté, consacré par le tombeau d'un Grec. Il marche à travers ces ombres qui doivent tant au génie des poètes. Il erre autour des ruines fameuses de Troie; il cherche les traces des murs élevés par Apollon. Quelques buissons stériles, quelques chênes au tronc pourri couvrent les palais d'Assaracus et de leur racine fatiguée pressent les temples des dieux. Troie entière est ensevelie sous des ronces ; ses ruines mêmes ont péri. Il reconnaît le rocher d'Hésione, et la forêt, couche mystérieuse d'Anchise, et l'antre où siégea le juge des trois déesses, la place où fut enlevé Ganymède, et le mont sur lequel se jouait la crédule OEnone. Pas une pierre qui ne rappelle un nom célèbre. Il avait passé, sans s'en apercevoir, un petit ruisseau qui serpentait dans la poussière; ce ruisseau était le Xanthe. Il portait négligemment ses pas sur un tertre de gazon, un Phrygien lui dit : « Que faites-vous? vous foulez les mânes d'Hector! » Il passait près d'un tas de pierres renversées qui n'étaient plus que d'informes débris. « Quoi ! lui dit son guide, vous ne regardez pas l'autel de Jupiter Hercéen? » 0 travail immortel et sacré des poètes ! tu sauves de l'oubli tout ce que tu veux ! c'est par toi que les peuples triomphent de la mort! César, ne porte point envie à la mémoire des héros! car si les Muses du Latium peuvent prétendre à quelque gloire, la race future lira ton nom dans mes vers aussi longtemps que le nom d'Achille dans les vers du chantre de Smyrne. Mon poëme ne périra point et ne sera jamais condamné aux ténèbres. Dès que César a rassasié ses yeux du spectacle de la vénérable antiquité, il érige à la hâte un autel de gazon; et après y avoir allumé la flamme, il verse avec l'encens des voeux qui seront exaucés : « Dieux des cendres de Troie ! ô qui que vous soyez qui habitez parmi ses ruines! et vous, aïeux d'Énée, et mes aïeux, dont les lares sont aujourd'hui révérés dans Albe et dans Lavinium, et dont le feu apporté de Phrygie brûle encore sur nos autels ! Et toi, Pallas, dont la statue qu'aucun homme ne vit jamais, est conservée à Rome, dans le lieu le plus saint du temple, comme le gage solennel de la durée de notre empire ; un illustre descendant d'Iule fait fumer l'encens sur vos autels et vous invoque sur cette terre, votre antique patrie. Accordez-moi des succès heureux dans le reste de mes travaux : je rétablirai ce royaume et je le rendrai florissant. L'Ausonie reconnaissante relèvera les murs des villes de Phrygie, et Troie, à son tour, fille de Rome, renaîtra de ses débris. » Après avoir formé ces voeux, il remonte sur ses vaisseaux, et profitant de la faveur des vents, il leur livre toutes ses voiles, afin de réparer le temps qu'il a perdu sur les bords Phrygiens. Déjà il a passé Lesbos, bientôt il laisse après lui l'Asie, Rhodes, et le zéphïr qui pousse sa flotte, ne laissant pas un moment ses cordages détendus, fait voir à César, dès la septième nuit, les flambeaux du Phare allumés sur le rivage de l'Egypte. Mais l'éclat du jour avait effacé celui de ces flambeaux nocturnes, avant que César arrivât dans le port. Au tumulte qu'il vit régner sur le rivage, au bruit confus de mille voix qui se confondaient dans les airs, il conçut des soupçons sur la foi de ce peuple; et n'osant d'abord s'y livrer, il tint sa flotte loin du rivage. Bientôt un satellite de Ptolémée, chargé de ses affreux présents, s'avance en pleine mer, il porte la tête de Pompée Couverte d'un voile ; et avant de l'offrir, sa bouche exécrable commence par faire valoir le crime de son maître : « Vainqueur de la terre ! ô vous, le plus grand des Romains ! et, ce que vous ne savez point encore, maître paisible et de Rômé et du monde, puisque Pompée ne vit plus, le roi du Nil vous assure le prix de vos travaux, et sur la terre et sur les mers. Il vous présente ce qui manquait seul à votre victoire de Pharsale. En votre absence, il a terminé pour vous la guerre civile. Pompée cherchant à réparer les pertes qu'il avait faites dans la Thessalie, est venu tomber sous nos coups. C'est à ce prix, César, que Ptolémée vient d'acheter votre faveur. C'est d'un tel sang qu'il a voulu cimenter son alliance avec vous. Recevez sous vos lois le royaume d'Egypte sans qu'il vous coûte un seul de vos soldats; acceptez l'empire du Nil; acceptez tout ce que vous donneriez pour la tête de Pompée, et regardez comme le plus fidèle de vos clients celui à qui les destins ont permis d'exécuter un si grand coup. Ne croyez pas, César, qu'il ne soit d'aucun prix parce qu'il a été facile. L'aïeul du jeune prince était lié avec Pompée des noeuds de l'hospitalité ; son père lui devait sa couronne. Que vous dirai-je de plus? Vous donnerez vous-même un nom au service qu'il vous a rendu ou vous attendrez que l'univers le nomme. Si c'est un crime, vous avouerez que le mérite en est plus grand, puisqu'on vous en a épargné le reproche. » Après ce discours, il découvre et présente à César la tête de Pompée. La mort avait déjà changé ses traits. César eut peine à le reconnaître. Ce ne fut point à la première vue qu'il rejeta cet horrible présent et qu'il en détourna les yeux : ses regards s'y attachèrent pour s'en assurer, mais lorsqu'il eut vérifié le crime et qu'il put, sans danger, paraître sensible et généreux, il répandit quelques larmes que la douleur ne faisait point couler ; et du fond d'un coeur satisfait, il fait sortir des plaintes simulées. Il ne fallait, pas moins pour déguiser sa joie que tous les signes de la douleur. Par là, il dérobe au tyran du Nil le mérite de son forfait, et les larmes qu'il répand sur la tête de Pompée le dispensent de la payer. Lui qui sans changer de visage avait foulé aux pieds les corps des sénateurs, et qui d'un oeil sec avait vu les champs de Pharsale, il n'osa refuser à Pompée des gémissements et des pleurs. 0 César! tu as fait une guerre implacable à celui que tu devais pleurer! Non, ce n'est pas ton alliance avec Pompée qui te touche; ce n'est pas le souvenir de ta fille et de ton petit-fils: tu sais que Pompée était cher aux peuples, et tu espères que tes regrets les rangeront sous tes drapeaux. Peut-être aussi es-tu indigné qu'un autre que toi ait osé disposer de sa vie et qu'on l'ait dérobé au triomphe de son superbe vainqueur. Mais quel que soit le sentiment qui t'arrache des larmes, il est bien éloigné d'une piété véritable; et ce n'était pas pour le sauver que tu le cherchais avec tant d'ardeur et sur la terre et sur les mers. Oh ! qu'il est heureux que la mort te l'ait enlevé! Quelle honte la Fortune a épargnée à Rome en ne lui donnant pas le spectacle de César pardonnant à Pompée ! César ne laissa pas de soutenir par ses paroles les apparences de sa douleur : « Va, traître! emporte loin de mes yeux, dit-il, ces dons funestes de ton roi ! Votre crime est encore plus grand envers César qu'envers Pompée. Vous m'enlevez le seul prix, le seul avantage de la guerre civile, celui de sauver les vaincus. Si la soeur de Ptolémée ne lui était pas odieuse, je le payerais comme il le mérite : je lui enverrais en échange ta tête, ô Cléopâtre. Qui lui a permis de mêler à mes victoires des trahisons et des assassinats? Est-ce pour lui donner sur nous le droit du glaive que nous avons combattu dans la Thessalie? L'avons-nous rendu l'arbitre de nos jours? Ce pouvoir que je n'ai pas voulu partager avec Pompée, souffrirai-je que Ptolémée ose l'exercer avec moi? En vain tant de peuples armés seraient entrés dans nos querelles, s'il restait dans l'univers d'autre puissance que César et si la terre avait deux maîtres. Je quitterais dès ce moment ce rivage que je déteste, sans le soin de ma renommée, qui me défend de laisser croire que je vous fuis par crainte plutôt que par indignation. Et ne croyez pas que je me trompe à ce que vous faites pour le vainqueur : l'accueil qu'a reçu Pompée en Egypte m'était préparé; et si ce n'est pas ma tête que tu portes à la main, je ne le dois qu'au bonheur de mes armes en Théssalie. Le péril était bien plus grand que je ne croyais dans cette journée! je ne craignais pour moi que l'exil, la colère de Pompée, le ressentiment de Rome; et je vois que le glaive de Ptolémée m'attendait si j'avais fui. Cependant je veux bien pardonner à son âge, et ne pas punir sa faiblesse du crime qu'on lui a suggéré. Mais qu'il sache que le pardon est tout le prix qu'il en peut attendre. Vous, ayez soin d'élever un bûcher, où la tête de ce héros se consume; non pas afin que votre crime soit à jamais enseveli, mais afin que son ombre soit apaisée. Sur un tombeau digne de lui, portez votre encens et vos voeux; recueillez ses cendres dispersées sur ce rivage, et donnez un asile à ses mânes errants. Que du sein des morts, il s'aperçoive de l'arrivée de son beau-père, et qu'il entende les regrets que ma piété donne à son trépas. En préférant tout à César et en aimant mieux devoir la vie à son client d'Egypte, il a dérobé un beau jour au monde. L'exemple et le fruit de notre réconciliation est perdu. Les dieux ne m'ont point exaucé, puisqu'ils n'ont pas permis, ô Pompée, que jetant mes armes victorieuses et te recevant dans mes bras, je t'aie conjuré de reprendre pour moi ton ancienne amitié et que je t'aie demandé pour toi-même la vie; satisfait, si par mes travaux, j'avais mérité d'être ton égal, alors, dans une paix sincère j'aurais obtenu de toi de pardonner ma victoire aux dieux, et tu aurais obtenu que Rome me l'eût pardonnée à moi-même. » Quelque touchantes que fussent ces paroles, aucun de ceux qui l'écoutaient ne mêla ses larmes aux siennes. Ils renferment tous leur douleur, ils la déguisent sous l'apparence de la joie, et d'un air satisfait, ô douce liberté! ils regardent le crime atroce dont César parait affligé.
Entrée de César dans Alexandrie. — Il visite les temples des dieux, le monument de Sérapis, le tombeau d'Alexandre. — Réflexions philosophiques sur ce prince. — Le jeune roi accourt à Péluse, et reste en otage près de César. — Cléopâtre aborde à son tour au Phare, et vient demander à César une part dans l'héritage de ses aïeux. — Discours qu'elle tient au héros : elle parvient, sinon à le persuader, du moins à le séduire. — César la réconcilie avec le roi, son frère : joie, festin, description de la salle du festin. — Description du festin. — Parure de Cléopâtre : luxe imprudemment étalé aux yeux de l'étranger. — Le sage Achoiée assiste au festin. — César l'interroge sur les secrets des pontifes; il veut savoir les mystères de la source du Nil. — Réponse du sage. — Pothin et Achillas trament un complot contre la vie de César. — Pothin presse Achillas de marcher contre l'étranger, maître du palais des rois : ses reproches.— Achillas obéit : soldats romains mêlés aux satellites des deux meurtriers de Pompée. — A l'approche de l'armée, César s'enferme dans le palais avec le jeune roi : il y est assiégé. — Défense du héros. — Il fait périr Polhin. — Arsinoé, soeur de Cléopâtre se rend au camp des Égyptiens, fait assassiner Achillas, et met Ganymède à sa place. — Le siège continue. — César tente, pour s'échapper, de regagner ses vaisseaux restés dans le port : il est attaqué sur la levée qui joint la ville à l'île du Phare.
Dès que César, suivant la tête de Pompée, est descendu sur
ce rivage odieux et foule aux pieds ces sables, il s'élève un
combat entre la fortune du chef et le destin de la coupable
Egypte, pour décider si le Nil subira la même loi que le Tibre,
ou si le glaive de Ptolémée enlèvera au monde le vainqueur après le vaincu. 0 Pompée, ton ombre secourut ton beau-père:
elle déroba César au fer des assassins.
D'abord, se croyant assuré de la foi de Ptolémée, après le
crime qui en était le gage, il entra, précédé de ses étendards,
dans les murs fondés par Alexandre. Mais à la vue des faisceaux, le peuple d'Egypte murmure, indigné que Rome vienne
jusque dans ses murs commander à ses rois, et s'attribuer leur
puissance. Ce tumulte avertit César que les esprits étaient
émus et divisés, et que ce n'était pas à lui qu'on avait immolé
Pompée. Mais dissimulant sa frayeur sous un visage serein, il
parcourut d'un pas intrépide les temples de Sérapis et des
autres dieux de l'Egypte, monuments dont la splendeur atteste
l'ancienne puissance des Macédoniens. Cependant ni la beauté
de ces édifices, ni les richesses qu'ils étalent, ni la majesté du
culte qu'on y rend, aux dieux, ni la magnificence et la grandeur
de la ville qui les renferme ne touchent l'âme de César. Un seul
objet l'émeut et l'intéresse, c'est le tombeau d'Alexandre. II
descend avec une ardeur impatiente dans son caveau funèbre ;
là repose ce brigand heureux, dont le ciel vengeur délivra la
terre. Ses restes, qu'il eût fallu disperser dans l'univers, sont
recueillis dans le sanctuaire. La fortune épargne jusqu'à ses
mânes, et le bonheur de son.règne se perpétue même après sa mort. Car si jamais la liberté rentrait dans ses droits sur la
terre, ce serait pour être le jouet des peuples qu'on aurait conservé
les cendres de leur oppresseur, de celui qui offrit au
monde l'exemple funeste de l'univers esclave d'un seul.
On le vit sortir de Macédoine, héritage obscur de ses aïeux,
regarder avec mépris Athènes, conquête de son père, et poussé
par ses heureux destins, marcher à travers les royaumes de
l'Asie et sur des champs couverts de morts. Son glaive destructeur
moissonne les peuples de l'Orient; les fleuves les plus
éloignés, dans la Perse l'Euphrate, et le Gange dans l'Inde,
sont teints du sang qu'il fait couler, fatal fléau de la terre,
foudre terrible dont les coups frappent les nations entières,
astre ennemi du genre humain. Il se préparait à lancer des
flottés Sur l'Océan extérieur. L'onde, le feu, rien ne l'arrête :
il affronte les Syrtes, il traverse les sables de la Libye, pour
aller consulter Ammon. Par l'Orient, il fût arrivé aux bords
où le Soleil se couche; il eût fait le tour des deux pôles; il
eût vu les sources du Nil. La mort l'arrêta dans sa course,
et la nature n'eut pas d'autre borne à l'ambition de ce furieux.
Le même orgueil jaloux, qui lui fit souhaiter d'avoir à lui seul
l'empire du monde, ne put souffrir qu'il se donnât un égal dans un successeur. Il aima mieux laisser sa dépouille à déchirer
entre ses héritiers. Maître de Babylone, il mourut dans ses
murs, révéré du Parthe qu'il avait dompté. 0 souvenir humiliant
pour Rome! Le Parthe a redouté la lance macédonienne
plus que le javelot romain ! Notre empire s'est étendu jusque
sous les astres de l'Ourse, jusques aux bornes du couchant,
et bien avant dans les climats d'où le vent du midi se lève ;
et le seul effort des Arsacides nous arrête dans l'Orient ! une
petite province de l'empire d'Alexandre a été l'écueil de nos
armes, et le tombeau de nos guerriers !
Le jeune Ptolémée, de retour de Péluse, avait calmé par sa
présence les clameurs d'un peuple timide ; et César ayant pour
otage le roi captif dans son palais, y croyait être en sûreté. Ce
fut alors que Cléopâtre quittant la maison de campagne où elle
était reléguée, et s'exposant la nuit sur une barque, se présenta
devant le Phare, corrompit le gardien du port, dont elle
fit baisser les chaînes, et se rendit dans le palais des rois macédoniens,
même à l'insu de César : femme dangereuse, l'opprobre
de l'Egypte, l'Érinnys des Latins, et dont, les vices
impurs ont fait le malheur de Rome. Autant la fatale beauté
de Sparte alluma de haines contre les héros de la Grèce et de
la Phrygie, autant Cléopâtre excita de fureurs entre les plus grands des Romains. Au son du sistre égyptien, elle jeta (je
rougis de le dire) la terreur dans le Capitole. Avec le peuple
amolli de Canope, elle osa marcher contre les aigles romaines,
et se promettre de rentrer triomphante dans le port du Phare,
en y menant captif un César. Leucade vit le moment où il était
douteux si l'empire ne passerait pas aux mains d'une femme,
et d'une femme, étrangère. Elle en conçut l'espoir, l'incestueuse
fille des Ptolémées, dès la première nuit qu'elle passa dans les
bras de César.
Qui peut, Antoine, ne pas te pardonner ton amour insensé
pour elle? L'âme inflexible de César a brûlé des mêmes feux.
Au milieu de ses fureurs, dans un palais habité par les mânes
de Pompée, tout fumant encore lui-même du sang versé dans la
Thessalie, cet amant adultère a pu mêler aux soins dont il était
tourmenté les plaisirs d'un honteux amour, et former au sein
des alarmes des noeuds criminels, dont les fruits feront rougir
la pudeur et la foi. Quel excès de honte! il oublie que sa fille
a été la femme de Pompée! ô Julie! il te donne des frères, nés
d'une femme incestueuse; et pour cette femme impudique, laissant
à ses ennemis tout le temps de se rassembler en Libye, il
perd avec elle au sein des voluptés les moments les plus précieux;
il aime mieux lui donner l'Egypte, que de vaincre pour
lui-même. Cléopâtre se confiant à sa beauté, parut devant César, affligée,
mais sans verser de larmes. Elle n'avait pris de la douleur
que ce qui pouvait l'embellir encore. Écheveiée, et dans ce désordre
favorable à la volupté, elle l'aborde, et lui parle en ces
mots.
« 0 César! ô le plus grand des hommes ! si l'héritière de Lagus,
chassée du trône de ses pères, peut encore dans son malheur
se souvenir de son rang; si ta main daigne la rétablir
dans tous les droits de sa naissance, c'est une reine que tu vois
à tes pieds. Tu es pour moi un astre salutaire qui vient luire
sur mes États. Je ne serai pas la première femme qui aura dominé
sur le Nil, l'Egypte obéit sans distinction à une reine,
comme à un roi. Tu peux lire les dernières paroles de mon père expirant : il veut qu'épouse de mon frère, je partage son lit et
son trône; et le jeune roi pour aimer sa soeur, n'a besoin que
d'être libre. Mais Pothin s'est emparé de son esprit, comme de
la puissance. Ce n'est pas l'héritage de mon père que je réclame :
affranchis notre maison de la honte qui la souille. Daigne, César,
éloigner de lui le satellite armé qui l'assiège, et ordonne
au roi de régner. De quel orgueil cet esclave n'est-il pas.enflé,
depuis qu'il a tranché la tête de Pompée ! C'est toi, César
(puissent les dieux écarter ce présage), c'est toi qu'il menace à présent ; et il n'est déjà que trop honteux pour le monde et
pour toi, que la mort de Pompée ait été le crime ou le bienfait
de Pothin. »
Le langage de Cléopâtre eût vainement flatté l'oreille farouche
de César ; mais le charme de sa beauté se communique à sa
prière, et plus éloquents que sa voix, ses yeux impurs parlent
et persuadent. Ainsi, après avoir séduit son juge, elle employa
une nuit honteuse à l'enchaîner.
César ayant rétabli et payé la paix à prix d'or, la joie de ce
grand événement fut célébrée dans un festin. Cléopâtre y fit éclater
un luxe, une magnificence, dont Rome encore n'avait pas
l'idée. Le lieu du festin ressemblait à un temple, tel que le siècle
présent, quoique corrompu, le construirait à peine. Les toits
étaient chargés de richesses, les bois de lambris étaient cachés
sous d'épaisses lames d'or. Les murs n'étaient pas incrustés, mais
bâtis d'agate et de porphyre ; dans tout le palais, on marchait
sur l'onix. L'ébène de Méroé y était prodigué, et y tenait lieu
du chêne vil, et servait aux portes du palais de support, et non
d'ornement. Les portiques sont revêtus d'ivoire. Sur ces portes
immenses, l'écaillé de la tortue de l'Inde est appliquée en relief,
et dans chacune de ses taches une émeraudé étincelle. Au dedans, on ne voit que des vases de jaspe, que des sièges émaillés
de pierreries, que des lits, où la pourpre, l'or, l'écarlate
éblouissent les yeux par ce riche mélange que la navette des
Égyptiens sait donner à leur tissu. La salle du festin se remplit
d'un peuple sans nombre, d'une multitude d'esclaves, différents
d'âge et de couleurs; les uns brûlés par le soleil d'Ethiopie, et
portant leurs cheveux relevés en arrière et repliés autour de leur
tête; les autres d'un blond si clair et si brillant, que César dit
n'en avoir pas vu de plus doré sur les bords du Rhin. On y voit
aussi une malheureuse jeunesse à qui le fer a ôté la vigueur.
Parmi elle, on distingue l'âge viril, mais dénué de ses forces, et
ayant à peine sur le menton le duvet de l'adolescence. Ptolémée et Cléopâtre se mirent à table; et César, plus grand
que les rois, prit place entre le frère et la soeur. Peu contente
du sceptre de l'Egypte, et du coeur du roi, son frère et son
époux, Cléopâtre avait employé tous les sacrifices du luxe à relever
l'éclat de sa beauté. Les dons les plus précieux de la mer
rouge brillent dans ses cheveux, et forment sa parure ; la blancheur
de son sein éclate à travers un voile de Sidon, tissé par
le peigne des Sères et dont l'aiguille des Égyptiennes a desserré
le tissu clair et large. Sur des trépieds formés des dents blanches de l'éléphant, on
a posé des tables rondes du bois du mont Atlas, et si belles qui
César n'en vit jamais de pareilles, même après qu'il eu
vaincu Juba.
Reine insensée, à quelle imprudence te porte ton ambition?
En étalant aux yeux d'un hôte vainqueur, tout-puissant et armé,
ces richesses, dignes d'envie, ne crains-tu pas d'allumer en
lui le désir de s'en emparer? Quand même il n'aurait pas résoui
de s'enrichir des dépouilles du monde, quand ce serait, au lieu
de César, un des héros de ces temps heureux, où la pauvreté
fut en honneur dans Rome, un Fabricius, un austère Curius, ou
ce consul que l'on tira de la charrue, et qu'on amena tout couvert
de la poussière de son champ ; assis à cette table, il serait
tenté d'emporter en triomphe dans sa patrie une si superbe dépouille.
On servit dans des vases d'or tout ce que l'air, la terre, le
Nil et la mer ont produit de plus exquis, tout ce que la folie
d'un luxe effréné a pu rechercher de plus rare, Ce n'est pas
aux besoins de la nature, mais aux délices de la table, qu'on
immole dans ce festin les oiseaux, les bêtes fauves, ces dieux
du Nil. Des urnes de cristal versent l'eau pure de ce fleuve.
De profondes coupes de pierres précieuses reçoivent le jus délicieux
des vignes de Méroé, cette liqueur qu'un soleil ardent fait bouillonner, et à laquelle il donne en peu de temps la maurité
d'une longue vieillesse. Le nard odoriférant, et la rose
qui ne cesse de fleurir dans ces climats, couronnent le front des
convives. Sur leurs cheveux coulent le cinname dont l'essence
ne s'est point évaporée, comme quand il passe sur des bords
éloignés, et l'amome nouvellement recueilli dans les campagnes
voisines.
César apprend à dissiper les richesses de l'univers conquis ;
et honteux d'avoir employé ses armes à vaincre un ennemi pauvre, il ne demande qu'un sujet de guerre contre un peuple
si opulent.
Lorsque la volupté rassasiée eut mis fin aux plaisirs de la
table, César s'adressant au sage Achorée, qui en longue robe
de lin assistait à cette fête, l'engagea dans un entretien qui fut
prolongé bien avant dans la nuit : « Vieillard voué au culte des
autels, et sans doute chéri des dieux qui vous accordent de si
longs jours, daignez, lui dit-il, m'apprendre l'origine des peuples
de l'Egypte. Décrivez-moi ces climats, et les moeurs de
leurs habitants; leurs rites sacrés, et les symboles sous lesquels
ils adorent la divinité. Expliquez-moi les caractères mystérieux
qu'on voit gravés sur vos sanctuaires antiques, et dévoilez enfin
des dieux qui ne demandent qu'à se manifester. Si vos ancêtres ont initié l'Athénien Platon dans la science des choses
saintes, à qui pouvez-vous confier ces secrets sublimes, qui en
soit plus digne que César ? et à qui l'univers doit-il être connu,
si ce n'est à son maître? Je suis venu chercher Pompée en
Egypte; mais votre renommée m'y attirait aussi. Au milieu des
combats, j'ai toujours étudié les mouvements du ciel, le cours
des astres et les secrets des dieux. Mon année ne le cédera
point aux fastes d'Eudoxe (1).
1 L'année grecque fut primitivement composée de trois cent cinquante-quatre jours, ce qui donnait en quatre ans quarante - cinq jours d'erreur. Vint ensuite Eudoxe, qui fixa la durée de l'année à trois cent soixante-cinq jours un quart, durée qu'admit depuis J. César, ou plutôt l'astronome Sosigène, en établissant le calendrier Julien. L'année de César fut de trois cent soixante-cinq jours, et de trois cent soixante-six après une période de quatre ans, ce qui donnait encore un jour d'erreur en cent trente-quatre ans : c'est cette erreur que le calendrier Grégorien a relevée. On sait que César s'occupa réellement d'astronomie et flt un traité sur cette matière. — Tout ce qui suit sur les causes des crues du Nil est tiré des opinions des divers philosophes de l'antiquité, Aristote, Anaxagore, Démocrile, etc.
Mais avec cet amour extrême de
la vérité, la plus noble passion de mon âme, il n'est rien que je
désire aussi ardemment de savoir, que les causes, inconnues
depuis tant de siècles, du débordement de votre fleuve, et dans
quel lieu inaccessible il prend sa source. Qu'on me donne une
pleine assurance de trouver les sources du Nil, et j'abandonne
la guerre civile. » Dès que César eut achevé, le sage vieillard
lui répond ainsi.
Oui, César, il m'est permis de vous révéler les secrets de
nos vénérables ancêtres; ces secrets qui jusqu'à ce jour ont
été inconnus aux profanes mortels. Que d'autres se fassent un
devoir religieux de renfermer tant de merveilles dans le silence,
pour moi, je crois qu'il est agréable aux dieux d'entendre annoncer
les prodiges de leur sagesse et que leurs lois soient
révélées à tous les peuples du monde.
Ces astres qui seuls modèrent la fuite du ciel et s'avancent vers le pôle, la loi du monde, dès l'origine, leur attribue une
puissance diverse. Le soleil partage les saisons de l'année,
règle l'échange du jour et de la nuit ; par la puissance de ses
rayons, tient les astres prisonniers et enchaîne à son centre
fixe leur course vagabonde. La lune avec ses diverses phases
racle la mer et les terres. A Saturne appartiennent les lieux glacés
et la zone neigeuse; Mars commande aux vents, aux foudres
errantes; pour Jupiter, l'air calme et l'éther inaltérable; la féconde
Vénus garde le germe de toutes choses; Mercure est
l'arbitre de l'onde immense, dès qu'il entre dans la région du
ciel, où l'astre du Lion se mêle au Cancer, où Sirius vomit ses
feux rapides, où le cercle changeant de l'année occupe l'OEgoceros
et le Cancer, témoin mystérieux des sources du Nil, c'est
alors que le maître de l'onde lance la flamme, le Nil s'élance
hors de sa source, comme l'Océan qui se gonfle sous l'action
de la lune, et ne rentre pas dans son lit avant que la nuit ait
recouvré les heures que lui dérobe le soleil d'été.
« Quant à l'accroissement du Nil, c'est une erreur des anciens de l'avoir attribué aux neiges de l'Ethiopie. Il n'en est point de
ces climats comme de ceux de l'Ourse et de Borée; la couleur même des peuples qui les habitent vous annonce un soleil
brûlant et un air sans cesse embrasé par le souffle du vent du
Midi. Ajoutez à cela que tous les fleuves, dont la fonte des
glaces grossit la source, commencent à s'enfler au retour du
printemps, au premier écoulement des neiges, au lieu que le
Nil n'élève jamais ses eaux que le Chien céleste n'ait dardé
ses rayons et ne rentre dans ses rivages, qu'après que la Balance,
devenue l'arbitre du jour et de la nuit, les a égalés l'un
à l'autre. Le Nil n'est pas soumis aux mêmes lois que les autres
fleuves. Il ne déborde point en hiver où l'éloignement du soleil
rendrait ses bienfaits inutiles. Destiné à tempérer les feux
d'une saison trop ardente, il sort de son lit au milieu de l'été.
Placé sous la brûlante zone, de peur que le ciel n'y consume
la terre, il est prêt à la secourir ; et c'est contre les flammes
dévorantes du Lion que ce fleuve élève ses eaux. Sitôt que le
Cancer embrase Syèno, le fleuve vient au secours de la ville
qui l'implore, et il ne cesse d'inonder ses campagnes, que lorsque
le soleil, déclinant \ers l'automne, allonge les ombres sur
Méroé. Qui peut dire les causes de ce prodige? C'est ainsi que
la mère commune, la sage nature a déterminé le cours du Nil :
il le fallait pour le bien du monde.
« L'antiquité crédule attribuait aussi l'accroissement du Nil aux zéphyrs, qui, tous les ans, dans la même saison, régnent
constamment dans les airs avec une pleine puissance; soit que
ces vents chassent vers le Midi les nuages du Notus, et que ces
nuages fondus en pluie grossissent les sources du Nil, soit que
les flots de la mer soulevés par la même cause, suspendent la
chute des eaux de ce fleuve, et que, refoulé vers sa source, il
soit forcé de surmonter ses bords et de se répandre dans les
campagnes.
« Il en est qui ont supposé de longs canaux dans les entrailles
de la terre, et entre les rochers qui composent la solide épaisseur
du globe, des vides profonds par lesquels la chaleur du
Midi attire les eaux du Nord et les rassemble au milieu du
monde, lorsque le soleil s'éloignant du pôle, lance directement
ses feux sur Méroé. Alors, disent-ils, par des routes cachées,
le Gange et le Pô viennent grossir le Nil, et un seul lit ne peut
contenir toutes les eaux que vomit sa source.
On croit aussi que c'est dans l'Océan qui embrasse la terre,
que le Nil va puiser ses eaux, et qu'elles déposent leur amertume
dans l'immensité de leur cours.
« On n'a pas manqué de dire encore que le soleil qui se nourrit
des humides vapeurs qu'il aspire, lorsqu'il touche à notre tropique, en élève plus qu'il n'en peut consumer, et que par la
fraîcheur des nuits, ces eaux surabondantes rendues à la terre
se joignent à celles du Nil.
Pour moi, s'il m'est permis de prononcer sur ce grand phénomène,
je crois, César, qu'entre les fleuves répandus sur la
terre, les uns, longtemps après qu'elle a été formée, sont sortis
de son sein par les secousses qui ont brisé ses veines, et sans
qu'un dieu les en ait tirés; que les astres ont été compris dans
la première disposition du mécanisme de la nature et ont commencé
avec le grand tout; que ceux-là coulent au hasard, mais
que ceux-ci sont dirigés par l'ouvrier et le moteur suprême
qui les soumet aux lois de l'ordre universel.
« Romain, le désir que vous témoignez de connaître la source
du Nil a été l'ambition des rois de Perse, d'Egypte, et de Macédoine.
Il n'est point de siècle qui n'eût été glorieux de transmettre
cette découverte aux siècles à venir. Mais le mystère
qu'en a fait la nature, demeure encore impénétrable. Le plus
grand des rois que Memphis révère, Alexandre, voulut dérober
au Nil le secret de son origine. Il envoya une troupe d'élite
jusque au fond de l'Ethiopie; la zone brûlante les arrêta; ils
virent le Nil tout fumant. Sésostris pénétra vers le couchant,
jusqu'aux limites du monde ; et dans sa course triomphante, ce
roi superbe se fit traîner, dit-on, par des rois attelés à son char égyptien. Mais il eût bu les eaux du Rhône et de l'Éridan, plutôt
que celles du Nil à sa source. L'insensé Cambyse porta la
guerre jusque chez l'Éthiopien à la longue vie; et après avoir
été réduit à se nourrir de la chair de ses compagnons, il revint
sur ses pas, sans avoir découvert le lieu où le Nil prend
naissance.
Fleuve mystérieux, la fable même n'ose parler de ton origine
: tu es inconnu partout où tu parais, et aucune nation n'a
eu la gloire de pouvoir dire, il est à moi. Je vais donc publier
du cours de tes eaux ce que m'en a révélé le dieu qui nous
cache ta source. Tu viens en croissant du milieu de l'axe de la
terre. Tu oses traverser le brûlant tropique, en dirigeant tes
flots vers le pôle de l'ourse, et contre les aquilons. Bientôt tu
t'égares en longs détours vers le couchant et vers l'aurore, arrosant
les plaines de l'Arabie, et les sables libyens. Les Sères
te voient les premiers, et demandent aussi ton origine, tu roules
ensuite dans l'Ethiopie une onde qui lui est étrangère. L'univers
ne sait d'où tu viens. La nature a jeté sur ta tête un voile
qu'elle n'a permis à aucun peuple de lever. Elle n'a pas voulu
que le monde pût le voir faible et rampant ; elle a caché le berceau
de tes eaux naissantes. Elle a mieux aimé te faire admirer, que de le faire connaître aux humains. En te voyant grossi des
pluies et des frimats d'un hiver éloigné, on s'imagine que tu
franchis les deux solstices, et que tu parcours les deux pôles.
Une partie du monde demande où tu commences, et l'autre où
tu finis ton cours. Tu te partages en deux canaux pour embrasser
l'île de Méroé, peuplée de noirs habitants, et plantée de
bois d'ébène ; mais quoique ces bois y abondent, et la couronnent
de leurs rameaux, les ardeurs de l'été ne sont tempérées
par aucun ombrage : tant elle est directement frappée des
feux du Lion. De là tu traverses les régions du soleil, sans que
le volume de tes eaux diminue; tu parcours d'immenses plaines
de sable, tantôt ramassé en un seul lit avec toutes les forces,
tantôt divisé en rameaux, ou répandu sur la pente du rivage.
En approchant des murs de Phila, barrière commune de l'Egypte
et de l'Ethiopie, tu rassembles de nouveau tes ondes; tu
les promènes lentement dans les déserts qui séparent notre
commerce de la mer Rouge. Qui croirait à voir le cours tranquille
de tes eaux, que dans peu tu vas les soulever avec tant
de fureur? C'est lorsqu'à travers des gouffres escarpés et de
profonds abîmes tes chutes rapides font écumer et bondir tes
flots mugissants, c'est alors qu'indigné des obstacles qui traversent ton cours, torrent fougueux, tu te révoltes, et lances ton
écume jusqu'aux cieux. Tout frémit au bruit de tes vagues; et
la montagne, dont tu bats les flancs de tes flots invincibles et
écumants, s'ébranle avec un profond murmure.
Au delà, s'élèvent Àbaton, cette roche sacrée chez nos vénérables
ancêtres, et deux écueils qu'il leur a plu d'appeler les
veines du Nil, parce qu'on y observe les premiers signes de son
accroissement. Plus loin se dressent de hautes montagnes, que
la nature t'oppose pour t'empêcher de te répandre, et qui privent
les champs de Libye du tribut de tes eaux. Entre les flancs
de ces montagnes, dans une profonde vallée, ton onde captive
et domptée coule paisiblement, dans un majestueux silence.
C'est à Memphis qu'il est réservé de l'ouvrir de vasles plaines
qu'elle te permet d'inonder, sans qu'aucune digue s'oppose au
débordement de tes eaux. »
Tel fut l'entretien que César, aussi tranquille qu'en pleine
paix, poursuit jusqu'au milieu de la nuit. Mais l'âme atroce de
Pothin, déjà souillée d'un meurtre abominable, ne peut s'abstenir
de crimes. Après l'assassinat de Pompée, il ne voit rien qui
ne lui soit permis. L'ombre de ce héros le tourmente, les furies
vengeresses le poussent à de nouveaux forfaits : il croit ses
viles mains dignes de verser un sang dont la Forlune a résolu d'arroser les Péres Conscrits, pour expier leur défaite. Peu s'en
fallut que le châtiment de la guerre civile et la vengeance du
Sénat ne fussent confiés à ce vil esclave. Sauvez-nous, grands
dieux! de cette honte : empêchez que César ne périsse d'une
autre main que de celle de Brutus : le supplice du tyran de
Rome ne serait plus que le crime de Pharos, et l'exemple en
serait perdu.
L'audacieux Pothin conspire contre le destin. Ce n'est point
par trahison qu'il attente à la vie de César; c'est à force ouverte
qu'il attaque ce chef invincible. Telle est, Pompée, l'audace que
lui inspire le succès de ta mort, qu'il prétend faire tomber la
tête de ton vainqueur comme la tienne, et le réunir à toi. Voici
ce qu'il écrit à son complice Achillas, qui alors commandait
toutes les forces de l'Egypte : car le jeune roi les lui avait confiées,
et l'avait armé autant contre lui-même que contre ses
ennemis.
« Repose-toi, lui disait Pothin, dans une honteuse mollesse;
reste plongé dans un profond sommeil. Cléopâtre s'est emparée
du palais; Pharos n'est pas seulement trahi, mais il est livré
aux Romains. Toi seul tu manques à l'hymen de ta reine. Cléopâtre,
cette soeur impie, vient de s'unir à son frère, après s'être unie à César; et passant de l'un à l'autre époux, elle possède
l'Egypte et achète Rome. Cléopâtre a pu captiver par ses
charmes l'âme d'un vieillard; et tu lui confies celle d'un enfant!
S'il passe une nuit avec elle, si une fois reçu dans ses bras, il a
goûté le charme de ses caresses incestueuses, et si, sous le nom
d'une amitié sainte, il a respiré un criminel amour, il lui livrera
tout, et ma tête et la tienne, chacune pour prix d'un baiser.
Nous expierons le crime de sa beauté sur les gibets et dans les
flammes. Il n'y a plus pour nous ni secours, ni refuge : elle a
d'un côté le roi pour mari, de l'autre, César pour amant; et
peux-tu douter qu'à ses yeux nous ne soyons tous deux coupables,
nous qui n'avons jamais recherché ses faveurs? Hâte-toi,
viens, au nom du crime que nous avons commis ensemble, et
dont nous perdons tout le fruit; au nom de cette alliance que le
sang de Pompée a scellée ; viens par un prompt soulèvement
allumer tout à coup la guerre. Marche au palais, change en funérailles
les fêtes nocturnes de l'hymen ; que dans le lit nuptial
même Cléopâtre soit immolée, avec celui des deux qui se
trouvera dans ses bras. Que la fortune du chef des Romains
n'étonne point notre courage. Le même coup du sort qui l'a
élevé, et qui a imposé son joug à l'univers, fait notre gloire comme la sienne. La mort de Pompée nous élève aussi. Jette
les yeux sur ce rivage, espoir de notre crime; consulte ces flots
encore teints du sang que nous avons versé; et demande leur
de quoi nous sommes capables. Regarde ce peu de poussière qui
fait le tombeau de Pompée, et qui couvre à peine son corps :
celui que tu crains n'était que son égal. Nous ne sommes pas
d'un sang illustre; mais qu'importe? nous n'avons pas en notre
pouvoir les richesses et les forces des nations; mais par le crime
nous sommes grands et faits pour accomplir de hautes destinées.
La Fortune attire elle-même en nos mains ces hommes
puissants qu'elle a proscrits? Après une illustre victime, une
plus illustre vient s'offrir à nous. Apaisons par ce sacrifice les
mânes plaintifs des Romains; il est possible que le meurtre de
César engage Rome à pardonner aux meurtriers de Pompée.
Qu'est-ce qui l'effraie ? est-ce le nom rie César ? et que fait un
nom pour sa défense? César n'est ici qu'un soldat : il a laissé
loin de lui ses forces. Cette nuit seule terminera la guerre civile,
vengera les nations, et précipitera chez les morts cette
tête qui nous reste encore à immoler au repos du monde. Venez
tous plonger vos mains dans le sang de César ; que les Égyptiens rendent ce service à leur roi, et les Romains à leur
patrie. Toi, Achillas. ne perds pas un instant. Tu trouveras César fatigué des délices de la table, troublé par les vapeurs
du vin, et prêt à se livrer aux plaisirs do l'amour. De l'audace!
les dieux seront pour toi, les voeux des Catons et des Brutus te
les rendront favorables. »
Achillas s'empresse d'obéir à la voix qui l'appelle au crime.
Il ne fait point, comme il est d'usage, donner le signal dans le
camp ; la trompette par aucun son n'annonce son départ. Il
transporte à la hâte tous les instruments de la guerre. Les
troupes s'avancent; elles sont en partie composées de Latins;
mais ces transfuges ont oublié leur naissance, et se sont corrompus
au point qu'ils obéissent à un esclave, et qu'ils marchent
sans honte sous le satellite d'un roi, eux pour qui même
il serait infâme de souffrir ce roi à leur tète : hommes sans foi,
sans piété envers les dieux, ni envers la patrie; mains vénales,
pour qui l'action la mieux payée est la plus juste. Ce n'est pas
en Romains, mais en vils mercenaires qu'ils attentent à la vie
de César. 0 malheureuse Rome, en quel lieu ne trouves-tu pas
la guerre civile? Ceux des tiens que l'Egypte a pu soustraire à
la Thessalie exercent sur le Nil les fureurs de Pharsale. Hélas !
qu'auraient-ils fait de plus, si Pompée, reçu en Egypte, les eût
rangés sous ses drapeaux? Il fallait donc que chaque main romaine
servit la colère du ciel, il n'est permis à personne de s'abstenir! voilà comme il a plu aux dieux de déchirer le Latium.
Ce n'est plus entre le beau-père et le gendre que les
peuples sont partagés : l'esclave d'un roi se met à la tète de la
guerre civile; Achillas commande un parti des Romains; et si
le sort ne prenait pas soin de garantir César du coup qui le
menace, ce parti serait le vainqueur.
Tout est prêt, tout est mûr pour le crime. Dans le tumulte
de la fête, le palais était ouvert aux surprises. Le sang de César
pouvait rejaillir dans la coupe des rois, et sa tête tomber
sur leur table. Mais les assassins craignirent que, dans le
trouble et la confusion d'un combat nocturne. Ptolémée ne fut
lui-même enveloppé dans le carnage, et que quelque main égarée,
ou conduite par le hasard, ne fit tomber sur lui ses coups.
La confiance qu'ils avaient en leurs forces fut telle, qu'ils dédaignèrent
de hâter leur crime, et qu'ils méprisèrent l'occasion
de l'exécuter infailliblement. Ces esclaves regardent la perte
du moment d'immoler César comme facile à réparer : on le
réserve pour en faire justice en plein jour! on donne à César
une nuit à vivre ; et grâce à l'eunuque Pothin, sa mort est différée
jusqu'au lever du soleil!
L'aurore, du haut du mont Cassius, regarde l'Egypte, et y répand le jour qui, dans ces climats, est brûlant dès sa naissance.
Alors on voit de loin s'avancer, non pas des troupes semées
dans la campagne et voltigeant par escadrons, mais une
armée rangée en bataille et marchant d'un pas égal, comme
elle irait à l'ennemi dans une guerre régulière. Elle accourt,
préparée à vaincre ou à périr.
César n'osant se fier aux murs de la ville s'enferme dans le
palais, honteux d'être réduit à chercher un refuge. Le palais
même est encore trop vaste pour le petit nombre de ses défenseurs;
leur chef les ramasse en un coin. La colère et l'effroi
l'agitent, il craint l'assaut, et s'indigne de le craindre. Ainsi frémit
un fier lion dans la cage étroite qui le renferme, et il brise ses
dents contre les barreaux de sa prison. Ainsi, dieu de Lemnos,
s'irriterait ta flamme dans les cavernes de Sicile, si l'on fermait
les bouches de l'Etna.
Cet audacieux qui, naguère, sur les rocs de l'Hémus, affrontait
tous les grands de Rome assemblés, l'armée du sénat et Pompée
à leur tête, qui, condamné par sa propre cause et n'ayant rien à
espérer des dieux, marcha sans crainte et osa se promettre de
rendre injustes les destins, ce même homme est pâle devant la
révolte d'un esclave, il va se cacher dans l'obscurité d'un palais; lui que n'eussent outragé ni l'Alain, ni le Scythe, ni le
Maure qui se fait un jeu de percer son hôte de ses flèches. Cet
homme qui trouve trop étroit l'espace de l'univers Romain,
l'empire compris entre l'Inde et les rives de la tyrienne Cadix,
voyez-le comme un enfant timide, comme une femme, dans une
ville prise, chercher asile au fond d'une maison, mettre tout
l'espoir de sa vie dans une porte qui l'enferme et courir égaré
au travers des vestibules. Mais le roi l'accompagne; César le
traîne partout derrière lui, il est résolu à se venger sur lui; et
si les flèches et les flambeaux lui manquent, il fera voler sur
ces esclaves, ta tête, ô Ptolémée! C'était ainsi que la barbare
Médée redoutant le vengeur de sa trahison et de sa fuite, le
glaive levé sur.la tête de son frère, attendait son père irrité.
Cependant l'extrémité du péril obligea César de tenter les
voies de la paix. Un soldat de Ptolémée fut envoyé vers ces
esclaves révoltés, pour leur reprocher leur conduite et leur
demander, au nom du roi, par quel ordre ils avaient pris les
armes. Mais, au mépris des droits les plus saints et des lois les
plus inviolables chez tous, les peuples du monde, ils firent massacrer
l'envoyé de leur maître et le ministre de la paix : crime
atroce partout ailleurs, mais qui doit à peine être compté parmi les forfaits monstrueux dont l'Egypte est chargée. Jamais la
Thessalie, ni le vaste royaume de Juba, ni le Pont, ni l'impie
Pharnace, ni les lieux qu'arrose l'onde fraîche de l'Ibère, ni les
Syrtes barbares, n'osèrent le crime que commit l'Egypte corrompue
et amollie.
César, que la guerre environne, se voit pressé de toutes
parts; Déjà tombent dans le palais mille traits lancés du dehors.
Cependant l'ennemi n'emploie ni le bélier, qui, d'un seul coup,
eût ébranlé les murs et brisé les portes, ni aucune autre machine
capable de les forcer; il n'a pas même recours aux
flammes; répandu autour du palais, il se contente d'en investir
l'enceinte, sans jamais réflnir ses forces pour tenter un assaut.
Les destins combattent pour César et sa fortune lui sert de
forteresse.
On attaque aussi le palais avec des navires du côté de la mer
où cet édifice pompeux s'avance au milieu des flots sur une
digue audacieuse. Mais César est présent partout : d'un côté, il
repousse, l'ennemi avec le fer; de l'autre, avec le feu, et telle est
sa constance et son activité, qu'assiégé lui-même, il se comporte
en assiégeant. Sur les vaisseaux unis pour le combat, il
fait lancer des torches de poix allumée. Le feu n'est pas lent à se communiquer aux cordages de chanvre et aux. bois enduits
de cire. Les antennes et les bancs des rameurs sont en même
temps embrasés. Déjà la flotte à demi-consumée s'enfonce dans
les eaux, et bientôt la mer est couverte d'armes et de cadavres.
L'incendie ne se borne pas aux vaisseaux; de son souffle
brûlant, il gagne les maisons voisines de la mer. Le Notus
favorise et propage la flamme, et emportée par un rapide souffle,
elle se répand sur les toits avec la même vitesse que ces feux
allumés dans l'air qui n'ont pour aliment qu'une vapeur subtile
et dont l'oeil suit à peine le lumineux siilon. Ce désastre rappela
au secours de la ville les troupes qui assiégeaient le palais ; et
César n'eut garde de donner au sommeil un temps propice;
dans l'obscurité de la nuit, il s'élance sur ses vaisseaux, et profitant
toujours avec succès des hasards de la guerre et du temps
qui s'enfuit, il emploie ce peu d'instants à s'emparer de Pharos,
la clef des mers.
Sous le règne du devin Protée, cette île était loin du rivage
et assez avant au milieu des flots; à présent elle touche presque
aux murailles d'Alexandrie. César en tira deux avantages : l'un
d'interdire la mer aux ennemis; l'autre d'assurer aux secours
qu'il attendait lui-même, l'entrée du port, l'accès des murs, et
la communication libre avec la mer. Sans différer, il punit le traître Pothin, mais non par le supplice
qu'il aurait mérité : il ne fut ni attaché à la croix, ni jeté
dans les flammes, ni déchiré par les bêtes féroces. 0 justice
des dieux ! sa tête pend , mal tranchée par le glaive : Pothin
mourut de la mort de Pompée.
Cependant la jeune soeur de Cléopâtre, Arsinoé, par l'industrie
de son esclave Ganymède, parvient au camp des ennemis;
fille de Lagus, elle règne dans le camp vide de son roi et
fait plonger le fer vengeur dans le sein du perfide Achillas.
0 Pompée! voilà encore une victime qu'on envoie à ton ombre.
Mais ce n'est pas assez pour la fortune ; nous préservent les
dieux que ce soit là le terme de ta vengeance! La cour d'Egypte
et son roi même ne suffisent pas pour apaiser tes mânes,
et jusqu'à ce que les glaives du sénat soient enfoncés dans le
sein de César, Pompée ne sera point vengé.
L'audace des Égyptiens ne fut point abattue ni leur fureur
étouffée par la mort de leur général, ils retournent aux combats
sous la conduite de Ganymède; et ce jour, où César courut
le plus affreux danger, suffirait seul pour perpétuer sa
mémoire dans tous les âges.
Sur la levée étroite qui traverse le port et joint L'île de Pharos à la ville, César, à la tête des siens, s'était avancé pour
gagner ses vaisseaux abandonnés. Dans un instant, il est environné
de tous les périls de la guerre. Devant lui et à ses côtés
d'épaisses lignes de vaisseaux le pressent et bordent l'enceinte
du port, par derrière, ceux de la ville le chargent en même
temps; pour lui, nul moyen de salut, ni dans la fuite, ni dans
la valeur, à peine l'espoir d'une mort honorable. Ce n'est pas
au milieu d'une armée qu'il a défaite et sur un champ couvert
d'ennemis égorgés, qu'il touche au moment de périr ; c'est
sans verser une goutte de sang qu'il se voit pris, forcé par le
lieu même, et sans savoir s'il doit craindre ou s'il doit souhaiter
la mort. Dans cette extrémité, se rappelant Scéva et sa défense
sur la brèche du fort devant Dyrrachium, il pense à la
gloire immortelle dont se couvrit ce Romain, lorsque, sur les
débris du rempart que l'ennemi allait franchir, il résista seul
à Pompée.
FIN DE L'OUVRAGE qui est inachevé.

Voir "Les Sources de Lucain" par R. Pichon; docteur es lettres. ICI