
Les prologues de Térence
thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des lettres de Paris
par
Philippe Fabia
Agrégé des Lettres, Professeur de Rhétorique au Lycée d'Avignon.
1888

Toutes les pèces de Térence sont sur site.
CHAPITRE PREMIER. — L'authenticité, le texte et la chronologie des prologues de Térence
CHAPITRE DEUXIÈME. — Le rôle, le personnage et l'acteur du prologue dans Térence
CHAPITRE TROISIÈME. — La polémique des prologues de Térence
CHAPITRE QUATRIÈME. — L'art oratoire dans les prologues de Térence
Depuis le temps où Montaigne lisait et relisait le « bon
Térence, la mignardise et les grâces du langage latin », ce
poète n'a cessé d'ètre dans notre pays l'un des plus connus
et des plus aimés de l'antiquité classique. Jusqu'à nos jours,
l'estime des lettrés français l'a placé au dessus de Plaute,
son devancier et, pour nous, son unique rival dans la comédie
latine. Parmi les poètes de Rome, Virgile et Horace
sont les seuls qui aient joui en France d'une faveur égale
à la sienne. C'est que tout, dans la personnalité deTérence,
est fait pour nous intéresser et nous charmer. L'homme
d'abord est loin d'ètre banal : sa courte existence a quelque
chose de romanesque qui pique vivement la curiosité. Africain,
on ne sait an juste de quelle nation, amené très jeune
à Rome comme esclave, son intelligence et sa beauté frappèrent
son maître, le sénateur Térentius Lucanus, qui lui
donna une éducation libérale et, bientôt, la liberté avec un
nom qu'il devait immortaliser. Le jeune affranchi, reçu dans
l'intimité des hommes les plus marquants de l'époque par
leur naissance et leur culture, Scipion-Emilien, Lélius le
Sage et d'autres, débuta au théâtre à dix-neuf ans avec son
Andrienne. La précocité de son talent et l'éclat de ses succès
excitèrent la jalousie d'un vieux poète qui ne cessa de le calomnier. A vingt cinq ans, après avoir donné. ses six
comédies, il partit pour la Grèce, patrie des chefs-d'oeuvre
qu'il naturalisait romains, et il mourut, l'année suivante,
au cours de ce voyage, dans des circonstances très incertaines.
Le mystère de sa naissance et de sa mort, le contraste
de sa condition et de ses amitiés, de son âge et de
son talent, tous ces traits donnent à sa biographie un air de
légende. La curiosité sympathique qui attire vers l'homme,
se change en admiration à mesure qu'on lie connaissance
avec le poète. Un esprit vraiment français ne peut se dérober
aux séductions de son exquise sensibilité, de son
enjouement gracieux, de son goût délicat, de son style souverainement
élégant.
Dans ces conditions, il est étrange qu'il ne se soit encore
trouvé personne parmi nous pour écrire sur Térence une
étude sérieuse et complète. Car la critique française ne lui
a guère accordé jusqu'ici que des jugements superficiels,
dont la pièce de résistance est en général un parallèle, plus
ou moins exact et ingénieux, entre les deux comiques latins,
et qui contiennent le plus souvent avec beaucoup d'erreurs
une foule d'à peu près. Nos voisins d'Allemagne ont fait
plus utile besogne : éditions soignées, dissertations minutieuses
sur des points de détail. Mais chez eux pas plus que
chez nous il n'existe un ouvrage d'ensemble, où toutes les
questions relatives à la vie et au théâtre de Térence soient
soumises à un examen approfondi, un monument digne du
poète et conforme aux exigences de la philologie moderne.
Je me hâte de dire que, ce monument, je n'ai pas eu,
pour ma part, la prétention de l'élever. Je me suis arrêté
au seuil du théâtre de Térence. J'ai étudié seulement les
prologues, ne touchant aux comédies qu'autant qu'il était nécessaire pour donner à cette étude toute sa clarté et tout
son intérêt. Le sujet, ainsi limité, était encore très vaste :
car les problèmes de toute sorte que soulève ce petit groupe
de deux cent quarante vers, sont nombreux et importants.
Plus que toute autre partie de l'oeuvre de Térence, ils réclamaient
un examen sérieux ; c'est, en effet, sur les prologues
qu'il s'écrit couramment le plus de choses inexactes
ou fausses. L'histoire elle-même du prologue, depuis ses
origines jusqu'à notre poète, est pour la plupart des esprits
pleine de confusion. Comme la dernière phase de cette
histoire ne pouvait être exactement connue, sans que l'on
eût au préalable une idée juste des phases antérieures,
toute la question a bénéficié de mon choix.
Dans la tragédie et la comédie grecques, le prologue
n'était autre chose que l'exposition. Les comiques romains,
devanciers de Térence, en firent une introduction distincte
du drame, contenant un sommaire de la pièce encadré dans
des actualités. Térence le transforma en plaidoyer. C'est
l'étude de cette transformation qui fait l'unité de mon livre.
Un premier chapitre est consacré à la discussion des questions
relatives à l'authenticité, au texte et à la chronologie
des prologues ; il prépare une base solide à ce qui doit suivre
et qui est l'essentiel. Le second chapitre forme le centre
de l'ouvrage : c'est là qu'est décrit le changement opéré par
Térence dans les rapports du prologue et du drame, avec
les conséquences que la transformation du rôle entraina
pour le personnage et l'acteur. Le contenu des prologues,
plaidoyers fait l'objet du troisième chapitre qui est, en quelque sorte, la révision des procès intentés à Térence devant
le tribunal du public par son vieux rival. L'art oratoire des prologues-plaidoyers est étudié dans le quatrième chapitre,
qui complète ainsi l'ensemble.
Sur beaucoup de points tout était à faire ; sur quelquesuns
j'ai profité, en gardant mon indépendance, comme
n'auront pas de peine à le reconnaître ceux qui voudront
bien comparer, des travaux antérieurs, presque tous allemands,
parmi lesquels ceux de M. Dziatzko tiennent la
première place. J'ai fait de mon mieux pour me procurer
tout ce qui a été écrit sur mon sujet et, si je n'y ai pas
toujours réussi, je crois cependant que rien d'important ne
m'a échappé. Quoique la plus grande partie de ce travail
ait été faite loin de tout centre d'études philologiques, j'ai
pu me tenir au courant, grâce à l'inépuisable bonté de mes
deux maîtres, M. Maurice Croiset et M. Max Bonnet, professeurs
à la Faculté des Lettres de Montpellier, qui ont
mis à mon service leur érudition et leurs livres ; je leur
en exprime ici toute ma reconnaissance. Mon frère doit avoir
aussi sa part de remerciements : étant élève de l'École Polytechnique,
il m'a sacrifié plusieurs de ses après-midi du
mercredi, passées à la Bibliothèque nationale en recherches
très méritoires.
Sauf avis contraire, je cite le texte de Térence d'après
l'édition critique d'Umpfenbach, Berlin, Weidmann, 1870.

L'AUTHENTICITÉ, LE TEXTE ET LA CHRONOLOGIE
DES PROLOGUES DE TÉRENCE
1
Le fait que les sept prologues de Térence, deux pour
l'Hécyre, un pour chacune des autres comédies, nous sont
parvenus en tête de chaque pièce proprement dite et dans
les mêmes manuscrits, ne constituerait pas à lui seul une
garantie absolue de leur authenticité. Les prologues des
comédies de Plaute nous ont été conservés dans des conditions
tout à fait pareilles ; et cependant la plupart d'entre
eux, au moins sous leur forme actuelle, sont certainement
postérieurs à la mort de Plaute : ils appartiennent à la première
moitié du septième siècle. On voit que la communauté
de transmission des prologues et des pièces fait simplement
naître des présomptions en faveur de la communauté d'origine,
et qu'il n est pas inutile d'en chercher des preuves
plus décisives. D'ailleurs, elles se présentent en abondance
et avec un tel caractère de certitude que l'on peut, en toute
sécurité, se reposer sur le témoignage des manuscrits et
des grammairiens, sans crainte de le voir jamais sérieusement
attaqué. Un premier point hors de discussion, c'est que les prologues
sont contemporains des comédies. On peut mème
préciser davantage : chacun d'eux fut écrit entre la composition
de la pièce correspondante et une représentation, donnée
du vivant de Térence, à laquelle il servit comme de prélude.
Ils contiennent, en effet, une sorte d'histoire de chaque
pièce, depuis le jour où elle est passée des mains du poète
qui venait de l'achever aux mains des acteurs chargés de
la jouer, jusqu'au jour où elle a été présentée au public :
les critiques formulées par les adversaires du poète, leurs
intrigues pour lui faire infliger un échec les incidents
survenus aux répétitions, des allusions à des échecs
précédemment subis, et, comme conclusion, un appel au
jugement impartial du public qui tranchera le débat encore
pendant. Partout il y est question du poète comme d'une
personne vivante et présente avec qui l'acteur du prologue
est en relations. Tandis que dans plusieurs prologues de
Plaute tel et tel passage se rapportent à des faits que le
poète n'a pu connaître, aux réformes théâtrales du septième
siècle, ici rien ne dénote une époque autre que celle de
Térence ; tout, au contraire, nous ramène au temps où il
vécut. Ses prologues sont tous en quelque sorte datés de
la veille d'une représentation où il put assister. S'ils sont
contemporains, il va presque de soi qu'ils sont authentiques.
Qui était plus intéressé et plus apte que lui à les composer?
A qui attribuer plutôt qu'à lui les prologues de ses comédies
écrits de son vivant ?
Si l'hypothèse bizarre d'un collaborateur, intervenant
quelques jours avant la représentation d'une pièce pour en
écrire le prologue, pouvait se présenter à l'esprit de quelqu'un,
elle ne résisterait pas à un sentiment que l'on éprouve de prime abord en lisant les prologues de Térence ;
c'est Térence lui-mème que l'on croit entendre et non un acteur récitant un rôle. Admettons, si l'on veut, qu'un
autre que le poète, que son ami le plus intime, aurait pu
définir, aussi nettement qu'ils le sont dans les prologues de
l'Andrienne, de l'Eunuque et des Adelphes, les rapports
de ces comédies avec les modèles grecs ou les oeuvres des
vieux comiques romains ; qu'un confident bien informé de
ses travaux, de ses idées, de ses impressions, aurait pu
entretenir le public des intentions passées et futures, des
espérances et des déceptions du poète, de ses théories littéraires,
des motifs qui avaient réglé sa conduite dans telle
circonstance. Mais le ton et l'accent dont tout cela est dit
révèlent autre chose que la sympathie d'un ami. Ce n'est
pas un écho des émotions de Térence qui vibre dans les
prologues : ce sont ses émotions elles-mêmes, c'est toute
son âme. Soit qu'abordant la scène pour la première fois il
prie les spectateurs de fonder sur le mérite de l'Andrienne
l'opinion qu'ils vont prendre de lui pour l'avenir, soit
qu'il repousse avec une indignation légitime l'accusation de
plagiat, soit qu'il revendique contre les attaques de ses
ennemis le droit de représailles, soit qu'il se fasse honneur
de ses relations amicales avec les plus grands personnages
del'Etat, à l'intensité et à la chaleur du sentiment,
on devine Térence en personne derrière l'acteur-prologue.
Il est bien rare que celui-ci prenne une affirmation quelconque à son propre compte : il se borne presque toujours à
rapporter celles du poète; par sa bouche, c'est le poète qui
parle ; il n'est qu'un porte-voix. A moins de monter lui-même
sur la scène, Térence ne pouvait pas donner plus de
relief à sa personnalité dans ses prologues et s'y montrer
plus à découvert au public.
Voici qui est encore plus concluant, s'il est possible : Térence se désigne formellement lui-même comme l'auteur du plus grand nombre de ses prologues « Le poète, est-il
dit dans celui de l'Andrienne, consume ses soins à écrire
des prologues, non pour y raconter le sujet de la pièce,
mais pour répondre aux propos méchants d'un poète malveillant.
Ceci revient à signer, pour ainsi dire, le prologue de
l'Andrienne et à revendiquer par avance tous ceux dont le
contenu répond à cette définition. Au début du prologue
de l'Eunuque, Térence manifeste le vif désir qu'il a de
blesser le moins de personnes possible et il ajoute : « S'il
est quelqu'un qui pense qu'on a parlé de lui trop durement,
qu'il pense bien à ceci : ces paroles étaient une réponse,
non une attaque ; c'est lui qui a porté le premier coup.
Le mécontent qui gémit, c'est le vieux poète, et Térence
l'a malmené dans le prologue de l'Andrienne, dont il se
proclame ainsi une fois de plus l'auteur. Ambivius, chargé
de plaider la cause de l'Heautontimorumenos, fait remarquer
qu'il prête simplement l'autorité de sa voix au poète,
auteur du discours qu'il va prononcer, c'est-à-dire du prologue. Plus loin, il annonce que Térence, quand il donnera
d'autres pièces nouvelles, parlera plus longuement des
fautes de son rival.
Il y a là encore une reconnaissance anticipée des prologues
à venir. A la représentation du Phormion, il attesta en termes non moins clairs l'authenticité de celui de cette
pièce et de tous les précédents : " S'il y a quelqu'un qui
dise ceci ou le pense : sans la provocation du vieux poète,
le nouveau n'aurait pu trouver aucun prologue à faire prononcer,
s'il n'avait eu quelqu'un à qui dire du mal ; voici ce qu'on lui répondra, etc. :
Si quis est, qui hoc dicat aut sic cogitet :
Vetus si poeta non lacessisset prior,
Nullum invenire prologum posset novus
Quem diceret, nisi haberet cui malediceret;
Is sibi responsum hoc habeat... "
Le prologue des Adelphes appartient aussi à la série de
ceux que Térence a revètus d'une sorte de signature. Dès
les premiers vers, il y est dit que le poète va faire lui-même
des révélations sur son compte et se soumettre au
jugement des spectateurs.
Le prologue presque tout entier est consacré à cette confession.
Seuls les deux prologues de l'Hécyre ne portent pas la
marque d'origine dont nous parlons. De plus, ils n'appartiennent
ni l'un ni l'autre à la catégorie définie par Térence
dans le prologue de l'Andrienne. Enfin dans le second, de
beaucoup le plus important des deux, la personnalité du
poète ne tient qu'une place secondaire, tandis que celle d'Ambivius, le vieil acteur chargé de le prononcer, occupe
le premier plan. A cela rien d'étonnant : Ambivius est
substitué au personnage ordinaire du prologue, et la raison
d'ètre de cette substitution, ce fut le désir de mettre à profit
l'ascendant dd vieil acteur sur le public. Elle avait été
également opérée pour l'Heautontimorumenos. Mais ici,
enhardi par un premier succès de son innovation à la perfectionner
et sentant plus vivement encore qu'alors le besoin
de s'abriter derrière un protecteur populaire, le poète a fait de ces moyens de recommandation un usage plus exclusif.
D'ailleurs les deux prologues en question présentent, au
même degré que les autres, le premier caractère d'authenticité
signalé par nous : ils sont contemporains de Térence. Or, plus que jamais aux deux reprises de l'Hécyre,
à la seconde surtout, l'obligation de préparer le public à
écouter favorablement la pièce était impérieuse et la cause
difficile à plaider. Térence aurait-il, dans ces graves conjonctures,
rompu avec une habitude constante et abandonné
à un autre le soin de lui composer un plaidoyer ?
A ceux qui ne voudraient pas accepter de telles garanties
d'authenticité il ne resterait qu'une ressource : faire
intervenir un faussaire, quelque grammairien désoeuvré,
qui, aveuglé par une ridicule ambition, se serait mis en
tète de refondre l'oeuvre de Térence en substituant ça et là
ses vers à ceux du poète, ou bien, poussé par un zèle
maladroit, aurait voulu combler des lacunes et réparer des
pertes causées par le temps. Le fait ne serait assurément
pas sans précédent (1).
(1) Les prologues des Bacchides et du Pseudolus de Plaute sont dans ce cas.
Mais ces sortes de contrefaçon se reconnaissent d'ordinaire sans trop de difficulté. La supercherie est mal déguisée par une imitation plus ou moins imparfaite de la manière et du style de l'auteur. Le faussaire croyait en donner une image fidèle : il n'a dessiné qu'une caricature. Au premier regard un oeil quelque peu exercé découvre la fraude : les idées s'enchaînent mal, l'expression manque de clarté et de justesse, l'emploi des tours et des procédés familiers à l'auteur est gauchement exagéré ; il tombe sous le sens que l'oeuvre n'est pas digne de lui. Rien de semblable dans les prologues de Térence : par les caractères de la langue et du style, par les mérites de la composition et de la forme, ils révèlent tous la main qui a écrit les comédies. Bien plus, à l'exception d'un seul vers 3, nous verrons qu'on n'y trouve pas de trace certaine d'interpolation. (1)
(1) Heaut.prol.
Sans doute quelques passages embarrassent
au premier abord l'interprétation et peuvent éveiller le
soupçon ; mais il n'en est aucun dont une étude patiente et
attentive ne puisse venir à bout ; bien loin qu'il soit nécessaire
d'avoir recours à des moyens extrêmes et de nier l'authenticité de tout un prologue ou même de quelques vers
d'un prologue.
Cependant trois des prologues de Térence, ceux de
l'Heautontimorumenos et de l'Hécyre, n'ont pas échappé
aux attaques, peu redoutables, il est vrai, de l'hypercritique Guyet celui que Bentley, qui lui-même n'était certes
pas un timide, a ainsi qualifié : « Vir sagacissimus, sed
audacia saepe praeceps. » Pour le prologue de l'Heautontimorumenos,
il le déclare formellement apocryphe,
" suppositicium". Mais les essais de restitution auxquels
il se livre ça et là sembleraient prouver que ce mot
ne rend pas bien sa pensée et qu'il le considérait plutôt
comme une refonte du texte primitif. Sinon à quoi bon
tous ces efforts ? Qu'importerait que le grammairien faussaire
eût écrit une sottise de plus ou de moins ?
Quant à ceux de l'Hécyre, il nie que le plus court soit de
Térence, sans préciser davantage et il attribue le plus
long à un grammairien désoeuvré, qui
aurait simplement amplifié le précédent au
moyen d'idées et d'expressions empruntées aux autres.
Si Guyet condamne le prologue de l' Heautontimorumenos, c'est qu'il n'a pas saisi le sens, pourtant assez clair,
des vers 11-15, c'est-à-dire, des explications fournies par
Ambivius de sa présence dans un rôle qu'il joue par extraordinaire.
Il est venu parce qu'il fallait au poète non pas un
véritable personnage de prologue, mais un avocat. Or,
cette importante mission, il en était plus digne que tout
autre acteur : Térence a bien compris que sa voix, sympathique
au public, aurait autant d'efficacité que le plaidoyer
lui-même. Au lieu de faire, dans le passage, du mot actor le synonyme d'orator, orateur, avocat, Guyet a pris inversementorator dans le sens ordinaire d'actor, acteur,
; et il s'est trouvé alors en face
d'une plaisanterie insipide ou, pour mieux dire, d'un non-sens. Égaré par cette méprise, il lui semble ensuite reconnaître
un peu partout des traces de corruption. Il n'admet
pas qu'Ambivius, un acteur, se proclame en quelque façon
l'égal du poète. Etrange anachronisme! Aux yeux du
public romain, un directeur de troupe, pour rendre à
Ambivius son véritable titre, valait bien un poète dramatique,
et, dans l'espèce qui nous occupe, Térence a montré
lui-même, en se plaçant sous la protection d'Ambivius,
combien l'autorité de celui-ci était supérieure à la sienne.
La partie du prologue (16-25), où il s'agit de la contamination
et des prétendus collaborateurs du poète, n'est,
d'après Guyet, que la reproduclion des vers 15-19 du prologue de l'Andrienne suivis des vers 15-19 du prologue
des Adelphes. Est-il donc impossible que Térence ait eu à
répondre deux fois au même reproche ? La ressemblance
dans les termes est-elle assez frappante entre les deux
réponses pour que l'on ait le droit de regarder l'une comme la copie de l'autre ? Non ; et en particulier les deux ripostes
de Térence à ceux qui lui donnaient des collaborateurs sont
parfaitement distinctes. Dans les vers 44-46, Guyet est
choqué par la lenteur de l'expression : defertur lui paraît
faible et froid après curritur. Enfin, il n'hésite pas à
biffer les deux derniers vers du prologue, parce que la
locution « exemplum statuite » lui déplaît. Il faut être
animé d'une sollicitude bien jalouse pour la gloire de son
auteur et se sentir une sûreté infaillible de goût et d'érudition, quand on condamne ainsi des vers sur un tour que
l'on trouve peu élégant ou sur une façon de parler que l'on
juge peu latine. Ce sont là, en somme, des critiques de
nulle valeur dont le point de départ est un contre-sens.
Guyet se refuse à tenir pour authentique le premier prologue de l'Hécyre à cause de la déclaration contenue dans
les vers 6.7 :
Et is qui scripsit hanc, ob eam rem noluit,
Iterum referre,ut iterum posset vendere. Il remarque ici : « Hoc pudoris Terentiani esse non videtur », parce qu'il ne s'est pas bien rendu compte de la
situation. La première fois que l'Hécyre fut donnée, les
spectateurs désertèrent le théâtre pour aller voir des lutteurs
et un danseur de corde. La représentation fat donc
interrompue et ne se termina pas. Térence aurait pu, pendant
la durée des mêmes jeux, en essayer une deuxième ; il
ne le fit pas, et la pièce ne reparut que quelques années
après, aux jeux funèbres de Paul-Emile. Voulant expliquer
alors à l'avantage de 1'Hécyre sa conduite passée, il prétendit
que, s'il n'avait pas fait sur-le-champ une tentative de reprise, c'était afin de pouvoir revendre plus tard son oeuvre
pour d'autres jeux comme pièce nouvelle : car, si elle avait
été jouée en entier aussitôt après la représentation inachevée
et considérée comme non avenue, elle n'aurait plus eu dès
lors au point de vue commercial que la valeur beaucoup
moindre d'une pièce ancienne. En donnant cette raison, il
s'exposait à passer pour un homme cupide ; mais aussi il
affirmait sa foi robuste au mérite de son oeuvre et indiquait
assez clairement qu'elle était partagée par des personnages
éminents : puisque l'Hécyre reparaissait, elle avait trouvé
de nouveaux acquéreurs, et ces nouveaux acquéreurs étaient
Scipion Émilien et son frère. C'est ce que Donat, plus
clairvoyant que Guyet, a très bien compris.
Dans le second prologue de l'Hécyre, Guyet ne voit
qu'une sorte de mosaïque faite de pièces fournies par les
autres. Il aurait bien dû apporter à l'appui de son affirmation
quelques exemples concluants et nous dire quel est,
parmi les vrais prologues de Térence, celui auquel le
prétendu faussaire a emprunté les détails sur les rapports
de l'acteur Ambivius avec le poète Cécilius, et le récit
du second échec de la pièce. Ces deux développements
forment ensemble une bonne moitié du prologue, sur
laquelle ne peut porter la critique de Guyet. Parce que le
mot calamitas, déjà employé au vers 2 du prologue précédent,
se retrouve au vers 22 de celui-ci, il en conclut que
le passage où figure ce vers n'est qu'une reproduction ;
comme si Térence en parlant du même fait n'avait pas pu
deux fois se servir du même mot caractéristique. Quant à la fin du prologue, depuis le vers 35, où Ambivius prend
si chaleureusement la défense du poète, Guyet pensait
sans doute qu'elle était imitée du prologue de l'Heautontimorumenos.
Du moins il prétend que les trois vers :
Si numquam avare pretium statui arti meae
Et eum esse qusestum in animum induxi maxumum,
Quam maxume servire vostris commodis,
textuellement communs aux deux prologues, ont passé de
celui de l'Heautontimorumenos dans celui de l'Hécyre. Mais,
abstraction faite de ces trois vers, qui ne sont à mes yeux
ni un larcin imputable au faussaire ni une interpolation, et
que je tiens pour une simple répétition, il n'y a qu'une
ressemblance assez vague entre la dernière partie des deux
prologues. Pour obtenir l'attention et la bienveillance,
Ambivius parle, dans l'un, de la fatigue excessive que lui
cause la représentation des pièces très mouvementées
fabulæ motoriae (1), dans l'autre, des intérèts de l'art
théâtral, motifs d'ordre tout différent.
(1) Tandis que l'Heaut. est une fabula stataria.
L'affirmation de Guyet
ne repose donc sur rien de solide, et le faussaire, au profit
duquel il veut dépouiller Térence, n'est qu'un rève de son
imagination.
L'opinion de Guyet, en ce qui concerne seulement les
prologues de l'Hécyre, a été reprise et modifiée dans ces
dernières années par M. Schindler. Frappé par certaines particularités de métrique, de vocabulaire et de syntàxe, il a
cru reconnaître dans ces deux morceaux une autre main que
celle de Térence. Mais il a vu qu'ils ne peuvent avoir été
écrits que du vivant de notre poète. La nature des idées
développées dans le second et la place qu'y tient la personnalité
d'Ambivius l'ont conduit à les attribuer l'un et l'autre
à ce directeur de troupe. Mais, comprenant fort bien que
son opinion ne serait pas soutenable, s'il était démontré que
Térence assista aux reprises de l'Hécyre, il essaie de prouver
que le départ de celui-ci pour la Grèce fut antérieur à la première,
celle des jeux funèbres de Paul-Emile. Or cette base de
tout le système manque absolument de solidité. Il est
d'abord impossible à cause de ce vers 1 du second prologue :
Ne cum circumventum inique iniqui inrideant,
de croire que la représentation définitive de l'Hécyre ait eu
lieu en l'absence de Térence. Ensuite, pour reculer son
départ jusqu'avant la première reprise, il faudrait admettre
qu'antérieurement aux funèrailles de Paul-Emile, où ils
furent donnés avec l'Hécyre, les Adelphes avaient eu une
autre représentation, précédée du prologue actuel, qui
atteste d'une manière évidente la présence du poète : nous
verrons plus loin qu'une pareille hypothèse est inacceptable.
On fait observer, il est vrai, que, si Térence a vu la dernière
reprise, aux jeux romains, en septembre, il n'a pu quitter
Rome que vers l'équinoxe d'automne ; car il est invraisemblable,
étant donné le passage de sa biographie par Suétone,
où il est question de ce voyage en Grèce, qu'il ait différé
son départ jusqu'au printemps de l'année suivante ; et l'on
insiste sur les difficultés de la traversée dans cette saison-là.
Elles étaient réelles sans doute, mais elles n'arrètaient pas
tous les voyageurs, puisque Virgile, venant par mer
d'Athènes, débarqua à Brindes quelques jours avant les calendes d'octobre 735. Qui sait si Térence n'eut point,
comme alors Virgile, des raisons spéciales de faire le
voyage à cette époque de l'année ? Nous nous sommes déjà
expliqués au sujet du relief donné dans le second prologue
à la personne d'Ambivius : il ne faut pas ètre dupe des
apparences et y voir autre chose qu'un artifice du poète.
Quant aux rapprochements dont M. Schindler voudrait tirer
la preuve d'emprunts faits aux vrais prologues de Térence
par l'auteur de celui-ci, ils sont insignifiants ou erronés. Ce
sont aussi de bien faibles raisons que les deux particularités
de métrique relevées dans le premier prologue : si l'on
ne veut pas les imputer à Térence, une légère correction
les fait disparaître. On aurait tort également d'attacher trop
d'importance à quelques tours de phrase du second prologue,
sans autre exemple dans les oeuvres de notre poète, et
mème à un nombre relativement considérable de mots, qui ne
s'y retrouvent pas ailleurs. Sans doute la proportion de ces
derniers est sensiblement plus forte ici que dans les autres
prologues: il y en a dix-huit pour quarante-neuf vers, soit
plus d'un pour trois vers. Mais peut-ètre trouverait-on dans
le texte des comédies proprement dites plusieurs passages non moins frappants au même point de vue : j'ai pris au
hasard le fameux récit du viol, dans l'Eunuque, et j'ai compté
sur une suite de trente-neuf vers (568-606) vingt-un mots
de cette catégorie, sans parler des noms propres ; ce qui
fait un peu plus d'un mot pour deux vers .
En somme, il faut être égaré par l'esprit de témérité ou
l'amour du paradoxe pour mettre en discussion l'authenticité
des prologues de Térence, datés de son vivant, pleins de
détails précis sur sa personnalité, trop éloquents pour n'être
pas l'expression directe de ses émotions, clairement avoués
pour la plupart et comme signés par le poète.
II
Si l'authenticité des prologues est généralement admise
sans contestation, il est pourtant plus d'un vers, plus d'un
passage, dont le texte, tel qu'il se présente dans les manuscrits,
a éveillé les soupçons de la critique et provoqué
des essais de correction. Parmi les erreurs que les philologues
ont découvertes ou cru découvrir, les unes portent
sur des détails minimes qui intéressent les seuls auteurs
d'éditions savantes ; étant donné l'objet de ce livre, nous
n'aurions aucun profit à les discuter minutieusement. D'autres,
sans avoir beaucoup plus d'importance par rapport à l'ensemble d'un prologue, méritent cependant d'attirer notre
attention, parce qu'elles peuvent modifier nos opinions sur
tel et tel fait particulier; il nous suffira, toutes les fois que
s'en présentera l'occasion, d'ouvrir une parenthèse, où nous
examinerons rapidement la solidité des reproches faits à la
leçon traditionnelle. Enfin, deux passages controversés appellent
un examen immédiat : le début du prologue de
l'Heautontimorumenos et la fin du premier prologue de
l'Hécyre. Quelles corrections faut-il faire aux quinze premiers
vers du prologue de l'Heautontimorumenos, pour
qu'ils offrent un sens clair et tout à fait satisfaisant ? Faut-il
admettre qu'il existe une lacune plus ou moins considérable
après le septième vers du premier prologue de l'Hécyre ?
La discussion de ces deux graves difficultés réclame trop de
développements pour tenir dans une simple note.
Par une dérogation à l'usage, qui était de confier le rôle
du prologue à un jeune acteur, le vieil Ambivius, chef de
la troupe, fut chargé de réciter celui de l' Heautontimorumenos.
L'origine de tous les embarras et le point de départ de
toutes les tentatives d'interprétation ou de restitution, c'est
ce troisième vers qui indique nettement la division du discours
d'Ambivius en deux parties : il dira d'abord pourquoi
le poète lui a confié ce rôle ; ensuite il s'acquittera de sa
mission. Or, les explications promises ne viennent pas immédiatement,
elles ne commencent qu'après le dixième vers.
Pourquoi ce retard imprévu et comment justifier la présence
intermédiaire des six vers précédents ?
Westerhov prétend tout éclaircir sans rien changer à la vulgate. D'après lui, le développement compris entre
les vers 4-10 n'est qu'une parenthèse. La première partie
annoncée s'étend du vers 10, simple transition, au vers 15
inclusivement, la deuxième du vers 16 à la fin. Mais alors,
tandis que la digression imprévue compterait six vers, le
développement principal promis et attendu n'en aurait que
cinq. La disproportion serait choquante et la façon de procéder
bien bizarre : promettre des éclaircissements sur un
point précis et, au lieu de les donner tout de suite, se perdre
d'abord dans une digression. Térence est un écrivain trop
habile et trop soigneux pour qu'on puisse avec quelque
vraisemblance mettre à sa charge une faute de composition
aussi grossière. Ce qui achève de rendre cette interprétation
inacceptable, c'est qu'entre la prétendue parenthèse et ce
qui est proprement le sujet, le vers 10 formerait une transition bien maladroite et bien lourde.
Bentley, tout en conservant lui aussi le texte traditionnel, a imaginé une autre solution de la difficulté,
très originale, mais très invraisemblable. L'acteur du prologue,
dit-il en substance, quittait d'ordinaire la scène après
l'avoir prononcé, et il était remplacé par les personnages de
la pièce. Ici au contraire, dès qu'Ambivius aura récité le
prologue, il entamera le rôle de Chrémès. Il va donc tout
d'abord expliquer pourquoi le poète l'a choisi comme acteur
du prologue, et le prologue tout entier sera consacré à
ces explications, puis il dira ce rôle de Chrémès, en vue
duquel il est venu en scène, « deinde quod veni eloquar. »
Cette façon d'entendre la division formulée au vers 3 influe
nécessairement sur l'interprétation des vers 11-15. On croit en général qu'Ambivius s'y présente comme un avocat
chargé de prononcer un plaidoyer, le prologue. D'après
Bentley « actor » est pris dans le sens d'acteur, et
« orationem quam dicturus sum » désigne le rôle d'Ambivius
dans la pièce. De sorte que, si l'on adopte l'opinion
de Bentley, les explications d'Ambivius n'offrent pas de
sens raisonnable. Pourquoi Térence l'a-t-il chargé du prologue
? Parce qu'il doit ensuite jouer la pièce. De plus,
Facteur-prologue avait, comme nous le dirons plus tard,
ses attributs à lui. Ambivius les portait alors, de mème
qu'il les porta dans la suite à la troisième représentation
de l'Hècyre ; c'est pourquoi les spectateurs virent au
premier coup d'oeil que le vieillard allait, contrairement à
la tradition, jouer ce personnage. Il ne pouvait donc, sans
changer de costume, remplir le rôle de Chrémès ou celui de
Ménédème ; il devait quitter la scène aussitôt après le prologue,
comme l'acteur-prologue ordinaire. S'il en est ainsi,
les mots « deinde quod veni cloquar » et « orationem
hanc quam dicturus sum » ne peuvent se rapporter à son
rôle dans la pièce et désignent nécessairement quelque
partie du prologue.
M. Dziatzko n'est pas à beaucoup près aussi conservateur
que Westerhov et Bentley. Il a bouleversé tout le
début de notre prologue. Il suppose d'abord une lacune
après le vers 2 et la comble par conjecture ; voici donc les
cinq premiers vers de sa restitution : Ne quoi sit vostrum mirum, quor partis seni
Poeta dederit, quae sunt adulescentium,
[ Id vos docebo; sed ne hujusce fabulae
Vos ignoretis nomen et qui scripserit, ]
Id primum dicam, deinde quod veni eloquar. Dans ce texte « id primum dicam » se rapporte aux
vers 4-9 du texte vulgaire et « quod veni eloqttar » au reste du prologue. On voit tout de suite combien ce système
de correction est téméraire ; bien plus, il est positivement
inacceptable. Si « quod veni eloquar » correspond
d'une part à « quor partis seni poeta dederit », de l'autre
à « nunc quam ob rem has partis didicerim », cette formule
doit signifier : « Je dirai pourquoi je suis venu, pourquoi
le poète m'a confié ce rôle » : et l'on n'arrive à un tel
sens qu'en mettant un solécisme sur le compte de Térence.
En bon latin, « quod veni eloquar » ne peut signifier
autre chose que : « Je dirai ce pourquoi je suis venu, je
m'acquitterai de la mission qui m'amène ici.»
Arrivé au vers 6, il le biffe 2, et avec raison, comme
n'étant qu'une interpolation. C'est, en effet, le seul vers des
prologues qu'on ne puisse défendre. De quelque façon qu'on
le tourne, il n'offrira jamais un sens clair et naturel ; il
sentira toujours le grammairien bien plus que le poète. Quant aux vers 7, 8, 9, ils devaient nécessairement disparaître
: ils auraient été en contradiction formelle avec la
déclaration qui précède. Mais quelle raison positive y a t-il
de les supprimer? M. Dziatzko adopte pour le vers 4 : Ex integra graeca integram comoediam, le sens traditionnel qu'il formule ainsi : « Ex graeca fabula,
cujus nemo quidquam, pl'æripuit, latinam, cui non oportuit quidquam addi » ; en d'autres termes : « La pièce est
la reproduction d'un seul original grec, elle n'est pas le
résultat d'une contamination ». Cette interprétation l'empèche
de voir le lien qui unit ce vers aux vers 7,9: Novam esse ostendi et quae esset : nunc qui scripserit Et cuja graeca. sit, ni partem maximam
Existimarem scire vestrum, id dicerem.
L'Heautontimorumenos était bien, dit-il, une pièce nouvelle
; mais l'acteur du prologue n'avait pas besoin de le
faire remarquer au public, les directeurs de troupe ne jouant
en ce temps-là que des pièces nouvelles ; et, en effet, il n'a
rien dit de tel ; dès lors que signifient ici les mots : « Novam
esse ostendi » ? La pièce étant nouvelle, comment
l'acteur du prologue peut-il supposer que la majorité des
spectateurs connaissent le nom du poète grec. M. Dziatzko en conclut que ces trois
vers ne sont pas ici à leur place. Nous trouvons cette mutilation de notre prologue inutile,
parce que nous entendons tout autrement le vers 4 : « Je
vais jouer aujourd'hui, dit Ambivius, l'Heautontimorumenos,
comédie non encore représentée, tirée d'une comédie
grecque non encore traduite ». C'est ainsi que le comprenait
le scholiaste du Bembinus qui explique « integra
graeca » par « a nullo translata », et « integram comaediam » par « novam, in scena nondum visam». Le sens
que nous donnons à l'adjectif « integer » est en tout conforme
à celui qu'il a partout ailleurs dans Térence, où il
s'applique à la personne, à la chose qui n'a rien perdu de
ses qualités naturelles et premières, qui n'a subi ni amoindrissement,
ni dommage, ni altération, ni souillure : il convient
donc à la pièce grecque, qui est dans l'état où son
auteur l'a laissée, et sur laquelle aucun poète latin n'a
encore mis la main, ni pour en distraire une partie, ni, à
plus forte raison, pour la livrer tout entière à la scène romaine
; il convient aussi à la pièce latine, telle qu'elle vient
de sortir des mains du poète, neuve et vierge, n'ayant pas
encore subi la diminution de valeur qui est le résultat de
la représentation. D'ailleurs, une remarque sur la composition
de la pièce ne serait guère à sa place en cet endroit
et viendrait beaucoup plus naturellement après les vers 16-19, où le poète parle de contamination. Au contraire, il
était très à propos, quoi qu'en dise M. Dziatzko, de signaler
aux spectateurs, dès le commencement du prologue, la nouveauté
de la comédie à jouer. La plupart d'entre eux avaient,
en effet, trop peu de culture intellectuelle et de goût pour
venir chercher au théâtre autre chose qu'un plaisir de rire
ou de curiosité. Ce qui les attirait, ce n'était point la beauté
artistique, c'était la nouveauté de l'oeuvre. En général ils
n'éprouvaient pas le désir de revoir les pièces déjà jouées :
il leur en fallait de nouvelles. Aussi le poète avait-il intérêt
à insister chaque fois sur ce fait que la condition capitale
de nouveauté était remplie par la comédie présente. De plus
le jour où fut représente l'Heautontimorumenos, Térence
avait une raison spéciale de le faire. A propos de l'Eunuque,
joué antérieurement, on lui avait reproché de remettre à
la scène une comédie déjà traduite, « veterem fabulam ».
Ce reproche l'avait vivement touché, et il tenait à bien montrer
que sa nouvelle oeuvre n'y donnait pas prise, même en
apparence.
Les mots « novam esse ostendiet quæ esset » font donc
une suite claire et logique aux vers 4-5. Mais pourquoi
Ambivius pense-t-il que la plupart des spectateurs savent
et le nom de l'auteur latin et surtout le nom du poète grec (1) ?
(1) Les raisons données par Ladewig (Cf. Dziatzko, De prol. Ter. et Pl. p. 9, n. 2) et Boissier (les prol. de Ter., dans les Mél.- Graux, p. 84) pour expliquer l'omission de ce dernier nom, ou plutôt les conséquences qu'ils en tirent, sont inadmissibles. L'un prétend qu'à l'époque de Térence la connaissance du théâtre de Ménandre était familière à un très grand nombre de spectateurs ; l'autre, que Térence ne parle ici qu'aux gens qui ont quelque littérature et que les autres ne comptent pas pour lui. Il faut encore moins s'arrêter à l'opinion de Lessing sur le sens de « novam esse ostendi et quae esset ». Il rapporte ces mots à une déclaration du poète aux édiles, quand il leur a présenté la pièce pour être achetée (Cf. Dziatzko, op. cit. p. 8).
Cette supposition, nous le prouverons plus tard, n'est
qu 'un prétexte pour se dispenser d'accomplir une formalité
consacrée par l'usage ; elle fait partie d'un système d'irrégularités
commises ce jour-là par Térence et dont la plus
frappante est l'attribution du rôle du prologue au vieil
acteur Ambivius.
Nous avouons qu'une interprétation pleinement satisfaisante
du début de notre prologue n'est pas possible, si l'on
ne change rien au texte traditionnel. Mais il suffit, lever pour les difficultés, d'une correction légère et très plausible.
Changeons simplement dans le vers 3 l'ordre des
adverbes de temps.
Cette transposition, proposée par Paulmier et par Guyet,
est beaucoup plus ancienne qu'eux ; les scholies du
Bembinus la mentionnent. La leçon courante, au temps
du scholiaste, était celle de nos manuscrits ; mais d'aucuns
lisaient pourtant « primum » et « deinde » dans l'ordre
inverse. Mais ce qui la recommande bien
plus encore que son antiquité, c'est la façon toute simple
dont s'explique pour qui l'adopte l'altération du texte primitif.
Il n est pas d'usage que dans une énumération
« deinde » précède « primum ». Cette anomalie se rencontrait
pourtant dans ce vers de Térence. De bonne heure
on dut en ètre frappé, et, faute d'avoir analysé attentivement
la suite des idées du prologue, on l'attribua à une distraction de copiste. On crut réparer une erreur en replaçant
les deux adverbes dans leur position relative habituelle.
Après cela, l'oeil des lecteurs superficiels n'aperçut rien de bizarre dans l'aspect du prologue, et la bévue se
perpétua.
Après notre correction, « primum quod veni eloquar »
porte sur les vers 4-9. La contenu en est-il de telle nature
qu'Ambivius puisse dire qu'il est venu pour les prononcer,
donnant à entendre par là qu'il ne s'est chargé du prologue
que par surcroît? Oui, car ils sont consacrés à l'annonce
préliminaire, à la pronuntiatio tituli, incomplète et irrégulière
ici. Or, nous insisterons plus tard sur ce point,
l'annonce complète et normale était faite par le directeur,
du haut de la scène, avant le prologue ; l'annonce était ce
pour quoi le directeur paraissait à ce moment sur le théâtre.
Une fois par exception Ambivius cumule avec sa mission
de directeur le rôle de personnage du prologue ; mais, cette
fois-là mème, il est surtout et avant tout directeur, il vient
surtout et avant tout pour la pronuntiatio tituli. Et il y
avait pour lui urgence à la faire, encore plus qu'à fournir
les raisons de son apparition sous un aspect inattendu
puisque d'ordinaire le public était renseigné avant le premier
vers du prologue. Comme elle devait tenir en peu de
mots, elle ne ferait pas longtemps attendre à l'impatience
des spectateurs l'explication déjà promise d'un choix tout
exceptionnel. Cette explication se trouve dans les vers 11-15,
annoncés par « id deinde dicam ». Quant au vers 10, il
forme une transition dont on comprend la force très accentuée,
puisqu'elle sépare, non pas une digression d'un développement
principal, mais bien deux développements principaux.
Ce qui suit, à partir du vers 16, constitue le prologue
proprement dit, le plaidoyer en faveur de Térence.
Il n'est pas annoncé dans la division du vers 3, et n'avait
nul besoin de l'ètre : les attributs portés par Ambivius
étaient une annonce assez claire. Tout s'arrange donc par
un simple déplacement de deux mots, sans qu'il soit nécessaire
d'avoir recours à des moyens extrèmes. C'est à M. W. Ihne que revient la hardiesse d'avoir
signalé une lacune après le septième vers du premier prologue
de l'Hécyre, et son opinion a fait école. Pour moi, je
considère ce texte, dans l'état où nous le possédons, comme
entier et complet. Que peut-on, en effet, lui reprocher?
Le trouve-t-on trop court par rapport aux autres prologues
de Térence ? Mais il ne faut pas oublier que la deuxième
représentation de l'Hécyre ne fut pas isolée, qu'elle eut lieu,
ou plutôt fut tentée, aux mêmes jeux que la première des
Adelphes et, selon toute vraisemblance, après le succès de
la pièce nouvelle. Térence avait dit aux spectateurs, dans
le prologue des Adelphes, tout ce qu'il avait à leur dire soit
de particulier à cette comédie, soit de général : il pouvait
donc être très bref dans le prologue de l'Hécyre. Mais
ne devait-il pas recommander avec insistance l'oeuvre si
dédaigneusement accueillie d'abord ? Non, ce jour-là sa
tactique était tout autre : il ne voulait pas avoir l'air de
mendier une attention bienveillante, il payait d'audace.
D'ailleurs, le succès tout récent des Adelphes pouvait bien
passer à ses yeux pour la plus efficace des recommandations.
Le sens donné par le texte actuel n'est-il pas acceptable
? demande-t-il à être changé ou au moins modifié par
une suite au vers 7 ? C'est l'objection qui ressort du commencement de restitution proposé par M. Ihne : « Si Térence fait représenter
de nouveau son Hécyre, ce n'est pas qu'il ait voulu
la vendre et en toucher le prix une seconde fois, c'est pour
une autre raison ». Mais on ne peut construire et expliquer
ainsi cette phrase sans torturer le texte et faire violence aux
lois de la langue latine. Elle ne peut raisonnablement fournir
qu'un seul sens : « L'auteur de la pièce n'a pas voulu
qu'elle fût de nouveau présentée au public (immédiatement
après l'échec et pendant les mêmes jeux), afin de pouvoir
la vendre de nouveau (pour d'autres jeux)» Dans cette
déclaration que trouve-t-on de choquant? Répugne-t-on,
comme Guyet, à mettre sur le compte de Térence l'aveu
formel d'un sentiment si peu désintéressé ? Nous avons dit
plus haut pourquoi nous sommes persuadé, avec Donat,
que Térence l'a réellement fait. Ou bien paraît-il invraisemblable
que Térence, aussitôt après son échec, ait conçu
l'espoir de revendre sa pièce et que plus tard il ait osé
afficher une pareille prétention? Qu'un drame comme
l'Eunuque, accueilli dans sa nouveauté par un succès
exceptionnel, ait été redemandé à l'auteur et payé le prix
d'une oeuvre nouvelle, cela se conçoit. Mais pouvait-il
jamais se trouver un donneur de jeux pour acheter l'Hécyre
déjà présentée au public qui n'en avait pas voulu ? Nous
répondrons qu'on n'est pas obligé de croire Térence sur
parole ; il n'a pas eu après son échec l'intention et la
confiance qu'il s'attribue, mais il veut en imposerau public.
Si l'Hécyre n'a pas reparu depuis, c'est en réalité que
l'accès de la scène lui est resté fermé. Arrivent les jeux
funèbres de Paul-Emile, dont l'un des fils est Scipion
Emilien, l'ami de Térence. Pour faire plaisir au poète, il
inscrit l'Hécyre au programme de ses fêtes : il va sans dire
que Térence accepte sans réclamer ses droits d'auteur. Mais qui l'empêche de faire accroire au public que la pièce
a été revendue et qu'il y avait bien compté ?
Nous venons de défendre, sur deux points importants, le
texte des prologues contre des entreprises téméraires. Les
discussions critiques de détail, qui trouveront place dans la
suite de cette étude, nous fourniront d'autres occasions de
prendre parti pour la tradition contre d'inutiles hardiesses.
En somme, les prologues de Térence, à peu près exempts
des altérations qui entachent beaucoup de textes anciens,
nous sont parvenus dans un état presque parfait de pureté.
III
Il est important pour nous de classer les prologues de
Térence dans leur ordre chronologique. Nous devrons en
effet nous demander plus loin quel emploi il a fait du prologue;
recueillir et coordonner les renseignements que, dans
ces curieux morceaux, il nous fournit lui-même en abondance
sur sa carrière ; enfin, apprécier les mérites littéraires
qui distinguent cette partie de son oeuvre. Nous ne pourrons
pas placer nos documents dans un ordre quelconque : ce serait
en altérer la valeur relative. Pour avoir une idée juste
des variations que Térence fit subir à sa manière selon
les nécessités du moment et les conseils de la pratique théâtrale,
pour tracer une image exacte de sa vie poétique,
pour signaler dans ses prologues le progrès de ses qualités
oratoires, il est indispensable d'en établir d'abord aussi solidement que possible la chronologie. D'ailleurs, même si
cette question, par les conséquences qui se déduiront de la
solution, n'était pas d'un intérêt fondamental pour notre
sujet, elle vaudrait bien en elle-même la peine d'être examinée
de près, parce qu'elle se pose depuis longtemps à
la curiosité philologique comme un difficile problème. Pour fixer la chronologie des prologues, il ne suffit pas
tout à fait d'établir celle des comédies. Nous avons la certitude
que deux d'entre elles, l'Eunuque et l'Hécyre, ont
été portées plus d'une fois sur la scène du vivant de Térence
; et, quoique, à cette époque, on ne jouât d'ordinaire
que des pièces nouvelles, il est possible à la rigueur qu'il y
en ait d'autres dans le mème cas. Or, nous avons déjà remarqué
que tous les prologues de Térence sont pour ainsi
dire datés de la veille d'une représentation. Il faut ajouter
qu'ils n'ont pu servir que pour cette représentation et
qu'aucun certainement n'a été prononcé deux fois devant
le public romain. Il y a là une différence essentielle entre eux
et ceux de Plaute et des poètes dramatiques antérieurs.
Supposons, par exemple, que le Rudens fût joué plusieurs
fois ; à chaque reprise la pièce a pu ètre précédée du
prologue de la première représentation; il ne convenait pas
plus spécialement à celle-ci qu'aux suivantes. Au contraire,
les prologues de Térence sont des morceaux d'actualité, des
discours de circonstance qui n'eurent plus, une fois prononcés,
qu'une valeur littéraire. Le plus souvent la pièce y
est signalée comme nouvelle. Ils répondent à des critiques
dont elle a été l'objet avant la représentation ; le public,
juge suprême, va se prononcer; si la pièce revient un jour
devant lui, après un premier succès, les mêmes critiques ne
seront pas de nouveau formulées, ou, si elles se reproduisent
par hasard, le poète les réfutera sur un autre ton et se
prévaudra forcément dans sa riposte de cet arrêt favorable.
Ils contiennent aussi parfois des allusions aux choses du
moment, qui mettraient à elles seules en lumière ce caractère
d'actualité. Par exemple, Ambivius a été chargé de
dire le prologue à la première de l'Heautontimorumenos;
il a dû tout d'abord expliquer sa présence aux spectateurs,
surpris de voir un vieillard dans un rôle attribué d'ordinaire
à un jeune acteur. Si la pièce a eu d'autres représentations,
ces explications n'ont pu évidemment se reproduire. De là
résulte qu'il faut avant tout vérifier si les prologues ont été écrits pour la première représentation des comédies correspondantes
ou pour une reprise.
Pour la plupart d'entre eux, la question n'offre pas de
difficulté; trois donnent formellement comme nouvelle la
pièce qu'ils précèdent. Il est dit au vers 24 du prologue du
Phormion : «Adporto novam, — j'apporte une comédie
nouvelle ; » au vers 12 du prologue des Adelphes : « Eam
nos acturi sumus novam, — c'est la comédie que nous
allons jouer, elle est nouvelle ; » et au vers 7 du prologue
de l'Heautontimorumenos : « Novam esse ostendi, — j'ai
montré que la comédie est nouvelle. » Il est certain aussi
que le prologue de l'Eunuque fut récité à la première représentation,
quoique cela ne soit pas dit en termes aussi
formels. Les adversaires de Térence lui ont reproché, à
propos de cette pièce, d'avoir mis au pillage ses devanciers
romains. Cette accusation de plagiat, dont le but était de
faire échouer l'Eunuque, fut évidemment lancée avant l'apparition de l'oeuvre. Confondus par son succès éclatant, ils
ne renouvelèrent sans doute pas leurs attaques; s'ils en eurent le courage, Térence, rassuré par les applaudissements
et confiant dans son public, ou n'en tint aucun
compte, ou y répondit dans d'autres termes. La répétition
dont il est parlé dans le prologue est donc une de celles qui
préparèrent la première représentation. De plus, le prologue
se termine par ces deux vers :
" Cum silentio animum attendite
Ut pernoscatis quid sibi Eunuchus velit;
faites silence et prêtez attention, afin de bien comprendre
l'Eunuque "; formule qui ne conviendrait pas à un public
connaissant déjà la pièce. Nous aurons à examiner plus
tard si, oui ou non, l'Hécyre fut donnée la première fois sans
prologue ; quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de prologue pour cette représentation. L'un des deux que nous possédons,
le plus court, est celui de la première reprise : il fait allusion au sort malheureux de la pièce dans sa nouveauté,
« cum data est nova », et explique pour quel motif le
poète n'a pas consenti depuis à la laisser reparaître sur la
scène : « Non iterum voluit referre » elle y revient maintenant
dans les mèmes conditions qu'une comédie nouvelle :
" Nunc haec plane est pro nova". Le second prologue, le
plus long, fait un récit détaillé de deux échecs antérieurs,
ni plus ni moins ; s'il y en avait eu un troisième avant cette
date, Ambivius n'aurait pu le passer sous silence. Nous
avons donc là le prologue de la deuxième reprise.
Reste seulement le prologue de l'Andrienne, au sujet
duquel ont eu lieu de longues discussions. Le vers 5 est
la cause première du désaccord :"
Nam in prologis scribundis operam abutitur."
Frappé par le pluriel « allusion au sort malheureux de la pièce dans sa nouveauté,
« cum data est nova », et explique pour quel motif le
poète n'a pas consenti depuis à la laisser reparaître sur la
scène : « Non iterum voluit referre ; » elle y revient maintenant
dans les mèmes conditions qu'une comédie nouvelle :
« Nunc haec plane est pro nova.» Le second prologue, le
plus long, fait un récit détaillé de deux échecs antérieurs,
ni plus ni moins ; s'il y en avait eu un troisième avant cette
date, Ambivius n'aurait pu le passer sous silence. Nous
avons donc là le prologue de la deuxième reprise.
Reste seulement le prologue de l'Andrienne, au sujet
duquel ont eu lieu de longues discussions. Le vers 5 est
la cause première du désaccord :"
Nam in prologis scribundis operam abutitur."
Frappé par le pluriel « prologis », Tanneguy-Lefèvre
émit l'opinion que Térence avait écrit plusieurs prologues
et par suite plusieurs pièces avant l'Andrienne. Mais cette conjecture ne peut tenir devant le témoignage catégorique
de Suétone, qui fait de l'Andrienne la première oeuvre de
Térence. Depuis, d'autres savants sont arrivés à une conclusion
plus spécieuse : le prologue actuel de l'Andrienne
serait celui d'une reprise et non celui de la première représentation.
Il n'est pourtant pas besoin de recourir à cette
hypothèse pour justifier convenablement le pluriel en question.
C'est un pluriel emphatique qui exprime bien la vive
contrariété causée au poète par l'obligation où les attaques, imprévues de Luscius l'ont mis, d'écrire un discours pour
défendre sa pièce, fastidieuse besogne avec laquelle il
n'avait pas compté. Il y a même quelque chose de plus.
Térence dit : « Me voilà forcé d'écrire des prologues », et
non « un prologue », parce qu'il se doute bien que les
attaques se reproduiront et que l'obligation reviendra à
chaque pièce nouvelle. L'argument n'est donc pas sans réplique ; mais, le doute une fois éveillé, on a trouvé d'autres raisons à l'appui. On a prétendu que ceux qui rapportent le prologue à la première représentation sont embarrassés pour
expliquer comment les adversaires de Térence arrivèrent à connaître l'Andrienne assez à fond pour savoir qu'elle était
formée de deux pièces grecques fondues ensemble ; que cette
connaissance suppose presque nécessairement une représentation
antérieure au prologue. Rien de plus faux. Térence
se vanta peut-être lui-même devant quelques personnes en
relations avec Luscius d'avoir opéré ce mélange, et la chose
vint ainsi aux oreilles de son rival; dans tous les cas, Luscius,
qui, en sa qualité de vieux poète, était connu du chef de troupe, des magistrats-présidents des jeux et de leurs
amis, a fort bien pu jeter les yeux sur le manuscrit et assister
à une répétition ; c'est alors qu'il a découvert et signalé
la contamination. De même, plus tard, assistant à une répétition de l'Eunuque, il découvrit et signala un prétendu
plagiat. Mais les premières attaques de Luscius ne se sont-elles
pas produites d'une autre façon, du haut de la scène,
dans un prologue, devant le grand public ? Dans ce cas,
elles ne pouvaient avoir de portée que si les spectateurs connaissaient déjà l'Andrienne par une représentation antérieure.
Seulement rien ne prouve que Luscius ait donné
poète : il se contenta de dire du mal de la pièce dans les
conversations de la vie quotidienne et de faire colporter des bruits malveillants à travers la ville par les gens de son
entourage. C'était là son procédé ordinaire, comme cela
ressort clairement des termes où Térence mentionne ces accusations. D'ailleurs, de quel droit son adversaire l'aurait-il chicané plus tard sur la composition de ses prologues,
s'il avait mérité les mêmes reproches, et le premier ?
On a voulu conclure qu'avant la représention de l'Andrienne
avec notre prologue, une ou plusieurs comédies de Térence
avaient échoué ; on a dit que Térence, réduit presque au
désespoir par ces revers, suppliait ici le public de ne pas
agir comme il l'avait fait auparavant, de ne pas repousser la
pièce avant de la connaître. Interprétation forcée qui ajoute
au texte et veut lire entre les lignes. Pourquoi ne pas entendre
tout naturellement ce que dit Térence ? « On a dit
du mal de ma pièce ; je viens de la défendre ; à vous maintenant
de juger entre mes adversaires et moi. Soyez équitables
; prenez entière connaissance de la chose, et vous verrez
après clairement si de moi vous pouvez attendre rien de bon,
si les pièces que je ferai à l'avenir, il conviendra de les
écouter ou de les repousser de prime abord. En un mot,
faites-vous aujourd'hui une opinion sur mon compte et qu'elle
vous serve de règle pour me juger dans la suite. » D'échecs
déjà subis, soit par l'Andrienne, soit par une autre comédie,
pas un mot dans le prologue, non plus que dans les témoignages
anciens qui signalent comme ayant échoué une
seule pièce de Térence, l'Hécyre ; pas un mot dans
le prologue du Phormion, où il n'est également question
que d'un échec de l'Hécyre. Serait-ce donc précisément
à celui-ci que feraient allusion nos quatre derniers vers ?
L'Andrienne, jouée une première fois en 588, aurait plu au
public ; puis serait venu l'échec de l'Hécyre. Pour reconquérir
la faveur populaire, Térence aurait remis sur la scène sa pièce précédemment applaudie, l'Andrienne. Combinaison
invraisemblable : car, si l'on place entre l'échec de l'Hécyre
et la représentation de l'Heautontimorumenos une reprise
de l'Andrienne, à moins d'admettre que l'oeuvre d'abord
applaudie tomba alors, on ne saurait expliquer pourquoi
Térence chargea Ambivius de prononcer le prologue de
l'Heautontimorumenos. Le but de cet artifice était évidemment
de prévenir le retour d'un malheur, retour contre
lequel aucun succès intermédiaire n'avait encore rassuré le
poète. De plus, les vers :
Favete, adeste sequo animo et rem cognoscite,
Ut pernoscatis ecquid spei sit relicuom...
démontrent que le public ne connaît pas encore d'un bout à
l'autre l'Andrienne ; ils ne peuvent s'entendre que dans
l'une de ces deux hypothèses : ou bien la pièce, présentée
pour la première fois en 588, ne put être complètement
jouée alors et fut reprise plus tard avec le prologue actuel ;
or nous avons prouvé que cela est tout à fait invraisemblable
; ou bien elle fut donnée en 588, dans sa nouveauté,
avec notre prologue ; c'est le seul parti auquel on puisse
s'arrèter.
Nous affirmons, en d'autres termes, que le prologue de
l'Andrienne est le premier prologue de Térence. Pris en
lui-mème, cette place lui convient très bien. Dans l'emploi
du prologue, la manière de Térence se distinguera de
celle qu'ont pratiquée ses devanciers : il fait connaître tout
de suite aux spectateurs en quoi va consister cette différence.
Il saisit aussi la première occasion qui lui est donnée de
s'entretenir avec le public pour faire en quelque sorte sa
profession de foi littéraire ; il se présente comme l'admirateur
et le disciple des anciens: Névius, Plaute, Ennius ; il
se place, lui adolescent humble et obscur, sous la protection
de leur gloire et de leur popularité. Mais ce n'est pas assez de dire que l'on reconnaît dans ce prologue le poète qui ne
s'est jamais encore entretenu avec le public ; on y reconnaît
aussi le débutant qui apporte son premier ouvrage sur la
scène avec une émotion où la crainte et l'espoir se balancent.
Ce débutant, à la fois timide et hardi, on le devine
surtout dans les quatre derniers vers, dans cet appel si pressant
adressé au spectateur impartial, sur un ton bien modeste
où perce pourtant une note de malicieuse ironie contre ses
ennemis. Il demande si peu ! qu'on lui permette de se faire
entendre une fois, une seule ; puis, si le public juge que le
nouveau venu n'est bon à rien, comme l'ont insinué les
mauvaises langues, on pourra le condamner pour toujours
au silence.
Il ne nous reste plus maintenant qu'à déterminer l'époque
des diverses représentations auxquelles nous avons assigné
les prologues.
IV
Pour cela, nous avons trois sources de renseignements : les didascalies du Codex Bembinus, celles des manuscrits de la récension de Calliopius et le commentaire de Donat. Les indications chronologiques fournies par chacune de ces trois sources sont de deux sortes : les noms des magistrats (édiles présidents des jeux et consuls de l'année) (1) sous lesquels la pièce fut jouée, et son rang dans la série des oeuvres de Térence.
(1) Dans la didasc. des Ad. les noms des fils de Paul-Emile, qui présidèrent les jeux funèbres, tiennent la place de ceux des édiles.
Mais si, en ce qui concerne les noms des magistrats, surtout des consuls, les trois sources sont d'accord
ou peuvent toujours ètre assez facilement conciliées il n'en
est pas de même pour l'ordre numérique : ici les deux premières,
les didascalies, se séparent de la troisième, le
commentaire de Donat. Autre dissentiment : dans aucune
des trois sources le classement résultant des indications
nominales ne concorde avec celui qui a pour base les indications
numériques. En somme, quand on veut établir la
chronologie des comédies de Térence, on se trouve en présence
des trois tableaux que voici :
I. Classement obtenu en ne tenant compte que des indications nominales, surtout des consulats :
1 L'Andrienne. M. Marcellus et C. Sulpicius étant
consuls, 588 de Rome. Pour cette pièce les didascalies
manquent, mais le témoignage de Donat est confirmé par
celui de Suétone (Vie de Térence).
2° L'Hécyire (première représentation). T. Manlius et Cn.
Octavius étant consuls, 589. Renseignements fournis par
les trois sources.
3° L'Heautontimorumenos. M. Juvencius et Ti. Sempronius
étant consuls, 591. Le commentaire de Donat
manque pour cette pièce.
4° L'Eunuque. M. Valerius et C. Fannius étant consuls,
593. Donat ne nomme pas les consuls. Les mss. de Call. et
Donat sont d'accord pour placer la représentation aux jeux
mégalésiens, en avril. Le Bembinus seul la place aux jeux
romains, en septembre.
5° Le Phormion. M. Valerius et C. Fannius étant consuls,
593. Ces noms sont fournis par les mss. de Call. et
Donat ; ceux du Bembinus se rapportent évidemment à
une représentation posthume. La pièce fut donnée, d'après
les mss. de Calliopius, aux jeux romains, d'après Donat,
aux jeux mégalésiens. Nous verrons plus loin que la première
date est la plus probable. 6° Les Adelphes. M. Cornélius Céthégus et L. Anicius
Gallus étant consuls, 594. Les noms des consuls manquent
dans Donat; mais il indique, d'accord avec les didascalies,
que la pièce fut représentée aux jeux funèbres de Paul-Émile.
7° L'Hécyire (deuxième représentation), aux jeux funèbres
de Paul-Émile, d'après les trois sources, par conséquent
sous les mèmes consuls que les Adelphes, mais, sans aucun
doute, après cette pièce.
8° L'Hécyre (troisième représentation). Q. Fulvius et L.
Marcius étant édiles curules. On ignore la date de leur édilité
; il y a tout lieu de croire que ces noms, fournis par les
trois sources, sont ceux des édiles de 594. Quoi qu'il en
soit, cette représentation ne peut avoir eu lieu qu'en 594,
puisque Térence y assista, partit ensuite pour la Grèce et
mourut dans le courant de l'année suivante, quand il se disposait
à rentrer à Rome.
II. Classement obtenu en ne tenant compte que des indications
numériques des didascalies :
1° L'Andrienne. Les didascalies manquent; mais, tous
les autres rangs étant pris, il ne reste pour cette pièce que
le premier.
2° L'Eunuque. Bemb. : facta secunda ; mss. de Call. :
acta secunda.
3° L'Heautontimorurnenos. Bemb. : factast tertia; mss.
de Call. : facta III. 4° Phormion. Bemb. : factaest IIII ; mss. de Call. : facta IIII.
5° L'Hécyre. Bemb. : facta est V ; l'indication manque
dans les autres.
6" Les Adelphes. Bemb. : facta VI. Les mss. de Call.
portent le mot facta, mais le chiffre manque.
III. Classement obtenu en ne tenant compte que des
indications numériques de Donat :
1° L'Andrienne. Prima acta est....
2° Les Adelphes. Hanc dicunt ex Terentianis secundo
loco actam....
3° L'Eunuque. Haec edita tertium est....
4° Lc Phormion. Editaque est quarto loco....
5° L'Hecyre. Factaque et edita quinto loco....
6° L'Heautontimorumenos, tous les autres rangs étant
pris.
Des trois tableaux, celui qui inspire le moins de confiance,
c'est le dernier. En effet, ce qu'il donne pour un
classement chronologique n'est en réalité qu'une liste par
ordre alphabétique (1) (Andria, Adelphae, Eunuchus, Formio (2), Hecyra, Heautontimorumenos (3) dérivée, au moyen
d'une modification très simple, du classement donné par les
indications numériques des didascalies, ainsi que nous le
montrerons tout à l'heure.
(1) Les anciens ne tenaient compte dans le classement alphabétique que de la première lettre.
(2) Orthographe latine du mot grec, dont nous retrouverons encore plus loin l'influence.
(3) Je crois avec Umpfenbach que Donat avait
aussi écrit un commentaire pour cette pièce ; mais je suis convaincu que
l'Heaut. occupait dans son ouvrage le 6 et non le 5 rang. On s'explique mieux de cette façon la perte de cette
partie du commentaire : elle a été détruite par un accident identique à
celui qui nous a privés de la Vidularia de Plaute.
Dans l'exemplaire de Térence
dont se servit Donat, les pièces étaient rangées suivant cet
ordre alphabétique, comme elles sont rangées suivant un
autre ordre alphabétique légèrement différent dans toute une branche des manuscrits de Calliopius. Les didascalies de
cet exemplaire donnaient d'ailleurs les mêmes indications
numériques que les nôtres. Donat, prenant l'ordre des
pièces dans le manuscrit pour leur ordre chronologique,
voulut tout concilier en changeant les numéros. Il ne vit
pas que le sixième rang ne pouvait convenir à l'Heautontimorumenos,
à cause de l'époque des consuls ; il ne sentit
pas tout ce que cette concordance parfaite entre l'ordre
alphabétique et son prétendu ordre chronologique avait
d'invraisemblable. Cependant on dirait qu 'il a eu une hésitation
la première fois qu'il a dû faire un changement de
numéro, c'est-à-dire à propos des Adelphes; ce qui semble
le prouver, c'est la formule qu'il emploie dans sa préface
de la pièce. Pour les autres comédies il s'exprime d'une façon
catégorique et affirme en son nom, tandis qu 'il a l'air ici de
rapporter l'opinion d'autrui. Comme il n'y a que le premier
pas qui coûte, quand il dut changer aussi le numéro
de l'Eunuque, il n'éprouva plus le mème scrupule. Quoi
qu'il en soit de cette explication, qui nous parait très plausible,
il est certain que le tableau numérique de Donat est
sans valeur.
Il ne convient pas non plus d'accorder trop d'autorité au
premier tableau. Voici pourquoi : les rédacteurs des didascalies
actuelles, comme Donat dans ses préfaces, n'eurent
en vue, sauf pour l'Hécyre, qu'une représentation de
chaque pièce, la première, et prétendirent grouper les seuls
renseignements qui s'y rapportaient : jeux, édiles ou autres
donneurs des jeux, directeur de troupe, consuls de l'année. Mais, malgré leur bonne intention, ils ont commis un grand
nombre d'erreurs manifestes; en sorte que nous retrouvons
souvent, dans les didascalies de nos manuscrits aussi bien
que dans les préfaces de Donat, des traces de représentations
autres que la première. Ou bien les noms des magistrats
sous lesquels fut jouée une comédie nouvelle sont
confondus avec les noms des magistrats sous lesquels elle
fut reprise : pour l'Andrienne, Donat nomme quatre édiles
curules ; pour l'Eunuque, les manuscrits de Calliopius
donnent trois consuls, tandis que le Bembinus désigne des
édiles qui ne sont pas de la mème année que ses consuls ;
pour l'Heautontimorumenos, les deux consuls mentionnés
par le Bembinus appartiennent à deux années différentes.
Ou bien même les noms propres récents ont, dans une de
nos sources, tout à fait supplanté les noms propres anciens ;
tel est le cas pour la didascalie du Phormion dans le Bembinus.
Le désaccord assez fréquent des trois sources relativement
au nom des jeux, et la présence presque constante
de deux noms de directeurs sont encore des indices de l'influence
exercée par les reprises sur la rédaction de nos
didascalies. La rédaction primitive, celle que composèrent,
peut-ètre au moyen de documents fournis par les exemplaires
des chefs de troupe, les grammairiens latins du
milieu du VIle siècle, tenait sans doute compte, non seulement
de la première représentation, mais aussi des suivantes
; et nos didascalies actuelles ne sont probablement
que des extraits faits sans soin et sans intelligence par des
grammairiens de l'époque postérieure, qui voulurent ne
considérer que la première représentation. En tout cas, les
erreurs sont évidentes et on a le droit d'en conclure que
les renseignements nominaux ne méritent pas une confiance
absolue. Ils démontrent seulement qu'une représentation a
eu lieu sous les magistrats nommés et, si tous ces magistrats
n'appartiennent pas à la mème année, qu'il y a eu plusieurs représentations, on peut dire aussi que la plus ancienne
représentation dont il reste des traces nominales est
très probablement la première, si on n'a aucune raison sérieuse
de supposer le contraire. Mais, s'il y a des motifs
solides d'assigner à cette première représentation une date
plus reculée, l'autorité des indications nominales ne saurait
nous empècher de le faire. Il est possible en effet que tous
les renseignements nominaux relatifs à une première représentation aient disparu dans les trois sources.
Le classement numérique, une fois établi, n'était pas
sujet à variation. Tandis qu'à chaque nouvelle représentation
d'une pièce la liste des noms propres s'allongeait, le numéro
d'ordre, fixé une fois pour toutes par la date de la première
représentation, n'avait rien à faire avec les reprises ; il
appartenait à la partie invariable de la didascalie avec le
titre de la pièce, le nom du poète latin et celui de l'auteur
grec, le nom du compositeur et l'indication du genre de
musique. Pour les rédacteurs de nos didascalies actuelles,
quelque ignorants et négligents qu'on puisse les supposer,
toute confusion était ici impossible : ils n'avaient pas à faire
un triage parmi des renseignements de mème espèce
accumulés, ils n'avaient qu'à transcrire un chiffre. Si donc
nous prouvons que l'ordre numérique des didascalies
représente une tradition authentique sur la chronologie des
pièces, il ne faudra pas hésiter à lui accorder la préférence.
Or il est d'abord certain qu'il représente le classement le
plus ancien, celui d'où dérivent tous les autres que nous
connaissons. Pour arriver au classement alphabétique de
Donat : Andria, Adelphoe, Eunuchus, Formio, Hecyra,
Heautontimorumenos, on n'a eu, en partant de l'ordre
numérique, qu'à intercaler les Adelphes entre l'Andrienne
et l'Eunuque et à rejeter l'Heautontimorumenos en queue
de la liste. Pour arriver au classement alphabétique légèrement
différent que donne toute une branche de la famille
de Calliopius, il a suffi, prenant le mème point de départ, d insérer également les Adelphes au deuxième rang et de
placer l'Heautontimorumenos au cinquième entre le
Phormion et l'Hécyire, Andria, Adelphoe, Eunuchus,
Formée, Heautontimorumenos, Hecyra. Si ces deux classements
alphabétiques avaient été faits indépendamment de
l'ordre numérique, ne serait-il pas surprenant qu'ils soient
l'un et l'autre daccord avec l'ordre numérique sur le rang de l'Andrienne et le rang du Phormion ? Comment expliquerait-on
que les Adelphes n'aient pris nulle part le premier rang auquel ils avaient, dans un classement alphabétique, le même
droit que l'Andrienne ; que le Phormion n'ait jamais été
renvoyé au sixième, qui lui revenait d'après l'orthographe
normale du mot? Evidemment les auteurs des deux listes
alphabétiques ont eu sous les yeux le classement numérique.
Le fait n est pas douteux non plus en ce qui concerne l'auteur
du classement des pièces tel que nous le trouvons dans
l'autre groupe des manuscrits de Calliopius : Andria,
Eunuchus, Heautontimorumenos, Adelphoe, Hecyra, Phormion, pour mettre ensemble d'une part les pièces traduites
de Ménandre, de l'autre les pièces traduites d'Apollodore, on
a opéré une simple permutation de place entre le Phormion
et les Adelphes. Quant au Bembinus, le plus ancien de nos manuscrits, les comédies s'y suivent précisément dans l'ordre
indiqué par les chiffres. Ainsi dans les archétypes de
tous les manuscrits de Térence que nous connaissons, soit directement, soit indirectement, l'ordre de succession des
comédies était conforme aux numéros d'ordre placés dans
les didascalies. Cette classification si ancienne avait-elle eu
pour origine le hasard, l'arbitraire ? N'y a-t-il pas dans
celle-ci un plan, comme dans toutes les autres, où l'intention
est visible ? Oui, on l'avait adoptée en qualité de classification
chronologique. L'ordre numérique dont elle fut la
conséquence, et non la cause, représente une tradition authentique
et non une notation arbitraire. Ce qui le prouve,
c'est d'abord sa presque concordance avec le classement
fourni par les indications nominales. Car, si l'on considère
comme nul le premier essai de représentation de l'Hécyre,
ce qui est bien légitime, puisque la pièce ne put pas même
être entamée ; si l'on tient pour valable le second où une
partie de la pièce fut jouée, après lequel Térence ne la
qualifie plus de nouvelle ; si enfin, par une inexactitude
fort explicable, les deux comédies ayant été données aux
mèmesjeux, on place cette représentation de l'Hécyre avant
celle des Adelphes, on arrive à ces deux tableaux :
Indications numériques,
Andria,
Eunuchus,
Heautontimorumenos,
Pliormio,
Hecyra,
Adelphoe,
Indications nominales,
Andria,
Heautontimorumenos,
Eunuchus,
Phormio,
Hecyra,
Adelphoe.
Ils ne différent que par la position respective de l'Eunuque
et de l'Heautontimorurnenus. Ne serait-il pas étrange
qu'un groupement fortuit eût abouti à cet accord presque complet ? Autre fait non moins extraordinaire dans cette
hypothèse : les deux tableaux ne sont pas incompatibles ;
ils peuvent ètre conciliés, puisque l'époque assignée par le chiffre à la première représentation d'une pièce n'est jamais
postérieure à la date de la plus ancienne représentation de
cette pièce, marquée par les noms propres. C'est donc
l'ordre numérique, comme étant de beaucoup le plus recommandable,
que nous prenons pour base de notre chronologie,
contrairement à l'usage.
Conservant à l'Andrienne le premier rang qu'elle occupe
partout, nous donnons le second à l'Eunuque. Cette pièce,
avant la représentation sur laquelle nous renseignent les
didascalies et Donat, en avait eu une autre, et le souvenir
ne s'en est pas entièrement perdu. Voici en effet ce que dit
Suétone, dans la Vie de Térence : « Eunuchus quidem bis
acta est meruitque pretium quantum nulla antea cujusquam
comoedia, octo millia nummum ». De ce passage
il faut rapprocher ces paroles de Donat, dans la préface de
son commentaire sur l'Eunuque L'eunuque fut donc joué pour la
première fois sans doute aux jeux romains de 588 ; car
l'Andrienne a été représentée aux jeux mégalésiens de la
même année, et l'Hécyre a échoué aux jeux mégalésiens de l'année suivante. Il est vrai que le second rang reviendrait
à l'Eunuque, même s'il avait paru immédiatement après,
puisque ce ne fut là qu'un essai de représentation nul et
non avenu ; mais il suffit de comparer le prologue de l'Eunuque
avec celui de l'Heautontimorumenos pour se convaincre
qu'entre cette dernière comédie et l'échec de l'Hécyre ne s'est point placé un succès.
Il résulte de notre classement que la production de Térence
fut plus féconde à ses débuts que pendant le reste de
sa carrière. A cela quoi de surprenant ? Il compose alors
avec une ardeur toute juvénile qu'excite le succès ; ses oeuvres,
bien reçues du public, ne manquent pas d'acquéreurs.
Mais le premier échec de l'Hécyre le refroidira et lui inspirera
plus de circonspection. Il laissera passer deux années
sans rien donner à la scène. Le bon accueil fait à l'Heautontimorumenos
ne suffira pas à le rassurer. Un nouveau
délai de deux ans s'écoulera sans qu'il se risque encore une
fois sur ce terrain, dont il connaît mieux maintenant les
dangers et les surprises. La fécondité que nous lui attribuons
n'a d'ailleurs rien en soi d'invraisemblable : six mois
devaient largement suffire à la composition d'une fabula
palliata.
L'Eunuque fut repris en 593. Après quatre ans, le souvenir
du succès éclatant que la pièce avait remporté lors
de son apparition, était encore si présent et si vif, que les présidents des jeux ou leurs intermédiaires la redemandèrent
au poète, sûrs qu'elle produirait autant d'effet qu'une
comédie nouvelle, et qu'il la revendit comme telle, malgré
sa qualité de pièce ancienne. Mais comment se fait-il que,
dans les indications nominales de nos trois sources, il ne reste
plus trace de la première représentation ? Pareille
chose, bien que possible à la rigueur, n'est arrivée pour
aucune autre pièce de Térence. Peut-être faut-il en chercher
la cause dans ce fait, que l'Andrienne et l'Eunuque
parurent la mème année. Les rédacteurs des didascalies actuelles,
qui firent parmi leurs documents un choix si arbitraire, retrouvant en tète de la seconde comédie des noms de magistrats qu ils avaient déjà vus en tète de la première,
crurent devoir les omettre et corriger ainsi une erreur. Les
exemples d'omissions analogues ne manquent pas. Les deux
reprises de l'Hécyre eurent lieu la même année que la représentation des Adelphes ; les noms des consuls de cette
année se sont conservés dans la didascalie des Adelphes et
ne figurent pas dans celle de l'Hécyre. La reprise de l'Eunuque
et la première du Phormion sont l'une et l'autre
de 593 ; les noms de tous les magistrats de la première représentation
ont disparu de la didascalie du Phormion dans
le Bembinus, et Donat ne nomme pas les consuls de cette
année dans la préface de l'Eunuque. Quoi qu'il en soit, la
représentation de l'Eunuque, sur laquelle les didascalies et
Donat nous fournissent la série ordinaire des renseignements
nominaux, n'était qu'une reprise.
En ce qui concerne l'Hécyre, il faut rectifier une erreur
du tableau numérique. D'aucune façon, l'Hécyre ne peut
être considérée comme la cinquième pièce de Térence. Si
le premier essai de représentation était valable pour le classement,
elle devrait occuper la troisième place entre l'Eunuque
et l'Heautontimorumenos. Les grammairiens n'ont
pas cru devoir en tenir compte. Dès lors le sixième rang
est le seul qui convienne à l'Hécyre. En bonne règle, on n'aurait dû faire entrer en ligne que la représentation définitive,
la troisième, qui fut postérieure de quelques mois à
celle des Adelphes. Mais, mème en comptant pour bon le
second essai de représentation, on doit mettre l'Hécyre à la
fin de la liste chronologique. Ce second essai fut en effet
tenté aux jeux funèbres de Paul-Emile, où eut aussi lieu la
première des Adelphes. Or, il est certain que les Adelphes
précédèrent alors l'Hécyre sur la scène. Donner l'Hécyre, avant les Adelphes, c'eût été de la part du poète et du directeur
une insigne maladresse ; à moins de vouloir tout compromettre,il ne fallait pas exposer la pièce nouvelle aux
effets de la mauvaise humeur que pouvait provoquer la pièce ancienne, entachée du souvenir d'un premier échec. En
adoptant l'ordre inverse, Térence et Ambivius firent preuve,
non pas d'habileté, mais simplement de bon sens ; ils comprirent
que le succès des Adelphes disposerait favorablement
le public et le préparerait à bien accueillir la reprise de
l'Hécyre. Les rédacteurs du tableau numérique ont donc
ici commis une erreur ; mais on se l'explique fort bien. On
ne peut pas dire que la deuxième et la troisième représentations,
qui eurent lieu la mème année, à quelques mois
d'intervalle, se sont confondues dans leur esprit et qu'ils
ont pris pour la représentation définitive celle des jeux funèbres
de Paul-Emile: les deux reprises sont trop nettement
distinguées dans les didascalies. Mais ils ont considéré
comme valable la première reprise où la pièce fut entamée,
se fondant peut-ètre sur cette circonstance que la qualité de
comédie nouvelle, revendiquée pour l'Hécyre dans le premier
prologue, ne lui est plus attribuée dans le second. Du
moment que les deux pièces avaient été jouées pendant les
mèmes fètes, ils ne se demandèrent pas laquelle des deux
y avait eu la priorité ; le fait n'étant pas consigné dans leurs
documents, il leur parut indifférent de classer d'abord l'une
ou l'autre, ou plutôt ils crurent bon de donner la première
des deux places à l'Hécyre, parce qu'elle n'était en somme
qu'une pièce ancienne, bien antérieure aux Adelphes par
la date de sa composition.
Dans cette discussion, nous avons jusqu'ici évité à dessein
de rien demander aux prologues, parce que la plupart des
arguments qu'ils auraient pu nous fournir ne sont pas assez
positifs, dépendent trop de l'interprétation et de l'appréciation
personnelles. Mais une fois notre classement chronologique établi sur des bases solides, il nous est bien permis
de chercher dans les prologues une sorte de vérification.
Ajoutons que nous y trouverons parfois mieux que cela,
une véritable confirmation par de nouvelles preuves. Nous
avons déjà vu que le prologue de l'Andrienne se plaçait
d'une façon fort satisfaisante en tète de la série. Le prologue
de l'Eunuque, qui vint après lui, si notre système est
le vrai, ne répugne nullement à lui faire suite. Le poète
n'a pas changé de sentiments et d'attitude : il est toujours
énergique en face de son adversaire, respectueux sans bassesse
à l'égard des spectateurs. Cependant il y a entre les
deux discours une nuance sensible : le ton est plus assuré
dans celui-ci ; on y respire la confiance que le jeune auteur
a puisée dans une première victoire remportée malgré
toutes les intrigues des envieux ; la vigoureuse netteté avec
laquelle il affirme son droit de légitime défense, la hardiesse
de sa tactique qui consiste à attaquer avant de se
défendre, attestent un ferme espoir de succès fondé sur
des gages déjà reçus. S'il fallait placer ce prologue entre
celui de l'Heautontimorumenos,où l'influence du premier
échec de l'Hécyre se fait si vivement sentir, et celui du
Phormion, qui se termine par une allusion très claire à ce
même malheur, ne serait-on pas à bon droit surpris de n'y
trouver aucun indice de pareille préoccupation ? On voit
bien que Térence l'a écrit avant l'échec de l'Hécyre ; nous
sentirons désormais qu'instruit par le revers il est moins
sûr de son public. On objecte que les mots :
Tum si quis est qui dictum in se inclementius
Existimavit esse (1)
qui font allusion à la mauvaise humeur de Luscius irrité
par la conduite du jeune poète, ne peuvent bien s'entendre
que si le prologue de l'Heautontimorumenos, où Térence
prend l'offensive, a déjà été prononcé.
(1) Eun. prol. 4 sq.
Ils sont pourtant
suffisamment justifiés, ce me semble, par les termes du prologue de l'Andrienne. Cette qualification de «vieux poète
malveillant », ce reproche de faire le connaisseur et de n'y
rien connaître, cette distinction si nette et si impertinente
entre les grands poètes anciens et Luscius, n'était-ce pas
assez pour l'exaspérer? De la part d'un débutant, d'un
inconnu, cette façon de le traiter en plein théâtre n'avait-elle
pas de quoi lui paraître au suprème degré dure et irrévérencieuse
?
L'impression profonde, ineffaçable, que Térence éprouva
de son premier échec, est sensible surtout dans le prologue
de l'Heautontimorumenos, écrit plus de deux ans après
celui de l'Eunuque, quand le poète essaya de retrouver le
succès qui avait manqué à l'Hécyre. Même après ce long
intervalle de silence, il ne reparaît devant le public qu'avec
crainte et entouré d'un appareil extraordinaire de recommandations.
Il est certain qu'aucun prologue ne s'est placé
entre la représentation malheureuse et le prologue de
l'Heautontimorumenos. Il me semble également certain
que ce prologue de l'Heautontimorumenos est postérieur
à celui de l'Eunuque. Ici revient en effet le reproche de
contamination déjà mentionné par Térence le jour où parut
l'Andrienne : les ennemis du poète l'accusent d'avoir gâté
beaucoup de pièces grecques en les mélangeant pour faire
quelques pièces latines.
On sait bien que l'exagération plaît à la médisance. Cependant,
si à la date où fut joué l'Heautontimorumenos,
Térence n'avait encore employé qu'une fois, dans l'Andrienne,
ce procédé de composition, le reproche formulé
dans ces termes ne se concevrait pas ; il se conçoit, au
contraire, si on trouve avant cette date un total de quatre
comédies grecques réduites à deux par le mélange. Or,
nous verrons plus tard que l'Hécyre, n'est, pas plus que l'Heautontimorumenos,le lésultat d'une contamination. Il
faut donc placer avant l'Heautontimorumenos une autre
d'après les renseignements fournis par Térence lui-même,
remplit cette condition.
Les quatre derniers vers du prologue du Phormion
attestent qu'un succès au moins s'est produit pour Térence
depuis l'échec de l'Hécyre.
Qu'il s'agisse de la mésaventure arrivée à la troupe
d'Ambivius le jour où elle allait représenter l'Hécyre de
Térence, et non d'une autre mésaventure semblable, cela
n'est pas douteux. Il ne s'agit pas d'une autre pièce de
Térence, puisqu'elles furent toutes, sauf l'Hécyre, bien
accueillies dès leur apparition. Il ne s'agit pas d'une pièce
d'un autre poète : Térence n'aurait pas eu à faire allusion
dans son prologue à un fait qui lui eût été étranger. De
même, pour que Térence puisse parler ici des succès remportés
par la troupe depuis ce malheureux évènement, il
est nécessaire que l'un au moins de ces succès ait été obtenu
avec une de ses oeuvres. En effet, depuis lors, l'Heautontimorumenos, pièce nouvelle, a reçu bon accueil ;
l'Eunuque, représenté pour la seconde fois, a retrouvé les
applaudissements qui l'avaient salué dans sa nouveauté.
Térence ose maintenant faire une allusion directe à l'échec
dont il n'avait pas soufflé mot dans le prologue de l'Heautontimorumenos.
On a soutenu de nos jours qu'il n'est pas possible de
placer le prologue des Adelphes après ceux de l'Heautontimorumenos,
de l'Eunuque et du Phormion. Un poète, mis
en possession de la renommée et de la faveur publique par
le succès de quatre comédies, n'aurait point, dit-on, parlé
aux spectateurs sur un ton si modeste. Et à quoi se reconnaît
cette modestie de ton ? D'abord à la façon relativement
très pacifique dont Térence traite ici son rival ; il ne le
désigne point, comme dans les prologues déjà énumérés,
par une qualification individuelle ; il ne l'attaque pas après
s'ètre défendu. Cela est vrai; mais la même différence d'attitude
se remarque dans les deux prologues de l'Hécyre, que
nous mettons immédiatement après celui des Adelphes, et nous en verrons plus tard l'explication en traçant un tableau
sommaire de la polémique de Térence contre Luscius. La
modestie de notre prologue se reconnaît encore, dit-on, à
la formule par laquelle le poète appelle sur son oeuvre l'attention
et la bienveillance du public. Les formules dont
Térence a fait successivement usage pour inviter les spectateurs
à écouter ses pièces, sont de plus en plus fermes et
assurées.
Tout va si bien que prologue des Adelphes succède a
celui de l'Andrienne. Oui, tout va bien, peut-ètre même
trop bien. Nous pouvons lire aujourd'hui en une seule fois,
à la file, tous les prologues de Terence; mais n'oublions pas
qu'il ne les a pas tous écrits le même jour, avec la préoccupation
d'établir entre eux une échelle de nuances; qu'il
Ies a composés separément à la veille des représentations,et
que le ton d'un prologue a été regle, non par le ton du prologue prcédent, mais par les circonstances. Or, souvenons-nous que la premiere des Adelphes eut lieu aux mêmes
jeux que la reprise de l'Hecyre. Lorsque Terence écrivait
Ie prologue des Adelphes, il n'était pas sans inquiétude ; les
spectateurs seraient-ils cette fois plus équitables pour la
comédie qu'ils n'avaient pas d'abord daignait écouter ? Instinctivement, quoiqu'il fit effort pour cacher son anxiété,
des paroles plus humbles venaient à l'ésprit du poete; il ne
reclamait plus expressment le silence, il ne demandait que
l'impartialité qui l'encourageât à écrire. Ceux qui s'étonnent
d'entendre Térence, à la représentation de sa dernière
piece, solliciter des encouragements comme un simple débutant, ne refléchissent pas qu'alors encore il était un tout
jeune poete, écrivant pour le théatre depuis cinq ou six ans
seulement, qu'il pouvait se considérer comme presque au
début de sa carriere dramatique. Savait-il que la mort l'atteindrait
quelques mois plus tard, en pleine jeunesse ?
D 'ailleurs, il ne faut pas non plus s'exagérer la modestie
du ton de ce prologue : elle ne va pas sans une certaine
assurance. A la façon simple et calme dont Terence vient
se dénoncer soi-meme au tribunal des spectateurs,
à la brièveté nette et franche de son plaidoyer, on voit bien
qu'il s'adresse à des juges qui l'ont plus d'une fois absous
et applaudi.
Au sixième rang, après le prologue des Adelphes, se place
sans difficulté le premier prologue de l'Hécyre. Nous savons
que l'Hécyre fut reprise aux jeux funèbres de Paul-Emile
et nous avons remarqué qu'on ne peut raisonnablement
placer ce second essai de représentation qu'après le succès
des Adelphes. Le dernier vers du prologue vient à l'appui
de cette opinion,
Térence n'aurait pu parler de la sorte si à ce moment les Adelphes, achevés, appris par la troupe, destinés aux mêmes
jeux, avaient été encore inconnus des spectateurs. Enfin, le
second prologue de l'Hécyre termine, sans contestation, la
série ; il relate en effet et le premier échec et le second qui
se produisit aux jeux funèbres de Paul-Emile après la représentation
des Adelphes. D'ailleurs, il est le plus parfait
de tous au point de vue littéraire, le modèle du genre créé
par Térence, le chef-d'oeuvre oratoire du poète. Par sa perfection
seule, il se révèlerait comme le dernier en date des
prologues de Térence. Ainsi, les prologues s'accommodent
fort bien de notre système chronologique ; loin de le contrarier,
ils le servent à merveille et le confirment.
Voici, tel qu'il résulte de cette discussion, le classement
chronologique des comédies de Térence :
1. Andria, 588.
II. Eunuchus, 588.
III. Heautontimorumenos, 591.
IV. Phormio, 593.
V. Adelphoe, 594.
VI. Hecyra, 594.
Voici, d'autre part, le tableau des représentations données
ou essayées du vivant de Térence, d'après tous nos documents
:
I. Andrienne, 588, aux jeux mégalésiens.
II. Eunuque, 588, probablement aux jeux romains (1).
(1) Peut-être les mots « acta ludis romanis », dans la didascalie du Bembinus, sont-ils un reste de la notice consacrée par la didasc. primitive à cette première représentation. Mais peut-être aussi faut-il n'y voir qu'une trace de reprise posthume. C'est à une reprise posthume que se rapportent, en effet, les deux noms de directeurs dans les didasc. des deux familles et celui du troisième consul dans les mss. de Calliopius.
III. Hécyre, 589, aux jeux mégalésiens.
IV. Heautontimorumenos, 591, aux jeux mégalésiens.
V. Eunuque, 593, aux jeux mégalésiens. Deuxième représentation,
celle à laquelle se rapportent la plupart des détails nominaux fournis par les didascalies et la préface
de Donat.
VI. Phormion, 593, aux jeux romains. La didascalie du
Bembinus indique les jeux mégalésiens; mais elle se rapporte
tout entière à une reprise posthume. Donat nomme
aussi les jeux mégalésiens ; selon toute vraisemblance, ce
mot a été écrit par erreur, sous l'influence de l'habitude,
les jeux romains étant beaucoup plus rarement mentionnés
que les jeux mégalésiens. Il est préférable de s'en tenir à
la leçon des mss. de Calliopius ; pour les jeux mégalésiens
de cette année-là, nous avons déjà une pièce de Térence,
l'Eunuque. Cependant il se peut, à la rigueur, que
les deux comédies aient été données à la même fête, comme
plus tard l'Hécyre et les Adelphes.
VII. Adelphes, 594, aux jeux funèbres de Paul-Emile.
VIII. Hécyre, deuxième essai de représentation, aux
mèmes jeux, après les Adelphes.
IX. Hécyre, représentation définitive, sans doute aux
jeux romains de 594. L'indication « ludis romanis »,
fournie par quelques 015S. de Calliopius, se rapporte peut-être
à cette reprise.
De ce tableau et des considérations présentées dans le
paragraphe précédent, se déduit l'ordre chronologique des
prologues :
I. Prologue de l'Andrienne.
II. — de l'Eunuque.
III. — de l'Heautontimorumenos.
IV. — du Phormion.
V. — des Adelphes.
VI. Premier prologue de l'Hécyre.
VII. Deuxième prologue de l'Hécyre.

V
Cette liste contient-elle tous les prologues de Térence ?
N'en avait-il pas écrit d'autres, perdus aujourd'hui ? L'un
quelconque des prologues de Térence, disions-nous plus
haut, n'a pu servir que pour une représentation. Or, du
vivant de l'auteur, l'Eunuque a été repris, l'Hécyre a été
portée trois fois sur la scène, et nous ne possédons de prologue
ni pour la première représentation de l'Hécyre, ni
pour la reprise de l"Eunuque. Devons-nous croire que
Térence a donné sans prologue une pièce nouvelle, qu'il
n'en a pas écrit pour une pièce ancienne qui, après un
brillant succès, avait l'honneur exceptionnel de revenir devant
le public ? Une remarque importante qu'il faut faire
tout d'abord et qui s'applique aux deux cas, c'est que les
prologues de Térence n'étant pas nécessaires à la pièce
comme ceux des Grecs, qui en constituaient l'exposition,
ne lui étant mème pas utiles, comme ceux de Plaute, qui
renfermaient un sommaire de l'action destiné à éclairer le
spectateur, n'étant utiles qu'au poète, si un jour Térence
n'eut rien de particulier à dire au public, s'il jugea superflu
de défendre et de recommander une de ses pièces avant la
représentation, il est au moins possible qu'alors il se soit
épargné la peine de composer un prologue. Cela est mème
probable, car au début de celui de l'Andrienne. il a parlé
des prologues à écrire comme d'une tâche ingrate, à laquelle
il ne s'est résigné que par force.
En ce qui concerne la première représentation de l'Hécyre,
la didascalie du Bembinus indique qu'elle ne fut pas précédée
d'un prologue : « Acta primo sine prologo. » Mais
l'autorité de ce témoignage a été contestée. On a dit qu'un
détail de cette nature était déplacé dans une didascalie et n'entrait pas dans la série des indications qu'on y trouve
normalement. Le Stichus de Plaute n'a point de prologue,
et pourtant la didascalie ne mentionne pas cette particularité.
De plus, dans notre exemplaire le détail en question
est fort singulièrement placé entre le numéro d'ordre de la
pièce et les noms des consuls de la première représentation.
Enfin, il occupe la sixième ligne, en compagnie des
mots «datasecundo», que l'on soupçonne de n'ètre qu'une
glose des mots « relata est » de la septième ligne, avec
lesquels ils font double emploi. Pour tous ces motifs on
nie l'authenticité du renseignement : il ne faisait point
partie de la rédaction primitive ; il a été inséré plus tard
par un grammairien qui, ne trouvant que deux prologues
en tète de 1'Hécyre et ne songeant pas que celui de la
première représentation avait pu se perdre, s'imagina qu'elle
n'en avait pas eu et crut devoir le constater. Mais l'interpolation
est loin d'ètre démontrée par ces raisons. D'abord
il n'est pas juste d'assimiler la didascalie de l'Hécyre aux
didascalies normales et de n'y vouloir trouver que le contenu
d'une didascalie normale. L'Hécyre n'eut pas un sort ordinaire
: il est naturel que la didascalie ait gardé la trace des
vicissitudes éprouvées par la pièce. Elle donne des détails
sur trois représentations, tandis que les autres didascalies
ne visent que la première, parce que, seule d'entre les
comédies de Térence, l'Hécyre eut le malheur de ne pouvoir
ètre réellement jouée qu'à la troisième fois. S'il est
vrai qu'au premier essai de représentation l'Hécyre fut
donnée sans prologue, pourquoi la didascalie n'aurait-elle
pas constaté ce fait également exceptionnel dans le théâtre
de Térence ? L'exemple du Stichus ne prouve pas grand
chose. D'abord la première représentation de cette pièce ne
fut sans doute signalée par aucun incident notable, de nature
à attirer spécialement sur elle l'attention du rédacteur
de la didascalie ; ensuite l'absence du prologue n'est pas
dans le théâtre de Plaute un fait exceptionnel et digne de
remarque, comme dans celui de Térence. Le cas de la didascalie de l'Hécyre signalant une particularité de l'histoire
de la pièce est-il unique? Non. Une autre comédie de
Térence, l'Eunuque, eut un sort peu ordinaire : vendue
deux fois comme pièce nouvelle, elle rapporta au poète une
somme très considérablepour l'époque ; et l'auteur de la Vie
de Térence nous apprend que, pour cette raison, le chiffre
de cette somme était inscrit de son temps dans la didascalie
: « Propterea summa quoque titulo ascribitur ». Les
exemplaires de Térence que Suétone eut sous les yeux
donnaient la didascalie de l'Eunuque avec un détail supplémentaire
qui manque dans les nôtres : le cas de la didascalie
de l'Hécyre dans le Bembinus est analogue. Quant à
la place occupée parles mots : « Acta primo sine prologo »,
elle ne leur convient pas, cela est vrai. Mais pourquoi ne
pas admettre ici une simple transposition? C'est par une
erreur semblable que, dans la didascalie de l'Eunuque
(Bembinus), la septième ligne (nom du compositeur) a été
placée entre le numéro d'ordre et les noms des consuls,
alors qu'elle devrait précéder la cinquième ligne (indication
du genre de musique). De même, nous devons reporter
dans la didascalie de l'Hécyre la sixième ligne après la
septième. Pour que le sens soit tout à fait satisfaisant,
nous n'aurons plus qu'à biffer dans notre nouvelle septième
ligne le mot « data », et nous écrirons :
facta est V, 5
Cn. Octavio, T. Manlio cos.
Acta primo sine prologo, secundo
Relata est
................,............. Tertio relata est 1 10
De cette façon les adverbes « primo, secundo, tertio »
se suivent fort bien. On s'explique, d'ailleurs, sans peine
l'interpolation du mot « data » : après la transposition,
« secundo », isolé au bout de la sixième ligne, n'offrant
plus de sens, un copiste le fil précéder de « data », et crut avoir réparé tout le mal. Ajoutons enfin que le témoignage
de la didascalie du Bembinus est confirmé par celui
de Donat, qui fait cette remarque au premier vers du premier
prologue : « Haec primo data est sine prologo ». L'opinion
que l'Hécyre fut donnée d'abord sans prologue nous a donc
été transmise par deux sources distinctes et très anciennes.
Si rien ne nous empêche de tenir pour authentique le
passage rectifié de la didascalie, conforme à la remarque de
Donat, d'un autre côté le fait lui-mème de l'absence du
prologue n'est pas du tout invraisemblable, quoi qu'on ait
prétendu. Quelle apparence, a-t-on dit, que le poète qui
adopta l'usage du prologue dès sa première pièce, qui le
conserva jusqu'au bout, mème pour la meilleure de ses
oeuvres, l'Eunuque, ait négligé le secours de cet auxiliaire
habituel le jour où il en avait besoin plus que jamais, le
jour où il présentait au public la plus faible de ses comédies?
La plus faible au jugement de quelques-uns d'entre
nous, modernes : mais savons-nous si l'auteur la jugeait
inférieure aux autres, si ses adversaires y trouvèrent rien
de particulier à reprendre ? Quand je considère, d'une part,
l'insistance avec laquelle Térence poursuivit le succès qui
lui échappait pour l'Hécyre, d'autre part, le caractère même
de la pièce, drame intime qui vaut et plaît par la finesse
de l'observation et l'élégance du style, par les qualités maîtresses
du talent de notre poète, je ne suis pas éloigné de
croire que c'était son oeuvre de prédilection. Mais supposons
seulement qu'il ne la trouvât ni inférieure ni supérieure à
ses aînées, l'Andrienne et l'Eunuque. Même ainsi nous
nous expliquons que Térence n'ait pas écrit de prologue
pour l'Hécyre dans sa nouveauté. Il ne se décida que contre
son gré, nous l'avons déjà répété, à écrire des prologues. Il en écrivit un pour l'Andrienne et un pour l'Eunuque,
afin de repousser les attaques dirigées contre ces pièces.
Malgré les intrigues de ses adversaires, l'Andrienne et l'Eunuque, l'Eunuque surtout, réussirent brillamment. Alors
il dut se dire que désormais il n'avait plus besoin de recommder ses oeuvres à un public qui, sans tenir compte des
bruits malveillants, leur faisait un accueil si encourageant.
De leur côté, Luscius et sa coterie, voyant que les accusations ne causaient aucun préjudice au jeune poète, se lassèrent
de semer ce mauvais grain qui ne levait jamais ; si
bien que l'Hécyre, dans sa nouveauté, eut peut-être le bonheur
unique de ne pas ètre dénigrée. Dans tous les cas et
si l inutilité de ses précédents efforts ne découragea pas complètement Luscius, Térence, fort de ses premiers succès,
dédaigna cette fois de riposter. Que l'Hécyre eût alors
réussi, l'Heautontimoruimenos et les pièces suivantes n'auraient
pas eu non plus de prologue. Mais 1'Hécyre échoua.
La confiance et les illusions du poète s'évanouirent pour toujours
l'audace revint à ses adversaires quand ils virent
qu'il n'était pas plus qu'un autre à l'abri des retours de
fortune. Désormais ils luttèrent infatigablement, et Térence
ne négligea plus aucune précaution pour se garantir soit de
leurs attaques, soit des caprices du public. Quant à l'Hécyire,
il est à peu près sûr, non seulement que les rédacteurs de
la didascalie primitive ne lui connurent que deux prologues,
mais encore que le prologue de la première représentation
n'a jamais existé.
Nous pouvons affirmer aussi que la reprise de I' Eunuque
eut lieu sans prologue. La malignité avait épuisé tous ses traits avant la première représentation, et ils étaient venus
piteusement se briser contre l'enthousiasme du public. Quand
la pièce, bonheur exceptionnel, fut revendue comme nouvelle,
les ennemis de Térence n'eurent qu'à dévorer silencieusement
leur rage jalouse. S'ils tentèrent une lutte inutile,
Térence n eut pas à se défendre. A quoi bon dès lors
composer un prologue ? Pour constater avec une orgueilleuse satisfaction le succès éclatant de la pièce ? Cette attitude,
contraire à la modestie caractéristique du prologue,
eût été déplacée et nuisible. L'occasion était belle, unique
de se soustraire à une besogne ennuyeuse : Térence en
profita. Selon toute vraisemblance aucune autre pièce de
Térence n'a été jouée deux fois de son vivant et il n'a
écrit que les sept prologues parvenus jusqu'à nous.
LE RÔLE, LE PERSONNAGE ET L'ACTEUR DU PROLOGUE DANS TÉRENCE
Pourquoi Térence écrivit-il des prologues? Quelles furent
la raison d'ètre et l'importance de ces discours adressés de
la scène au public avant la représentation de chaque comédie?
Le moment est venu de traiter à fond cette question
à laquelle, dans le chapitre précédent, nous avons été forcé
de toucher plus d'une fois par avance. Il en est deux
autres qui s'y rattachent et dont nous avons dû également
dire déjà quelques mots, sans les approfondir. L'acteur qui
récitait les prologues de Térence quittait-il son individualité
réelle pour entrer dans une fiction; devenait-il, comme les
autres acteurs, ceux de la pièce proprement dite, un personnage
dramatique ; avait-il en cette qualité des attributs
extérieurs qui lui fussent propres, un costume? Comment
choisissait-on,parmi les sujets de la troupe, celui à qui l'on
confiait ce rôle et quelles raisons pouvait-il y avoir de ne
pas le donner à tel ou tel des histrions indifféremment ?
Toutes ces questions une fois résolues, nous aurons une vue
nette des rapports du prologue avec le drame dans le théâtre
de Térence.
Mais le prologue n'est pas une invention de Térence. Si
notre poète, dans l'emploi qu'il en a fait, s'est écarté de
l'usage traditionnel et a montré une grande originalité, le
prologue avait avant lui une très longue existence et une
histoire très curieuse. Et si l'on ne connaît pas cette histoire,
au moins dans ses grandes lignes, il est bien évident que l'on ne peut apercevoir et apprécier les innovations de
Térence. Un tableau rapide des transformations du prologue
depuis ses origines jusqu'aux prédécesseurs immédiats de
Térence ne sera donc pas ici une digression, mais une introduction
indispensable.
1
Au chapitre XII de la Poétique, dans lequel il énumère
les divisions de la tragédie quant à l'étendue, Aristote définit
ainsi le prologue : « le prologue est toute une partie de la
tragédie, celle qui précède le chant d'entrée du choeur ».
Cette définition indique nettement la position et les limites
du prologue. Dans un autre passage, au chapitre XIV du
livre III de la Rhétorique, le mème Aristote s'explique incidemment,
mais en termes aussi clairs, sur le rôle et le
contenu du prologue. Il y compare l'exorde au prologue et
au prélude, qui, comme l'exorde, sont des débuts et préparent,
pour ainsi dire, les voies à ce qui va suivre. Mais le
prélude ressemble à l'exorde du genre démonstratif, dont le
contenu n'est pas nécessairement déterminé par le sujet du
discours et dépend du choix de l'orateur ; le prologue ressemble
à l'exorde du genre judiciaire : ils doivent indiquer
le sujet que le poète ou l'orateur va traiter et faciliter à
l'auditeur l'intelligence du drame ou du discours. Et ce
qu'Aristote dit ici du prologue s'applique aussi bien à la
comédie qu'à la tragédie. On le voit par ces deux citations le prologue, tel qu'il l'entend, n'est pas autre chose que
l'exposition.
Un drame, quelque simple qu'on le suppose, ne peut se
passer d'exposition. L'action du drame est une et complète,
mais elle n'est pas indépendante de tout événement antérieur.
Les personnages que le poète met en scène ont un
nom, une histoire, un caractère; des faits précédemment
accomplis expliquent leur présence en un lieu donné, à un
moment donné, dans telle situation matérielle et morale.
Pour que le spectateur comprenne le drame et s'y intéresse,
il faut que dès le début on le renseigne sur ces divers
points. C'est là le rôle de l'exposition, aussi ancienne que
le drame, car elle est essentielle au drame. L'existence du
prologue tragique date donc da jour où le dithyrambe se
transforma en tragédie proprement dite, où un individu
détaché du choeur « se présenta sur la scène avec le nom
et le masque d'un personnage étranger, et entretint son
auditoire d'un événement imaginaire, comme s'il se fût agi
d'un événement réel » ; du jour, en un mot, où fut créée
la fiction dramatique. Or l'honneur de cette innovation capitale
revient, selon toute probabilité, à Thespis (1) ; Thespis
fut donc le premier poète qui écrivit des prologues tragiques.
(1) Cf. Plutarque Vie de Solon, 29; Diog. Laert, I, 59.
C'était l'opinion exprimée par Aristote dans un
passage perdu pour nous de la Poétique, et le rhéteur
Thémistius nous la fait connaître en déclarant ne s'y point
rallier.
Plus le drame est simple, plus l'exposition est.facile et
courte. Or, si la tragédie d'Eschyle, qui vint après Thespis
et Phrynichos, et disposa de deux acteurs au moins, tandis
que ses devanciers n'en eurent qu'un seul, est si peu compliquée
qu' « il n'y a pas proprement d'action », si elle
n'est guère « qu'une sorte de cantate dont l'introduction de ses rares personnages renouvelle de temps en temps le
motif épuisé » , quelle devait être la simplicité de la tragédie
de Thespis ! Quelques vers suffisaient assurément à
l'exposition. Mais qui les prononçait de l'acteur ou du
choeur? Le prologue de Thespis n'était-il que le début de
la parodos, une courte narration précédant le développement
lyrique? C'est la forme la plus rudimentaire que
l'on puisse imaginer, et nous la trouvons dans deux tragédies
d'Eschyle : les Perses et les Suppliantes. Pourtant
il me semble que le texte de Thémistius doit plutôt nous
faire songer à un discours de l'acteur. Avant Thespis, le
choeur entrait et entonnait un hymne en l'honneur des
dieux : c'était là toute la tragédie. Thespis, avec ses innovations,
en fit un composé de parties chantées et de parties
parlées : l'acteur parut d'abord et prononça un discours, le
prologue ; puis le choeur s'avançant se mit à chanter ;
mais de loin en loin il s'interrompit et, à chaque pause,
l'acteur s'entretint avec lui. Au surplus, il est très vraisemblable
que Thespis n'arriva pas du premier coup à constituer
cet ensemble relativement complexe. Il eut d'abord, on eut
peut-être avant lui, l'idée des intermèdes parlés : ce furent
des récits en rapport avec le sujet du dithyrambe ; le coryphée
en était chargé. Puis ce narrateur fut transformé en
personnage dramatique. Le coryphée ne pouvait entrer en
scène qu'avec le choeur dont il était tout simplement le chef :
le personnage, ayant son individualité bien distincte, ne fut
pas soumis à la mème loi. Mais le poète songea-t-il dès le
premier jour à le faire paraître et parler avant l'entrée du
choeur? Non, cette pensée ne dut pas lui venir alors à
l'esprit. Ses plus anciens drames, comme les dithyrambes
dont ils prirent la place, débutèrent par un morceau lyrique
dans lequel se trouvaient éparses quelques indications narratives.
Puis ces indications narratives ayant été réunies
à part formèrent le premier discours de l'acteur. Ainsi le prologue se détacha de la parodos. Il va sans dire que ces
expositions de Thespis ne furent pas d'un art achevé, qu'il
n'y respecta point la vraisemblance dramatique dont il n'avait
pas sans doute un sentiment bien net, que son acteur, sans
interpeller directement les spectateurs, ne s'adressa le plus
souvent qu'à eux, et d'une façon manifeste. C'est là un défaut
dont l'enfance de l'art dramatique ne pouvait guère être
exempte et qui se montre encore fréquemment dans les
prologues d'Eschyle. Rien n'est moins facile, en effet, pour
un dramaturge, même s'il a les ressources et l'expérience
qui manquèrent à Thespis, que de faire une exposition de
tout point naturelle et vraisemblable, que de mettre le public
au courant sans avoir l'air de se douter qu'il existe.
Les successeurs immédiats deThespis,qui n'eurent, comme
lui, qu'un seul acteur, ne purent apporter de perfectionnement
considérable à l'art de l'exposition. D'ailleurs, s'ils
ont réalisé quelques innovations, Eschyle en a hérité, et nous
allons voir que pour nous elles ne se distinguent plus bien
des siennes. Nous ne pouvons donc évaluer ni la somme
de ces progrès, ni la part d'originalité de chaque poète. Il
y a dans le théâtre d'Eschyle, tel que nous le possédons,
quatre variétés de prologue. Dans les Perses et les Suppliantes
le prologue est fondu avec la parodos; c'était là,
disions-nous tout à l'heure, la forme d'exposition la plus
élémentaire, celle qui précéda l'invention du prologue proprement
dit. Dans l'Agamemnon et les Choéphores, le prologue
est un discours récité par l'un des acteurs. Mais il y
a entre ces deux prologues une différence qu'il vaut la peine
de noter : le veilleur de nuit qui prononce le premier est
absolument seul, tandis que dans le second, à côté d'Oreste,
se tient Pylade, personnage muet, auquel s'adresse à un
moment donné le discours. L'Agamemnoa est la seule tragédie
d'Eschyle où se trouve exactement reproduit le type
des prologues de Thespis. Phrynichos s'en écarta sans doute
beaucoup plus rarement ; mais tout ce que nous pouvons dire de certain, quant aux expositions de ce vieux poète,
c'est que dans sa tragédie des Phéniciennes, qui se place
chronologiquement entre la bataille de Salamine et les
Perses d'Eschyle, il avait fait paraître d'abord un eunuque,
qui, tout en rangeant des sièges pour le Conseil de Perse,
racontait dans un monologue la défaite de Xerxès (1).
(1) Cf. l'argument grec des Perses.
Un prologue
comme celui des Choéphores marquait évidemment un
progrès. On est d'abord tenté de faire hommage de cette
innovation au génie d'Eschyle ; car c'est Eschyle qui a inventé
le deuxième acteur. Seulement il faut avouer que,
mème à l'époque où il n'en existait qu'un, on a pu s'aviser
d'introduire deux personnages à la fois, dont un simple figurant
qui se bornerait à écouter l'acteur. Le prologue des
Sept contre Thèbes révèle d'une façon plus certaine l'originalité
d'Eschyle. Il se compose de trois discours : le premier
contient les recommandations d'Etéocle au peuple de
Thèbes, le second est un rapport du messager à Etéocle, le
troisième une prière d'Etéocle aux dieux protecteurs de la
ville. Ce n'était pas encore là le dialogue dans l'exposition,
mais, pour arriver à cette forme plus parfaite, il ne restait
plus qu'un pas à faire. Eschyle fut-il le premier à le faire?
C'est possible, puisqu'il disposa de deux acteurs, c'est mème
assez vraisemblable. Mais une affirmation catégorique serait
ici téméraire ; les prologues du Prométhée enchaîné et des
Euménides, qui comprennentun monologue et un dialogue,
exigent la présence de trois acteurs ; ils sont donc postérieurs
aux débuts de Sophocle.
Quoi qu'il en soit, grâce au dialogue, l'art de l'exposition
faisait un progrès décisif. Il est vrai que, même avec la
seule ressource du monologue, on pouvait faire une exposition
irréprochable au point de vue de l'illusion dramatique.
Il y a en effet deux espèces de monologue, qu'il importe de
bien distinguer : le monologue narratif, où l'intention d'instruire
le spectateur n'est pas dissimulée avec assez d'art ; et le monologue dramatique, où cette préoccupation ne se
montre nulle part, soit que l'acteur se livre à une méditation (1)
suffisamment motivée par sa situation, soit qu'il
adresse au choeur ou à d'autres personnages un discours tel
que ceux-ci puissent vraisemblablement l'écouter.
(1) Dans la tragédie grecque, ces méditations se présentent d'ordinaire sous la forme d'une invocation à quelque divinité.
Mais un
monologue tout à fait naturel est chose rare ; par exemple,
ceux du veilleur de nuit dans l'Agamemnon et de la Pythie
dans les Euménides sont trop visiblement destinés au spectateur.
Dès que l'invention du second acteur permit de
substituer le dialogue au monologue, jusqu'alors obligatoire,
l'exposition devint plus facile. Désormais le sujet de
la pièce pourrait s'expliquer par une conversation naturelle
entre les personnages; l'acteur, ayant en face de lui un autre
acteur pour lui donner la réplique, n'aurait pas à se tourner
vers le public et l'instruirait sans paraître lui adresser un
mot. Elle y gagna aussi en mouvement et en variété ; elle
fut plus animée et plus vivante. Le dialogue était la forme
vraie et définitive de l'exposition.
Tous les prologues d'Eschyle sont d'un effet dramatique
saisissant; mais dans trois seulement sur sept,l'illusion est
d'un bout à l'autre habilement ménagée. Ces trois prologues,
où rien n'est contraire à la nature et aux exigences du
drame, sont ceux des Choéphores, des Sept contre Thèbes
et du Prométhée enchaîné. Celui-ci surtout réunit si heureusement
tous les mérites, que l'on peut le tenir pour un
chef-d'oeuvre d'exposition et le comparer sans désavantage
avec ce que Sophocle a produit de plus parfait dans ce
genre. Mais, pour Sophocle, la perfection où Eschyle n'est
arrivé qu'une fois, à notre connaissance du moins, fut l'ordinaire
et la règle. La supériorité du dialogue comme
moyen d'exposition lui paraissant incontestable, il s'en
servit dans les prologues de toutes ses pièces. Les monologues y sont rares, toujours précédés ou suivis d'un dialogue,
provoqués et motivés par la situation, dramatiques et non narratifs. Il faut cependant faire exception pour celui
de Déjanire au début des Trachiniennes ; il est vrai que ce
long discours est écouté par une servante, qui répond ensuite
à sa maîtresse ; mais il est trop visible que les confidences
du personnage sont à l'adresse du public. Pour les
sept tragédies que nous avons de lui, c'est la seule infraction
aux lois de la vraisemblance dramatique commise par Sophocle
dans le prologue. Toutes ses autres expositions sont
des modèles de naturel et d'aisance. Et ce n'est pas là leur
seul mérite. Aussi saisissantes que celles d'Eschyle, aussi
propres à éveiller l'attention et l'intérèt du spectateur, elles
sont plus variées et plus vivantes. Elles présentent, en un
mot, un tel ensemble de qualités diverses, que l'on chercherait
vainement dans tous les théâtres du monde une
exposition qui les surpasse, qu'il est même impossible de
concevoir un idéal plus accompli. Sophocle, dans cette
partie du drame, n'inventa peut-ètre rien d'essentiel; mais
il se servit, avec son habileté d'incomparable artiste, des
ressources créées par le génie d'Eschyle. Après lui, le prologue
ne pouvait recevoir de perfectionnement. Quiconque,
au lieu de suivre un tel maître, chercherait une voie nouvelle,
s'égarerait et ferait rétrograder l'art dramatique.
Ce fut là le tort d'Euripide. Ce qui nous frappe tout
d'abord dans ses prologues, ce qui les caractérise extérieurement,
c'est la présence constante en tète de ses tragédies
d'un monologue narratif. Dans ce récit préliminaire, un
personnage de la pièce ou une divinité qui s'intéresse à
l'action explique, avec force détails et en reprenant les
choses de très haut, quelle est la situation au moment où
commence la pièce. Puis, ou bien le choeur fait son entrée,
ou bien l'exposition se continue, soit par un dialogue, soit
par un monologue dramatique. On le voit, rien ne ressemble moins aux prologues de Sophocle que ceux d'Euripide ; il
se séparait complètement ici de son illustre contemporain.
Mais s'il se décida à ne point pratiquer un système dont les
mérites, dont la supériorité dramatique et littéraire ne pouvaient
lui échapper, ce ne fut point pour obéir à un caprice,
au désir de faire autrement que son rival ; il eut de bien
meilleures raisons. Quand on considère cette innovation
isolément, elle paraît inexplicable; pour s'en rendre compte,
il faut la rattacher à des innovations autrement importantes
du mème poète. Euripide, réformateur hardi, eut sa manière
originale de concevoir le drame. Il se proposa de
représenter sur la scène des situations extrèmes et des passions
dans toute leur violence, et cela dès le début de la
pièce. Il fut donc obligé de résumer, aussi vite que possible,
les motifs de la crise à la peinture de laquelle il voulait
consacrer toute la tragédie. La recherche immodérée de
la variété, de l'effet, des coups de théâtre, qui est aussi un
trait distinctif de ce génie où ne règne pas entre les facultés
dramatiques l'harmonieux équilibre que révèlent les oeuvres
de Sophocle, amena forcément Euripide à charger l'intrigue,
au détriment de la simplicité et de la clarté, d'incidents extraordinaires, imprévus, insuffisamment motivés.
D'un autre côté, sous l'influence de ses idées philosophiques,
il lui arriva de modifier à sa guise, de bouleverser de fond
en comble les mythes qui lui fournissaient des sujets et des
personnages. Ces complications et ces changements n'auraient
peut-ètre pas dérouté l'intelligence subtile du spectateur
athénien ; mais il était toujours plus sûr de l'éclairer
d'abord et de le préparer par un récit détaillé à comprendre
sans effort la pièce qu'il allait voir. Voilà quelles furent,
au jugement des critiques, les principales raisons qui engagèrent
Euripide à ouvrir tous ses drames par un monologue
narratif. Je me contente de les énumérer ici, sans
entrer dans une discussion qui ne serait pas de mon sujet.
Qu'il me suffise de dire qu'à mon avis elles ont toutes eu
leur part d'influence, mais qu'elles n'ont pas toujours agi simultanément ni avec une force égale, que pour telle pièce
l'une d'elles a pu avoir plus de poids que les autres ou
mème entraîner à elle seule l'esprit du poète. Il convient
aussi d'ajouter que l'habitude dut bientôt peser sur la décision
d'Euripide presque autant que la réflexion. Le procédé
était si commode, il simplifiait si bien la tâche difficile
de l'exposition, qu'il aurait fallu pour l'abandonner, après
s'en ètre plusieurs fois servi, un effort de volonté que ne fit
jamais Euripide.
Ces monologues narratifs, dont la froideur et la monotonie
se dissimulent mal sous des ornements de style répandus
à profusion, sont loin d'ètre irréprochables au point
de vue littéraire. Mais c'est surtout au point de vue dramatique,
qu'ils méritent d'ètre jugés sévèrement. Comparés à
ceux de Sophocle, les prologues d'Euripide, avec ces longs
récits qui choquent la vraisemblance et détruisent l'illusion,
marquent un recul . Ils nous ramènent à l'enfance de l'art
dramatique. La faute que Thespis avait faite naïvement,
n'ayant de l'essence du drame qu'une idée encore confuse
et ne disposant que d'un seul acteur, Euripide, à qui ne
manquèrent ni les exemples ni les moyens matériels, la
commit en toute connaissance de cause.
Pour nous, qui ne perdons pas de vue que cet aperçu
historique doit nous conduire jusqu'à Térence à travers les
transformations du prologue, un fait surtout est ici important
et doit attirer notre attention : l'isolement du monologue
narratif en tète des drames d'Euripide. Cet isolement
n'est pas le mème partout. Souvent un second acteur rejoint
sur la scène celui qui vient de prononcer le monologue,
avec lequel se trouve ainsi liée la conversation qui s'engage
entre eux et complète le prologue (les Héraclides, Alceste,
Médée, Andromaque, Hercule Furieux, les Troyennes,
Hélène, Electre, Oreste). C'est dans ce cas que le caractère
dont nous parlons est le moins sensible. Dans d'autres
pièces, l'acteur qui a récité le monologue se retire aussitôt ;
il est remplacé par un ou deux autres acteurs ; en sorte que ce que disent les nouveaux venus, monologue ou dialogue,
ne tient pas à ce qui précède leur entrée (Hippolyte,
Hécube, Ion, Iphigénie en Tauride, les Phéniciennes). Ici
l'indépendance du monologue narratif est bien plus apparente.
Mais où elle est plus complète encore, c'est dans les
drames dont le prologue ne contient pas autre chose que
ce monologue narratif immédiatement suivi de la parodos (les Suppliantes, les Bacchantes, le Cyclope), Voilà donc,
à ne considérer que le rapport extérieur de la partie narrative du prologue avec la partie dramatique, trois degrés
d'isolement : ou bien la partie narrative, sans faire corps
avec le drame, y est comme soudée par une de ses extrémités
; ou bien, cette soudure elle-mème venant à manquer,
les deux parties sont simplement juxtaposées ; ou bien
il n'y a pas de partie dramatique, et alors c'est le prologue
tout entier qui, par la forme, se trouve séparé du drame.
N ayons égard maintenant qu'au personnage du monologue.
Selon que ce personnage revient plus tard sur la scène ou
n'a pas de rôle au-delà du prologue, un lien existe ou
manque entre le récit préliminaire et le reste du drame : les
divinités qu'Euripide introduit au début d'Alceste, d'Hippolyte,
d Hécube d'Ion, des Troyennes, quoique s'intéressant
aux évènements de la pièce, n'y sont pas activement
et visiblement mêlées. Pour Alceste et les Troyennes,
il faut même faire une remarque de plus : ici le monologue
entraîne dans son isolement la partie dramatique du prologue,
qui est une conversation entre le personnage du monologue
et un autre personnage étranger, lui aussi, à l'action
proprement dite. Enfin, par le contenu, les monologues
narratifs de l'Hippolyte, de l'Hécube, de l'Ion et les prologues
tout entiers de l'Alceste et des Troyennes se placent
tout à fait en dehors du drame : le récit y dépassant la
limite des faits déjà accomplis et empiétant sur l'avenir, ils
ne peuvent pas être considérés comme partie intégrante de
l'action dramatique. Ils ne sont autre chose qu'une introduction distincte de la pièce elle-même. Ainsi, tandis que,
dans Sophocle, l'exposition par la forme, les acteurs et le
contenu est étroitement unie au drame,.les monologues narratifs,
par lesquels Euripide commence toutes ses pièces,
sont tous plus ou moins isolés et indépendants. Hàtons-nous
pourtant d'ajouter que ceux-là mêmes où ce caractère
est le plus frappant tiennent encore par plus d'un lien à
l'ensemble du drame. D'abord, en effet, le contenu de ces
discours, qui servent à l'exposition, est déterminé par le
sujet de la pièce. Ensuite l'acteur qui les prononce entre
dans la fiction, a son individualité dramatique, et, s'il ne se
mêle pas sur la scène aux autres personnages, s'intéresse
du moins à leurs actions : ces liens, qu'Euripide a respectés,
nous les verrons se rompre successivement et l'indépendance,
qui est ici limitée, deviendra alors absolue.
La manière d'Euripide fit école et exerça une influence
décisive sur l'évolution du prologue. Mais avant de parler
des poètes plus jeunes que lui, qui l'acceptèrent pour guide
et pour modèle, il faut dire quelques mots d'un de ses contemporains
qui ne l'aima guère et se garda bien de l'imiter.
Si les prologues d'Aristophane ne sont pas sans défauts,
du moins ils ne ressemblent pas à ceux d'Euripide ; surtout
on ne saurait leur reprocher l'ennuyeuse uniformité dont
le poète comique a fait, dans les Grenouilles ', une impitoyable
satire. Ils sont loin, en effet, d'ètre tous coulés dans le
même moule. D'abord il en est plusieurs qui méritent d'ètre
placés sur le mème rang que les meilleures expositions de
Sophocle, comme réalisant dans le genre comique la perfection
à laquelle s'était élevé et maintenu dans le genre tragique
l'auteur d'OEdipe Roi et d'OEdipe à Colone. Quoi de
plus naturel et à la fois de plus vivant que les prologues de
Lysistrata, des Thesmophoriazuses,des Grenouilles ? A ces
trois expositions un scrupule nous empêche d'ajouter celles
des Acharnions, de l'Assemblée des Femmes et du Plutus :
elles débutent par un monologue. Mais remarquons que ces monologues sont liés au dialogue qui les suit et dont le
personnage qui a d'abord parlé seul est un des interlocuteurs.
Remarquons aussi qu'ils ne sont pas purement narratifs.
Je mets à part le discours de Praxagora à sa lampe ;
ce discours n'est qu'une parodie. Quant au monologue de
Dicéopolis, il est destiné à faire ressortir l'isolement de
l'Acharnien dans le parti de la paix ; celui de l'esclave Carion
est motivé par l'obstination de son maître Chrémyle à
suivre, pour obéir à l'oracle, cet aveugle que l'on ne connaît
pas et qui n'est autre que Plutus. La pensée ne peut venir
à personne d'assimiler de tels monologues aux récits préliminaires
d'Euripide.
D 'ailleurs, aucun des six prologues déjà mentionnés ne
nous a révélé un procédé nouveau, quelque chose que nous
ne connussions point par les tragiques. C'est dans ceux dont
il nous reste à parler qu'il faut chercher l'originalité d'Aristophane,
ou, pour ètre plus exact, de la comédie ancienne ;
car il est très vraisemblable qu'Aristophane ne fut pas l'inventeur
de ce système. Dans cinq de ses comédies sur onze
(les Chevaliers, les Nuées, les Guêpes, la Paix, les Oiseaux),
l'exposition se fait au moyen d'un récit manifestement destiné
au spectateur, mais encadré dans une scène dramatique.
Toutes ces pièces, une seule exceptée, s'ouvrent par une
vive et joyeuse bouffonnerie, au beau milieu de laquelle un
des acteurs se tourne vers le public pour expliquer le sujet ; après quoi reprennent le dialogue et l'action. Au commencement
des Nuées, la scène bouffonne est remplacée par un
monologue dramatique qui contient les amères réflexions
de Strepsiade, tourmenté par l'insomnie. Tantôt le récit
explicatif est d'une seule pièce (les Chevaliers, les Oiseaux) ; tantôt il est interrompu par divers incidents (les Nuées, les
Guêpes, la Paix). Sans doute toutes ces expositions pèchent
contre la vraisemblance ; mais on voit aisément que la partie
narrative y est bien moins isolée, bien moins indépendante
que dans les prologues d'Euripide. En somme, ce n'est pas
Aristophane qui a fourni des modèles aux poètes dont nous nous occuperons tout à l'heure, ce ne sont pas ses procédés
qui ont prévalu. Notons pourtant ici deux particularités que
ne présentent jamais les prologues d'Euripide et que nous
retrouverons dans la suite de cette histoire. D abord l'explication
du sujet s'adresse ouvertement, franchement aux
spectateurs, qui sont interpellés ou au moins nommés, excepté
toutefois dans les Nuées. Cette liberté, le poète se la
donne non seulement dans le prologue, mais un peu partout
dans la pièce, et principalement dans la parabase : elle est
excusée par les habitudes de la comédie ancienne et par la
nature des sujets empruntés à la vie publique contemporaine.
Autre détail digne de remarque : dans les Guêpes, la
narration a comme une préface, où il est parlé de choses
étrangères à l'exposition, où l'on fait appel aux sympathies
du public pour le poète ; or ces recommandations trouvent
d'ordinaire leur place dans la parabase et non dans le prologue.
Nous ne séparerons point ici la comédie moyenne de la
comédie nouvelle : car de la première période nous savons
trop peu de chose, au point de vue de l'exposition, pour en
faire l'objet d'une étude distincte. Je continue à me servir indifféremment des mots exposition et prologue : j'y suis
autorisé par la définition d'Aristote, qui s'applique aussi
bien à la comédie qu'à la tragédie. Dans le passage de la
Rhétorique cité plus haut, où le philosophe décrit l'office du
prologue, il assimile les deux genres dramatiques. Ajoutons
que les grammairiens grecs dont nous possédons des traités
ou des fragments de traités sur la comédie, nous ont laissé
du prologue comique, quant à l'étendue, une définition semblable
à celle du prologue tragique par Aristote. Le prologue,
c'est toute la partie de la pièce qui précède la parodos. Mais après la snppression du choeur, comment fut marquée
cette limite ? Ni Aristote, ni les autres grammairiens ne
nous l'apprennent ; dans les renseignements qu'ils donnent nous sur le prologue, ils ne distinguent pas les trois
époques de la comédie grecque. Si, à la place autrefois occupée par la parodos, les poètes, dès qu'ils ne disposèrent
plus d 'un choeur, laissèrent un vide indiquant une pause de
l'action, le prologue se termina à cette sorte d'entr'acte. Si
un joueur de flûte fut chargé de remplacer le choeur, la première apparition de ce joueur de flûte marqua la fin du prologue. De toute façon, le prologue correspondit à ce que
nous appelons le premier acte de la pièce.
Les poètes de la moyenne et de la nouvelle comédie empruntèrent à Euripide son procédé facile d'exposition, mais
n'en firent pas un usage aussi constant. Toutes les tragédies
d 'Euripide, toutes celle du moins qui nous sont parvenues
et toutes celles que cite Aristophane dans la scène
bien connue des Grenouilles, s'ouvraient, avons-nous dit,
par un monologue narratif. Ses imitateurs s'attachèrent
plus d'une fois à la manière de Sophocle. Trois des comédies
de Ménandre, qui ont servi à Térence d'original principal
ou secondaire, commençaient par un dialogue : la
Périnthienne, dont Térence a pris la première scène pour
modèle de la scène correspondante de son Andrienne, c'était, d'après Donat, un entretien du vieillard Simon
avec sa femme à laquelle Térence crut devoir substituer un affranchi ; l'Eunuque, dont le satirique Perse a traduit les
premiers vers : le comique latin n'a fait que supprimer quelques lignes au début et changer les noms des interlocuteurs dans Ménandre, Phoedria s'appelle Choerestratos
et Parménon Davos; la situation est d'ailleurs absolument
la même. Et, n'eussions-nous pas ici un témoignage formel,
nous pourrions affirmer presque avec certitude que le dialogue
par lequel s'explique le sujet de la pièce latine existait
dans l'original grec : Parménon n'est point, en effet,
comme l'affranchi Sosia, dans l'Andrienne, un personnage
protatique, servant seulement à faciliter l'exposition et
n'ayant pas de rôle dans le reste de la comédie ; Parménon
est un des principaux acteurs de toute la pièce. Pour la
même raison il est permis d'affirmer que l'Heautontimorumenos
de Ménandre débutait par une conversation entre
les deux vieillards que Térence a nommés Chrémès et Ménédème.
Nous possédons d'ailleurs deux fragments de la
pièce grecque, dont on reconnaît une traduction libre dans
deux passages de la pièce latine, appartenant tous les deux
à la première scène et faisant partie l'un du rôle de Chrémès,
l'autre du rôle de Ménédème. Ces trois comédies
n'étaient sans doute pas les seules où, conformément à la
bonne tradition et aux règles de la vraisemblance,Ménandre
eût mis son public au courant du sujet par un entretien
naturel. Rien ne fait supposer que cette imitation des prologues
de Sophocle fut particulière au seul Ménandre et
que les autres poètes de la même école suivirent constamment
les traces d'Euripide. Une pièce d'Apollodore de
Carystos, reproduite par Térence, l'Hécyre, prouve même
le contraire, puisqu'il ressort d'un fragment de l'original,
cité par Donat dès le premier vers de la première scène
latine, que dans la scène correspondante d'Apollodore conversaient
deux personnages dont l'un était la courtisane
Syra. Peut-être constaterions-nous, en étudiant de près les
comédies de Plaute, qu'il serait possible d'allonger cette liste. Mais nous n'y avons pas, en somme, grand intérêt :
l'important était de montrer que, dans l'évolution du prologue,
dont nous suivons les phases, l'influence d'Euripide
ne fut pas assez puissante sur les poètes de la nouvelle
comédie pour les empêcher d'adopter parfois une forme
plus parfaite d'exposition, la forme dialoguée.
Mais il y a tout lieu de croire, quoique nous manquions
de données positives pour évaluer le rapport des deux catégories,
que les pièces qui s'ouvraient, comme celles d'Euripide,
par un monologue narratif, étaient de beaucoup les
plus nombreuses. N'est-il pas naturel de songer à une préférence
des écrivains de la moyenne et surtout de la nouvelle
comédie pour les procédés d'un poète avec lequel ils
avaient d'ailleurs tant d'affinités que l'on peut les considérer
comme ses disciples, comme ses héritiers? Dans la tragédie
d'Euripide, c'est l'intérêt psychologique qui domine : peindre
l'âme en proie aux plus violentes passions, voilà son
objet principal. L'étude fine, délicate, savante des sentiments
du coeur humain, est aussi la préoccupation et le
triomphe de Ménandre et de ses rivaux. Comme Euripide,
ils abrègent donc autant que possible les scènes préliminaires,
ils se débarrassent à la hâte de l'exposition et courent
à ces développements où ils se complaisent, à ces tableaux
qui sont pour eux la partie essentielle du drame. Ce
qu'il faut dire aussi, c'est que les difficultés de l'exposition
sont plus grandes pour ces poètes que pour leurs aînés de
la comédie ancienne et que pour les tragiques. Eschyle et
Sophocle empruntent leurs sujets à des traditions familières
au spectateur ; Aristophane transporte sur la scène les
hommes et les évènements du jour. Mettre au courant un
public, sur les souvenirs personnels duquel ils peuvent
compter, leur est chose relativement aisée. Tout le monde;a entendu parler de Prométhée et d'Oreste ; tout le monde a vu Cléon et Socrate. Mais ces personnages que la nouvelle
comédie crée de toutes pièces, nul ne les connaît. Que de détails, quelle longue histoire il va falloir apprendre aux
spectateurs ! Si on tient à les en instruire avec vraisemblance,
comme on devra se mettre l'esprit à la torture pour
échapper à d'interminables lenteurs ! A quoi bon se donner
tant de mal, puisque, somme toute, l'exposition n'est pas
l'essentiel, puisque l'intérêt et le charme du drame ne sont
point là? Ainsi raisonnèrent ces auteurs, et, avisant un
moyen commode de se tirer d 'affaire, recommandé et consacré
par l'autorité d'Euripide, ils s'en servirent sans scrupule.
La mode s'établit donc de placer en tète des comédies
un monologue narratif. Quel était le personnage de ce monologue?
Quel en était le contenu ? Comment se trouvait-il
extérieurement uni à la suite du drame ?
Celui que le poète chargeait de donner au public, dès le
commencement, les indications nécessaires pour suivre l'intrigue
et y prendre plaisir, était tantôt un personnage de
la pièce, qui, en dehors de ses fonctions de narrateur, avait
à jouer un rôle dramatique, tantôt une divinité ou quelque
autre personnification allégorique qui, son récit achevé,
n'ayant plus rien à dire ou à faire dans la pièce, s'en allait
et ne reparaissait pas. A la première classe appartenaient
ce Chrémès, ce Phidon, à qui le public, dit Antiphane, ne
ménagerait pas les sifflets, s'ils venaient à oublier dans leur
récit quelque détail important; Simon (1), le vieillard de
l'Andrienne :
(1) Térence a peut-être ici changé les noms propres, comme il l'a fait ailleurs ; peu importe.
dans Ménandre, il adressait directement au
public les confidences que dans la pièce latine il fait à son
affranchi Sosia; Micion, le père indulgent des Adelphes :
Térence lui a conservé le monologue narratif qu'il disait
dans l'original grec; un autre personnage encore de Ménandre, un acteur de l'Epicleros, que l'insomnie avait,
disait-il, chassé de son lit et amené devant les spectateurs
pour raconter toute sa vie depuis le commencement;
enfin, dans la Thaïs du mème poète, cet amant de la belle
courtisane, qui, parodiant la solennité des invocations épiques,
s'écriait :"« Chante-moi donc, ô déesse, cette femme
effrontée, mais jolie et séduisante ..."
S'il faut s'en rapporter à une indication, un peu vague,
il est vrai, de Donat, l'Epidicazomenos d'Apollodore de
Carystos s'ouvrait, comme le Phormion de Térence, qui en
est la reproduction, par un monologue narratif de Dave.
Mais, l'exposition de la comédie se faisant tout entière dans
la deuxième scène qui est dialoguée, il ne convient peut-ètre
pas d'ajouter cet exemple à ceux qui précèdent. L'étude
des prologues de Plaute nous mettrait en mesure d'en
grossir encore le nombre. Elle nous fournirait également
des représentants de la seconde classe. Nous pouvons d'ailleurs
en désigner quelques-uns dès à présent. Philémon
avait fait paraître, dans on ne sait quelle comédie, le dieu
Aer, « le même que Zeus ». On peut conclure d'un passage de Sextus Empiricus que Phobos disait le prologue d'une
comédie dont le titre et l'auteur sont inconnus. Lucien cite
comme personnage d'un des prologues de Ménandre Elenchos,
« ami de la vérité et de la franchise ». Il résulte en
outre de ce texte très curieux que d'autres divinités étaient
venues remplir sur la scène les mèmes fonctions. Et Ménandre
avait, semble-t-il, entre tous les poètes de cette époque, une
prédilection marquée pour cette sorte d'allégories ; c'est
évidemment ce qu'indique le rhéteur Théon quand il dit
que l'on trouverait dans ses drames de beaux exemples de
prosopopée. Pourquoi Ménandre et les autres eurent-ils
recours à l'artifice de ces personnifications ? Pour deux
raisons, les mèmes qui avaient conduit Euripide à l'emploi
de moyens analogues : d'abord la nécessité de faire paraître
dans ce rôle de narrateur, chaque fois que, pour un motif
ou pour un autre, aucun des personnages de la pièce n'était
en mesure de fournir au public tous les renseignements indispensables
ou désirables, une individualité douée du privilège
divin de tout savoir ; Aer, étant partout, sait forcément
tout ce qui se passe en quelque lieu du monde que
ce soit ; il n'est personne, ni homme ni dieu, qui puisse lui
cacher une seule de ses actions ; voilà sans doute pourquoi
Philémon l'a chargé de l'exposition ; ensuite le désir de
corriger par l'agrément du spectacle la grossièreté d'un procédé si contraire aux lois du drame et de dérober sous d'ingénieuses
inventions la froideur, la monotonie des longs
récits préliminaires. Tous n'y réussirent pas. La courtisane
Gnathaena dit un jour à Diphile, l'un des plus célèbres, que
pour rafraîchir l'eau elle avait soin d'y mettre les prologues
de ses drames. Cette anecdote nous porte à croire, d'une
part, que Diphile faisait un usage à peu près constant de
l'exposition narrative; d'autre part que, s'il se mettait en
frais d'imagination pour l'encadrer dans de jolies allégories,
il perdait sa peine et ne créait le plus souvent que des
figures sans couleur et sans vie.
Quel que fût le personnage du monologue initial, divinité
ou simple mortel, sa mission était toujours la même : expliquer
au public le sujet de la pièce. Ce qui nous autorise à
l'affirmer, c'est, pour ne point parler des quelques vers que
nous pouvons avec certitude ou avec vraisemblance considérer
comme des fragments de prologues, l'assimilation établie
par Aristote, quant au rôle du prologue, entre la tragédie
et la comédie. Mais si ces préambules contenaient,
tout de même que ceux des pièces d'Euripide, l'exposition
avec des réflexions générales provoquées par les faits racontés,
ne s'y trouvait-il rien de plus ? Le poète n'y glissait-il
pas quelquefois un éloge de ses mérites personnels ou des
qualités de son oeuvre? Aristophane l'avait fait dans le prologue
des Guêpes ; exception unique peut-ètre : car il avait,
lui, pour s'entretenir librement avec son public de choses
actuelles et personnelles, la parabase. Lorsque ses successeurs,
privés de cette ressource, crurent opportun d'adresser
aux spectateurs une communication de ce genre, ils la placèrent
dans le prologue, où étaient déjà admises tant d'infractions
aux règles de la vraisemblance. C'est ce que nous prouve le passage déjà cité du Pseudologiste de Lucien.
Ce pamphlet est dirigé contre Timarque. Pourquoi Lucien
attaque-t-il Timarque? Une narration préliminaire va l'apprendre
au lecteur. Seulement, au lieu de la faire lui-mème,
l'auteur la confiera à l'un des personnages de prologue inventés
par Ménandre, à Elenchos « ami de la vérité et de
la franchise, dieu et non le plus obscur de ceux qui montent
sur la scène, haï de vous seuls qui redoutez sa langue... ».
Lucien l'invite à venir « raconter aux spectateurs tout le
sujet de la pièce
. Elenchos devra démontrer que celui qui l'envoie a
des motifs sérieux de malmener Timarque ; puis, l'exposition
achevée, il se retirera, sans adresser au public un éloge
de Lucien . Le prologue de
Ménandre, auquel Lucien fait ici allusion et qu'il a sous les
yeux ou dans la mémoire (1), se composait donc de trois parties: le personnage se présentait et expliquait son intervention
; il s'acquittait de son rôle de narrateur ; il faisait en
terminant l'éloge du poète ou déclarait qu'il se dispenserait
de le faire.
(1) On retrouverait aisément dans la prose de ce passage de Lucien plus d'un vers de Ménandre.
D'où nous concluons qu'à l'époque de Ménandre
un élément nouveau, étranger au drame, s'introduisit dans
un certain nombre de prologues, et sans doute de préférence
dans les prologues à personnages allégoriques qui,
placés par leur nature mème en dehors et au dessus du
monde des personnages de la pièce, pouvaient plus librement
mêler dans leur discours les choses de la réalité quotidienne
aux choses de la fiction dramatique. Avec cette
licence, le prologue de Ménandre prit aussi à celui d'Aristophane
le droit de s'adresser directement et sans façon au
public.
Quant aux rapports extérieurs du monologue préliminaire
avec la suite du drame, il faut distinguer deux cas : ou bien
il est uni à une scène dialoguée où se continue l'exposition, ou bien il est suivi d'une pause et forme à lui seul le prologue.
Le monologue est isolé, toutes les fois qu'il est prononcé
par une divinité : quand celle-ci a disparu, la scène
reste vide en attendant que les personnages de la pièce se
présentent. Si c'est au contraire un personnage de la pièce
qui fait l'introduction narrative, cette première scène peut
se lier à la seconde : ainsi le prologue des Adelphes de
Ménandre se composait de deux parties : le monologue de
Micion et un dialogue entre Micion et Déméa. Mais il arrive
aussi que la liaison dont nous parlons, n'existe pas :
dans l'Andrienne de Ménandre, Simon se retirait après
avoir dit son monologue, et le prologue finissait là (1).
(1) Cf. le Térence de Fleckeisen (Teubner). La division des actes donnée par la vulgate est évidemment mauvaise.
Pour
ma part, je ne suis point porté à considérer les monologues
indépendants, tels que celui de Simon, comme des exceptions
; j'inclinerais plus volontiers à croire qu'ils étaient
en nombre respectable, et que, ce contingent grossissant la
foule des monologues à figures allégoriques, les prologues
à une seule scène constituaient une bonne majorité. Ceci
m'expliquerait comment le mot prologue a pu passer de son
sens primitif à une autre signification que nous lui trouvons
chez Lucien et qu'il avait déjà au temps des comiques romains.
Si l'on admet qu'à l'époque de Ménandre le
prologue se réduisait très souvent à un monologue et n'avait
par suite qu'un seul personnage, rien n'est plus facile à
comprendre que cette dérivation de sens.
Les poètes comiques de la nouvelle école adoptèrent donc
le système d'exposition mis en vogue par Euripide et caractérisé
par la présence, au début du drame, d'un monologue
narratif. Il va sans dire que cette révolution ne se fit pas
d'un seul coup et que, surtout pendant la période de transition, celle qui correspond à la comédie moyenne, l'ancienne
manière garda des partisans, imitateurs de Sophocle ou
d'Aristophane; il est mème certain qu'elle ne fut jamais
absolument délaissée. Mais le parti opposé gagnait tous les
jours du terrain : les meilleurs poètes suivaient la mode
nouvelle. Et l'on n'imita pas purement et simplement Euripide
: ses procédés subirent certaines modifications, dont le
résultat fut d'augmenter l'isolement du monologue narratif.
On respecta, en somme, le lien intime qui l'unissait au
drame, puisqu'on le consacra surtout au récit des faits nécessaires
ou utiles à l'intelligence du sujet ; mais on y parla
aussi d'autre chose : les actualités s'y firent une place à côté
de l'exposition. Puis, le lien extérieur manqua plus fréquemment
que chez Euripide. Enfin, les personnalités allégoriques,
à qui l'on prit l'habitude de confier ce rôle, étaient
encore plus étrangères à l'action que les divinités dont Euripide
s'était servi pour le mème usage : il fallait renoncer
à justifier leur intervention par des raisons sérieuses et se
borner à imaginer des prétextes plus ou moins spécieux. A
tous ces caractères ajoutons le sans-gène avec lequel le spectateur
est interpellé dans ces monologues. N'est-il pas clair
que les poètes comiques, disciples d'Euripide, ont fait parcourir
au prologue une étape de plus vers l'indépendance
absolue ?
On pense bien que les premiers poètes qui reproduisirent
pour la scène romaine les oeuvres de la moyenne et de
la nouvelle comédie, que les vieux représentants de la
fabula palliata ne furent pas choqués de l'invraisemblance
des monologues narratifs : ils n'avaient pas le jugement
assez fin et le goût assez délicat pour sentir la grossièreté
de l'artifice. D'ailleurs, l'expérience dut leur en faire chaque
jour mieux apprécier les avantages. A ces robustes laboureurs,
à ces braves soldats, qui vinrent se délasser au
spectacle nouveau des drames d'Andronicus, la nature avait
donné plus d'énergie et de bon sens que d'imagination,
plus d'aptitude à agir en vue de l'utile que de penchant à rêver au beau. L'éducation n'avait pas réformé, loin de là,
leurs qualités natives. Enfants, ils ne s'étaient pas exercés
dans une école à lire les poètes ; adolescents, ils ne s'étaient
pas attachés à un philosophe savant et beau parleur. Ils
excellaient donc à guider la charrue et à manier l'épée ;
mais aux choses de l'esprit ils étaient absolument neufs,
insensibles aux mérites littéraires de la pièce qui se jouait
sous leurs yeux, s'épanouissant de rire aux scènes bouffonnes,
bâillant d'ennui aux endroits sérieux, incapables en
somme de suivre l'intrigue avec une attention soutenue et
d'y rien comprendre pour peu qu'elle fût compliquée.
N'était-il pas nécessaire de leur conter d'avance une foule
de détails que des spectateurs moins distraits et plus exercés
eussent trouvés superflus ? Ne fallait-il pas leur faire toucher
les choses du doigt ? Le prologue narratif répondait à ce
besoin. Aussi, loin de le remplacer par une exposition
dialoguée, quand il existait dans l'original grec, Andronicus
et ses successeurs jusqu'à Térence en munirent-ils
beaucoup de pièces qui n'en avaient pas. Mais il était bien
plus facile de composer le récit préliminaire que de créer
chaque fois un personnage à qui le confier. Tout le monde
n'est pas Ménandre : les vieux poètes romains remédièrent
à l'infécondité de leur imagination par un expédient
aussi naïf que commode. Ils personnifièrent le prologue ;
ils en firent Prologus, et toutes les fois qu'on eut besoin
de lui, Prologus se chargea complaisamment de réciter
l'argumentum.
Prologus est bien d'origine romaine. Peut-ètre un poète
comique athénien s'avisa-t-il un jour de personnifier Prologos, de même qu'on avait personnifié Elenchos et Phobos.
Mais il ne se condamna sûrement pas à enfermer toutes ses
expositions dans ce cadre une fois trouvé ; Prologos, comme
les autres abstractions, ne servit que pour une pièce. Prologus,
personnage permanent du prologue, ne vint pas de
Grèce, il naquit à Rome. Le grammairien Evanthius, dans
son traité de Comaedia, l'atteste en termes formels. Il ne s'agit pas ici du contenu du prologue.
Evanthius en parle plus loin; il s'agit des personnanages
de prologue, des Prologi. En effet, dans les phrases
qui précèdent il est question d'un autre personnage de la
comédie, le choeur, et voici la phrase qui suit immédiatement :
« Deinde Osou; id est deos argumentis narrandis
machinatos, cæteri Latini instar Graecorum habent :
Tercntius non liabet. » Le contexte ne laisse donc pas de
doute sur le sens du témoignage.
C'est dans le théàtre de Plaute que nous rencontrons
pour la première fois l'étrange personnalité de Prologus.
Sur les vingt comédies que nous avons de ce poète, il en
est une dont les premières scènes nous manquent (Bacchides) ; quatre s'ouvrent par une exposition dialoguée, sans
prologue narratif (Curculio, Epidicus, Persa, Stichus) ;
huit sont précédées d'un de ces monologues prononcés par
un personnage de la pièce ou une figure allégorique, que
nous appellerons, pour abréger, prologues grecs (Amphitryo,
Afercalor, Miles Gloriosus (1), Mostellaria, Aulularia,
Rudens, Trinummus (2), Cistellaria ; enfin six ou sept
débutent par un discours de Prologus, par un prologue
romain (Asinaria, Casina, Captivi, Afenæchmi, Poenulus,
Pseudolus (3), Truculentus (4).
(1) Dans le Miles, la Mostellaria et la Cistellaria, le prologue n'est pas en tête de la pièce, mais après une scène ; artifice destiné à produire un peu de variété, et dont les poètes de la N. Com. durent user quelquefois. Il y a une certaine analogie entre ces prologues et ceux d'Aristophane.
(2) Prologue à deux figures (Luxuria et Inopia), mais la seconde est presque muette et ne reste qu'un instant sur la scène.
(3) Nous n'avons que les deux derniers vers de ce prologue ; il semble qu'ils conviennent fort bien à Prologus.
(4) Nous n'avons que les deux derniers vers de ce prologue ; il semble qu'ils conviennent fort bien à Prologus.
(5) Ce prologue est tronqué à la fin.
Mais de ces prologues grecs
et romains pouvons-nous affirmer qu'ils remontent jusqu'à
Plaute? On a élevé des doutes contre l'authenticité de la plupart d'entre eux1. Il n'y a pourtant pas trop de témérité à
prendre la défense des prologues grecs. Plaute n'aurait pu
tirer d'une exposition dialoguée de son original le monologue
de Mercure, ou de Charinus, ou de Palestrion, ou de
Philolachès, sans faire subir à tout le premier acte des remaniements
considérables : le monologue existait déjà dans
la pièce grecque, cela est infiniment probable. Quant aux
figures allégoriques, quoiqu'à la rigueur Plaute en ait pu
créer quelqu'une, il est bien plus naturel de les attribuer en
général aux poètes grecs, qui avaient le goût de ces prosopopées
et une imagination sans contredit plus riche. Si ces
prologues étaient dans les originaux de Plaute, ils sont évidemment
authentiques, au moins pour le cadre et le noyau ;
car en plus d'un endroit l'interpolation est visible. Au
contraire, la cause des prologues romains est mauvaise ; on
ne peut pas apporter en leur faveur de preuves intrinsèques,
d'arguments décisifs.
Faudra-t-il donc renoncer à démontrer que Plante s'est
servi de Prologus ? Non. D'abord nous savons que ce personnage
existait et que tous les spectateurs le connaissaient
à l'époque où débuta Térence : sinon comment aurait-il pu
paraître sur la scène, à la représentation de l'Andrienne,
sans provoquer la curiosité et même la surprise du public,
sans avoir besoin de fournir, avant de remplir sa mission,
quelques renseignements sur son individualité ? Prologus
était donc alors d'un usage courant. On peut préciser davantage
: deux comédies de Plaute, les Captifs et les Ménechmes,
ont une intrigue assez compliquée ; des spectateurs
ignorants et souvent distraits, comme ceux qui en ce
temps-là formaient la masse du public, n'auraient pu suivre facilement ni l'une ni l'autre de ces pièces sans le secours
d'une narration préliminaire qui leur mît entre les mains le
fil conducteur. Toutes deux avaient certainement un prologue,
dont celui que nous possédons n'est qu'un remaniement
fait en vue des reprises postérieures à la mort de
Plaute, et Prologus en était, cela va sans dire, le personnage.
D'ailleurs Plaute lui-même ne fut sans doute pas
l'inventeur de Prologus : l'idée si simple, si naïve de cette
personnification dut venir à l'esprit du premier qui se trouva
dans l'embarras en face d'une piècè grecque dépourvue de
monologue initial et trop embrouillée pour être ainsi comprise
du public romain. Prologus doit être à peu près aussi
ancien que la fla palliata, Si nous ne trouvons pas,
avant le temps de Plaute, des traces certaines de son
existence, c'est que nous ne savons presque rien des prologues
de l'époque antérieure.
Un personnage tel que Prologus est avec l'action dramatique
dans un rapport encore plus éloigné que les divinités
de Ménandre : il ne peut même pas avoir l'air de
prendre part en secret aux évènements de la pièce : car il
n'entre pas dans la même fiction que les autres personnages,
il ne dépend pas du drame, en dehors duquel il a une
situation distincte et une existence permanente. De ce côté
donc les prologues romains ne tiennent pas à la comédie
qu'ils précèdent, ils n'y tiennent pas même en apparence.
Les comiques grecs, à défaut de rapport réel, avaient eu
l'art de ménager une ombre de rapport ; les comiques romains
l'ont effacée. C'est un lien de plus qui se brise.
Pourtant l'émancipation du prologue n'est pas encore complète
: indépendant par le personnage, il est toujours soumis au drame par le contenu. Car le morceau principal
du prologue est l'argumentum récit des faits antérieurs
au moment où s'engage l'action, augmenté le plus souvent
d'une analyse de la pièce elle-mème. Prologus sait fort bien
tout ce qui s'est déjà passé et tout ce qui va maintenant
arriver ; non qu'il tienne de la nature le don de tout connaître,
comme les divinités du théâtre grec, mais simplement
parce qu'il a reçu les confidences du poète.
D'ailleurs, son discours n'est pas tout entier consacré à
l'exposition. La fable et la réalité, ces deux éléments que
nous avons distingués dans l'un des prologues de Ménandre,
se retrouvent ici, représentées l'une par l'argumentum, l'autre par la captatio benevolentiæ, c'est-à-dire par certains développements qui, n'ayant rien de commun avec le
sujet du drame, sont destinés non à mettre le public au
courant, mais à le rendre sympathique. La captatio benevolentiae faisait sûrement partie des prologues authentiques
de Plaute. Nous ne fondons pas cette affirmation sur le
contenu des prologues actuels, puisqu'ils sont suspects.
Nous n'invoquons pas non plus le témoignage des grammairiens,
celui d'Evanthius, par exemple, qui définit ainsi
le prologue : « Prologus est velut praefatio quædam fabulae,
in quo solo licet praeter argumentum aliquid ad
populum vel ex poetae vel ex ipsius fabulas vel ex actoris
commodo loqui. » Evanthius, selon toute apparence, ne
connaissait pas mieux que nous le texte primitif. Mais
voit-on pour quelle raison Plaute et les autres vieux comiques
romains n'auraient pas suivi l'exemple donné par
les poètes de la nouvelle comédie, leurs modèles ? Tout les
engageait au contraire à le suivre, et, qui plus est, à élargir
la place, à augmenter l'importance des actualités. D'abord,
avec Prologus plus de fiction à respecter, plus d'illusion à ménager; le poète peut, sans scrupule, donner carrière à
sa verve; et Névius et Plaute n'étaient pas hommes à laisser
échapper l'occasion. Le plaisir que procurait aux Athéniens,
que procure encore parfois aux Romains l'apparition
d'une figure allégorique, agréable par la nouveauté de ses
attributs, l'originalité de son costume, Prologus, personnage
banal et sans prestige, ne peut le donner à son public ; il
n'a pas non plus la ressource d'étaler au début de son discours
cette pompeuse énumération de titres et de prérogatives
par laquelle les divinités-prologues expliquaient leur
intervention.
----Le Prologus prononçant le prologue de L’Hécyre . Manuscrit enluminé (début du IXe siècle) qui reproduit un manuscrit antique aujourd’hui disparu comportant les six comédies de Térence, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Paris.Gallica.
Pour réparer le mauvais effet de cette infériorité
extérieure et pour combler cette lacune, il faut qu'il
fasse appel à toutes les finesses de son esprit, à toutes les
ruses de son sac. Obligation impérieuse. Car ses auditeurs
sont grossiers, ignorants, turbulents. Avant de commencer
l'argumentum, Prologus doit par son exorde attirer leur
attention et les décider au silence. Pour qu'ils écoutent le
récit jusqu'au bout, il ne suffit pas qu'il soit clair, il faut
encore qu'il soit intéressant, coupé de loin en loin par une
piquante digression. Qu'une péroraison flatteuse ou amusante
complète le discours, et l'effet désiré est obtenu ; voilà
les spectateurs tout prèts à faire bon accueil aux acteurs de
la pièce. Il est donc logique de croire que, dans les prologues
des comiques romains antérieurs à Térence, et dans
ceux de Plaute en particulier, les actualités jouaient leur
rôle, qu'elles y jouaient un rôle beaucoup plus considérable
que dans ceux de Ménandre.
Le prologue romain, tel que nous venons de le décrire,
n'est pas une simple exposition (1) ; il est mème suivi d'une
seconde exposition, la vraie, avec laquelle nous trouvons,
nous autres, qu'il fait double emploi (2); c'est une sorte d'annonce détaillée, de programme avant la pièce.
(1) La distinction établie par Evanthius et Donat entre le prologue et la protase s'applique parfaitement à cette catégorie de prologues.
(2) Exemple frappant : les Captifs de Plaute. Comparez le prologue et la première scène.
Mais, quoique nous soyons bien loin à présent de la définition d'Aristote, qui a été notre point dedépart, la révolution du prologue n'est pas achevée ; pour le rendre tout à fait indépendant du drame, il reste encore un pas à faire: la suppression de l'argumentum. : C'est Térence qui le fera.
II
Le jour où il donna sa première pièce, l'Andrienne,
Térence, dès les premiers vers du prologue, avertit les
spectateurs qu ils n 'y trouveraient pas d'argumentum. Et
ceux qui, ayant écouté attentivement la déclaration du poète,
en pesèrent bien tous les termes, durent comprendre que
l'élément exclu de ce prologue ne serait pas davantage
admis dans les suivants; que Térence en avait décidé la
suppression, non pour une fois, mais pour toujours. Cette
innovation n'empècha point l'Andrienne de réussir ; l'auteur
n'eut donc alors aucune raison d 'y renoncer. Le succès
extraordinaire de l'Eunuque, qui parut avec un prologue
du mème genre, était encore moins fait pour le ramener au système qu'il avait cru devoir abandonner. Mais bientôt
après, l'Hécyre échoua, et nous savons que Térence ressentit
très vivement l'amertume et l'humiliation de ce premier
échec. D'aucuns se demandèrent peut-ètre, lorsqu'il fit
jouer l'Heautontimorumenos,après deux ans de silence et
de retraite, s'il n'allait pas, ramené par la réflexion et l'expérience
à l'usage traditionnel, rétablir à sa place l'argumentum.
Mais le prologue de l'Heautontimorumenos, qui
présente d'ailleurs certaines particularités notables, ne contient pas plus d'argumentum que les précédents. Un moment
vint où les ennemis de Térence lui cherchèrent querelie sur la composition de ses prologues les insinuations
les plus malveillantes allèrent leur train : si le nouveau
venu n'écrivait pas, comme ses devanciers, de vrais prologues,
c'est qu'il en était incapable; heureusement pour
lui que les attaques de Luscius l'avaient sauvé de sa pauvreté
d'invention en lui ménageant la ressource d'une polémique.
Voilà ce que l 'on disait. Sans ébranler Térence,
de telles critiques l'émurent un peu ; il y répondit dans le
prologue du Phormion. Si sa réponse prouva aux jaloux
qu'ils n'auraient pas facilement raison de son obstination,
elle ne leur ferma pourtant pas la bouche ; ils persistèrent
à décrier les procédés du jeune poète et à faire l'éloge du
vieil usage. Peine perdue; dans le prologue des Adelphes,
sans discuter une seconde fois leurs objections, Térence
affirmait nettement qu'il n'y avait pas à attendre de lui
l'argumentum, et, fidèle jusqu 'au bout à ses résolutions,
il écrivait encore sans argumentum les deux prologues qui
servirent aux reprises de l'Hécyre.
Hâtons-nous de remarquer, pour ne point exagérer l'originalité
de Térence, que la suppression de l'argumentum n'était pas, à l'époque de ses débuts, une nouveauté sans
précédent. Avant le prologue de l'Andrienne, le public
romain avait écouté au moins un prologue sans argumentum,
celui du Trinummusde Plaute. Que ce petit discours
de Luxuria soit ou non imité du grec, on doit le tenir pour
authentique : il est d'une telle beauté littéraire qu'on ne
pourrait guère hésiter à l'attribuer à Plaute, mème si le
poète n'y était pas désigné en termes formels comme l'auteur
de la personnification. Térence connaissait si bien ce
précédent créé par son illustre devancier, que, dans le prologue
des Adelphes, pour annoncer l'absence de l'argumentum,
il s'est servi de la formule employée par Plaute. On lui avait reproché de ne pas faire comme les anciens ;
avec beaucoup d'à-propos, il rappela que l'un des plus aimés
s'était séparé avant lui de la tradition. Pourquoi murmurait-on ? Il ne faisait que suivre l'exemple de Plaute. Sans
nul doute l'allusion ne fut pas comprise des spectateurs
vulgaires qui, ou bien ne connaissaient pas le prologue du
Trinummus, ou bien en avaient oublié peut-ètre la substance
et à coup sûr les expressions textuelles. Mais elle ne
dut point échapper aux critiques partisans de l'argumentum,
gens lettrés, à qui seuls elle était destinée. Quoi qu'il
en soit, puisque Plaute prit la précaution de signaler à son
public la suppression de l'argumentum, le prologue du
Trinummus était, au temps où parut cette comédie, une
dérogation hardie, peut-ètre même la première, à l'usage
établi. Depuis ce jour jusqu'à la représentation de l'Andrienne,
le fait se reproduisit-il ? Nous l'ignorons. Mais ce
qui est certain, c'est que le mérite original de Térence fut
de convertir une exception, sinon unique, du moins fort
rare, en règle et en règle absolue.
Quand on considère qu'il accomplit cette importante réforme
dès sa première pièce et qu'il ne revint jamais sur sa
décision, pas même pour mettre à néant par le meilleur des
arguments, par un prologue à l'ancienne mode, ce reproche
de stérilité auquel son amour-propre de poète dut être très
sensible, on n'a pas de peine à croire qu'il ne se détermina qu'après mûre réflexion et pour de bonnes raisons qui ne
cessèrent jamais de lui paraître concluantes. Aussi demeure-t-on tout surpris qu'il ne les ait nulle part exposées. Au début
du prologue de l'Andrienne une explication de ce genre
était naturelle, nécessaire même. Il le comprit bien. Mais au
lieu de la donner claire, complète, sincère, il se contenta
d'une annonce, catégorique sur le fait de la suppression,
obscure et peu satisfaisante sur la question des motifs. « Le
poète, y est-il dit, lorsqu'il s'est décidé à écrire pour le théâtre,
a cru d'abord que dans la composition de ses pièces il
devait avoir uniquement en vue les suffrages du public »,
en d'autres termes, il s'est figuré qu'à chaque oeuvre nouvelle,
la cause arriverait entière devant des juges libres de
toute prévention et que l'accueil fait à ses comédies dépendrait
seulement de l'impression bonne ou mauvaise produite
sur les spectateurs pendant la représentation ; il a compté
sans le péril que des bruits malveillants, semés par la jalousie
avant le grand jour, feraient courir à la pièce encore
inédite ; « mais l'événement lui a montré que son erreur
était grande ; et il consume ses soins à écrire des prologues
non pour exposer le sujet, mais pour se défendre contre un
vieux poète mal intentionné», qui met tout en oeuvre pour
faire échouer l'Andrienne. On le voit, Térence cherche à
rejeter sur ses détracteurs la responsabilité de son innovation.
Il est un point essentiel qu'il laisse à dessein dans le
vague et que nous essaierons bientôt d'éclaircir : si Luscius
ne l'avait point attaqué, aurait-il fait jouer ses comédies
avec des prologues à argumentum, ou bien aurait-il purement
et simplement supprimé le prologue? Quant à la
raison donnée ici, ce n'est qu'un prétexte d'une faiblesse
dérisoire. Qui empêchait le poète de présenter d'abord sa
justification et de raconter ensuite l'argumentum? La longueur du prologue était-elle limitée à quelques vers près?
Les deux éléments étaient-ils incompatibles ? Dans le prologue
des Adelphes, après avoir répondu aux attaques de
ses ennemis, Térence ajoute :
« Dehinc ne exspectetis argumentum fabulae. » Lui-même reconnaît donc qu'il ne serait pas impossible
de placer à cet endroit le récit préliminaire.
Quelques années après, une nouvelle occasion s'offrit à
Térence de s'expliquer franchement sur sa conduite. Le
gros du public ne chicana pas le poète sur la valeur de son
excuse ; mais il était plus difficile de donner le change aux
spectateurs instruits. Moins que personne, Luscius et ses
partisans pouvaient être dupes d'un pareil subterfuge. Il
leur fut aisé d'en faire justice ; on pense bien qu'ils ne s'en
tinrent pas là : ils interprétèrent les choses à leur manière
et lancèrent contre Térence cette accusation :
« Vetus si poeta non lacessisset prior,
Nullum invenire prologum posset novus
Quem diceret, nisi haberet cui malediceret D. (1).
(1) Phorm.prol. 13 sqq. Après Guyet, Ihne (Quæst. Ter. 42) met en doute l'authenticité du dernier de ces trois vers. Quant à moi, je le trouve indispensable pour le sens. Dans sa réponse, Térence ne tiendra compte que du grief de médisance : il faut bien qu'il lui donne dans l'objection le plus de relief possible. Si on supprim ece vers, les vers 20 sq. ne sont plus suffisamment préparés. L'observation de Ritschl D signifie « faire dire (par l'acteur du prologue). » Il y a de plus dans le vers qui nous occupe une sorte de jeu de mots entre « dicere » et malediceret ».
Il y a ici deux griefs : le grief de stérilité et le grief de
médisance. Térence feint de ne voir que le second et se
justifie en invoquant le droit de légitime défense. Quant au
premier, qui est évidemment le principal, il néglige de le
réfuter. Il se tire d'affaire par une réponse énergique de ton, mais au fond tout à fait évasive, qui dénote chez lui
l'invincible parti pris de garder son secret.
Car il a son secret, et les propos méchants mis en circulation
par ses envieux ne méritent pas d'ètre pris au sérieux.
Prétendre que l'auteur de tant d'admirables narrations, gaies
ou touchantes, si habilement arrangées, si vivement menées,
était incapable de présenter l'argumentum sous une forme
intéressante et spirituelle, n'est-ce pas le comble de l'invraisemblance
? Pour les récits qu'on lit au courant de ses
pièces il a eu sous les yeux, il a copié le modèle grec. Sans
doute; et nous savons qu'il a suivi ses originaux de plus
près que Plaute. Mais encore faut-il reconnaître qu'il n'a
pas toujours traduit mot à mot. D'ailleurs, quelque stérilité
d'invention qu'on lui suppose, il avait assez lu pour enrichir
son fonds personnel ; sa mémoire pouvait venir en aide à
son imagination. Fallait-il enfin une prodigieuse fécondité
d'esprit pour encadrer et égayer de quelques vers l'élément
narratif du prologue ? Si Térence avait écrit des prologues
à argumentum, ils n'auraient certainement pas eu l'allure
bouffonne et l'entrain bruyant de ceux que nous lisons en
tète des comédies de Plaute : ils eussent été, en revanche,
plus gracieux et plus coquets. Nous y retrouverions l'empreinte
d'un talent moins fort et moins riche, mais plus fin et
plus cultivé. La différence est frappante entre les pièces des
deux poètes ; leurs prologues se distingueraient aussi très
nettement, même si le contenu en était de nature semblable.
On peut ajouter que ceux de Térence, comme ses pièces,
auraient provoqué moins de gros éclats de rire, auraient eu
un succès moins populaire. Mais on ne saurait aller plus
loin sans injustice, et il faut chercher ailleurs la véritable
explication du changement capital que notre poète fit subir
à l'office du prologue.
Il n'est pas difficile de voir que ce furent des raisons
d'art qui engagèrent Térence à rompre dès le début et pour
toujours avec la tradition. S'il manquait à son talent la
verve et le feu, sources des beautés dramatiques vives et éclatantes, de celles dont l'attrait puissant agit d'emblée et
sur toutes les âmes ; si par là il fut inférieur aux vieux comiques
romains, à Névius et à Plaute, il se plaça bien au
dessus d'eux par la finesse de son jugement et la délicatesse
de son goût, qualités naturelles qu'une culture soignée, que
l'étude des chefs-'oeuvre du théâtre grec, que le commerce
journalier des hommes les plus intelligents et les plus instruits
de l'époque développèrent merveilleusement. Poète
de sang-froid, artiste patient, il eut des scrupules, il fit des
réflexions, auxquels ses devanciers, emportés par leur fougue,
ne s'étaient pas arrêtés. Le premier à Rome, il considéra
qu'une comédie n'est pas seulement un spectacle, mais
encore une oeuvre d'art ; que, si l'obligation immédiate du
poète comique est de plaire aux contemporains, spectateurs
de sa pièce, il a pourtant le droit de songer aux lecteurs
et à la postérité. Le premier, il sentit tout le prix de la
perfection littéraire, exquise et modeste, qui échappe aux
ignorants, mais charme les délicats. Le premier aussi, en
écrivant ses comédies, il médita à fond sur les conditions
de l'art dramatique et le trouva soumis à des lois auxquelles
il donna une adhésion pleinement raisonnée ; et il lui parut
que la plus respectable, la plus essentielle de toutes, c'était
la loi de vraisemblance.
Or elle condamne les monologues narratifs. MaisTérence,
quelque envie qu'il en eût, ne pouvait pas songer à faire
disparaître tous ceux qui se rencontraient dans ses originaux.
Il aurait fallu pour cela faire subir aux pièces grecques
des remaniements interminables et fort compliqués ;
car les poètes de la nouvelle comédie ne s'étaient guère
gènés pour user et abuser de ce procédé commode, tant au
début qu'au courant de leurs pièces. Pour les monologues
de cette dernière catégorie, il semble que Térence s'est
résigné de bonne grâce à les conserver (1) et qu'il n'a pas essayé d'en remplacer un seul par une scène dialoguée.
(1) On peut en distinguer deux variétés : 1° les a parte, c'est-à-dire les
monologues d'un personnage qui n'est pas seul en scène on les trouve
d'ordinaireau début des scènes; 2° les monologues proprement dits. Ils sont particulièrement nombreux
dans l'Eunuque (I, 2, Gnathon 32 vers ; III, 3,
Chrémès, 24 v. ; III, 4, Antiphon, 10 v. ; IV, 1, Dorias, 14 v. ; IV, 2,
Phaedria, 14 v.; V, 2, Choeréa, 10 v.; V, 4, Parménon, 18 v.) Le plus étendu
de tous est celui de l'Hécyre, III, 3, Pamphile, 54 v.
Mais il crut devoir se comporter tout autrement à l'égard
des monologues initiaux, plus choquants parce qu'ils sont
plus isolés et surtout parce qu'on ne peut pas invoquer pour
les justifier la passion qui, sous diverses formes, s'empare
plus ou moins des personnages, une fois que l'action est
engagée. Il résolut donc en principe de les éviter et il ne
viola qu'une fois cette règle de l'exposition dialoguée. Ayant
choisi pour original Andrienne de Ménandre, il remplaça
le monologue du vieux Simon par une conversation dont la
Périnthienne du même auteur lui fournit le modèle. Les
comédies qui vinrent ensuite, l'Eunuque, l'Hécyre, l'Heautontimorumenos,
avaient déjà dans l'original grec une exposition
dramatique ; et cette circonstance ne fut sans doute
pas sans influencer un peu le choix de l'imitateur latin. Le
Phormion commence, il est vrai, par un monologue ; mais
ce petit discours de Dave ne contient pas le récit du sujet,
il ne sert qu'à préparer la scène suivante où l'exposition se
fera dans un entretien de Géta avec Dave. Quant à la première
scène des Adelphes, elle constitue dans le théâtre de
Térence une exception remarquable : il n'a point fait pour
cette pièce de Ménandre ce qu'il avait fait pour l'Andrienne;
il a conservé, à quelques détails près, le monologue de Micion, qui contient l'exposition. Pourquoi cette dérogation à,
son habitude constante? Peut-être a-t-il essayé de placer
auprès de Micion un personnage protatique un équivalent
de l'affranchi Sosia, mais sans réussir à en imaginer aucun
qui fût dans les conditions voulues pour recevoir avec vraisemblance les confidences du vieillard. Comme la pièce,
malgré cet inconvénient du début, lui plaisait d'ailleurs,
surtout par l'intérêt de la question d'éducation qui s'y pose»
comme elle lui paraissait, dans un temps où la lutte était
vive à Rome entre les vieux principes nationaux et les nouvelles
tendances grecques, avoir beaucoup d'à-propos et
partant des chances sérieuses de succès, il se décida à passer outre. Avec l'âge et l'expérience, sans rien perdre de
leur fermeté, ses convictions littéraires se faisaient sans doute plus tolérantes. Il avait laissé subsister en tête du
Phormion, sa cinquième comédie, un monologue de seize
vers, préambule de l'exposition ; il commença la sixième,
les Adelphes, par un monologue beaucoup plus étendu et,
pour une fois, il profita des ressources de l'exposition narrative.
Mais entre un récit de ce genre fait par un personnage
de la pièce et l'argumenturn raconté par Prologus la différence
est évidente. Micion a qualité pour mettre le public
au courant : appartenant au monde de la fiction et mêlé à
l'intrigue du drame, la connaissance des faits qu'il expose
est toute naturelle chez lui. Il n'a que le tort de se tourner
en parlant vers le public. En cela seulement son monologue ne donne pas l'illusion que le drame doit produire; là est
d'ailleurs la véritable exposition de la pièce, qui n'en a pas
d'autre. Au contraire, l'argumentum de Prologus n'est
point une partie essentielle de la pièce, et ce n'est qu'en
vertu d'une convention grossière que ce personnage, étranger
à l'action et à la fiction, connaît si bien le sujet. Térence,
qui évitait autant que possible les monologues initiaux
comme celui de Micion, ne pouvait manquer de trouver
monstrueuse l'invraisemblance de l'argumentum. Il éprouva
toujours pour cet artifice une répugnance insurmontable ;
malgré l'autorité et le succès de ses devanciers, malgré les
calomnies de ses envieux, il ne confia jamais l'exposition à
Prologus. C'est donc une raison d'art, l'intelligence et le
respect des lois du drame qui a motivé cette innovation.
Nous voyons maintenant pourquoi Térence ne s'est jamais
nettement expliqué à ce sujet. Les considérations
d'ordre littéraire qui furent si puissantes sur son esprit auraient
sans doute été appréciées à leur juste valeur par la
partie lettrée de son auditoire. Mais ce n'était là qu'une
infime minorité. Or l'étude de la polémique des prologues
nous montrera le poète constamment et uniquement préoccupé
de se mettre, soit dans la défense, soit dans l'attaque
à la portée de la majorité qui tenait dans ses mains
le succès. La plupart des spectateurs étaient-ils capables
d'écouter utilement la justification de Térence et mème d'en
saisir le sens ? Entendaient-ils quelque chose à tous ces
scrupules d'écrivain? Se souciaient-ils qu'on mît à composer
une comédie tant de façons et tant de raffinements? Que
la pièce fùt divertissante, ils n'en demandaient pas davantage.
Si elle les amusait, ils applaudiraient et resteraient
jusqu'à la fin ; sinon, ils siffleraient et s'en iraient. Quant
aux mérites artistiques de l'oeuvre, ils ne s'en inquiétaient
guère. Aussi Térence n'eut-il garde de soumettre à leur
approbation les vrais motifs de sa conduite. Il fallait cependant
signaler l'innovation, au risque de choquer un public
accoutumé à entendre l'argumentum toutes les fois que paraissait sur la scène Prologus. C'est ce que fit Térence,
après avoir affirmé que, du jour où il s'était mis en tète
d'écrire, son unique préoccupation avait été de faire plaisir
au peuple ; puis il donna un prétexte qui parut sans doute
spécieux aux ignorants. La réforme fut acceptée du public.
Plus tard, quand les bavardages de ses ennemis le mirent
presque dans la nécessité de parler, il se renferma dans un
sage silence. La bonté de sa cause ne lui semblait pas
douteuse, mais il se défiait de l'intelligence de ses juges.
Nous voyons aussi quelles étaient les intentions primitives
de Térence et ce qu'il aurait fait dans le cas où les circonstances
l'auraient laissé libre d'agir à sa guise. Puisque
les raisons qui amenèrent la suppression de l'argumentum n'ont aucun rapport avec les attaques de Luscius, il est
clair que notre poète qui, de son aveu même, n'écrit de
prologues que pour répondre à ces attaques, n'en aurait
pas composé du tout si nul ne l'eût inquiété. Il ne faut pas
s'étonner que l'idée de cette réforme radicale soit venue à
l'esprit d'un débutant : elle était en réalité beaucoup moins
hardie que le parti où Térence s'arrêta définitivement, et il
y avait moins d'audace à donner des comédies sans prologue
qu'à donner des prologues sans argumentum. Nous
avons parlé tout à l'heure d'un prologue de Plaute qui
ne contient pas l'exposition du sujet, mais c'est un prologue
grec. Un discours de Prologus non consacré en grande
partie à l'analyse de la pièce était peut-être chose inouïe.
Au contraire, les exemples ne manquaient pas de comédies
jouées sans prologue romain. D'abord toutes les comédies
pourvues d'un prologue à figure allégorique, où la captatio
benevolentix trouvait place aussi bien que l'argumentum,
étaient dans ce cas. Il est, en outre, permis de croire que
plusieurs pièces de Plaute, qui nous sont parvenues sans
discours initial de Prologus ou d'une divinité, n'en eurent
pas à la première représentation, le poète s'étant dit que
la popularité de son nom, sans autre recommandation,
concilierait toutes les sympathies à ces oeuvres, d'ailleurs simples et claires. Prologus n'était donc pas un introducteur
obligé, et Térence, à l'époque où il écrivait l' Andrienne,
pouvait sans trop de témérité songer à se passer de ses
services. Il était alors persuadé que le meilleur moyen de
rendre le spectateur attentif et bienveillant, ce serait une
première scène intéressante. Haranguer le public avant la
pièce lui paraissait superflu. Mais il ne tarda pas à reconnaître
que l'usage du prologue avait du bon, que cette
occasion de causer librement avec le peuple n'était pas toujours
à dédaigner. Forcé par des circonstances indépendantes
de sa volonté à revenir sur sa décision première, il
se servit de Prologus dont il avait sans doute voulu d abord
supprimer l'emploi, mais lui réserva un rôle qu 'il pouvait
tenir sans invraisemblance.
Les prologues de Térence ne sont pas autre chose, en
effet, que des plaidoyers en faveur de ses pièces.
Dès le commencement de sa carrière s'engage entre ce
vieux poète et lui une polémique littéraire qui dure presque
jusqu'à la fin. L'adversaire et ses partisans formulent leurs
critiques de leur propre bouche dans les entretiens de la
vie quotidienne. Térence, au lieu de riposter de la même
façon, a l'idée très heureuse de donner à ses réponses une
bien plus grande publicité en les faisant présenter par
Prologus du haut de la scène. Ses prologues nous retracent
donc toute l'histoire de la lutte. Un chapitre spécial sera
consacré à l'examen des accusations qu'on lança contre lui,
des moyens de défense qu'il y opposa, des reproches qu'il
fit à son tour au chef de ses détracteurs. Mais notre but
étant de montrer ici quel fut le rôle du prologue dans Térence, nous devons dès à présent tracer un résumé rapide
de cette polémique.
Lorsque Térence débuta, il y avait à Rome un vieux poète comique dont nous savons le nom par Donat, Luscius
Lavinius ou Lanuvinus, qui compta sans doute un
moment, grâce à la mort récente de Cécilius, régner sans
rival sérieux sur la scène romaine. Avait-il beaucoup de
talent? N'étant guère renseignés sur lui que par son adversaire,
il nous est bien difficile de le juger. Volcatius Sedigitus
le place au neuvième rang dans ce fameux canon où
Térence occupe le sixième. Térence ne lui adresse en
somme qu'une critique sérieuse : il l'accuse de mal écrire,
Le choix qu'il avait fait pour les traduire de deux charmantes
comédies de Ménandre, l'Apparition et le Trésor,
prouve qu'il ne manquait pas d'intelligence et de goût. Ses
pièces réussissaient : Térence est obligé de l'avouer une
fois5 et il ne fait mention d'aucun échec subi par lui. Il
avait un nom, une situation, des relations qui lui permettaient
de connaître avant le public les pièces achetées par
les magistrats et d'assister parfois aux répétitions. Il était
le chef d'une coterie de lettrés qui partageaient ses doctrines
sur l'art dramatique et firent campagne avec lui
contre son jeune rival. Traducteur exact des modèles grecs,
il s'était séparé des anciens comiques romains, de Névius
et de Plaute, dont les imitations lui paraissaient trop libres.
Voilà à peu près tout ce que nous connaissons sur la personne
du poète à qui la disparition de Cécilius semblait
devoir laisser le premier rang. On conçoit qu'il fut désagréablement
surpris de voir surgir aussitôt un concurrent redoutable
par son talent et peut-être plus encore par ses protecteurs.
Les vieux n'aiment pas à être supplantés par les
jeunes : l'amour-propre de Luscius fut blessé quand il sut
qu'un adolescent de dix-huit ans, qui n'était pas de son école et ne travaillait pas d'après sa méthode, avait trouvé
acquéreur pour sa première pièce, quand surtout il dut
s'avouer, ayant pris connaissance de l'oeuvre, qu'elle était
bonne et taillée pour réussir. De plus, ses intérêts pécuniaires
étaient en jeu : il n'y avait pas à Rome dans l'année
beaucoup de représentations dramatiques ; la vente de ses
pièces pouvait donc être entravée par les succès d'un
nouveau poète ; elles subiraient au moins une diminution
de valeur, du moment qu'elles seraient sur le marché en
présence de productions rivales. Avec plus de noblesse de
sentiments et moins d'âpreté au gain, Luscius aurait fait
bon accueil à son jeune confrère. Mais, au lieu d'imiter la
conduite de Cécilius il n'écouta que les mauvais conseils
d'une double jalousie, littéraire et mercantile ; il s'efforça
méchamment d'arrêter le débutant par une chute à l'entrée
de la carrière.
Il avait compté sans la hardiesse de Térence, qui, mis au
courant des critiques dirigées contre sa pièce, se fit une
arme du prologue et s'en servit avec autant de vigueur que
d'habileté pour se défendre d'abord et bientôt après pour
attaquer à son tour. Le prologue de l'Andrienne est consacré
tout entier à la polémique. Il contient un exposé des
circonstances qui ont amené l'auteur sur ce terrain (1-7),
une réponse énergique au grief de contamination lancé par
les adversaires, avec des paroles très dures pour toute la
coterie et des menaces collectives de représailles (8-23) ;
enfin un appel à l'impartialité du public, que le poète prend
pour juge dans le débat (24-27). Il sortit vainqueur de ce
premier engagement. Mais ses ennemis ne désarmèrent pas.
Tout au contraire, la jalousie de leur chef se compliqua dès
lors de rancune, parce qu'il avait été malmené, et de dépit,
parce qu'il avait été vaincu.
Luscius étant revenu à la charge contre l'Eunuque. Térence employa cette fois encore tout son prologue à lui
répondre. Comme son vieux rival se plaignait d'avoir été traite avec une rigueur excessive, il
protesta d'abord que son désir était de blesser le moins de
gens possible ; attaqué, il avait riposté, voilà tout. Enhardi
par son premier succès, avant de se défendre contre les critiques
de Luscius, il l'accusa lui-mème. Puis il réitéra ses
menaces, sous une forme personnelle cette fois. Cela fait,
il réfuta l accusation de plagiat qu'on lui avait intentée. Il
remporta ce jour-là une nouvelle victoire, plus brillante
encore que la première.
Au point de vue de la matière, le seul qui nous occupe
ici, le prologue de l 'Heautontimorumenos se distingue
sensiblement des deux précédents. C'est encore un plaidoyer
en faveur de Térence; mais la polémique n'y entre
que pour un tiers environ (16-34). Les idées exprimées
dans les deux parties restantes ne sont pas de même nature.
Dans l'une (1-15), Ambivius, le vieil acteur aimé du public, expose que c'est précisément à cause de son influence
sur les spectateurs que le poète lui a confié par extraordinaire
le rôle de Prologus ; dans l'autre (35-52), prêtant à
Térence l'appui de sa popularité, il fait valoir au profit de la
pièce qu'il va jouer des recommandations d'ordre tout personnel. Cette différence si marquée entre le contenu de
deux prologues consécutifs, s'explique par l'échec de l'Hécyre.
Notre poète ne s'était inquiété d'abord que des calomnies de son rival; l'expérience lui a démontré qu'il fallait
redouter bien plus encore les caprices du public. Malgré
les manoeuvres de Luscius, l'Andrienne et l'Eunuque
avaient pleinement réussi ; l'Hécyre échoua parce que, au
moment de la représentation, la foule, attirée ailleurs par
des spectacles plus conformes à ses goûts, ne consentit pas à l'écouter. Donc il ne suffisait pas toujours, pour la rendre
attentive et favorable, de lui prouver l'injustice des reproches faits à la comédie qu'on lui présentait. Aussi Térence
effrayé eut-il recours, sans abandonner ses moyens ordinaires,
à un artifice exceptionnel qu'il crut plus efficace. D'ailleurs, dans la partie de ce prologue consacrée à la polémique,
on voit que la tactique de ses adversaires s'était
modifiée. Soit que l'Heautontimorumenos n'ait pas donné
de prise à leurs critiques, soit qu'ils aient reconnu aux deux
premiers succès de Térence l'impuissance d'un système
d'attaques dirigées contre une pièce en particulier, les accusations
qu'ils produisent ici ont une portée générale :
elles visent toutes les comédies déjà données par le nouveau
poète. Il semble donc que leur but est maintenant,
non pas d'infliger à l'ennemi un échec immédiat et décisif,
mais de saper lentement sa réputation et de compromettre
son avenir. Ils ont perdu l'espoir de l'arrèter et de l'abattre
d'un seul coup ; ils gardent celui d'user son courage par
d'incessantes tracasseries (1).
(1) II me semble que Térence a signalé ce changement de tactique dans les premiers vers du prologue du Phormion. Ne pouvant arracher le jeune poète à ses occupations (en faisant échouer ses pièces) et le réduire à l'inaction (parce qu'alors ses oeuvres ne trouveraient plus d'acquéreur), Luscius s'apprête à le dégoûter par ses médisances du métier d'écrivain. Cf. les vers 13-19 du second prol. de l'Héc, où il est question des échecs de Cécilius. Les manoeuvres iniques de ses adversaires faillirent l'arracher à ses occupations de poète comique ; si, au lieu de lui témoigner la plus active sympathie, Ambivius s'était alors montré froid et dédaigneux, il l'eût facilement dégoûté d'écrire .
A cet effet, ils reprochent d'abord
à Térence de s'être rendu plusieurs fois coupable du délit
poétique de contamination ; à ce grief réédité succède une
accusation toute neuve : Luscius insinue que les amis du
jeune poète collaborent à ses pièces. Térence riposte en
quelques mots à cette double attaque et prend ensuite l'offensive,
qu'il menace de ne point quitter si l'adversaire ne
cesse les hostilités. Dans le prologue de l'Eunuque, il avait
suivi l'ordre inverse, provoquant avant de se défendre. Ici
il manoeuvre avec moins d'audace, parce qu'il a perdu, depuis
l'échec subi, sa belle témérité d'autrefois. Le prologue du Phormion nous montre les détracteurs
de Térence fidèles à leur nouveau plan de campagne. Ils ne
lui adressent ici encore que des critiques générales, l'une
relative au ton de ses comédies, l'autre à la composition de
ses prologues. Sa riposte ne contient pas de partie agressive
distincte ; seulement au premier de ces deux reproches
il répond en signalant dans une pièce de Luscius le défaut
contraire. Il y a un autre trait de ressemblance entre le
prologue du Phormion et celui de l'Heautontiinoruînenos:
c'est que la polémique n'en fait pas tous les frais ; le dernier
tiers du morceau est un appel à la bienveillance des
spectateurs avec une allusion à l'échec, déjà réparé d'ailleurs,
de l'Hécyre ; on y reconnaît, quoique moins évidente
et moins inquiète, la préoccupation, que nous signalions
tout à l'heure, des caprices du public et de ses impressions
du moment.
Dans le prologue des Adelphes, au contraire, il n'y a pas
autre chose que de la polémique. Térence, rassuré par plus
d'un succès, n'éprouve pas le besoin d'implorer longuement
l'attention et la sympathie. Peut-être même se montre-t-il
plus confiant qu'il ne l'est au fond, précisément parce qu'il
va bientôt tenter un coup hardi, la reprise de l'Hécyre. Au
début de la lutte, les adversaires ne produisaient qu'un grief
contre chaque pièce. A partir de l'Heautontimortimenosils
les ont groupés par deux, essayant de rémédier par le
nombre au défaut de précision des attaques. Nous en découvrons
ici jusqu'à trois. Il est vrai que des trois pas un
seul n'est inédit. Quant à leur nature, deux sont généraux :
celui qui a trait aux prétendus collaborateurs de Térence et
celui qui vise la composition de ses prologues ; le troisième est spécial aux Adelphes : c'est une accusation de plagiat..
On voit par là qu'à ce moment le parti de Luscius combina
ses deux systèmes d'attaque ; la pièce nouvelle prètait le
flanc à une critique précise ; ils en ont profité pour déployer contre elle toutes leurs ressources. Autre particularité
à relever : Térence, qui, dans tous les prologues antérieurs
à celui-ci, consacre une mention distincte au chef de la coterie,
ne se sert plus dans le prologue des Adelphes et dans
les suivants que d'une désignation collective. Du moment
que la personnalité de l'adversaire principal a disparu du
prologue, plus de représailles, plus de menaces ; notre poète
ne sort pas de la défensive. Mais à quoi faut-il attribuer ce
changement d'attitude ? Est-ce un effet de l'âge, qui a calmé
sa fougue et son irritabilité ; de l'expérience, qui lui a démontré, en même temps que l'impuissance des propos méchants
à compromettre le succès de ses oeuvres, celle de ses
menaces et de ses ripostes à empêcher les mauvaises langues
de jaser; enfin, des sages conseils de ses amis, qui l'ont
exhorté à faire acte de magnanime modération ? Ces suppositions
sont toutes vraisemblables. Le prologue du Phormion,
où l'attaque n'est pas indépendante de la défense, où
il n'est pas dit d'une façon positive que les représailles
continueront, ménage assez bien la transition. Mais il se
peut aussi que la mort de Luscius, survenue avant la représentation
des Adelphes, ait ôté à Térence le moyen de
rendre coup pour coup. Dès lors en effet, qui restait en ligne?
Les gens de l'entourage, adversaires de petite taille, contre
lesquels on ne pouvait décemment partir en guerre, à supposer qu'aucun d'eux fût poète et par conséquent sujet à la
critique littéraire.
Quoi qu'il en soit, le prologue des Adelphes fut, du côté
de Térence, le dernier acte de polémique. Il ne faudrait pas
se hâter d'en conclure que ses détracteurs furent les premiers
à poser les armes et ne tentèrent rien pour faire
échouer les deux reprises de l'Hécyre. Cela n'est pas en
soi très probable. Quand le second prologue de cette pièce
nous les montre prèts à se réjouir d'une défaite essuyée par
leur ennemi,nous serions plutôt tentés de croire qu'ils firent
de leur mieux pour la préparer. Mais alors, pourquoi Térence
garda-t-il, contrairement à son habitude, le silence
sur ces manoeuvres ? Parce que l'effet qu'elles pouvaient
avoir sur les dispositions du public lui parut à bon droit insignifiant
en comparaison de l'influence fâcheuse qu'exercerait
nécessairement le souvenir du passé de la pièce; ce
fut donc cette influence qu'il s'appliqua à détruire. Il défendit
l'Hécyre non contre les critiques de ses adversaires,
qui semblent n'avoir été pour rien dans son double échec ;
mais contre le dédain du public, qui lui fit deux fois un
accueil si décourageant. A ce dédain il opposa d'abord
l'assurance. Son prologue de la première reprise, très court
et très ferme de ton, mentionne simplement le malheur qui
est arrivé à la pièce dans sa nouveauté, puis le motif qui a
poussé l'auteur à ne pas essayer tout de suite après une
seconde représentation: le désir et l'espoir de revendre sa
comédie pour d'autres jeux comme pièce nouvelle. Mais
dans le prologue de la deuxième reprise, il mit en oeuvre
les plus adroites et les plus pressantes instances. Le vieil
Ambivius, chargé encore une fois de haranguer les spectateurs,
leur adressa un éloquent discours en trois points.
D'abord il prouva, par l'exemple des premières pièces de
Cécilius, applaudies après avoir été situées, que du fait
qu'une comédie a échoué il ne faut pas toujours conclure qu'elle est mauvaise ; puis il montra que cette conclusion
serait fausse appliquée au cas de l' Hécyre, parce que son
double échec n'était imputable qu'à des circonstances extérieures
; enfin, s'étant donné pour tâche de rendre à Térence
le mème service qu'à Cécilius, il réclama la faveur
du public pour la pièce malheureuse, au nom des intérêts
de l'art dramatique et surtout au nom de sa propre popularité.
De cette analyse sommaire il résulte que Térence, non
content d'avoir supprimé l'un des éléments du prologue romain,
l'argumentum, changea la nature de l'autre, de la
captatio benevolentix. Pour nous faire une idée de ce
qu'était avant lui cette partie si importante du discours
préliminaire, nous n'avons, il est vrai, que les prologues
romains de Plaute, dont les moins discutables sont d'une
authenticité douteuse. Mais quel qu'ait été le contenu de
ceux que Plaute lui-même écrivit, nous sommes assurés
qu'ils se distinguaient nettement par là des prologues de
Térence : quand les amis de Luscius affimaient que notre
poète, livré à ses propres ressources, n'aurait pu composer
un seul prologue, ils ne prétendaient certainement pas le
faire passer pour incapable d'écrire un argumentum, un
simple résumé de la pièce ; la chose était par trop facile ;
ce qu'ils lui refusaient, c'est une imagination assez riche,
une verve assez féconde pour inventer une harangue intéressante,
comme celles de Plaute, où s'encadrerait le récit.
Si, d'ailleurs, on tient compte de la tournure d'esprit que
révèlent les comédies de Plaute, on se persuade aisément
que les prologues actuels sont une image assez fidèle des
vrais prologues ; et je crois pour ma part que, si nous venions
à retrouver ceux-ci, nous serions souvent surpris de
les voir si peu différents de ceux-là. Des traits grossis outre
mesure, de la prolixité, des allusions aux réformes théâtrales
accomplies dans la première moitié du septième siècle,
voilà à peu près tout ce dont les auteurs des remaniements
ont surchargé le fond de Plaute; mais ils ne l'ont pas essentiellement altéré : par la qualité du comique les prologues
sont dignes des pièces. On peut donc affirmer que
dans les prologues de Plaute (1) la captatio benevolentix était formée surtout de plaisanteries qui égayaient l'auditoire
; de loin en loin une sentence, un lieu commun de
morale pratique charmait le gros bon sens des spectateurs ;
parfois une adroite flatterie chatouillait leur vanité ou leur
patriotisme ; il se peut bien aussi que le poète, comme
l'avaient fait avant lui les comiques grecs, ait consacré de
temps en temps quelques vers à l'éloge de sa pièce.
(1) Je parle ici des prologues romains. Du reste les libertés que le poète y prenait ont réagi sur la composition des prologues grecs. Cf. celui d'Amphitryon.
Hormis ce dernier moyen, tous ceux dont se servait Plaute
pour gagner la sympathie du public étaient, on le voit,
étrangers à sa personne et à ses oeuvres, extérieurs, indirects
; ses prologues étaient beaucoup plus impersonnels
que ceux de Térence, où il n'est question que de l'auteur,
de ses amis et de ses ennemis, de ses pièces., de leurs interprètes
et de leur fortune, où la recommandation, en un
mot, est toujours directe. Pour trouver dans le théâtre de
l'antiquité classique un emploi de la captatio benevolentiae
personnelle comparable à celui qu'en a fait Térence, il faut
remonter jusqu'à la comédie ancienne. Dans les parabases
d'Aristophane, la longue tirade du début est ordinairement
un appel à la faveur du public ; le thème que le poète y
développe de préférence, c'est son propre éloge tiré le plus
souvent de l'énumération des services rendus par ses comédies
aux Athéniens. Cette partie de la parabase a donc des
allures de panégyrique; c'est là, au point de vue du contenu,
malgré le caractère général de ressemblance que nous
venons d'indiquer, ce qui la distingue du prologue de
Térence, plus modeste de ton et de pensées, comme il sied
à un plaidoyer. Les deux sources où Térence puise à peu près toute la
matière de ses prologues, sont la polémique contre Luscius
et l'intervention d'un acteur influent ; la première lui fournit
le contingent d'idées de beaucoup le plus considérable et le
plus original. Faire par la bouche de Prologus son apologie
et le procès de son accusateur était, en effet, une chose
absolument nouvelle. Le reproche de stérilité encouru par
notre poète précisément à cause de cela et l'insistance avec
laquelle il montre que les provocations de ses adversaires
l'ont mis dans l'obligation de se défendre, prouveraient
tout au moins qu'il agissait contrairement à l'usage. Mais il
faut aller plus loin, et l'on ne saurait guère admettre qu'avant
Térence le prologue romain ait été employé, mème à
titre exceptionnel et partiellement, à la polémique : dans le
cas contraire, lui qui aime tant à se couvrir de la protection
des vieux comiques n'eût pas négligé de citer ici leur exemple.
Est-il donc le premier qui ait eu maille à partir avec
la jalousie, et l'idée d'un expédient si nouveau lui fut-elle
suggérée par les embarras d'une situation où nul de ses
devanciers ne s'était jamais trouvé ? Il faudrait ètre bien
optimiste pour supposer que les envieux leur manquèrent à
tous ; d'ailleurs, si l'on s'en rapporte aux termes d'un vers
du second prologue de l'Hécyre 2, on voit que Cécilius eut
lui aussi ses ennemis dont les intrigues ne furent pas étrangères
aux revers qu'il éprouva d'abord. Mais il ne s'avisa
pas de s'armer du prologue pour les déjouer ; il laissa
l'honneur de cette transformation à Térence, inspiré sans
doute par la crainte d'un sort pareil au sien et plus hardi
que lui. Nous admettons, cela va sans dire, que les prédécesseurs
grecs et romains de notre poète ont pu parfois dans
le prologue lancer quelque trait satirique contre leurs concurrents
; il nous paraît mème difficile qu'une rivalité littéraire
comme celle dont l'histoire a gardé le souvenir entre Ménandre et Philémon n'ait pas donné lieu à un certain
nombre de petites méchancetés de ce genre. Mais ce ne
furent là que de rares et courtes attaques perdues dans l'ensemble
d'un prologue, toujours plus ou moins indirectes,
dissimulées le plus souvent sous le voile d'une allusion. Il
y a loin de pareilles escarmouches à la guerre régulière,
ouverte et suivie de Térence contre Luscius. On lui comparerait
plus justement la polémique d'Aristophane contre
Euripide ; encore faudrait-il se garder de serrer le rapprochement
de trop près, sous peine d'ètre frappé beaucoup
moins par les analogies que par les différences ; notons seulement
les deux principales: cette polémique a un caractère
constamment offensif ; elle se produit à un endroit quelconque
de la pièce. En somme, Térence n'a imité personne :
il a inventé; il n'a pas trouvé de guide dans le passé : il s'est
frayé hardiment son chemin.
Au contraire, lorsqu'il fait intervenir Ambivius recommandant
par des considérations toutes personnelles la pièce
et le poète, on peut dire qu'il suit, quoique de loin et en
imitateur original, la trace de ses devanciers. Dans les
prologues grecs à figures allégoriques, la présence seule
d'une divinité ne constituait-elle pas une sorte de recommandation
? Un être du monde supérieur avait daigné se
déranger pour descendre sur la scène et faciliter au poète
par son concours la tâche pénible de l'exposition. N'était-ce
pas lui donner un témoignage flatteur de sympathie et engager
du mème coup le public à imiter un exemple parti de si
haut ? D'ailleurs, le dieu ne bornait pas toujours à cela ses
démonstrations d'amitié. Parfois il faisait explicitement
l'éloge du poète, et cet éloge acquérait une grande valeur à
sortir d'une bouche surnaturelle. Il est bien clair que la
raison des spectateurs n'était pas dupe d'un tel artifice ; il
arrivait mème que les divinités-prologues prenaient soin de
dissiper l'illusion en montrant l'acteur sous le personnage
dont la fiction dramatique l'avait revêtu : ainsi fait, par
exemple, le Mercure de l'Amphitryon. Mais, malgré tout, l'imagination était charmée. La vue du céleste messager,
l'énumération de ses attributs, l'intérêt qu'il montrait pour
l'auteur de la comédie produisaient une impression favorable (1).
(1) Quant à Prologus, il faisait de son mieux par sa belle humeur, n'ayant pas d'autre titre à la considération du public.
De même Aristophane a tiré plus d'une fois, dans
la parabase, une recommandation de la personnalité du
choeur. Les Nuées et les Oiseaux promettent leurs bienfaits
aux spectateurs s'ils couronnent sa pièce ; les Chevaliers
affirment que tout autre poète les eût difficilement décidés à
paraitre et à prendre la parole sur le théâtre : c est à un
mérite exceptionnel, à sa haine courageuse des méchants
qu'Aristophane doit cette marque de bienveillance.
Voilà de quels précédents pouvait s'inspirer Térence.
Ce qui fait son originalité, c'est qu'Ambivius est à la fois
le personnage et l'acteur du prologue. La recommandation
est faite non par une individualité née de la fantaisie du
poète, mais par une personne réelle que le public connaît et
estime ; elle résulte non d'une sorte d'agréable erreur où
la fiction induit l'esprit qui se laisse faire, mais d'un ensemble
de solides motifs sur iesquels on appelle son attention
réfléchie ; ce n'est point à l'imagination du spectateur qu'elle
s'adresse, c'est à sa raison.
D'ailleurs, cette qualité est commune à toutes les idées
exprimées dans les prologues de Térence. S'il ne cherche
pas à séduire ses auditeurs par des prestiges poétiques, il ne
tente pas non plus de les gagner en provoquant leurs éclats
de rire ou en caressant leur vanité. Il leur parle toujours
d'un ton simple et sérieux ; il fait appel à leur intelligence
et à leur impartialité ; il vise à conquérir leur estime. Il
marche donc au même but que ses devanciers par un chemin
tout différent. Aristophane et Ménandre sont des magiciens
qui charment un public fin et artiste par tous les
enchantements de la poésie ; Plaute est un saltimbanque
de grand talent qui allèche une troupe d'ignorants et de badauds par les bouffonneries d'un boniment; Térence est
un plaideur qui, menacé par ses ennemis dans ses intérêts
les plus chers et fort de la bonté de sa cause, soumet des
moyens positifs de défense à l'équité de ses juges et les
fait valoir par toutes les ressources de l'art oratoire.
Eu résumé, jusqu'à Térence, malgré toutes les altérations
subies, malgré le mélange d'éléments étrangers dont la
quantité alla toujours croissant, le prologue avait gardé
quelque chose de sa nature primitive, telle que la définit
Aristote. Le temps avait singulièrement changé sa physionomie;
mais à certain trait caractéristique on pouvait encore
la reconnaître. Il en était venu d'abord à ne plus être uniquement
l'exposition, plus tard à ne plus être la véritable
exposition : le drame pouvait se passer de lui. Pourtant
même ainsi il dépendait essentiellement du drame, parce
qu'il contenait l'analyse sommaire du sujet, l'argumentum.
Ce lien intime qui avait résisté à toutes les secousses, Térence
le rompit. Entre chacun de ses prologues et la pièce
correspondante, il n'y a qu'un rapport accidentel ; la matière
en est fournie non par le contenu même de la pièce,
mais par les circonstances qui ont accompagné son apparition.
Si Luscius n'avait pas lancé contre l'Andrienne le
reproche de contamination, cette comédie n'aurait pu avoir
le prologue qu'elle a ; si le public romain n'avait pas dédaigné
deux fois d'écouter l'Hécyre, le beau discours d'Ambivius,
qui servit de prologue à la deuxième reprise, n'aurait
pu être écrit. De cette innovation découla une conséquence
capitale que nous avons déjà notée : les prologues des
poètes dramatiques antérieurs à Térence pouvaient servir
autant de fois que leurs pièces avaient de représentations ;
ceux de Térence furent écrits en vue d'une représentation
donnée, la première en général, et ne conviennent à aucune
autre. Dans l'évolution du prologue, déjà si riche en particularités
intéressantes, il inaugura, par la manière dont il
en conçut le rôle, une phase toute nouvelle.
III
Pour compléter notre étude sur le rôle du prologue dans
le théâtre de Térence, il nous reste encore un problème à
résoudre. De nos jours, au moment où commence une représentation
dramatique, chacun sait déjà dans la salle,
par une affiche ou quelque écrit du même genre, le titre de
la pièce, le nom de l'auteur et certains autres détails. Les
spectateurs des comédies de Térence étaient-ils munis d'informations
semblables ; et, s'ils les possédaient, d'où leur
venaient-elles ? Les devaient-ils, en totalité ou en partie,
habituellement ou par exception, au prologue de la pièce ?
En ce qui concerne le nom de l'auteur, fussions-nous
absolument dépourvus de preuves écrites, nous aurions
pourtant la certitude qu'en Grèce et à Rome, aussi bien que
de nos jours, il était communiqué de quelque façon au
public avant la représentation. Se figure-t-on en effet un
peuple tel que les Athéniens assistant, sans le savoir, à un
drame de Sophocle, d'Aristophane ou de Ménandre ? En
matière de poésie, le public romain n'était pas, tant s'en
faut, un juge aussi éclairé ni un amateur aussi passionné ;
néanmoins, le nom du poète dont il venait voir la pièce
était loin de lui ètre indifférent : tous les auteurs ne lui
procuraient pas au même degré le plaisir qu'il demandait
au théâtre. Quand un nom était populaire, il constituait
donc à lui seul une recommandation et une garantie; dans
ce cas, on ne manquait sûrement pas de le faire connaître
pour exciter la curiosité et l'attention; et, si le poète était
un inconnu, il fallait encore le nommer, de peur que l'absence
de ce renseignement préalable ne fût prise pour une
marque de médiocre confiance en la valeur de l'oeuvre. Ainsi soyons assurés que cet usage fut importé de Grèce à
Rome en même temps que la comédie. Térence, le trouvant
établi, eut des raisons particulières de le maintenir : ses
prologues, véritables plaidoyers, n'auraient eu aucune efficacité,
n'auraient même pas été intelligibles pour les spectateurs,
si, au moment où on les prononçait, ils avaient
ignoré le nom de celui qui réclamait de leur équité une
sentence favorable. Ils devaient nécessairement en être informés
au plus tard dès le début du prologue.
Nous ne saurions, au contraire, affirmer que le titre des
oeuvres dramatiques ait eu en Grèce, avant leur première
représentation, une publicité officielle. Aucun texte n'est là
pour le prouver, et l'on ne voit pas d'ailleurs qu'une indication
de cette nature fût indispensable. Ce qui attirait les
Athéniens au théâtre, c'était, quand on donnait des tragédies,
l'amour des beaux vers harmonieux composés sur les vieilles
légendes familières à tous ; s'il s'agissait de comédies,
c'était, au temps d'Aristophane, la discussion libre et hardie
des plus graves questions politiques ou sociales à l'ordre
du jour, les virulentes satires personnelles et les ingénieuses
créations d'une riche fantaisie ; au temps de Ménandre,
les fines études du coeur humain en style élégant et pur. Peu
leur importaient en général le sujet précis et encore moins
le nom de la pièce. Aussi voyons-nous que leurs poètes ne
se mirent pas l'esprit à la torture pour chercher des titres à
effet ; ils ne se firent même pas scrupule d'en reprendre
qui avaient déjà plusieurs fois servi, comptant sur l'autorité
de leur nom, connu et aimé du public, bien plus que sur les
promesses d'un titre piquant et inédit. Mais il n'en fut plus
de même, lorsque, l'époque de production féconde une fois
passée, on reprit des pièces anciennes. Le titre eut dès lors
son importance et sans doute on le publia pour allécher
ceux qui connaissaient déjà la pièce par une représentation
antérieure, par la lecture ou simplement par ouï-dire. Cet
usage existait, n'en doutons pas, dans les villes de la grande
Grèce, à l'époque de Livius Andronicus. Quand ce poète donna la première fabula palliata, il fit à Rome ce qu'il
avait toujours vu faire à Tarente. Ses successeurs l'imitèrent,
non pas seulement pour se conformer à la tradition,
mais encore et surtout pour montrer aux spectateurs, en
leur livrant un titre inconnu d'eux, que la pièce était nouvelle,
c'est-à-dire qu'elle reproduisait une comédie grecque
non encore traduite ; renseignement auquel ils attachaient
la plus grande importance. De plus, comme beaucoup de
titres appartenaient à plusieurs pièces du répertoire grec,
pour éviter toute confusion, les comiques romains furent
obligés de faire connaître, en même temps que leur nom,
celui de l'auteur original. A cette raison peut-être faudrait-il
en ajouter d'autres, du moins en ce qui concerne Livius
Andronicus : des scrupules de probité littéraire et de modestie
qui lui défendaient de se donner pour autre chose
que le traducteur des maîtres, et l'espoir, assez illusoire sans
doute, que ses pièces, présentées sous ce patronage auguste,
s'imposeraient plus sûrement à l'attention du public.
La série des renseignements fournis au public romain à
l'époque de Térence devait comprendre aussi le nom du
directeur de troupe. Pour les Athéniens, du moins aux
beaux jours de leur théâtre, la distribution des rôles d'une
pièce n'était qu'un détail d'une importance secondaire : ils
s'intéressaient bien plus aux beautés de l'oeuvre elle-même
qu'aux mérites de l'interprétation, et la renommée du poète
avait sur leurs esprits un pouvoir autrement considérable
que celle des acteurs. Pour les Romains, beaucoup moins
sensibles au charme littéraire, le jeu des histrions était
presque le principal attrait d'une représentation dramatique.
Quand on voit que le vieux directeur Ambivius avait
acquis assez d'ascendant sur les spectateurs pour leur recommander
un poète, n'est-on pas obligé de reconnaître
qu'il y avait utilité à leur désigner par le nom de son chef
la troupe qui allait jouer devant eux ? Cette indication prit
place dans l'annonce théâtrale probablement dès le temps
de Névius, qui, en sa qualité de citoyen romain, ne pouvait,
comme Andronicus, ètre lui-même l'acteur de ses drames. Dans l'antiquité classique, toute pièce de théâtre était
donc précédée d'une communication aux spectateurs, d'une
annonce dont le contenu varia avec les temps et les pays.
Mais quels furent les rapports de cette annonce avec le
prologue ? En Grèce, il n'y en eut jamais aucun. Ni dans
les tragédies d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, ni dans
les comédies d'Aristophane, il n'est fait mention du nom de
l'auteur ; et le contraire, au moins de la part des tragiques,
nous surprendrait et nous choquerait comme la plus grossière
des invraisemblances. Si Ménandre et ses confrères
n'avaient pas eu d'autre moyen de publicité, ils auraient pu à
la rigueur introduire leur nom dans ces discours de personnages
allégoriques, qui servent de prologues à un grand
nombre de leurs drames : du moment qu'une divinité faisait
l'éloge du poète, rien ne l'empêchait plus de le nommer.
Mais ils n'en furent pas réduits à cette ressource, et, autant
qu'on en peut juger par les prologues grecs de Plaute, où
le nom de l'auteur latin ne se trouve généralement pas,
non plus d'ailleurs que celui de son modèle, ils semblent
n'en avoir profité qu'à titre de rare exception. La présence
de leur nom dans le prologue n'était alors qu'une répétition.
Presque toujours ils se bornaient à des indications
par périphrases, comme celles que nous rencontrons çà et
là dans le passage du Pseudologiste où Lucien a imité un
prologue de Ménandre. Plus tard, lorsqu'on reprit leurs
pièces, ce fut nécessairement avec les mêmes prologues qui
en faisaient partie intégrante, de sorte qu'il fallut toujours
par une autre voie procurer au public les renseignements
préliminaires. A Rome, jusqu'au temps de Térence, l'annonce théâtrale fut également indépendante du prologue.
Parmi les prologues actuels de Plaute, il est vrai qu'il y en
a plusieurs qui contiennent des indications de ce genre, trop complètes et trop précises pour permettre de supposer
qu'aucune des représentations auxquelles ils ont pu servir
ait été précédée d'une autre communication au public
Mais ce sont justement pour la plupart les moins autentiques, et, en particulier, les passages où se trouvent ces renseignements présentent le plus souvent des marques certaines
d'interpolation. Pour les autres pièces, il faut bien
admettre l'existence d'une publication antérieure aux premiers
vers; et, puisque la représentation de ces pièces n'eut
pas lieu, à notre connaissance, dans des conditions exceptionnelles,
l'annonce distincte du prologue était de règle au
temps de Plaute.
Quand il fit jouer l'Andrienne et l'Eunuque, Térence se
conforma en tout point à l'usage existant : ses spectateurs
connurent avant le prologue le titre de la pièce et le nom
des deux poètes, aussi bien que celui du chef de troupe.
D'abord, en effet, ni dans l'un ni dans l'autre, Térence
n'est désigné nominativement. « Poeta, hic, hic noster,
poeta hic », telles sont les expressions très vagues dont se
sert Prologus en parlant de lui. Ainsi une publicité officielle
avait déjà été donnée à son nom ; car il ne pouvait compter,
pour mettre les intéressés en possession de ce renseignement
indispensable, sur les indiscrétions de ses amis, des
acteurs, des magistrats ou autres personnages acquéreurs
de la pièce, moyen de publicité aussi peu sûr que restreint.
Le nom de l'acteur principal ou chef de troupe ne figure
pas davantage dans les deux prologues. On y trouve, il est
vrai, le nom du poète original et le titre de la pièce, qui est le même en grec qu'en latin. Mais Térence ne les donne
qu'en passant, à propos d'autre chose, sans les mettre assez
en relief pour y appeler l'attention. Dans le prologue de
l' Andrienne les mots « Andria, » et « Menandri » sont forcément
amenés par le courant des explications que le poète
fournit sur le grief de contamination, et ne s'en détachent
point. Dans celui de l'Eunuque, en racontant l'incident
provoqué par Luscius à la répétition, pour démontrer que
l'accusation de plagiat est fausse, que la pièce présente n'est
pas une comédie ancienne, c'est-à-dire déjà reproduite en latin par d'autres poètes, le Colax de Ménandre, il décline
le véritable titre de l'original. Mais les mots « Menandri
Eunuchum » ne sont encore ici qu'un moyen de démonstration
: le poète ne les y a pas mis pour eux-mêmes. Dans
ces deux cas, si Térence avait eu à donner ces indications à
des spectateurs non encore renseignés, rien ne lui aurait
été plus facile que de les placer en vedette, comme il le fit
dans d'autres prologues. Nous verrons tout à l'heure bien comme la différence est frappante entre les passages que nous
venons d'examiner et ceux auxquels nous faisons maintenant
allusion.
Il nous reste à savoir de quelle façon les spectateurs de
l'Andrienne et de l'Eunuque reçurent leurs informations
avant le prologue. Ici encore, pour acquérir la notion exacte
de ce qui se passait au temps de Térence, il n'est pas inutile
de remonter jusqu'aux origines du théâtre classique.
Les représentations de tragédies étaient à Athènes des solennités si importantes qu'on s'en préoccupait et qu'on en parlait longtemps à l'avance. La curiosité et l'impatience
de toute une ville étaient en éveil. Mème s'il n'était pas donné de publicité, par voie d'affiche ou autrement, à la
décision des magistrats qui choisissaient les poètes admis
au concours et leur accordaient un choeur, mème si les noms des concurrents n'entraient pas dans la proclamation du
héraut qui annonçait l'ouverture de la fète, il ne pouvait leur arriver de rester secrets jusqu'au grand jour. Lorsque
les Athéniens prenaient place au théâtre de Dionysos, ils
ignoraient donc seulement l'ordre, déterminé sans doute
par le sort et séance tenante, où les oeuvres de chaque poète
se produiraient. Le héraut n'appelait les concurrents qu 'individuellement
et à mesure que leur tour de représentation
était venu. Dicéopolis se rendit un jour au théâtre, sachant
qu'il y avait au programme des tragédies d'Eschyle et
espérant qu'on allait les donner tout de suite. Il fut vivement
désappointé quand il entendit le héraut crier : « Théognis,
fais entrer ton choeur, » Tel était l'usage pour la
tragédie ; pour la comédie ancienne, selon toute vraisemblance,
les choses se passaient de même, et rien n'empêche
de croire que la façon traditionnelle de procéder se maintint
ou à peu près pendant la période de la nouvelle comédie
et aussi pendant les siècles suivants, du moins en ce qui
concerne les représentations qui faisaient partie des solennités
publiques à concours dramatiques. Ainsi sans doute
faisait-on encore à Tarente au temps d'Andronicus.
A Rome, à l'époque de Térence, un édit des magistrats
présidents, ou un avis émanant des particuliers qui faisaient
les frais des jeux, annonçait au peuple, par la bouche du
héraut ou par le moyen d'affiches, l'ouverture de la fète.
Il contenait peut-être une liste succinte des divertissements
qui seraient offerts, mais sans indiquer exactement l'ordre
des spectacles. Aux jeux funèbres de Paul-Emile, où fut donnée la première reprise de l'Hécyre, lorsque le public
prit place pour assister à la pièce, il ignorait qu'elle serait
suivie d'un combat de gladiateurs. La nouvelle s'en répandit
durant le premier acte, mais ce ne fut qu'un simple
bruit, « rumor ». La proclamation officielle avait donc été
différée jusqu'au dernier moment, afin que l'attente du
spectacle annoncé ne nuisit pas à l'effet du spectacle présent.
Dans l'annonce générale qui précédait l'ouverture de
la fête, on pouvait fort bien, en admettant qu'elle fut énumérative,
introduire, parmi d'autres détails propres à attirer
la foule, le nom du poète et celui du directeur de troupe,
s'ils étaient populaires; sinon peut-être les réservait-on.
Mais qu'ils eussent été ou non communiqués alors, il fallait
nécessairement les proclamer au moment où, dans la
série des jeux, arrivait le tour de la pièce et en même temps
que l'on livrait au public les indications jusque-là inconnues
de lui, c'est-à-dire le titre de la pièce et le nom de
l'auteur grec, détails qui n'ont pu être utilement fournis
que tout de suite avant la représentation. Cette seconde
annonce, spéciale et plus complète, était plus que jamais
nécessaire dans les cas où l'on donnait, au courant des
mêmes jeux, plusieurs pièces, soit d'un seul auteur, soit
d'auteurs différents. Donat en atteste l'existence et nous
apprend qu'elle se produisait, non par voie d'affiche, mais
oralement ; il indique même à quel moment précis : après
l'ouverture musicale de la pièce. Il ne reste qu'un point
obscur : qui chargeait-on de la pronuntiatio tituli? Était-ce un acteur ou bien le héraut dont certains prologues de
Plaute nous signalent la présence aux abords de la scène?
J'inclinerais à croire que le rôle du héraut se bornait ici à
convoquer le public dans le théâtre et à l'inviter ensuite au
silence ; l'annonce était alors faite par un acteur, non par
un acteur quelconque,car, dans ce cas, au lieu d'en faire
défiler deux devant le public avant la pièce proprement
dite, l'un pour l'annonce, l'autre pour le prologue, on se serait
naturellement bientôt avisé de confier le tout à un seul,
à Prologus, dont le discours aurait absorbé l'annonce,
mais par l'acteur principal, par le directeur de la troupe,
qui avait, nous le verrons plus loin, de bonnes raisons pour
se retirer aussitôt et laisser à un autre la mission de réciter
le prologue. Sa présence et sa voix avaient en cet instant
décisif bien plus d'autorité que celles du héraut. Mais ce
qui recommande surtout cette opinion, c'est qu'elle nous
aide beaucoup à nous expliquer l'innovation considérable
réalisée par Térence dans son troisième prologue (1).
(1) Les tessères théâtrales n'ont jamais joué le rôle d'annonces. Il n'est pas prouvé qu'on ait fait usage d'affiches graphiques, au moins au temps de la république, pour donner au public les renseignements dont nous parlons, dans les jeux scéniques ; de plus, toutes celles de l'époque impériale que l'on a trouvées à Pompéi ou ailleurs, se rapportent à des jeux d'amphithéâtre, combats de gladiateurs et chasses L'usage de l'annonce orale, faite séance tenante, se retrouve encore au temps de Néron ; Suét. Nero, 21 :
Après s'être conformé deux fois à l'usage traditionnel, il
l'abandonna, en effet, quand vint le tour de l'Heautontimorumenos.
Les vers 4-9 du prologue de cette comédie ne peuvent se comprendre, si l'on n'admet pas que la pronuntiatio
tituli ordinaire fut cette fois supprimée. D'abord le
titre de la pièce y est donné d'une façon qui prouve que
les spectateurs ne le connaissaient pas encore. Tandis que
dans les prologues de l'Eunuque et de l'Antirienne il ne
figure que comme moyen et dans l'intérêt d'un développement
important, qu'il y est, en quelque sorte, perdu au
cours d'une démonstration, ici il est mis pour lui-même et
sans autre but que de l'énoncer, il occupe une situation
saillante dans la proposition dont il fait partie. De plus il
se présente dès les premiers vers du prologue. Le poète
aurait-il donné tant de relief à cette mention, si elle n'avait
été que la redite d'une annonce toute fraîche ? Mais voici
qui est encore plus frappant. Jusqu'à maintenant Térence
a été désigné par des qualifications très vagues, sans que
Prologus ait cru devoir s'en excuser et manifester la moindre
intention de préciser davantage. Rien de plus naturel,
puisque l'annonce venait de fournir au public un renseignement nominatif. Or Ambivius déclare ici qu'il se dispensera
de faire connaître le nom du poète, et la raison
qu'il apporte du silence gardé par lui sur ce nom et celui
de l'auteur grec, c'est que la plupart des spectateurs les
savent déjà. La déclaration est étrange et plus étrange
encore le prétexte. Puisque Ambivius a pu parler ainsi,
impossible de supposer que la proclamation des deux noms
avait eu lieu un moment auparavant. D'où vient cette anomalie
et par quoi ce jour-là fut remplacée l'annonce régulière?
Le premier échec de l'Hécyre fit sur Térence une
impression assez forte pour le tenir deux ans éloigné du
théâtre, et il n'y reparut qu'avec une peur exagérée des
caprices du public Ce sentiment lui suggéra l'idée de faire
jouer sa pièce sans dire son nom. Mais comment s'y prendre
pour échapper à la formalité obligatoire? Térence s'avisa d'un expédient fort adroit. Comme chef de troupe, Ambivius,
probablement sans costume ou, pour nous servir d'une locution
moderne, en habits de ville, aurait dû venir faire l'annonce : le poète lui confia le rôle et lui fit prendre les attributs
de Prologus. Les spectateurs furent grandement
étonnés, non pas de voir paraître Ambivius qu'ils attendaient,
mais de le voir paraître, lui vieillard, en Prologus,
personnage que jouait toujours un jeune acteur ; de sorte
que leur attention se détourna aussitôt de la pronuntiatio
tituli et que cette première surprise les prépara à d'autres
irrégularités. Alors seulement se produisit l'annonce, mais,
bien entendu, sous une forme extraordinaire. Le titre de la
pièce nouvelle, qui n'avait rien de compromettant, fut énoncé
comme d'habitude; puis, arrivé à l'endroit où il aurait dû
dire le nom de l'auteur, Ambivius se déroba par un subterfuge.
La plupart des spectateurs, qui, en réalité, ne savaient
rien du tout, songèrent, chacun à part soi, que leurs
voisins étaient sans doute mieux informés, et n'eurent ni le
loisir, ni mème la pensée de vérifier si cette grande majorité
dont on leur parlait existait vraiment : car leur attention
était toute aux motifs que le vieil acteur leur donnait de son
apparition en Prologus. Ensuite, par égard pour lui, ils
écoutèrent en silence le reste du prologue, et, favorablement
impressionnés, se laissèrent aller à l'intérêt de la pièce.
Quand ils eurent le temps de réfléchir et purent se rendre
compte de la supercherie, ils avaient applaudi, le tour était
joué. Seulement on se demande au premier abord pourquoi
Térence a cru devoir taire aussi le nom de son modèle grec,
dont la divulgation ne pouvait aucunement produire un
mauvais effet. Ce fut pour cacher son jeu et ne pas éveiller
les soupçons qui auraient envahi plus d'un esprit, s'il avait
eu la maladresse d'omettre juste le détail qu'il avait intérêt
à dissimuler, et rien de plus. En outre, dans la formule
normale
étroitement associés ; on disait par exemple : Andria Terenti,
graeca Menandrus ; si l'un d'eux était supprimé, la
formule sonnait mal. Impossible de s'en servir sans choquer
les oreilles du public, qui auraient senti dans la phrase familière l'omission d'un mot essentiel. Pour dérouter les
spectateurs il fallait donc les dépayser tout à fait.
Pour la reprise de l'Eunuque, Térence revint sans aucun
doute à la forme ordinaire de l'annonce. A la représentation
du Phormion elle fut également distincte du prologue,
où l'on ne voit ni le nom du poète latin ni celui du poète
grec. Si l'on y trouve le double titre de la pièce, le but de
cette mention n'est pas de le faire connaître au public, mais
de lui apprendre le motif d'un changement unique dans le
théâtre de Térence qui partout ailleurs s'est contenté de
transcrire le titre grec (1).
(1)
Térence dit : « Cette pièce s'appelle en grec Epidicazomenos,en latin
Phormion, parce que celui qui y jouera le premier rôle, ce sera le parasite
Phormion... » (v. 25 sqq.). Ce n'est évidemment pas là le vrai motif
du changement. Térence pensait en réalité que ses spectateurs ne comprendraient
pas le titre grec, emprunté à la langue juridique d'Athènes.
Dans le prologue des Adelphes, le
titre de l'original principal ainsi que le titre et le nom du
poète de l'original secondaire sont donnés pour la même
raison que les indications de ce genre dans le prologue de
l'Eunuque. On accusait Térence d'avoir pillé les Commorientes
de Plaute, reproduction des Synapothnescontes de
Diphile. «C'est faux, répondit-il, j'ai seulement inséré une
scène des Synapothnescontes, laissée de côté par Plaute, dans
les Adelphes; c'est cette pièce que nous allons jouer ; elle
est bien nouvelle, et il n'y a pas de plagiat». Ce prologue
fut donc aussi précédé de l'annonce régulière.
Au contraire, dans les deux prologues de l'Hécyre, où,
d'ailleurs, manque le nom des deux poètes, le titre de la
pièce se présente avec trop de relief, surtout dans le premier, et occupe une position trop indépendante pour qu'onpuisse croire qu'il avait été proclamé un instant auparavant.
A la première reprise, voici sans doute comment les choses
se passèrent. L'Hécyre fut donnée après les Adelphes; il y
eut une annonce commune : Ambivius dit qu'il jouerait successivement
deux pièces nouvelles de Térence et nomma
la première ; pour la seconde il ne reparut pas, et Prologus
fut chargé d'en proclamer le titre accompagné de quelques
explications. A la seconde reprise, par mesure de précaution,
l'annonce fut supprimée. Ambivius lui-même récita
le prologue et se borna à y faire connaître le titre de la
pièce. C'était, dans l'espèce, le seul détail indispensable :
grâce à sa double mésaventure, on savait alors généralement
à Rome que l'Hécyre était de Térence. Quant au nom du
poète grec, dans les deux cas il n'avait aucune importance ;
il était surtout une garantie de nouveauté, et Térence qui
l'avait fournie lors du premier essai de représentation, pouvait
fort bien se dispenser de la reproduire, puisque, au su
de tout le monde, l'Hécyre n'avait été jouée ni alors ni
depuis.

IV
Sur les sept prologues de Térence, cinq, ceux de l'Andrienne,
de l'Eunuque, du Phormion, des Adelphes et le
premier de l'Hécyre, furent récités par Prologus. Ce personnage
que le théâtre grec n'avait pas connu, nous avons
déjà vu pour quelle raison ies comiques romains s'avisèrent
de l'inventer : ils éprouvèrent le besoin de pourvoir d'un
monologue narratif préliminaire certaines comédies qui
s'ouvraient daus l'original par une exposition dramatique,
et, pauvres d'imagination, ils ne surent pas, à l'exemple de leurs devanciers grecs, créer pour chaque monologue une
belle figure allégorique, une divinité de théâtre. Nous
avons aussi remarqué que Prologus était placé en dehors
de l'action dramatique, appartenait à un autre monde que
les personnages de la pièce proprement dite, n'entrait pas
dans la même fiction. Il nous faut maintenant lier plus
intime connaissance avec cette curieuse individualité et montrer
que Térence, qui l'emprunta à ses prédécesseurs, lui fit
subir une transformation considérable, conséquence nécessaire
de la façon tout originale dont il conçut l'office du
prologue.
D'abord Prologus, étranger à la fiction de la pièce, entret-il dans une autre fiction quelconque? Sommes-nous bien
sûrs, en d'autres termes, qu'il soit un personnage et non
pas simplement un acteur? On est tenté de le comparer soit avec celui
qu'on appelait au XVIIe siècle l'orateur de la troupe, soit
avec celui qu'on nomme dans nos théâtres contemporains
le régisseur parlant au public ; on est tout près d'affirmer
que les prologues de Térence furent prononcés par un histrion
qui n'avait pas à dépouiller, pour s'acquitter de cette
mission, sa personnalité réelle. Et cependant le grammairien
Evanthius classe Prologus parmi les personnages
dramatiques au même titre que le choeur et le « deus ex -
machina ». Térence lui-même n'atteste-t-il pas l'existence d'une individualité de ce nom, quand il fait dire à Ambivius : « Le poète a voulu que je fusse un orateur et non
un personnage de prologue, un Prologus » ? De plus, l'acteur
chargé de ce rôle ne se présentait pas sur la scène avec
ses vêtements de la vie quotidienne ou avec le costume d'un
personnage quelconque de comédie : il paraissait avec des
attributs spéciaux, « ornatus prologi ». Ainsi il avait tout l'extérieur d'un personnage dramatique. Mais la fiction ne
se bornait pas à le revêtir de cet aspect emprunté : elle le
pénétrait plus intimement, puisque nous constaterons tout à
l'heure qu'il prenait avec le costume de ce rôle des sentiments
et un tour d'esprit indépendants de ceux qu'il pouvait.
avoir dans la réalité. Il y a donc là, sinon au fond, du moins
en apparence, une contradiction. Comment l'expliquer ?
Les personnages allégoriques, créés par la fantaisie féconde de Ménandre et de ses rivaux au fur et à mesure qu'ils
en avaient besoin pour leur confier la tâche de l'exposition,
étaient quelque chose par eux-mêmes et en dehors des
fonctions de narrateur dont ils se chargeaient pour la circonstance.
Si on leur supprimait ce rôle, ils ne rentraient.
pas dans le néant, ils existaient encore dans le monde de
la fiction poétique, parce que l'auteur avait su leur donner,
la vie et une véritable individualité, c'est-à-dire un ensemble de qualités et de prérogatives à eux appartenant, un
passé, un caractère, un extérieur qui les distinguaient de
tout autre. Supposons qu'Élenchos et Aer ne soient pas chargés
de faire l'exposition d'une comédie, l'un de Ménandre, l'autre de Philémon, ils ne cesseront pas pour cela d'exister: celui-ci sera toujours le dieu qui est partout et
sait tout, à qui personne, homme ou divinité, ne peut cacher une seule de ses actions ; celui-là, le dieu ami de la
vérité et de la franchise, dont les méchants seuls redoutent
la langue. Le récit préliminaire était l'objet de leur présence sur la scène, leur occupation actuelle ; le reste du
temps ils avaient d'autres occupations, ils menaient une existence
surnaturelle en rapport avec cette individualité
qu'ils détaillaient complètement devant le public au début
de leur discours. Si au contraire, la figure allégorique disparaissait
et si l'on retranchait du prologue tout ce qui lui
appartenait, que restait-il? Un récit sans cadre et une abstraction
toute nue, le narrateur de l'exposition. C'est l'abstraction
que les comiques romains personnifièrent sous le
nom de Prologus, et d'une façon bien imparfaite au point de vue esthétique. Même à Prologus l'imagination d'un
Ménandre aurait donné une personnalité originale : elle en
aurait fait, pour s'en servir une fois, une divinité allégorique,
comme Élenchos. La pauvreté d'invention des poètes
romains se marque non seulement par l'usage permanent
d'une seule et même machine, mais encore par la manière
défectueuse dont elle fut construite. L'inventeur de Prologus
n'eut pas le moyen, il n'eut même pas la pensée d'en
faire une belle création artistique, un individu distinct et
complet ; son unique dessein fut de répondre aux besoins
de la situation en donnant au narrateur du prologue juste
ce dont il avait besoin pour être bien accueilli d'un public
grossier. Prologus n'eut pas les honneurs de l'apothéose :
il fut simple mortel, et sa figure y perdit en éclat et en grandeur. Cependant, l'abstraction qu'il représentait devait forcément s'envelopper d'une forme concrète. Incapable d'en
créer une de toutes pièces, le poète romain assimila Prologus
en partie avec lui-même qui écrivait le rôle, en partie
avec l'acteur pour lequel il l'écrivait. Il lui donna son caractère,
sinon le vrai, au moins celui qu'il voulait qu'on lui
crût, et son esprit, avec le langage, les manières, les préoccupations
professionnelles de l'acteur. Il en fit son contemporain,
son compatriote, un homme de son milieu, du
monde de théâtre. Prologus naquit et vécut dans les coulisses
parmi les histrions. La fiction fut si voisine et si peu
distincte de la réalité, que de l'une à l'autre le passage se
fit sans secousse et comme de plain-pied. Les poètes romains,
que ne retenait pas d'ailleurs le souci de la vraisemblance
dramatique, se laissèrent involontairement aller
à cette facilité de communications. En somme, Prologus
fut un individu indécis et mal défini, un être mal venu.
Tel il nous apparaît dans les prologues des comédies de
Plaute, images encore suffisamment ressemblantes, quoique
altérées, de la physionomie que lui donnèrent les devanciers
de Térence, et nous venons de voir que même dans
les prologues de notre poète, si soucieux dans ses pièces de ménager l'illusion, l'acteur perçait parfois sous le personnage.
C'était là une imperfection originelle, une faute
de l'inventeur, dont Prologus devait toujours porter la
peine.
Prologus est donc bien un personnage. Mais n 'y a-t-il
qu'un personnage de ce nom ? Est-ce le même qui revint
sur la scène pendant toute la période de la fabula palliata?Ou bien le nombre des Prologi fut-il égal à celui des comédies
munies de prologues romains ? Ni l'un, ni l'autre.
D'une part, il y en eut plusieurs. Évanthius emploie le pluriel
en parlant de ce personnage comme en parlant du choeur
et du « deus ex machina. » Le Prologus de Térence, celui
de Cécilius, celui de Plaute, celui de Névius furent des
individus distincts. Cela était inévitable à cause du rapport
étroit qui unissait cette personnalité à celle du poète. Chaque
poète fit le sien à son image et lui donna une physionomie
différente. Mais, d'autre part, il est naturel de penser
qu'ils n'en créèrent qu'un chacun. Il y eut autant de
Prologi que de poètes comiques, il n'y en eut pas davantage.
Tous ne faisaient d'ailleurs qu'une corporation, unis qu'ils
étaient entre eux par la communauté des attributs et, jusqu'à
Térence, des fonctions. L'acteur du rôle pouvait changer,
mais le personnage durait autant que la canière dramatique
du poète. Un mème acteur, si sa troupe jouait des pièces
de différents poètes, pouvait représenter plusieurs personnages
de Prologus.
Dans le théâtre de Térence, en particulier, la permanence
du personnage est évidente. Ses prologues ne furent pas
prononcés par une série d'individus n'ayant de commun
entre eux que le nom, le costume, l'emploi et certains
traits généraux de caractère, comme sont, par exemple, les
jeunes Pamphiles, les vieux Chrémès, les esclaves Syrus
de ses comédies ; les cinq que nous avons énumérés plus
haut furent dits par le même individu. Ce qui prouve que
le Prologus de Térence ne se renouvelle pas à chaque comédie,
c'est d'abord qu'il parle de ce qu'il fera ou dira dans l'avenir, à une prochaine occasion, donnant ainsi clairement
à entendre qu'il reviendra :
« J'ai encore bien des choses à dire, dont on lui fera grâce
pour le moment (à Luscius), et qu'on publiera plus tard (à
l'occasion d'un nouveau prologue), s'il continue à attaquer. »
Ainsi parle-t-il dans le prologue de l'Eunuque ; et dans
celui du Phormion :
Cesserai-je de parler de lui, alors que lui de son côté ne
cesse de se mal conduire? » Une autre preuve de la permanence
du personnage, c'est l'uniformité absolue du caractère
que nous essaierons tout à l'heure d'analyser.
Il est encore plus manifeste que le Prologus de Térence
est distinct de tous ses aînés. Ce que le poète fit dire un
jour au vieil Ambivius, chargé par extraordinaire de réciter
un prologue, il aurait pu tout aussi justement le faire dire
chaque fois à Prologus : « Le poète a voulu que je fusse
un orateur, non un personnage de prologue.
Car il a, dès le premier jour, transformé complètement le
rôle de Prologus et n'est jamais revenu à l'ancien usage.
De ce qui était avant lui surtout un récit, il fit un plaidoyer ;
du même coup, il remplaça le narrateur par un avocat. Son
Prologus, par la nature des fonctions qu'il remplit, se sépare
des autres ; entre eux et lui il n'y a plus comme marques
de parenté que le nom et le costume. Les effets de cette
évolution sont frappants, et il vaut la peine d'y insister.
La personnalité du Prologus de Térence a très peu de
relief: elle s'efface le plus souvent derrière celle de l'auteur.
Il n'est que le confident et le porte-voix du poète ; presque partout et pour les choses les plus importantes, il ne faIt
que répéter les affirmations du poète ; par sa bouche et à
la troisième personne, c'est le poète qui attaque ou réfute
Luscius. Messager docile, il récite exactement la leçon qu'on
lui a apprise, de mème qu'au 9" chant de l'Iliade Ulysse,
envoyé en ambassade auprès d'Achille irrité, lui redit avec
une fidélité scrupuleuse la longue énumération des promesses
d'Agamemnon. Cette substitution du poète au personnage est tellement réelle, qu'en deux endroits très re
marquables, c'est le poète lui-même qui est désigné comme
prononçant le prologue : « Notre auteur parlera plus Ionguement des bévues de son détracteur, quand il donnera
d'autres pièces nouvelles (c'est-à-dire dans les prologues de
ces pièces).
Le second passage est plus frappant encore : « Si le vieux
poète, disent les adversaires de Térence, n'avait pas commencé
la guerre, le nouveau n'aurait pu trouver aucun prologue
à réciter
»
Pourtant on trouve dans les discours de Prologus quelques
rares verbes à la première personne, quelques affirmations
dont il prend la responsabilité : dans les formules
d'appel à la bienveillance du public, aux endroits où l'acteur
reparaît sous le personnage, enfin quand celui-ci parle
de sa conduite à venir : c'est lui, et non le poète, qui annonce
d'abord des représailles contre Luscius et, une fois
qu'elles sont commencées, la continuation des hostilités.
On voit qu'en somme son initiative n'est pas grande et que
la plupart du temps il se borne en quelque sorte à redire
les phrases qui lui sont soufflées. L'effacement de Prologus derrière le poète ne fut pas toujours aussi complet, et en ceci
on sent bien l'influence du changement subi par l'office du
prologue. Dans ces plaidoyers que Térence écrivait pour
lui-mème, où il n'était guère question que de lui, sa personne
arrivait tout naturellement à occuper le premier plan
et c'est le plaideur que chacun voyait, quoiqu'on eût sous
les yeux son fondé de pouvoirs. Les prologues de contenu
plus impersonnel, ceux des vieux comiques et ceux des
pièces de Plaute, n'étant pas encombrés par cette sorte de
présence du poète, Prologus pouvait plus librement y déployer
son individualité. Voyez par exemple celui du Poenulus,
où il apostrophe en son nom les spectateurs, engage
avec eux des pourparlers, édicte un long et plaisant règlement
de police théâtrale. Il se met en avant, il paie de sa
personne, il est plus original et plus vivant.
Comme le Prologus de Térence parle presque toujours au
nom d'autrui, son caractère à lui n'a que peu d'occasions
de se manifester et n'est pas facile à saisir. On doit évidemment
le chercher dans les seules affirmations qu'il émet
pour son propre compte. Il me semble qu'on peut le résumer
en deux traits : assurance énergique vis-à-vis des adversaires
du poète, affabilité respectueuse à l'égard du public.
Or ce sont précisément là, d'après le contenu de ses prologues, les sentiments que Térence lui-même avait ou
affectait d'avoir. En même temps que ses idées, il a donc
inculqué à Prologus son caractère ; il s'est identifié ce personnage,
ou plutôt il l'a détaché de lui-même ; il a envoyé,
pour ainsi dire, son ombre, un dédoublement de sa personnalité
le représenter et parler en son nom sur la scène.
Nous avons posé cette ressemblance morale de Prologus
avec son poète comme un fait général et nécessaire. Mais
nulle part elle ne put être aussi parfaite qu'ici, parce que
nulle part les fonctions de Prologus ne favorisèrent au mème
degré la sympathie et, pour dire plus, la confusion des deux
individus.
On peut faire, à ce point de vue, un curieux rapprochement entre le Prologus de Térence et le choeur d'Aristophane.
Ce dernier personnage possède, il est vrai, dans
presque toute la pièce, une individualité complète et indépendante
de celle du poète ; presque partout il agit et parle
pour son propre compte, il n'est que lui-même. Cependant,
à un certain endroit de la comédie, dans la parabase proprement
dite, il lui arrive parfois d'abdiquer pour un moment
cette individualité et de s'effacer derrière le poète
dont il est alors le représentant et le porte-voix. C'est là
qu'Aristophane, par la bouche du coryphée, aime à entretenir
le public des mérites littéraires et politiques de ses
pièces, à se décerner des éloges, à médire de ses adversaires.
Quoique ce discours soit prononcé par un autre que lui, sa
personnalité, sous laquelle disparaît celle de l'orateur, ses
idées, ses sentiments en font toute la matière ; il y tient la
même place que Térence dans ses prologues. Tantôt le
coryphée rapporte en son propre nom les affirmations du
poète qu'il représente et, d'un bout à l'autre du discours, le
fait parler à la troisième personne (Chevaliers, Guêpes);
c'est en ce cas surtout que l'analogie est saisissante entre
ce personnage et Prologus. Tantôt le coryphée parle au
nom du poète et à la première personne, comme s'il était
Aristophane, soit après lui avoir fait pendant un certain temps
tenir un discours indirect qui se transforme tout à coup en
discours directs (Acharniens, Paix), soit même d'emblée et
dès le commencement de la parabase (Nuéesz). Il y a là
une hardiesse que Térence ne s'est jamais permise. Le
public athénien l'admettait le mieux du monde : cette
convention poétique n'était pas plus obscure pour lui que
ne l'est pour les magistrats de nos tribunaux la figure de
rhétorique par laquelle un avocat se met à la place de son
client. Quand la parabase proprement dite était achevée,
les choses rentraient dans l'ordre : le poète qui s'était un instant montré disparaissait de la scène, le coryphée et le
choeur reprenaient leur personnalité dramatique.
La ressemblance que nous étudions entre Térence et son
Prologus se poursuit dans les manières et le langage.
Qu'est-ce que le Prologus de Plaute? Un homme de basse
naissance et sans éducation, comme l'était l'histrion chargé
du rôle, aux allures triviales et au parler vulgaire, doué
d'une voix sonore, d'une grande volubilité de langue, d'une
verve intarissable mais grossière, saluant et flattant le public
avec l'obséquieuse politesse des petites gens à l'égard des
puissants, délayant l'argumentum en un long récit amusant
qu'il entremêle de plaisanteries, ramassées pour la plupart
dans les carrefours, et de réflexions à tournure proverbiale
dans le goût du populaire ; causeur gai, insinuant, sentencieux,
que l'on croit voir encore soulignant ses paroles d'une
gesticulation animée et de grimaces bouffonnes, charlatan
qui exécute sa parade. Pour réussir auprès de spectateurs
peu délicats, il a tout ce qu'il faut, il est bien l'homme de
son rôle. Mais autre chose est un boniment, autre chose un
discours. L'orateur Prologus ne pouvait avoir les façons et
le ton du conteur Prologus : ses fonctions exigeaient plus de
sérieux et de dignité, des manières plus distinguées, un
langage plus choisi, un geste plus sobre, en un mot, un
homme de meilleure compagnie. Il devait renoncer au
milieu inculte où ses aînés avaient vécu et s'acclimater dans
un monde plus poli. L'histrion n'était plus digne de servir
de modèle au personnage. Mais celui-ci n'eut qu'à se régler
sur le jeune esclave que le sénateur Térentius Lucanus
avait fait élever avec tant de soin, sur l'affranchi que
Scipion et Lélius accueillaient avec tant de faveur dans
leur élégante société ; ici encore la figure de Prologus reproduisit les traits de Térence. Est-il vrai que dans l'oeuvre
de tout dramaturge on trouve un personnage où il a mis de
lui-même plus que dans aucun autre, pour lequel le peintre
a été son propre modèle; que, par exemple, il faut voir
Sophocle vieillard sous les traits d'OEdipe à Colone ? Quoi
qu'il en soit, on peut dire que Prologus est une incarnation
dramatique de Térence et qu'il n'en est point dans le
théâtre classique de plus complète et de plus visible.
Ce qui achève de rendre le phénomène frappant, c'est
qu'à la ressemblance morale s'ajoute, jusqu'à un certain
point, la ressemblance physique. Les vieux comiques romains
avaient fait de Prologus un jeune homme. Sauf deux
cas extraordinaires, Térence s'est conformé à la tradition,
de sorte que son avocat ordinaire, son interprète attitré, fut
à peu près du même âge que lui.
Si les devanciers de Térence établirent l'usage dont nous
parlons, ce n'est pas que la jeunesse convint à Prologus à
l'exclusion de tout autre âge. Parmi les divinités allégoriques
de la nouvelle comédie grecque, les unes étaient jeunes
ou vieilles par nature ; certaines convenances artistiques
indiquaient au poète l'âge qu'il devait donner aux autres.
Mais la personnalité si vague de Prologus se fût accommodée
de la maturité ou de la vieillesse aussi facilement que
de la jeunesse. Car les qualités de narrateur, qui en formaient
le trait essentiel, ne sont pas, loin de là, le monopole du
jeune homme, et il n'est point rare de trouver d'amusants
conteurs à cheveux blancs. Peut-être mème pourrait-on
remarquer qu'un vieillard aurait débité avec plus d'à-propos
qu'un adolescent les sentences qui abondent dans les
prologues de Plaute, qu'il aurait réclamé avec plus d'autorité
le silence et la faveur du public. La décision des comiques
romains ne se fonda ni sur une nécessité logique, ni
sur des considérations artistiques ; elle fut entrainée par des
motifs d'ordre purement extérieur et matériel. Prologus,
n'ayant point par lui-même d'âge certain et obligé, s'assimila
en ceci, comme pour les idées, le langage et les manières, à l'interprète du rôle. Or ce dernier fut constamment
un jeune homme, c'est ce que démontrent les deux
premiers vers du prologue de l'Heautontimorumenos.
« Le poète, dit le vieil Ambivius, a confié aujourd'hui à
un vieillard un rôle qui appartient aux jeunes gens. » Et il
explique ensuite pourquoi. La seule vue de ce vieux Prologus
a causé de l'étonnement aux spectateurs accoutumés à
voir apparaître le personnage sous les traits d'un jeune
acteur.
On n'a pas de peine à comprendre pourquoi les poètes de
la fabula palliata prirent l'habitude d'attribuer à un jeune
homme le rôle de Prologus. Il suffit pour cela de se figurer
l'aspect du théâtre de l'époque, quelques instants avant
la représentation. Dans le vaste espace limité par les barrières,
sans gradins ni sièges, la foule des spectateurs, où
domine de beaucoup l'élément grossier et inculte, où abondent
les gens qui ont fèté par de copieuses libations la
solennité du jour, s entasse debout, par cela seul mouvante
et houleuse. Des conversations bruyantes s'engagent entre
voisins : le méridional ne sait pas attendre en silence.
D'une extrémité à l autre de l'enceinte, des appels, des
quolibets s'échangent entre amis qui s'aperçoivent. Si le
spectacle tarde trop à commencer, des murmures d'impatience
s'élèvent et grossissent rapidement, mêlés de sifflets
et de cris d'animaux. A tout ce bruit ajoutons les bousculades
qui se produisent vers les portes, à l'entrée d'une
bande de retardaires qui prétendent, non seulement se placer,
mais encore arriver jusqu'aux bonnes places, soulevant
des tempêtes de protestations et d'injures, plus d'une fois
suivies de coups de poing. Voilà bien le public romain tel
que nous le montrent les prologues des comédies de
Plaute écrits cependant, ou du moins remaniés, à une
époque où la foule était assise, par conséquent moins remuante et plus stable. S'il faut en croire Horace, ces habitudes
tapageuses ne s'étaient pas perdues au siècle d'Auguste.
Quiconque a fréquenté les théâtres de nos grandes
villes du Midi trouvera que le tableau n'est pas chargé : les
jours de représentations populaires surtout, quand l'abaissement
du prix des places ouvre l'accès de la salle au plus
petit artisan, pour ne rien dire des gros orages qui éclatent
fréquemment, le bruit normal y est assourdissant avant le
lever du rideau. C'était donc au milieu d'un formidable
vacarme que Prologus faisait son entrée. Un calme relatif
s'établissait à son apparition et s'affermissait peu à peu, si
son discours était amusant. Mais il n'y avait pas d'apaisement
subit et absolu ; tout le temps qu'il parlait, les derniers
grondements du tumulte résonnaient encore autour
de lui, à tel point qu'il était parfois obligé d'appeler à son
aide le héraut pour inviter les récalcitrants à faire enfin
silence.
Dans ces conditions, la tâche de l'acteur chargé du rôle
était des plus fatigantes. Pour se faire entendre dans ce
théâtre en plein air, au milieu de ce tapage, il devait donner
un volume de voix considérable. Or se faire entendre,
c'était le seul moyen de contenter les spectateurs déjà disposés
à écouter, qui se seraient bientôt fâchés, s'ils avaient
en vain prêté l'oreille ; ajoutons que c'était aussi le meilleur
moyen de s'imposer à l'attention de ceux qui n'écoutaient
pas encore. Mais, pour cela, il ne fallait ménager ni
ses poumons ni son gosier ; il fallait y aller de toute sa voix
et de tout son corps, crier et se démener, pour n'arriver
bien souvent, malgré tant de rudes efforts, qu'à un demi-succès.
Une digression du prologue des Captifs nous monttre, sous un jour plaisant, il est vrai, mais d'une façon très
vive, les désagréments de ce rôle aussi ingrat que pénible.
L'acteur a commencé le récit de Vargumentum ; il s'interrompt
pour s'assurer que tout le monde l'a bien suivi :
« Vous y êtes? dit-il; c'est parfait ». Mais alors il aperçoit,
ou feint d'apercevoir, tout au fond de l'enceinte un
spectateur qui se plaint de n'avoir pas entendu : « Par Hercule,
en voilà un là-bas, au dernier rang, qui prétend que
non ». Et il interpelle en ces termes le mécontent hypothétique
: « Va t-en ; s'il n'y a pas de place pour t'asseoir,
il y en a pour te promener, puisque tu réduis l'histrion à la
mendicité. Pour ton plaisir, ne t'y trompe pas, je ne vais
point me crever ». Réduire l'histrion à la mendicité, c'est
l'obliger de crier au point d'en avoir la voix cassée, et lui
faire perdre ainsi son gagne-pain. L'expression est énergique
; celle du vers suivant l'est encore davantage. Elles
attestent à elles deux, avec une exagération bouffonne, que
réciter le prologue, ce n'était pas petite affaire.
C'était une lourde corvéa que tous les acteurs de la
troupe devaient envisager avec répugnance. Les vieux la
rejetaient naturellement sur les jeunes ; parmi ceux-ci,
c'était à qui l'esquiverait. Comme il fallait pourtant de toute
nécessité que quelqu'un s'en chargeât, on l'imposa au plus
jeune, au dernier venu; du moins cela est très vraisemblable.
Rien de plus naturel et de plus juste que cette attribution.
C'est une loi encore appliquée de nos jours dans
beaucoup de sociétés, que les nouveaux doivent alléger les
anciens de certaines tâches plus ou moins désagréables et
payer ainsi une sorte d'impôt pour leur entrée dans la société.
Grâce à cette combinaison, l'interprète du rôle n'était jamais désigné arbitrairement, on le connaissait d 'avance,
la besogne lui revenait de droit, et il restait titulaire de
l'emploi jusqu'à ce que le directeur de la troupe eût fait
acquisition d'un nouveau jeune histrion. La jeunesse a
surabondance de forces physiques ; elle est assez riche pour
dépenser sans compter. Les acteurs plus avancés en âge
avaient besoin de plus de ménagement. Ils avaient aussi
le dèsir de réserver leurs efforts pour une meilleure occasion,
pour le moment où le public, rendu attentif par l'intérêt
de la pièce, apprécierait mieux leurs beaux effets de
voix. En faveur de cette prétention, ils pouvaient invoquer
les exigences d'une bonne interprétation de l'oeuvre à jouer.
C'était en général à des acteurs déjà anciens, ajoutant au
talent naturel l'expérience de la scène, que revenaient les
rôles les plus importants et les plus difficiles, tandis que les
débutants faisaient les personnages secondaires et n'avaient
même parfois que des bouts de rôle. Imposer aux premiers
la fatigante récitation du prologue, c'eût été gaspiller leur
énergie et compromettre le succès des situations capitales
où les ressources de leur action devaient faire valoir les
inventions heureuses du poète. Le débutant, dont la part
de travail était légère en dehors de cette besogne préliminaire,
pouvait, sans préjudice pour l'exécution de l'ensemble,
s'époumoner à prononcer le discours de Prologus.
Comme la taille, la prestance, la figure (1) de Prologus
n'étaient pas plus déterminées que son âge, l'extérieur,
quel qu'il fût, du débutant, n'était jamais un obstacle à
l'application de la règle.
(1) Nous verrons plus loin que, même au temps de Térence, Prologus ne portait pas de masque.
Pour tenir cet emploi il ne fallait aucune qualité spéciale, il suffisait de celles qu'exigeait en général le métier d'acteur : avant tout, voix forte et mimique animée. Voilà donc pourquoi Prologus, qui de sa nature n'était ni jeune ni vieux, prit place parmi les adulescentes de la comédie latine. On a donné, il est vrai, de ce fait une autre explication; mais elle n'est pas acceptable. On a dit que le rôle de Prologus fut habituellement confié à de jeunes acteurs, parce qu'ils paraissaient plus aptes à gagner la bienveillance du public. Si, pour prendre une décision, les poètes romains s'étaient placés à ce point de vue, n'auraient-ils pas au contraire choisi un vieil acteur, un des plus anciens de la troupe, dont l'âge, le talent éprouvé, les succès passés n'auraient pas manqué de faire sur le public une favorable impression? Par quels titres, comparables à ceux-là, se recommandait un jeune homme ? Dans deux occasions où Térence jugea cette sympathie des spectateurs plus difficile à conquérir que d'ordinaire, ce fut précisément à un vieillard, comme nous allons le voir, qu'il demanda de réciter le prologue.
V
L'originalité de Térence ne se borna pas à la transformation de Prologus, dont nous venons de rendre compte.
Deux fois il se passa de ce personnage attitré du prologue
romain et le remplaça par un autre, parce que dans ces
deux circonstances il trouva le rôle trop lourd pour lui. La
première fois que Prologus se vit ainsi dépossédé de ses
fonctions, ce fut à la représentation de l'Heautontimorumenos.
On sait qu'elle suivit directement, quoiqu'à long
intervalle, l'échec de l'Hécyre qui causa au poète une si
douloureuse émotion ; la seconde fois, ce fut à la représentation
définitive de cette comédie si peu favorisée du sort
qui lui avait déjà infligé un double revers. Dans l'un et
l'autre cas, Térence, ayant un procès plus difficile à gagner
que ses autres procès, trouva insuffisant son avocat ordinaire,
sans prestige et sans autorité ; il fit appel au concours
d'un défenseur exceptionnel. Pour tenir la place de Prologus dans ces graves conjonctures, à qui s'adressa-t-il ? Il ne prit pas un personnage
du monde allégorique, et cela n'a rien de surprenant. Lui
que le souci de la vraisemblance dramatique détourna toujours
de traduire celles d'entre les comédies grecques qui
s'ouvraient par l'apparition et le monologue des divinités
de théâtre, ne devait guère se sentir porté à leur demander
aide et protection, à leur accorder sa confiance, dans une
situation délicate. D'ailleurs, il n'avait pas la richesse d'imagination
de Ménandre et sa merveilleuse aptitude à créer,
comme en se jouant, de charmantes figures allégoriques. Il
est vrai qu'il aurait pu, à la rigueur, se dispenser d'être
tout à fait original et trouver dans l'Olympe de la comédie
nouvelle quelque dieu complaisant qui serait venu avec
assez de naturel présenter sa défense ; Elenchos, par exemple,
aurait pu, dévoilant et confondant les calomnies de ses
détracteurs, prononcer le prologue de l'Heautontimorumenos.
Mais une raison plus décisive pesa sur son choix. Dans
l'intérêt du poète en péril, quelle recommandation pouvait
produire une divinité de théâtre? Son prestige, par où elle
était supérieure au simple mortel Prologus. C'était beaucoup
à Athènes, où la vive imagination des spectateurs se
laissait charmer par ces brillantes apparences. C'était relativement
peu à Rome, auprès d'un public bien moins sensible
aux séductions de l'art. L'effet de ce prestige parut à
Térence une garantie trop incertaine et trop peu solide. Il
voulait un avocat dont l'ascendant plus sérieux s'imposât
plus sûrement à l'esprit des juges. Ce fut tout près de lui,
parmi ses contemporains et dans son entourage même,
qu'il choisit le suppléant extraordinaire de Prologus. Au
lieu d'une individualité dramatique, il se servit pour ce rôle
d'une personne réelle, du directeur de la troupe qui jouait
ses comédies, le vieil acteur Ambivius.
Dès le premier vers des prologues en question, il est visible
que les choses ne se passèrent pas comme d'habitude.
Tandis que dans les autres le personnage se présente sans croire opportun de motiver son apparition, comme quelqu'un
que l'on connaît et que l'on attend, ici il éprouve le
besoin de s'annoncer et de prévenir l'étonnementdu public.
«
Pour que nul de vous ne soit surpris de voir que le poète
a chargé un vieillard du rôle qui appartient aux jeunes
gens... »
C'est en orateur que je viens à vous, sous le costume de
Prologus. » Celui qui parle ainsi n'est évidemment pas le
personnage traditionnel, le Prologus familier à tous. Du
contenu des deux prologues, il résulte que c'est un vieil
histrion, en même temps chef de la troupe. Or, les témoignages
réunis des didascalies et de Donat prouvent qu'Ambivius
a joué toutes les pièces de Térence et qu'il les a
jouées d'original. Donat, corroboré par Eugraphius et un
de nos plus anciens manuscrits des comédies, le Victorianus, le désigne expressément comme ayant récité
le second prologue de l'Hécyre. Il est dit dans ce prologue
que les deux tentatives malheureuses de représentation ont
été faites par le même Ambivius. D'après un autre passage
de Donat, sa troupe a joué aussi, comme pièce nouvelle, le Phormion, où il a créé pour sa part le rôle du parasite.
Le prologue de cette comédie fait allusion1 à un échec subi
par la troupe, le jour évidemment où elle essaya pour la
première fois de jouer l'Hécyre, échec réparé depuis par un
succès au moins, remporté sans doute avec une autre ou
plusieurs autres pièces du poète qui a écrit le prologue,
c'est-à-dire, pour préciser, soit avec l'Heautontirnorwnenos,
soit avec la reprise de l'Eunuque, ou plutôt avec les
deux. Ajoutons à cela que la façon dont Ambivius parle de
Térence dans le second prologue de l'Hécyre, atteste des
relations déjà anciennes et constantes. C'est donc bien lui
qui a donné toutes les premières représentations, et c'est lui
qui a remplacé Prologus à l'apparition de l'Heautontimorumeuns aussi bien qu'à la reprise définitive de l'Hécyre.
L. Ambivius Turpio était à tous égards l'homme qui
convenait pour remplir cette mission délicate : il pouvait
mettre en ligne, au profit de la pièce et du poète, les plus
sérieuses recommandations. D'abord il était vieux : lui-même
se dit à plusieurs reprises senex. Puisqu'il avait joué,
étant déjà à la tète d'une troupe, les premières comédies de
Cécilius qui, d'après la chronique d'Eusèbe fleurissait
vers 575 de Rome, il devait avoir, au temps de Térence, à
peu près l'âge que Chrémès donne à Ménédène. Sans compter
cette sorte de respect involontaire que les cheveux blancs
inspirent en général et de prime abord à la foule, ceux
d'Ambivius rappelaient aux spectateurs romains une longue
carrière bien remplie. Il méritait qu'on eût égard à ses intérêts matériels, qu'on accueillît favorablement la pièce qu'il jouait à ses risques et périls, le vieux directeur qui pouvait
prendre le public à témoin de son zèle et de son désintéressement.
Il méritait bien qu'on fît silence pour lui rendre la tâche
moins pénible, que l'on consentît à l'entendre dans une comédie
du genre calme, le vieil acteur qui s'était prodigué
dans toute sorte de rôles laborieux.
L'écouter et l'applaudir, c'était d'un salutaire exemple :
c'était engager les jeunes acteurs à imiter son zèle.
C'était exciter l'ardeur des poètes à écrire, et l'encourager
lui-même à faire acquisition de pièces nouvelles pour le
divertissement du public.
Enfin et surtout, sur ces spectateurs qui l'applaudirent si
souvent il avait l'autorité du talent. Il fut évidemment le
plus remarquable comédien de son époque. Ses succès durent
être nombreux et éclatants, sa réputation lui survécut,
et les écrivains des temps postérieurs ne dédaignèrent pas
de le placer à côté du célèbre Roscius, le contemporain de Cicéron. Donat l'appelle actor peritissimus, et rapporte
une curieuse anecdote sur son entrée en scène et son jeu
dans le rôle de Phormion, à la première scène du deuxième
acte. Ciceron atteste qu'il eut la rare fortune de plaire
aux spectateurs de tous les rangs, bien que son talent charmât
surtout les esprits cultivés. Tant de titres réunis lui
donnaient un ascendant considérable : on le voit bien au
ton dont il s'exprime dans ces deux prologues ; on le voit
mieux que partout ailleurs dans le passage où il explique
qu'il a été choisi pour avocat parce que sa parole aura autant
d'efficacité que le plaidoyer même écrit par le poète.
Qu'il y a loin de cette protection réelle et solide à l'effacement
banal de Prologus et au prestige frivole des figures
allégoriques ! Térence ne pouvait produire sur la scène un
défenseur plus compétent, plus sympathique au coeur de ses
juges, plus influent sur leur esprit. En le choisissant, il
fit un coup de maître.
De son côté, en acceptant la mission de plaider sa cause,
Ambivius donna par deux fois au poète une preuve de la
plus vive amitié. Cette amitié naquit sans nul doute à l'occasion
des rapports commerciaux qui s'établissaient forcément
entre auteurs et directeurs. A Rome, en effet, les
chefs de troupe servaient d'intermédiaires entre les donneurs de jeux et les poètes. C'était à leur expérience que
s'en remettaient, pour le choix des pièces à jouer, les magistrats,
très médiocres connaisseurs en matière poétique,
sauf quelques rares exceptions, et désireux uniquement
d'augmenter leur crédit par des spectacles agréables au
peuple. C'était à eux aussi que les écrivains s'adressaient
et qu'ils offraient leurs oeuvres à vendre. Leur situation les
mettait en mesure de rendre beaucoup de services, surtout
aux débutants, de favoriser les vocations naissantes, d'aplanir
aux jeunes l'entrée de la carrière. Si le directeur et
le poète n'avaient point l'âme tout à fait vulgaire, les relations
d'acheteur à vendeur se transformaient aisément en
d'honorables et solides amitiés. C'est ce qui arriva pour
Ambivius et Térence. Ambivius, homme de coeur et de
goût, qui ne s'enfermait pas dans la considération étroite
de ses intérêts personnels, mais se préoccupait du sort de
l'art dramatique à Rome conçut une profonde sympathie
pour le caractère et pour le talent de Térence. De grands
personnages lui recommandèrent peut-être d'abord le débutant
; dès qu'ils se connurent, leurs qualités respectives
firent le reste. Les oeuvres du poète valurent de beaux succès
au comédien ; le comédien rendit de signalés services
au poète. Ce n'était pas d'ailleurs la première fois qu'Ambivius
faisait acte de dévouement. Plus de vingt ans
avant, lorsqu'il avait joué les premières pièces de Cécilius,
le public s'était montré défavorable. Pour empêcher un
poète, dont il appréciait la valeur, de succomber au découragement,
il avait repris les comédies d'abord mal accueillies,
il avait réussi à les faire écouter et applaudir ; Cécilius
lui devait d'avoir pu suivre sa carrière. Térence reçut
d'Ambivius, en ce qui concerne l'Hécyre, un service du même genre, et de plus, quand il jugea la protection de
Prologus insuffisante, il le trouva prêt, malgré son âge,
malgré l'importance de son rôle dans la pièce, à payer de
sa
personne dans le prologue. Il est vrai que le vieil acteur
dut éprouver une douce satisfaction d'amour-propre à réciter
ces deux discours où il est tant parlé de ses mérites et
de son autorité. Ce fut sa première récompense. Le gain
des deux procès qu'il plaida et la reconnaissance du poète
achevèrent de le payer.
L'innovation de Térence, substituant Ambivius à Prologus,
un être réel à un être fictif, bien qu'elle paraisse et
qu'elle soit en somme très hardie, n'a rien qui déroute l'esprit.
Elle n'est qu'une conséquence logique du long travail
de transformation subi par le personnage du prologue. Avoir
recours à une allégorie, c'eût été rebrousser chemin
par
le choix que fit Térence, au contraire, se poursuivait l'évolution
normale, et l'on voit très bien la marche régulière
qui a conduit le personnage vers cette dernière étape : on
est même obligé d'avouer que, sous peine de rester incomplet,
le voyage devait aboutir à ce terme. Les devanciers
de Prologus ont appartenu, aussi complètement que les
personnages de la pièce proprement dite, au monde de la
fiction dramatique. Prologus fait bande à part et se rapproche,
on ne peut plus, du monde réel. Nous avons vu jusqu'à
quel point il en est voisin : il occupe, pour ainsi dire,
la frontière des deux régions, et au premier coup d'oeil on
ne voit pas distinctement dans laquelle des deux il se trouve.
Mais qu'il fasse un pas de plus, et l'incertitude cessera : il
entrera tout à fait sur les terres de la réalité. La personnalité
d'emprunt qui couvrait l'acteur chargé de ce rôle
n'était pas assez complète ni assez épaisse pour dérober
aux regards sa véritable personnalilé : elle ressemblait à
un brouillard transparent et sans consistance. Notre poète
le dissipa. Le personnage, ou plutôt l'ombre de personnage,
que l'on avait vue jusqu'alors sur la scène, s'évanouit
et il ne resta que l'acteur. Si l'on veut être d'une rigoureuse exactitude, il faut
cependant remarquer que Térence dut s'y reprendre à deux
fois pour opérer complètement cette métamorphose ; car le
prologue de l'Heautontimorumenos nous offre le phénomène
bizarre d'une sorte d'individualité hybride. Lorsque
Ambivius réfute, pour le compte du poète, les accusations
lancées par Luscius et ses partisans, ne croirait-on pas entendre
le vulgaire Prologus? Ce sont les mêmes affirmations
à la troisième personne, la même récitation presque machinale
d'une leçon apprise, le même effacement, le même rôle
de porte-voix. Mais il n'agit et ne parle pas toujours au
nom d'autrui : dans la première partie du prologue, d'abord
il s'acquitte, en faisant l'annonce, d'une formalité indépendante
des attributions de Prologus, puis il expose les
motifs tout personnels qui ont arrêté sur lui le choix extraordinaire
du poète ; dans la dernière partie, il sollicite,
en son propre nom, pour des raisons que Prologus ne pourrait
faire valoir, la bienveillance des spectateurs : il parle
des fatigues de sa profession, du désintéressement et du
zèle qu'il a toujours montrés dans sa longue carrière ; il
n'est plus du tout Prologus, il n'est plus que l'acteur-directeur
Ambivius. Un personnage provisoire, en pleine transition,
déjà sorti de son état ancien, mais non encore parvenu
à son nouvel état, voilà comment on peut définir ce
mélange.
L'étrangeté de cette création prouve que l'idée de remplacer
le personnage par l'acteur ne vint pas de prime abord
à Térence, claire et précise. Il y a pourtant dans le prologue
en question un vers qui ferait croire le contraire, si
on n'en mesurait avec soin la portée :
« ; le poète a voulu que je fusse un orateur, non
un Prologus. » Ces mots semblent indiquer que Térence
avait dès lors l'intention arrêtée de supprimer Prologus et que l'exécution seule fut imparfaite. Mais au fond il n'en
est rien ; nous avons vu en effet qu'ils conviennent aussi
bien au personnage des prologues ordinaires de notre
poète. Ils distinguent le Prologus de Térence, orateur, des
anciens Prologi, narrateurs. Le prologue de l'Andrienne
contient, sous une autre forme, une déclaration équivalente.
Ambivius ne fait que la renouveler : il n'est pas venu
pour raconter l'argumentum, et il donne à entendre que,
s'il s'était agi d'un récit, on n'aurait pas eu besoin de confier
le rôle à un acteur exceptionnel. Ses paroles caractérisent
une fois de plus la transformation du personnage par
Térence, mais elles ne marquent nullement sa suppression.
Le dessein du poète, au moment où il se mit à écrire le prologue
de l'Heautimorumenos, était sans doute seulement
de produire dans le rôle de Prologus un vieil acteur,
au lieu du jeune acteur traditionnel, de vieillir Prologus.
Mais il dépassa le but qu'il s'était marqué, et le choix irrégulier
de l'interprète eut, au point de vue de l'effacement
du personnage, des résultats dont Térence lui-même n'avait
peut-être pas d'abord prévu l'importance. C'était fatal ;
l'irrégularité commise n'avait qu'un objet : tirer de l'âge,
du passé, de la réputation de l'acteur, en un mot, de toute
sa personnalité, une efficace recommandation pour la pièce.
La personnalité d'Ambivius, ainsi mise en évidence, pouvait-elle ne pas apparaître avec une netteté frappante à
travers l'enveloppe légère et, pour ainsi dire, diaphane de
Prologus ? Sans doute, mème en temps normal, Prologus,
pour bien des choses, était tributaire de son interprète, au
point d'avoir avec lui une ressemblance qui ne nous a pas
échappé. Mais ces emprunts, il les faisait à l'acteur en général,
non à celui qui était en scène, au métier, non à l'individu qui, comme tel, n'avait pas à se découvrir. Ici tout
est bien différent : ce n'est pas à une abstraction, mais à
une personne que s'assimile Prologus, et de plus à une personne
point du tout banale, pleine de relief et d'originalité.
Aussi, quoiqu'incomplète encore, l'absorption du personnage
par l'acteur est-elle très sensible. Le prologue une fois
écrit, Térence fut certainement frappé des conséquences de
son innovation : il distingua alors le terme de la voie où il
s'était engagé et s'en vit tout proche. Il n'avait eu en vue
que l'introduction du vieil acteur dans le rôle de Prologus
et déjà Prologus n'existait presque plus.
Ce résultat constaté lui donna l'idée de le faire disparaître
tout à fait et ce fut dans cet état d'esprit qu'il composa le
second prologue de l'Hécyre. Ici plus rien de mixte ni de
confus : la période de transition est passée ; la métamorphose
est achevée. L'inventeur, instruit par une première
expérience, a perfectionné son procédé. Celui qui se présente
maintenant au public, non seulement ce n'est pas
Prologus, mais ce n'est pas non plus un mélange de Prologus et d'Ambivius, c'est d'un bout à l'autre du discours
Ambivius tout pur. Les idées qu'il émet sont toutes à lui
et il prend la responsabilité de toutes ses affirmations. Nulle
part on ne sent derrière lui le poète qui souffle la leçon :
ceci le distingue essentiellement du Prologus de Térence.
Point de compromis maladroitement avoué entre la réalité
et la fiction : point d'acteur venant dire, comme dans le
prologue de l'Heautontimorumenos : « On m'a confié un
rôle qui n'est pas de mon âge ; je l'ai appris ; je vais le
réciter. » Ambivius récite ici un discours appris, oeuvre
d'un autre, mais il en a soi peu l'air qu'on est allé jusqu'à
s'y méprendre et lui attribuer naïvement la composition de
ce prologue. Cependant, s'il n'est plus Prologus, il en a
gardé l'apparence ; il porte le costume du personnage dont
il a pris l'emploi : Térence n'a pas cru devoir le dépouiller de ces attributs
spéciaux pour le faire parattre dans un costume quelconque
de comédien, celui du rôle qu'il allait bientôt jouer dans la
pièce, ou bien sous ses vêtements de la vie ordinaire, comme
lorsqu'en sa qualité de directeur il venait avant le prologue
s'acquitter de la pronuntiatio tituli. Il est très vraisemblable
qu'il n'y a pas même songé. Que lui importaient à lui la
forme et la couleur de l'habit, s'il avait le défenseur de son
choix? Ou,s'il y a songé, il a reculé devant la crainte de
choquer en pure perte le public. Les mêmes spectateurs qui
virent sans se formaliser Ambivius usurper la place de
Prologus n'auraient-ils pas murmuré s'il était venu faire
sa harangue avec un autre costume que celui de Prologus ?
Ce sont les modifications extérieures qui frappent le plus
vivement la foule. La suppression de l'argumentum et l'attribution
du rôle au vieux directeur étaient dans le prologue
des nouveautés autrement essentielles qu'un changement
de costume. Mais elles ne sautaient pas aux yeux et, pour
en saisir la portée, il fallait quelque réflexion. Tant que
l'acteur chargé du prologue paraissait avec les insignes traditionnels, le regard ne donnait pas l'éveil à l'esprit ; au
fond le personnage avait pu changer, mais en apparence il
était le même. Le Prologus de Térence était un être si insignifiant que sa disparition causa moins de surprise que n'en
aurait causé celle de ses attributs.
Que l'idée de substituer dans le prologue l'acteur au personnage
fût absolument nouvelle, lorsque Térence composa
les deux prologues de l'Heautontimorumenos et de l'Hécyre,
cela n'est pas douteux. Pour nous en convaincre, il
ne faut que nous rappeler de quelle façon imparfaite cette
substitution fut exécutée la première fois : des remarques
déjà faites à ce propos on est en droit de conclure que le
poète ne se guida alors sur aucun précédent. Mais l'idée de faire jouer le rôle de Prologus par un vieil acteur, qui a été le point de départ de la transformation, était-elle aussi
neuve ? On ne saurait l'affirmer avec la même assurance ;
il se peut à la rigueur que quelqu'un des vieux comiques
l'ait eue une fois. Ce qui ressort des termes absolus où Ambivius
déclare que le rôle appartient aux jeunes gens, c'est
qu'une exception de ce genre ne s'était pas produite depuis
longtemps. Les anciens poètes, dont le prologue était un
récit, n'avaient pas à se servir d'un vieillard le même intérêt
que Térence, qui fit du sien un plaidoyer. Il est incontestable
qu'un orateur a besoin de plus d'autorité sur son
auditoire qu'un narrateur, puisque celui-ci se propose d'intéresser
et celui-là de convaincre. Il n'est pas moins incontestable
que l'âge contribue grandement à munir l'orateur
de cette autorité. Avant la transformation du prologue,
l'idée de le faire prononcer par un vieil acteur était donc
beaucoup moins naturelle qu'après. Au reste, une lointaine
exception, si elle était démontrée, n'amoindrirait guère le
mérite de Térence, et l'innovation, dans ce qu'elle a d'essentiel,
resterait d'ailleurs tout entière sa propriété. Ce qui
lui en inspira la pensée, ce fut d'abord le besoin et cette
sorte d'instinct de la conservation qui l'avait déjà poussé à
transformer le prologue pour en faire une arme à la fois
défensive et offensive ; il s'avisa qu'au lieu de la confier au
premier venu, il valait mieux choisir son champion. Ce fut
aussi l'heureux concours de circonstances qui le mit en relations
avec un directeur offrant des garanties extraordinaires.
S'il était tombé sur un homme vulgaire, il n'aurait pas
songé à se placer publiquement sous sa protection : mais la
différence était si frappante entre le novice Prologus et Ambivius, le vétéran de la scène, tant de fois vainqueur,
que le respect de la tradition ne pouvait vraiment pas contrebalancer
le désir de mettre en ligne un aussi vaillant
lutteur.
Dans ces conditions, pourquoi, après avoir trouvé cet expédient,
Térence ne s'en servit-il pas à chaque occasion ?
Car, si le début du prologue de l'Heautontimorumenos
atteste que jamais auparavant il n'avait rompu sur ce point
avec la coutume, il n'est pas moins certain que jusqu'au
second prologue de l'Hécyre Ambivius ne reparut plus à
la place de Prologus ; ce qui le prouve, c'est que, dès le
premier vers, il juge nécessaire de s'annoncer, tandis que
les prologues intermédiaires ne signalent rien d'anormal
sous le rapport de l'acteur ou du personnage. Térence n'a
donc fait appel au concours d'Ambivius que deux fois, dans
des circonstances graves, d'abord parce que l'intervention
du vieil acteur était un grand moyen qu'il ne fallait pas
user: ainsi, dans les guerres de l'histoire romaine, les vieux
soldats de la troisième ligne ne viennent aux mains avec
l'ennemi et les chevaliers ne mettent pied à terre que si la
bataille est acharnée et le danger pressant. Il y avait une
autre raison : Ambivius était âgé ; il jouait dans la pièce l'un
des premiers rôles. Même s'il avait mis sans restriction son
dévouement au service de Térence, celui-ci devait le ménager.
Il comprit parfaitement la situation et sut concilier
le souci de ses intérêts avec la discrétion qu'elle commandait.
VI
Térence, qui, pour de bonnes raisons, transforma le
prologue et Prologus, n'avait aucun intérêt à modifier l'extérieur
du personnage, le costume ; et nous avons la certitude
que sur ce point il a respecté la tradition. Si, en effet,
il avait introduit ici quelque changement, il aurait dû s'en
expliquer avec le public à la première violation de l'usage, comme il l'a fait pour ses autres innovations. Or, dans
aucun de ses prologues on ne trouve la moindre remarque
à ce sujet ; de plus, dans le dernier en date, le second de
l'Hécyre, il est dit formellement que l'acteur parait revêtu des insignes traditionnels :
" Orator ad vos venio ornatu Prologi."
La valeur de ce vers est considérable au point de vue qui
nous occupe : c'est le seul texte qui démontre que Prologus
prenait pour se présenter aux spectateurs des attributs spéciaux.
Il est vrai que, même en dehors de cette preuve
positive, le fait ne pourrait guère être mis en doute, du
moins pour le temps de notre poète et l'époque antérieure.
Puisque le Prologus ordinaire de Térence ne s'annonce
jamais comme tel, c'est que, grâce à une marque distinctive
quelconque, les spectateurs le reconnaissent au premier coup
d'ceil, et ne sont pas exposés à la confondre avec un personnage
de la pièce : car plus d'une comédie, dans le répertoire
romain, n'avait pas de prologue et commençait
d'emblée (1),
(1) Plusieurs pièces de Plaute sont dans ce cas.
C'est pour le même motif qu'à la représentation
de l'Heautontimorumenos ils comprirent tout de suite
qu'Ambivius allait tenir l'emploi de Prologus, et non remplir
sa mission de directeur ou jouer son rôle de la pièce :
aussi dès que le vieil acteur ouvrit la bouche, ce fut pour
dissiper la surprise provoquée par sa seule vue, sans qu'il
eût dit un mot.
L'existence d'attributs extérieurs particuliers à Prologus,
déjà usités avant les débuts de notre poète, est donc hors de
controverse. Mais de quelle importance étaient ces attributs?
S'agit-il seulement d'un emblème, plus ou moins considérable,
porté soit avec la toge, vêtement de la vie journalière,
soit avec le costume, quel qu'il fût, du rôle que l'acteur allait
ensuite jouer dans la pièce ? Le mot «ornatus », employé
.par Térence dans le texte déjà cité, nous fait plutôt songer à tout un costume qu'à un ornement de détail. Le même
substantif se retrouve, à ma connaissance, en trois autres
passages de ses oeuvres. Dans le premier, il a le sens très
large d'appareil, préparatifs de fête : Dave, qui revient de
chez Chrêmes, raconte à son jeune maître Pamphile que
rien dans la maison n'annonce pour le jour même la célébration
d'un mariage : « Matronam nullam in aedibus,
nihil ornati, nihil tumulti ». Dans le second, il désigne
l'aspect général d'un homme, l'état extérieur de toute sa
personne, et peut se rendre par le français « équipage » :
le parasite Gnathon, qui a rencontré un de ses compatriotes
réduit à la misère, en fait le portrait. Dans le troisième enfin, il a d'une
manière plus précise la signification de costume : Antiphon,
voyant sortir de chez Thaïs son ami Chæréa déguisé en
eunuque, s'écrie : « Qui hic ornatus est? » En aucun des
trois cas, on le voit, Térence n'a pris le mot en question pour
traduire l'idée de parure partielle. D'où la conclusion probable
que dans l'expression « ornatus Prologi », il n'a pas
non plus ce sens.
Cette conclusion se confirme au point de devenir certaine,
si l'on songe, d'une part, combien peu la toge convenait à
Prologus, d'autre part, quels inconvénients il y aurait eu à
faire paraître l'acteur chargé du prologue avec le costume
quelconque de son rôle dans la pièce. Que le directeur de
troupe soit en toge pour l'annonce, rien de plus naturel : il
ne fait pas à ce moment oeuvre de comédien, il ne dépouille
pas plus sa personnalité que le régisseur de nos théâtres
quand il vient, par exemple, solliciter l'indulgence du public
pour un de ses camarades. Mais Prologus est un personnage
: l'acteur qui est chargé du prologue joue un rôle. Or ce rôle, bien qu'il ne fasse point partie intégrante de la
pièce proprement dite, y tient encore par le contenu, au
temps des devanciers de Térence, des inventeurs de Prologus,
et se rattache à un ensemble grec, à une fabula palliata. Dans ces conditions, il est nécessaire que Prologus
soit vêtu à la grecque, non à la romaine. Même si cette nécessité
logique ne s était pas imposée à l'esprit des vieux
comiques latins, la seule force de la tradition les aurait entraînés car Prologus prenait la place de personnages,
allégorigues ou autres, qui tous portaient le costume grec,
et qui reparaissaient encore parfois. Et il ne suffisait nullement
de lui faire revêtir un costume grec quelconque, celui
qui convenait au rôle de l'acteur dans la pièce. Etant donnée
la variété des rôles que l'interprète de Prologus pouvait être
appelé à jouer dans la pièce (1), on serait arrivé ainsi souvent
à un résultat bizarre, ou même grotesque.
(1) Sur la variété des rôles que pouvait jouer le même acteur, cf, Plaute prol. des Ménec., à la fin, et Térence,Heaut. 39 sqq.
Sans doute Prologus
n 'a pas une individualité bien compliquée ; mais enfin
il a un sexe : en parlant de lui-même, il se sert partout du
genre masculin. Se le figure-t-on apparaissant sous des
habits de femme ? Il a aussi un âge : de l'attribution permanente
du rôle à un jeune acteur nous avons conclu avec
la plus grande vraisemblance à la jeunesse du personnage.
Lui sied-il dès lors de se montrer en vieillard ? Pour éviter
des inconvénients de cette sorte, qui n'auraient pas manqué
de se produire fréquemment, il fallait adopter une règle
générale et assigner à Prologus, une fois pour toutes, un
costume en rapport avec sa personnalité.
Mais si cette personnalité ne s'accommodait pas d'un costume
grec quelconque, il n'était pas non plus facile, égard eu à son extrême effacement, d'en imaginer un qui lui
convînt d'une manière spéciale. Comment donner un aspect
caractéristique à cet être dont l'essence était si simple, si
pauvre ? Les poètes de la nouvelle comédie n'éprouvèrent
pas le même embarras à vêtir leurs créations allégoriques, parce qu'elles avaient une individualité mieux déterminée
et plus complexe : de leurs attributions morales, riches et
bien définies, résultaient forcément des indications sur leur
extérieur. Ayant de plus à leur service une imagination
féconde qu'avivait encore la vue des nombreux chefs-d'oeuvre
inspirés par la mythologie aux arts plastiques, les
comiques grecs durent réaliser dans cet ordre d'idées des
merveilles d'à-propos et de variété, et associer savamment
pour la joie des spectateurs le plaisir des yeux à celui de
l'esprit. D'une façon générale, les personnages de prologue,
étant de nature divine, ne pouvaient être vêtus comme de
simples mortels : leurs costumes se distinguaient de ceux
que portaient dans la pièce les personnages de même sexe
et de même âge, souvent par la forme et toujours par la
magnificence. Mais Prologus, qui n'était point par sa nature
au-dessus des personnages de la pièce, de quel droit se
serait-il mis à une autre mode ou avec plus de somptuosité ?
Il n'y avait pas lieu d'enrichir à son intention la série des
costumes typiques de la palliata : il lui fallait choisir dans
cette garde-robe. Ses fonctions de narrateur, si elles n'exigeaient
pas un costume nouveau, ne repoussaient absolument
aucun de ceux qui existaient déjà. Ce qui détermina
le choix, ce fut donc le sexe et l'âge de Prologus : jeune
homme, il ne put prendre que les habits des jeunes gens,
des adulescentes.
Quel était ce costume Donat nous dit : « Adolescentibus
discolor (vestitus) attribuitur ; » ce que signifie que
les différentes pièces du vêtement
ne sont pas de même couleur. Les couleurs sont en général vives et voyantes :
blanc, rouge, violet, etc. Les deux pièces principales sont
la tunique, longue et à manches, et le manteau. Seulement,
pour les jeunes gens de la comédie, deux sortes de
manteau sont en usage : le pallium qui
s'enroule autour du corps, la chlamyde qui
s'agrafe sur l'épaule droite. Il n'est guère possible de savoir
avec une entière certitude lequel de ces deux manteaux
fut assigné à Prologus. Peut-être portait-il indifféremment
l'un ou l'autre. J'inclinerais cependant plutôt pour la chlamyde.
Car, s'il est bien vrai, comme nous l'avons avancé
plus haut, que le rôle était confié au plus jeune acteur de la
troupe, à un novice, Prologus étant éphèbe par l'âge, le
manteau des éphèbes lui convenait mieux que tout autre.
Nous trouverons tout à l'heure, dans les miniatures des manuscrits,
un nouvel argument à l'appui de cette opinion.
Ainsi, il pouvait arriver à l'acteur qui remplissait les fonctions
de Prologus de se présenter pour jouer ce personnage
avec son costume de la pièce : il était dispensé de changer
d'habits après le prologue, toutes les fois qu'il tenait dans
la pièce un rôle de jeune homme, ou d'une façon plus précise,
si l'on adopte notre opinion, un rôle d'éphèbe, comme
celui de Chaeréa dans l'Eunuque, Dans tous les autres cas,
il devait avoir deux costumes successifs. Voilà dans quel
sens on peut dire qu'au rôle de Prologus appartenait un
costume distinct.
Mais le personnage ainsi vêtu n'eût pas été reconnaissable
au premier coup d'oeil : une comédie pouvait n'avoir
pas de prologue et commencer par l'apparition d'un « adulescens.
» Or, d'emblée le public de Térence s'aperçut
qu'Ambivius tenait le rôle de Prologus. Il y avait donc dans
son extérieur quelque chose qui rendait toute méprise impossible.
De plus, si le costume de Prologus avait été celui
des jeunes gens, sans rien de plus, sans aucun signe distinctif,
Térence aurait-il pu employer l'expression « ornatu Prologi ? » Pour la comprendre, il faut admettre que les
comiques romains ajoutèrent aux vêtements, trop peu caractéristiques
de Prologus un emblème spécial. De même
que les dieux de marbre ou de bronze créés par les sculpteurs
grecs, les divinités allégoriques du théâtre avaient
sans doute, indépendamment du costume proprement dit,
certains attributs particuliers à chacune, dont le poète
trouvait l'idée dans la personnalité même qu'il donnait à
ces êtres de fantaisie. Ainsi le Lare qui récita le prologue
de l'Aululaire, portait peut-être une couronne (1), et il est
certain qu'Arcturus, chargé de dire le prologue du Rudens
avait une étoile au front ou dans la coiffure.
(1) Du moins il dit en parlant de la fille d'Euclion : "Dat mihi coronas" v. 25. Ceci n'est d'ailleurs qu'une conjecture.
Mais, à la
rigueur, les personnages de cette espèce auraient pu en général
se passer de pareils insignes : au début de leur discours
ils prenaient si bien soin de décliner leur nom et
d'énumérer leurs prérogatives, que leur identité n'était
nullement douteuse. Prologus au contraire, n'ayant pas
cette ressource, devait nécessairement être distingué par
quelque marque extérieure. Les devanciers de Térence
comprirent cette obligation et eurent même pour y satisfaire
une idée assez ingénieuse.
En Grèce, les suppliants avaient coutume de porter à la
main des rameaux ornés de bandelettes. Des traces fréquentes
de cet usage se retrouvent dans la tragédie. Les
filles de Danaos, dans les Suppliantes d'Eschyle, les prêtres
et les enfants réunis devant le palais, au début de l'OEdipe
Roi de Sophocle, les mères des sept chefs morts devant
Thèbes, dans les Suppliantes d'Euripide, paraissaient sur
la scène avec cet emblème. Et ce n'était pas là seulement
un usage de l'époque héroïque, reproduit par les poètes
tragiques ; il existait encore de leur vivant et longtemps
après eux : on le pratiquait en Sicile et dans l'Italie méridionale,
quand les Romains firent la conquête du pays. Tite-Live le signale en plus d'un endroit : tantôt ce sont
des habitants de Léontium « ramos oleae atque velamenta
alia supplicium porrigentes ; » tantôt des Locriens
« velamenta supplicium, ramos oleoe, ut Græcis mos est,
pnrgentes. » Au premier siècle de notre ère, les habitants
de Vienne, d'après Tacite, vont à la rencontre des soldats
de Valens, « velamenta et infulas prseferentes. »
C'est encore sans nul doute du même appareil qu'il s'agit
ici. Il semble que l'olivier, symbole de paix, était le feuillage
choisi de préférence. En dehors des suppliants proprement
dits, c'est-à-dire, des personnes qui, réduites à une
situation désespérée, imploraient la pitié des dieux ou des
hommes, le rameau orné de bandelettes était aussi, du
moins chez les poètes, l'attribut d'une autre classe d'individus
qui ont avec les premiers une analogie plus ou moins
grande suivant les cas : les ambassadeurs. Il est plusieurs
fois question de cet insigne dans l'Enéide. Débarqué en
Italie, Enée envoie vers Latinus cent députés.
Le chef de l'ambassade fait allusion dans son discours à ces
rameaux d'olivier.
Plus loin, Enée lui-même, dans le même appareil, arrive
chez Evandre pour solliciter son alliance. Ce feuillage, ces bandelettes, Prologus avait, lui aussi, le
droit de s'en parer. S'il n'était pas, avant Térence, le représentant
des intérêts personnels du poète, son avocat, il était
cependant déjà son envoyé auprès du public, une sorte
d'ambassadeur. Sa mission ne se bornait pas au récit de
l'argumentum. Après avoir instruit les spectateurs, sans
oublier de les amuser et de les flatter, il sollicitait formellement
leur attention et leur bienveillance, comme les ambassadeurs
d'un peuple demandent à un autre peuple la paix
ou sa protection. Ce rapprochement vint à l'esprit des
comiques romains et ils jugèrent que les emblèmes pacifiques
ne seraient pas déplacés entre les mains de Prologus.
Parmi les prologues de la palliata primitive, il s'en trouvait
sans doute plus d'un où était expliquée la raison d'être de
cet attribut, alors nouveau, mais si familier aux yeux des
contemporains de Térence qu'il eût été tout à fait oiseux de
le leur signaler. En l'adoptant, non seulement on donnait
à Prologus un aspect individuel qui supprimait toute chance
de confusion, mais encore on rehaussait le prestige du personnage,
qui en avait grand besoin : à ces insignes il empruntait,
sinon un véritable caractère sacré, comme les suppliants
et les ambassadeurs, du moins l'ombre, la fiction
d'un caractère sacré. C'était une sorte de dédommagement :
Prologus, qui n'avait pas, comme ses devanciers, l'avantage
d'être dieu, portait encore la livrée de ceux que protégeaient
les dieux.
Il n'y a pas de texte ancien qui attribue à Prologus le
rameau orné de bandelettes. Mais notre opinion, que la nécessité
d'un insigne distinctif et la parfaite convenance de
celui-ci font déjà très vraisemblable, est confirmée par un
monument figuré de la plus grande valeur. Deux des principaux
manuscrits de Térence, le Vaticanus et le Parisinus, sont ornés, en tête de chaque scène, de miniatures en couleur dans le premier, noires dans le second,
représentant les personnages. Nous avons là deux copies,
sans doute indirectes, très grossièrement exécutées, d'un
même original excellent et très ancien. Or, Prologus s'y
trouve figuré, non pas toujours, mais quelquefois, avec un
rameau à la main. Le Parisinus fournit un seul exemple :
le Prologus des Adelphes (1), portant un rameau de forme très
allongée, assez semblable à une palme.
(1) Mm. Dacier y voit une branche de cyprès et croit que Prologus la porte parce que la pièce fut jouée aux funérailles de Paul-Emile. L'explication est mauvaise, puisque dans le Vat. Prologus du Phormion a aussi le rameau.
Le Vaticanus nous
en offre deux : le Prologus des Adelphes, avec un rameau
plus court et plus large, de je ne sais trop quel arbre ; le
Prologus du Phormion, avec un rameau dont les feuilles
étroites rappellent fort celles de l'olivier. D'ailleurs, je ne
connais ces deux dernières figures que par des reproductions
dont Wieseler a signalé l'infidélité. Partout le rameau
est dans la main gauche, la droite restant libre pour le
geste; nulle part il n'est accompagné de bandelettes. Si
l'usage a réellement existé de distinguer Prologus par un
rameau, l'on s'explique très bien la présence de cet insigne
dans les trois miniatures ; et on ne peut guère se l'expliquer
autrement Les copistes étaient bien plus à même de supprimer
que d'ajouter. C'est par leur négligence qu'ont disparu,
avec les bandelettes, les rameaux des autres Prologi.
On la prend, pour ainsi dire, sur le fait dans la figure du
Prologus du Phormion, telle que la donne le Parisinus ;
la ressemblance de cette figure avec celle du Vaticanus est
frappante : même costume et même attitude, même position
de la main gauche cachée sous le manteau ; mais le copiste du Parisinus a négligé de dessiner le rameau qu'elle tient
dans le Vaticanus.
L'absence presque constante du rameau n'est pas la seule
inexactitude à relever dans les miniatures. D'abord Prologus
y porte le masque, ainsi que tous les autres personnages.
Or, il est à peu près démontré aujourd'hui que les
masques n'étaient pas en usage au temps de Térence.
Puisque chacun de ses prologues n'a servi que pour une
représentation donnée de son vivant, son Prologus, qui ne
lui a pas survécu, à la différence de ceux des autres poètes,
n'a jamais porté le masque. Il est certain, en particulier,
qu'Ambivius récita deux fois le prologue à visage découvert;
car les spectateurs reconnurent d'emblée, non seulement
qu'ils avaient devant eux un vieillard, mais encore qui
était ce vieillard. Comment d'ailleurs aurait-il pu prendre
un masque, alors qu'il se présentait sur la scène avec sa
personnalité réelle ? Il n'avait pas non plus besoin de la
perruque, qui alors tenait lieu de masque. Quant à Prologus,
en sa qualité de jeune homme, il portait la perruque
noire (1).
(1) La perruque tenait lieu de masque. L'âge et la condition du personnage
se reconnaissaient à la couleur.
Le costume proprement dit n'est pas non plus, tant s'en
faut, fidèlement rendu dans nos manuscrits. Dans les deux,
Prologus est vêtu en vieillard pour l'Heautontimorumenos,
l'Hécyre et les Adelphes ; en éphèbe pour le Phormion, en
esclave pour l'Andrienne. Le Parisinus ne donne pas le
Prologus de l'Eunuque, le Vaticanus en fait, semble-t-il,
un esclave. Faut-il pour cela renoncer aux conclusions
déjà acquises et admettre que Prologus pouvait porter un costume grec quelconque ? Non. Les manuscrits ont tort
et leur erreur s'explique. L'archétype de nos miniatures
était l'oeuvre d'un homme au courant des choses, telles
qu'elles se passèrent au temps de Térence, excepté peut-être
en ce qui concerne l'usage des masques. Ce qui le prouve,
c'est qu'il avait donné le rameau à Prologus. Il avait figuré
cinq fois le personnage sous les traits et le costume d'un
jeune homme. Au Prologus de l'Heautontimorumenos et
au second Prologus de l'Hécyre, il avait donné les traits
d'un vieillard, sachant que les deux prologues avaient été
dits par Ambivius; par une erreur excusable, il leur avait
donné aussi le costume des vieillards. De là, confusion
dans l'esprit des copistes qui, ne voyant pas la raison de
cette différence et n'étant pas guidés ici, comme dans la
pièce, par une indication placée après le nom de chaque
personnage, crurent pouvoir prendre toute liberté, sous la
seule condition d'attribuer à Prologus un costume masculin.
En somme, le Prologus d'une seule comédie, du Phormion,
est représenté en jeune homme; dans nos deux manuscrits,
il a le manteau des éphèbes, la chlamyde, ce qui semble
venir à l'appui de notre opinion exprimée plus haut, Enfin,
dans la figure du Vaticanus, il porte le rameau distinctif.
Cette représentation est, de toutes celles que nous possédons,
la plus voisine de la vérité historique.
VII
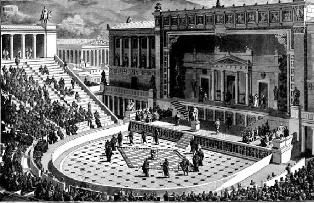
Grâce à Térence, le prologue de la comédie est arrivé à
la pleine indépendance : sans liaison extérieure avec la première
scène, il ne se rapporte à la pièce, par son contenu,
que d'une façon accidentelle, et le personnage qui le récite appartient à un autre monde que ceux du drame, quoiqu il
s'habille comme eux à la mode grecque. Dès lors on peut
dire que l'évolution du prologue est terminée. Dans son
histoire, il ne se rencontrera plus de nouveauté importante;
mais des retours au passé, complets ou partiels, pourront se
produire. Il y a donc intérêt à la suivre, tant que dure le
développement de la comédie latine, si nous voulons
savoir quels furent l'influence et le sort des réformes de
notre poète. Malheureusement, la période dont il s'agit est
des plus obscures. L'oeuvre des écrivains de la palliata
postérieurs à Térence, de la togata, de l'atellane et du mime
a péri de fond en comble. Avec les débris insignifiants de
cette ruine et les rares renseignements fournis par les auteurs
anciens, impossible d'arriver partout à la certitude ;
établir.
C'est par la suppression de l'argumentum et la transformation
de la captatio benevolentix que Térence avait renouvelé
l'office du prologue. Il faut reconnaître que ni l'une
ni l'autre de ces réformes ne pouvait faire école. L'argumentum était un expédient si commode! Commode pour le
poète, à qui il simplifiait la tâche de l'exposition, toujours
difficile, mais plus que jamais dans les genres nouveaux où
l'original grec ne guidait pas l'auteur romain ; commode
pour le public, qu'il dispensait d'une attention soutenue et
de toute sagacité. Consacré par l 'usage, employé par le plus
populaire des comiques, sa grossièreté ne choquait que les
délicats raffinés, tels que Térence. L'arrêt de suppression
qu'il avait porté ne fut sûrement pas confirmé par ses successeurs,
et le septième siècle vit encore fleurir l'argumentum à la manière romaine, aussi bien que le monologue
préliminaire à la manière grecque. Quant à faire du prologue
un plaidoyer, il fallait pour s'y résoudre un concours de circonstances exceptionnelles, comme celles qui suggérèrent
à Térence cette idée originale. A moins d'être attaqué
avec acharnement par des ennemis assez redoutables
pour mériter une réponse publique, situation heureusement
rare, avait-on le droit d'entretenir les spectateurs de sa personne
? Le moi est haïssable, a dit Pascal. C'eût été le
moyen de déplaire. Si l'on voulait disposer favorablement
le public, des plaisanteries et des flatteries valaient bien
mieux.
On ne saurait même affirmer qu'après Térence, dans aucun
des genres comiques qui se succédèrent pendant le
septième siècle sur le théâtre romain, il y ait eu un seul prologue
du type créé par lui. Ceux qui servirent pour les reprises
des comédies de Plaute n'étaient que des remaniements,
sans altération essentielle du contenu authentique (1).
(1) Si, à l'époque des reprises, telle pièce qui n'avait pas de prologue, en reçut un (p. ex. l'Asinaria), il fut naturellement composé sur le modèle des autres.
De
Turpilius, un des derniers représentants de la palliata,
nous savons que dans son Épicleros, il avait remplacé le
monologue initial du modèle grec par une exposition dialoguée,
ce qui dénote chez lui une tendance à se passer de
l'argumentum ; mais il est vraisemblable que dans ce cas
il fit ce qu'aurait fait Térence, s'il avait été libre d'agir selon
sa décision primitive, qu'il supprima le prologue. Afranius,
au moins une fois, s'en servit comme Térence, dans
un but d'apologie personnelle et littéraire. On l'avait accusé
de mettre au pillage Ménandre : il répondit à ses détracteurs
qu'il ne s'en cachait pas, qu'il en avait fait autant pour bien
d'autres poètes, même pour un poète romain, Térence, que
dans le même discours il proclama sans rival. Toute cette partie du prologue des Compitalia rappelait absolument
par le fond ceux de Térence. Mais qui nous dit que dans le
reste du morceau rien n'était à la vieille mode? Afranius
admire et imite Térence ; il admire et imite aussi Ménandre
à l'exemple duquel il s'est servi, nous le verrons tout à
l'heure, des divinités allégoriques. Ce mélange du récit et
du plaidoyer, s'il a réellement existé, doit être signalé
comme une innovation dans le prologue. Dans l'éloquent
discours en vers que le chevalier-poète Labérius prononça
sur la scène, le jour où, contraint par César, il y monta
pour jouer lui-même un de ses mimes, c'est aussi de la personne
de l'auteur qu'il est question ; seulement, au lieu
d'un plaidoyer, nous entendons une lamentation. D'ailleurs,
si Afranius s'est inspiré de l'exemple de Térence, on ne
peut en dire autant de Labérius: le chevalier romain, obligé
à se déshonorer sur la scène, n'a songé qu'à la honte inouïe
de sa situation. Mais le morceau que nous possédons formait
il à lui seul un tout complet et distinct ? Sans doute,
on répugne à se le figurer soudé avec l'exposition forcément
bouffonne d'un mime. Cependant, il n'y a pas là de
preuve formelle, et peut-être appartenait-il à un de ces prologues mixtes dont nous parlions tout à l'heure.
Relativement à l'annonce, les choses se passèrent après
Térence comme avant, c'est-à-dire qu'en général elle resta
étrangère au prologue. Du moins, il n'y a pas de raison de
croire que l'usage établi dès l'origine du théâtre régulier se
soit modifié au cours du septième siècle. Bien plus, un témoignage
ancien en atteste l'existence au temps de César,
lorsque fleurissait le mime. La palliata avait
cédé la place à la togata, la togata à l'atellane, l'atellane
au mime ; mais la coutume s'était maintenue d'une annonce
faite tout de suite avant la représentation par un acteur,
l'acteur principal sans doute. Seulement, depuis la chute
de la palliata l'annonce était plus courte : il n'y avait plus
d'original et de poète grec à nommer. Cette persistance de
l'ancien usage n'a rien que de très naturel : les conditions
qui l'avaient fait adopter et que nous avons étudiées plus
haut, n'étaient nullement changées.
Cependant il faut admettre que dans cette longue période
il y eut sous ce rapport quelques dérogations à la règle générale,
comme celles que Térence s'était accidentellement
permises. Pour des raisons exceptionnelles, il put arriver à
un auteur de renvoyer après les premiers vers du prologue
les renseignements ordinaires, en totalité ou en partie. Le
fait se produisit pour la Casina de Plaute, à la première
reprise posthume. Contrairement à l'usage qui était de donner
des nouveautés, un entrepreneur de spectacles, dans les
premières années du septième siècle, eut l'idée de reprendre
les comédies de Plaute. Il commença par Casina. Ce jour-là
il crut bon de supprimer l'annonce préliminaire et de renseigner
le public seulement au courant du prologue, après
lui avoir donné les raisons de son innovation. Elle réussit,
et la série des reprises de Plaute continua. Mais alors ce qui
attira le public au théâtre, ce fut le nom de l'auteur latin
et ce nom seul ; le titre de la pièce et le nom de l'auteur
grec, si importants quand il s'agissait d'une oeuvre nouvelle,
parce qu'ils servaient précisément à en démontrer la nouveauté,
n'étaient ici que d'un intérèt très secondaire. Aussi
les directeurs de troupe, aux représentations de cette sorte,
ne prirent-ils plus la peine de venir faire l'annonce. Le nom de Plaute fut publié en même temps que l'heure du spectacle
: quant aux autres indications, ou bien elles furent omises
comme inutiles, ou bien, plus ou moins complètes, elles
prirent place dans le prologue (1).
(1) Parfois le titre qu'on attribue à la pièce dans ces prologues n'est pas celui que lui donnent les manuscrits : Casina est appelée Sorticntes ; Poenulus, Pater pultipliagonides. Le nom ne faisait rien à l 'affaire. On ne se faisait pas non plus scrupule de donner comme étant de Plaute des comédies d'autres poètes moins populaires : le pavillon couvrait la marchandise. Ainsi se forma cette longue liste d'où Varron s'efforça de dégager les pièces authentiques.
Voilà pourquoi nous trouvons
ces renseignements dans plusieurs prologues des comédies
de Plaute, ceux de l'Asinaria, du Mercator, du
Miles, du Poenulus, du Trinummus, sans compter celui de
Casina. Le plus souvent l'interpolation a été faite d'une
manière très maladroite.
Prologus ne fut pas dans la période de Térence l'unique
personnage du prologue. Ses devanciers, les dieux de
théâtre, reprirent plus d'une fois leurs fonctions, et l 'exclusion
absolue dont notre poète les avait frappés ne fut pas
maintenue. S'il était bien prouvé qu'il faut
prendre au pied de la lettre l'affirmation du grammairien,
tous les comiques du septième siècle auraient fait usage des
figures allégoriques, ce qui n'est pas du tout invraisemblable
: chacun d'eux a bien pu, au cours de sa vie, trouver,
ou emprunter au riche répertoire des Grecs, quelque
personnage de ce genre. Quoi qu'il en soit, dans les reprises de Plaute on revit sur la scène ceux qu'il avait créés : car ses prologues grecs servirent pour les représentations posthumes
avec autant de convenance que pour la première. Un
poéte de la togata, Afranius, paraît avoir eu un goût très
marqué pour ces divinités complaisantes, d'accord en cela
avec Ménandre dont ses ennemis lui reprochaieut de piller
les comédies. Nous savons qu'il avait confié le prologue de
sa Sella à Sophia; cette déesse se faisait en ces termes connaître
aux spectateurs.
Au début d'une autre pièce, apparaissait dans le même
rôle Priape, et un fragment nous le montre s'efforçant de
discréditer une version qui avait cours sur sa naissance.
A la même catégorie appartenait peut-être une individualité fantastique.
On conçoit que souvent, dans l'intérêt de la variété et de
l'agrément, Prologus, banal et terne, se soit vu dédaigner
pour des figures plus brillantes et plus neuves.
Mais quand on n'avait pas mieux, c'est-à dire dans le cas
le plus fréquent sans doute, on revenait à lui : car, aussi commode que l'argumentum, il était toujours prêt à tirer
les gens d'embarras. Faute de textes, il nous est impossible
de dire ce qu'il devint au juste chez les divers poètes qui
l'employèrent et selon quelle proportion chacun d'eux mêla
les deux éléments que l'analyse nous a fait découvrir dans
cette bizarre individualité, l'un emprunté à la personne de
l'auteur, l'autre à celle de l'acteur. D'une façon générale,
s'il est vrai que l'argumentum et la vieille captatio benevolentioe reprirent faveur, pour être dans son rôle, Prologus
dut se faire remarquer par la verve abondante et bouffonne
du narrateur de Plaute plutôt que par l'élégance modeste
et grave de l'orateur de Térence. Avec des nuances propres
à chaque poète, il reproduisit à peu près le type que nous
présentent les prologues actuels de Plaute.
Les successeurs de Térence eurent-ils quelquefois l'idée
de faire réciter le prologue par le directeur de la troupe?
C'est possible. On peut mème conjecturer, d'après la nature
des idées exprimées au début et quoique rien dans le texte
ne l'indique formellement, que tel fut le cas pour le prologue
actuel de Casina. Les circonstances exceptionnelles de la
représentation justifiaient ce jour-là le choix d'un acteur
exceptionnel. Au premier abord on croirait aussi que le
prologue du Poenulus, où le personnage s'intitule « imperator
histrions », fut joué par un directeur de troupe, mais la
lecture attentive du contexte montre que le sens de cette
expression est tout autre. Dans l'Achille, le
chef haranguait son armée ; Prologus parodie le début de
ce discours ; les spectateurs sont les soldats, il représente
lui-mème le chef, mais ce chef, dit-il, n'est qu'un histrion.
D'ailleurs, s'il est probable que l'acteur principal a parfois
remplacé l'acteur ordinaire du rôle, jamais, à notre connaissance,
il ne s'est substitué au personnage, à Prologus, avec
la même franchise qu'Ambivius, jamais le choix d'un interprète
extraordinaire n'a eu pour conséquence un changement
aussi net et visible d'individualité. Il n'y a de comparable
à la hardiesse de Térence que celle de Labérius, qui, un jour, dans les circonstances dont nous avons déjà parlé,
mit à la place de Prologus une autre personne, non pas
celle d'un tiers, mais la sienne propre ; il est vrai que ce
jour-là, par la volonté de César, le poète fut en même temps
acteur, et acteur principal. Quant au fragment, cité plus
haut, du prologue des Cornpitalia, où Afranius parle à la
première personne, il n'implique pas du tout la présence du
poète sur la scène. Au lieu de reproduire sa réponse en
discours indirect, comme le Prologus de Térence, le personnage,
Prologus ou autre, en fait une citation directe.
A part quelques exceptions, l'usage de confier le rôle de
Prologus à un jeune histrion se maintint certainement au
septième siècle. Les prologues actuels de Plaute montrent
bien que l'emploi était aussi pénible alors qu'auparavant ;
les vieux acteurs n'avaient pas sujet de se l'approprier. Le
costume traditionnel de Prologus fut-il aussi conservé, tant
que dura la palliata ? Il est à peu près sûr qu'il était tombé
en désuétude à l'époque où fut composé le prologue
actuel du Poenulus. Quand l'acteur dit : « Ego ibo, ornabor.... ibo, alius nunc fieri volo, (1) »
(1) Poen. prol. 123... 126.
il ne faut pas chercher
à expliquer ces paroles en admettant qu'il s'agit d'un changement
de costume, et que l'acteur ne joue pas dans la pièce
un rôle d'adulescens ; il faut reconnaître qu'à ce moment il
porte ses habits ordinaires et n'a pas de masque. Mais
quand et comment fut rompue la tradition ? sans doute au
début du siècle, lorsque commença la vogue de la togata :
dans ce nouveau genre, Prologus était un jeune romain, le
personnage devait porter sur la scène les mêmes habits que
l'acteur dans la vie réelle ; on se dispensa dès lors de lui
donner un masque ; on ne garda que le rameau distinctif.
Cette coutume, déjà en vigueur au temps des reprises de Plaute, fut conservée pour ces représentations de palliata.
Les entrepreneurs, esprits grossiers, n'en saisirent pas l'inconvenance.
D'ailleurs la notion du rôle et du personnage,
claire pour ceux qui inventèrent Prologus et le mirent à la
place des divinités allégoriques, devait être alors, si loin de
l'origine, bien confuse et bien effacée. En ce qui concerne
l'atellane et le mime, il serait téméraire de vouloir préciser
quelque chose au sujet du costume qu'y porta Prologus.
Nous arrêtons notre histoire du prologue aux limites où
finit celle de la comédie latine. Il ne nous appartient pas de
la suivre dans les théâtres du moyen-âge et des temps modernes.
LA POLÉMIQUE DES PROLOGUES DE TÉRENCE
Le contenu principal des prologues de Térence se divise
en deux parties d'importance inégale. La moins étendue
comprend les recommandations empruntées'à la personne
d'Ambivius : nous nous en sommes suffisamment occupé,
quand nous avons étudié la substitution du vieil acteur à
Prologus. La plus considérable n'est autre chose que la
polémique de Térence contre ses détracteurs : elle va faire
l objet d 'un examen spécial. En dehors de cette division, il
ne reste que les formules de politesse ou de sollicitation à
l'adresse du public et quelques développements secondaires
de nature diverse.
Voici, d après le tableau sommaire de la polémique tracé
au chapitre précédent, la liste, dans l'ordre où ils se sont
produits, des griefs littéraires imputés à Térence : contamination,
plagiat, collaboration clandestine, défauts du ton et
du style des pièces, pauvreté d'invention des prologues.
Nous avons déjà dit ce qu 'il faut penser de cette dernière
accusation. Nous mettons aussi à part le reproche moral de
médisance, auquel la réponse était fort simple : Térence
avait pour lui l'excuse de légitime défense, et l'analyse oratoire
des prologues, considérés comme des plaidoyers, nous fera voir plus tard, avec quelle habileté il s'en est couvert.
Quant aux autres critiques, elles appellent dès à présent
une discussion attentive qui en fixera le sens et la portée,
ainsi que la valeur des moyens de justification fournis par
Térence. Nous le suivrons ensuite, lorsque, prenant l'offensive,
il signale à son tour les fautes de Luscius, son principal
adversaire, dont nous avons déjà fait un rapide portrait.
Rien de plus intéressant et de plus profitable que l'étude de
cette polémique : par elle on pénètre à fond dans l'âme de
Térence, on connaît le talent du poète et le caractère de
l'homme. C'est la meilleure préparation à une lecture
sérieuse de son théâtre.
1
Le reproche de contamination fut adressé à la première
pièce de Térence, l'Andrienne.
Nous ignorons s'il fut renouvelé contre l'Eunuque, qui tombait
sous le coup de la même critique; il n'y est fait aucune
allusion dans le prologue. Avant la représentation de l'Heautontimorumenos,
on le reproduisit encore, mais sous une
forme plus générale, sans rappliquer à une pièce spécialement
désignée.
A partir de ce moment, il n'en est plus du tout question dans
les prologues, quoique les Adelphes aient fourni à la cabale
une occasion de le rééditer. Elle l'abandonna sans doute, après deux essais infructueux, comme une arme impuissante.
Avant d'étudier l'artifice de composition qui valut ces
attaques à Térence, il nous importe de préciser le sens du
mot dont il se sert dans les deux passages où il relève l'accusation.
Le verbe « contaminare » se rattache, par l'intermédiaire
de « contamen » et de « con-tango», à la
racine « tag ». Etymologiquement il ne signifie pas autre
chose que « mettre en contact, mélanger ». Mais à cette
idée primitive de mélange s'est associée naturellement l'idée
très voisine d'altération. Puis, prenant peu à peu plus d'importance, elle en est enfin venue jusqu'à exclure le primitif, sens et « contaminare » n'a plus signifié alors que
« altérer, gâter, souiller ». Cette signification dérivée est
celle qui domine à l'époque classique. Elle ne convient
évidemment pas aux deux textes de Térence : le procédé
qu'on reproche au poète est un mélange. D'autre part, il
ne faut pas non plus y donner au mot sa seule force étymologique.
D'abord, à notre connaissance, aucun écrivain latin
ne l'a ainsi employé. Ensuite Térence lui-même, qui, en dehors des prologues, s'en est servi une fois, lui donne le sens mixte. Lorsque Chæréa, après son aventure amoureuse,
s'élance hors de chez Thaïs, il s'écrie :
« Cc'est maintenant, certes, que je puis me laisser mettre à
mort, pour que la vie ne mèle pas quelque chagrin à ma
joie présente. » L'idée d'altération est inséparable dans cette
phrase de l'idée de mélange, et notre verbe français « mêler »
traduit très bien «contaminare» parce qu'ici il les
exprime toutes deux. L'intention de ceux qui employèrent
le mot contre Térence, achève d'en éclairer le sens. Ce
qu'ils critiquaient chez le poète, ce n'était pas seulement le mélange des comédies grecques, c'était aussi et
surtout le résultat de ce mélange, l'altération subie par les
oeuvres ainsi traitées. Ils voulaient signaler le procédé de
Térence et du même coup le flétrir. Pour formuler leur
grief, il fallait une expression forte et caractéristique, qui
éveillât nettement dans l'esprit les deux idées, qui fût à
elle seule un blâme sévère. Le contexte des passages de
Térence montre que « contaminare » est bien le mot choisi
et employé par eux-mêmes. S'ils le choisirent, c'est que
dans la langue de leur temps il avait toute cette force.
« Gâter les pièces grecques en les mélangeant, » voilà ce
que signifie « contaminare fabulas graecas. »
D'après les prologues, trois comédies de Térence, l'Andrienne, l'Eunuque et les Adelphes, sont le résultat de ce
que Luscius et les siens appelèrent une contamination,
c'est-à-dire, du mélange de deux comédies grecques.
Pour composer sa pièce, il a pris deux pièces de Ménandre,
semblables quant au sujet, mais différentes quant
aux pensées et au style. L'une, l'Andrienne, lui a servi
de base, d'original principal : il y a fait passer certaines
parties de l'autre. A cela se bornent ses indications. Il ne signale pas les parties empruntées à l'original secondaire,
parce qu'il n'a aucun intérêt à préciser. Ce n'est pas, en effet, tel ou tel détail de la composition, c'est seulement la
légitimité du procédé qu'il doit défendre contre le principe
posé par ses adversaires :
« Contaminari non decere fabulas. »
Il nous faut donc recourir à d'autres sources d'informations,
si nous voulons savoir ce dont l'Andrienne latine est redevable
à la Périnthienne. Térence a donc
pris pour modèle la première scène de la Perinthia, et non
celle de l'Andria ; seulement, dans son exposition, il a
remplacé la femme de Simon par l'affranchi Sosia, sans
doute parce que l'ignorance de certains faits que raconte le
chez la mère de Pamphile ; il a dû trouver aussi que le
rôle d'espion, dont Simon charge Sosia et qui motive la
confidence, ne convenait pas à la dignité de la matrone,
non plus que les réflexions et les aphorismes passablement
vulgaires, tout à fait dignes d'un subalterne, dont l'interlocuteur
souligne de temps en temps les paroles du narrateur.
Mais était-ce là le seul emprunt fait à la Perinthia ? La
chose en soi ne semble guère probable : eût-on pour si
peu accusé Térence d'avoir contaminé deux pièces grecques?
D'ailleurs Donat nous met sur la piste d'un autre emprunt,
par cette note au vers 301, à propos des personnages épisodiques
Charinus et Byrria. Les deux rôles n'appartenaient donc pas à l'Andria grecque : ils
se détachent en effet très facilement, sans préjudice pour
l'ensemble. Or Térence ne les a pas tirés de son propre
fonds : de la part d'un poète qui dans ses autres oeuvres
a toujours suivi de près ses originaux grecs, un pareil acte
d'indépendance est invraisemblable, surtout à ses débuts ;
s'il avait pris la liberté d'introduire dans le modèle grec un
épisode de sa façon, ses ennemis qui lui reprochèrent un
simple mélange d'éléments empruntés à Ménandre, n'auraient
pas manqué de la signaler comme une altération
encore plus grave, et il aurait dû se disculper aussi de ce
chef dans le prologue ; enfin n'est-il pas frappant qu'un
fragment de la Perinthia de Ménandre, cité par Athénée :
corresponde à deux vers de Térence, qui font justement partie d'une scène où figurent Charinus et Byrria ?
Les deux rôles furent donc pris à la Perinthia ; cela est,
sinon évident, du moins à peu près certain. Pour ètre exact,
Donat aurait dû dire : « Non sunt apud Menandrum in
Andria. » Il ne s'est pas exprimé ainsi, parce qu'il n'a pas
eu sous les yeux l'original secondaire et ne l'a connu qu'indirectement,
comme le prouve l'absence de toute citation.
Mais enfin, puisque les deux pièces de Ménandre étaient
de sujets semblables et que Térence trouvait dans la Perinthia
un ensemble de personnages plus complet, mieux
à son goût, pourquoi ne l'a-t-il pas choisie pour original
principal? C'est que l'Andria, malgré cette infériorité, facile d'ailleurs à réparer, avait toutes ses préférences au point de
vue des pensées et du style (1).
(1) II est possible que Térence ait emprunté quelques détails, en dehors de ces deux emprunts principaux, soit à la Perinthia, soit à une autre source.
Sur la composition de l'Eunuque, Térence nous donne
dans le prologue les renseignements suivants : l'original
principal est l'Eunuque de Ménandre.
Il y a de plus un original secondaire, le Colax, du même
poète.
Térence a fait passer du Colax dans l'Eunuque les personnages
du parasite et du soldat, comme il avait déjà transporté
Charinus et Byrria de la Périnthienne dans l'Andrienne.
Rien n'empêche de la tenir pour rigoureusement
exacte. On peut très bien, en effet, supprimer les deux
rôles dont il s'agit; l'unité de l'action n'en reste pas moins
intacte, et la marche de l'intrigue n'est aucunement entravée.
Ni Thrason ni Gnathon ne paraissent au premier acte. Il y
est seulement question d'un soldat, rival de Phaedria auprès
de Thaïs. La courtisane, qui ne l'aime pas, est forcée pour
le moment de le ménager ; car il va lui faire présent d'une
jeune esclave, Pamphila, qu'elle tient beaucoup à posséder,
parce qu'elle la sait de condition libre par naissance et
pourra bientôt la rendre à sa famille. A l'acte II, scène 2,
la jeune fille est amenée chez Thaïs par le parasite Gnathon. Cette démarche avait aussi lieu dans la pièce grecque ;
elle est indispensable pour la suite de l'action ; elle motive
la scène 3, où Chaeréa se présente désolé d'avoir perdu la
trace de Pamphila qu'il suivait, où Parménoa lui apprend
qu'elle vient d'entrer chez Thaïs, où se décide, enfin, la
substitution de Chaeréa à l'eunuque. Mais la participation
de Gnathon à cette démarche n'est pas du tout nécessaire :
dans la pièce grecque, la jeune fille était sans doute conduite
par un esclave quelconque du soldat ; en arrivant sur
la scène, il disait en deux mots sa mission ; puis, apercevant
Parménon, il engageait avec lui une petite conversation.
Le monologue de Gnathon (1-34) est donc tiré du
Colax, le dialogue qui suit se trouvait dans l'Eunuque.
C'est dans ce sens qu'il faut interpréter la remarque de
Donat au vers 228 : « Haec apud Menandrum in Eunucho
non sunt, ut ipse professus est, parasiti persona et militis,
sed de Colace translatae sunt. » La scène première de
l'acte III n'est en rien utile à l'action ; que viennent faire
chez Thaïs le soldat et son parasite ? Ils viennent la prendre
pour le festin. Mais elle a déjà reçu l'invitation1 et s'y rendrait
bien toute seule. Il est vrai que cette scène est liée à
la suivante, où Parménon amène à Thaïs l'esclave noire et
le prétendu eunuque, présents de Phædria. Mais la liaison
est l'oeuvre de Térence ; on peut la rompre sans préjudice
pour l'action. Dans l'Eunuque grec, au début de l'acte,
au moment où Thaïs (Chrysis) partait pour se rendre
chez Thrason, Parménon lui présentait les cadeaux de son
maître. Remarquons ici, une fois pour toutes, qu'en dehors
de la scène du second acte où le parasite a pris la place
d'un autre personnage, Thrason et Gnathon ne paraissent
jamais qu'au commencement ou à la fin d'un acte; les scènes
où ils figurent ne sont jamais fortement unies à l'ensemble :
elles y sont soudées par un bout ; avant ou après se trouve
une pause de l'action. Ainsi l'acte IV se termine par la marche offensive du soldat, de son parasite et de son armée
contre la maison de la courtisane. Cette scène épisodique
se sépare sans effort de la précédente. Dans l'Eunuque de
Ménandre, Thaïs revenait en toute hâte de chez le soldat,
qui, irrité par la jalousie, l'avait menacée d aller lui reprendre
Pamphila. Chrémès, le frère de la jeune fille, recommandait
de tenir la maison fermée, tandis qu'il irait chercher
la vieille nourrice et lui montrer les preuves d'identité.
L'acte s'arrêtait là : le soldat n'exécutait pas sa menace.
Qui ne voit enfin que la pièce est terminée, lorsque Chæréa,
sortant de chez Thaïs, annonce à Parménon et à Phoedria
la conclusion de son mariage et la réconciliation de leur
père avec la courtisane? L'amusante scène où Thrason, par
l'entremise de Gnathon, fait sa paix avec les deux frères, est
encore un hors-d'oeuvre.
Le témoignage formel de Térence est donc confirmé
par la facilité avec laquelle, sans nuire à l'intégrité de la
pièce, on en retranche les rôles du soldat et du parasite. Il
n'est pas nécessaire d'admettre que ces deux personnages
existaient déjà dans l'original principal et que Térence s'est
contenté de substituer à certaines parties, plus ou moins
considérables, de leurs rôles d'autres parties, préférables
selon son goût, tirées de l'original secondaire. Ce que Térence
a trouvé dans l'Eunuque grec, c'est seulement la
mention d'un soldat, rival de Phaedria. Elle lui a suggéré
l'idée de mettre en scène ce soldat ; pour en écrire le rôle,
il a alors cherché un modèle dans le répertoire de la comédie
nouvelle qui avait fait de ce type un usage fréquent. Il
a choisi le Colax de Ménandre, et la raison déterminante
de son choix a sans doute été une grande analogie de situation.
Un fragment de la pièce (1) nous indique au moins qu'il y avait un festin ; à ce festin assistait probablement un rival
dont la présence était la cause d'une querelle entre le soldat
et la courtisane.
(1) L'étude des frag. du Colax, montre aussi que Térence a beaucoup élagué. Les deux rôles en question, épisodiques dans sa pièce, tenaient évidemment une place bien plus importante dans le Colax.
C est à la suite de la querelle qu'il venait, avec son cortège burlesque, mettre le siège devant la maison de l'infidèle, dans le but de lui reprendre ce qu'il lui avait donné. Le rival jouait tantôt le rôle de Chrémès, comme dans la scène du siège, peut-être avec une nuance plus énergique, tantôt celui de Phaedria, comme dans la scène finale de réconciliation. En même temps que le soldat Bias, Térence fut amené à transporter dans l'Eunuque le parasite Strouthias et les personnages secondaires qui les accompagnent dans leur expédition contre Thaïs. Pour fondre les scènes empruntées à l'original secondaire avec l'original principal, il lui a suffi de changer ça et là un mot, d'ajouter ou de couper quelques vers (1).
(1) Par ex., pour introduire Gnathon au premier acte, il a remplacé au v. 228 par les mots ( parasitus Gnatho) une autre désignation de personne. C est cette substitution qui a appelé juste à ce vers la remarque de Donat. Les réflexions de Parménon pendant le monologue (254, 265) ou bien sont de Térence, ou bien étaient faites dans l'original par un autre personnage écoutant également sans être vu. Au vers 265, un mot de transition, « sed ego cessa... » raccorde le morceau tiré du Colax à l'Eunuque.
Le prologue des Adelphes nous apprend que cette comédie
fut, elle aussi, composée au moyen d'un double modèle grec.
Il résulte que l'original principal des Adelphes
est une pièce grecque du même nom, dont l'auteur, d'après
le témoignage unanime des didascalies, de Donat, de Suétone (1) et de Varron, est encore Ménandre, le poète préféré
de Térence. Les Synapothnescontes de Diphile ont
servi d'original secondaire. Dans les Adelphes de Ménandre,
le rapt d'une courtisane, enlevée par Eschine pour son
frère Ctésiphon, était le pivot de toute l'intrigue, mais le
spectateur n'y assistait pas. Il en recevait la première nouvelle,
comme Micion, par Déméa. Au début du second acte,
des renseignementsplus détaillés lui étaient fournis par un
monologue du leno (2), qui venait réclamer, sinon l'esclave
volée, au moins le remboursement du prix qu'elle lui avait
coûté.
(1) Suét., Vie de Tér., cite le témoignage de Varron. Ménandre avait fait deux comédies de ce nom. L'une est l'original du Stichus de Plaute, l'autre a servi de modèle à Térence.
(2) Dziatzko (éd. des Adelphes, Teubner, p. 10 sq) pense que le second acte de Ménandre commençait par l'arrivée d'Eschine qui faisait un court récit des faits. Cela est encore possible. Dans ce cas Térence aurait remplacé ce petit monologue par la scène de l'enlèvement.
Térence eut l'idée de mettre le rapt en action. Il
chercha donc dans le répertoire grec une scène de ce genre,
la trouva dans les Synapothnescontes de Diphile et la mit
en tète de son deuxième acte, avant le monologue du leno.
Ce qui prouve bien qu'il ne doit pas à l'original secondaire
autre chose que la scène où Eschine, aidé de son esclave
Parménon, malgré la résistance désespérée du leno, fait
entrer la courtisane dans la maison de Micion, c'est que
Donat, au quatrième vers du monologue de Sannion, le
leno, cite le fragment correspondant de Ménandre. Le
commencement de ce monologue, abrégé sans doute par
Térence, marque donc la limite du morceau emprunté à
Diphile, qui se réduit à une quarantaine de vers. On conçoit dès lors que Plaute, dans sa traduction des Synapothnescontes,
ait pu omettre un passage de si peu d'étendue
sans inconvénient. Enfin réduire l'emprunt à ces bornes
étroites, c'est se conformer strictement aux indications de
Térence qui désigne, comme fournie par la pièce de
Diphile, la seule scène du rapt.
Quant aux trois autres comédies de Térence, rien ne
porte à croire qu'elles soient le produit d'une contamination.
Dans le prologue de l'Heautoîitimorumenos, il est
dit que le poète a fait
Ex intagra grasca integram comaediam, d'une pièce grecque intacte une pièce latine intacte. Il n'est
nullement question d'original secondaire. La forme laquellle sous sont reproduits un peu plus loin le grief de contamination et la réponse du poète, montre bien que ce grief
ne s'applique pas à la pièce actuelle.Dans l'attaque et dans la riposte tout est général ; pas un
mot qui vise l'Heautontimorumenos. Ni Luscius, ni Térence
ne se seraient bornés à des généralités aussi vagues,
si la pièce avait fourni matière à une accusation précise. Il
s'agit évidemment d'oeuvres déjà jouées, déjà jugées. D'ailleurs,
en lisant avec attention cette comédie, on n'y trouve
aucune partie qui puisse se détacher de l'ensemble. Les
rôles de Clitiphon et de Bacchis, auxquels on pourrait
d'abord songer, sont indispensables. Il résulte de la première scène qu'avant d'être son voisin de campagne Chrémès ne connaissait pas Ménédème ; il y entend parler pour
la première fois de Clinia, le fils du vieillard. Pour que
Clinia, à son retour d'exil, se cache avec sa maîtresse dans
la maison de Chrémès, il faut pourtant qu'il y soit introduit
par quelqu'un. Que Chrémès ait un fils, lié d'amitié
avec Clinia depuis le gymnase et l'éphébie, tout s'arrange
sans difficulté : le rôle de Clitiphon est donc nécessaire. De
même, pour que l'esclave Syrus puisse combiner le stratagème
qui tient tant de place dans l'intrigue, il faut que Clitiphon
ait une maîtresse : donc le personnage de Bacchis
est nécessaire. Que resterait-il dans la pièce si on supprimait
ces deux rôles ? L'action serait d'une pauvreté excessive,
ou, pour mieux dire, nulle. Telle qu'elle est, paraît-elle
trop compliquée pour un Ménandre ? Qu'on se reporte,
pour ne citer qu'un seul exemple, à celle de la Périnthienne.
Dans le prologue du Phormion, il n'est également question
que d'un seul original grec, l'Epidicazomenos. Le
poète, qui s'est cru tenu de signaler et d'expliquer au public
un simple changement de titre, aurait-il gardé le silence
sur une modification autrement importante ? Pas plus ici
que dans l'Heautontimorumenos, on ne trouve au courant
de la pièce la moindre trace de contamination. Davus, le
personnage protatique, appartient à l'oeuvre d'Apollodore. Quant aux trois dernières scènes, que M. Rummler (1) voudrait
attribuer à un original secondaire, sous prétexte
qu'elles ne tiennent pas à l'action, elles sont au contraire
très utiles et inséparables du reste.
(1) Rummler, Quaest. Terent. Halle, 1873. Il invoque aussi, comme preuve de contamination, le nombre des acteurs nécessaires pour jouer la pièce, qui est de six, tandis que, d'après la règle énoncée par Evanthius, la nouvelle comédie n'en avait que cinq. Mais, en admettant que cette règle n'ait pas souffert d'exception, le sixième acteur n'est indispensable ici que pour la scène des advocati, où son rôle se borne à quelques mots (II, 3). Le moindre figurant pouvait tenir le rôle. Or les figurants ne comptaient évidemment pas dans le nombre des acteurs proprement dits avec les cinq acteurs, il y a deux figurants dans la scène du siège (Bunuch. IV, 7), empruntée au Colax de Ménandre. D'ailleurs, il est vrai que les pièces contaminées de Térence exigent plus de cinq acteurs.
Si, dans celle qui précède,
le sort des deux jeunes gens, Phasdria et Antiphon,
est déjà décidé, la pièce n'est pas finie pour cela. Il faut
que nous sachions ce que deviendra le personnage principal,
le héros de la comédie, et comment il se mettra à l'abri de
la vengeance dont le menacent les deux vieillards dupés.
Après avoir sauvé les autres, Phormion doit se tirer lui-même
d'embarras ; alors seulement son triomphe sera complet et
la pièce achevée.
Il semble qu'à propos de l'Hécyre l'idée d'une contamination
n'aurait dû venir à l'esprit de personne, tant l'intrigue
de cette comédie est simple et dépourvue d'éléments
épisodiques. Simplicité unique dans le théâtre de Térence
et qui a frappé Evanthius. Cependant, la question a été posée et discutée.
L'origine de tout le débat est le désaccord de nos sources
relativement à l'auteur du modèle grec. Térence ne le nomme pas, non plus que les didascalies des manuscrits de
Calliopius. Celle du Bembinus donne: : « Graeca Menandru»,
témoignage confirmé par un texte de Sidoine Apollinaire. Enfin, Donat, par deux fois, dit que la pièce grecque
est d'Apollodore ; de plus, il cite cinq fois Apollodore
au cours de son commentaire. Ces citations permettent
d'établir un premier point : s'il y a eu mélange de deux
pièces, celle de Ménandre a servi seulement d'orignal secondaire
: car Donat ne cite jamais que l'original principal.
Elles ôtent aussi toute autorité au témoignage du Bembinus:
il est de règle que l'auteur seul de l'original principal soit
mentionné par les didascalies. Mais on ne peut même pas
accorder à Ménandre le second rôle, et il faut écarter toute
idée de contamination : la pièce n'en présente absolument
aucune marque. L'exposition se fait, il est vrai, au moyen
de personnages protatiques, Philotis et Syra ; mais c'est
Apollodore qui les a imaginés, puisque, dès le premier vers,
Donat reproduit le fragment correspondant d'Apollodore.
On s'est demandé4 si le court dialogue des esclaves Parménon et Sosia (III, 4, 1-15) sur les ennuis d'une traversée,
ne provenait pas d'une contamination, parce que Donat
dit à cet endroit : « In hac scena, donec perveniat ad Pamphilum
Parmeno, hoc inducitur, cum hoc ostenditur,
quid mali sit navigatio. » Cette remarque ne prouve
ni que Térence a tiré l'entretien de son propre fonds, ni
qu'il l'a emprunté à un original secondaire : comme tant
d'autres du même genre, elle s'applique à l'économie de
la pièce, d'une façon générale, et non spécialement au
traducteur latin. D'ailleurs, il n'y aurait vraiment pas là de
quoi parler de contamination. Le seul modèle de Térence,
ce fut donc ici l'Hécyre d'Apollodore. L'autorité du témoignage
de Sidoine Apollinaire est nulle : les assertions de cet
écrivain de la basse époque, plus attentif à l'éclat de la
forme qu'à la vérité du fond, ne doivent être en général
acceptées qu'avec précaution ; celle dont il s'agit éveille
particulièrement la défiance : la pensée et l'expression manquent
de netteté ; les fragments conservés des Epitrepontes
ne dénotent point une similitude de sujet entre cette pièce
et l'Hécyre latine ; même si l'on admet que cette similitude
a existé, il n'est nullement prouvé que Sidoine Apollinaire
ait eu le droit de prendre les Epitrepontes pour terme de
comparaison et de les considérer comme l'original de l'Hécyre
: le domaine de la comédie nouvelle était si restreint
qu'il arriva souvent au même sujet d'être traité plus d'une
fois. Quant à l'erreur de la didascalie du Bembinus, on se
l'explique facilement : ou bien il y avait ici une lacune dans
l'archétype de ce manuscrit, comme dans celui de l'autre
famille, et de son propre mouvement le copiste l'a comblée
par analogie ; ou bien plutôt, le nom de Ménandre se trouvant
à cette place dans la grande majorité des didascalies,
il a écrit par habitude, machinalement, Ménandre au lieu
d'Apollodore. C'est donc seulement d'après l'Andrienne, l'Eunuque
et les Adelphes qu'il nous faut maintenant définir et qu'il
nous faudra tout à l'heure apprécier le procédé de Térence.
D'abord, il ne s'agit pas le moins du monde de la
fusion totale des deux originaux grecs. Le mélange est
partiel ; les deux éléments y entrent en proportions très
inégales. Il y a, suivant les termes dont nous nous sommes
servi à plusieurs reprises, l'original principal et l'original
secondaire : l'un sert de fond à l'imitation latine, l'autre ne
fournit qu'un supplément plus ou moins considérable : tantôt
des personnages épisodiques, tantôt une simple addition
au rôle de certains personnages appartenant déjà à
l'original principal. L'Andrienne doit à la Périnthienne
Charinus et Byrria, avec l'idée du personnage protatique ;
l'Eunuque doit au Colax Thrason, Gnathon et les autres
acolytes du soldat. Dans les Adelphes, les rôles d'Eschine
et de Sannion ont été augmentés d'une scène de médiocre
étendue, prise aux Synapothnescontes. Ensuite, les deux
pièces choisies par Térence pour le mélange ne sont pas des
pièces quelconques : il y a entre elles quelque ressemblance,
quelque affinité. L'Andrienne et la Périnthienne ont même
sujet ; l'Eunuque et le Colax, les Adelphes et les Synapothnescontes
ont une situation commune : dans les
deux premières, celle de la courtisane à qui le soldat, son
amant, a fait un riche cadeau qu'il voudrait ensuite reprendre
par jalousie; dans les deux autres, celle du jeune homme
qui enlève une femme au leno.
Voilà le procédé de composition que Luscius incrimina.
Pourquoi ? Il y eut le motif apparent et le motif réel. Le
motif réel, non particulier à cette accusation, mais commun
à toutes celles qui furent successivement lancées contre Térence,
ne fut autre que la jalousie, aigrie bientôt par le
dépit. Térence eut le tort impardonnable de réussir à se
faire jouer, puis applaudir, sans s'être placé sous la protection
du vieux poète ; il commit le crime capital de se poser
avec indépendance en rival, au lieu de prendre l'humble attitude d'un disciple : de là cette guerre acharnée qu'il eut
à soutenir durant toute sa carrière, de là tout d'abord le
grief de contamination. Le motif réel n'étant pas avouable,
on trouva un motif apparent, très spécieux : on prétendit,
sans aucun doute, que l'unité de l'original était détruite par l'adjonction de parties étrangères. Luscius soutint cette,
thèse avec d'autant plus de force que sa méthode de traduction
avait pour principe la fidélité scrupuleuse au modèle
grec. D'ailleurs il y avait là un beau lieu commun à développer : le désordre et l'incohérence substitués à l'harmonie.
et à l'unité, les chefs-d'oeuvre de l'esprit attique mis en
pièces par une main sacrilège, une chose informe, un
monstre créé avec ces lamentables débris. Seulement, des
dissertations de ce genre n'étaient à leur place que dans
les cercles lettrés ; les raffinés seuls pouvaient s'indigner
des profanations accomplies par Térence. Quant à la foule,
ces notions n'étaient pas à sa portée. Pour faire naître dans
l'esprit inculte de la masse des spectateurs une prévention
défavorable au jeune poète, on compta sur l'effet de ce vilain
verbe « contaminer. » Incapables qu'ils étaient de
saisir la chose, on voulut les édifier par le mot.
Puisqu'on accusait Térence de détruire par ses opérations
l'unité des pièces grecques, il devait pour se justifier démontrer
que cette unité en sortait intacte. Il essaya peut-être
de le faire, mais dans ses entretiens avec des personnes
lettrées, et non dans ses discours au grand public, dans ses
prologues. Pas plus que les considérations sur lesquelles
Luscius avait pu fonder sa critique, celles que notre poète
pouvait présenter pour sa défense n'étaient à la portée des
spectateurs ignorants, de beaucoup les plus nombreux. Il
lui était impossible de traiter à fond, en plein théâtre, la
question soulevée contre lui par ses adversaires. Cependant
il sentait que les bruits méchants avaient fait leur chemin :
la foule ne savait pas au juste ce que l'on reprochait au
nouveau poète ; mais le crime devait être bien noir, puisqu'on
l'appelait d'un tel nom. Impression fàcheuse et de nature à compromettre le succès, surtout la première fois,
lorsque Térence était tout à fait un inconnu. Sous peine de
paraître lui-même convaincu de sa culpabilité, il lui fallait
donner une réponse plausible. Celle qu'il trouva avait le
double avantage d'être facilement intelligible, même pour
le plus grossier des spectateurs, et d'ètre en parfait accord
avec la tournure d'esprit du public romain.
Il dut être fort content de l'effet qu'elle produisit, puisqu'il
la répéta, sans l'appuyer d'aucun autre argument, lorsqu'il
eut de nouveau à repousser le même reproche.
Invoquer l'exemple et l'autorité des anciens, tel est
donc le système de défense adopté par notre poète. Cet
artifice de composition, dont ses ennemis lui faisaient un
crime, n'était pas chose nouvelle : ses devanciers en avaient
usé. Le fait doit être vrai (1), puisque Térence l'affirme deux
fois, sans avoir l'air de redouter la contradiction ;
(1) Sur la contamination dans le théâtre de Plaute, cf. Teuffel, Stud.und Cliaraht. 256 sqq. Il pense que Plaute n'a usé de ce procédé que par exception, étant assez inventif pour enrichir son original grec au moyen de son propre fonds. Comme ex. de contam. dans Ennius, Spengel cite sa tragédie d'Iphigénie où il avait mêlé avec le drame d'Euripide des parties empruntées à celui de Sophocle.
dans tous
les cas, il est on ne peut plus vraisemblable : aussi soucieux
que Térence de plaire au public, les vieux poètes furent
conduits à l'emploi de ce procédé par des raisons analogues
à celles dont il subit à son tour l'influence et que nous rechercherons tout à l'heure. D'ailleurs, rien ne les gênait
dans cette voie : ils n'avaient pas, la lecture des comédies
de Plaute le prouve, ce respect scrupuleux, superstitieux de
l'original grec, que Luscius et son école érigèrent en principe.
Qui fut l'inventeur de la contamination? Névius sans
doute, le plus ancien de ceux que cite Térence, Névius
dont le génie puissant a marqué de son empreinte originale
tous les genres littéraires où il s'est exercé. Est-ce Luscius
qui a le premier condamné le procédé ? Cécilius, son contemporain,
s'en est-il encore servi? On serait tenté de
croire que non, quand on voit que ce poète ne figure pas
dans l'énumération de Térence ; mais il est plus probable
que, s'il n'est pas nommé ici, c'est qu'il vivait encore à
l'apparition de l'Andrienne. Quoi qu'il en soit, Térence
avait pour lui l'autorité du passé; il n'était pas un novateur,
il agissait conformément à une vieille coutume. Au
nom de leur légendaire respect pour le « mos majorum »,
les spectateurs romains devaient donc l'absoudre. De plus
l'accusation qu'on lui lançait atteignait aussi la mémoire de
trois grands poètes au moins, Névius, Plaute, Ennius, la
fleur des poètes romains, comme dit le prologue de Casina.
Le peuple qui les avait tant de fois applaudis, ne pouvait
pas condamner leur complice.
Si cette justification parut suffisante et même excellente
au public romain, elle n'a pas de quoi nous satisfaire. Peu
nous importent à nous les précédents invoqués par Térence
; car ils ne l'excuseraient pas s'il avait réellement gâté
ses originaux en les mélangeant, et, d'autre part, nous
sommes convaincus qu'ils n'ont pesé d'aucun poids sur sa
décision, la transformation du prologue nous ayant déjà
montré combien peu notre poète se mettait en peine d'agir
à la guise de ses devanciers. Nous voulons donc savoir si
l'on peut, par des raisons vraiment solides, défendre la contamination
contre les allégations de Luscius ; nous voulons en même temps découvrir, malgré le silence des prologues
à cet égard, le véritable motif qui conduisit Térence à l'emploi
du procédé.
Voyons d'abord si les trois comédies que Térence a composées
au moyen d'un double original, laissent à désirer
sous le rapport de l'unité. Les remarques par lesquelles
nous avons tout à l'heure défini son procédé, font à elles
seules pressentir que nous trouverons sans fondement le
reproche de Luscius. Elles nous ont montré, en effet, la
prétendue contamination, non comme un mélange confus de
pièces sans analogie, mais comme l'addition à un original
principal d'éléments choisis dans un original secondaire
qui lui ressemble par certains côtés. Une telle façon d'opérer
est le fait d'un poète qui a vu l'écueil du système et qui
prend toutes ses mesures pour s'en garantir. L'analyse
attentive des pièces elles-mêmes démontre qu'il y a réussi.
L'action, une et simple, de l'Andrienne grecque peut se
résumer en ces quelques mots : Simon veut marier son fils
Pamphile à Philumena, fille de Chrémès ; le jeune homme
se refuse à ce mariage, parce qu'il est engagé avec Glycérium
; elle est reconnue pour une autre fille de Chrémès et
il l'épouse. Qu'y a-t-il de plus dans l'Andrienne latine ?
Sosia, le personnage protatique, dont la présence ne saurait
évidemment nuire à l'unité de la pièce, et l'épisode de
Charinus. Charinus est un jeune homme épris de cette
Philumena que Pamphile, son ami, serait au désespoir
d'épouser. L'introduction de cet épisode dans l'intrigue
partage-t-elle l'intérêt et détruit-elle l'unité d'action? Non,
puisque la question que le dénouement résoudra est toujours
la même, une et simple : Pamphile épousera-t-il enfin
Glycérium ? Voilà tout ce qu'il s'agit de savoir. Nous
savons bien d'avance que, si ce mariage a lieu, le mariage
de Charinus avec Philumena en sera la conséquence, que
le sort de Charinus, qui ne prend d'ailleurs aucune part
active aux évènements de l'intrigue, sera fixé du même coup que celui de son ami. Remarquons aussi que les
scènes ou parties de scène dont ce personnage épisodique
est acteur, tiennent très peu de place dans l'ensemble, si
bien qu'il n'y a pas plus disproportion que disparate. Dans
l'Eunuque de Ménandre, il était question d'un soldat ; mais
on ne le voyait pas. Après avoir fait présent à sa maîtresse
Chrysis de la jeune esclave, il invitait la courtisane à dîner
et, pendant le repas, pris d'un accès de jalousie, menaçait
d'aller reprendre son cadeau; Chrysis, effrayée de ces menaces,
se retirait précipitamment chez elle pour hâter la
reconnaissance de l'esclave comme citoyenne n'ayant plus
après cela de ménagement à garder avec le soldat, elle ouvrait
de nouveau sa maison à Chserestratos. De personnage
invisible qu'il était chez Ménandre, le soldat passa chez
Térence à l'état de personnage visible. Il parut sur la
scène, flanqué tantôt de son seul parasite, tantôt de toute
une escorte grotesque. Il vint lui-même prendre la courtisane
Thaïs chez elle pour la conduire au repas ; il donna
à ses menaces de reprendre Pamphila un commencement
d'exécution, en mettant le siège devant la maison de Thaïs ; il fit enfin sa soumission au rival qui l'avait supplanté.
Térence s'est donc borné à mettre en action et à développer
les incidents simplement racontés par Ménandre ; il n'a
rien ajouté d'important, rien changé à la donnée de l'intrigue
originale. L'action principale, à laquelle tout se subordonne et qui fait l'unité de la pièce grecque, comme de
la pièce latine, c'est le mariage du faux eunuque Chæréa
avec Pamphila, qu 'il a d'abord violée et qui est ensuite reconnue
pour la soeur de Chrémès. Rien de plus simple et de
moins préjudiciable pour l'unité d'action que le changement
apporté à l'économie des Adelphes : un évènement qui fait
partie essentielle de l'intrigue, l'enlèvement de la musicienne,
n'était que raconté dans Ménandre ; Térence l'a mis en action dans une scène de proportions très restreintes.
L'unité d'action est donc aussi parfaite dans les trois
pièces contaminées de Térence que dans les originaux.
Mais, si le fond en est un, n'y a-t-il pas dans la forme quelques
discordances de détail ? Les morceaux rapportés s'ajustent-ils si bien au morceau principal que nulle part on n'aperçoive
trace de soudure maladroitement exécutée ?Pour l'Andrienne
et l'Eunuque, on ne peut pas, je crois, y relever à
à ce point de vue le moindre défaut : les rôles de Charinus
et de Byrria dans l'une, du soldat et de son parasite dans
l'autre ont été admirablement fondus avec le contexte de
l'original principal, et, sans les renseignements qui nous
apprennent le contraire, nous serions convaincus que chacune
de ces comédies est la reproduction d'un seul modèle
grec. A la rigueur, il y a pourtant dans l'Andrienne un
passage qui semble, mais au premier abord seulement,
démentir notre appréciation. Aux vers 373 et suivant,
Davus conseille à Charinus de faire une démarche auprès
des amis de Chrémès pour le succès de son mariage. Charinus
promet de suivre le conseil et quitte aussitôt la scène.
Or, dans le reste de la pièce il n'est plus jamais question
de cette démarche. Faut-il croire que dans la Périnthienne
il en était reparlé, et mettre ici une inconséquence au
compte de notre poète ? Pas du tout : le conseil donné par
Davus est uniquement destiné à motiver la sortie de Charinus
qui ne doit pas assister à la suite de l'entretien où
l'esclave engage Pamphile à faire semblant de consentir
au projet d'union formé par son père : car instruit de cette
feinte, il ne croirait pas à la fausse nouvelle que lui apporte
un peu plus tard Byrria, et la scène où il accable son ami
de reproches ne pourrait avoir lieu. Dans la Périnthienne,
comme dans la pièce latine, la visite aux amis de Chrémès
restait à l'état de projet : entre le moment où il quittait
Pamphile et celui où Byrria, trompé par les apparences,
venait lui annoncer que Simon avait trouvé son fils tout disposé à se marier le jour même avec Philuména, Charinus
n'avait guère le temps de courir la ville pour solliciter
des recommandations. A l'Ennuque aussi on a fait une
petite querelle de ce genre : on a signalé, dans le rôle de
Chrémès, aux scènes 6 et 7 du quatrième acte, un défaut
d'unité, et on y a vu une trace mal dissimulée de la contamination.
Il est vrai que le rôle de ce personnage dans la
scène 6 appartient à l'Eunuque grec, tandis que son rôle
dans la scène 7 provient du Colax ; mais la discordance
signalée n'existe pas. A la scène 6, la venue imminente du
soldat et de son armée jette Chrémès dans un grand trouble
et lui donne une forte envie de déserter la place, sous
prétexte d'aller chercher la nourrice de Pamphila ; à la sc.
7, il tient vigoureusement tête au soldat et ne lui épargne
ni les injures ni les menaces. Le changement d'attitude est
frappant sans doute ; il n'en est pas moins très naturel :
Chrémès aurait bien voulu se dérober à cette rencontre ;
ne l'ayant pu, il prend son courage à deux mains pour
faire bonne contenance ; les nécessités de la situation lui
donnent quelque bravoure, bravoure plus apparente d'ailleurs
que réelle, car on sent bien qu'il n'est pas à son aise
et qu'il a hâte de voir finir la lutte. De plus le changement
ne s'opère pas tout d'un coup et sans préparation :
les remontrances de Thaïs, qui se continuent même après
l'arrivée du soldat, raffermissent peu à peu le jeune poltron.
Enfin n'oublions pas qu'il sort de table ; de son propre aveu,
il a bu plus que de raison : ce que l'on peut trouver de
bizarre à ses façons d'agir s'explique par un commencement
d'ivresse. Les Adelphes, il faut l'avouer, ne sont pas aussi complètement
à l'abri de tout reproche. Mais, à propos de cette
pièce, on impute, en général , à Térence beaucoup plus de fautes qu'il n'en a commis, et nous allons voir que sa culpabilité se réduit à peu de chose. On relève d'abord dans la
scène du rapt, empruntée à Diphile, un trait que Térence
aurait dû supprimer ou corriger, parce qu'il ne s'accorde
pas avec la donnée de l'original principal : Eschine prétend
que la femme enlevée à Sannion est de condition libre
tandis que partout ailleurs elle est présentée comme une
véritable esclave. Chez Diphile, l'affirmation d'Eschine était
sans doute conforme à la vérité : la femme enlevée était revendiquée
et reconnue pour libre. Mais est-ce à une inadvertance
de notre poète que nous avons affaire ? Je ne le
crois pas. Térence a voulu conserver le trait avec une portée
tout autre : ce n'est plus ici qu'une menace en l'air, un
mensonge auquel le caractère du jeune homme est loin de
répugner. Le leno, à qui pareille menace a été jetée bien
des fois, n'en tient aucun compte dans son monologue : il
sent que pour lui le véritable danger n'est pas là. Pourtant
Térence aurait peut-être mieux fait d'admettre que, malgré
son invraisemblance, le dire d'Eschine impressionne quelque
peu Sannion, et de l'indiquer d'un mot. Presque au début de
son monologue, Sannion se plaint d'avoir été violemment
arraché de sa maison. Dans la
pièce de Diphile, le ravisseur, si la femme était libre, avait
des raisons sérieuses de tratner le leno dans la rue et jusque
devant les juges ; il convenait, au contraire, à Eschine de le laisser chez lui pour éviter le bruit et le scandale public.
Si Térence a écrit ces mots, il a emprunté le trait à Diphile
et ne s'est pas aperçu qu'il n'allait point du tout avec la situation
de son personnage. Mais les a-t-il écrits ? La question
est douteuse, et la leçon vraie pourrait bien être :
« Domi me arripuit; » auquel cas, il n'y aurait rien à critiquer. Autre reproche encore: à la scène 3 de l'acte III,
Déméa dit qu 'il a appris que son fils Ctésiphon n'est étranger pas à l'enlèvement. Or, jusqu'ici nous n'avions
pas entendu dire que le frère d'Eschine eût pris part à cet
acte de violence: c'est vrai, mais nous n'avions pas non plus entendu dire le contraire ; quand on affirme que son entretien avec Eschine, à l'acte second, donne l'impression
qu'il rencontre son frère pour la première fois de la journée
et qu 'il n 'a nullement participé au rapt, on est, je crois,
dans l'erreur. Ses paroles nous le montrent dès son entrée
en scène 2 au courant de ce qui s'est passé, et, puisqu'il ne dit pas de qui il tient ses informations, c'est qu'il n'a pas eu besoin d 'en prendre, c' est qu'il a été témoin et acteur des
violences accomplies dans la maison de Sannion. Il a secondé
son frère jusqu'au moment où la musicienne a été
emmenée dans la rue. Alors il s'est retiré pour ne pas être
vu et dénoncé à son père. Comme c'était de grand matin,
peu de gens l'ont aperçu sortant de chez le leno, si bien que
Déméa n 'a pas été informé tout de suite de sa complicité.
Maintenant que tout est fini, Ctésiphon revient, impatient
de remercier son frère. Il est possible, à la rigueur, que
dans le monologue de Sannion, par lequel commençait son deuxième acte, Ménandre eût indiqué d'un mot la présence
de Ctésiphon à l'enlèvement ; peut-être aussi avait-il,
comme Térence, différé le moment d'en informer le spectateur,
pour ménager l'intérêt et donner à la révélation, faite
par Déméa lui-même, quelque chose de plus piquant. Quoi
qu'il en soit, il n'y a rien d'incohérent à cet égard dans la
pièce de Térence. On reproche enfin aux Adelphes de notre poète une invraisemblance dans la marche de l'action : dès
le premier acte, dit-on, l'enlèvementest annoncé par Déméa
qui l'a appris de tout le monde ; toute la ville en parle ;
et c'est seulement au début du second acte qu'Eschine,
avec la femme et le leno, arrive devant la maison de
son père adoptif. S'il y a ici une invraisemblance, elle n'est
point l'effet de la contamination : elle existait aussi dans la
pièce de Ménandre, où Eschine ne rentrait chez Micion
qu'assez longtemps après le récit de Déméa, au début du
second acte ou, au plus tôt, pendant l'entr'acte. Mais il n'y
a pas d'invraisemblance. D'abord, il ne faut pas prendre à
la lettre les affirmations de Déméa.
L'exagération est dans le caractère passionné, excessif de
ce personnage. Ensuite, la scène qui se joue au début du
second acte est absolument distincte de celle que Déméa raconte
au premier : il nous dit comment Eschine a fait irruption chez le leno, l'a roué de coups dans sa maison et a
emmené la musicienne ; nous voyons comment le leno, qui
s'est mis à la poursuite du ravisseur, tente un dernier effort
pour l'empêcher de mettre son butin en sûreté chez son
père. Entre ces deux scènes, si l'on veut bien admettre que
la maison du leno et celle de Micion sont aux deux bouts
de la ville, et qu'en chemin Sannion a fait tout son possible
pour retarder la marche d'Eschine, il s'est écoulé assez de
temps pour que Déméa ait appris de quelques témoins le
méfait du jeune homme et soit venu en toute hâte le raconter
à Micion. En somme, si les Adelphes donnent prise à quelques
critiques, elles ne sont guère sérieuses. Pour accuser
Térence d'avoir corrompu la beauté de son original, c'eût été bien peu de chose que ces menues fautes de détail.
D'ailleurs, il se trouve que la seule pièce de notre poète où
la contamination n'a pas été exécutée d'une manière absolument
parfaite, est la seule qui n'ait pas encouru, du moins
à notre connaissance, le reproche de contamination.
Quant à nous, pour que l'emploi du procédé soit pleinement
justifié à nos yeux, il ne nous suffit pas que les originaux
grecs n'y aient rien perdu, il faut que sous quelque
rapport ils y aient gagné, et nous en voudrions à Térence
s'il les avait modifiés sans profit d'aucune sorte pour eux,
quoique sans préjudice. Mais tel n'est pas le cas. Pour ne
rien dire de cette admirable exposition, dont l'éloge n'est
plus à faire depuis bien longtemps, où l'introduction de
Sosia constitue évidemment un avantage au point de vue
de la vraisemblance dramatique, l'Andrienne gagne à la
contamination deux personnages intéressants soit par eux-mêmes,
soit par le contracte qu'ils forment avec deux autres
personnages, soit par quelques situations comiques ou touchantes
que l'intrigue doit à leur présence. C'est une
sympathique figure que celle de Charinus, caractère faible
et timide, qui ne sait point agir et succombe au désespoir,
sans ressource et sans ressort ; âme loyale et simple jusqu'à
la naïveté. La naïveté, voilà le trait le plus original
de cette physionomie sobrement dessinée à l'arrière-plan :
pour faire rougir et se récrier Charinus, une insinuation
grivoise de Byrria, une question de Pamphilus sur la nature
de ses rapports avec Philumena suffisent largement ;
Davus ne lui épargne pas les railleries et lui accorde, comme
une aumône, la promesse d'une visite et d'une bonne nouvelle. A côté de ce pâle et mélancolique amoureux, Pamphilus
se détache vigoureusement, plein de vie et d'énergie,
véhément dans sa douleur, exubérant dans sa joie. Entre les deux jeunes gens il y a la même différence qu'entre
leurs amours : celles de Charinus fleurissent à peine, celles
de Pamphilus sont déjà dans la saison des fruits ; ainsi
l'un représente le printemps de la jeunesse, l'autre l'été.
Même auprès de Davus, Byrria est un curieux type d'esclave
: incapable de combiner au profit de Charinus quelque
adroite machination, incapable de lui donner un utile
conseil, il ne sait mettre à son service que des consolations
aussi peu efficaces que banales, et de grosses plaisanteries.
La chance le sert d'ailleurs aussi mal que la nature l'a
pauvrement doué : lorsque Charinus apprend une bonne
nouvelle, c'est toujours d'une autre bouche : le triste monopole
des mauvaises nouvelles appartient à Byrria. Et
quel relief sa lourdeur, sa sottise et son inutilité donnent à
la supériorité de Davus, le tacticien consommé, fin et souple,
fécond en artifices, prompt à se relever d'un échec, le
serviteur au dévouement efficace et indispensable, d'une
fidélité à l'épreuve de toutes les menaces et de tous les
risques ! La démarche de Charinus auprès de Pamphilus,
pour lui demander de renoncer à la main de Philuména ou
tout au moins de différer son mariage, forme une scène
vraiment touchante qui manquait à l'Andrienne grecque :
on est ému de l'anxiété du jeune homme au moment où il
aborde celui qu'il croit son rival, de son embarras à faire
l'aveu de son amour pour Philuména, de sa passion désespérée
dont l'indifférence de Pamphilus fait si bien ressortir
l'ardeur, du soupir de soulagement qu'il pousse lorsqu'il
connaît la vérité. La présence de Charinus donne à la
scène suivante plus d'animation et de gaîté qu'elle ne pouvait
en avoir dans l'original : Davus, placé entre les deux
jeunes gens désolés, l'un d'épouser, l'autre de ne pas épouser
Philuména, reçoit les doléances de chacun, leur répond
tour à tour, et, quand ils lui laissent enfin le moyen de
raconter tout au long la bonne nouvelle qu'il apporte, fait
d'un seul coup deux heureux ; ce tableau, plein d'entrain est d'un excellent comique. Plus loin, la méprise de Byrria, très naturellement amenée, ménage une attachante
péripétie : l'esclave, trompé par les apparences, a cru que
Pamphilus consentait sincèrement à épouser la jeune fille
choisie par son père, Philuména ; Charinus, informé de
cette trahison, retombe dans son désespoir aigri encore par
la déloyauté de son ami. Il vient lui reprocher avec amertume
la promesse violée ; mais bientôt il s'aperçoit que
Pamphilus, aussi malheureux que lui, n'a nullement mérité
ses sarcasmes, ne veut pas du tout, et pour de bonnes
raisons, se marier avec Philuména ; alors sa jalousie indignée
fait place à la pitié, et en même temps ses espérances
renaissent. Dès ce moment le poète, ayant tiré du personnage
tout ce qu'il pouvait donner, l'a sagement mis de
côté jusqu'au dénouement, où il vient apprendre, à la satisfaction
du spectateur auquel il est sympathique, le mariage
de Pamphilus avec Glycérium et les conséquences heureuses
de cet événement pour son propre avenir.
L'Eunuque doit à la contamination les figures du parasite
et du soldat. De leur présence l'action, déjà très riche,
tire un surcroît de variété et de mouvement, mais surtout ils
fournissent une source abondante du comique le plus franc ;
ils forment à eux deux l'élément le plus divertissant de la pièce. Gnathon est un novateur de génie ; il a transformé
le métier de parasite : grâce à lui, cette carrière, autrefois
lucrative, mais dure, n'aura plus guère désormais qu'avantages
et agréments. Gnathon, en effet, au lieu de faire
rire à ses dépens et d'endurer les coups sans se plaindre,
comme ses devanciers, admire les qualités que le maître
croit avoir, le flatte, l'approuve, rit de ses bons mots ; il paie
de sa complaisance seule, et non de sa personne ; c'est un
sceptique, un égoïste, un roué qui exploite une dupe. Quel
chef-d'oeuvre de finesse et de verve que ce monologue où
il développe la nouvelle doctrine et se pose en chef d'école,
en fondateur de la secte des Gnathoniciens ! Quoique moins original, Thrason, le soldat, est aussi très amusant. Vanité,
sottise, poltronnerie, telle est en trois mots l'âme du personnage
: ce familier imaginaire du grand roi, ce prétendu
homme d'esprit, qui d'un bon mot écrase un adversaire,
n'est qu'un nigaud dont le parasite se rit et s'engraisse, en
attendant de le livrer pieds et poings liés à son rival ; ce
fanfaron à la bruyante colère n'est qu'un peureux qui bat
en retraite devant une femme. Voilà les deux types que
Térence a mêlés à l'action. Au lieu de faire amener Pamphila
à Thaïs par un esclave banal, il a chargé de ce soin
Gnathon, qui, à cette occasion, prenant texte d'une rencontre
récemment faite, débite sa profession de foi : nul ne
s'avisera, je pense, de la trouver longue ou déplacée, tant
elle est intéressante, et de regretter ici Ménandre. Le soldat
et son parasite assistent à la scène 2 où Parménon remet à
Thaïs les présents de son maître Phaedria ; ainsi cette
scène est plus animée et plus comique : on rit de la confusion
que le soldat ne peut dissimuler à la vue du faux
eunuque ; on rit des traits mordants que Parménon décoche
au maître d'abord, puis au parasite. La scène du
siège est une admirable bouffonnerie. Thrason a mis
toutes ses troupes sur pied, et quelles troupes ! Il lui faut
une éclatante vengeance. Il range d'abord son armée en
bataille d'après les principes d'une habile tactique, renouvelée,
dit-il, de Pyrrhus, et dont la première préoccupation
est de mettre en sûreté la personne du général. Avant
de donner le signal, en homme sage qui connaît le prix du
sang, il épuise tous les moyens pacifiques d'obtenir satisfaction;
mais l'ennemi fait bonne contenance, et les menaces
elles-mêmes ne l'intimident guère. Que faire ? Gnathon
consulté ouvre un avis excellent : les femmes sont capricieuses
; la satisfaction que refuse Thaïs, maintenant qu'on
l'exige, elle viendra bientôt d'elle-même supplier Thrason
de l'accepter ; il n'y a donc qu'à battre en retraite. La solution
plaît au soldat, et les troupes enchantées rentrent dans leurs foyers. La scène finale ne devait pas moins égayer le
public, toujours aux dépens du fanfaron. Le voici qui
retourne chez Thaïs, mais cette fois pour demander grâce
et se rendre à discrétion : Hercule ne fut-il pas l'esclave
d'Omphale ? Hélas ! au lieu d'une capitulation, il en aura
deux à signer. Pendant son absence, d'importants évènements
ont rouvert à Phaedria la maison de la courtisane,
et désormais le soldat n'y pourra pénétrer que si son rival
veut bien le permettre. Tandis qu'il se tient à l'écart,
Gnathon, investi de ses pleins pouvoirs, négocie le traité
de paix. Il faut voir comme l'ambassadeur, qui n'a garde
de s'oublier lui même, prend en main les intérêts de son
maître et de quels traits flatteurs il le peint : l'heureux Phaedria
aura sans partage les faveurs de Thaïs ; Thrason, riche
et stupide, paiera toutes les dépenses de la maison. Il va
sans dire que les clauses du traité sont tenues secrètes
Thrason apprend seulement le succès des négociations. Ce
qui achève de le rendre ridicule, c'est le contraste entre son
humiliation profonde et ses airs de fatuité que, tout fier
d'un si beau résultat, il reprend aussitôt. Il était impossible
de finir la pièce par un tableau plus gai, et l'invitation
du Cantor dut être accueillie par une salve bien nourrie de
sincères applaudissements.
Grâce à la contamination, les Adelphes se sont enrichis
d'une scène fort agréable. Elle présente aux yeux du spectateur un groupe de personnages nombreux, animé, aux
attitudes variées et fortement accusées : Sannion, le leno,
indigné et désolé ; la musicienne, tremblante d'effroi entre
son maître qui la retient et son ravisseur qui l'entraîne ;
Eschine, plein de sang-froid et d'une imperturbable audace;
Parménon, l'esclave, les poings serrés, ne demandant
qu'à frapper. La situation est en soi des plus comiques
pour le public romain : un leno, personnage odieux et méprisé,
privé, en dépit des lois qui protègent la propriété et
le domicile, d'une femme qui lui appartient, se voit pour
comble de misère bafoué et battu. Elle est traitée d'une façon très vivante, avec un entrain vraiment dramatique.
D'abord les cris, les protestations bruyantes du leno alternant
avec les paroles froides et énergiques d'Eschine, puis
la lutte violente, enfin la série des ripostes alertes et ironiques
qu'Eschine oppose aux raisonnements du leno, quand
celui-ci a renoncé enfin à toute résistance matérielle. Il ne
faut pas négliger de dire que cette scène du rapt, si amusante
par elle-même, est utile au développement du caractère
d'Eschine. Quel que fût dans Ménandre le début du
second acte, monologue d'Eschine rentrant chez son père
avec la musicienne ou monologue du leno venant réclamer
satisfaction, le poète grec n'avait pu donner à l'assurance
hardie, qui est le trait le plus frappant de ce caractère, autant
de relief que Térence : au lieu d'un récit, plus ou moins
circonstancié et imagé, de l'action audacieuse commise par
le jeune homme, c'est l'action elle-même que nous avons
ici, c'est le flagrant délit. Après avoir assisté à cette scène,
comme nous trouverons saisissant le contraste des deux
frères ! Quelle différence entre cette entrée tumultueuse
d'Eschine triomphant et l'entrée modeste du timide Ctésiphon
après la bataille !
Accroissement d'animation et de gaieté, voilà en un mot
le profit que les oeuvres de Térence ont retiré de la contamination.
Ce résultat indique assez clairement quelle fut la
raison qui détermina notre poète à adopter le procédé. Il
voulut donner à ses comédies plus de variété et de mouvement
dans l'action, plus d'abondance et d'énergie dans le
comique, plus de vie, sinon intime, au moins superficielle,
que n'en possédaient leurs originaux Mêler à l'action un
plus grand nombre de personnages, représenter sûr la
scène des incidents dont Ménandre, son modèle, se bornait
à parler ; tels furent pour lui les deux moyens pratiques
d'arriver à ce but. Les matériaux des constructions accessoires dont il agrémentait ainsi l'ordonnance plus simple de
l'édifice grec, il les emprunta à d'autres oeuvres grecques,
non pas seulement parce qu'il avait l'esprit peu inventif et
que ces emprunts le dispensaient de créer, mais encore et
surtout parce que cette façon de procéder était plus légitime
et plus naturelle qu'un système d'additions originales. La
palliata est par essence une traduction ; en général, une
pièce grecque fournit assez d'étoffe pour une pièce latine ;
mais si, par exception, un seul original est trouvé insuffisant,
n'est-ce pas au fonds grec, à une autre oeuvre du
répertoire, qu'il convient d'avoir recours pour le compléter?
Il y a là une loi, issue de la force des choses, si juste et si
impérieuse, que Plaute lui-même, esprit éminemment libre
et primesautier, malgré des actes fréquents d'indépendance,
d'indiscipline, s'y est plus d'une fois soumis, puisque Térence le met au nombre des poètes qui ont avant lui fait
usage de la contamination.
Donat, s'il faut en juger par ce qui nous reste de son
commentaire, n'a pas vu clair dans les intentions de Térence.
Il ne nous dit nulle part pourquoi, à son avis,
Térence a contaminé dans l'Eunuque et dans les Adelphes.
L'explication qu'il donne pour l'Andrienne est d'une faiblesse
dérisoire. Nous ne savons
presque rien de Philuména; à peine nous a-t-on dit en
passant qu'elle est riche et qu'elle est belle; nos sympathies
ne se portent pas sur elle ; nous lui en voulons, au
contraire, d'être, même involontairement, un obstacle au
mariage de Pamphilus avec Glycerium. Celle-ci, le poète
a tout mis en oeuvre pour nous la faire aimer ; son sort nous
intéresse vivement, et nous souhaitons qu'elle épouse Pamphilus. Quant au mariage de Philuména, il nous cause, il
est vrai, une certaine satisfaction ; mais seulement parce
qu'il fait le bonheur de Charinus. Ce n'est évidemment pas
ainsi que Térence aurait distribué l'intérèt, s'il avait eu l'intention
que lui prête Doaat. Ici, comme dans l'Eunuque et
les Adelphes, il a demandé à la contamination un surcroît
de variété et de comique. Au surplus, la contamination
n'est pas dans le théâtre de Térence le seul indice qui dénote
ce penchant pour l'animation extérieure. Cinq de ses
comédies sur six ont une intrigue complexe, deux couples
d'amoureux ; dans une seule, l'Andrienne, ce fait est le résultat
de la contamination ; dans les quatre autres, l'économie
de l'original comportait les deux couples. N'y avait-il
donc dans le répertoire de la nouvelle comédie que des
pièces de ce genre, à quelques exceptions près ? Le théâtre
de Plaute suffit à prouver que non. Térence les a librement
choisies. Evanthius a noté cette préférence; il en fait même
un mérite au poète.
On peut se demander pourquoi Térence n'a usé que trois
fois des ressources de la contamination. A-t-il jugé superflu de rien ajouter aux originaux de ses trois autres comédies,
parce qu'ils étaient assez animés et assez amusants par eux-mêmes
? Cette opinion serait plausible, s'il ne s'agissait que du Phormion ; la pièce n'est certes pas languissante et
ennuyeuse. Mais il y a l'Heautontimorumenos, où, quoique
l'intrigue soit complexe, l'action est très peu animée : Térence
lui-même classe cette comédie parmi les fabulae statariæ
parmi celles dont la représentation donne moins
de fatigue aux acteurs, parce qu'elles ne contiennent que
de calmes entretiens. Il y a surtout l'Hécyre, dont la simplicité d'intrigue, unique dans
le théâtre deTérence, a été signalée par Evanthius ; tableau
finement peint de la vie de famille, étude de moeurs très
attachante à la lecture, mais un peu froide et terne à la
scène. Ce qu'il lui manquait de couleur et de vie, n'était-ce
pas le cas de le demander à la contamination ? Certes, Térence
eut le temps d'y réfléchir entre le premier essai de
représentation et la représentation définitive. S'il fit des
retouches dans l'intervalle, ce que nous ignorons, il laissa
à l'intrigue sa simplicité, il ne contamina pas. Je crois que
deux motifs sérieux l'empêchèrent de suivre plus souvent
son penchant pour ce procédé de composition. D'abord,
après l'Andrienne et l'Eunuque, deux pièces contaminées,
qui se succédèrent coup sur coup, il voulut montrer à ses adversaires et au public que l'appui de la contamination
n'était pas indispensable à son talent. Ensuite le désir de
varier et d'égayer fut toujours subordonné chez cet artiste
délicat au sentiment et au respect de l'unité ; il considéra
la contamination comme une opération périlleuse qu'il ne
fallait entreprendre que dans des conditions très favorables ;
lorsqu'il ne trouva pas d'original secondaire dont il pût sans
danger fondre quelque partie avec son original principal, il
s'abstint et sacrifia l'animation à l'unité.
En se servant de la contamination, Térence obéissait-il
vraiment à un penchant naturel, ou bien faisait-il violence à
ses goûts personnels pour se conformer à ceux du public ?
Certes, les qualités au profit desquelles se faisait l'opération
étaient loin de déplaire aux spectateurs romains, et s'ils
avaient été en mesure de comparer l'original principal avec
la reproduction latine, c'est à celle-ci sans contredit qu'ils
auraient donné le prix. Trop grossiers pour s'intéresser aux
longs détails d'une savante étude morale, il leur fallait surtout
dans une pièce de l'action et du comique. Ils aimaient le mouvement et le bruit, les entrées et les sorties fréquentes,
les personnages qui, sur la scène, couraient, criaient,
gesticulaient, plaisantaient. L'ennui les gagnait souvent aux
longs entretiens sérieux et calmes (1).
(1) La préférence du public romain pour les fabules motoriae est nettement démontrée, sans chercher d'autres textes, par les v. 35-47 du prol. de l'Heaut.
Et plus la palliata
devenait ancienne, plus leurs exigences étaient grandes.
Dans la nouveauté du genre, l'intrigue la plus simple suffisait
à les distraire. Depuis ils s'étaient blasés : il leur fallait
plus fort, plus compliqué ; non qu'ils fussent sensibles au
plaisir de la surprise : l'usage de l'argumentum prouve
qu'ils ne s'en souciaient point et qu'ils préféraient être avertis
d'avance ; mais parce que la multiplicité des incidents
excluait du spectacle la monotonie. Pour amuser un tel
public, amateur de situations variées et gaies, les ressources
de la contamination étaient précieuses au poète, surtout s'il
n'avait point la verve d'un Plaute.
Or, Térence n'écrivait pas seulement pour la postérité.
S'il a tranformé l'ancien prologue narratif en plaidoyer, si,
malgré deux tentatives infructueuses de représentation, il a
persisté à faire jouer son Hécyre, c'est qu'il tenait beaucoup
aux applaudissements de ses contemporains. Il l'a dit lui-même
au début de son premier prologue.
Térence désirait le succès,
il le désirait assez ardemment pour le payer de quelque
sacrifice, et je suis convaincu que, s'il avait eu une prédilection
naturelle pour la simplicité d'intrigue, il aurait agi
comme il l'a fait, puisqu'il le pouvait sans choquer le bon
goût et sans détruire la beauté des oeuvres grecques. Mais
il n'avait point cette prédilection naturelle, et ni la contamination,
ni la préférence accordée aux comédies originales à intrigue double ne doivent être regardées comme des sacrifices
du poète au public.
Térence n'a pas le culte aveugle et superstitieux des originaux
grecs; même en dehors de la contamination, il y fait
souvent des changements. Pour ne parler que d'une seule
pièce, on en trouve toute une série dans les Adelphes.
D'abord, au témoignage de Suétone, Térence a modifié le
début de la pièce grecque, sans que nous puissions dire au
juste en quoi. Un peu plus loin, lorsque Déméa fait sa première
entrée, Micion l'accueille d'un salut amical que l'irascible
vieillard ne lui rend pas, tout entier à la querelle qu'il
veut lui faire et qui commence d'emblée: Ménandre avait
cru devoir lui donner plus de politesse : c'est Donat qui
nous l'apprend. Nous savons par le même Donat que le
Ctésiphon de Ménandre, désespèrant de posséder la musicienne,
avait résolu de mourir ; celui de Térence a pris un
parti moins violent : il veut s'exiler. Hégion était dans
Ménandre le frère de Sostrata ; dans Térence, ce n'est
qu'un parent plus éloigné. Enfin, le Micion de l'original
se laissait, sans la moindre opposition, marier à Sostrata, la
vieille belle-mère de son fils ; le Micion de la pièce latine
ne consent à cette bizarre union qu'après une longue et vive
résistance. Ces changements et tous les autres de ce genre
n'ont évidemment rien à voir avec le goût du public : ils
n'ont pas été imposés au poète, il les a faits pour sa propre
satisfaction. Dans les quelques exemples que nous venons
de citer, le motif du changement est clair : Térence, sur
certains points de détails, a cru pouvoir être peintre plus
exact de la vérité des caractères que son devancier. Il n'a
donc pas toujours considéré ses originaux comme des oeuvres
parfaites ; il les a corrigés parfois ; il a pensé que son
rôle de traducteur comportait, même en mettant de côté le
style, une petite part d'originalité. Pourquoi ne pas admettre
que cette manière de voir lui fit aussi adopter la contamination ? Qu'il ait considéré la variété dans l'art dramatique
comme un progrès, rien de plus naturel. Il a subi en cela
l'influence d'une loi de l'esprit humain à laquelle aucun des
dramaturges, ses prédécesseurs, n'avait échappé. L'action
des tragédies d'Eschyle parut trop simple à Sophocle, et il
imagina des intrigues plus complexes. Après lui, Euripide
accrut encore la variété et le mouvement. Les poètes de la nouvelle
comédie, qui étaient ses disciples, l'imitèrent en
cela et allèrent plus loin encore que lui, s'il faut juger de
leur manière par des oeuvres telles que l'Heautontimorumenos
et les Adelphes de Ménandre, où le poète a très habilement mêlé deux intrigues pour former la trame de l'action. Térence n'a fait qu'accentuer la même tendance. Dispensé
de songer au contentement du public, libre d'agir,
selon sa fantaisie, il n'en aurait pas moins adopté la contamination.
Le goût des spectateurs contemporains le confirma
simplement dans une résolution dont il ne faut pas
chercher la raison déterminante ailleurs que dans ses préférences
personnelles.
Cependant il n'a pas obéi à son penchant pour l'animation
extérieure jusqu'au point de sacrifier, dans ses pièces
contaminées ou dans les autres, les parties de sentiment,
qui sont celles où se concentre la vie intime du drame. S'il
ne les a pas augmentées, du moins ne les a-t-il pas diminuées
; et c'est en particulier une hypothèse purement
gratuite de prétendre qu'il a, par principe, supprimé ou
raccourci ces monologues, appelés en grec monodies et en
latin cantica, où la passion d'un personnage se développe,
dans les moments de crise, à la façon lyrique. Les monologues
de ce genre sont assez nombreux et parfois fort
étendus dans toutes les comédies de Térence. Donat ne
signale à ce point de vue aucune suppression ; une seule
fois il indique une réduction, mais il s'agit d'un monologue
narratif. On ne saurait démontrer d'ailleurs que la contamination ait eu pour résultat nécessaire de faire disparaître
aucune monodie : c'est une erreur de croire 1 que
dans l'Andrienne, par exemple, deux monodies de Pamphilus
ont été remplacées par les scènes II, 1, et IV, 1,
où figure Charinus. Rien ne modifie la situation de Pamphilus
entre le moment où son père lui annonce qu'il doit se
marier le jour même, et celui où Davus lui apprend que ce
mariage est une feinte ; la douleur causée au jeune homme
par la communication imprévue de son père est suffisamment
exprimée dans son monologue et son entretien avec
Mysis (I, 5) ; une nouvelle monodie eût été superflue, et
Ménandre n'avait sûrement pas commis la faute de l'écrire.
De même plus loin, la colère de Pamphilus contre l'esclave
dont les funestes conseils l'ont mis dans un embarras désespéré,
s'exhale dans le dialogue avec Davus (sc. 111, 5) ;
une monodie succédant à cette scène n'aurait pu être qu'une
redite (1).
(1) Ajoutons ici que l'Eunuque a gagné à la contamination le long monologue de Gnathon ; mais il est narratif.
Enfin rien n'obligeait Térence à restreindre l'importance
des cantica. Sans doute le public préférait les
dialogues à ces longues méditations solitaires. Mais notre
poète s'est-il fait une loi absolue de suivre en tout les préférences
du public ? La suppression de l'argumentum, l'absence des plaisanteries grossières ou obscènes, chères
à la grande majorité des spectateurs, prouvent assez que
non. Térence ne fut pas l'esclave de ses spectateurs ; il ne
leur sacrifia jamais ce que son goût lui recommandait comme
beau et bon ; or, les éminentes qualités des ses cantica
ne permettent pas d'en douter, il avait un sentiment
très vif de l'excellence littéraire des monodies et il s'est
donné à lui-même en les traduisant un exquis régal d'artiste.
Mais, dans les pièces contaminées, des suppressions
ne furent-elles pas imposées par la nécessité de contenir la
longueur de l'oeuvre dans les limites normales ? Entre la plus courte comédie de Térence, l'Hécyre, qui a 823 vers,
et la plus longue, l'Eunuque, qui en a 1049 , l écart est
de 226 vers ; c'est-à-dire que les limites normales étaient
très élastiques. Des trois pièces contaminées, l'Eunuque est
de beaucoup celle qui doit le nombre de vers le plus considérable à l'original secondaire. Or, ce nombre dépasse à
peine la différence donnée tout à l'heure. En retranchant
de la pièce latine tout l'appoint fourni par la contamination,
on a encore une longueur suffisante pour qu'il ne soit
pas nécessaire d'admettre que Térence ait pratiqué des
coupures importantes dans l'original principal. Quant aux
coupures de détail, il s'en est permis plus d'une (1),
(1) Ainsi, nous savons, par le passage de Perse mentionné plus haut, que Térence a supprimé qq. vers au début même de l'Eunuque; nous avons signalé une autre coupure au v. 1001 de la même comédie. Ce qu'il y a de certain,c'est que Térence a ici abrégé son original
mais
aussi bien dans les pièces à un seul que dans les pièces à
double original : elles n'ont rien à voir avec la contamination
; elles se rattachent à la série des petites améliorations
dont nous parlions plus haut à propos des Adelphes.
La conclusion de tout ce débat est que Térence n'était
pas coupable. Ses devanciers, doués d'un goût moins délicat
et moins sûr, uniquement préoccupés de donner à leurs
comédies une allure aussi amusante que possible, n'avaient-ils
pas toujours su avec autant d'art que lui se garder contre
les dangers du procédé ? Certaines de leurs oeuvres, mélanges plus ou moins incohérents d'éléments disparates,
péchaient-elles sous le rapport de l'unité ? Cela est très
possible. Mais la contamination n'est pas responsable de
ces fautes : il ne faut condamner que la manière maladroite
dont ils s'en sont servis. Térence a usé d'un procédé
légitime, il en a fait un usage irréprochable. Sans détruire
l'unité, il a su accroître la variété ; sans exigences manquer aux de l'art, il a rendu ses oeuvres plus agréables au public. Une telle conduite mérite-t-elle autre chose que des éloges? Luscius était trop lettré pour ne pas sentir lui-même
que son accusation était injuste. Mais la mauvaise foi
est volontiers compagne de l'envie.
II
Térence a été accusé de plagiat deux fois, à propos de
l'Eunuque d'abord, plus tard à propos des Adelphes.
Ainsi l'Eunuque a été acquis par les édiles ; on répète en présence des magistrats ; Luscius trouve moyen de se faire
admettre à la répétition. Tout à coup il s'écrie voleur, : « C'est un voleur non un poète, qui a donné la pièce ; mais il n'a pas donné le change. Il y a le Colax de Névius et de Plaute, une vieille pièce ; les personnages du parasite et du soldat
en sont tirés ». Les renseignements fournis par le prologue
des Adelphes ont beaucoup moins de précision : ils ne nous
apprennent ni où ni comment fut alors formulé le grief. Mais
ils nous laissent voir clairement que l'acte reproché à Térence
était bien de même nature : on l'accusait d'avoir pillé
une pièce de Plaute, les Commortentes ; on se servait contre lui du même terme flétrissant ; car, après s'être justifié,
il disait au public :
" pernoscite
Furtumne factum existimetis"
Dans les deux cas, les adversaires de notre poète lui reprochaient
donc d avoir dérobé quelque chose à l'un de ses
devanciers et de le donner comme sien ou, ce qui revient
au même, comme directement traduit du grec. Les deux
plagiats, de l'aveu des accusateurs, étaient partiels. Térence
avait volé chaque fois, non une pièce tout entière, mais des
fragments plus ou moins considérables qu'il avait mêlés à
une comédie réellement nouvelle et sienne : les rôles du
parasite et du soldat, introduits dans l'Eunuque de Ménandre,
la scène du rapt de la courtisane, fondue avec les
Adelphes du même auteur. le fait était vrai, en voudrions-nous beaucoup à Térence,
nous autres modernes ? En voulons-nous à Molière
d'avoir mis au pillage, je ne dis pas les classiques anciens
et les Italiens, mais ses contemporains français ? Non, parce
que les éléments empruntés, il les perfectionne, les transfigure,
les crée pour ainsi dire une seconde fois. Dans ses
Fourberies de Scapin, par exemple, dont l'intrigue est due
au Phormion de Térence, il a mis à contribution, avec les
farces italiennes et le théâtre de Tabarin, une pièce qui datait
alors d'une vingtaine d'années, le Pédant joué, par
Cyrano de Bergerac : il y a pris suitout la fameuse scène où
revient comme un refrain l'exclamation maintenant proverbiale
: « Mais qu'allait-il faire à cette galère ! » Je ne sache
pas que son public lui en ait tenu rigueur. Quant à la critique
moderne, elle est loin de lui en faire un crime : l'ébauche
vigoureuse, mais grossière de Cyrano, est devenue, grâce à
lui, une peinture achevée. De même, si vraiment Térence
était plagiaire, nous l'absoudrions, pourvu seulement qu'il nous fût démontré que sous sa main les parties dérobées
se sont transformées en mieux.
Mais les contemporains de Térence auraient jugé autrement
que nous. A leur tribunal le poète eût vainement
apporté pour sa défense l'excuse dont nous serions, nous
autres, pleinement satisfaits : la grande majorité des spectateurs
étaient incapables de l'apprécier à sa juste valeur.
Comment, s'il avait emprunté aux vieux comiques latins,
les aurait-il surpassés? Par l'élégance et le bon goût, qualités
purement littéraires, partant peu prisées ou plutôt entièremeut
méconnues d'un public inculte, sur lesquelles on
ne pouvait faire fond pour plaider l'acquittement, que dis-je
? les circonstances atténuantes. Le plagiat n'apparaissait
à de tels juges que par ses côtés odieux : c'était l'atteinte
portée au bien d'autrui, le vol de la propriété littéraire,
crime que les lois ne punissaient pas, mais que l'opinion
publique devait nécessairement réprouver à cause de son
analogie avec le vol ordinaire ; surtout l'opinion publique
romaine : car le Romain, esprit pratique, attentif aux intérêts
matériels, avait un sentiment très profond des droits du
propriétaire. Mais la palliata n'était-elle point par essence
un plagiat? Nullement. Prendre aux Grecs leurs comédies
pour la scène latine, comme on prenait leurs statues pour
orner les temples de Rome, rien de plus légitime : c'était
exploiter le vaincu au profit du vainqueur, user des droits
de la conquête. Seulement, dès qu'une pièce devenait latine,
elle était sous cette forme la propriété de celui qui l'avait
traduite. Voleur quiconque la pillait. Si la fraude était découverte,
il n'avait pas trop à compter sur l'attention bienveillante
et les applaudissements du public ; à défaut de
peines légales, il devait redouter les sifflets.
Le plagiat avait un autre tort, plus grave assurément
aux yeux des spectateurs, parce qu'il les touchait de plus
près. Non seulement le poète plagiaire s'appropriait le bien
d'autrui, mais encore il dupait le public lui-même. En effet,
le plaisir que les vieux Romains allaient chercher au théàtre ne ressemblait guère à celui qu'y goûtent les esprits
cultivés. Pour un lettré délicat quelle jouissance compliquée
qu'un spectacle dramatique ! Il n'est pas indifférent
au sujet de la pièce, à la matière, mais il s'intéresse aussi
et surtout à l'art : l'habileté de la composition, la vérité et
la finesse dans la peinture des caractères, les mérites du
style, mille attraits à la fois, quand l'oeuvre est d'un vrai
poète, sollicitent son attention, flattent son goût, le captivent
tout entier. Une seule représentation n'épuise pas le charme
; il devient au contraire plus complet et plus exquis à
mesure que l'on connaît mieux la pièce ; on est plus maître
de soi, on a plus le loisir d'analyser et de sentir les impressions
qui la première fois se sont produites en foule,
un peu confuses ; on savoure alors pleinement la jouissance
littéraire, sensation raffinée, inconnue à la plupart des spectateurs
de Térence. Ils arrivaient au théâtre avec l'espoir
d 'y rire beaucoup, avec le désir d'y voir des choses non
encore vues : situations neuves, incidents originaux, figures
inconnues. La nouveauté de l'intrigue était essentielle à la
satisfaction de cette curiosité naïve et grossière. Aussi, du
temps de Térence, ne jouait-on en général que des comédies
nouvelles ; il était bien rare qu'une pièce déjà représentée
revînt sur la scène ; à l'exception de quelques oeuvres
privilégiées,comme l'Eunuque,accueillies par un succès
extraordinaire, les comédies, après la représentation, descendaient
au rang de choses hors d'usage. On a donc annoncé
au public une pièce nouvelle, il est venu pour assister à une
pièce nouvelle. Quelle déception s'il s'aperçoit qu'on lui
sert un spectacle déjà vu, ou seulement que ce spectacle,
quoique nouveau pour la génération actuelle, ne l'est pas
absolument ! Même dans ce dernier cas, le public se sent
victime d'une tromperie: on lui a promis une pièce nouvelle,
c 'est-à-dire, nouvellement traduite du grec et représentée
pour la première fois sur la scène romaine. Pour Térence
en particulier, les deux comédies que Luscius lui reprochait
d'avoir pillées, étant de Plaute, les plus âgés d'entre les spectateurs les avaient sans doute vues dans leur nouveauté;
les plus jeunes ne les connaissaient probablement pas ;
n'importe : ils auraient crié aussi fort que leurs aînés, si
l'accusation eût été vraie, contre le poète assez impudent
pour se moquer du public romain.
La mauvaise humeur provoquée par la découverte d'un
plagiat ne se serait pas tout entière concentrée sur l'auteur
du méfait; les présidents des jeux, magistrats ou simples
particuliers, et le directeur de troupe en auraient eu leur
part. Le directeur, intermédiaire habituel entre les poètes
et les acquéreurs de leurs oeuvres, eût été accusé ou d'incapacité
pour s'être laissé tromper, lui homme du métier, sur
la qualité de la marchandise offerte, ou de fourberie pour
avoir aidé le poète à conclure un marché avantageux aux
dépens du public et des acquéreurs; sans compter le ressentiment
redoutable de ceux-ci, personnages haut placés, en
état de nuire à un humble affranchi. Quant aux donneurs
des jeux, on les aurait traités de ladres, régalant le peuple
à petits frais avec les restes misérables des fêtes du passé,
de fripiers et de ravaudeurs. Au lieu de la popularité ambitionnée,
ils se fussent assuré le discrédit et le mépris,
moins riches et moins considérés après que devant. Or, par
contre-coup, cette colère du public contre les présidents des
jeux et le directeur atteignait aussi le poète. Plus de directeur
qui voulût s'employer pour la vente des productions du
plagiaire ; plus d'acheteur qui consentit à les acquérir. Se
rendre coupable d'un plagiat, c'était donc non seulement
s'exposer à un échec immédiat, mais encore compromettre
tout son avenir. On le voit, l'accusation lancée par Luscius
contre Térence était grave, plus grave que celle de contamination, parce que tous les spectateurs étaient parfaitement
capables d'en saisir le sens et d'en mesurer l'importance.
Pour l'accusé il ne s'agissait plus ici de justifier une
action incriminée à tort, il s'agissait de répudier une action
réellement criminelle ; il ne fallait pas plaider le droit, mais
nier le fait. Heureusement pour lui, Térence se trouvait en état de
le faire ; car dans les deux cas l'accusation était fausse.
C'est même par ce seul point, la négation du plagiat, que
se ressemblent ses deux réponses, très différentes d'ailleurs
; ainsi le voulait, nous allons le voir, la diversité des
deux situations.
Térence affirme avoir traduit directement certaines
parties du Colax de Ménandre pour les insérer dans l'Eunuque,
et ne s'être nullement servi du Colax latin de Névius
et de Plaute. En celà il est tout à fait croyable : il
était trop vivement épris de l'élégance et du bon goût pour
hésiter un instant entre le modèle grec et la copie, vigoureuse
peut-être, mais grossière. Seulement, il ajoute qu'il
ignorait l'existence d'une traduction latine des passages en
question, antérieure à la sienne, l'existence du Colax de
Névius et de Plaute. Pareille ignorance est-elle vraisemblable?
Non. Plaute, le plus jeune des deux auteurs nommés,
était trop près de notre poète pour que se fût déjà
formée l'épaisse incertitude qui, du temps de Varron, régnait
sur le nombre et le titre de ses oeuvres : on devait
alors dans le monde lettré connaître toutes ses pièces, au
moins de nom. Pourquoi supposer Térence moins bien renseigné
à ce sujet que Luscius ? Il a prouvé, dans le prologue des Adelphes, qu'il savait en détail le contenu des
Commorientes de Plaute : est-il possible que, connaissant
de si près certaines oeuvres de ce théâtre, il n'ait même pas
su le nom de certaines autres ? Il a commis ici un mensonge;
ce n'est d'ailleurs pas le seul que l'on puisse relever dans
les prologues, et il faut bien avouer que Térence s'y montre
plus soucieux du succès que respectueux de la vérité.
Mais dans quel dessein ce mensonge fut-il fait? Il sentait
que sa conduite, même quand il aurait démontré son innocence
sur le chef de plagiat, ne paraîtrait pas irréprochable aux
spectateurs : en traduisant de nouveau une pièce grecque
déjà traduite, il prenait une liberté qui, sans avoir l'odieux du
plagiat, en avait cependant tous les inconvénients : son
Eunuque, en partie du moins, n'était qu'une comédie déjà
vue, une vieille pièce. Nous savons bien, nous autres,
pourquoi il passa outre à cette considération : il voulut enrichir
l'Eunuque grec de types curieux et de scènes comiques. Mais, pas plus ici qu'à propos de la contamination,
il ne pouvait faire valoir une telle raison. Pourtant il lui
fallait une excuse: il prétendit que, s'il avait péché, il avait
péché par ignorance. C'était assez plausible pour le gros
des spectateurs : que le vieux Luscius connût le Colax
latin, rien de plus naturel : il avait pu le voir jouer au
temps de Plaute ; mais Térence, non. Or, eux qui ne lisaient
pas les pièces de théâtre, ne songeaient guère qu'on
pût les connaître autrement que par la représentation.
Cependant les gens difficiles ou mal disposés, même en
acceptant cette excuse d'ignorance, pouvaient encore blâmer
la conduite du poète : sans doute il n'avait pas commis
la faute avec intention, mais enfin il l'avait commise ; il aurait
dû avant d'écrire prendre ses précautions, se bien renseigner
auprès de personnes plus âgées que lui et mieux au
courant ; quand on a l'ambition de plaire au public, on ne saurait se donner trop de peine; le jeune poète avait agi
avec une coupable légèreté.
Ce qu'il affirme avoir fait par ignorance, donnant ainsi à
entendre que, mieux informé, il ne l'aurait pas fait, Térence
prétend donc ici qu'il avait en somme le droit de le faire : il revendique la liberté, non de commettre un vrai plagiat,
mais de puiser à une source grecque déjà exploitée par devanciers. Mais il ne la revendique pas avec franchise,
et le raisonnement sur lequel il appuie son opinion n'est
qu'un sophisme. Son action est légitime, dit-il en substance,
parce que les poètes comiques ont le droit incontesté
d 'employer des personnages, des incidents, des passions
déjà vus sur la scène romaine. Oui, sans doute, pouvait-on
répondre à Térence, quoique votre devoir soit d'être
aussi peu banal, aussi neuf que possible, vous avez ce droit
sans lequel votre tâche serait impraticable. Mais ne jouez
pas sur le sens des mots « isdem personis. » Nul ne songe
à vous reprocher d'avoir fait paraître un parasite et un
soldat, pas plus qu'on ne vous blâme d'avoir mis dans vos
pièces des esclaves et des vieillards, par exemple, personnages
bien connus pourtant du public, et d'avoir fait duper
vos vieillards par vos esclaves, situation peu originale pourtant.
Mais de ce droit essentiel à la reproduction des scènes,
déjà traduites par vos devanciers, où figurent les personnages,
où se développent les passions, où sont mis en oeuvre
les incidents en question, il y a loin, et vous n'avez nullement démontré que cette reproduction ne vous soit pas
interdite. Or on ne vous reproche pas autre chose. Il est
évident que Térence, dans l'intérêt de sa cause, a confondu
à dessein deux choses très différentes. Il s'est dit que la
distinction, facile pour lui comme pour nous, était assez
subtile pour échapper à l'esprit peu exercé des spectateurs
qui n'auraient pas, d'ailleurs, le temps d'y regarder de près.
Enfin, pour donner à cette apologie une couleur plus spécieuse,
il a invoqué l'argument magique, l'exemple des
anciens.
Si le raisonnement de Térence manque de franchise, sa
véritable façon de penser n'en est pas moins très claire pour
nous. Sachant que le Colax de Ménandre avait été traduit
par Névius et Plaute, il s'en est tout de même servi comme
original secondaire de son Eunuque ; il était donc convaincu
qu'il pouvait, sinon piller ses devanciers, au moins essayer
après eux de tirer une meilleure copie des mêmes modèles
grecs. La justesse de son opinion nous paraît indiscutable ;
mais son public ne la partageait pas, persuadé qu'une pièce
ne pouvait le divertir que si elle était pour la première fois
traduite du grec. Le poète n'a pas dit sa pensée en termes
clairs et sincères, parce qu'il n'a pas osé heurter de front ce
préjugé. Les spectateurs se sont contentés de ses mauvaises
raisons. Ils ont écouté l'Eunuque, ils l'ont applaudi, ils
l'ont redemandé. Toutes leurs préventions contre les comédies
tirées, totalement ou en partie, d'originaux déjà exploités,
n'auraient-elles pas dû tomber à ce coup ? Les faits
avaient démontré de la plus éclatante manière, d'abord, que
le poète méritait des éloges au lieu de reproches, ensuite,
que son procédé, bien distinct du plagiat, n'était pas mauvais
et condamnable en soi.
On se demande, à la première lecture du vers : Colacem esse Naevi et Plauti, veterem fabulam, comment il se fait que Térence ne se soit pas défendu par
une excuse autrement décisive que celles dont il s'est servi.
Il a cité, pour mieux faire passer un sophisme, l'exemple des anciens en général. Au lieu de cela, ne pouvait-il fonder
une justification légitime sur un exemple précis ? Si
Plaute avait traduit après Névius le Colax de Ménandre, il
avait commis, lui aussi, la faute qui restait au compte de
notre poète, son innocence du chef de plagiat une fois reconnue; le cas de Térence était même beaucoup moins
grave, puisqu'il n'avait donné qu'une reproduction partielle
de l'original en question, et que son Eunuque était bien,
pour la plus grande partie, une pièce nouvelle. Voilà, certes,
un moyen de défense éminemment propre à faire impression
sur les spectateurs romains: Que Luscius ne l'ait pas prévu,
cela se conçoit : la jalousie l'aveuglait ; d'ailleurs, il a lancé
son accusation brusquement et sans prendre le temps de la
réflexion. Mais Térence qui a préparé son plaidoyer à tète reposée,
qui attachait le plus grand prix aux arguments de cette
sorte, qui n'a pas cherché d'autre réponse au grief de contamination, comment n'a-t-il pas ici profité d'un tel avantage?
S'il n'a pas agi ainsi, c'est que la situation n'était point ce
qu'elle paraît être au premier coup d'oeil ; c'est qu'il n'y
avait pas deux comédies latines distinctes, traduites du
Colax de Ménandre ; c'est qu'il est question dans le vers
cité plus haut d'une seule et unique pièce. A Ritschl
revient l'honneur d'avoir fait la lumière sur ce point important. Il a prouvé qu'au lieu de la leçon fournie par tous
les manuscrits pour le vers 25 du prologue : « eas fabulas,» il faut lire: « eas ab aliis. » On traduisait jusqu'à
lui : « Mais l'existence de ces pièces latines antérieures à
la sienne, le poète affirme qu'il l'ignorait. » Et pour donner
un sens satisfaisant à cette déclaration, on admettait un
Colax de Plaute distinct du Colax de Névius. Avec la correction de Ritschl, on doit traduire : « Mais que ces personnages
(le Parasite et le Soldat du Colax de Ménandre),
fussent déjà devenus latins, passés sur la scène romaine, le
poète affirme qu'il l'ignorait. » Ainsi tombe la seule raison
qui vînt à l'appui d'une opinion invraisemblable. Plaute
n'était pas remonté jusqu'à la source grecque, il s'était
borné à remanier la traduction de Névius, comme après sa
mort on remania ses propres oeuvres pour les reprendre (1)
(1) Teuffel croit que le Colax latin était le résultat d'une collaboration entre Névius et Plaute. Ce serait là un fait isolé dans l'histoire du théâtre de Rome. Opinion invraisemblable.
Ainsi retouchée, il l'avait présentée au public, qui peut-être
l'avait redemandée, non comme pièce nouvelle, mais comme
reprise et sous le nom de Névius, échappant de cette façon
à tout reproche de plagiat. Seulement, tandis que le nom
des obscurs directeurs de troupe qui refondirent ses comédies
n'a pas survécu à côté du sien, sa popularité et le succès
de la reprise lui valurent de passer dès lors pour l'auteur
du Colax, conjointement avec Névius, et le Colax,
étant devenu la propriété commune de Névius et de Plaute,
fut cité par les grammairiens sous le nom tantôt de l'un,
tantôt de l'autre.
Quand l'accusation lancée contre l'Eunuque se reproduisit
à propos des Adelphes, pour la repousser Térence
n'eut besoin de recourir ni au mensonge ni au sophisme.
N'ayant sur la conscience ni plagiat ni faute d'aucune sorte,
il expliqua en toute sincérité sa conduite. Le cas était fort simple. Térence avait ajouté à son original
principal une scène des Synapothnescontes, pièce de
Diphile déjà traduite par Plaute ; mais Plaute avait laissé
de côté précisément la scène utilisée par Térence. Ainsi,
non seulement notre poète démontrait qu'il avait puisé à la
source grecque et, par conséquent, n'était point coupable
de plagiat ; mais encore il revendiquait pour la partie de
sa comédie empruntée à l'original secondaire, au même titre
que pour le reste, le mérite de la nouveauté ; ce qu'il n'avait
pas pu faire dans le procès de l'Eunuque. Au point de vue
moral et au point de vue pratique sa conduite était également
irréprochable.
On n'est pas peu étonné au premier aborp d'entendre
affirmer que Plaute, traduisant les Synapothnescontes, a
négligé cette scène de l'enlèvement, si animée et si amusante,
si riche d'action et de comique, du genre, en un mot,
pour lequel il avait le plus de goût. Il est impossible cependant
de mettre en doute ici la sincérité de Térence, de le
supposer assez maladroit pour avoir risqué un mensonge
qui, un grand nombre de ses spectateurs ayant sans doute
vu les Commorientes de Plaute, pouvait si facilement tourner
à sa confusion. La coupure faite par Plaute dans l'original
grec, quoique surprenante, n'est pas inexplicable. Ou
bien, en effet, dans une pièce de lui jouée peu de temps
avant les Commorientes, il y avait eu une scène de rapt à
peu près semblable, et le poète, sachant son public épris de
la variété et de la nouveauté, n'avait pas voulu paraître se
répéter; ou bien plutôt il avait,en écrivant sa reproduction
de l'oeuvre grecque, lâché la bride à sa verve et, suivant
son habitude, développé outre mesure certains endroits du
modèle qui lui plaisaient particulièrement ; de sorte que,
pour n'avoir pas une pièce d'une interminable longueur, il
s'était vu presque forcé de sacrifier une scène intéressante,
à la vérité; mais non indispensable à l'intrigue. Dans les deux accusations de plagiat la mauvaise foi des
adversaires de Térence est manifeste. Dans le cas de l'Eunuque,
Luscius devait bien se douter que Térence avait
remonté à l'original grec; du moins, il aurait pu prendre
la peine de vérifier, avant de lancer publiquement une imputation
aussi grave. Mais la malveillance avait étouffé en
lui tout sentiment d'impartialité. La campagne contre les
Adelphes fut aussi déloyale : la coterie de Luscius savait
très probablement que Plaute avait omis la scène en question
; elle était certainement persuadée, dans tous les cas,
que Térence, pas plus ici que pour l'Eunuque, n'avait songé
à tirer parti d'une comédie latine. Mais il yavait contre
lui une apparence ; l'occasion parut bonne à ces gens peu
scrupuleux de tenter encore une manoeuvre perfide (1).
(1) M. Dziatzko (éd. des Ad. note au v. 13 du prol.) croit que les ennemis de Térence ne connurent pas sa pièce textuellement avant la représentation, mais surent seulement qu'elle était en partie imitée des Synapothn et conjecturèrent dès lors que Térence avait dû se servir des Commor. Même si cela est vrai, la conduite des amis de Luscius fut fort déloyale. Mais je croirais plutôt que les adversaires eurent entière connaissance de la pièce, comme il était arrivé pour l'Eunuque, et peut-être de la même façon.

III
Le grief de collaboration clandestine, comme ceux de
contamination et de plagiat, est relevé deux fois par Térence
: dans le prologue de l'Heautontimorumenos et dans
celui des Adelphes. C'est évidemment qu'il fut lancé et exploité
contre notre poète avant la représentation de ces deux
seules comédies. Mais pourquoi, ne s'appliquant pas en
particulier à l'Heautontimorumenos et aux Adelphes, ayant,
d'après les termes où il est formulé par Térence, une portée
absolument générale, se produisit-il dans ces deux cas plutôt
qu'à propos des autres pièces ? Les reproches plus précis sont signalés et réfutés dans les prologues des comédies qui
y prêtèrent le flanc : l'Eunuque et les Adelphes, où la mauvaise
foi avait dénoncé un prétendu plagiat, sont défendus
contre l'accusation de plagiat ; la légitimité de la contamination
est plaidée à propos de l'Andrienne, pièce contaminée.
Il en est ici tout autrement. L'Heoutontinioiumenos
n'est point, parmi les drames de Térence, le premier
que ses adversaires aient considéré ou feint de considérer
comme le résultat d'une collaboration ; mais ce fut seulement
avant la représentation de cette pièce qu'ils s'avisèrent
de ce grief ; ce fut elle qui leur fournit la première occasion
d'en faire usage ; ils s'en servirent alors avec d'autant plus
d'empressement que l'oeuvre ne donnait prise à aueune critique
spéciale et ils rééditèrent, pour l'appuyer, le grief de
contamination, sous forme générale aussi. Plus tard, quand
ils surent que les Adelphes seraient représentés aux jeux
funèbres de Paul-Emile, s'ils crurent opportun de reprendre
l'accusation laissée de côté dans l'intervalle comme inefficace,
c'est qu'elle empruntait aux circonstances une apparence
de fondement. L'un des fils du défunt, présidents
des jeux, était Scipion Emilien, ami de Térence, et comptait
au nombre de ces grands personnages dont Luscius et les
siens voulaient faire, aux yeux de l'opinion publique, les
collaborateurs du poète. Scipion avait choisi pour cette solennité
deux oeuvres de Térence, les Adelphes et l'Hécyre;
à cela rien d'étonnant : il avait mis lui-même la main à la
composition de ces pièces ; il était bien naturel qu'il profitât
de ses propres jeux pour les faire connaître. Voilà sans
doute les réflexions au moyen desquelles les malveillants
s'efforcèrent de donner du crédit à la vieille accusation renouvelée.
Il ne semble pas, d'après les passages des deux prologues
en question, que, du vivant de Térence, ses détracteurs
soient jamais allés jusqu'à prétendre qu'il n'était pour rien
dans les comédies jouées comme siennes. C'eût été là vouloir
le réduire au rôle de prête-nom, de pseudonyme vivant imaginé pour cacher certains personnages de la noblesse,
les vrais auteurs, désireux de ne pas se livrer à la publicité;
rôle pareil, malgré la différence des situations, à celui de ce
Callistrate, de ce Philonide, qui, en attendant la majorité
théâtrale d'Aristophane, adoptèrent et présentèrent les drames
du jeune poète, les enfants de la fille-mère. Si le parti
de Luscius n'essaya pas de répandre cette opinion extrême,
ce ne fut ni par amour de la vérité, ni par ménagement
pour l'ennemi ; le reste de leur polémique nous en est
garant. Mais elle était trop invraisemblable : trop de gens
savaient et pouvaient attester que Térence passait son temps
à travailler pour le théâtre. Une telle légende ne s'est formée
qu'après la mort du poète, à quelque distance des
évènements. On dirait cependant que le sens du grief de
collaboration n'a pas été le même dans les deux cas où il
s'est produit.
Luscius aurait voulu d'abord faire passer Térence pour
une sorte de pauvre d'esprit qui s'est voué à une tâche au-dessus
de ses forces et ne s'en tire que grâce au concours
de personnes plus capables sur lesquelles il a compté,
quand il s'est mis à l'ouvrage, pour guider sa main aux
endroits difficiles. D'après ces affirmations, Térence aurait
été, par rapport à ses collaborateurs, comme un élève mal
doué dont le maître retouche à chaque instant l'ébauche.
Ses adversaires paraissent lui avoir reconnu, quand ils reprirent
l'accusation à propos des Adelphes, une situation
moins humble. Les rôles sont intervertis, l'élève a fait tant de progrès
qu'il est devenu maître, chef d'atelier ; les collaborateurs
ne sont plus maintenant que des auxiliaires exécutant sous
sa conduite la part de besogne qu'il leur distribue ; la direction
du travail n'appartient qu'à lui. En somme, les
ennemis de Térence prétendaient le dépouiller seulement
d'une partie plus ou moins grande de son mérite littéraire,
et cela, comme il ressort des pluriels employés dans les deux
passages cités, au profit non d'un seul, mais de plusieurs.
Que faut-il penser de cette prétention, et d'abord qu'en
ont pensé les anciens ? L'opinion soutenue du vivant de
notre poète par ses détracteurs, trouva après sa mort des
partisans dont la plupart allèrent même beaucoup plus loin
que Luscius. « Non obscura fama est, dit Suétone, adjutum
Terentium in scriptis a Laelio et Scipione », et il
ajoute un peu plus loin que cette opinion, en faveur surtout
parmi les contemporains de Térence, « usque ad posteriora
tempora valuit ». A l'appui de son dire, il produit deux
témoignages. L'un est de Népos qui raconte, comme puisée
à une source sûre, l'anecdote de Lélius priant sa femme,
qui l'appelle pour se mettre à table, de ne pas le troubler
et, quand il entre enfin dans la salle à manger, disant « non
ssepe in scribendo magis sibi successisse, » récitant même ce
qu'il venait d'écrire, un passage de l'Heautontimorumenos.
L'autre est de C. Memmius,
l'ami de Lucrèce et de Catulle, qui, dans un discours
pour lui-même, avait dit : « P.Africanus, a Terentio personam
mutuatus, qux domi luserat ipse, nomine illius in scaenam detulit ». Donat, dans l'Auctarium de la Vie
de Térence, apporte un troisième témoignage, celui d'un
certain Vallégius.
Ainsi, d'après Népos, Lélius aurait été le collaborateur, non accidentel, mais assidu, de Térence; d'après Memmius et
Vallégius, Scipion serait le véritable auteur des comédies
jouées sous le nom de Térence. On voit que, si Népos ne
dépasse pas la limite des assertions de Luscius, les deux
autres sont tout à fait radicaux. Cette opinion extrême, Cicéron
et Quintilien en mentionnent aussi l'existence, mais
d'une façon générale et sans citer de noms propres. Tandis
que Quintilien, d'accord avec Memmius et Vallégius, désigne,
comme auteur prétendu des comédies, Scipion, Seulement, Cicéron fait
remonter la tradition jusqu'au temps même de Térence, et
en cela il commet une erreur manifeste : si quelqu'un alors
avait émis le grief sous cette forme absolue, c'eût été Luscius,
et notre poète n'aurait pas manqué de rapporter, sans
l'atténuer, un reproche qui, par sa grossière invraisemblance,
lui aurait fait la partie belle.
D'ailleurs, il est clair que Cicéron et Quintilien se bornent
à reproduire la manière de voir d'autrui, sans l'adopter.
Ajoutons que Cicéron a montré dans le traité de l'Amitié
quel cas il faisait de la légende. Lélius, le principal interlocuteur
du dialogue, cite l'Andrienne et cela, sans profiter de l'occasion
pour dire ou donner à entendre qu'il a pris une part
quelconque à la composition soit de cette pièce, soit d'aucune
autre du même poète, quoiqu'il s'entretienne avec des personnes
auxquelles il n'a rien à cacher, ses deux gendres.
Suétone ne croit pas davantage aux collaborateurs de Térence.
Ce qui le prouve, c'est que, se posant la question de
savoir pourquoi le poète s'est défendu mollement contre
cette accusation, il en trouve la raison non dans le sentiment
intime que Térence avait de sa culpabilité, mais dans son désir de plaire à ses amis en laissant courir un bruit qui
les flattait. Enfin ni César, dans ses vers fameux sur Térence, ni Horace, ni aucun autre écrivain sérieux et compétent, ne font la moindre allusion au grief dont Memmius,
Vallégius et Népos restent ainsi pour nous, en dehors
de Luscius, les seuls champions anciens nominativement
connus.
Or, de ces trois champions deux ne méritent pas du tout
d'être pris au sérieux. Qu'est-ce que Vallégius ? Quelque
poète fort obscur, dont le nom même n'est pas certain. De
plus le fragment que Suétone nous a conservé de lui, extrait d an écrit intitulé : « Actio », n'inspire guère confiance
par son ton de pamphlet. Nous connaissons mieux Memmius
; mais c'est d'un plaidoyer que provient son témoignage
contre Térence ; et chacun sait que pour l'auteur
d'un plaidoyer le souci du vrai n'est pas l'unique, n'est pas le principal ; au fond Memmius ne croyait peut-être point
à l'opinion qu'il affirmait, et ne l'affirmait que pour les
besoins de sa cause. La chose ne tirait pas à conséquence
et ne faisait de mal à personne. Le témoignage de Memmius
nous révèle donc, une fois de plus, l'existence de la légende,
mais ne saurait à nos yeux en augmenter l'autorité. Reste
Cornélius Népos, qui n'est, lui, ni un pamphlétaire, ni un
orateur judiciaire, mais un historien, ou du moins un biographe.
Il avait écrit plusieurs séries de vies d'hommes
illustres groupés selon la nature de leur illustration : c'est
sans doute dans une vie de Térence, qui faisait partie de la
série des poètes, que se trouvait racontée l'anecdote en question. Il ne faudrait pourtant pas faire trop grand cas
de ce témoin. Il est vrai qu'il garantit l'origine du renseignement,
mais il ne la fait pas connaître, et, s'il l'avait fait
connaître, nous ne serions peut-être pas aussi disposés que
lui à la trouver certaine. Pline l'Ancien l'accuse de crédulité,
et l'étude des débris de ses oeuvres montre qu'il avait un goût très prononcé pour les déiails anecdotiques et qu'il
ne s'est pas toujours informé aux meilleures sources ni avec
assez d'attention. Si donc l'on n'a égard qu'à l'autorité des
témoignages, à l'opinion de l'antiquité, les alliés de Luscius
font à tel point pauvre figure en face des alliés de Térence,
qu'il n'est pas possible d'hésiter entre les deux partis.
Considérons maintenant l'accusation en elle-même. Il ne
s'agit pas, bien entendu, de la version qui substitue radicalement
à Térence Scipion ou Lélius : il tombe sous le sens
qu'elle est fausse, et Luscius lui-même, peu suspect de
partialité en faveur de notre poète, n'eut pas l'audace de la
produire, n'y songea sans doute pas, trop habile pour
essayer de faire accroire aux contemporains une chose aussi
grossièrement invraisemblable. Elle n'apparut, disions-nous
tout à l'heure, qu'après la mort de Térence; il n'est pas
difficile de comprendre comment elle s'est formée. L'accusation,
telle que l'avait lancée Luscius, n'empêcha pas le
public de faire bon accueil à l'Heautontimorumenos et aux
Adelphes; mais il va sans dire qu'un certain nombre de
personnes la tinrent pour vraie : elle était bizarre, elle était
méchante ; elle piquait la curiosité et à la fois la malignité
de l'esprit humain ; elle était bien faite pour y entrer et y
rester. Aussi survécut-elle à Térence, mais non sans se
transformer. La malignité, qui l'avait trouvée de son goût,
la grossit et l'exagéra, aidée dans cette oeuvre par un autre
penchant de notre esprit, qui le porte vers les idées simples,
nettes, faciles à exprimer et à retenir. Au lieu d'adjoindre
à Térence des collaborateurs, ce qui était trop
bénin et trop compliqué, on le supprima et on mit à sa
place, non plusieurs, mais un seul de ces personnages qu'on
lui avait primitivement donnés pour auxiliaires, tantôt l'un,
tantôt l'autre des deux principaux, Scipion et Lélius. Ainsi
Térence, que ses adversaires contemporains avaient admis
au partage, en fut exclu ; ses comédies furent regardées
comme l'oeuvre d'un seul, mais d'un autre que lui. Plus on
s'éloignait des événements, moins l'on était sensible à l'invraisemblance de cette légende fantaisiste. L'origine en est
claire ; le désaccord touchant le nom qu'on substituait à
celui de Térence nous la montre en pleine formation ; elle
ne mérite pas la discussion. Laissons de côté la version
posthume, d'une évidente fausseté, et venons à la version contemporaine. Faut-il reconnaître pour vrai le grief de
collaboration clandestine réduit aux proportions que lui
donnait Luscius?
Les deux passages cités des prologues nous laissent aisément
apercevoir de quelles raisons Luscius appuyait son
accusation : il exploitait contre Térence la soudaineté de son
apparition dans le monde théâtral et ses relations familières,
qui étaient de notoriété publique, avec de nobles
personnages lettrés. Ces raisons n'ont grande force ni
l'une ni l'autre. Il est vrai qu'un beau jour, n'ayant pas
encore vingt ans, nes'étant d'abord attaché comme disciple
à aucun poète comique de l'époque, sans avoir annoncé aux
gens du métier qu'il se vouait à l'art dramatique et préparait
une première pièce, Térence sortit brusquement de l'ombre
pour offrir aux édiles son Andrienne. Mais parce que ses
débuts se firent à l'improviste, avait-on le droit de nier la
vocation et la capacité du nouveau poète, de le représenter
comme poussé par les suggestions de ses puissants amis
dans une carrière vers laquelle ne l'attirait pas la nature,
comme soutenu et presque porté par eux dans un chemin
trop rude pour sa faiblesse ? S'il vint au théâtre sans y être
attendu, est-ce la preuve qu'il n'était pas fait pour y venir,
qu'il ne se préparait pas de longue main à y venir ? En étudiant,
avec les fils des grandes familles, les chefs-d'oeuvre
des lettres grecques, Térence s'est senti plus particulièrement
charmé par la comédie nouvelle, par Ménandre : il
s'est peut-être essayé à en traduire quelques scènes ; ses
maîtres, ses protecteurs l'ont encouragéà aller plus loin, et
un jour l'idée bien arrêtée de se consacrer au théâtre s'est
établie dans son esprit. Mais il n'a pas cru pour cela devoir
se mettre en relation avec les comiques romains contemporains : ni leur méthode de traduction, ni leur manière d'écrire
ne lui plaisaient ; les seuls modèles grecs avaient son
admiration et sa confiance, il voulait être le disciple et l'imitateur
des seuls poètes attiques. Aussi ne quitta-t-il point
le cercle où il vivait depuis l'enfance, où n'entraient, à notre
connaissance, ni Cécilius, ni surtout Luscius, ni aucun autre
comique, pour aller chercher auprès d'eux des conseils. Il
n'en sortit que le jour où, la première oeuvre achevée, il
fallut la soumettre à l'épreuve de la publicité. Ainsi s'explique,
bien plus naturellement que par les insinuations de
Luscius, la subite venue de Térence à la scène.
Les relations familières de Térence avec les membres
les plus instruits de l'aristocratie contemporaine ne sauraient
non plus passer pour un argument sérieux. Entre
poète et gens du monde lettrés, ne peut-on concevoir l'amitié
sans la collaboration? Térence est-il le seul, pour ne parler
que des écrivains latins, qui ait vécu dans l'intimité de personnages
distingués par leur culture intellectuelle ? La plupart
des grands poètes du siècle d'Auguste sont dans le
même cas : Mécène a été le protecteur et l'ami de Varius,
de Virgile, d'Horace, de Properce ; Messala Corvinus a
joué le même rôle auprès de Tibulle. Quelqu'un a-t-il prétendu
qu'ils leur aient servi en même temps de collaborateurs
? Sans sortir de l'époque à laquelle appartient Térence,
il est constant qu'Ennius fut reçu dans la société
des nobles les plus ouverts aux choses de l'esprit; Pacuvius,
au rapport de Cicéron, fut l'hôte et l'ami de ce Lélius
précisément dont le nom figure en première ligne parmi
ceux des prétendus collaborateurs de notre poète ; Lucilius,
d'après Horace, eut des rapports très amicaux avec le
même Lélius et avec Scipion-Emilien, autre auxiliaire supposé de Térence. A-t-on jamais ouï dire que ces personnages aient pris une part plus ou moins considérable aux
oeuvres de leurs protégés ou amis ? Non, exception faite
pour Térence. Et de quel droit cette exception ? Pourquoi
admettre la collaboration ici plutôt qu'ailleurs ? Térence
avait-il besoin d'aide pour ses comédies, plus que Pacuvius
pour ses tragédies, ou Lucilius pour ses satires ? Était-il
inférieur à sa tâche ?
Nous chercherions en vain une raison solide qui nous
permît de conclure à cette infériorité. Peut-on invoquer
contre Térence son extrême jeunesse ? Il n'avait pas vingt
ans lorsqu'il donna sa première pièce, il n'en avait pas vingt cinq
quand fut jouée la dernière. Mais d'abord Scipion et
Lélius, que la légende lui adjoint ou lui substitue, étaient
celui-là aussi jeune, celui-ci à peine plus âgé (1).
(1) Scipion naquit en 570, Lélius (consul en 614) était un peu plus âgé que son ami, (Cic. de Rep. I, 18).
D'ailleurs,
dans l'histoire des littératures, les exemples ne manquent
pas de poètes chez qui le génie n'a pas attendu pour se déclarer
le nombre des années ; notre siècle en fournirait d'illustres.
N'en citons qu'un, emprunté à la Grèce : Ménandre,
le maître préféré de Térence, avait, quand il fit sa première
oeuvre, à quelques mois près, l'âge de son disciple écrivant
l'Andrienne. La précocité poétique de Térence est remarquable
; elle n'a rien d'anormal et d'invraisemblable ; si
son talent a donné rapidement des fruits, c'est que de très
bonne heure une excellente éducation en a développé la richesse
naturelle, c'est que la plante vigoureuse a eu le
bonheur d'être favorisée par une culture soignée. Avec
moins de légitimité encore on objecterait l'humble condition
de Térence. Il était affranchi ; mais ce n'est point dans
les hautes classes de la société romaine, dont les membres
étaient imbus des vieux préjugés ou, par intérêt de popularité,
affectaient d'y être fidèles, que l'on trouve les représentants
de la poésie à cette époque ; Lucilius, au septième
siècle, est, je crois, le plus ancien poète marquant de rang
équestre. Névius, Plaute, Ennius, simples plébéiens, ne s'élevaient guère au-dessus de Térence par leur condition
sociale ; Andronicus et Cécilius avaient été esclaves comme
lui. Dira-t-on enfin que Térence était un étranger, un barbare
de Carthage, de Numidie ou de Libye ? Qu'importe, si dès
son enfance il avait été élevé comme un Romain ? Les dons
de l'esprit n'étaient pas, que l'on sache, en ce temps-là, le
privilège exclusif des hommes nés dans l'enceinte ou sous
les murs de la Ville. Andronicus était un Grec de Tarente,
Ennius un Campanien de Rudies, Cécilius un vrai barbare,
un Gaulois de la tribu des Insubres. A l'époque impériale,
les pays barbares, où pénétra la civilisation gréco-romaine
fournirent en abondance des écrivains latins de mérite : les
Espagnols tiennent un rang fort honorable dans la littérature
des deux premiers siècles de notre ère ; parmi les plus célèbres représentants de l'apologétique chrétienne
brillent des Africains, des compatriotes de Térence. C'est
peu d'affirmer que la condition d'étranger et d'affranchi
ne fit aucun tort au talent naturel de Térence : elle
le servit à merveille. Si, avec les mêmes qualités intellectuelles,
il était né libre et citoyen romain, d'autres ambitions
auraient pu le détourner de la carrière dramatique ; si
surtout le hasard en avait fait le fils d'un chevalier ou d'un
sénateur, il aurait été soldat, orateur, magistrat, il aurait
peut-être aimé les lettres et protégé les poètes, comme Scipion
et Lélius, mais il n'aurait sans doute pas songé à faire
des comédies. Rien ne prouve donc, rien ne permet de
soupçonner que Térence ne fût pas capable, à lui tout seul,
de se tirer d'affaire. Un fait rapporté par Suétone prouve
même péremptoirement le contraire : pendant son séjour en
Grèce, alors qu'il n'avait plus à côté de lui ses prétendus
collaborateurs, il fit plusieurs nouvelles pièces traduites
de Ménandre. Il est vrai que ces oeuvres sont malheureusement perdues et que nous ne savons pas si elles étaient
comparables aux six comédies que le poète avait données
avant de quitter Rome.
Cette comparaison eût détruit le seul prétexte spécieux
de la légende. Car, sans compter leur faiblesse, les deux arguments
produits par Luscius étaient de nature, tirant toute
leur apparence de l'actualité des faits, à frapper de moins
en moins les esprits avec le. temps. Ce qui contribua le plus
à revêtir la calomnie d'un faux air durable de vérité, ce fut
un troisième motif dont la force restait toujours égale, ce fut
la pureté, le bon goût, l'exquise élégance du style des comédies.
Luscius ne dut pas le faire valoir ; il ne le pouvait
sans décerner un éloge à des oeuvres qu'il s'efforça constamment
de décrier. Mais ceux qui dans la suite adoptèrent
son opinion en furent fortement influencés. C'est à cause
de l'élégance du style, d'après Cicéron, dans le passage cité
plus haut, que les pièces de Térence étaient attribuées à
Lélius. On se disait évidemment qu'il n'était pas possible
qu'un étranger, un Africain, fût arrivé le premier à une
science si pleine, si sûre et si délicate de la langue latine,
laissant bien loin derrière lui, sous ce rapport, tous les
poètes ses devanciers, étrangers et Romains de naissance.
Son prédécesseur immédiat, Cécilius, un barbare lui aussi,
avait écrit des comédies, supérieures aux siennes à certains
points de vue, mais combien inférieures pour la valeur de
la forme! Cicéron, excellent juge en ces questions, l'accuse
d'avoir mal parlé le latin, faisant d'ailleurs le même reproche
à Pacuvius, autre poète contemporain. Dans un autre endroit, il lui refuse une autorité sérieuse en matière de latinité,
tandis qu'il l'accorde à Térence.
Mais l'exemple de Cécilius, l'exemple de tous les vieux
poètes de Rome, ne prouve rien contre Térence. Si nul d'entre eux n'écrivit le latin aussi bien que Térence, c'est
que nul d'entre eux ne fut préparé au métier d'écrivain par
un concours de circonstances aussi heureuses. Les uns, sortis
des derniers rangs de la plèbe, n'eurent pas d'éducation et
se formèrent eux-mêmes ; les autres, étrangers venus à
Rome dans la force de l'âge, n'y trouvèrent pas le loisir de
compléter, avant de se mettre à l'oeuvre, la connaissance
qu'ils pouvaient avoir de la langue. Tous furent aux prises
avec l'inexpérience d'un idiome non encore rompu à la
poésie. Prenons Cécilius en particulier. Il vint assez tard à
Rome, s'il est vrai qu'il y fut amené comme prisonnier de
guerre Il se mit à l'étude du latin et des belles-lettres, il
choisit la profession de poète, à un âge où l'esprit, trop
formé déjà, n'a plus assez de souplesse pour se laisser docilement
façonner par l'éducation. D'ailleurs, son éducation,
jusqu'à quel point fut-elle bonne et soignée ? Après son
affranchissement, il s'attacha, dit-on, à Ennius. Ennius,
poète de talent, put lui rendre au point de vue intellectuel
de très grands services, mais il ne put en faire un maître
dans l'art du style, dont pour sa part il était loin deposséder
tous les secrets, toutes les finesses. Se vouant à la comédie,
Cécilius dut aussi lire et se proposer pour modèles ses devanciers
dans ce genre, Névius et Plaute surtout, grands
écrivains sans doute, mais non sans défauts : négligence,
rudesse, grossièreté et dont il était plus facile, suivant la
règle générale, d'imiter les défauts que les mérites. Il ne
faut donc pas s'étonner que l'Insubre, transplanté à Rome
en pleine maturité, livré dans son inexpérience à des guides
peu sûrs, n'ait pas atteint les difficiles sommets de la perfection
littéraire. Mais pour Térence, les conditions furent
autrement favorables. Il arriva à Rome tout enfant : la langue
latine, la plus pure, celle de la Ville même, lui devint
promptement, grâce à cette facilité d'assimilation que possèdent
les très jeunes esprits, aussi familière que sa langue maternelle, ou plutôt la lui fit oublier et la remplaça. Esclave
d'un sénateur qui, frappé de ses brillantes dispositions, le
fit soigneusement élever avec ses propres enfants sans
doute, il grandit parmi les fils des sénateurs : les incorrections
et les trivialités du langage plébéien ne souillèrent pas
ses oreilles ; la lecture des oeuvres grecques, l'étude spéciale
de Ménandre, le plus élégant poète de la nouvelle comédie,
développèrent en lui le sentiment et l'amour de la
correction et de la distinction dans le dessin, dans le coloris
du style. Il fréquenta toujours le cercle de Scipion-Émilien,
qui était à Rome le foyer de la culture littéraire, milieu
autrement poli et délicat que celui où ses devanciers avaient
vécu ; enfin, venu le dernier dans le genre déjà vieux de
la palliata, il profita de toutes les ressources dont les efforts
de ses aînés avaient doué l'instrument de traduction. N'y
a-t-il pas dans toutes ces raisons de quoi expliquer les caractères
du style de Térence ? Est-il nécessaire d'attribuer à
d'autres qu'à lui son mérite d'écrivain ?
Si Térence était aussi heureusement doué que ses prétendus
collaborateurs, ce que nous avons le droit de supposer,
s'il reçut le même genre d'éducation, ce qui est
prouvé, la parfaite élégance de son latin n'a rien d'étrange
et de suspect : on peut admettre en toute sécurité qu'elle
vient de lui et non d'autrui ; bien plus, on doit l'admettre.
Car aucun des contemporains de Térence n'était mieux en
mesure que lui de réaliser cette merveille d'art délicat et
fin. Égal aux plus instruits par la connaissance de la langue,
il avait sur tous une supériorité considérable, celle
que lui donnèrent ses études spéciales, son apprentissage.
Au sortir de l'enfance, après avoir quitté l'école et les pédagogues,
Scipion, Lélius et d'autres encore que l'on a
cités comme auxiliaires de Térence, continuèrent à s'occuper
de belles-lettres, mais seulement par goût d'amateurs
et par distraction. La meilleure partie de leur temps fut dès
lors consacrée à des travaux plus sérieux pour eux et plus pratiques. Destinés par leur naissance à la vie politique, à la
carrière des honneurs, ils se préparèrent à cet avenir : ils
apprirent le droit en s'attachant à la personne de quelque
jurisconsulte en renom ; ils cultivèrent leurs facultés oratoires
en vue des luttes du forum et du sénat. Tandis qu'ils
s'exerçaient ainsi à leur rôle de citoyens influents, Térence,
libre de cette nécessité, entraîné par sa vocation, consacrait
tout son temps à ses études poétiques : surtout il lisait et
relisait Ménandre ; il se pénétrait des beautés de son auteur
favori ; un vif désir de les reproduire l'enflammait, lui
communiquait courage et adresse, lui faisait trouver dans
la langue latine des ressources que tout autre y eût vainement
cherchées. Pour cette lutte avec le modèle grec, il
était bien mieux armé que Scipion et Lélius. Ceux-ci ne
pouvaient qu'être spectateurs du combat, encourageant leur
jeune ami, suivant avec intérêt les progrès de son oeuvre,
donnant parfois un conseil en hommes de goût, mais rien
de plus.
Un examen attentif ne laisse donc subsister aucune vraisemblance
en faveur de l'accusation émise par Luscius. Ce
qui achève de lui ôter tout crédit, c'est sa source la plus
ancienne, et la seule sans doute ; car il est infiniment probable
que la légende posthume n'eut pas d'autre origine que
les calomnies du vieux poète malveillant. Or, comment
nous inspireraient-elles quelque confiance, les assertions
d'un rival dont la partialité nous est démontrée, que nous
avons pris, à propos du grief de plagiat, ea flagrant délit
de mauvaise foi ? Il ne croyait pas plus lui-même à ce reproche
qu'aux autres ; mais dans la guerre déloyale qu'il
faisait à Térence toute arme lui était bonne, pourvu qu'il
espéràt pouvoir en blesser l'ennemi. Notons bien que, s'il
s'agit d'imputer au jeune poète un vol littéraire, un vice
de composition, des défauts de style, c'est à Térence seul
que Luscius s'en prend, c'est Térence seul qu'il trouve
dans les comédies, et il se garde bien de faire intervenir les
collaborateurs pour leur infliger leur part de blâme. C'eût été justice cependant, et la logique l'eût voulu. Mais
Luscius se moquait de la justice et de la logique, il ne
cherchait qu'à satisfaire sa haine.
Or, la même accusation qui nous parait à nous invraisemblable,
avait, du vivant de Térence, un air de vérité
pour la masse du public, pour ce grand nombre à l'opinion
de qui étaient subordonnés le succès et l'échec des pièces
de théâtre; et cela précisément en vertu des motifs que
nous avons trouvés sans force. D'abord Térence était très
jeune : de tout temps les gens du peuple ont difficilement
admis que l'on puisse exceller dans un art quelconque sans
l'expérience de l'âge. Les spectateurs romains, raisonnant
par analogie, considérant qu'on ne devient pas bon laboureur,
bon artisan, avant d'avoir longuement manié la charrue ou
l'outil, devaient se dire qu'en effet il n'était guère probable
qu'un adolescent, presque un enfant, eût fait, sans être
aidé, des comédies de valeur. Ce qui pouvait contribuer à
les affermir dans ce soupçon, c'est que Térence vivait, au
su de tous le monde, dans l'intimité de grands personnages,
les uns plus âgés que lui, les autres aussi jeunes il est
vrai, mais dont on se faisait parmi le vulgaire une si haute
idée à cause de leur naissance, qu'on n'hésitait pas à leur
attribuer, à nombre égal d'années, beaucoup plus de capacité.
Que tous ces hommes, jeunes ou vieux, fussent capablès
de faire des comédies, s'ils le voulaient, la foule n'en
doutait pas : ils avaient fait, eux ou leurs pères, des choses
autrement difficiles. En général, ils ne le voulaient point,
pensait-on ; en général, les nobles laissaient à de plus
humbles la poésie, occupation qu'ils jugeaient indigne de
leur rang. On concevait cependant qu'il arrivât à quelqu'un
d'entre eux d'écrire, par amusement, par caprice, ou encore
par obligeance, pour venir en aide à un poète, son protégé,
pour rendre un petit service de patron à un client ; et qu'alors,
n'attachant aucun prix à pareilles bagatelles, il lui
abandonnât tout l'honneur et tout le profit de l'oeuvre produite
en commun. Était-il impossible que Lélius, Scipion, ou d'autres, voulant du bien à Térence, lui fissent cette faveur
? Et c'était là une illusion dont les ignorants seuls ne
devaient pas être dupes ; elle avait de quoi séduire aussi
les personnes de quelque instruction, un peu enclines à la
malignité : la distinction de bonne compagnie qui régnait
dans le style de Térence, était propre à éveiller leurs soupçons,
et le soin que les auxiliaires supposés du poète mettaient
à se cacher, s'expliquait suffisamment, à leur sens,
par la crainte d'encourir le blâme populaire, de perdre en
considération auprès des partisans sévères des anciennes
moeurs. Voilà sur quelles trompeuses apparences Luscius
comptait pour accréditer dans le public une erreur préjudiciable
à son jeune rival.
Car le grief de collaboration clandestine pouvait faire un
tort réel à Térence dans l'esprit des spectateurs. L'insuffisance
attire le ridicule, l'hypocrisie appelle l'antipathie. Si
Térence était incapable de composer à lui seul une comédie,
s'il mentait en faisant annoncer comme exclusivement
siennes des pièces où d'autres que lui avaient mis la main,
il risquait ce double péril. Les vieux poètes, Névius, Plaute,
Ennius, Cécilius, étaient d'une autre taille ; ils n'avaient pas
besoin, eux, que des amis complaisants les aidassent à se
tirer d'affaire ; l'argent qu'ils recevaient, les applaudissements
qu'ils recueillaient étaient bien tout à eux : ils n'empochaient
pas sournoisement la part d'autrui ; ils ne ressemblaient
pas, comme le nouveau venu, au geai paré des
plumes du paon. Telles pouvaient être les réflexions peu
obligeantes du public. Cependant l'accusation, sans être
inoffensive, avait beaucoup moins de gravité, au point de
vue des conséquences matérielles, que celles de contamination
et de plagiat, parce qu'en somme l'intérêt du public
n'était pas en jeu. Que la pièce donnée sous le nom de
Térence fût tout entière de Térence, ou non, qu'importait
au fond, si elle était bonne, c'est-à-dire divertissante ? Or
cette condition, l'oeuvre de plusieurs pouvait aussi bien la
remplir que l'oeuvre d'un seul. Pourvu qu'elle fût remplie, les spectateurs, amusés, n'iraient pas jusqu'à siffler la
pièce ; ils se borneraient à mépriser le poète. Celui-ci
n'aurait donc pas à subir pour le moment un échec, mais
un simple préjudice moral. C'était bien là l'objectif de
Luacius ; nous avons noté plus haut un changement de sa
tactique à partir de l'Heautontimorumenos : au lieu d'attaques
précises portant contre la pièce à jouer, des accusations
générales dirigées plutôt contre le poète, non dans
l'espoir de l'abattre d'un coup par un échec éclatant, mais
pour ruiner son avenir en le perdant peu à peu dans l'opinion
publique. Toutefois, il était difficile que le mépris
ainsi attiré sur Térence fût sans mélange, qu'il ne se compliquât
pas d'un sentiment tout opposé, d'une sorte de
respect. Celui que des hommes qui comptaient parmi les
premiers de la cité, honoraient de leur amitié jusqu'à l'aider
dans ses ouvrages, apparaissait naturellement à la foule
éclairé et comme protégé par un reflet de leur illustration
et de leur popularité. L'idée que de tels personnages avaient
travaillé aux comédies de Térence, les recommandait à la
faveur publique. Le grief de collaboration clandestine devait
donc produire une impression complexe par sa nature,
bizarre par ses effets, confuse pour ceux qui purent l'éprouver.
Sans nuire à telle pièce de Térence, elle nuisait à
Térence; car elle rapetissait en lui le poète. Mais en même
temps elle grandissait l'homme.
Les deux réponses de Térence montrent qu'il se rendit
un compte exact de cette situation et, à défaut d'une candide
franchise, dénotent beaucoup d'habileté. La première
fois qu'il relève le grief, il se contente de s'en remettre à
l'appréciation du public.
Il attend la sentence sans plaider sa cause. Cependant il
insinue clairement que l'accusation est fausse. Eût-il fait montre de cette sécurité, de cette confiance dans
la décision de ses juges, s'il avait cru sa comédie en péril
de ce chef? Est-ce ainsi qu'il repousse les reproches de
contamination et de plagiat ? Ii a compris qu'ici le danger
n'était pas immédiat. Il s'est flatté peut-être que la plupart
des spectateurs auraient assez de bon sens pour ne pas
croire aux calomnies de Luscius, mais il s' est dit surtout
que ceux qui y croiraient applaudiraient tout de même. La
seconde réponse, celle du prologue des Adelphes, ne contient
pas plus que la première une réfutation nette du
grief.
Ce que Térence avoue, ce n'est pas la collaboration, ce sont
ses relations d'amitié avec de grands personnages, aimés
de tous, serviables à chacun toujours et partout; ce qu'il
considère comme très honorable pour lui, ce n'est pas le
fait d'avoir de tels auxiliaires, ce sont les bruits que ses
ennemis font courir à ce sujet, s'imaginant lui faire une
grosse injure (1).
(1) On a remarqué, dès l'antiquité, que cet éloge si pompeux convenait, non à Scipion et à Lélius, mais à des hommes plus âgés ayant parcouru toute la carrière des honneurs ; Santra, cité par Suétone, désigne C. Sulpicius Gallus (orateur et savant), Q. Fabius Labeo et M. Popilius, poètes, tous les trois consulaires. Il est plus exact de dire que Térence a fait allusion en bloc à tous ses amis de la noblesse (Suét. : Cum multis nobilibus familiariter vixit). Il y a ici de sa part, comme l'a fort bien remarqué Ritschl, une sorte de dissimulation : au lieu de ceux qu'on lui donnait plus spécialement pour collaborateurs, il met en première ligne, en vedette, les personnages plus influents dont le crédit ne pouvait manquer de lui être utile en cette affaire.
Mais, si Térence
ne reconnaît pas la vérité de l'imputation, il ne la nie pas
non plus formellement, il n'insinue même pas qu'elle est
fausse, et l'on peut, je crois, sans être taxé de subtilité,
affirmer qu'il soutient, d'une façon très incidente et très
timide, il est vrai, la légitimité de la collaboration. Ces
hommes, dont tout le monde a éprouvé, chacun en ses besoins,
les bons offices, ne serait-il pas naturel que le poète
lui aussi eût recours à eux? Qui pourrait lui jeter la première
pierre ? Il suffit d'ailleurs de comparer cette réponse
avec celle qu'il fait dans le même prologue au grief de plagiat,
pour comprendre quelle différence de gravité il y avait
à ses yeux entre les deux accusations, et combien moins
redoutable lui paraissait celle-ci. Mais enfin, puisqu'en
réalité il n'avait pas de collaborateurs, pourquoi ne l'a-t-il
pas dit catégoriquement, pourquoi a-t-il permis, par ses réponses
évasives, à une opinion qui amoindrissait sa gloire
poétique, de subsister et de se répandre? C'est qu'il n'avait
pas le moyen de faire autrement. Nier n'eût servi de rien,
s'il n'avait pas produit de preuves à l'appui de sa négation ;
or quelles preuves produire? Un seul système de défense
était rationnel : essayer de démontrer qu'étant plus capable
d'écrire des comédies que ses nobles amis, il n'avait pas
besoin de leur concours. Mais, sans compter la difficulté de
persuader cela aux spectateurs, se défendre ainsi n'était-ce
pas désobliger gravement des hommes puissants, des bienfaiteurs
dévoués ? Térence préféra donc laisser se former
une légende qui avait pour lui du bon et du mauvais, et
garder les bonnes grâces de ses protecteurs.Térence ne chercha pas à les flatter,
il évita seulement de les blesser.
Le grief de collaboration clandestine ne réussit pas mieux que ceux de contamination et de plagiat, à faire échouer
les comédies de Térence. Mais, tandis que les deux autres
furent réduits à néant par les réponses du poète, de celui-ci
il resta quelque chose. Si beaucoup de spectateurs ne surent
trop que croire, si quelques-uns haussèrent les épaules, il
y en eut qui firent bon accueil en leur croyance aux mensonges
de Luscius ; ainsi se forma la tradition que nous
avons suivie jusqu'au temps de Quintilien et de Suétone.
Faut-il, avec ce dernier, compter, parmi les motifs possibles
du départ de Térence pour la Grèce, le désir d'échapper
aux soupçons de collaboration ? Le moyen n'eût pas été
très efficace : dès le retour de Térence les soupçons auraient
repris leur train, en même temps que ses relations avec les
prétendus collaborateurs. Il vaut mieux croire que ce voyage,
comme ceux que firent plus tard dans le mème pays
Cicéron, Virgile et tant d'autres, fut un voyage d'agrément
et surtout de perfectionnement.
La légende des collaborateurs de Térence a trouvé quelques
partisans dans les temps modernes. Mme Dacier, avec
une certaine hésitation, il est vrai, accepte la version modérée;
la version extrème est soutenue avec chaleur par
Montaigne; Boileau, qui partout ailleurs rend hommage
à Térence seul, s'y range en un passage bien connu de ses
stances à Molière. Nous nous bornons à signaler ces opinions
: elles n'apportent aucun élément nouveau dans le débat.
IV
Le reproche dont il nous reste à parler est, comme celui
de collaboration clandestine, d'une portée générale. Térence
l''a relevé une seule fois, dans le prologue du Phormion.
Ses adversaires ne le mirent donc en circulation que
vers la représentation de cette pièce : avant, ils ne s'en
étaient pas encore avisés ; après, ils l'abandonnèrent comme inefficace. Térence le mentionne en ces termes :
" ita dictitat (vetuspoeta), quas antehac fecit fabulas,
Tenui esse oratione et scriptura levi".
Qu 'est-ce à dire au juste ? Le mot latin « oratio » a deux
sens principaux, l'un général, l'autre particulier. Au particulier, sens il désigne le discours oratoire, et on peut alors
lui opposer « sermo », le discours familier, la conversation.
C'est avec cette signification qu'il est employé par Térence
dans ce vers du prologue de l'Heautontimorumenos :
" Qui orationem hanc scripsit quam dicturus sum",
celui qui a écrit le discours, le plaidoyer que je vais prononcer, dit Ambivius, qui se présente au public comme
orator, actor, avocat. Elle ne convient évidemment pas
au passage maintenant en question. Au sens général, « oratio » signifie discours quelconque, langage, paroles, par
opposition à « res, opera, actio, etc. » ; c'est ainsi qu'il
est pris constamment par Plaute, de même que par Térence,
à l'exception près que nous venons de citer. D'ordinaire,
l'idée de fond ne s'y sépare pas nettement de l'idée de
forme, cependant c'est elle qui y prédomine. Mais dans le
texte qui nous occupe la disjonction est faite : « oratio »
ne s'applique qu'au fond, à la matière du discours, car il est
,coordonné avec un autre mot qui désigne spécialement la
jforme, avec le mot « scriptura ». « Scriptura » signifie résultat de l'écriture, l'écrit, l'ouvrage, comme dans trois
vers de Térence, dont voici l'un pour exemple :
« Quod si scripturam sprevissem in prassentia, si j'avais (c'est Ambivius qui parle) dédaigné les écrits, les
comédies de Cécilius » ; ou bien enfin l'art d'écrire, au sens
figuré, c'est-à-dire le style : c'est la seule façon dont on
puisse l'entendre ici. « Oratio » et « scriptura » sont
associés dans le mème rapport que « oratio » et « stilus »
au prologue de l'Andrienne.
Donat établit ainsi la différence de
sens des deux mots : « Oratio in sensu est,stilus in verbis... Orationem in sententiis dicunt esse, stilum in verbis ».
La même distinction s'applique aux mots « oratio » et
« dicta », dans deux fragments d'Ennius. :
Dans le passage de Térence qui nous occupe, « oratio »
se rapporte donc à la matière, aux pensées des scènes, dialogues
ou monologues, au ton qui dépend de la nature des
pensées; « scriptura », à l'expression, au style. Le reproche
que Luscius fait au ton et au style est exprimé par les
deux épithètes dont chacune contient une image en harmonie
avec le sens premier de son substantif. Le ton est fluet,
sans force : oratio tenuis; le style est léger, sans relief. Ce qui revient à dire en somme que les
comédies de Térence manquent d'élévation et de vigueur.
De toutes les critiques lancées contre notre poète par son
vieux rival, celle-ci est la seule qui ait quelque fondement. D'autres l'ont renouvelée, dont on ne saurait récuser la
compétence et qui étaient loin d'avoir un parti-pris à son
égard ; seulement ils se sont servis de termes plus mesurés,
moins dédaigneux, et ils ont en même temps rendu hommage
à ses qualités. Leur appréciation a donc tout ce qu'il
faut pour inspirer pleine confiance. Cicéron, dans un fragment
en vers cité par Suétone, vante l'élégance, la grâce,
la douceur des traductions que Térence a données de Ménandre
; mais à ces éloges il met une restriction discrète en
constatant que la copie est plus calme, moins passionnée
que le modèle.
En passant du grec au latin, Ménandre, d'après Cicéron,
a donc perdu de sa force. A côté de ce jugement, Suétone
cite celui de César, en vers aussi, et plus explicitement
affirmatif sur le même reproche. César ne reconnaît en
Térence, comparé avec les grecs, qu'un élément d'infériorité,
le manque de force.
Quintilien, après avoir déclaré que les ouvrages de notre
poète sont, dans le genre comique, des modèles d'élégance,
ajoute qu'ils auraient encore plus de charme, si Térence
s'était renfermé dans l'emploi du vers trimètre. Pourquoi ?
C'est sans doute qu'à son avis Térence, admirable dans les
scènes calmes, auxquelles convient ce vers, n'a pas assez
d'élan et de vigueur dans les morceaux de passion, où la nature du sujet l'a conduit à se servir de rhythmes plus
nobles et plus mouvementés. D'après le savant Varron,
Térence exprime supérieurement les moeurs, mais quand il
s'agit de peindre les passions, il est surpassé par d'autres
comiques romains, il est au dessous de Cécilius, par exemple.
Cette infériorité tient évidemment à ce que, plein de
finesse et de délicatesse, son talent n'est pas assez vigoureux.
Parmi les contemporains d'Horace, les plus versés
dans la connaissance de la vieille littérature romaine établissaient
un parallèle analogue entre Cécilius et Térence :
Térence est un artiste plus habile, mais il a moins de force:
voilà l'opinion de ces connaisseurs. Les voix de l'antiquité
sont unanimes à le condamner sur ce chef, et la critique
moderne n'a point réformé la sentence.
Il n'est malheureusement pas en notre pouvoir de comparer
les comédies de Térence avec celles de Cécilius ;
mais nous pouvons les comparer avec celles de Plaute, et
ce rapprochement fait ressortir à merveille les faiblesses
du talent de notre poète. On sent tout ce qu'il manque
d'énergie à son style au cours limpide, égal et paisible,
quand on lui oppose le style de Plaute, torrent souvent
bourbeux, mais d'une superbe impétuosité. Ses tranquilles
dialogues où les personnages, même s'ils sont de condition
infime, s'expriment toujours en excellents termes, corrects
et choisis, paraissent bien froids, bien dépourvus de variété
et de vie, à côté des dialogues de Plaute, bruyants, pétulants,
féconds en surprises et en caprices de ton et de langue.
Son comique discret, fait de raillerie spirituelle, de
délicates épigrammes, de piquantes sentences, dont l'effet
ne va pas au-delà du sourire, est un mets de saveur un
peu fade pour qui a goûté au comique fortement relevé de
Plaute, mélange d'allitérations, de gros jeux de mots, d'expressions burlesques tirées de l'argot populaire ou bizarrement
forgées, d'énormes plaisanteries, abondant et débordant,
qui épanouit largement le rire. Ses fines études de
sentiments, où les plus fugitives nuances sont observées
avec une science pénétrante de moraliste et rendues avec
un art exquis d'écrivain, pâlissent, s'effacent pour ainsi dire,
devant le dessin puissant et l'éclatante couleur des tableaux
où le pinceau hardi de Plaute étale les passions dans leur
violence, dans leur nudité, dans leur débraillé. Certes, il y
a de graves défauts dans la manière de Plaute, des défauts
autrement voyants et choquants que ceux de Térence. Trop
fréquemment sa verve sans frein l'emporte au delà des limites
de la bienséance et de la vraisemblance, dans le domaine
de la bouffonnerie et de la caricature ; sa force n'est
pas réglée et contenue par le goût. Mais il se fait pardonner
ses extravagances, parce qu'il la possède, cette force qui
manque à Térence, parce qu'on trouve en lui la puissance
de souffle, l'ampleur de voix, la richesse de veine qui font
que ses comédies, comme celles d'un Aristophane ou d'un
Molière, méritent vraiment le nom de poèmes. Avec Térence,
au contraire, point d'écarts, point d'escapades à craindre :
sa verve est bien trop faible pour entraîner son goût, son
inspiration est bien trop paisible pour égarer sa raison.
Toujours de sang-froid, son regard calme et sûr attaché à un
idéal modeste, l'imitation scrupuleuse du langage de la
bonne société contemporaine et l'obéissance fidèle aux lois
de la vraisemblance et du naturel, les grands effets de la
poésie dramatique excèdent la mesure de son talent. C'est
à propos de ses oeuvres que l'on peut se poser la question
agitée, selon Horace, par certains anciens : La comédie
est-elle, oui ou non, un genre poétique? On peut presque
leur appliquer ce que le même Horace dira plus tard de
ses satires : ce n'est pas de la poésie, c'est de la prose
rhythmée.
En somme il faut regretter que Térence n'ait pas pu à son élégance, à sa grâce, allier des qualités plus élevées et plus
robustes.
Toute la faute en est bien au poète lui-même, et l'on ne
saurait, pour lui procurer des circonstances atténuantes, mettre
en cause le genre comique ou ses modèles grecs. L'élévation
du ton, la vigueur du style ne sont pas des mérites
essentiellement propres à la tragédie et défendus à la comédie,
ainsi que paraît l'avoir cru le naïf Evanthius, qui
admire précisément dans Térence ce que nous lui reprochons.
La tragédie et la comédie sont genres distincts, sans
doute ; cependant il arrive parfois à des personnages comiques
d'être sous l'empire d'une passion violente, dans
une situation émouvante, tragique. Alors, si le poète a du
souffle, il doit quitter le langage simple, le ton familier, pour
parler avec noblesse, chaleur, éclat, sans se laisser arrêter
par la crainte ridicule de franchir les frontières de la tragédie.
Les comiques grecs, et en particulier Ménandre, le
modèle préféré de Térence, avaient usé de ce droit incontestable.
Sans avoir besoin d'en chercher la preuve dans les
fragments, nous la trouvons, en ce qui concerne Ménandre,
dans les jugements déjà cités de Cicéron et de César sur
Térence. D'après Cicéron, c'est un Ménandre adouci, apaisé,
que Térence présenta au public romain.
D'après César, Térence n'est que la moitié de Ménandre,
« dimidiate Menander » ; il en reproduit la pureté et la
douceur, mais non la force. Donat se fait l'écho de la même
appréciation. Ménandre avait donc les qualités qui manquent à
Térence. Celui-ci, malgré l'exactitude de son imitation, ne
les a pas fait passer en latin ; il a rendu le sens, mais non
la passion et la poésie des grandes scènes grecques, semblable
à ces chanteurs qui donnent avec une parfaite justesse
toutes les notes d'un morceau, sans en traduire pourtant
l'expression.
Cette impuissance de son talent à faire passer en latin
toute la force des originaux grecs, le poète en avait le sentiment,
cela n'est pas douteux. Ce qui le prouve, c'est en
premier lieu la préférence qu'il accorda à VAndrienne de
Ménandre sur la Périnthienne. Au lieu de compléter celle-là
par celle-ci, n'était-il pas plus simple pour lui de s'attacher
uniquement à la pièce qui, lui offrant l'ensemble de
personnages qu'il souhaitait, l'aurait dispensé de recourir à
un orignal secondaire, de contaminer ? Mais le ton et le
style de l'Andrienne lui plaisaient davantage. Par quoi
différaient-ils donc du ton et du style de la Périnthienne ? Si
l'on admet, ce qui est très vraisemblable, que cette dernière
comédie était une oeuvre de jeunesse, plus tard refondue et
remise à la scène sous un nouveau titre, il n'est pas difficile
d'imaginer la différence : la Périnthienne fut écrite avec
une fougue juvénile qui s'était calmée quand Ménandre fit
l'Andrieniie ; elle avait plus de chaleur dans la passion,
plus d'élan dans le style, chaleur et élan que le poète, quand
il remania l'oeuvre, trouva sans doute un peu excessifs et
crut devoir atténuer. Térence, écrivain de sens rassis et de
jugement sûr, sentit que l'Andrienne allait mieux à ses
moyens naturels. Le choix d'originaux tels que l'Hécyre et
l'Heautontimorumenos, indique clairement chez notre poète
la mème défiance de ses forces, le même goût pour les sentiments
modérés et le ton posé. Il serait, en effet, malaisé
de concevoir des pièces moins fécondes en éclats de passion,
en véhémence de langage. Ce caractère de tranquillité est si
frappant que Térence a jugé bon, dans le prologue de l'Heautontimorumenos,de le signaler par avance au public
et de l'excuser adroitement : « Souvent, fait-il dire en
substance au vieil Ambivius, il me faut jouer des comédies
mouvementées, fatigantes, Clamore summo, cum labore maximo ;
en voici une qui est du genre calme, où les personnages se
bornent à discourir (1).
(1) On entend d'ordinaire : « Dans cette pièce le style est pur » ; ce qui est un contre-sens. Le contexte indique évidemment qu'il faut traduire : « Dans cette pièce il n'y a que discours. » Oratio est ici opposé à actio. Les comédies que joue d'ordinaire Ambivius exigent beaucoup de mouvement et de grands efforts de voix (v. 40). Celle-ci, non. Elle est du genre calme. Que les spectateurs veuillent bien se donner la peine d'apprécier dans ce genre calme le talent d'Ambivius.
Écoutez-la en silence. C'est une occasion
pour moi de ménager mes forces, et pour vous d'apprécier
mon mérite d'acteur sous un autre jour. »
S'il est vrai que notre poète avait pleine conscience des
lacunes de son talent, il ne dut pas pouvoir s'empêcher de
reconnaître en lui-même que, malgré l'exagération malveillante des termes, le reproche de Luscius avait au fond du
vrai. Effectivement, le Phormion et les Adelphes, écrits
après la divulgation de ce reproche, dénotent l'influence
d'un aveu intime de culpabilité et la préoccupation d'échapper
désormais à une critique plus sensible que les autres
en vertu de sa justesse. Le Phormion est, sans contredit,
des six comédies de Térence la plus mouvementée et la
plus passionnée. Donat l'a fort bien remarqué : « Haec
igitur proprie totainotoria est; l'Andrienne, l'Eunuque
et les Adelphes sont, d'après lui, seulement « magna » ou
« majori ex parte motorise »
En particulier,
c'est la seule pièce où Térence ait mis, et au premier plan,
un de ces rôles de parasite qu'Ambivius, au prologue de l'Heautontimorumenos, classe parmi ceux qui lui donnent
tant de mal à jouer; car le Gnathon de l'Eunuque, quoique
parasite, n'appartient pas à la famille de Phormion : il ménage
ses poumons, il cause, tandis que celui-ci, à pleine
voix, avec de grands gestes, crie, menace, tempête. Quant
aux Adelphes, quoique la pièce prise dans son ensemble
soit moins mouvementée, on y trouve trois des rôles pénibles
à jouer, cités par Ambivius dans la même énumération :
un « servus currens », Géta, dont le monologue dépasse
de beaucoup par le ton tout ce que Térence a écrit dans ce
genre ; un « iratus senex », Déméa, le personnage le plus
violent du théâtre de Térence, autrement passionné que le
Simon de l'Andrienne et le Chrémès de l'Heautontimorumenos
; enfin un « avarus leno », Sannion, un de ces
ignobles trafiquants familiers à Plaute, évités jusqu'alors
par Térence. Ce leno est d'autant plus significatif dans les
Adelphes, que le poète aurait pu se passer, sinon du personnage,
au moins d'une bonne partie de son rôle, la plus
véhémente, qu'elle ne se trouvait pas dans les Adelphes de
Ménandre, que le traducteur est allé la chercher dans un
original secondaire. Les deux dernières oeuvres de Térence
laissent donc apercevoir un effort vers cette élévation de ton
et cette vigueur de langage que Luscius affirmait, non sans
raison, manquer à ses oeuvres antérieures.
En face d'une critique fondée, qu'en son for intérieur
Térence reconnaissait comme telle, quelle fut son attitude ?
Il ne pouvait pas négliger d'y répondre : ne point relever
le grief, c'eût été passer tacitement condamnation, s'amoindrir
aux yeux de beaucoup de gens et enflammer Luscius
d'une nouvelle ardeur pour la lutte, lutte facile désormais,
si l'adversaire montrait qu'il n'osait plus tenir tète. Il n'y a
pas de bonne défense contre une accusation fondée : il peut
y en avoir de spécieuses. Avec plus de hardiesse et devant
un public plus lettré, Térence aurait pu se tirer d'affaire
en avouant, et en soutenant que le prétendu défaut, grossi d'ailleurs par la malveillance des expressions, était une
qualité dans la comédie, « miroir de la vie quotidienne, »
selon le mot du vieil Andronicus. Mais une démonstration
de ce genre exigeait d'assez longs développements, des
considérations littéraires sur la distinction de la comédie et
de la tragédie: elle n'avait guère chance de toucher un
public aussi peu lettré que la foule romaine. Térence ne
l'essaya pas, du moins d'une façon directe et explicite :
car, implicitement et indirectement, c'est bien à une apologie
de cette sorte qu'il s'arrêta. « Le vieux poète, répondit-il
par la bouche de Prologus, lance cette accusation au
nouveau,
Quia nusquam insanum scripsit adulescentulum
Cervam videre fugere et sectari canes
Et eam plorare, orare ut subveniat sibi»;
allusion à quelque scène d'une pièce de Luscius, dont
le ton, d'après Térence, n'était pas du tout celui de la
comédie. Le rival qui l'accusait de ramper, il l'accuse de
se perdre dans les nuages ; il critique l'extravagance des
oeuvres de celui qui critiquait la banalité des siennes. Il
donne à entendre, sans le dire nettement, que son ton à
lui est le vrai ton de la comédie. Il n'est fluet que par rapport
à celui de Luscius, ridiculement éclatant. Nous verrons
bientôt ce que vaut cette critique en elle-même. Elle
est évidemment insuffisante comme moyen de justification.
Si Luscius est tombé dans un extrême, Térence n'en a pas
moins eu tort de tomber dans l'autre. Le public s'en contenta,
puisqu'il applaudit le Phormion, et, le grief n'ayant
pas été reproduit, Térence fut dispensé de chercher mieux.

V
Dans la guerre que lui avait déclarée Luscius, Térence,
avons-nous dit, ne resta pas constamment sur la défensive. Les prologues de l'Eunuque, de l'Heautontimorumenos
et du Phormion contiennent une partie agressive. C'est
naturellement par des accusations d'ordre littéraire que Térence
voulut se venger des accusations d'ordre littéraire
dont le poursuivait Luscius. Il y a pourtant de notables différences
entre les coups portés par chacun des deux adversaires.
Luscius attaque dans les entretiens de la vie journalière,
devant un nombre plus ou moins restreint de personnes
; Térence, du haut de la scène, devant le public ; ce
qui rend ses représailles beaucoup plus sensibles à l'adversaire.
Mais, si les blessures qu'il fait sont plus douloureuses
sur le moment, elles sont en somme moins dangereuses
: il ne critique, en effet, que des oeuvres déjà jouées,
dont le sort par conséquent est déjà décidé. Il ne se flatte
pas de faire infliger à son rival un échec immédiat ; il ne
veut que le déconsidérer et surtout se donner à lui-même
aux yeux des spectateurs une attitude résolue. Tout autre
est le plus souvent l'objectif du vieux poète. On s'explique
du reste aisément pourquoi Térence n'a pas adopté la tactique
familière à son rival : il avait affaire, lui, non pas à un
débutant, mais à un vétéran dont la réputation était depuis
longtemps établie. C'est de cette partie agressive des prologues
qu'il nous reste à parler pour achever l'étude de la
polémique, partie intéressante à un double titre : parce
qu'elle nous fournit quelques renseignements sur la manière
de Luscius, et surtont parce qu'elle complète et accentue les
indications piquantes que la partie défensive nous a données
sur le caractère de Térence.
La série des attaques s'ouvre par une accusation à
portée générale, par une critique qui atteint tout le théâtre
de Luscius ; c'est la seule de cette espèce. Luscius a bien traduit ses originaux,
mais qu'il a mal écrit ses pièces, en sorte que de
bonnes comédies grecques il a fait des comédies latines qui
ne sont pas bonnes. Le sens de « benevertendo» ne saurait
être douteux pour qui se rappelle qu'au prologue de
l'Andrienne Térence a caractérisé par le mot « diligentia »
la manière de son adversaire. Il s'agit d'une méthode de
traduction exacte, scrupuleuse. Il est clair aussi que Térence
ne prétend pas faire à Luscius un mérite de cette
exactitude : il la qualifie d'obscure, sans éclat, « obscura ».
C'est la marque d'un talent pauvre, sans originalité, incapable
de risquer un pas en dehors de la piste tracée par
l'auteur grec. Jusqu'à quel point Luscius méritait-il ce dédain
? Était-ce bien Térence qui avait le droit de l'en
accabler ?
Les vieux comiques romains, à l'exception sans doute de
Livius Andronicus, qui semble avoir montré dans ses traductions
plus de gaucherie que d'indépendance, reproduisirent
les originaux grecs avec une grande liberté. Ils avaient
peu souci de la régularité du plan, de la logique des caractères,
de la vérité des moeurs, en un mot de tout ce qui
aurait pu donner à leurs comédies une haute valeur artistique.
Leur seule ambition était d'amuser un public composé
presque exclusivement d'esprits incultes. Aussi ne se
firent-ils aucun scrupule d'abréger et même de supprimer
certaines scènes, d'en amplifier d'autres outre mesure, de
mêler les choses romaines aux choses grecques, insensibles
aux altérations, aux mutilations infligées à l'oeuvre grecque,
pourvu que l'action de l'oeuvre latine fût vive, variée, et le
dialogue animé, riche en comique. Les comédies de Plaute nous donnent une idée suffisante d'un tel système de traduction,
qui fut sans doute encore plus accentué chez Névius.
D'abord, personne ou à peu près personne n'y trouva
à redire ; mais avec le temps s'accrut le nombre des esprits
lettrés qui sentaient le prix de la beauté artistique jusqu'alors
méconnue et la grossièreté des productions dramatiques
romaines. Cette sorte de réaction contre les vieux
comiques eut ses intransigeants, dont Luscius était le chef
au temps de Térence. Admirateur superstitieux des modèles
grecs, non seulement il n'admettait ni les coupures ni les
additions originales, mais il repoussait aussi la contamination,
c'est-à-dire le mélange des oeuvres grecques. Il s'attachait
à un seul modèle, il le reproduisait d'aussi près que
possible, sans aller pourtant jusqu'à la traduction littérale,
telle, que nous l'entendons, inconnue des anciens, mais sans
se permettre au fond le moindre changement, pas même
dans le but d'adoucir un détail de moeurs choquant pour
des spectateurs romains ou de corriger une faute légère
commise par l'auteur grec, qui, après tout, n'était pas impeccable.
Sa manière marquait évidemment un progrès sur
celle de Névius et de Plaute : au genre bâtard, demi-grec
et demi-romain, de la vieille palliata, elle substituait un
genre nouveau, inférieur, si l'on veut, en ce qu'il n'avait
rien d'original et de national, mais supérieur au point de
vue artistique, par cela même qu'il était franchement et
complètement étranger. C'est en quoi Térence n'a pas rendu
justice à son rival. Que le culte de Luscius pour le modèle
grec ait été parfois exccessif, aveugle, cela est vrai : il a eu
tort, par exemple, de proscrire absolument la contamination
; erreur où il fut induit par sa jalousie encore plus que
par ses principes. Mais un juge impartial n'eût pas condamné
sa méthode d'un mot dédaigneux. Térence y était
peut-être autorisé moins que tout autre. Car si la méthode
de Luscius n'est pas la sienne, elle n'en diffère pas considérablement
; elle en est beaucoup plus voisine que l'indépendance
des anciens poètes, en disciple desquels il s'est posé pour les besoins de sa cause. La part d'invention est
minime dans ses comédies ; presque toujours il suit pied à
pied son modèle grec, et quand il le quitte pour faire un
écart de quelque importance, c'est qu'il s'attache à un autre
modèle grec, qu'il abandonne un moment la main de l'original
principal pour prendre celle de l'original secondaire.
Au reste, le reproche que Térence fait à Luscius est exprimé
bien moins par les mots « bene vertendo » que par
les suivants : « easdem scribendo male ». On ne peut ici
donner au verbe « scribere » que la signification correspondante
à celle du substantif « scriptura » dans le passage
du prologue du Phormion que nous avons étudié tout
à l'heure. Puisque, d'après Térence lui-même, les pièces
grecques qui ont servi de modèles à Luscius étaient bonnes,
et qu'il les a traduites exactement, la mauvaise qualité des
pièces latines ne peut tenir qu'à la forme, au style. En
d'autres termes, Térence accuse Luscius d'être un mauvais
écrivain. L'accusation est grave. Que faut-il en penser ?
D'abord on ne saurait nier la compétence de l'accusateur :
en matière de style, Térence était un maître, un fin connaisseur.
Il n'a pu s'y tromper; si, sincèrement, il jugeait les
comédies de son rival mal écrites, c'est qu'elles l'étaient en
effet. Mais n'a-t-il pas menti par esprit de vengeance ? Non ;
car une pareille critique n'était pas de nature à faire grande
impression sur le public romain ; Térence n'eût pas songé
à l'inventer : comme elle était fondée, il ne négligea pas de
la formuler, voulant à tout prix exercer des représailles et n'y trouvant pas matière aussi ample qu'il l'aurait désirée.
Il sentait si bien l'inefficacité relative de l'accusation, pourtant
si grave en soi, qu'il n'a pas insisté. Au lieu de prouver,
il s'est contenté d'affirmer, parce que pour prouver il
eût fallu citer des exemples que les spectateurs n'auraient
sans doute pas trouvés concluants, énumérer des défauts
dont l'importance dont le sens même leur auraient échappé.
Si le procès se fût plaidé devant un tribunal composé de
lettrés, tels que Scipion et Lélius, soyons assurés que Térence
aurait produit une solide et triomphante démonstration.
Malheureusementpour lui, le grief le plus sérieux qu'il
eût à faire valoir contre son adversaire, le seul vraiment
sérieux, pour parler plus exactement, perdait à peu près
toute sa force devant les juges qui écoutèrent le réquisitoire.
Mais la postérité le retient et il pèse de tout son poids réel
dans notre jugement sur le talent de Luscius. Si le caractère
du vieux poète malveillant nous a paru peu digne
d'estime, jusqu'ici son talent s'était montré à nous sous un
jour assez favorable : en choisissant pour les traduire des
pièces telles que l'Apparition et le Trésor de Ménandre, il
avait fait preuve de goût et d'intelligence ; sa méthode de
reproduction, quoiqu'un peu étroite, était en somme d'un
amateur éclairé de la beauté littéraire : ajoutons tout de
suite que les autres critiques de Térence, dont il nous reste
à parler, n'auraient pas sensiblement modifié cette bonne
impression. Mais voici qui l'amoindrit comme poète d'une
manière sérieuse : il était mauvais écrivain. Il appartenait
à la catégorie des Cécilius et des Pacuvius : ainsi que ses
deux contemporains, si durement traités par Cicéron, il
ignora l'art du beau style latin. Mal écrites et sans originalité,
ses oeuvres ne dépassaient pas le niveau du médiocre.
Il n'était ni Plaute ni Térence, n'ayant ni la riche verve de
l'un ni l'art consommé de l'autre. Après avoir attaqué en bloc tout le théâtre de Luscius au
point de vue de la forme, Térence a-t-il voulu signaler
comme exemple du défaut en question le Phasma, pièce récemment
jouée, présente encore à la mémoire des spectateurs
? C'est l'opinion exprimée dans une des scholies de
Donat.
Mais Bothe et Bentley ont senti qu'il était bien difficile
d'adopter l'opinion de Donat, si l'on gardait la leçon des
manuscrits. Il faut donc repousser les corrections et chercher
si la leçon des manuscrits n'offre pas, telle quelle, un sens
raisonnable. En y regardant de près, on en trouve un qui
est déjà signalé dans une autre scholie de Donat. Térence n'a pas de reproche spécial à faire
au Phasma ; il va sans dire qu'il tombe, ainsi que le
Thesaurus et toutes les autres pièces de Luscius, sous le
coup de la critique précédente. Mais le Phasma est la dernière
comédie de Luscius ; le Thesaurus, où Térence a
trouvé matière à une nouvelle accusation, est plus ancien ;
beaucoup de spectateurs ne savent plus de quel poète il
est; tous au contraire se souviennent, la représentation
ayant eu lieu tout récemment, que l'auteur du Phasma est
Luscius. Ainsi Térence, sans le nommer, désigne clairement
au public son adversaire, ce qui était indispensable
pour que l'attaque eût tout son effet. Le vers qui nous
occupe ne doit donc pas être rattaché à la partie antérieure
du contexte : il sert de préparation à la suite; il ne contient
pas une critique : il n'est qu'une indication (1).
(1) Luscius n'est jamais nommé dans les prologues ; nous verrons pourquoi et nous dirons aussi comment Térence a pu se passer de le nommer.
La seconde critique, la voici maintenant :
" Atque in Thesauro scripsit causam dicere
Prius unde petitur, aurum qua re sit suom,
Quam ille qui petit, unde is sit Thesaurus sibi,
Aut unde in patrium monumentum pervenerit."
Nous savons que plusieurs comédies grecques portaient ce
titre de Trésor (1);
(1) Le Trésor de Philémon servit d'original à Plaute pour son Trinummus.
il s'agit ici, selon toute apparence, du Trésor de Ménandre; puisque Térence, qui vient de nommer
l'auteur du Phasma, Ménandre, ne nomme pas celui du
Thesaurus, c'est que la pièce est du même auteur. Pour
comprendre d'abord et pour apprécier ensuite la critique
faite à Luscius, il faut connaître le sujet de cette comédie.
Nous en trouvons une analyse dans le commentaire de
Donat. Un jeune homme a dévoré en dix ans la fortune que
lui avait laissée son père. Le vieillard, de son vivant,
s'était fait construire un magnifique monument funèbre et
avait ordonné, par testament sans doute, qu'on vînt lui apporter
là un festin dix ans après sa mort. Le jeune homme,
qui n'a pas oublié cette prescription, envoie son esclave au
tombeau avec le festin. Mais le champ où se trouve le monument
ne lui appartient plus, il l'a vendu à un vieil avare.
C'est donc en compagnie du nouveau propriétaire que l'esclave
ouvre le tombeau. Ils y trouvent un trésor et une
lettre. L'avare retient et revendique le trésor qu'il a, dit-il,
caché là au moment d'une guerre. Le jeune homme s'adresse
à la justice pour être remis en possession de son bien. Devant
les juges, son vieil adversaire prend le premier la
parole, et Donat nous a même conservé le début de ce
discours dans la pièce de Luscius :
Athenienses, bellum cum Rhodiensibus
Quod fuerit, quid ego hic prasdicem ?...
Il soutient donc hardiment son mensonge. Mais le jeune
homme, prenant à son tour la parole, le confond en montrant
la lettre trouvée avec le trésor, lettre où le père disait
évidemment que, sachant la prodigalité de son fils et voulant
lui ménager une ressource suprême, il faisait ce dépôt,
et, pour en amener la découverte après dix ans, inscrivait
dans son testament la clause du festin funèbre. Ainsi, à la fin de la comédie de Luscius, il y avait un
procès dans lequel le défendeur parlait avant le demandeur,
l'accusé avant l'accusateur. C'est ce renversement de l'ordre
normal et logique des débats judiciaires que Térence
reproche à son rival. « Arguit Terentius, dit Donat, quod
Luscius, contra consuetudinem litigantium, defensionem
ante accusationem induxerit. » On le voit, cette
critique est bien distincte de la première : il s'agit, non plus
d'une faute de style, mais d'une faute de composition.
Luscius est-il coupable? Sans doute, il a enfreint les règles
de la procédure, l'usage des tribunaux ; il y a quelque chose
de conventionnel dans son procès. Mais il a eu grandement
raison d'admettre cette convention : s'il avait suivi l'ordre
inverse, l'ordre réel, c'est alors qu'il faudrait lui reprocher
une faute, et une grosse faute de composition. Que le demandeur
exhibe son titre de propriété, la lettre de son père,
un argument aussi décisif tranche la question ; la plaidoirie
du défendeur ne saurait plus produire aucun effet sur le
juge ; l'intérêt est épuisé, l'intrigue est dénouée. Si, au
contraire, la production de la lettre est réservée, les raisons
de l'avare peuvent paraître spécieuses au tribunal ; il y a
jusqu'à la fin incertitude sur la possession du trésor; la pièce
est attachante jusqu'au dernier vers; elle est habilement
conduite. Cette disposition, cela va sans dire, était l'oeuvre
du poète grec ; Lucius n'eut pas le mérite de la trouver,
mais il eut le bon goût de la conserver. Nous avons trop
bonne opinion de celui de Térence pour croire qu'il l'aurait
changée, s'il avait traduit la pièce. Alors, pourquoi en avoir
fait un crime à Luscius ? C'est une mauvaise querelle, un
acte de déloyauté. Térence sentait que son accusation était
injuste ; mais il pensait que les spectateurs romains, gens à l'esprit formaliste en matière judiciaire autant qu'ils l'étaient
en matière religieuse, la trouveraient fondée, prendraient
une mauvaise idée de son rival ; et cela lui suffisait.
Si ce n'est pas une aussi mauvaise querelle, c'est une
querelle bien futile que Térence fait à Luscius dans le prologue
de l'Heautontimorumenos. Après avoir sollicité en
ces termes l'équité du public :
"Soyez équitables : procurez le moyen de grandir à ceux qui
vous procurent le spectacle de pièces nouvelles sans défauts; "
il ajoute :
" Ne ille pro se dictum existumet,
Qui nuper fecit servo currenti in via
Decesse populum : cur insano serviat ?"
Ce passage a beaucoup exercé la sagacité des interprètes,
et je ne sache pas qu'on en ait trouvé jusqu'à présent une
explication satisfaisante de tout point. Celui de tous qui s'est
égaré le plus loin du vrai sens, c'est l'aventureux Bentley.
Il propose de lire « dixisse, » au lieu de « decesse, »
Ainsi, d'après Bentley, la faute commise
par Luscius consistait à faire parler le peuple avec un esclave.
L'hypothèse est absolument invraisemblable.Ce « populus, »
interlocuteur de l'esclave, quel était-il, où était-il ? Sur la
scène, comme le dit Bentley au commencement de son explication
? Il n'y a jamais de « populus » sur la scène dans
la palliata, autant que nous pouvons en juger soit par les
pièces conservées, soit par les monuments figurés ; on y voit tout au plus, dans quelques cas, à côté des acteurs, un, deux
ou trois comparses. Admettons que ces comparses aient pu
représenter le peuple. S'ils étaient sur la scène, s'ils entraient
dans la fiction du drame, pourquoi ne se seraient-ils
pas entretenus avec l'esclave ? S'agit-il du « populus » de
la « cavea, » du public, comme Bentley semble l'entendre
ensuite, ou du moins de quelques spectateurs chargés par
Luscius de donner la réplique à l'esclave ? L'idée est tellement
étrange qu'il ne vaut pas la peine de s'y arrêter.
D'ailleurs, « dixisse cur » serait une façon de parler peu
latine : il faudrait : « quaesivisse cur. » Enfin, quel sens
offriraient les mots : « cur insano serviat, » qui représenteraient
la question posée par le peuple à l'esclave qui
court ? Si le sujet de « serviat » est « servus, » cela veut
dire : « Pourquoi es-tu l'esclave d'un insensé ? » Belle
demande ! parce que l'insensé l'a acheté et payé, à moins
qu'il ne l'ait reçu en héritage. Si le sujet est « populus, »
nous devons entendre : « Pourquoi le peuple obéirait-il à
un insensé ? » Mais à quel propos cette question ironique
ou indignée ? Peut-être parce que l'esclave dans sa hâte a
demandé qu'on lui fit place et bousculé le peuple ? Que de
complications et que d'obscurité ! Ce qui achève la conjecture
de Bentley, c'est que la leçon des manuscrits peut
s'expliquer et d'une façon autrement simple, autrement
claire.
Déjà le vieux commentateur Calphurnius avait vu en
quoi consistait réellement la faute reprochée à Luscius.
C'était une infraction au décorum. Westerhov a compris aussi que Térence
accusait Luscius d'avoir fait écarter la foule des citoyens
devant un esclave courant et demandant place. Pourquoi le peuple (en s'écartant
pour faire place à un esclave) obéirait-il, ferait-il acte
de soumission à cet esclave insensé (insensé à cause de
sa folle course ou de sa prétention exorbitante de faire écarter devant soi les rangs du peuple)? Cette phrase est donc
mise au compte de Térence ou, ce qui revient au même,
du personnage du prologue. Or il n'est pas possible que
Térence se soit mis ainsi à raisonner sur la faute commise
par son adversaire : insister de la sorte pour en faire sentir
au public toute l'énormité, c'eût été maladroit et naïf.
« Serviat », comme l'a fort bien compris Mme Dacier, ne
peut avoir pour sujet que le poète, Térence.
Ce sujet est sous-entendu ici, comme en beaucoup d'autres
endroits des prologues, parce qu'il est très facile à suppléer,
pour ne pas dire évident. Le sens de la phrase et la suite
des idées dans tout le passage deviennent dès lors clairs et
naturels. Térence demande qu'on écoute avec impartialité,
qu'on encourage ceux qui produisent des pièces nouvelles, des pièces sans défauts ; car il aurait tort de se figurer
qu'on parle pour lui, celui qui naguère a commis une si
grosse sottise : pourquoi Térence servirait-il les intérêts de
cet insensé ? Non seulement les interprètes que nous citions,
il y a un instant, ont fait un contre-sens sur ce dernier
vers ; mais encore ils ont laissé subsister dans le passage
une difficulté considérable. Puisque le « populus » ne figurait
pas sur la scène dans la palliata, comment la situation
que Térence critique était-elle possible ? C'est ce que nous
allons expliquer, après avoir donné quelques éclaircissements
sur le grief de Térence.
Un esclave qui court n'est pas chose rare dans la palliata.
Tels sont Mercure, déguisé en Sosie, dans l'Amphitryon
de Plaute, Léonidas dans son Asinairp, Acanthion
dans son Alarchand, Tranion dans sa Mostellaire, Stasime
dans son Trinummus ; tels sont dans Térence le Davus
de l'Andrienne, le Géta du Phormion et le Géta des Adelphes. La course, c'est l'allure ordinaire des esclaves, tandis
que les hommes libres vont à travers la ville d'un pas
tranquille. A deux reprises dans
les prologues, Térence, parlant du rôle de l'esclave, le
précise par ce mot. Dans sa course précipitée, il arrive
fréquemment à l'esclave de rencontrer des obstacles : passants
de condition libre qui avancent sans se presser, foule
stationnaire. Alors il demande place, il joue des coudes
pour s'ouvrir un chemin. Le Mercure de l'Amphitryon
nous fait connaître ces habitudes en les imitant. Mais les bourgeois ne se laissent guère émouvoir par ces
cris et par ces gestes; l'esclave a beaucoup de mal à se
frayer son chemin. Acanthion, du Mercator, s'en plaint
vivement.
Il paraît que l'esclave de Luscius avait eu affaire à une
foule moins récalcitrante,qui s'était complaisamment écartée
pour le laisser passer. C'est la complaisance de cette foule
que Térence reproche à Luscius. Mais, si le Mercure et
l 'Acanthion de Plaute, si un autre personnage du même
poète, le parasite Charançon, crient, s'indignent, menacent
en arrivant sur la scène, ce n'est pas que leur course y rencontre
des obstacles ; seulement, ils viennent d'en rencontrer
sur les places, dans les rues, partout sur le chemin qui
les a amenés. Ils se sont échauffés dans la lutte, et leur agitation
n'est pas encore calmée, quoique la lutte soit finie.
Sur la scène la foule n' obéit ni ne résiste à leurs injonctions,
par cette bonne raison qu'il n'y a pas de foule sur la scène.
Ce n était pas non plus sur la scène que l'esclave de Luscius
traversait les rangs des citoyens, obligeamment ouverts
devant lui; c était hors de la scène. Le fait incriminé par
Térence ne s'était pas accompli sous les yeux des spectateurs
; ils l'avaient appris par un récit, de l'esclave sans
doute. La situation est facile à reconstituer par conjecture, l'esclave avait une communication importante à faire à son
maître, comme le Davus de l'Andrienne. Ne le trouvant pas
à la maison, il a couru le chercher dans la ville, sur la
place publique. Là, d'un endroit élevé où il était monté, il l'a distingué au milieu de la foule. Alors il s'est précipité
vers lui en demandant place, et, les citoyens ayant obéi sans
se faire prier, il est arrivé jusqu'à son maître. Voilà comment
les choses ont pu se passer dans la pièce de Luscius.
On le voit, il suffit d'admettre qu'il y avait ici récit, et non
tableau, pour que tout s'éclaircisse. D'ailleurs, si Térence
a mis le parfait decesse et non le présent « decedere »,
n'est-ce pas la preuve que l'action, le passage de l'esclave
à travers les rangs des citoyens, était déjà accomplie quand,
dans la pièce, elle venait à la connaissance du public ? En
deux autres endroits des prologues, où Térence relève
également des bévues de son adversaire, il emploie l'infinitif
présent dans des phrases de construction tout à fait semblable.
C'est que dans ces deux cas, l'action se passait sous les yeux
du public, il en avait connaissance au moment où elle se
produisait. Elle était présente, et, dans l'autre cas, passée.
La faute commise par Luscius était-elle si énorme, qu'il
méritât pour cela d'être traité d'insensé ? Traducteur fidèle,
il n'avait sans doute fait ici, comme dans le procès du
Trésor, que copier son original. A sa place, Térence aurait
peut-être songé à corriger ce détail, dans la crainte de choquer
les idées reçues du public romain. Luscius n'y songea
pas. Mais sa faute, si faute il y a, avait de bonnes excuses.
A Rome, la foule des citoyens ne s'écartait pas devant un
esclave : elle réservait de telles marques de déférence pour
les magistrats précédés de leurs appariteurs ; cela est vrai :
mais la pièce ne se passe pas à Rome ; elle se passe en
Grèce, ou plutôt dans un monde étrange où la convention
tient une large place. Est-ce qu'à Rome les esclaves sont
plus intelligents et plus sages que leurs maîtres, les mènent
à leur guise, passent leur temps à protéger les plaisirs des
jeunes et à vider la bourse des vieux? Non, et voilà pourant
ce que le public romain supporte constamment sur la scène. Qu'est-ce donc que le manquement de Luscius aux
bienséances, quand on le compare à ce manquement perpétuel,
énorme? Au fond, Térence ne jugeait certainement
pas que le cas fût pendable ; mais du moment qu'il croyait
pouvoir faire quelque tort à son adversaire, il n'hésita pas
à lancer le reproche. Il avait sans doute des raisons de le
croire. Il connaissait les opinions absolues, les préjugés des
citoyens romains en matière de décorum. A la représentation,
le passage incriminé avait probablement soulevé des
protestations : car le vulgaire, insensible à des énormités
comme celle dont nous parlions tout à l'heure, est souvent
choqué par un détail insignifiant. Térence en avait pris
bonne note, et à la première occasion il réveilla le souvenir
récent de ce mécontentement. Si les choses se sont ainsi
passées, s'il n'a eu qu'à raviver une mauvaise impression
déjà manifestée, il s'est trouvé ici contre son adversaire
dans une position plus avantageuse qu'à propos de l'affaire
du Trésor : car il est infiniment probable que le vice de
procédure signalé par Térence ne fut point aperçu des spectateurs
à la représentation, l'intérêt de l'action, à ce moment
de la pièce, ayant endormi leur formalisme. Mais parce qu'il
s'agissait de toute une scène importante, Térence put faire
fond sur la mémoire de ses spectateurs et provoquer après
coup leur désapprobation ; résultat qu'il aurait difficilement
obtenu, s'il se fût agi d'un simple détail, comme ici, d'un
détail passé d'abord inaperçu, tout à fait oublié depuis.
Nouvelle et dernière attaque contre Luscius dans le prologue
du Phormion. Si notre poète, fait dire Térence à
son Prologus, est accusé par son rival de ne composer que
des pièces de ton fluet et de style faible, c'est parce que dans une pièce de Luscius récemment jouée, il y avait donc
une scène d'hallucination : un jeune homme, réduit au désespoir
par des chagrins d'amour, croyait voir, dans un
accès de délire, sa bien-aimée sous la figure d'une biche
poursuivie par des chiens ; il croyait entendre ses gémissements,
ses appels au secours. Ce que Térence reproche à
cette scène, le contexte l'indique clairement : d'après lui,
des tableaux de ce genre ne sont pas à leur place dans la
comédie, ils appartiennent à la tragédie ; Luscius a confondu
les genres, il a donné une preuve de mauvais goût,
il a fait une extravagance.
Pour sa justification, Luscius aurait pu produire de sérieuses
autorités ; d'abord, celle du poète grec dont il avait
traduit l'oeuvre en question : car il est bien improbable que
Luscius ait dérogé ici à ses habitudes de traduction exacte
et ajouté cette scène à l'original ; le poète grec était donc
atteint avec lui par le reproche de mauvais goût et d'extravagance,
c'est-à-dire que Luscius se trouvait dans la même
situation qu'à propos des deux critiques dont nous venons
de parler. Si on lui objectait qu'il aurait dû corriger l'erreur
du modèle grec, il était en mesure de se défendre par
l'exemple des anciens, l'argument dont Térence fait si volontiers
usage. En effet, il y a dans le Marchand de
Plaute une scène d'hallucination non moins passionnée que
celle-ci. Charinus, privé de sa maîtresse, se dispose à partir
pour l'exil. Le voilà équipé : chlamyde, ceinture, épée,
fiole d'huile. Il monte sur un char imaginaire, il prend les
rênes, il arrive à Chypre, il en repart, il est maintenant à
Chalcis. Là, on lui assure que sa maîtresse est à Athènes, et le voici de retour dans cette ville, dans sa patrie, saluant
son ami Eutychès, s'informant de ses parents, comme après
une longue absence. Enfin, Luscius avait pour sa défense
la meilleure des raisons : le succès de sa pièce ; car Térence
est bien forcé d'avouer qu'elle a réussi et, pour la scène en
question, il n'insinue pas qu'elle ait déplu au public : donc
le public avait accepté sans murmure le tableau de l'hallucination.
Il est vrai que Térence attribue le succès au jeu
des acteurs plutôt qu'au talent du poète.
Mais ce sont là affirmations perfides de confrère jaloux,
qui n'inspirent aucune confiance. D'ailleurs, était-ce bien
Térence qui devait reprocher à Luscius de ne devoir ses
succès qu'au mérite des histrions, lui qui eut tant besoin
d'Ambivius ? Nous ne savons pas ce que serait devenu
l'Heautontimorumenos sans la recommandation et le jeu
d'Ambivius ; nous savons quel eût été sans le vaillant acteur
le destin de l'Hécyre. Mais du moins on peut dire en faveur
de Térence qu'en faisant à Luscius ce reproche d'extravagance,
il était de bonne foi : son penchant naturel ne le
portait pas vers ce genre de scènes violentes ; elles lui déplaisaient
; le désespoir d'amour lui semblait un motif insuffisant
pour expliquer l'hallucination ; il croyait que
l'hallucination elle-même était un procédé dramatique réservé
à la tragédie ; tout cela était probable. N'avait-il pas
raison? Il est incontestable que de tels moyens conviennent
mieux à la tragédie qu'à la comédie : ils excitent la terreur
et la pitié plus aisément que le rire. Cependant, on ne saurait
aller jusqu'à les exclure absolument de la comédie : parfois
ils n'y sont pas déplacés, pourvu que l'auteur sache les employer en poète comique, comme l'avait fait Plaute dans
la scène du Marchand, c'est-à-dire pourvu qu'il mêle aux
transports de la passion en délire un grain de bouffonnerie.
N'est-il pas permis de croire que le poète grec original, et
partant Luscius, l'avaient fait ?
En somme, de toutes les accusations une seule est sérieuse,
celle qui nous représente Luscius comme un mauvais
écrivain. Aussi est-ce celle-là que Térence a formulée
d'abord, dès qu'il a commencé les représailles. Ce trait une
fois lancé, il s'est trouvé sans armes solides pour l'attaque,
et alors il a fait flèche de tout bois. Pour nous, spectateurs
impartiaux de la lutte, ce qu'il y a de frappant dans l'offensive
de Térence, c'est, avec la faiblesse des coups portés,
la disproportion entre les menaces et les effets. Les menaces
apparaissent dès le premier prologue :
« Dehinc ut quiescant porro moneo et desinant
Maledicere, malefacta ne noscant sua, »
Les représailles par lesquelles débute le prologue de l'Eunuque
peuvent passer pour une réalisation suffisamment
sérieuse de cette promesse. Mais à partir de ce moment
Térence promet beaucoup et ne tient guère.
il ne relève au prologue de l'Heautontimorumenos que
l'incidet du « servus currens. » On est en droit de trouver
que c'est peu, et que Térence ménage trop sa prétendue
réserve de griefs. Mais, il en dira plus long une autre
fois, afïirme-t-il : or, qui s'attendrait à voir enfin dans le prologue du Phormion
Térence accablant son ennemi d'une grêle de coups,
serait vivement déçu : une seule attaque encore et fort peu
meurtrière. A partir de ce prologue les représailles cessent.
Notre poète n'avait qu'un reproche grave à faire à son
rival. Il n'en put tirer à peu près aucun parti à cause de
l'ignorance du public. Cette ignorance gêna beaucoup
moins Luscius dans ses attaques : les griefs de plagiat et
de collaboration clandestine étaient à la portée de tous les
spectateurs ; quant à la contamination, le mot leur faisait
comprendre la gravité de la chose ; le défaut même que
Luscius critiquait dans le ton et le style des comédies de
Térence, était de telle nature, qu'ils pouvaient sentir, au
moins vaguement, la justesse de la critique. A ce point de
vue, Luscius avait donc un grand avantage sur un adversaire
paralysé dans ses attaques, paralysé aussi le plus souvent, nous l'avons vu, dans ses parades. L'offensive de Térence ne dut pas l'émouvoir beaucoup : il n'avait rien à
craindre pour les pièces attaquées en particulier ; elles
avaient été jouées, elles avaient plu, leur destinée était
accomplie. Arrivé presque au terme de sa carrière, l'atteinte,
forcément faible, que les critiques d'un débutant
pouvaient porter à sa considération, ne l'inquiétait pas beaucoup. Par la faiblesse de ses attaques, évidente pour tout
esprit cultivé, Térence, qui s'était flatté de lui paraître plus
redoutable en quittant la défensive, s'amoindrissait au
contraire à ses yeux. Dans ces conditions, les représailles
de Térence étaient impuissantes à faire cesser la persécution
de Luscius. Bien plus, en irritant sa haine, elles l'excitaient
à la continuer.
L'étude de cette polémique laisse une impression attristante.
C'est une guerre déloyale que se font les deux
adversaires, ayant mis de côté tout scrupule de délicatesse,
toute bonne foi. Nul souci de la vérité : tout en vue du
succès. Aucune répugnance à se servir des moyens les plus
méprisables : le mensonge et la calomnie. Cependant entre les denx rivaux notre sympathie n'hésite pas ; elle ne saurait se porter sur le vieillard jaloux et venimeux qui s'efforça
de barrer le chemin à un jeune homme de talent.
Elle va toute vers Térence, malgré les fautes où il se laisse
entraîner, parce que le bon droit est avec lui. S'il est venu
sur ce champ de bataille où il ne se conduit pas toujours
loyalement, c'est qu'on l'y a provoqué ; il ne demandait
qu'à vivre en paix. Il a presque toujours raison contre son
accusateur ; c'est pourquoi nous l'excusons de n'avoir pas
toujours plaidé sa cause avec une franchise qui aurait pu
la lui faire perdre devant des juges ignorants. Quand il attaque
à son tour, c'est avec perfidie : mais nous sommes
indulgents à cette perfidie, parce qu'elle s'exerce contre un
homme qui a fait le plus de mal possible à un innocent et
lui a donné le mauvais exemple. N'importe : si la gloire
poétique de Térence sort pour nous à peu près intacte de
cette polémique, il n'en est pas ainsi de son caractère.
L'ART ORATOIRE DANS LES PROLOGUES DE TÉRENCE
Ce que nous avons étudié jusqu'ici dans les prologues de
Térence, c'est d'abord l'introduction du drame, introduction
d'un genre si original, ensuite la source abondante de renseignements
sur la carrière, le caractère et le talent du poète.
Nous ne les avons pas encore considérés en eux-mêmes, au
point de vue de leur valeur littéraire. Leurs rapports avec
le drame nettement définis, leur matière examinée en détail,
il convient donc maintenant d'y chercher l'art, l'art oratoire;
car ce sont, nous l'avons déjà dit, de véritables plaidoyers.
Comme un accusé, au sens juridique du mot, se défend devant
les juges compétents par l'organe d'un avocat, Térence,
qui se trouvait sous le coup de griefs dont l'appréciation
ressortissait au public, chargea le personnage du prologue
de plaider sa cause devant ce tribunal. Il a fait lui-même
de fréquentes allusions à cette analogie de situation, par
l'emploi de termes techniques empruntés au langage judiciaire
: il a appelé le prologue « oratio », le personnage,
« orator, actor », ses ennemis, « adversarii », la question
en débat, « causa », le public, « judices », la décision du
public, « judicium », etc. Si les prologues sont des plaidoyers,
il faut en faire l'étude littéraire suivant la méthode
classique de l'analyse oratoire, c'est-à-dire qu'il faut y étudier successivement l'invention, la disposition et le style.
Voilà certes un aspect intéressant du talent de Térence, et
trop peu connu; car ce talent on le cherche plus volontiers,
comme il est bien naturel, dans les pièces que dans les prologues
; le poète dramatique absorbe toute l'attention au
préjudice de l'orateur. Nous allons rendre à celui-ci l'hommage
qu'il mérite et que les historiens de l'éloquence romaine
ne songent pas à lui décerner.
1
Pour atteindre son but, qui est le gain de sa cause,
l'avocat, d'après les auteurs de traités de rhétorique, peut
produire et combiner trois effets : convaincre les juges,
gagner leur sympathie, émouvoir leurs passions. Les deux
premiers sont de mise dans toutes les affaires; mais le troisième,
le pathétique, ne convient qu'à celles qui ont assez
d'importance pour passionner les juges; l'essayer dans une
cause qui n'a point ce caractère, c'est non seulement perdre
sa peine, mais encore courir le risque du ridicule. Un
premier mérite de Térence est d'avoir compris que, dans
le procès de ses comédies, il ne devait pas y avoir recours.
L'intérêt capital qu'il attachait à leur succès ne l'a pas
aveuglé : il a senti que pour le public romain l'affaire n'avait
qu'une importance minime. Aussi, sans tenter de faire
jouer les grands ressorts des passions, a-t-il employé tous
les efforts de son invention à chercher les moyens de prouver la bonté de sa cause et de se concilier le coeur des juges. Les arguments que Térence apporta pour sa défense
dans les diverses phases du procès, nous les avons déjà
discutés en détail. Il n'y a place ici que pour quelques
considérations générales sur l'habileté de son argumentation.
Sauf dans un cas, le poète eut toujours pour lui la
conviction que sa cause était juste et la force que donne
cette conviction. Il ne lui eût pas été difficile de la faire
partager à un tribunal de lettrés impartiaux. Malheureusement
pour lui, la grande majorité des juges devant lesquels
il dut plaider, n'étaient pas des lettrés, tant s'en faut. Il lui
fallut traiter des questions qui étaient presque toutes de
nature purement artistique, avec des auditeurs absolument
étrangers, pour la plupart, aux choses de l'art. Situation
épineuse, s'il en fut, dont les embarras étaient encore aggravés
par cette circonstance que les spectateurs, venus au
théâtre pour s'y amuser, pour y voir la comédie, ne devaient
évidemment pas être disposés à prêter une oreille
bien attentive aux discussions préliminaires, peu intéressantes
pour eux, qui retardaient le moment de leur plaisir.
Térence avait donc contre lui un double désavantage, auquel
n'étaient pas exposés à Rome les plaideurs ordinaires ; car
les juges appelés à connaître d'une affaire avaient en général
la compétence voulue et, quand ils se rendaient au tribunal,
ils savaient bien d'avance qu'ils allaient, non à un divertissement,
mais à une occupation sérieuse. Dans les conditions
défavorables où il se trouva, Térence dut ne faire valoir
que des preuves ayant ces deux caractères : être facilement
intelligibles pour des esprits grossiers, pouvoir se formuler
en quelques mots sans rien perdre de leur efficacité. Il fut
ainsi obligé souvent de renoncer à ses meilleures raisons
et, dans les cas où il ne vit aucun bon argument à la portée
du public, d'appeler à son aide, pour n'avoir pas l'air de
passer condamnation, le sophisme et le mensonge.
En deux occasions seulement, l'invention des preuves fut toute simple pour lui, parce qu'il n'eut alors qu'à dire
la vérité sans artifice oratoire. Au début du prologue de
l'Enuque, il répondit à qui l'accusait de médisance par
l'excuse de légitime défense, raison excellente en soi, facile
à exprimer brièvement, et dont l'instinct de la conservation
fait tout de suite sentir la justesse aux plus ignorants ; dans
le prologue des Adelphes, il démontra la fausseté du grief
de plagiat par une preuve de fait : Plaute n'avait pas traduit
la scène qu'on lui reprochait d'avoir volée à Plaute ;
il suffisait d'avoir du bon sens pour saisir la démonstration
qui était l'évidence même. Partout ailleurs, l'invention
des preuves exigea de sa part plus d'efforts et d'habileté.
Contre le grief de contamination, il avait un sérieux moyen
de défense, qui se présenta naturellement le premier à sa
pensée : l'opération incriminée, loin d'altérer en rien la
valeur du modèle, l'enrichissait de qualités nouvelles ;
mais une pareille apologie eût été trop longue et trop
technique ; il l'écarta pour en produire une autre beaucoup
moins solide : il se prévalut de l'exemple des anciens, argument
plus accessible et absolument concluant pour des
esprits romains. Ce n'était encore là que de l'habileté ;
voici maintenant le sophisme et le mensonge. Térence est
accusé d'avoir pillé pour son Eunuque le Colax de Névius
et de Plaute ; il commence par nier le fait : c'est au Colax
de Ménandre qu'il a directement puisé. Cet argument, si
les spectateurs admettent la véracité du poète, détruit le
grief principal de plagiat ; mais il reste l'accusation subsidiaire
d'avoir voulu donner au public du vieux pour du
neuf. La bonne et sincère réfutation serait celle-ci : d'un
original grec déjà exploité on peut encore tirer, avec du
talent, quelque chose d'intéressant, quelque chose de meilleur
que la première copie ; donc la conduite du poète n'est
pas blâmable. Mais le raisonnement est trop compliqué pour
le public romain. Il faut chercher plus simple : de là un
mensonge, la prétendue « imprudentia » de Térence qui
ignorait, dit-il, l'existence du Colax latin ; de là encore un sophisme, le droit incontestable d'user de personnages déjà
vus sur la scène romaine, invoqué à tort ici ; mauvaises
raisons en soi, mais bonnes au point de vue oratoire, parce
qu'elles étaient de nature à persuader les auditeurs naïfs et
distraits du prologue, surtout appuyées qu'elles sont d'un
habile argument déjà employé ailleurs, l'exemple des anciens.
Térence est accusé d'infécondité relativement à ses
prologues : il n'aurait pu, dit-on, en écrire un seul, s'il
n'avait eu quelqu'un de qui médire. Il devrait, pour se justifier,
faire connaître et son projet primitif de suppression
du prologue et les raisons de cette détermination que les
attaques de Luscius l'ont empêché de suivre. Mais qui l'écouterait,
qui le comprendrait ? Il élude adroitement le reproche
principal de stérilité et il repousse le reproche accessoire
de médisance par l'excuse, déjà donnée ailleurs, de
légitime défense. Térence est accusé d'avoir des collaborateurs
clandestins. L'accusation serait anéantie, s'il prouvait
à ses auditeurs qu'il est bien plus capable de composer des
comédies que les personnages désignés par les mauvaises
langues comme ses auxiliaires. Mais le moyen de prouver
cela aux spectateurs romains ? Ici Térence cherche vainement
d'abord, à défaut de bonne raison, une raison spécieuse,
et, comme l'accusation ne lui est pas à tous égards
préjudiciable, il prend le parti de s'en remettre à la décision
des juges, sans plaider ; c'est un subterfuge. L'accusation
s'étant reproduite, il trouve cette fois pour la repousser, ou
mieux pour l'éluder, un sophisme : les bruits qui courent à
ce sujet lui font honneur, dit-il ; les amis qui passent pour
lui rendre service dans la composition de ses pièces rendent service à tous dans toute sorte de circonstance et sont
aimés de tous. Reste l'accusation fondée, celle qui a trait
au ton et au style des comédies : contre celle-là il n'y
avait pas de bonnes raisons ; ce ne fut pas l'ignorance du
public qui gêna le poète : ce fut la vérité. Ne trouvant pas même une réponse spécieuse, il imagina de se dégager par
une attaque : il détourna habilement du défaut qu'on lui
reprochait l'attention des spectateurs, pour la porter sur le
défaut contraire, reproché par lui à son accusateur. En
nous plaçant au point de vue moral, nous avons dû juger
sévèrement l'habileté de Térence à se disculper ; mais au
point de vue oratoire, qui nous occupe seul maintenant, il
faut y reconnaître un mérite, la marque d'un esprit fécond
en ressources.
Cette qualité, frappante dans l'invention des preuves, se
révèle encore mieux dans l'invention de ce que les rhéteurs
appellent les moeurs. Gagner l'estime et la sympathie
de ses juges est une chose très importante pour tout accusé ;
ce qui la rendait plus importante pour Térence, c'est qu'il
ne pouvait essayer d'émouvoir leurs passions en sa faveur :
n'ayant pas le moyen de les entraîner violemment vers lui,
il devait mettre tous ses soins à les attirer doucement ; et,
en effet, il n'a rien négligé pour cela. D'abord il s'est très
adroitement servi dans ce but des avantages que lui assurait
sa situation d'attaqué. La bienveillance instinctive de
la foule n'est pas pour l'agresseur : il l'a bien senti et il a
fait valoir à mainte reprise son droit de légitime défense.
Ses prologues ne sont pas amusants ; il impose au public
qui est venu voir une comédie divertissante, l'ennui d'un
plaidoyer : mais ce n'est pas sa faute ; il est juste de s'en
prendre au vieux poète dont les calomnies l'ont mis dans la
nécessité de se défendre. On l'accuse d'être médisant : il
ne l'a été que par force ; son rival a voulu lui fermer la car
rière dramatique, lui ôter son gagne-pain, le réduire à la
misère et à la faim ; il n'a fait que répondre à ces provocations
: au fond nul n'est plus doux, plus pacifique, plus
désireux de ne blesser personne. Ce n'est pas seulement son droit de légitime défense qu'il
exploite pour se rendre sympathique, c'est aussi la modération
avec laquelle il use de ce droit. Nous savons, nous autres, pourquoi il n'a pas pris plus souvent et plus longuement
l'offensive : non seulement il n'a pas fait grâce à
son adversaire d'un seul reproche mérité, mais encore il a
eu recours aux accusations fausses et déloyales ; si ses attaques
ne sont pas plus fréquentes et plus terribles, c'est donc
impuissance et non magnanimité. Et cependant c'est en
adversaire magnanime qu'il se pose devant les spectateurs.
Dès son premier prologue, il insinue que son rival a commis
des méfaits, qu'il pourrait les lui reprocher publiquement
; mais il ne le fera que si les hostilités continuent,
si l'on pousse à bout sa patience. Elles continuèrent en
effet. Dans le prologue de l'Eunuque, il se résout donc à
frapper : mais il ménage, à l'en croire, son ennemi ; loin de
se montrer impitoyable, il retient ses coups ; il en aurait
bien long à dire, il en dit peu et fait grâce pour le moment
du reste : il ne se départira de cette modération dans
l'attaque que si Luscius persiste à le calomnier. Luscius
persista. Et pourtant, dans le prologue de l'Heautontimorumenos,
Térence se contient encore : il ne décoche qu'un
trait au vieux poète ; une fois de plus les grandes représailles
sont retardées : elles n'auront lieu que si Luscius
ne change pas de conduite. Quelle mansuétude et quelle
générosité ! Comment ne pas estimer un homme qui, provoqué,
attaqué avec tant d'acharnement, garde une attitude
pareille à l'égard de son agresseur ?
Un autre trait de modération affectée, dans l'usage du
droit de légitime défense, c'est le silence constamment observé
sur le nom de l'adversaire. Les Athéniens acceptaient
volontiers les personnalités au théâtre : Aristophane ne se
gène pas pour nommer en toutes lettres plusieurs de ses
contemporains, et il va même jusqu'à leur donner un rôle
dans ses comédies. A Rome les habitudes étaient tout autres. De bonne heure fut réprimée la licence de la poésie
fescennine : les lois des Douze Tables punissaient du bâton,
d'après Horacel, de mort, d'après Cicéron, quiconque portait atteinte par des vers injurieux à la bonne renommée
d'un citoyen. Quand Térence écrivit ses prologues, Lucilius
n'avait pas encore donné par ses satires, qui d'ailleurs
n'eurent pas la même publicité, un exemple de désobéissance
à ces lois. Névius, qui avait tenté de s'en affranchir
dans ses comédies, avait payé cher sa hardiesse. Sans doute
le cas de Térence, nommant Luscius, n'eût pas été criminel
au même point. Mais certainement les spectateurs lui surent
gré de l'attaquer sans crier son nom du haut de la
scène ; cette preuve de réserve fut un titre sérieux à leur
estime. D'ailleurs Luscius ne gagna absolument rien à ces
ménagements apparents : on ne lui faisait pas l'honneur de
l'appeler par son nom, on le qualifiait avec dédain de « malivolus
vetus poeta. » L'absence du nom propre n'atténua
l'efficacité des prologues ni dans la défensive, ni dans l'offensive.
D'abord, en effet, on peut supposer que le rival de
Térence était le seul vieux poète comique de ce temps-là.
Ensuite, parmi les spectateurs, les uns arrivaient au théâtre
sans avoir entendu dire du mal de la comédie qui allait se
jouer : ce n'était pas à ceux-là que Térence présentait sa
défense ; d'autres connaissaient les bruits malveillants, mais
en ignoraient l'origine : il leur importait uniquement que
Térence se justifiât par de bonnes raisons ; d'autres enfin
savaient fort bien d'où partaient les critiques et n'avaient
par conséquent nul besoin que Prologus en nommât l'auteur.
Une désignation vague fut donc suffisante tant que Térence
resta sur la défensive ; dès qu'il prit l'offensive, il fut tenu
de préciser davantage; il sentit que ses traits n'auraient
toute leur force que si tous les spectateurs voyaient qui ils
atteignaient. Mais il sut se dispenser, même alors, de nommer Luscius. Dans le prologue de l'Eunuque, il n'eut pour
le faire reconnattre de tous qu'à citer le titre de sa dernière
pièce jouée.
Dans le prologue de l'Heautontimorumenos, il fit allusion
à un incident bizarre d'une comédie également assez récente
pour que la plupart des spectateurs n'eussent pas oublié
le nom de l'auteur. D'ailleurs, un grand nombre de
ceux qui écoutèrent ce prologue avaient écouté aussi le
prologue de l'Eunuque et pouvaient se rappeler le nom du
rival deTérence; d'une façon générale, plus la polémique
se prolongeait, plus le nombre des personnes au courant de
ce nom augmentait; si bien que, dans le prologue du Phormion,
Térence n'eut besoin de citer ni le titre ni un incident
d'une oeuvre récente et put, sûr de parler devant des
gens bien informés, critiquer chez Luscius une faute déjà
ancienne. Il s'arrangea donc toujours de manière à ce que
tout le monde, ou à peu près, sût de qui il s'agissait, sans
qu'il eût lui-même à sortir de sa malicieuse réserve.
Si Térence fait parade de sa modération et de sa discrétion
vis-à-vis de son adversaire, il tient beaucoup également
à ne pas être soupçonné par le public d'avoir peur : il veut
que l'on voie dans cette conduite un signe de force et non
de faiblesse. Il sait que les poltrons et ceux qui ont l'air de
trop se défier d'eux-mêmes ne sont pas sympathiques à la
foule. Aussi se montre-t-il plein d'assurance en face de son
ennemi, plein de confiance en la valeur de ses propres oeuvres.
Cette assurance se reconnaît au ton toujours ferme
des réponses, au ton menaçant des attaques. Cette confiance,
sensible partout à la façon simple et calme dont le poète
s'en remet à la décision du public, éclate dans le premier
prologue de l'Hécyre, où il affirme, au risque de passer pour
cupide, qu'il a retardé la reprise de la pièce malheureuse
afin de la revendre, donnant ainsi à entendre que l'insuccès d'autrefois n'a pas modifié la bonne opinion qu'il avait de
cette oeuvre.
Térence cherche aussi des titres à la sympathie des spectateurs
dans les sentiments qu'il professe à leur égard. Il
déclare dès le commencement de son premier prologue que,
du jour où il s'est mis en tète d'écrire pour la scène, son
unique préoccupation a été de faire plaisir au public, de
mériter ses suffrages. Sa reconnaissance n'est pas moindre
que son dévouement : après l'échec de l'Hécyre est venu le
succès de l'Heautontimorumenos ; il en fait hommage à la
bonté et à l'impartialité du public, non moins qu'au talent
des acteurs Il affecte, pour les juges qui vont avoir à se
prononcer sur le sort de ses pièces, la plus haute considération
: leur grossièreté fut la cause du double échec de
l'Hécyre ; il n'a garde de la leur reprocher ; c'est la mauvaise
chance seule qu'il accuse; c'est à l'intelligence, à l'autorité
du public qu'il fait appel pour réparer les injustices
du sort. N'est-ce pas d'ailleurs, d'une façon générale,
flatter les spectateurs, laisser voir clairement combien on
apprécie leurs lumières, que de les prendre pour juges dans
ces débats littéraires ? Les gens du vulgaire sont loin d'en
vouloir à qui leur reconnaît une compétence qu'ils n'ont pas,
à qui les fait arbitres d'une question qu'ils ignorent. Enfin,
autant le ton que prend Térence à l'égard de ses adversaires
est assuré, hautain, autant les prières qu'il adresse au
public sont empreintes de modestie et de respect. Et ce qui
dut donner à cette habile attitude toute son efficacité, c'est
l'air de sincérité dont il exprime ces sentiments, sans affectation,
sans excès : point de grosses flatteries, point de
pompeux éloges, point de plates sollicitations; juste ce qu'il
faut pour que le charme agisse, pour que l'auditeur soit
attiré comme à son insu.
Notre énumération n'a pas encore épuisé la série des
moyens que Térence trouve dans sa propre personne pour se concilier la bienveillance du public. Il fait valoir son
attachement aux procédés des anciens poètes ; c'est une
conformité de goût avec la plupart des spectateurs, qui aiment
et respectent tout ce qui est ancien. Il insinue discrètement
qu'un auteur comme lui, capable d'écrire des pièces sans défauts,
rend service au public et mérite quelque reconnaissance,
que l'avantage du public est de protéger les jeunes poètes
d'avenir, de ne pas laisser une coterie accaparer la scène ;
ce qui revient à établir adroitement une sorte de solidarité
entre ses intérêts et ceux de ses juges, Enfin, il se pare
de l'amitié que lui témoignent de grands personnages aimés
par tous, utiles à tous : il exploite en sa faveur la considération
et l'affection universelles dont jouissent ses protecteurs.
Térence ne pouvait guère se recommander par la personne
de son avocat ordinaire : car Prologus n'avait aucun
prestige, aucune autorité, n'était qu'un instrument docile,
un porte-voix. Mais avec l'avocat extraordinaire Ambivius,
il en fut tout autrement. En lui confiant la mission de plaider
sa cause, Térence s'ouvrit une riche source de recommandations
dont il tira le plus habile parti. Ambivius, nous
l'avons déjà dit, mit dans la balance tous ses titres à la faveur
du public : une longue et laborieuse carrière, consacrée
à lui procurer de l'amusement, avec la préoccupation constante
de lui être agréable et non de s'enrichir. Fort de ses
mérites, il put parler de ses intérêts et montrer qu'ils étaient
liés au succès des pièces pour lesquelles il plaida : l'Heautontimorumenos,
pièce calme, lui ménageait une bonne
occasion, dont il ne fallait pas le priver, de jouer sans subir
la lourde fatigue de la plupart des représentations; l'Hécyre,
injustement repoussée d'abord, si elle était enfin applaudie
comme elle le méritait, encouragerait les poètes à écrire pour
le théâtre, et Ambivius pourrait, en montant fréquemment des pièces nouvelles, réaliser un honnête gain. Il mit aussi
en avant sa compétence incontestée en matière de comédie :
s'il garantissait la valeur de l'Hécyre, lui, vieux connaisseur,
c'est que l'Hécyre était bonne ; ce n'était pas la première
fois qu'il soutenait à bon droit une oeuvre injustement traitée
dès son apparition : l'exemple des premières comédies
de Cécilius attestait la sûreté de son jugement.
Pour se rendre sympathique, Térence s'applique enfin à
rendre son adversaire antipathique. Il fait tout son possible
pour l'amoindrir aux yeux du public, tant au point de vue
moral qu'au point de vue intellectuel. L'envie, tel est, d'après
Térence, le trait dominant de son caractère : il est
constamment appelé dans les prologues, ainsi que ceux de
sa coterie. Susceptible à l'excès,
blessé par quelques mots vifs que Térence, attaqué, s'est
permis de lui décocher, il ne ménage guère pourtant la
susceptibilité d'autrui et, devant les acteurs, devant les
magistrats, il traite brutalement son jeune rival de voleur.
A sa vile besogne de colporteur de calomnies il s'acharne
avec une rage que l'insuccès ne fait qu'exaspérer jalousie,
brutalité, acharnement, voilà en abondance de quoi rendre
l'homme méprisable et odieux. Térence n'épargne pas davantage
le poète : c'est un ignorant qui veut faire le fin
connaisseur en matière dramatique et n'y entend rien ; son
exactitude est dédaigneusement qualifiée d'obscure ; il ne
sait pas écrire ; il commet les plus lourdes sottises et en
grand nombre, violant les règles les plus élémentaires de
la procédure,
violant les bienséances
,
violant le bon
sens : c'est un fou. Défauts de caractère, défauts
d'esprit, Térence ne néglige rien pour s'en faire une
sorte de repoussoir. En somme, dans l'invention des prologues, parmi tant
d'excellentes idées, à peine peut-on relever une ou deux
fautes. La hardiesse de Térence dans le passage' où, pour
donner une preuve frappante de la bonne opinion qu'il a de
l'Hécyre, malgré son premier malheur, le poète ne craint
pas de se montrer intéressé, âpre au gain, sera peut-être
considérée par quelques-uns comme téméraire et traitée
d'imprudence. Une véritable maladresse, c'est l'explication
que Térence prétend donner du succès d'une pièce de Luscius,
en l'attribuant aux acteurs bien plus qu'au poète :
n'est-il pas obligé de reconnaître, à la fin du prologue
même où il donne cette explication, n'a-t-il pas reconnu
ailleurs, que le talent des interprètes n'est pas, pour lui
non plus, un appoint à dédaigner ? Mais en dehors de ces
deux endroits, toutes les idées des prologues, très propres
à recommander la personne et la cause de Térence, sont
d'une irréprochable invention.
II
Le sujet creusé à fond et toute la matière trouvée, l'avocat
doit faire le plan de son plaidoyer et y distribuer ses
idées de façon à leur donner le plus de valeur possible par
la disposition. Il est guidé dans ce travail et par les principes
généraux de la composition oratoire et par les exigences
particulières de sa cause. Apercevoir nettement ces
exigences et en tenir habilement compte, voilà surtout en quoi consiste, dans la disposition, l'art de l'orateur. Il n'est
pas plus difficile à qui connaît les éléments de la rhétorique
de faire un plan de discours, que de faire un plan de bataille
à qui connaît les éléments de la tactique et de la stratégie ;
le difficile et l'essentiel, c'est de faire un plan qui ne soit
point banal, qui révèle la science de la théorie et à la fois
l'intelligence des circonstances. Voyons si notre poète a eu
ce talent.
S'il peut arriver que l'exorde soit inutile dans un plaidoyer,
ce n'était évidemment pas le cas pour le prologue
de l'Andrienne. Au moment où les spectateurs virent paraître
Prologus, ils s'attendaient de sa part à un amusant récit
de l'argumentum : il fallut donc tout d'abord prévenir leur
surprise et leur mécontentement, en motivant la transformation
du prologue. L'exorde était indispensable, et le
contenu de l'exorde s'imposait. Le poète y expose que les
attaques de son adversaire sont venues le troubler dans la
préoccupation, où il était absorbé, de faire des pièces agréables
au public, et l'obligent à écrire des prologues-plaidoyers.
Voilà le sujet du discours annoncé, et de plus, les auditeurs,
concevant une opinion favorable de l'accusé, défavorable de
l'accusateur, sont préparés à écouter le reste avec bienveillance
: le but de l'exorde est ainsi pleinement atteint. Enfin
l'entrée en matière se rattache de la façon la plus naturelle
à la suite du discours : " On m'a mis dans la nécessité de
me défendre, parce que l'on m'a attaqué".
La narration
ne pouvait viser ici à être très intéressante, puisqu'elle
roule sur des choses littéraires, sur une question de
rapports de deux pièces et de mélange des mêmes pièces.
Mais elle devait se faire écouter et comprendre par sa clarté et sa précision, elle devait aussi donner à l'auditeur une
bonne idée du procédé incriminé. Térence y a très bien
réussi. Il établit nettement trois points essentiels : que le
mélange n'est pas hétéroclite, puisque les deux pièces ont
une grande ressemblance; qu'il a sa raison d'être pourtant,
puisqu'elles diffèrent à certains points de vue ; qu'il est,
non confus, mais raisonné, puisque le poète n'a fait passer
de l'original secondaire dans l'original principal que ce qui
convenait à celui-ci.Comme conclusion de cet exposé, arrive
la proposition, que les auditeurs sont maintenant en état
de comprendre et qu'ils sont disposés à résoudre en faveur
de l'accusé.
Les adversaires ont tort, puisque l'accusé n'a fait qu'imiter
les anciens, auxquels on n'en a jamais voulu d'avoir employé
ce procédé : telle est la réfutation du grief, facilement intelligible
pour le public et concluante à ses yeux. Elle est
appuyée d'une digression où les accusateurs sont maltraités
et menacés de représailles : après les avoir confondus,
Térence s'applique à les déconsidérer et à mettre en relief
son assurance et sa modération. La péroraison accentue la
bonne impression qu'il donne par là de lui-même : l'accusé
a des prétentions très modestes : il demande seulement que
le public prenne connaissance de la pièce incriminée et,
d'après cet échantillon, le juge une fois pour toutes.
Un caractère frappant de la disposition de ce prologue,
c'est que les parties s'y succèdent justement dans l'ordre
préconisé par ces rhéteurs grecs que Cicéron livre aux railleries
d'Antoine dans le traité de l'Orateur : exorde, narration,
proposition, confirmation, digression, péroraison. Cette concordance est-elle le fait du hasard ? Non, elle est
voulue : Térence, nous insisterons bientôt sur ce point, avait
sans doute suivi les leçons de quelque rhéteur grec. La
première fois qu'il eut à écrire un plaidoyer, il utilisa ses
connaissances en rhétorique et, naturellement, il conforma
la disposition de son discours au type suivant lequel il avait
composé à l'école du rhéteur ses exercices oratoires. Mais
sous cette fidélité scrupuleuse d'écolier à peine émancipé,
dont Térence saura s'affranchir dans la suite, perce déjà
son indépendance, son habileté personnelle : on la reconnaît
aux proportions relatives des parties dont l'étendue a été
visiblement mesurée sur l'importance de chacune d'elles
dans l'espèce, bien plus que sur leur importance théorique.
Un rhéteur pointilleux trouverait l'exorde et la narration un
peu longs, la confirmation beaucoup trop courte. Toutes ces
irrégularités sont cependant faciles à justifier : Térence a
donné du développement à l'exorde, parce que la déclaration
qu'il contient est capitale, parce que ce n'est pas ici seulement
l'exorde du prologue de l'Andrienne, c'est aussi l'exorde
de tous les prologues à venir. S'il a insisté sur la narration,
c'est qu'il avait d'autant plus intérêt à prévenir dès ce moment
le public en faveur du fait incriminé, que la discussion
de ce fait, à cause de l'incompétence des juges, ne pouvait
pas être poussée à fond dans la confirmation. Et voilà juste le
motif pour lequel il a abrégé cette dernière partie.
Sans être aussi essentiel que l'exorde du prologue de
l'Andrienne, l'exorde du prologue de l'Eunuque est très
important. Après la représentation del'Andrienne, le vieux
poète, malmené par son jeune rival, avait poussé les hauts
cris et s'était efforcé de faire à celui-ci un mauvais renom
de médisance. Térence, comprenant tout le tort que
lui causerait dans l'esprit des spectateurs ce bruit, s'il s'accréditait,
proteste ici de ses intentions pacifiques et inoffensives
: il n'a frappé que pour se défendre. L'utilité de
cet exorde est double : il déblaie le terrain d'un obstacle dangereux, il prépare les auditeurs à écouter sans murmure
les attaques auxquelles le poète, toujours dans le cas de
légitime défense dont il vient de revendiquer les droits, va
se livrer tout de suite. En effet, le dernier vers de l'exorde
est lié, même grammaticalement, au premier vers d'une
longue digression composée de critiques et de menaces
contre Luscius, dont le but est de le déconsidérer comme
poète et comme homme. Par une habile transition, Térence
arrive ensuite à l'accusation lancée contre 1"Eunuque il
l'introduit comme un cas particulier de la conduite malveillante
de Luscius à son égard. Avec la même intention
de déconsidérer son adversaire dont il fait ressortir la brutalité,
il raconte la scène de la répétition et met ainsi ses
auditeurs au courant de l'accusation. Le récit, dans sa vive
précision, n'omet aucun détail intéressant : par exemple,
la présence des magistrats, circonstance qui aggrave les
torts de Luscius, du calomniateur, est soigneusement notée.
La narration se termine par la proposition, que Térence
met dans la bouche de l'accusateur lui-même.
Térence est donc accusé par Luscius d'avoir pillé ses devanciers
: il se disculpe de ce chef1 en affirmant qu'il a
pris les personnages en question dans le Colax grec et
qu'il ignorait l'existence du Colax latin. C'est la première
partie de la réfutation ; il y en a une seconde. Car le
grief de plagiat écarté, reste l'accusation subsidiaire d'avoir
s'est bien gardé de la formuler dans la proposition ;
il espère que, pour beaucoup de spectateurs, elle ne se
dégagera pas nettement de la principale, et il estime qu'il
serait naïf de les aider à l'apercevoir. Mais, d'un autre côté,
beaucoup certainement l'ont distinguée, et, pour ceux-là, il
la combat en établissant une habile confusion entre ce qu'il
a fait et d'autres choses qu'on a évidemment le droit de faire, que les anciens ont faites bien des fois. Il a réservé
ce dernier argument, le plus décisif, pour la fin, selon le
précepte des rhéteurs. Nous sommes déjà sur la frontière
de la péroraison : ici pas d'instantes prières, une simple invitation
au silence, la confiance que donne la certitude d'un
acquittement.
La disposition de ce prologue est moins classique, plus
originale que celle du précédent. La moitié de la proposition
n'est pas formulée, nous avons dit pourquoi, et, surtout,
entre l'exorde et la narration, dans ce premier joint du discours,
se place une digression. Pourquoi là plutôt qu'entre
la confirmation et la péroraison, à l'endroit classique,
comme dans le prologue de l'Andrienne ? C'est une hardiesse
de tactique. Le grief que Térence doit repousser est
grave ; les moyens de réfutation qu'il peut produire ne sont
pas en somme bien solides. Il éprouve donc le besoin de
chercher, avant d'en arrriver là, à dépouiller l'accusateur
de toute autorité. Dans ce prologue encore, nous remarquons
que l'étendue relative des parties est sagement proportionnée
à leur importance actuelle. La digression et la
confirmation se distinguent par leur longueur : c'est que
Térence attachait un grand prix à l'effet de l'une ; quant à
l'autre, il voulait dissimuler sous l'abondance de l'expression
la pauvreté des arguments, il voulait parler beaucoup pour
faire accroire au public qu'il avait beaucoup à dire.
Dans le prologue de l'Heautontimorumenos, l'exorde
joue le même rôle que dans celui de l'Andrienne : il explique
aux spectateurs une dérogation à l'usage, dont ils doivent
être informés tout de suite : l'apparition imprévue du
vieil Ambivius en Prologus. Mais il comprend une autre
partie que l'on ne rencontre pas habituellement dans les
prologues de Térence, la pronuntiatio tituli, présentée ici
.avec une habileté que nous avons déjà fait ressortir. Il est
,donc doublement indispensable : il prévient la surprise légitime
du public, il le munit des renseignements préliminaires. En ce qui concerne la position relative des deux
parties de l'exorde, nous avons déjà dit pourquoi Térence
avait placé l'annonce avant les explications d'Ambivius : il
se hâtait de l'amener, parce qu'elle était déjà en retard sur
son moment normal. De l'exorde à la confirmation, le passage
se fait sans secousse : Ambivius est venu, dit-il, pour
plaider la cause du poète, et il se met à la plaider. Il répond
rapidement1 aux deux griefs de contamination et de
collaboration : à l'un par une affirmation très énergique du
droit de Térence, fondé sur de bons précédents ; à l'autre
par un acte de confiance en l'appréciation du public. Dès
ce moment commençe la péroraison, qui est bientôt interrompue
par une digression contre la sottise de l'adversaire,
puis elle reprend son cours ; dans la partie antérieure
à la digression, Ambivius appelle la bienveillance des spectateurs
sur les poètes qui leur procurent des pièces nouvelles
irréprochables ; dans celle-ci, il réclame l'impartialité
et le silence pour lui-même qui les mérite bien.
On est vivement frappé d'abord de la longueur de cette
péroraison, qui forme à elle seule, sans tenir compte de la
digression qu'elle englobe, presque la moitié du prologue.
Mais, à la réflexion, on trouve cette anomalie très naturelle
: c'est précisément en vue de cette péroraison, pour
mettre en avant les motifs de recommandation tirés de la
personne d'Ambivius, que Térence a chargé le vieillard du
rôle de Prologus, et il ne cherche pas à dissimuler, contrairement
à la règle donnée par les rhéteurs et à son
propre usage, que le plaidoyer a pour but de gagner la
sympathie des juges bien plus que de les éclairer. On
conçoit aussi la longueur de l'exorde : il a ici une importance
considérable et il est augmenté de l'annonce. Par contre, la confirmation est très courte : il devait en être
ainsi, puisque l'un des griefs, déjà exploité par l'accusateur,
est repoussé par le même argument, et que l'accusé ne
veut pas discuter l'autre. Irrégulier par les proportions
anormales des parties, ce prologue l'est également par la
situation de l'une d'elles, la digression, qui se trouve, non
dans un joint du discours, mais au coeur de la péroraison,
et par la suppression d'une autre, la narration. L'inutilité
de celle-ci était évidente : les spectateurs savaient déjà ce
qu'il fallait entendre par contaminer ; il n'y avait pas lieu
de leur expliquer longuement ce que c'était qu'une collaboration.
Quant à la place de la digression, elle a été déterminée
par le désir de ménager un contraste, tout à l'avantage
de Térence, entre ce poète pour lequel Ambivius réclame
la faveur du public, et cet autre poète, l'accusateur,
pour lequel il ne la réclame pas.
Le prologue du Phormion débute par la constatation de
l'acharnement que Luscius met à poursuivre Térence de ses
attaques. En comparant cet exorde à ceux des trois prologues
précédents, on est frappé de son peu de relief et de
sa concision : c'est un simple début plutôt qu'un exorde.
Térence, n'ayant aucune idée importante à placer en tète
de son discours, n'avait qu'à aller droit au sujet. C'est ce
qu'il a fait en rapportant, dès le quatrième vers, l'une de
ces calomnies dont il vient de dire que son adversaire le
harcèle. Il en rapportera tout à l'heure une seconde ; car
dans ce prologue, comme dans celui de l'Heautontimorumenos
et dans celui des Adelphes, la proposition et la
confirmation sont doubles, La réponse au premier grief a
ceci de remarquable qu'elle est une attaque, non une défense,
suivie d'une courte digression destinée à déconsidérer
l'accusateur : il importait ici d'insister sur ses défauts,
d'amoindrir sa personne, parce qu'on ne faisait pas de réponse
directe et dicisive à son grief. Par une rédaction habile
de la seconde proposition, Térence élude, dans le grief relatif à la nature de ses prologues, le reproche de stérilité,
qui est l'essentiel, et met en vedette un reproche de médisance
contre lequel il aura beau jeu. Pour que le public n'ait
pas le loisir d'apercevoir la supercherie, il absorbe toute son
attention au moyen d'une longue et éloquente tirade sur
le droit de légitime défense. Il n'y a de narration ni avant
l'une, ni avant l'autre des deux parties de la confirmation :
les faits incriminés pouvaient, sans préjudice pour la clarté,
se formuler en quelques mots. Vient ensuite la péroraison,
assez développée, car elle a une importance particulière :
Térence y fait allusion au premier échec de l'Hécyre. C'est
là un point délicat auquel il n'arrive pas d'emblée : il tourne
quelque temps autour, donnant dans une petite digression
la raison du changement de titre qu'il a fait subir à l'original
; dès qu'il y a touché, il s'empresse de le quitter pour
faire allusion aux succès remportés depuis. En somme, dans
ce prologue il faut remarquer, relativement à l'ordre des
parties, l'absence de la narration et la place des deux digressions
; relativement à leur étendue, la concision de
l'exorde, l'ampleur de la confirmation et de la péroraison,
qui sont l'une et l'autre construites avec beaucoup d'art.
L'exorde du prologue des Adelphes appartient au genre
simple ; mais avec cette simplicité, quoiqu'il n'ait pas l'allure
insinuante de ceux de l'Andrienne et de l'Eunuque, il est
très adroit : c'est sans faire paraître la moindre inquiétude
au sujet de l'arrêt du public, que Térence déclare venir se
dénoncer lui-même. Suit la narration, qui contient la dénonciation
promise : les faits y sont nettement exposés
dans leur vérité, et il en résulte que le poète n'est pas coupable
du plagiat qu'on lui impute. La seule narration suffit
à anéantir le grief. Pas de proposition explicitement formulée,
pas de confirmation ; tout cela eût été inutile. Entre les
deux termes de l'alternative que Térence pose dans la conclusion
de son récit, les juges ne sauraient hésiter. Mais voici une seconde partie du plaidoyer, que l'exorde, visant
spécialement la première, ne faisait pas clairement prévoir
: il s'agit d'un autre reproche, général celui-ci, le reproche
déjà connu de collaboration ; Térence, sans le réfuter
plus que la première fois, en tire un avantageux parti
pour se grandir dans l'estime du public. Il fait ensuite une
courte digression sur l'absence de l'argumentum : nous
en avons dit depuis longtemps le sens et la portée : il faut
y voir une allusion au reproche relatif à la matière des prologues.
Térence, qui l'a déjà éludé dans le prologue du
Phormion, ne veut pas davantage y répondre franchement
ici. Il tient pourtant à faire sentir aux lettrés qu'en cette
question il peut se prévaloir d'un précédent : Plaute a supprimé
un jour l'argumentum; et il cite à peu près textuellement
l'excuse donnée ce jour-là par Plaute. Sa péroraison,
très simple comme l'exorde, est un bref appel à l'impartialité.
Ce qu'il y a de remarquable dans la disposition
de ce prologue, c'est le rôle que Térence fait jouer à la
narration : elle sert à la fois de narration proprement dite
et de confirmation, et, en guise de conclusion, elle amène
non pas la proposition ordinaire, mais pourtant une sorte de
proposition déjà résolue dans le sens favorable au plaidant.
Le premier prologue de l'Hécyre n'est pas, à vrai dire,
un discours : c'est plutôt un avis au public, en deux parties
: la première explique l'échec immérité que la pièce a
déjà subi ; la seconde, le délai qui a séparé cet échec
de la reprise. Comme entrée en matière, le nom de la
pièce, que les spectateurs n'apprirent pas ce jour-là par l'annonce ordinaire ; comme conclusion, une exhortation à ne
pas priver cette comédie du bon accueil fait aux autres
oeuvres du poète. Les deux explications qui composent ce
petit morceau sont, dans leur brièveté, des modèles d'art
oratoire.
Le second prologue est bien un vrai discours, le plus
original, le plus parfait qu'ait écrit Térence. L'exorde, insinuant, est tiré de la personne de l'orateur, le vieil Ambivius.
Il se garde bien de dire tout de suite qu'il vient
présenter au public l'Hécyre : le titre de la pièce deux fois
repoussée aurait pu faire mauvaise impression ; il fallait
d'abord préparer le public à l'entendre. Ambivius déclare
qu'il sollicite une faveur, un droit qu'on lui a accordé
dans sa jeunesse. Peut-on refuser au vieillard ce qu'a obtenu
le jeune homme ? Ce privilège consista à faire réussir
des pièces qui avaient été d'abord malheureuses, les premières
oeuvres de Cécilius. Ainsi est amenée une longue
digression sur les services rendus par Ambivius à Cécilius.
Cette digression joue le rôle de préparation à la cause. En
premier lieu, elle combat un préjugé dangereux pour l'Hécyre,
à savoir, qu'une pièce est mauvaise dès l'instant qu'elle a
subi un échec. Les premières comédies de Cécilius ou bien
échouèrent ou bien furent à grand peine jouées. Pourtant,
reprises par Ambivius, elles finirent par être applaudies. La
cause de leur mauvaise fortune passée n'était pas en elles-mêmes
; elle était dans les caprices du sort : des cabales
avaient étouffé leur voix ; dès qu'elles purent se faire entendre,
elles plurent. Conclusion implicite : ce qui est arrivé
à plusieurs comédies de Cécilius a bien pu arriver à une
comédie de Térence. En second lieu, la digression fait valoir
l'autorité de celui qui va bientôt recommander l'Hécyre.
Connaisseur exercé, il n'a pas été dupe du hasard : il a su
apprécier à leur valeur les oeuvres malheureuses de Cécilius.
Ami dévoué, poursuivant avec des risques certains un succès
incertain, il les a courageusement reprises, il a rendu au
poète, sauvé par lui du désespoir, le goût et le zèle du
théâtre : il lui eût été bien moins malaisé de le dédaigner
et de le rebuter. En définitive, dans cette lutte contre la
mauvaise chance, il a eu le dessus, il avait raison. Conclusion
implicite : il pourrait bien en être de même dans le
cas de l'Hécyre.
Après cette savante manoeuvre préliminaire, il engage le combat : il énonce l'objet de son discours, la proposition :
c'est de l'Hécyre qu'il s'agit ; il va la rejouer; il faut que
l'intelligence des spectateurs, secondant le zèle des acteurs,
fasse raison à la pièce des injustices du sort. La narration
qui vient ensuite (1), sans blesser le public, lui montre qu'il
n'a pas traité l'Hécyre comme il convenait, qu'elle a deux
fois échoué par son malheur et non par sa faute.
(1) Térence a-t-il poussé ici l'habileté oratoire jusqu'au mensonge et faut-il chercher la véritable raison du double échec de l'Hécyre dans le manque d'intérêt de la pièce ? Mais elle n'est pas acceptable. D'abord, on ne pourrait mettre en cause que le manque d'intérêt de l'exposition, puisque l'exposition seule put être jouée, et seulement à la seconde fois ; or, franchement, elle n'est ni plus ni moins intéressante que celle des autres pièces. Ensuite, il faudrait attribuer à Térence une maladresse et une impudence insignes, pour admettre qu'il ait essayé d'en imposer à des spectateurs dont la plupart assistaient aux deux échecs, et de leur faire accroire qu'ils avaient dédaigné la pièce, parce qu'ils avaient été attirés par d'autres spectacles, et non parce qu'elle ne leur plaisait pas.
Le jour
de la première représentation, dès le commencement il y
eut désordre dans le théâtre : des athlètes et un acrobate,
dont on attendait l'exhibition avec impatience, en furent le
motif ; la pièce n'y fut pour rien. Et ce désordre eut pour
agents les esclaves et les femmes ; il n'est pas dit que les
hommes libres s'y soient mêlés. Voilà donc, d'une part, la
responsabilité de l'Hécyre dégagée, de l'autre, toute la partie
sérieuse et influente du public mise hors de cause. Ambivius
comprit que l'occasion était venue de se conformer à son
ancienne habitude : il assimila le sort de l'Hécyre à celui
des premières pièces de Cécilius. Reprise de l'Hécyre ; tout
va bien au début : on écoute avec plaisir. Mais le bruit se
répand qu'un combat de gladiateurs se prépare. Tumulte
général : chacun se hâte d'aller prendre sa place, et la représentation
est interrompue. Ce second échec n'est pas plus
imputable à la pièce que le premier ; mais cette fois Ambivius
n'essaie pas d'innocenter une partie du public ; sans
formuler un mot de reproche, il montre que tout le monde
a pris part au tumulte. Cette constatation n'était pas de
nature à choquer le public : entre une pièce de théâtre,
fût-elle excellente, et un combat de gladiateurs, un vrai Romain
ne pouvait hésiter : ils avaient agi en vrais Romains
et n'avaient pas à rougir de leur choix. L'histoire de l'Hécyre,
telle que la raconte Ambivius, prouve donc qu'il serait
injuste de lui faire mauvais accueil en raison de ses deux
échecs. La péroraison, longue et pressante, sollicite le public à
sauvegarder, en assurant le succès de l'Hécyre et l'avenir de
Térence, les intérêts du théâtre : ainsi l'orateur amplifie la
cause de son client : ce n'est pas le sort d'une pièce, affaire
minime et personnelle, qui est en question ; c'est le sort des
jeux scéniques, affaire importante et générale. Il rend ensuite
cette cause chère à ses auditeurs en l'associant à la
sienne : qu'une vie de dévouement et de désintéressement
lui vaille la faveur de dérober un innocent à la condamnation
et à ses conséquences, qu'il exagère avec intention ;
qu'on n'oublie pas, enfin, que l'activité de la production
dramatique est dans un rapport intime avec les intérêts
matériels de l'orateur.
Cette entente parfaite des exigences du moment, que nous
avons rencontrée partout dans les prologues de Térence,
unie à la connaissance des règles générales de la disposition
oratoire, est plus frappante ici que partout ailleurs. Ici Térence
a combiné, a concentré les artifices les plus efficaces
et les plus savants de tous ses autres prologues : l'exorde
insinuant des prologues de l'Andrienne et de l'Eunuque,
la digression servant de préparation à la cause, du prologue
de l'Eunuque, la narration jouant le rôle de confirmation,
du prologue des Adelphes, enfin la péroraison abondante du
prologue de l'Heautontimorumenos, où l'orateur cher au
public demande le succès de son client comme une faveur
personnelle.
III
Il est un mérite de l'élocution oratoire, qui les domine
et les résume tous : la convenance. Le style d'un plaidoyer
est irréprochable, s'il est approprié à la nature de la cause,
à la personne de l'avocat, à celles des juges, aux circonstances
où le discours est prononcé.
Les causes plaidées dans les prologues de notre poète
sont de petite importance, sinon pour l'intéressé, du moins
pour ses auditeurs, ce qui est l'essentiel. Il s'agit du sort
d'une comédie, de l'avenir d'un poète : la question n'est pas
de celles que le vieux peuple romain regarde comme capitales.
De même qu'il ne saurait viser au pathétique, Térence
doit aussi renoncer aux ornements les plus brillants
du style oratoire. Il ne doit pas cependant les exclure tous,
car ce sont des plaidoyers qu'il écrit ; il veut qu'on prenne
ses prologues au sérieux. Pour qu'ils produisent cette impression,
il est nécessaire qu'il y ait quelque chose d'oratoire
dans leur physionomie. Ce n'est pas le poète qui présente
lui-même sa défense ; car s'il diffère des logographes
grecs en ce sens qu'il écrit des discours pour soi, et non
pour autrui, il leur ressemble en ce sens qu'il ne prononce
pas lui-même les discours qu'il écrit. Comme les logographes,
il faut qu'il accommode son style à la condition
d'un autre que lui, de l'orateur. Or, son avocat ordinaire
Prologus et son avocat extraordinaire Ambivius sont des
histrions ; pour que leur langage soit naturel, en rapport
avec leur profession, il convient qu'il soit familier et se rapproche
du langage de la conversation populaire. L'auditoire
est composé d'une infime minorité de lettrés, d'une énorme
majorité de gens du peuple sans culture. Or Térence, sachant
bien que l'opinion du plus grand nombre fait la loi
au théâtre, parle pour être entendu de tous les spectateurs
et ne dédaigne aucun suffrage, moins délicat à cet égard que la fameuse actrice de mimes Arbuscula, à qui suffisaient,
disait-elle, les applaudissements des chevaliers. Il faut
donc qu'il se mette au niveau des moins cultivés et, pour
cette raison encore, que son langage soit voisin de celui de
la conversation populaire. Il doit tenir compte enfin des
dispositions que les circonstances font naître dans l'esprit
des auditeurs. Ils sont au théâtre, réunis pour écouter des
comédiens, et non au forum, pour écouter un orateur. Au
risque de les choquer, il faut que le prologue-plaidoyer ne
soit pas trop en désaccord par sa forme avec le lieu et le
temps. De toutes ces considérations il résulte que le style
des prologues devait ètre une sorte de compromis entre le
style comique, image du langage de la conversation, et le
style oratoire. C'est en effet ce mélange que notre poète,
appréciateur subtil de la convenance, a savamment réalisé.
Le langage de Prologus et d'Ambivius a d'abord en
commun avec celui des avocats plusieurs termes empruntés
au vocabulaire juridique, ceux que nous avons énumérés au
début de ce chapitre et quelques autres. Mais il s'en rapproche
surtout par un emploi des figures de rhétorique,
trop frappant pour être fortuit, comme il arrive dans la conversation,
et non étudié. Ce n'est pas principalement des
figures de pensée que je veux parler. La plupart de celles
que l'on rencontre dans les prologues ne méritent pas d'être
signalées ; elles ne se distinguent pas sensiblement de celles
dont le langage quotidien est émaillé. Il y en a pourtant
quelques-unes qui ont un caractère oratoire plus accentué :
l'énumération accumulative avec gradation, par laquelle,
dans le prologue de l'Eunuque, le poète s'efforce d'établir
qu'il a eu le droit d'user de personnages déjà vus sur la
scène romaine; la communication, ou acte de confiance, qui
sert d'exorde au prologue des Adelphes ; la périphrase
« malivolus vetus poeta », sous laquelle est habilement
dérobé le nom de l'adversaire ; l'allusion discrète à l'échec de l'Hécyre, qui termine le prologue du Phormion ; les
euphémismes qui remplacent le mot propre et brutal, dans
les deux prologues de l'Hécyre, en parlant du double échec.
Les hyperboles que commet Térence en appelant son rival
« insanus », en faisant dire à Ambivius que, toute sa vie,
le vieil acteur s'est dévoué aux intérêts du public, « commodis », alors que le mot exact serait « voluptatibus », aux
plaisirs; enfin cette figure, qui est une sorte d'éthopée et qui
consiste à donner une mauvaise opinion de l'adversaire en
citant de lui, avec un acte de grossièreté, une insipide
plaisanterie.
Mais en somme Térence n'a fait qu'un usage très discret
des figures de pensée, et parmi celles-ci il a choisi surtout
les figures convenables à la preuve, sentant bien que les
figures de passion et d'ornement ne conviennent guère qu'à
la grande éloquence.
Au contraire, il a largement usé des figures de mots,
spécialement de celles que les rhéteurs ont appelées figures
de diction. Les tropes et figures de grammaire qu'il emploie
sont plutôt empruntés au langage de la conversation ;
mais les figures de diction ont bien le caractère oratoire. Ce
sont d'abord des variétés multiples de la répétition : la plupart de celles que la subtilité des rhéteurs a distinguées se
trouvent représentées dans les prologues. Il y a l'antistrophe
ou conversion : deux membres de phrase se terminant par
le même mot,
l'anadiplose ou réduplication : un membre de phrase commençant
par le mot qui termine le précédent,
l'antanaclase ou répétition d'un même mot dans une situation
identique à celle-là, mais avec deux sens différents,
la polyptote : le même mot revenant plusieurs fois dans la
phrase sous différentes formes grammaticales..
Je ne prétends pas avoir cité tous les cas de répétition qui
ornent les prologues : je n'ai donné que quelques exemples ;
pour être complet, il faudrait reproduire ici presque la
moitié du texte. A côté des répétitions, il y a les paronomases,
très nombreuses aussi, c'est-à-dire, l'emploi calculé,
dans une phrase, de deux ou plusieurs mots, ayant un
son semblable, sans avoir même sens, composés le plus
souvent du même simple, ou dérivés de la même racine : et beaucoup d'autres. Avec la paronomase nous touchons
à l'allitération, nous sommes sur les confins du style oratoire
et du style comique. Signalons en dernier lieu le
chiasmus, ou construction en croix, dont le prologue du
Phormion fournit à lui seul plusieurs exemples.
Sans doute ces figures ne sont pas exclusivement propres
aux prologues ; on les retrouve en général dans les comédies,
mais beaucoup plus rarement. Térence les a prodiguées
dans les prologues, parce que, sans leur communiquer un éclat
et une grandeur qui n'eussent pas été de mise, elles leur
donnaient un aspect oratoire très manifeste. Ajoutons à ces
caractères du style ceux de la disposition, dont nous avons
parlé plus haut, et nous aurons la somme des moyens que
Térence mit en oeuvre pour faire de ses prologues des plaidoyers
par la forme, comme ils en étaient par le fond.
Cependant le style des prologues a une évidente parenté
avec celui des comédies. Le fond du vocabulaire est
le même : à part quelques termes juridiques dont nous
avons parlé et d'autres termes, un peu plus nombreux, forcément
empruntés à la langue technique du théâtre, on n'y
trouve que les mots et les façons de parler du langage
quotidien. Les images sont également populaires. Ça et là une pensée à tournure proverbiale.
Ajoutons à tout cela plusieurs particularités de construction,
qui sentent aussi le langage familier : la suppression
très fréquente des pronoms sujets et régimes, l'ellipse d'autres mots faciles à suppléer, comme « fabula»
dans les vers: Quam non acturi sumus,
Menandri Eunuchum.... (Fun. pr. 19 sq).
Eam nos acturi sumus novam....; (Ad.pr. 12).
comme l'infinitif « esse, » dans une foule de cas ; la syllepse
du prologue de l'Andrienne, où, après avoir annoncé qu'il va
répondre aux calomnies du vieux poète malveillant, Térence
continue :
" Nunc quam rem vitio dent, quaeso, animum attendite". Toutes ces négligences voulues, et quelques autres que
j'oublie peut-être, contribuent à donner une allure familière
au style des prologues. Enfin on y relève de nombreuses
allitérations, ou répétitions de la même lettre, parfois
de la même syllabe, dans deux, dans plusieurs mots
qui se suivent.
La proportion de ces paronomases grossières, chères aux
vieux poètes romains, innombrables dans Plaute, mais dont
Térence n'a pas abusé, est beaucoup plus élevée dans ses
prologues que dans ses comédies. Il a cherché, cela est
visible, à se faire pardonner la sévérité du fond en semant
à pleines mains cet agrément qui n'était pas, pour la foule,
l'un des moindres charmes du style comique. En somme, le
langage des prologues est un composé, fait avec beaucoup
d'art, d'éléments oratoires et d'éléments populaires : c'est
le langage d'un orateur à qui toutes les convenances imposent
la simplicité, et à la fois le langage d'un acteur qui
descend à la familiarité, sans s'abaisser à la grossièreté du
parler vulgaire. Les prologues de Térence sont des modèles de plaidoyer
littéraire, dans les dimensions étroites qui lui furent aussi
imposées par les convenances. Mais ils ne sont pas le produit
de la nature seule, de l'habileté innée d'un homme
intelligent stimulé par le besoin. Ils sont trop savants dans
la disposition et l'élocution, pour qu'on ne soit pas obligé
d'y reconnattre l'art et même l'artifice. Sûrement, la rhétorique
grecque fit partie de cette éducation libérale que
Térence reçut par les soins de son maître. Vers l'époque où
Caton, l'adversaire implacable de la civilisation grecque,
jugeait à propos de faire pour son fils un manuel d'art
oratoire, est-il surprenant qu'un jeune homme élevé dans
un milieu autrement accessible à l'influence étrangère, que
l'ami de Lélius le Sage, ait été initié par ses professeurs,
des Grecs sans doute, aux secrets de la rhétorique ?
Il n'y a rien à dire de la métrique des prologues. Ils
sont tous écrits en vers iambiques sénaires, et la manière
dont Térence traite ce vers dans les prologues est absolument
celle que les spécialistes ont étudiée et définie dans
les comédies. En l'adoptant, Térence ne fit que se conformer
à la tradition. Nous voyons, en effet, que tous les
prologues de Plaute sont écrits en iambiques sénaires. Le
même vers paraît avoir été de règle chez les comiques
grecs. Il domine aussi dans les expositions des tragiques.
Puisqu'il était le mètre du dialogue tranquille, on conçoit
qu'il ait été généralement employé au début du drame, d'où
l'animation et la passion sont le plus souvent absentes.
Il me semble que cette étude a pour résultat général de
modifier l'opinion commune sur Térence, en donnant tout le
relief qu'ils méritent à deux traits jusqu'ici trop peu remarqués
de sa personnalité : la hardiesse et l'habileté pratique.
Sans doute Térence, comme les autres poètes de la fabula
palliata, n'est qu'un traducteur des comiques grecs. Il s'est
mème plus fidèlement attaché aux modèles que les plus
connus d'entre ses devanciers. En dehors de la contamination,
il ne s'est permis de changements, de suppressions,
d'additions que pour des détails. La contamination elle-mème,
procédé par lequel l'auteur latin enrichissait son original
principal d'éléments empruntés à un original secondaire,
et non d'inventions personnelles, notre poète n'en
est pas le créateur : ses aînés s'en étaient servis, avec moins
d'art probablement. L'art, voilà en effet, le caractère distinctif
de Térence, non seulement en ce point particulier,
mais d'une façon générale, comme on le reconnaissait déjà
au temps d'Horace, dans son imitation des Grecs ; voilà le
mérite éminent qui en rachète l'infériorité sous le rapport
de l'indépendance et de la verve.
Mais, si Térence a fidèlement imité les Grecs dans ses
comédies, il s'est séparé d'eux, il s'est séparé aussi de ses
prédécesseurs, dans ses prologues, où il s'est révélé novateur
hardi. On peut dire que le prologue, dans tout le cours de son
existence, féconde pourtant en vicissitudes, n'avait jamais
subi d'un seul coup une transformation aussi considérable.
Les monologues initiaux d'Euripide et des poètes de la nouvelle
comédie, récités tantôt par un personnage de la pièce, tantôt par une divinité, avaient ménagé le passage du prologue,
véritable et naturelle exposition du drame, tel qu'on
le trouve dans Sophocle, au prologue à argumentum des
vieux comiques romains, introduction distincte de l'exposition
et en dehors du drame. Mais de ce prologue à argumentum au prologue-plaidoyer de Térence il n'y a pas de
transition, il y a un saut brusque, une subite métamorphose.
Ce coup d'audace fut un coup de maître. Pour repousser
les attaques de ses calomniateurs, Térence avait trouvé
d'emblée l'arme la plus efficace. Qu'il y avait loin de ces
réponses venant à l'heure la plus opportune, à l'instant où
le sort de l'oeuvre et du poète incriminés allait se décider,
entendues de tous ceux dont les bonnes dispositions importaient
au poète, du public tout entier, aux réponses que
Térence aurait pu faire dans les entretiens de la vie quotidienne,
connues d'un nombre toujours restreint de personnes,
malgré le zèle officieux des amis, discutées et
affaiblies, sinon mises à néant, par les ennemis avant le
moment décisif ! Voilà pourtant à quoi en étaient réduits,
depuis longtemps, les poètes calomniés comme lui, Cécilius
par exemple. Car depuis Aristophane aucun auteur
dramatique n'avait disposé d'un tel moyen de publicité.
Aristophane, d'ailleurs, n'eut qu'à se servir de la parabase,
héritage de ses devanciers ; Térence dut inventer le prologue-plaidoyer. A ce prologue on peut comparer, dans les
temps modernes, la préface : quand Racine publia Britannicus,
il répondit en tète de la pièce aux critiques dont elle
avait été l'objet, non sans faire allusion aux réponses semblables,
aux prologues de Térence. Mais Térence avait sur
Racine, et le prologue-plaidoyer sur la préface, le double
avantage de l'opportunité et de la publicité, que nous signalions
tout à l'heure.
L'habileté de Térence se marque aussi dans la façon
prudente dont fut opérée la transformation. Du prologue
que lui léguaient ses devanciers il ne répudia pas tout absolument;
il garda tout ce qui pouvait se concilier avec le nouvel état des choses. Le costume traditionnel fut toujours
maintenu, le personnage attitré ne fut remplacé que par
exception, et son suppléant ne parut ni à la première ni à
la seconde occasion, mais seulement à la troisième. Chaque
fois que Prologus eut à se montrer, le rôle fut interprété,
selon la coutume, par un jeune histrion. Cette adoption
partielle de l'usage établi n'était pas seulement commode
pour Térence, qu'elle dispensait de créer du nouveau, là
où il n'y avait pas nécessité ; elle lui était aussi et surtout
avantageuse : elle dissimulait autant que possible l'innovation;
elle en atténuait les risques. Or, ces risques étaient
réels avec un public à esprit éminemment conservateur,
qui d'ailleurs perdait au changement, si le poète y gagnait.
Térence eut l'heureuse précaution, en transformant l'intérieur,
l'essentiel, de laisser subsister l'extérieur, qui n'était
que l'accessoire, mais dont la soudaine et complète disparition
aurait choqué davantage les spectateurs.
Cela ne l'empècha pas de donner au personnage, qu'il
faisait paraître avec son nom et son costume traditionnels,
un caractère et un langage conformes à ses nouvelles fonctions,
de changer en orateur le narrateur Prologus : au
premier coup d'oeil il semblait le mème, mais la réflexion
le découvrait tout autre. Cette transformationdu personnage
en prépara une autre plus radicale : la substitution d'Ambivius
à Prologus. Choisir pour avocat, dans des circonstances
particulièrement difficiles, le vieux comédien populaire,
c'était le fait d'un esprit ingénieusement pratique ;
c'était aussi le fait d'un esprit hardi, de rompre sur un point
essentiel avec la tradition : le personnage du prologue avait
été jusque-là une fiction ou une demi-fiction, une individualité
indépendante de celle de l'acteur. Ambivius est la réalité
pure : le personnage et l'acteur se confondent. De prime
abord Térence s'était fait une arme du prologue : il la perfectionna
avec le temps.
L'ayant créée et perfectionnée, il la mania avec une merveilleuse adresse. Sa polémique contre Luscius est d'une grande habileté. Presque toujours il a pour lui, il est vrai,
la bonté de sa cause : la contamination, qu'on lui reproche
comme une atteinte grave à l'unité des originaux grecs, est
un procédé de composition très légitime, qui, sans gâter le
modèle, donne à la copie un surcroît de qualités ; il n'a pas
commis les plagiats qu'on lui impute ; nul autre que lui n'a
mis la main à ses oeuvres, quoiqu'on l'accuse d'avoir des
collaborateurs clandestins ; un seul grief est juste : celui
qui a trait aux faiblesses de son style. Mais il a contre lui
l'ignorance des juges, qui le prive le plus souvent de ses
meilleurs moyens de défense. Comme d'autres poètes qui
ont été en butte avant lui à la jalousie et la malignité de
leurs contemporains, il pourrait, à la rigueur, opposer aux
calomnies le mépris et le silence. Il préfère soutenir la
lutte, malgré ses difficultés ; il se sent assez habile pour se
tirer d'affaire. Et il s'en tire fort bien ; il satisfait à toutes
les exigences de sa situation. Ses plaidoyers sont courts :
le public n'aura pas le temps de se lasser et de murmurer ;
ils sont clairs : le moins lettré des spectateurs comprendra
de quoi il s'agit et comment le poète se disculpe ; ils sont
persuasifs : ils tiennent compte et tirent parti des idées,
des sentiments, des préjugés de l'auditoire : la sympathie,
s'ajoutant à la conviction, achèvera d'assurer le gain de la
cause ; enfin le ton est savamment accommodé aux circonstances
: Térence n'a pas perdu de vue que ses plaidoyers
seraient prononcés au théâtre ; et les spectateurs lui en sauront
gré ; mais il s'est arrangé aussi pour que, de leur part,
ils ne perdent pas de vue qu'ils ont à jouer le rôle de tribunal.
Si l'on ne considère que l'art oratoire, l'habileté de
Térence est absolument remarquable ; mais si on veut la
juger en moraliste, elle n'est pas toujours irréprochable ;
elle manque de scrupule, elle n'a pas le respect de la franchise
et de la loyauté. Le poète, dans sa polémique, se montre
pratique jusqu'au point de ne pas reculer devant le
sophisme et le mensonge.
Que les circonstances aient contribué à développer chez notre poète cette hardiesse et cette habileté dont nous venons
de résumer les traits, que les attaques de Luscius aient
puissamment influé sur le tempérament de Térence, on ne
saurait le nier ; mais il est évident que la nature ne lui avait
pas donné l'âme d'un irrésolu et d'un naïf.
