





 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
Lettres de Pline le Jeune
traduction :de Sacy et de J. Pierrot
Garnier Frères éditeurs 1920
LIVRE PREMIER. Retour
I. - Pline à Septicius.
Vous m'avez souvent engagé à réunir à publier les lettres que j'ai écrites avec quelque soin. Je les ai recueillies sans avoir égard aux dates, car il ne s'agit pas de composer une histoire : je les ai disposées dans l'ordre où elles se sont trouvées sous ma main. Je souhaite que nous ne nous repentions pas, vous de votre conseil, moi de ma condescendance. Je me verrai donc obligé de rechercher les lettres que j'avais négligées jusqu'ici, et de conserver celles que je puis ajouter aux premières. Adieu.
II. - Pline à Arrien.
Comme je prévois que vous ne reviendrez pas de longtemps, je vous envoie l'ouvrage que mes dernières lettres vous avaient annonce. Lisez-le, je vous prie, et, selon votre coutume, n'épargnez pas les corrections ; d'autant plus, que je crois n'avoir jamais fait tant d'efforts pour lutter avec les grands modèles. J'ai essayé d'imiter Démosthène, dont vous avez toujours fait vos délices, et Calvus, dont je fais depuis peu les miennes. Quand je dis imiter, je parle seulement de la tournure du style car, pour atteindre au génie de ces grands hommes, il faut compter parmi les favoris des dieux.
Mon sujet, soit dit sans amour-propre, secondait mon ambition ; il exigeait une véhémence de diction presque continuelle qui réveillait, ma longue paresse, si toutefois elle peut être réveillée. Cependant je n'ai pas entièrement dédaigné les fleurs de notre Cicéron, toutes les fois que j'ai pu en cueillir sans trop m'écarter de mon chemin. Je cherchais la force, mais sans renoncer à la grâce.
N'allez pas croire que, sous ce prétexte, je veuille désarmer votre critique. Au contraire, pour la rendre encore plus sévère, sachez que mes amis et moi nous ne sommes pas éloignés de l'idée de publier cet ouvrage, pour peu que vous approuviez notre folie. Il faut bien que je publie quelque chose. Et pourquoi ne pas donner la préférence à ce qui est tout prêt? Tel est le vœu de ma paresse. Quant aux motifs qui me déterminent à faire paraître un ouvrage, j'en ai plusieurs. Le principal, c'est qu'on m'assure que mes derniers écrits sont encore entre les mains de tout Je monde, quoiqu'ils aient perdu le charme de la nouveauté. Peut-être les libraires nous flattent-ils. Mais laissons-les nous flatter, si leurs mensonges nous rendent nos études, plus chères. Adieu.
III.- Pline à Caninius Rufus.
Que devient Côme, vos délices et les miennes? que devient cette charmante maison du faubourg, et ce portique où règne un printemps éternel ? et cet impénétrable ombrage de platanes? et ce canal, bordé de verdure et de fleurs ? et ce bassin destiné à en recevoir les eaux ? et cette promenade à la fois si douce et si ferme ? et ces bains que le soleil inonde et enveloppe de ses rayons? et ces salles à manger où vous recevez tant de monde? et ces autres cabinets où vous en admettez si peu? et ces appartement de jour et de nuit? Ces lieux enchanteurs vous retiennent-ils et vous possèdent-ils tour à tour ? ou bien le soin de vos affaires domestiques vous force-t-il , comme de coutume, à de fréquentes excursions? Si vous jouissez de tous ces biens, vous êtes le plus heureux des mortels sinon, vous n'êtes qu'un homme vulgaire.
Que ne confiez-vous à d'autres, il en est temps, les occupations viles et abjectes, pour vous livrer tout entier, à l'étude dans cette paisible et délicieuse retraite? Que ce soient là vos affaires et votre repos, votre travail et vos délassements. Consacrez aux lettres vos veilles, votre sommeil même. Créez-vous, assurez-vous un bien que le temps ne puisse vous ôter. Toutes les autres propriétés, après vous, changeront mille fois de maîtres mais vos œuvres littéraires ne cesseront jamais de vous appartenir. Je sais à quelle intelligence et à quel esprit je m'adresse. Tâchez seulement d'avoir pour vous l'estime que vous témoignera le public, si vous commencez par vous rendre justice à vous-même. Adieu
IV.— Pline à Pompéia Célérina.
Quelle abondance dans vos villas d'Otricoli, de Narni, d'Ascoli, de Pérouse ! quel bain commode à Narni ! Je n'ai plus besoin de vos lettres pour connaître tout cela. La lettre que je vous écrivis il y a déjà quelque temps, quoique fort courte, en est une preuve. Certes, mon bien n'est pas plus à moi que le vôtre. J'y vois pourtant une différence : vos gens me servent avec plus d'attention et d'empressement chez vous, que les miens chez moi. Peut-être aurez-vous la même chance dans les maisons qui m'appartiennent, si vous y descendez. Courez-en le risque, d'abord pour user de mon bien, comme j'use du vôtre, ensuite pour réveiller enfin l'assoupissement de mes valets qui m'attendent toujours avec une apathie voisine de la négligence. Tel est le sort des maîtres indulgents, leurs domestiques s'habituent à n'en avoir point peur. Les nouveaux objets raniment leur zèle, et ils aiment mieux plaire à leurs maîtres par le suffrage d'autrui que par leurs services personnels. Adieu.

V. — Pline à Voconius Romanus.
Vites-vous jamais, depuis la mort de Domitien, un homme plus lâche et plus rampant que Régulus, dont les crimes, quoique cachés, n'étaient pas moindres sous le règne de ce prince que sous celui de Néron? Il s'est avisé de craindre que je n'eusse du ressentiment contre lui. Il n'avait pas tort, je lui en voulais. Non content d'avoir fomenté la persécution exercée contre Rusticus Arulénus, il avait triomphé de sa mort, jusqu'à lire en public et à répandre un libelle, où il le traite de singe des stoïciens, et d'homme qui porte les stigmates de Vitellius. Vous reconnaissez là l'éloquence de Régulus. Il déchire avec tant d'emportement Hérennius Sénécion, que Métius Carus n'a pu s'empêcher de lui dire : Quel droit avez-vous sur mes morts? Me voit-on remuer les cendres de Crassus ou de Camérinus? C'étaient des personnages que, du temps de Néron, Régulus avait accusés. Persuadé que j'étais indigné de toutes ces horreurs, il ne m'invita point quand il lut son ouvrage en public.
Il se souvenait d'ailleurs qu'il m'avait exposé à un danger capital devant les centumvirs. Je parlais, à la recommandation de Rusticus Arulénus, pour Arionilla, femme de Timon, et j'avais Régulus contre moi. Je fondais en partie mon droit, sur une opinion du vertueux Métius Modestus, alors exilé par Domitien. Régulus m'apostropha tout à coup ainsi : Pline, que pensez-vous de Modestus? Vous voyez quel péril je courais, si j'eusse rendu témoignage à la vérité et de quel opprobre je me couvrais, si je l'eusse trahie. Je dois le dire : les dieux m'inspirèrent dans cette circonstance. Je vous répondrai, lui dis-je, si c'est là la question que les centumvirs ont à juger. Il reprit : Je vous demande ce que vous pensez de Métius Modestus? Je lui répliquai que l'on ne demandait témoignage que contre des accusés, et non contre un homme condamné. Eh bien! continua-t-il je ne vous demande plus ce que vous pensez de Modestus, mais quelle opinion avez-vous de son attachement pour le prince? - Vous voulez, dis-je, savoir ce que j'en pense mais moi, je crois qu'il n'est pas même permis de mettre en question ce qui est une fois jugé. Il se tut. Les éloges et les applaudissements suivirent cette réponse qui, sans blesser ma réputation par une flatterie, utile peut-être, mais contraire à l'honneur, me tira d'un piège si artificieusement tendu.
Aujourd'hui Régulus, troublé par ses remords, s'adresse à Cécilius Celer, et ensuite à Fabius Justus ; il les prie de le réconcilier avec moi. Il ne s'en tient pas là. Il court chez Spurinna et, comme il est le plus abject de tous les hommes lorsqu'il a peur, il le supplie humblement de me venir voir le lendemain matin, mais de grand matin : Je ne puis plus longtemps vivre, dit-il, dans l'inquiétude où je suis. Obtenez de lui, à quelque prix que ce soit, qu'il ne m'en veuille pas. J'étais à peine éveillé, qu'un messager vint me prier, de la part de Spurinna, de vouloir bien, l'attendre. Je lui fais répondre que je vais le trouver et, comme nous allions l'un au-devant de l'autre, nous nous rencontrons sous le portique de Livie. Il m'expose le sujet de sa mission. Il joint ses instances à celles de Régulus, mais avec la modération qui convenait à un honnête homme, sollicitant pour un personnage qui lui ressemblait si peu. Vous verrez vous-même, lui dis-je, ce qu'il faut répondre à Régulus. Je ne veux point vous tromper : j'attends Mauricus (car il n'était pas encore revenu de son exil), je ne puis donc vous donner aucune parole certaine, je ferai ce qu'il vaudra. C'est à lui de me guider en tout ceci, et c'est à moi de suivre ses avis.
Peu de jours après, Régulus vint me trouver dans la salle du préteur. Là, après m'avoir suivi, il me tire à l'écart, et il m'avoue qu'il craignait que je ne me souvinsse toujours des paroles qui lui étaient échappées un jour au tribunal des centumvirs (il t'aidait contre Satrius et moi) : Satrius, avait-il dit, et cet orateur qui, dégoûté de l'éloquence de notre siècle, se pique d'imiter Cicéron... Je lui répondis que son aveu seul, m'ouvrait l'esprit, que jusqu'alors je n'y avais pas entendu malice, et qu'il avait pu donner un sens fort honorable à ses paroles. Je me pique en effet, poursuivis je, d'imiter Cicéron, et j'estime fort peu l'éloquence de notre temps. Je trouve ridicule, lorsqu'on se choisit des modèles, de ne pas prendre les meilleurs. Mais vous, lui dis-je, qui vous souvenez si bien de ce qui se passa dans cette cause, comment avez-vous oublié celle où vous me demandâtes ce que je pensais de l'attachement de Métius Modestus pour le prince? La pâleur ordinaire de Régulus augmenta sensiblement, et il me dit avec hésitation : Ce n'était pas à vous que je voulais nuire ; c'était à Métius Modestus. Remarquez la cruauté de cet homme qui ne craint pas d'avouer qu'il voulait nuire à un exilé ! Il ajouta, pour se justifier une raison excellente. Modestus avait écrit une lettre qui fut lue chez Domitien, et dans laquelle il disait : Régulus est le plus méchant des bipèdes. En effet, Modestus l'avait écrite. Notre conversation n'alla guère plus loin car je voulais me réserver la liberté entière d'agir comme il me plairait, quand Mauricus serait de retour. Ce n'est pas que j'ignore qu'il est difficile de perdre Régulus. Il est riche, il est intrigant ; bien des gens le courtisent, beaucoup plus encore le craignent et la crainte souvent a plus de pouvoir que l'amitié. Mais, après tout, il n'est rien que de violentes secousses ne puissent abattre. La fortune n'est pas plus fidèle aux scélérats qu'ils le sont à autrui. Au reste, je vous le répète, j'attends Mauricus. C'est un homme grave, prudent, instruit par une longue expérience, et qui saura lire l'avenir dans le passé. Ses conseils me fourniront des motifs, ou pour agir, ou pour demeurer en repos. J'ai cru devoir ce récit à l'amitié qui nous unit : elle ne me permet pas de vous laisser ignorer mes démarches, mes discours, ni même mes desseins. Adieu.
VI. — Pline à Tacite.
Vous allez rire : eh bien ! riez tant qu'il vous plaira. Ce Pline que vous connaissez, a pris trois sangliers, et des plus beaux. Quoi ! lui-même? oui, lui-même. N'allez pourtant pas croire qu'il en ait coûté beaucoup à mon repos et à ma paresse. J'étais assis près des toiles : ni épieu ni dard sous ma main ; rien qu'un poinçon et des tablettes. Je rêvais, j'écrivais, et je me préparais la consolation de remporter mes pages pleines, si je m'en retournais les mains vides. Ne dédaignez pas cette manière d'étudier. Vous ne sauriez croire, combien le mouvement du corps donne de vivacité à l'esprit sans compter que l'ombre des forêts, la solitude, et ce profond silence qu'exige la chasse, sont très propres à nous inspirer. Ainsi, croyez-moi, quand vous voudrez vous livrer à cet exercice, portez votre pannetière et votre bouteille mais n'oubliez pas vos tablettes. Vous éprouverez que Minerve ne se plaît pas moins que Diane sur les montagnes. Adieu.
VII. — Pline à Octavius Rufus.
Savez-vous que vous me placez bien haut, et que vous me donnez autant de pouvoir et d'empire qu'Homère en accorde au grand Jupiter,
Ce dieu qui n'accomplit qu'une part de nos vœux.
Car je puis, comme Jupiter, répondre à vos désirs, en accueillant l'un et en rejetant l'autre. S'il m'est permis, pour vous complaire, de refuser mon ministère aux habitants de la Bétique contre un homme qu'ils accusent, la loyauté et la constance de principes que vous chérissez en moi, ne m'interdisent pas moins de prendre la défense de cet homme contre une province que je me suis attachée au prix de tant de services, de travaux, et même de dangers. Je prendrai donc un terme moyen, et, de deux choses que vous me demandez, je vous accorderai celle qui, en satisfaisant vos désirs, ne nuira, pas à l'estime dont vous m'honorez. Car je dois moins considérer ce que veut aujourd'hui un homme de votre caractère, que ce qu'il approuvera toujours. J'espère me rendre à Rome vers les ides d'octobre. J'y réitérerai à Gallus en personne la promesse que je vous fais, et je lui engagerai ma parole et la votre. Vous pouvez d'avance lui répondre de moi.
Il dit, et Jupiter abaissa ses sourcils.
Pourquoi ne vous citerais-je pas toujours les vers d'Homère, puisque vous ne voulez pas que je cite les vôtres? Je les attends avec une si grande impatience, qu'un tel salaire serait peut-être le seul attrait qui pût me séduire, et me faire plaider même contre les habitants de la Bétique. J'allais oublier quelque chose qui mérite pourtant bien qu'on en parle. J'ai reçu vos dattes : elles sont excellentes, et vont disputer le prix à vos figues et à vos morilles. Adieu.
VIII.— Pline à Pompéius Saturninus.
On m'a remis fort à propos votre lettre où vous me priez instamment de vous envoyer quelque ouvrage de ma façon : je me disposais précisément à vous en adresser un. C'est éperonner un cheval qui ne demande qu'à courir. Vous ôtez ainsi toute excuse à votre paresse, et tout scrupule à ma discrétion. J'aurais aussi mauvaise grâce de me croire importun, que vous de me traiter de fâcheux, quand je ne fais que répondre à votre impatience. Cependant n'attendez rien de nouveau d'un paresseux. Je veux vous demander de vouloir bien réviser encore le discours que j'ai prononcé dans ma ville natale, le jour où je fondai une bibliothèque. Je me souviens que vous m'avez fait déjà, sur cette pièce, quelques remarques générales. Je voudrais aujourd'hui que votre critique ne s'attachât pas seulement à l'ensemble, mais qu'elle relevât les moindres détails avec ce goût sévère que nous vous connaissons. Nous serons libres, après cet examen, de le publier ou de le garder. Peut-être même cette revue attentive aidera-t-elle notre détermination car, à force de revoir et de retoucher l'ouvrage, ou nous le condamnerons à l'obscurité, ou nous le rendrons digne de paraître.
Toutefois mon incertitude vient moins de la composition que du sujet. Ne m'expose-t-il point un peu au reproche d'ostentation et de vanité ? Quelque simple et réservé que soit mon style, il sera difficile que, contraint à parler de la libéralité de mes aïeux et de la mienne, je paraisse assez modeste. Le pas est dangereux et glissant, lors même que la nécessité nous y engage. Si les louanges que nous donnons aux autres ne sont déjà pas trop bien reçues, comment se promettre de faire passer celles que nous donnons à nous-mêmes ou à notre famille? La vertu, qui toute seule fait des envieux, nous en attire bien davantage, quand la gloire et les éloges l'accompagnent enfin on expose moins les belles actions à la censure et à la malignité en les laissant dans l'ombre et dans l'oubli. Plein de ces pensées, je me demande souvent si je dois avoir composé mon ouvrage, quel qu'il soit, pour le public ou seulement pour moi. La preuve que je dois avoir travaillé pour moi, c'est que les accessoires les plus nécessaires à une action de ce genre, ne conservent, après l'action, ni leur prix ni leur mérite.
Sans aller chercher bien loin des exemples, n'était-il pas très utile d'expliquer les motifs de ma munificence ? D'abord j'arrêtais mon esprit sur de nobles pensées ensuite une longue méditation m'en dévoilait mieux la beauté enfin je me précautionnais contre le repentir inséparable des largesses précipitées. C'était comme une occasion de m'exercer au mépris des richesses. Car, tandis que la nature enchaîne tous les hommes à la conservation de leurs biens, l'amour longuement raisonné d'une libéralité bien entendue m'affranchissait des vulgaires entraves de l'avarice. Il me semblait que ma générosité serait d'autant plus méritoire, que j'y étais entraîné, non par le caprice, mais par la réflexion. De plus, ce n'étaient pas des spectacles ou des combats de gladiateurs que je proposais, c'étaient des pensions annuelles qui assurassent des secours à des jeunes gens de bonne famille. On n'a pas besoin de recommander les plaisirs qui charment les yeux ou les oreilles. A cet égard, l'orateur doit moins exciter que contenir notre élan. Mais, pour engager quelqu'un à se charger des ennuyeuses et pénibles fonctions d'instituteur, il faut joindre aux récompenses des encouragements délicats. Les médecins essaient par des paroles flatteuses de tempérer la salutaire amertume de leurs remèdes. A combien plus forte raison, en faisant à mes concitoyens un présent d'une utilité incontestable, mais peu reconnue, fallait-il l'accompagner de toutes les grâces du discours, surtout quand il s'agissait de faire approuver, à ceux qui n'ont plus d'enfants, une institution qui n'est fondée qu'en faveur de ceux qui en ont, et d'inspirer à tous assez de patience pour attendre et pour mériter une distinction restreinte au petit nombre.
Mais si, à cette époque, en exposant le but et les avantages de notre établissement, j'étais plus occupé de l'utilité publique que de ma vanité, je crains aujourd'hui, en publiant ma harangue, de paraître plus occupé de ma gloire personnelle que des intérêts d'autrui. Je n'ai pas oublié qu'il y a plus de grandeur à chercher la récompense de la vertu dans sa conscience, que dans l'éclat de la renommée. La gloire doit être la conséquence, et non le motif de nos actions et, s'il arrive qu'elle nous échappe, ce qui l'a méritée ne perd rien de son prix. Relever le bien qu'on a fait, c'est donner lieu de penser que l'on ne s'en glorifie pas parce qu'on l'a fait, mais qu'on l'a fait pour s'en vanter. Ainsi notre action, magnifique dans la bouche d'autrui, n'est plus rien dans la nôtre. On s'en prend à la vanité, quand on ne peut anéantir ce qui est louable. Si donc nous ne faisons rien qui nous attire des éloges, on nous blâme, et si nous faisons quelque chose de bon, on ne nous pardonne pas de le dire.
J'ai encore un scrupule qui m'est personnel ; c'est que j'ai ha rangué, non en public, mais dans l'assemblée des décurions. Or, je crains qu'il soit peu convenable de briguer, par cette publication, les suffrages et les applaudissements de la multitude que j'ai évités en prononçant mon discours. Il s'agissait des intérêts du peuple, et j'avais mis entre lui et moi les murs du sénat, pour ne point avoir l'air de capter sa bienveillance. Mais aujourd'hui ne semblerai-je pas mendier par vanité l'approbation de ceux même qui n'ont d'autre intérêt à mon action que celui de l'exemple quelle donne ? Vous voilà instruit de tous mes doutes ; décidez. Je m'en rapporterai à votre avis. Adieu.
IX. — Pline à Minutius Fundanus.
Chose étonnante ! prenez à part, chacune des journées que l'on passe à Rome, vous vous rendrez compte, ou à peu près, de son emploi. Prenez-en plusieurs ou réunissez-les toutes, il en sera autrement. En effet, demandez à quelqu'un : « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? J'ai assisté, vous dira-t-il, à une prise de toge virile. J'ai été invité à des fiançailles ou à des noces. On m'a requis pour cacheter un testament. Celui-ci m'a chargé de sa cause ; celui-là m'a fait appeler à une consultation. » Chacune de ces occupations, le jour où l'on s'y est livré, a paru nécessaire, mais quand on vient à réfléchir que c'est ainsi que se sont écoulées toutes les journées, on les trouve vides, surtout dans la retraite. On se dit alors : « A quelles bagatelles ai-je perdu mon temps ! » C'est ce que je répète souvent dans ma villa de Laurente, où je lis, où je compose, où j'exerce mon corps dont la bonne disposition seconde les opérations de mon esprit. Je n'entends, je ne dis rien, que je me repente d'avoir entendu et d'avoir dit. Personne, devant moi, ne déchire autrui par de malins discours. Ma censure ne s'adresse qu'à moi-même, quand je suis mécontent de ce que j'écris. Point de désir, point de crainte qui m'inquiète, point de bruit qui me tourmente. Je ne m'entretiens qu'avec moi et avec mes livres. O l'agréable, ô la paisible vie! ô le délicieux loisir ! Qu'il est honorable, et préférable peut-être à tout emploi ! O mer, ô rivage, mes vrais musées solitaires, qui fécondez mon imagination, que de pensées ne m'inspirez-vous pas ! Fuyez donc, comme moi, le fracas et le vain mouvement de la ville ; renoncez à toutes ces occupations frivoles qui vous y attachent ; livrez-vous à l'étude ou au repos, et songez au mot si profond et si plaisant de notre cher Attilius : Il vaut mieux ne rien faire, que de faire des riens. Adieu.

X. —Pline à Atrius Clémens.
Si jamais les belles-lettres ont fleuri à Rome, c'est assurément, aujourd'hui. Je pourrais vous en citer beaucoup d'illustres exemples : vous en serez quitte pour un seul ; je ne vous parierai que du philosophe Euphrate. J'étais fort jeune quand je commençai à le connaître en Syrie, dans le service militaire. Admis chez lui, je l'étudiai à fond. Je tâchai de m'attirer son amitié, et je n'eus pas de peine à y parvenir. Il est affable, prévenant, et respire l'urbanité qu'il enseigne. Que je serais heureux, si j'avais répondu à l'idée qu'il avait conçue de moi, comme, de son côté, il a beaucoup ajouté à son mérite personnel ! Peut-être aujourd'hui ai-je plus d'admiration pour ses vertus, parce que je les connais mieux, quoique je ne les connaisse pas encore assez. S'il n'appartient qu'à un artiste de juger un peintre, un sculpteur, un statuaire, il faut, de même, posséder la sagesse pour apprécier un sage. Mais, autant que je puis m'y connaître, tant de rares qualités brillent dans Euphrate, qu'elles frappent et pénètrent les moins clairvoyants. Il a tout à la fois de la finesse, de la solidité et de la grâce dans la discussion, souvent même il reproduit le sublime et la majesté de Platon. Il règne dans ses discours une abondance, une variété qui enchantent, et surtout une douceur qui séduit et entraîne les plus rebelles. A ces qualités il joint une haute taille, un beau visage, une longue chevelure et une grande barbe blanche. Ces dehors, quelque vains et indifférents qu'ils paraissent, ajoutent singulièrement à la vénération qu'on a pour lui. Sa tenue est convenable ; son air est sérieux, sans être chagrin ; son abord inspire le respect, sans imprimer la crainte. Son extrême politesse égale la pureté de ses mœurs. Il fait la guerre aux vices, et non aux hommes. Il corrige l'erreur et ne la réprimande point. On est si charmé de l'entendre, qu'après même qu'il vous a persuadé, vous voudriez qu'il eût à vous persuader encore. Trois enfants composent sa famille. Il a deux fils qu'il élève avec le plus grand soin. Pompéius Juilanus, son beau-père, est recommandable par sa vie entière. Il s'est honoré surtout par le choix de son gendre, puisque, tenant le premier rang dans sa province, il a cependant choisi la vertu plutôt que la naissance et la fortune.
Mais pourquoi m'étendre davantage sur les louanges d'un ami dont il ne m'est plus permis de jouir. Ai-je donc peur de ne point sentir assez ma perte ? Enchaîné à un emploi aussi important que fâcheux, je passe ma vie à siéger sur un tribunal, à répondre à des requêtes, à faire des réglements, et à écrire une infinité de lettres qui ne sont rien moins que littéraires. Je m'en plains quelquefois à Euphrate (et encore combien est-il rare que j'aie ce plaisir !). Il essaie de me consoler, « C'est, dit-il, la plus noble fonction de la philosophie, que de mettre en œuvre les maximes des philosophes, que de prendre en main les intérêts publics, de connaître, d'apprécier, de faire éclater la justice et de la rendre. » Voilà le seul point où il ne me persuade pas. Je suis encore à comprendre que de semblables occupations puissent valoir le plaisir de passer tous les jours à l'entendre et à l'étudier. Aussi, je vous le répète, vous qui êtes libre, revenez promptement à Rome, et, dès que vous y serez, allez vous former et vous perfectionner à son école. Vous voyez que je ne ressemble pas à la plupart des hommes, qui envient aux autres les avantages dont ils sont privés. Au contraire, j'éprouve un sentiment de plaisir quand je vois mes amis regorger des biens dont je ne puis jouir. Adieu.
XI.- Pline à Fabius Justus.
Depuis longtemps vous ne me donnez point de vos nouvelles. « Je n'ai rien à vous écrire, » dites-vous. Eh bien ! écrivez-moi que vous n'avez rien à m'écrire, ou contentez-vous de me dire ce que nos ancêtres avaient coutume de mettre au commencement de leurs lettres : Si vous êtes en bonne santé, j'en suis charmé, pour moi, je me porte bien, C ela me suffit car c'est l'essentiel. Vous croyez que je badine ? non, je parle sérieusement. Mandez-moi ce que vous faites. Je souffre trop de ne pas le savoir. Adieu.
XII.. – Pline à Calestrius Tiron.
J'ai fait une perte cruelle, si ce terme est assez fort pour exprimer le malheur qui nous enlève un si grand homme. Corellius Rufus est mort et, ce qui m'accable davantage, il est mort de son plein gré. Cette manière de quitter la vie, dont on ne peut accuser la nature ni la fatalité, me semble là plus affligeante de toutes. Lorsque nos amis meurent de maladie, nous trouvons une grande consolation dans la nécessité qui frappe tous les hommes. Mais ceux, qui se livrent eux-mêmes à la mort, nous laissent l'éternel regret de penser qu'ils auraient pu vivre longtemps. Une raison suprême qui passe pour la nécessité aux yeux des sages, a entraîné Corellius Rufus dans son dessein, quoique bien des causes l'attachassent à la vie, une bonne conscience, une haute réputation, un crédit puissant, une épouse, une fille, un petit-fils, des sœurs, et, parmi tant d'objets d'affection, de véritables amis. Mais sa santé était depuis longtemps si délabrée, que les raisons de mourir l'emportèrent sur tant d'avantages qu'il trouvait à vivre. À trente-trois ans (il me l'a dit lui-même), il fut attaqué de la goutte aux pieds. Il l'avait héritée de son père car les maux, comme les autres choses, nous viennent souvent aussi par succession. Dans la force de la jeunesse, il triompha de cette maladie par la diète et par la chasteté. Lorsque, enfin, elle se fut accrue avec l'âge, il se soutint par son énergie. Sous Domitien, j'allai le voir dans sa maison, près de Rome. Il souffrait des tourments inouïs et des douleurs atroces. Le mal n'attaquait plus seulement ses pieds, il parcourait tout son corps. Ses valets se retirèrent, selon l'usage établi chez lui. Quand un ami intime entrait dans sa chambre, tout le monde en sortait, même sa femme, quoiqu'elle fût d'une discrétion à toute épreuve. Après avoir jeté les yeux autour de lui : Savez-vous bien, dit-il, pourquoi je m'obstine à supporter si longtemps mes tortures cruelles ? c'est pour survivre, ne fût-ce qu'un seul jour, à ce brigand et j'en aurais eu le plaisir, si mes forces n'eussent pas trahi mon courage.
Le ciel exauça pourtant ses vœux en lui permettant, de mourir enfin tranquille, et de rompre les liens nombreux, mais plus faibles, qui l'attachaient à la vie. Ses maux empirèrent. Il essaya de les adoucir par le régime. Ils continuèrent. Il s'en délivra par sa fermeté. Il y avait déjà quatre jours qu'il s'était abs tenu de nourriture, quand Hispulla, sa femme, envoya notre ami commun, C Géminius, m'apporter la triste nouvelle, que Corellius avait résolu de mourir, que les supplications de sa femme et de sa fille ne gagnaient rien sur lui, et que j'étais le seul qui pouvait le rattacher à la vie. J'y courus. J'arrivais, lorsque Julius Atticus, de nouveau dépêché vers moi par Hispulla, m'annonça que moi-même je n'obtiendrais rien : tant Corellius était endurci dans sa détermination. Il venait de répondre à son médecin qui lui présentait des aliments : Je l'ai résolu; parole qui me remplit tout, à la fois d'admiration et de douleur.
Je ne cesse de penser quel ami, quel homme j'ai perdu. Sans doute il avait passé soixante-sept ans, terme assez long, même pour les santés les plus robustes. Sans doute il est délivré des souffrances d'une maladie continuelle, et il laisse florissantes sa famille et la république, qui lui était plus chère que tous les siens. Cependant je le regrette comme s'il m'eût été ravi jeune et plein de santé. Dussiez-vous m'accuser de faiblesse, je le regrette pour moi-même. J'ai perdu, en effet, j'ai perdu le témoin, le guide, le modèle de ma vie. Vous ferai-je enfin un aveu que j'ai déjà fait à notre ami Calvisius, dans les premiers transports de ma douleur? je crains de trop m'y abandonner. Donnez-moi donc des consolations. Mais ne me dites pas : Il était vieux, il était souf frant ; j e sais cela. Il me faut d'autres motifs, des considérations plus puissantes, que je n'aie entendus, que je n'aie lus nulle part. Car tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, se présente naturellement à ma pensée, mais cède à une si grande douleur. Adieu
XIII. - Pline à Sosius Sénécion.
L'année a été fertile en poètes. Le mois d'avril n'a presque pas eu de jour où il ne se soit fait quelque lecture. J'aime à voir fleurir les lettres et les esprits se produire au grand jour, malgré le peu d'empressement de nos Romains à venir entendre les ouvrages nouveaux. La plupart se tiennent sur les places publiques, et perdent en causeries le temps qu'ils devraient consacrer à écouter. Ils envoient demander de temps en temps si le lecteur est entré, si son préambule est achevé, s'il est bien avancé dans sa lecture. Alors seulement vous les voyez venir lentement et avec circonspection. Encore n'attendent-ils pas la fin pour s'en aller. L'un s'esquive adroitement, l'autre sort sans façon et sans gêne. Quelle différence, du temps de nos pères! On raconte qu'un jour l'empereur Claude, en se promenant, dans son palais, entendit un grand bruit. Il en demanda la cause. On lui dit que Nonianus faisait une lecture publique. Ce prince vint aussitôt surprendre l'assemblée. Aujourd'hui les gens les plus oisifs, longtemps avant une lecture, priés et souvent avertis, dédaignent de venir; ou, s'ils viennent, ce n'est que pour se plaindre qu'ils ont perdu un jour, justement parce qu'ils ne l'ont pas perdu. Cette nonchalance et ce dédain de la part des auditeurs rehaussent beaucoup dans mon estime le courage des écrivains qu'ils ne dégoûtent pas de la composition et des lectures publiques. Pour moi, j'ai assisté à presque toutes les lectures. A dire vrai, les auteurs étaient mes amis car il n'y a peut-être pas un ami des lettres qui ne soit aussi le mien. Voilà ce qui m'a retenu à Rome plus longtemps que je ne voulais. Enfin je puis regagner ma retraite, et y composer quelque ouvrage, que je me garderai bien de lire en public. Ceux dont j'ai écouté les lectures croiraient que je leur ai, non pas donné, mais seulement prêté mon attention. Car, dans ces sortes de services, comme dans tous les autres, le mérite cesse dès qu'on en demande le prix. Adieu.
XIV. — Pline à Junius Mauricus.
Vous me priez de chercher un parti pour la fille de votre frère. C'est avec raison que vous me donnez cette commission plutôt qu'à tout autre : vous savez jusqu'où je portais mon admiration et mon attachement pour ce grand homme. Par quels sages conseils n'a-t-il point soutenu ma jeunesse ! Combien ses éloges ne m'ont-ils pas aidé à en mériter! Vous ne pouviez donc me charger d'un soin plus important, d'un soin qui me fit tout à la fois plus de plaisir et plus d'honneur que celui de choisir un époux digne de faire revivre Rusticus Arulénus dans ses descendants. Ce choix demanderait beaucoup de temps, si nous n'avions pas Minucius Acilianus, qui semble fait exprès pour cette alliance. C'est un jeune homme qui m'aime comme on aime les gens de son âge (car je n'ai que quelques années plus que lui), et qui me respecte comme un vieillard. Il veut tenir de moi l'instruction et les principes que je dus autrefois à vos leçons.
Il est né à Brescia, ville de ce canton d'Italie où l'on conserve oncore beaucoup de vestiges de la modestie, de la frugalité, et même de la simplicité antique. Minucius Macrinus, son père, n'oo cupa d'autre rang que celui de premier des chevaliers, parce ; qu'il refusa de monter plus haut. Vespasien voulut l'admettre au nombre des anciens préteurs; mais il préféra constamment un repos honorable à ce qui n'est peut-être que Je l'ambition cachée sous le nom de gloire. Serrana Procula, aïeule maternelle de ce jeune homme, est du municipe de Padoue. Vous connaissez les mœurs sévères de ce pays. Serrana y est citée comme un modèle. Il a aussi pour oncle P. Acilius. C'est un personnage d'une sagesse, d'une prudence, d'une intégrité presque incroyable. En un mot, vous ne trouverez, dans toute cette famille, rien qui ne vous plaise autant que dans la vôtre. Quant à Minucius Acilianus, il joint à beaucoup de talent et d'activité une modestie extrême. Il a exercé avec honneur la questure, le tribunal, la préture, et il vous a épargné ainsi d'avance la peine de les briguer pour lui. Sa figure est noble, son teint animé et vivement coloré. Tout en lui respire la distinction, la dignité d'un sénateur. Ces avantages, selon moi, ne sont point à négliger : c'est, en quelque sorte, une récompense que l'on doit aux mœurs innocentes d'une jeune personne.
Ajouterai-je que le père est fort riche. Quand je songe au caractère de ceux qui veulent un gendre de ma main Je n'ose parler de sa fortune mais, quand je considère, les mœurs publiques et même nos lois qui mettent les revenus en première ligne, cet article me semble ne devoir pas être omis. Franchement, on ne peut envisager les nombreuses conséquences du mariage, sans faire entrer la richesse dans les conditions du bonheur. Vous croyez peut-être que mon amitié s'est plu à exagérer le mérite d'Acilianus. Rapportez-vous-en à ma parole : vous verrez qu'il tiendra bien plus que je ne promets. Je vous avoue que j'ai pour ce jeune homme la plus vive affection, et il la mérite. Mais, plus je l'aime, moins je dois outrer son éloge. Adieu.
XV. — Pline à Septicius Clarus.
A merveille ! vous me promettez de venir souper, et vous me manquez de parole ! Mais il y a une justice : vous me rembourserez mes frais jusqu'à la dernière obole et ils ne sont pas minces. J'avais préparé à chacun sa laitue, trois escargots, deux œufs, un gâteau miellé et de la neige car je vous compterai jusqu'à la neige, la neige surtout, puisqu'elle ne sert jamais qu'une fois. Nous avions d'excellentes olives, des courges, des oignons et mille autres mets aussi délicats. Vous auriez eu à choisir d'un comédien, d'un lecteur ou d'un musicien ou même, admirez ma générosité, vous les auriez eus tous ensemble. Mais vous avez préféré, chez je ne sais qui, des huîtres, des fressures de porc, des oursins, et des danseuses espagnoles. Vous me le paierez, je ne vous dis pas comment. Vous avez été cruel, vous m'avez privé d'un grand plaisir, peut-être vous aussi, du moins, vous y avez perdu. Comme nous eussions ri, plaisanté, moralisé ! Vous trouverez chez beaucoup d'autres des repas plus magnifiques mais nulle part plus de gaieté, plus de franchise, plus d'abandon. Faites en l'épreuve et après cela si vous quittez toute autre table pour la mienne, je consens que vous quittiez la mienne pour toujours. Adieu.
XVI. -Pline à Erucius.
Je chérissais déjà Pompéius Saturninus (je parle de notre ami), je vantais son esprit, même avant d'en connaître toute la souplesse, toute la flexibilité, toute l'étendue. Aujourd'hui il s'est emparé de moi ; il me possède, il m'absorbe tout entier. Je l'ai entendu plaider avec autant de véhémence que d'énergie, et je n'ai pas trouvé moins de pureté et d'élégance dans ses improvisations que dans ses discours étudiés. Raisonnements justes et serrés, plans sages et bien faits, diction harmonieuse et d'un goût antique, toutes ces beautés, qui vous transportent quand la chaleur et la rapidité du débit les animent, vous charment encore lorsque vous les retrouvez sur ses tablettes. Vous serez de mon avis, dès que vous aurez en main ses pièces d'éloquence. Vous n'hésiterez pas à les comparer aux plus belles que les anciens nous ont laissées, et vous avouerez qu'il égale ses modèles. Comme historien, il vous satisfera davantage par la précision, la netteté, l'agrément, quelquefois même par l'éclat et la sublimité de ses récits. Il n'a pas moins de vigueur dans ses harangues que dans ses plaidoyers mais il y est plus concis, plus serré, plus pressant. Ce n'est pas tout : il fait des vers qui valent ceux de Catulle ou de Calvus. Que de grâce, de douceur, de tendresse, et quelquefois de mordant! Aux vers faciles et coulants, il en mêle, à dessein, d'une harmonie un peu rude : c'est la manière de Catulle et de Calvus. Dernièrement, il me lut des lettres qu'il disait être de sa femme. Je crus entendre Plaute ou Térence en prose. Que ces lettres soient de sa femme, comme il l'assure, ou qu'elles soient de lui, ce qu'il n'avoue pas, il mérite les mêmes éloges, ou pour les avoir écrites, ou pour avoir donné à sa femme, qu'il épousa si jeune, le talent de les écrire. Je ne le quitte donc plus de toute la journée : je le lis avant de prendre mes tablettes, quand je les quitte, quand je me délasse et il est toujours nouveau pour moi. Je ne puis trop vous engager à m'imiter. Faut-il dédaigner ses œuvres, parce qu'il est notre contemporain? Quoi ! s'il avait vécu parmi des gens que nous n'eussions jamais vus, nous rechercherions ses livres et même ses portraits et, parce qu'il est au milieu de nous, nous serons dégoûtés de son mérite éclatant par la facilité même d'en jouir ! Il est absurde, il est injuste de ne pas admirer un homme si digne d'admiration, parce qu'on a le bonheur de le voir, de lui parler, de l'entendre, de l'embrasser, et non seulement de le louer, mais encore de l'aimer. Adieu.

XVII. — Pline à Cornélius Titianus.
Il reste encore du dévouement et de l'honneur parmi les hommes : on en voit dont l'amitié survit à leurs amis. Titinius Capito a obtenu de notre empereur la permission d'élever sur le forum une statue à L. Silanus. Qu'il est beau, qu'il est honorable de consacrer à cet usage la faveur dont on jouit, et d'employer son crédit à rendre hommage au mérite d'autrui ! Capiton s'est fait une habitude d'honorer les grands hommes. On ne saurait dire avec quelle vénération, avec quel amour il conserve chez lui, ne pouvant pas les voir ailleurs, les portraits des Brutus, des Cassius, des Catons. Il célèbre aussi en vers excellents tous les illustres personnages. Croyez-moi, l'on n'aime point tant le mérite d'autrui, sans en avoir beaucoup soi-même. L. Silanus a reçu les honneurs qui lui étaient dus, et en lui assurant l'immortalité, Capiton a fondé la sienne. Il n'est pas, en effet, plus noble et plus glorieux de mériter une statue dans Rome, que de l'ériger à celui qui la mérite. Adieu.
XVIII— Pline à Suétone.
Vous m'écrivez qu'épouvanté par un songe, vous craignez pour le succès de votre plaidoyer. Vous me priez de demander un délai de quelques jours, ou d'obtenir au moins que vous ne plaidiez pas à la prochaine audience. Cela n'est pas facile. Cependant j'essaierai :
Car c'est de Jupiter que nous viennent tes songes.
Mais il importe de savoir si d'ordinaire l'événement est conforme ou contraire à vos rêves. En me rappelant un des miens, j'augure bien de celui qui vous fait peur. J'allais plaider la cause de Julius Pastor. Je rêvai que ma belle-mère, à mes genoux, me conjurait de ne point plaider ce jour-là. J'étais fort jeune, je devais parler devant les quatre tribunaux assemblés ; j'avais contre moi les citoyens les plus, puissants, et même les favoris de l'empereur. Toutes ces circonstances, après mon songe fatal, devaient me faire perdre la tête. Je plaidai néanmoins, en pensant que
Défendre sa patrie est le plus sûr présage.
Ma parole engagée était pour moi là patrie, et, s'il est possible, quelque chose de plus cher encore. Je réussis. C'est même cette cause qui fit d'abord parler de moi, et qui m'ouvrit les portes delà renommée. Voyez donc si cet exemple ne vous engagera point à mieux augurer de votre songe ou, si vous trouvez plus de sûreté à suivre ce conseil de la prudence : dans le doute, abstiens-toi, faites-le-moi savoir. J'imaginerai quelque prétexte, et je plaiderai pour que vous puissiez ne plaider que quand il vous plaira. Après tout, vous êtes dans une situation différente de celle où je me trouvais. L'audience des çentumvirs ne souffre point de remise. Celle où vous devez parler ne s'ajourne pas aisément mais enfin elle peut s'ajourner. Adieu.
XIX. — Pline à Romanus.
Nés dans la même ville, instruits à la même école, nous avons, depuis notre enfance, habité la même maison. Votre père était lié d'une étroite amitié avec ma mère, avec mon oncle, avec moi, autant que le pouvait permettre la différence de nos âges. Que de raisons à la fois pour prendre intérêt à votre élévation, et pour y concourir! Il est certain que vous avez cent mille sesterces de revenu, puisque vous êtes décurion dans notre province. Pour que nous ayons le plaisir de vous posséder encore dans l'ordre des chevaliers, j'ai à votre service les trois cent mille sesterces qui vous manquent, et je vous les offre. Notre ancienne amitié m'est un gage suffisant de votre reconnaissance. Je ne vous ferai pas même la recommandation que je devrais vous faire, si je n'étais persuadé que vous n'en avez pas besoin : c'est de vous gouverner avec sagesse dans ce nouvel emploi que vous tiendrez de moi. On ne peut remplir avec trop d'exactitude les devoirs de son rang, lorsqu'il faut justifier le choix de l'ami qui nous v élève. Adieu.
XX. — Pline à Tacite.
J'ai de fréquentes discussions avec un homme savant et habile, qui, dans l'éloquence du barreau, n'estime rien tant que la concision. J'avoue qu'elle n'est pas à négliger, quand la cause le permet ; autrement, ce serait une prévarication que d'omettre ce qu'il est utile de dire, et c'en serait une autre que d'effleurer, comme en courant, ce qu'on doit imprimer, inculquer, répéter. Dans la plupart des causes, l'amplification ajoute de la force et du poids aux idées. Pour qu'elles pénètrent dans l'esprit, comme le fer dans un corps, il ne suffit pas de frapper, il faut appuyer. A ces raisons, notre homme répond par des autorités : il étale âmes regards, chez les Grecs, les harangues de Lysias ; chez nous, celles des Gracques et de Caton, qui en général sont brèves et concises. A Lysias, moi j'oppose Démosthène, Eschine, Hypéride, et un grand nombre d'autres. Aux Gracques et à Caton, j'oppose Pollion, César, Célius, et surtout Cicéron, dont la plus longue harangue passe pour la plus belle. Il en est d'un bon livre comme de toute autre chose bonne en soi : son étendue ajoute à son prix. Voyez les statues, les figures en relief, les tableaux, les portraits dès hommes, ceux de beaucoup d'animaux, et même d'arbres : pourvu que ces effigies soient bien faites, rien ne les relève comme leur grandeur. Il en est de même des harangues. Un ouvrage doit à son étendue je ne sais quoi de plus brillant et de plus majestueux.
Mon adversaire, homme subtil et difficile à, saisir, échappe, à ces raisonnements et à plusieurs autres que j'emploie pour le convaincre, par un détour assez ingénieux. Il prétend que les harangues sur lesquelles je m'appuie, étaient plus courtes lorsqu'elles, furent prononcées. Je pense tout autrement. Je me fonde sur une foule de harangues de divers orateurs, par exemple, sur celles de Cicéron pour Muréna, pour Varénus. L'orateur s'est contenté d'indiquer dans un simple sommaire les chefs d'accusation qu'il avait à traiter ce qui prouve, qu'en parlant, il s'était étendu sur bien des choses qu'il a supprimées en écrivant. Il affirme qu'en se conformant à l'ancien usage, il plaida seul pour Cluentius, et pendant quatre audiences pour C. Cornélius. Par là il fait assez comprendre que ce qu'il avait été forcé de développer dans sa plaidoirie de plusieurs jours, il avait su depuis, à force de retranchements et de corrections, le réduire à un discours, fort long sans doute, mais enfin à un seul discours. Mais, me dira-t-on, il y a une grande différence entre un bon plaidoyer et un bon discours, C'est l'opinion de quelques personnes, je le sais. La mienne (peut-être me trompé-je), c'est qu'un bon plaidoyer peut n'être pas un bon discours, mais qu'il est impossible qu'un bon discours ne soit pas un bon plaidoyer. Car le discours écrit est le type et le modèle du discours qui doit être débité. De là vient que dans les meilleurs, et dans ceux même que nous savons n'avoir jamais été prononcés, nous, trouvons mille figures improvisées. Ainsi, dans une des harangues contre Verres, nous lisons : Un ouvrier.... comment s' appel ait-il? Vous m'avertissez à propos. C'est P olyclète, disait-on. Il faut en conclure que la meilleure plaidoirie est celle qui se rapproche le plus du discours, pourvu qu'elle ne soit pas resserrée dans un trop court espace de temps. Si on l'y renferme, ce n'est plus la faute de l'avocat ; tout le tort appartient au juge. Les lois viennent à l'appui de mon opinion : elles ne sont point avares du temps pour l'orateur. Ce n'est point la brièveté, c'est l'attention à ne rien omettre, qu'elles lui re commandent et l'on ne peut s'acquitter de ce devoir que dans les petites causes, si l'on se pique d'être court.
J'ajoute ce que je tiens de l'expérience, le plus sûr de tous les maîtres. Dans mes fonctions d'avocat et de juge, comme dans mes consultations, j'ai mille fois remarqué que les mêmes raisons n'agissent pas sur tous les hommes, et que, la plupart du temps, de petites considérations produisent sur eux de grands effets. Leurs idées et leurs goûts varient à un tel point, que souvent ils prononcent diversement sur une question que l'on vient d'agiter devant eux et, s'il leur arrive de s'accorder, c'est quelquefois par des motifs différents. D'ailleurs on s'engoue de ce qu'on a imaginé soi-même et, lorsque le moyen qu'on a prévu est proposé par un autre, on le regarde comme péremptoire. I l faut donc donner à chacun quelque chose qu'il puisse saisir, qu'il puisse reconnaître. Un jour que Régulus et moi défendions le même client, il me dit :Vous vous imaginez qu'il faut tout faire valoir dans une cause. Moi, je prends d'abord mon ennemi à la gorge, je l'étran gle. Il presse effectivement l'endroit qu'il saisit mais il se trompe souvent dans son choix. Ne pourrait-il point arriver, lui répondis-je, que vous prissiez quelquefois le genou, la jambe, ou même le talon pour la gorge? Moi, qui ne puis apercevoir la gorge, j'essaie tout, je tente tout, je mets touten oeuvre. Je fais valoir ma cause, comme un domaine. On n'en cultive pas seulement les vignes, on prend soin des moindres arbrisseaux. On en laboure les champs. Dans ces champs, on ne se contente pas de semer du froment ou du seigle, on y sème de l'orge, des fèves et tous les autres légumes. Je jette aussi à pleines mains dans ma cause des moyens de toute espèce pour en recueillir ce qui pourra venir à bien. On ne risque pas moins de se tromper sur la certitude des jugements que sur la constance des saisons et sur la fertilité des terres. Je n'ai pas oublié qu'Eupolis, dans une de ses comédies, loue ainsi l'illustre orateur Périclès :
Sur ses lèvres siégeait, outre la véhémence,
Les dons les plus heureux de la persuasion ;
Et de son ascendant, telle était la puissance,
Que seul dans tous les cœurs, il laissait l'aiguillon.
Mais, sans sa merveilleuse abondance, Périclès eût-il exercé cet empire souverain sur les âmes, soit par la rapidité, soit par la concision de ses discours (car il ne faut pas les confondre), ou par toutes les deux ensemble? On ne parvient à plaire et à persuader qu'en prenant assez de temps pour déployer son éloquence et l'on ne peut laisser l'aiguillon dans les coeurs, si l'on pique sans enfoncer. Un autre poête comique, parlant du même orateur, dit :
Il tonnait, foudroyait, bouleversait la Grèce.
Ce n'est pas dans un discours concis et serré, c'est dans une amplification majestueuse et sublime qu'on peut mêler la foudre aux éclairs, et jeter partout le trouble et la confusion. Il y a pourtant une juste mesure, je l'avoue. Mais celui qui n'atteint pas cette limite est-il plus estimable que celui qui la passe ? Vaut-il mieux ne pas dire assez que trop dire? Aussi vous entendez souvent reprocher à tel orateur une extrême abondance, à tel autre la sécheresse et la stérilité. On dit de celui-là qu'il dépasse son sujet; de celui-ci, qu'il ne peut l'embrasser. Tous deux pèchent également, l'un par excès de force, l'autre par faiblesse. Cette fécondité sans doute marque moins de culture, mais plus d'étendue d'esprit. Quand je parle ainsi, je n'approuve pas ce discoureur sans fin que peint Homère, je songe plutôt à celui dont les paroles se précipitent,
Comme à flocons pressés on voit tomber la neige.
Ce n'est pas que je n'aie aussi beaucoup de goût pour l'autre,
Qui sait dans peu de mots cacher un sens profond.
Mais, si vous me laissez le choix, je me déclarerai pour cette éloquence semblable à des flocons de neige, c'est-à-dire, abondante, large, impétueuse ; c'est là ce que j'appelle une éloquence vraiment divine. Cependant, direz-vous, beaucoup d'auditeurs préfèrent la concision. Oui, sans doute, les paresseux, dont il serait ridicule de prendre pour règle la délicatesse et l'indolence. Si vous les consultez, non seulement vous parlerez peu, mais vous ne parlerez point.
Voilà mon sentiment, que j'offre d'abandonner pour le vôtre. Toute la faveur que je vous demande, si vous êtes d'un autre avis, c'est de m'en expliquer les motifs. Quelle que soit la soumission que je dois à votre autorité, dans un sujet de cette importance, je crois qu'il est mieux encore de céder à la raison. Si donc je vous parais être dans le vrai, écrivez-le-moi, aussi brièvement que vous voudrez mais n'y manquez pas : cela me fortifiera dans mon jugement. Si je me trompe, prouvez-le-moi dans une longue lettre. N'est-ce point vous corrompre que d'exiger seulement un billet, si vous partagez mon opinion, et une longue épître, si vous m'êtes contraire? Adieu.

XXI — Pline à Paternus.
Je ne me fie pas moins à vos yeux qu'à votre discernement ; non que je vous croie fort habile (car il ne faut pas vous donner de vanité), mais je crois que vous l'êtes autant que moi ; c'est encore beaucoup dire. Raillerie à part, les esclaves que vous m'avez fait acheter me paraissent d'assez bonne mine. Reste à savoir s'ils sont honnêtes. Sur ce point il vaut mieux s'en rapporter à leur réputation qu'à leur physionomie. Adieu.
XXII.-Pline à Catilius Sévérus.
Une circonstance douloureuse me retient depuis longtemps à Rome. Je ne puis voir sans une profonde inquiétude la longue et opiniâtre maladie de Titus Ariston pour qui j'ai une admiration et une tendresse extraordinaires. Rien n'égale sa sagesse, son intégrité, son savoir. Aussi me semble-t-il voir les sciences et les lettres prêtes à disparaître avec lui. Quelle connaissance du droit public et du droit particulier ! Que de faits, que d'exemples, que d'érudition il possède ! Tout ce que vous désirez apprendre, il peut vous l'enseigner. C'est pour moi un trésor où je trouve tout ce qui me manque. Quelle confiance, quel respect inspirent ses paroles! Quelle admirable et charmante modestie dans ses décisions ! Que de choses n'embrasse-t-il pas sur-le-champ? Et cependant il doute presque toujours, il hésite, combattu par les raisons opposées que son esprit fin et pénétrant va rechercher jusque dans leur principe, il les examine, il les pèse. Vous vanterai-je la frugalité de sa table, la simplicité de sa mise? Je retrouve dans sa chambre et jusque dans sa couche l'image des mœurs de nos pères. Il rehausse cette simplicité par une grandeur d'âme qui n'accorde rien à l'ostentation, qui donne tout au témoignage de la conscience, et n'attache point la récompense d'une bonne action aux louanges qu'elle attire, mais à l'action elle-même. En un mot, il est peu de personnes, parmi celles qui affichent au dehors le goût de la philosophie, qu'on puisse lui comparer. Il ne court point les gymnases et les portiques pour charmer, par de longs débats, l'oisiveté des autres et la sienne. Les affaires, le barreau l'occupent tout entier. I1 plaide pour les uns, il donne des conseils aux autres et, pourtant, il ne le cède à ancun philosophe en probité, en désintéressement, en justice, magnanimité.
Si vous étiez près de lui, vous admireriez avec quelle patience il supporte la maladie, comment il triomphe de la douleur, comment il résiste à la soif, avec quel courage il souffre, immobile et couvert, les plus cruels accès de la fièvre. Dernièrement il me fit appeler avec quelques-uns de ses plus intimes amis. Il nous pria de consulter ses médecins pour se résoudre à quitter la vie, si la maladie était incurable, ou pour attendre avec constance la guérison, si elle n'était que longue et difficile. I l devait, disait-il, aux prières de sa femme, aux larmes de sa fille, aux vœux de ses amis, de ne point trahir leurs espérances par une mort volontaire, pourvu que ces espérances ne fussent pas vaines. Rien de plus noble, à mon gré, rien de plus digne d'éloges qu'un tel courage. Vous trouverez assez de gens qui courent à la mort, poussés par un aveugle instinct mais il n'appartient qu'à une grande âme de peser la mort et la vie, et de se déterminer, d'après la raison, pour l'une ou pour l'autre.
Sans doute les médecins nous donnent de l'espoir mais il faut que les dieux confirment leurs promesses, et me délivrent enfin de cette mortelle inquiétude. Alors je retournerai à ma villa de Laurente, c'est-à-dire à mes livres, à mes tablettes et à mes studieux loisirs. Car, tant que je garde mon ami, ou que je suis dans la perplexité, je n'ai ni le temps de lire, ni l'envie d'écrire. Vous voilà informé de mes alarmes, de mes vœux, de mes desseins. Apprenez-moi, à votre tour, mais plus gaiement, ce que vous avez fait, ce que vous faites, et ce que vous voulez faire. Ce ne sera pas un faible soulagement à ma peine de savoir que vous n'avez rien qui vous afflige. Adieu.
XXIII. — Pline à Pompéius Palcon.
Vous me demandez s'il convient que vous plaidiez pendant que vous êtes tribun. Avant tout, il est bon de savoir quelle idée vous vous faites de cette dignité. La regardez-vous comme une ombre vaine, comme un titre sans réalité, ou comme un pouvoir respectable pour tout le monde, même pour celui qui en est revêtu? Pour moi, lorsque j'étais tribun, j'ai peut-être eu tort de me croire un personnage important mais je me suis conduit comme si je l'étais, et je me suis abstenu de plaider. J'ai cru qu'il était messéant que le magistrat à qui la première place est due en tout lieu, devant qui le public devait se tenir debout, se tint debout lui-même, pendant que le public serait assis ; que lui, qui a droit d'imposer silence, reçût de la clepsydre l'ordre de se taire ; que lui, qu'il n'est pas permis d'interrompre, fût exposé à s'entendre dire des injures ; qu'il fût traité de lâche s'il les souffrait, et de superbe s'il s'en vengeait. J'y voyais un autre écueil. Que faire, si l'une des parties venait à réclamer ma protection? Aurais-je usé de mon autorité, ou bien serais-je demeuré muet et immobile, abdiquant en quelque sorte mon pouvoir, et me réduisant à la condition de simple particulier? Par ces motifs, j'ai mieux aimé être le tribun de tous nos citoyens, que l'avocat de quelques-uns. Pour vous, je le répète tout dépend de savoir ce que vous pensez du rang que vous occupez, et quel rôle vous avez résolu de choisir en homme sage, afin de le soutenir jusqu'au bout. Adieu.
XXIV. - Pline à Bébius Hispanus.
Suétone, qui loge avec moi, veut acheter une petite terre, qu'un de vos amis, dit-on, à l'intention de vendre. Faites en sorte, je vous prie, qu'elle ne lui soit vendue que ce qu'elle vaut : c'est à ce prix qu'elle lui plaira. Un mauvais marché est toujours désagréable, surtout en ce qu'il semble nous reprocher notre sottise. Cette propriété, si d'ailleurs le prix lui parait convenable, tente mon ami par plus d'un endroit. Elle est voisine de Rome ; la route est commode, le bâtiment peu considérable, le sol peu étendu, et plus capable d'amuser que d'occuper. Aux gens de lettres, comme notre Suétone, il ne faut que le terrain nécessaire pour délasser leur esprit, réjouir leurs yeux, se promener dans une allée, fouler un sentier, connaître toutes leurs vignes et compter tous leurs arbres. Je vous donne ces détails pour vous apprendre combien il me devra, et combien je vous devrai, s'il achète ce petit bien qui offre tant d'avantages, à des conditions dont il n'ait jamais lieu de se repentir. Adieu.
LIVRE SECOND. Retour
I. — Pline à Voconius Romanus.
Les funérailles publiques de Virginius Rufus, citoyen dont le bonheur égale le mérite éclatant, viennent de donner aux Romains un des plus beaux et des plus mémorables spectacles qu'ils aient vus depuis quelques années. Il a survécu trente ans à sa gloire. Il a lu des poèmes et des histoires dont ses actions avaient fourni le sujet, et joui des suffrages de la postérité. Trois fois consul, il est parvenu au plus haut rang où pouvait monter un simple particulier qui n'avait pas voulu être souverain. Il a échappé aux empereurs dont ses vertus avaient excité les soupçons et la haine. Il a laissé sur le trône le meilleur des princes, qui l'honorait de son amitié, et qui semble avoir été réservé pour relever la pompe funèbre d'un si grand homme. Il a vécu plus de quatre-vingt-trois ans, entouré de vénération, dans la tranquillité la plus profonde. Sa santé fut parfaite et il n'eut d'autre incommodité qu'un tremblement de mains, sans aucune douleur. Il est vrai que son agonie a été longue et douloureuse mais elle ne fait que rehausser sa gloire. Il était debout, et se préparait à remercier publiquement l'empereur de l'avoir élevé au consulat, lorsqu'un gros livre qu'il tenait, échappa de ses débiles mains. Il s'empressa de le ramasser. Mais, comme le sol était uni et glissant, le pied vint à lui manquer. Il tomba et se rompit une cuisse. Elle fut mal remise, et, l'âge supposant aux bienfaits de la nature, les os ne purent reprendre. Les obsèques de ce grand homme honorent à la fois l'empereur, notre siècle, la tribune même et le barreau. Cornélius Tacite a prononcé son éloge : en lui donnant le plus éloquent des panégyristes, la fortune a mis le comble à son bonheur.
Il est mort chargé d'années, comblé d'honneurs, même de ceux qu'il a refusés et cependant nous n'en devons pas moins le pleurer et le regretter, comme le modèle des anciennes mœurs, moi surtout, qui le chérissais, qui l'admirais autant dans le commerce familier, que dans sa vie publique. Nous étions du même pays : nos villes natales étaient voisines ; nos terres et nos propriétés se touchaient. Il m'avait été laissé pour tuteur, et avait eu pour moi la tendresse d'un père. Je n'ai brigué aucune charge qu'il ne m'ait honoré de son suffrage, et qu'il ne soit accouru du fond de sa retraite pour m'appuyer de son crédit, quoique depuis longtemps il eût renoncé à ces sortes de devoirs. Enfin, le jour où les prêtres ont coutume de nommer ceux qu'ils croient les plus dignes du sacerdoce, il m'a toujours donné sa voix. Je dirai plus. Pendant sa dernière maladie, craignant d'être un des cinq membres de la commission instituée par le sénat pour travailler à la diminution des charges publiques, il me choisit, malgré ma jeunesse, pour le remplacer, de préférence à tant de vieux amis et de personnages consulaires. Quand jamais un fils , me dit-il, c'est à vous que je confierais cet emploi. Puis-je donc ne pas pleurer auprès de vous sa mort comme prématurée? si toutefois il est permis de la pleurer,ou d'appeler mort le passade d'un si grand homme à une vie sans fin. Car il vit, et il vivra toujours, plus que jamais présent à la mémoire des hommes, et mêlé à leurs discours, depuis qu'il a disparu à leurs veux. J'avais mille autres choses à vous mander mais mon esprit ne peut, se détacher de Virginius ; je ne puis penser qu'à Virginius. L'imagination prête à mes souvenirs toute la force de la réalité : je crois l'entendre, l'entretenir, l'embrasser. Nous avons et nous aurons peut-être encore des citoyens qui l'égaleront en vertus mais nul n'égalera sa gloire. Adieu. .
II — Pline à Paulinus.
Je suis fâché ; c'est peut-être à tort, mais je suis fâché. Vous savez à quel point l'amitié est quelquefois injuste, souvent exigeante, toujours pointilleuse. Néanmoins, j'aurais ici une belle occasion de me mettre en colère, si mon courroux était fondé et je le fais éclater, comme si le motif en était aussi légitime qu'il est grave. Quoi! rester si longtemps sans me donner de vos nouvelles ! Vous n'avez qu'un moyen de m'apaiser : écrivez-moi désormais fort, souvent, et de très longues lettres. C'est pour moi la seule excuse véritable : je traiterai toutes les autres de mensonges. ^ Je ne me payerai pas de ces défaites : Je n'étais point à Rome ; fêtais accablé d'occupations. Quant à l'excuse, j'étais malade, plaise aux dieux que vous n'ayez jamais à y recourir! Pour moi, je me partage ici entre l'étude et la paresse, ces deux enfants du loisir. Adieu,
III— Pline à Népos.
Isée a dépassé la brillante réputation qui l'avait précédé. Rien n'égale la facilité, l'abondance, la richesse de son élocution. Il improvise toujours, et ses improvisations valent des discours écrits. Il a toute la grâce du langage grec ou plutôt du dialecte attique. Ses préambules ont de l'élégance, de la délicatesse et de la douceur, quelquefois de la grandeur et de la majesté. Il soumet à ses auditeurs plusieurs controverses, leur laisse le choix du sujet et souvent même du rôle. Il se lève, il s'arrange, il commence. Aussitôt tout se trouve presque au même instant sous sa main. Les pensées profondes et les expressions arrivent en foule. Mais quelles expressions! les mieux choisies, les plus élégantes. Ses improvisations décèlent beaucoup de lecture et d'habitude d'écrire. Ses exordes sont justes, ses narrations claires, ses arguments vifs, ses pérorations véhémentes, sa diction élevée. En un mot, il instruit, il plaît, il touche, sans qu'on puisse décider en quoi il réussit le mieux. Ses pensées sont si brillantes, ses raisonnements si concis et si serrés, que la plume leur donnerait à peine autant d'énergie. Sa mémoire est prodigieuse : il reprend d'un bout à l'autre un discours qu'il vient d'improviser, sans se tromper d'un seul mot. L'étude et l'exercice lui ont acquis ce merveilleux talent car, nuit et jour, ce qu'il fait, ce qu'il entend, ce qu'il dit, tout se rapporte là. Il a plus de soixante ans, et il ne s'exerce encore que dans les écoles. C'est chez les hommes de ce genre qu'on trouve au plus haut degré la simplicité, la bonté, la franchise. Nous autres, qui passons notre vie dans les contestations réelles du barreau, nous apprenons, sans le vouloir, toutes les ruses de la chicane. Les écoles, au contraire, qui vivent de fiction, ne nous offrent que des sujets innocents, et rien n'est plus agréable, surtout dans la vieillesse. Est-il, en effet, pour elle un amusement plus doux que celui qui fait les délices du jeune âge?
Je crois donc Isée, non seulement le plus éloquent, mais encore le plus heureux des hommes et vous, vous êtes le mortel le plus insensible, si vous ne brûlez de le connaître. Lors même que d'autres affaires et le désir de me voir ne vous appelleraient pas ici, vous devriez venir l'entendre. N'avez-vous jamais lu qu'un citoyen de Gadès, frappé de la réputation et de la gloire de Tite-Live, accourut des extrémités du monde pour le voir, et s'en retourna après l'avoir vu? Il faut être sans goût, sans littérature, sans émulation, j'ai presque dit sans honneur, pour ne pas céder à cette curiosité, la plus séduisante, la plus noble, enfin la plus digne d'un homme. Vous médirez peut-être: « J'ai ici des ouvrages non moins éloquents. » Oui, mais vous les lirez toujours quand il vous plaira, et vous ne pourrez pas toujours entendre Isée. Ignorez-vous d'ailleurs ce qu'on dit partout, que le débit fait une impression bien plus profonde? Ce que vous lisez, fût-il plus énergique, les traits que l'orateur enfonce par le geste, par la voix, par le jeu de la physionomie, entrent toujours plus avant. Révoquerons-nous en doute ce que l'on raconte d'Eschine? Un jour qu'il lisait à Rhodes la harangue que Démosthène avait prononcée contre lui, son auditoire était dans l'enthousiasme. Que serait-ce donc, s'écria-t-il, si vous eussiez entendu le monstre lui-même? Cependant, si l'on en croit Démosthène, Eschine avait un organe très sonore et Eschine avouait néanmoins que l'auteur du discours l'avait infiniment mieux débité que lui. Dans tout ceci, quel est mon but? C'est de vous déterminer à venir entendre Isée, ne serait-ce que pour dire que vous l'avez entendu. Adieu.

IV. — Pline à Calvina.
Si votre père avait laissé des créanciers, ou même un seul créancier autre que moi, vous auriez peut-être raison de délibérer si vous devez accepter une succession dont un homme même redouterait le fardeau. Mais aujourd'hui (les lien? qui nous unissent m'en imposaient le devoir), j'ai payé je ne dis pas les plus importuns, mais les plus pressés, et je suis devenu votre créancier unique. J'avais déjà contribué à votre dot d'une somme de cent mille sesterces, outre celle que votre père s'était engagé à payer, en quelque sorte, sur mon bien (car c'était moi qui devais en faire les fonds) : voilà des gages certains de mes dispositions pour vous. Avec cette assurance, il faut épargner une tache à votre père en acceptant sa succession et, pour donner de l'efficacité à mes paroles, je vous envoie une quittance générale de tout ce que me doit la succession. N'appréhendez point qu'une telle donation me soit à charge. Je ne suis pas riche, il est vrai mon rang exige de la dépense, et mon revenu par la nature de mes terres, est aussi incertain que modique. Mais ce qui me manque de ce coté-là, je le retrouve dans l' économie : voilà la source de mes libéralités. Je dois pourtant éviter de la tarir à force de profusion. Mais cette précaution ne concerne qu'autrui. À votre égard, quand ma générosité passerait les bornes, j'aurai toujours bien calculé. Adieu.
V. — Pline à Lupercus.
Je vous envoie un discours que vous m'avez demandé plus d'une fois, et que je vous ai souvent promis. Vous n'en recevrez pourtant aujourd'hui qu'une partie ; je corrige encore l'autre. J'ai cru devoir soumettre à votre critique ce qui m'a paru le plus achevé. Lisez je vous prie, ce fragment avec le m ême soin que j'ai mis à l'écrire. Je n'avais rien fait encore qui exigeât de moi autant d'application. On n'avait à juger, dans mes autres discours, que du zèle et de la probité de l'avocat ; ici, l'on jugera de la vertu du citoyen. Aussi mon ouvrage s'est-il étendu, grâce au plaisir que j'éprouvais à louer et à célébrer ma patrie, à travailler tout ensemble à sa défense et à sa gloire. Retranchez cependant à votre gré : car, toutes les fois que je pense au goût difficile et délicat de nos lecteurs, je conçois que la brièveté même est un moyen de succès.
Néanmoins, en me recommandant à votre sévérité, je me vois forcé de vous demander une faveur toute différente : c'est de vous laisser quelquefois dérider le front. Il faut bien flatter les jeunes gens, surtout, quand le sujet ne s'y oppose pas. Dans cet ouvrage, on peut prêter aux topographies qui reviendront souvent, non seulement les ornements de l'histoire mais peut-être encore ceux de la poésie. Si pourtant quelqu'un pensait que j'ai répandu plus d'agréments que n'en comportait la gravité du sujet, le reste de mon discours fléchira, je l'espère, ce rigoureux censeur. Je me suis efforcé, par la variété du style, d'intéresser toutes les classes des lecteurs. Ainsi, tout en craignant que ce qui pourra plaire à l'un ne déplaise à l'autre, je présume que cette diversité même sauvera l'ouvrage entier. Dans un repas, quoique nous ne touchions pas à tous les mets, nous louons pourtant l'ensemble du festin, et ce que notre palais refuse ne fait point de tort à ce qu'il admet. N'allez pas croire par là que je prétende avoir atteint au degré de perfection dont je parle : je veux seulement, vous faire entendre que j'y visais. Peut-être n'aurai-je pas travaillé en vain, si vous prenez la peine de retoucher ce que je vous envoie et ce que je vous enverrai bientôt. Vous direz qu'il ne vous est pas facile de vous bien acquitter de ce soin sans voir toute la pièce. J'en conviens mais vous vous familiariserez toujours avec les morceaux que je vous soumets et vous y trouverez quelque endroit qui peut souffrir des corrections partielles. Que l'on vous présente une tête, ou quelque autre partie d'une statue, vous ne pourrez sans doute en saisir les rapports et les proportions et pourtant vous ne laisserez pas de juger du mérite de cette partie. Par quel autre motif va-t-on lire ça et là les commencements d'un ouvrage, sinon parce que l'on est persuadé qu'une de ses parties peut avoir sa beauté indépendamment du reste ? Le plaisir de m'entretenir avec vous m'a mené loin. Je finis. Quand on blâme les longs discours, on ne devrait pas faire de si longues lettres. Adieu.
VI. — Pline à Avitus.
Il faudrait remonter trop haut et la chose n'en vaut pas la peine pour vous dire, comment malgré mon extème réserve, je me suis trouvé à souper chez un individu, selon lui, magnifique et rangé, selon moi, somptueux et mesquin tout à la fois. Il servait pour lui et pour un petit nombre de conviés des plats excellents, et pour les autres des mets communs et grossiers. II avait aussi partagé les vins en trois classes dans de petites bouteilles, non pour laisser la liberté de choisir, mais afin d'ôter le droit de refuser. Le premier était pour le maître et pour nous, le second, pour les amis du second degré (car il a des amis de plusieurs rangs), le dernier, pour ses affranchis et pour les nôtres. L'un de mes voisins me demanda si j'approuvais l'ordonnance de ce festin. Je lui répondis que non. Comment donc en usez-vous ? me dit-il. Je fais servir également tout le monde : car mon but est de réunir mes amis dans un repas, et non de les offenser par des distinctions injurieuses. Je n'établis aucune différence entre ceux que ma table a mis de niveau. — Quoi! reprit-il, traitez-vous de même les affranchis ? Oui. Ils ne sont plus alors à mes yeux des affranchis, mais des convives. — Cela vous coûte beaucoup, ajouta-t-il. — Point du tout.— Est-il possible? — Voici comment : c'est que mes affranchis ne boivent pas le même vin que moi, mais que je bois le même vin que mes af franchis.
Ne soyons pas trop délicats, et il ne nous en coûtera jamais bien cher pour traiter les autres comme nous-mêmes. C'est notre propre sensualité qu'il faut réprimer, et, pour ainsi dire, mettre à l'ordre, quand nous voulons épargner la dépense. Il est bien plus raisonnable de fonder son économie sur sa tempérance, que sur l'humiliation d'autrui. A quoi tend ce discours? à ne pas vous laisser imposer, vous dont j'estime tant l'heureux naturel, par le luxe qu'étalent certaines personnes à table, sous l'apparence de l'économie. L'amitié que je vous porte exige que toutes les fois que je rencontre un exemple semblable, je m'en serve pour vous avertir de ce qu'il faut éviter. N'oubliez donc jamais que l'on ne saurait trop éviter ce monstrueux mélange d'avarice et de prodigalité et que, si un seul de ces vices suffit pour ternir la réputation, ils ne peuvent que déshonorer davantage, quand ils sont réunis. Adieu.
VII. — Pline à Macrinus.
Hier le sénat, sur la proposition de l'empereur, ordonna qu'il serait élevé une statue triomphale à Vestricius Spurinna, non comme à tant d'autres, qui ne se sont jamais trouvés à une bataille, qui n'ont jamais vu de camp, et qui n'ont jamais entendu la trompette que dans des spectacles, mais comme à ceux qui ont acheté cet honneur au prix de leurs fatigues, de leur sang et de leurs exploits. Spurinna, par la force des armes, a rétabli le roi des Bructères dans ses États. Il lui a suffi de paraître (et c'est sans doute la plus glorieuse de toutes les victoires), pour dompter par la terreur une nation si belliqueuse. Mais en même temps qu'on a récompensé son courage, on a consolé sa douleur. Spurinna, en son absence, a perdu son fils Cottius, et Cottius a aussi été honoré d'une statue, honneur rarement accordé à un jeune homme. Les services du père l'avaient bien mérité et il ne fallait rien moins qu'un tel remède pour une plaie si profonde. D'ailleurs Cottius brillait déjà de tant de vertus, que l'on devait prolonger sa vie si courte par cette sorte d'immortalité. La pureté de ses mœurs, la sagesse et la supériorité même de son esprit lui permettaient de disputer de mérite avec les vieillards auxquels cette distinction l'a égalé. Un tel honneur, si je ne me trompe, ne se bornera pas à la consolation du père et à la gloire du fils ; il éveillera ? l'émulation dans tous les cœurs. Les jeunes gens, animés par l'espoir de si nobles récompenses, se distingueront à l'envi dans l'exercice des vertus. Les personnages du plus haut rang élèveront leurs enfants pour avoir le bonheur de revivre en eux, s'ils les conservent, ou pour être aussi glorieusement consolés, s'ils les perdent.
Voilà pourquoi je suis charmé que, dans l'intérêt public et pour moi-même, on ait érigé une statue à Cottius. J'aimais cet excellent jeune homme aussi vivement que je le regrette aujourd'hui et je trouverai une bien douce consolation à contempler de temps en temps son effigie, à me retourner quelquefois pour la voir, à m'arrêter à ses pieds, à passer devant elle. Si, dans l'enceinte de nos maisons, les images des morts calment notre douleur, combien ne nous frappent-elles pas davantage, lorsque, dans une place publique, elles nous retracent, non seulement le visage et les traits de nos amis, mais leur mérite et leur gloire! Adieu.
VIII. — Pline à Caninius.
Est-ce l'étude, est-ce la pêche, est-ce la chasse, ou ces délassements réunis qui vous captivent? car on peut les goûter à la fois dans notre charmante retraite, près du lac de Côme. Le lac vous fournit du poisson, les bois qui l'environnent sont pleins de bêtes fauves, et la profonde tranquillité du lieu invite à l'étude. Mais, que tous ces plaisirs ensemble ou quelqu'autre vous récréent, il ne m'est pas permis de dire que je vous porte envie. Je souffre pourtant de ne pouvoir jouir, ainsi que vous, de ces passe-temps, après lesquels je soupire comme le malade après le vin, les bains et les eaux. Ne briserai-je donc jamais les liens qui m'attachent, puisque je ne puis les dénouer? Je n'ose m'en flatter car de nouvelles affaires se joignent aux anciennes, sans que celles-ci soient terminées. La chaîne de mes occupations s'étend et s'appesantit de jour en jour. Adieu.
IX. — Pline à Apollinaire,
Je suis dans une grande perplexité au sujet des démarches de mon ami Sextus Érucius. Je ressens pour cet autre moi-même des tourments et des inquiétudes, qu'en pareille occasion je n'ai point éprouvés pour moi. D'ailleurs, il me semble que mon honneur, mon crédit et ma dignité sont compromis. J'ai obtenu de l'empereur, pour Sextus, le laticlave et la charge de questeur. Il doit à mes sollicitations la permission de demander celle de tribun. Si le sénat la lui refuse, je crains de paraître avoir abusé le prince. Je ne dois donc rien négliger pour que le jugement public confirme l'opinion que l'empereur, sur la foi de mes éloges, a bien voulu concevoir de son mérite. Quand ce motif pressant me manquerait, je n'aurais guère moins d'ardeur pour l'élévation de Sextus. C'est un jeune homme plein de probité, de sagesse, de savoir, et digne de tout éloge, lui et sa famille entière. Son père, Érucius Clarus est un homme d'une vertu antique. Avocat éloquent et exercé, il honore sa profession par son intégrité parfaite, autant que par son courage et par sa modestie. C Septicius, son oncle, est la vérité, la franchise, la candeur, la droiture même. Tous rivalisent d'affection pour moi, et cependant ils m'aiment tous également. Voici une occasion où je puis, en témoignant ma reconnaissance à un seul, m'acquitter envers tous. Je sollicite donc, je supplie, j'assiège mes amis ; je vais de maison en maison, de place en place et j'essaye, par mes prières, tout ce que j'ai de crédit et de considération. Veuillez, je vous en conjure, vous charger d'une partie des soins que je me suis imposés. Je vous payerai de retour, aussitôt que vous le demanderez ; je n'attendrai même pas votre demande. On vous chérit, on vous honore, on vous courtise. Manifestez seulement vos intentions, et l'on s'empressera de les seconder. Adieu.
X, — Pline à Octavius.
Que vous êtes nonchalant, ou plutôt dur, j'allais dire cruel, de retenir si longtemps dans l'obscurité de si charmants ouvrages ! Jusques à quand serez-vous l'ennemi de votre gloire et de notre (plaisir? Laissez vos livres courir le monde ; qu'ils se répandent aussi loin que la langue romaine. D'ailleurs une attente si vive et si prolongée ne vous permet plus de nous faire languir davantage. Quelques-uns de vos vers ont déjà paru, et se sont fait jour malgré vous. Si vous ne prenez soin de les réunir en un seul corps, ces vagabonds trouveront quelque jeux un maître. Songez que nous sommes mortels, et que ce monument peut seul vous assurer l'immortalité. Tous les autres ouvrages, aussi fragiles et périssables que les hommes; passent et disparaissent comme eux. Vous me direz, selon votre habitude : Cela regarde mes amis. Je souhaite que vous ayez des amis assez dévoués, assez savants, assez laborieux pour vouloir se charger de cette entreprise considérable, et pouvoir l'exécuter. Mais croyez qu'il y a peu de sagesse à se promettre des autres ce qu'on se refuse à soi-même. Ne parlons plus de publier vos vers, ce sera quand il vous plaira. Au moins lisez-les pour vous inspirer l'envie de les publier, et donnez-vous enfin la satisfaction que je goûte d'avance pour vous depuis longtemps. Je me représente, en effet, cette foule d'auditeurs, ces transporte d'admiration, ces applaudissements, ce silence même, qui, lorsque je plaide ou que je lis mes ouvrages, n'a pas moins de charmes pour moi que les applaudissements, s'il est animé par l'attention et par l'impatience d'entendre ce qui va suivre. Ne dérobez donc plus à vos veilles, par d'éternels délais, une récompense si belle et si certaine. Un plus long ajournement vous attirerait le nom d'indifférent, de paresseux, et peut-être de timide. Adieu.
XI. — Pline à Arrien
Je sais quelle satisfaction vous éprouvez, quand notre sénat s'honore par un acte digne de son auguste caractère. L'amour du repos, qui vous éloigne des affaires, ne bannit pas de votre cœur la passion que vous avez pour la gloire de l'empire. Apprenez donc ce qui vient d'arriver ces jours derniers. C'est un événement fameux par la célébrité du personnage, salutaire par la sévérité de l'exemple, mémorable à jamais par son importance.
Marius Priscus, proconsul d'Afrique, accusé par les Africains, se bornait à demander des juges ordinaires, sans proposer aucune défense. Cornélius Tacite et moi, chargés par ordre du sénat de la cause de ces peuples, nous crûmes qu'il était de notre devoir de représenter que la barbarie et la cruauté imputées à Priscus ne permettaient pas de lui accorder sa demande. On l'accusait d'avoir reçu de l'argent pour condamner et faire égorger des innocents. Catius Fronton répondit, en suppliant le sénat de renfermer l'affaire dans l'accusation de péculat, et cet orateur, très habile à tirer des larmes, fit jouer tous les ressorts de la pitié. Grande contestation, grandes clameurs de part et d'autre. Selon les uns, la loi assujettissait le sénat à juger lui-même ; selon les autres, elle lui laissait la liberté pleine et entière d'agir selon la grandeur des crimes.
Enfin, Julius Férox, consul désigné, homme droit et intègre, ouvrit un troisième avis. Il voulut que, par provision, on donnât des juges à Priscus mais qu'on appelât les personnes auxquelles on prétend qu'il a vendu le sang innocent. Non seulement cet avis l'emporta, mais il n'y en eut presque plus d'autres, après tant de disputes et l'on remarqua que, si les premiers mouvements de l'enthousiasme et de la pitié sont vifs et impétueux, la sagesse et la raison parviennent peu à peu à les apaiser. De là vient que personne n'a le courage de proposer seul ce qu'il osait soutenir en mêlant ses cris à ceux de la multitude. La vérité, obscurcie par la foule, se manifeste dès qu'on s'en sépare.
Vitellius Honoratus et Flavius Martianus, complices assignés, se rendirent à Rome. Le premier était accusé d'avoir donné trois cent mille sesterces pour faire bannir un chevalier romain, et mettre à mort sept amis de cet exilé ; le second, d'avoir acheté sept cent mille sesterces diverses peines imposées à un autre chevalier romain. Ce malheureux avait été d'abord condamné au fouet, puis envoyé aux mines, et à la fin étranglé en prison. Une mort opportune déroba Honoratus à la justice du sénat. Martianus fut introduit, en l'absence de Priscus. Alors Tulius Céréalis, personnage consulaire, usant, de son droit de sénateur, demanda que Priscus assistât à la discussion, soit pour accroître par sa présence ou la compassion ou la haine, soit plutôt qu'il jugeât équitable que les deux accusés repoussassent en commun une accusation commune, et fussent punis ensemble, s'ils ne pouvaient se justifier. L'affaire fut renvoyée à la première assemblée du sénat, qui fut des plus augustes. Le prince y présida, il était consul. Nous entrions dans le mois de janvier, celui de tous qui rassemble à Rome le plus de monde, et particulièrement de sénateurs. D'ailleurs, l'importance de la cause, le bruit qu'elle avait fait, l'attente qui s'était encore accrue par tant de émises, la curiosité naturelle à tous les hommes de voir de près Des événements graves et extraordinaires, avaient attiré de toutes parts un immense concours. Imaginez-vous quels sujets d'inquiétude et de crainte pour nous, qui devions porter la parole dans une si grande affaire, devant une telle assemblée, et en présence de l'empereur!
J'ai plus d'une fois parlé dans le sénat, nulle part même je ne suis plus favorablement écouté ; cependant tout m'étonnait, comme si tout m'eût été nouveau. La difficulté de la cause ne m'embarrassait pas moins que le reste. J'envisageais dans la personne de Priscus, tantôt un consulaire, tantôt un septemvir, quelquefois un homme déchu de ces deux dignités. Il m'était extrêmement pénible d'accuser un homme déjà condamné pour crime de péculat. Si l'énormité du forfait aggravait sa position, la pitié qui s'attache à le première condamnation plaidait en sa faveur. Néanmoins je recueillis mes esprits et mes idées. Mon discours fut écouté avec autant de bienveillance qu'il m'avait inspiré de crainte. Je parlai près de cinq heures (car on me donna presque une heure et demie au delà des trois et demie qui m'avaient été d'abord largement accordées) : tant les parties mêmes de la cause qui m'avaient paru les plus épineuses et les plus défavorables, se présentèrent sous un jour heureux, quand je vins à les traiter! Les bontés de l'empereur, ses soins pour moi, je n'oserais dire ses attentions, allèrent si loin, qu'il me fit avertir plusieurs fois par un affranchi que j'avais derrière moi, de ménager ma poitrine et mes forces : il craignait que la chaleur de l'action m'emportât plus loin que ne le permettait la faiblesse de ma complexion.
Claudius Marcellinus défendit Martianus. Le sénat se sépara, et remit l'assemblée au lendemain : car il n'y avait pas assez de temps pour achever un nouveau plaidoyer avant la nuit. Le jour suivant, Salvius Libéralis parla pour Marius. Cet orateur a de la finesse, de l'art, de la véhémence, de la facilité. Il déploya dan cette occasion tous ses avantages. Cornélius Tacite répondit avec beaucoup d'éloquence, et fit admirer cette élévation majestueuse qui caractérise ses discours. Catius Fronton répliqua avec talent, et, se conformant à la circonstance, il songea plus à fléchir les juges qu'à justifier l'accusé. Il finissait son plaidoyer, quand la nuit survint. On renvoya donc les preuves au jour suivant. C'était quelque chose de beau et d'antique, que de voir le sénat trois jours de suite assemblé, trois jours de suite occupé, ne se séparant qu'à la nuit.
Cornutus Tertullus, consul désigné, homme d'un rare mérite et d'une loyauté incorruptible, opina le premier. Il fut d'avis de condamner Marius à verser dans le trésor public les sept cent mille sesterces qu'il avait reçus, et de le bannir de Rome et de l'Italie. Il alla plus loin contre Martianus, et demanda qu'il fût banni même de l'Afrique. Il conclut, en proposant au sénat de déclarer que nous avions, Tacite et moi, fidèlement et dignement rempli le ministère qui nous avait été confié. Les consuls désignés, et tous les consulaires qui parlèrent ensuite, se rangèrent à cette opinion, jusqu'à Pompéius Colléga. Il proposa de condamner Marius à verser dans le trésor public les sept cent mille sesterces, et d'exiler Martianus pour cinq ans, mais de ne rien ajouter à la peine prononcée déjà contre Marius pour le crime de péculat. Chaque opinion eut de nombreux partisans mais la balance pencha en faveur de la dernière, comme étant plus indulgente, ou moins rigoureuse car plusieurs de ceux qui avaient adopté le sentiment de Cornutus, se déclaraient maintenant pour Colléga. Toutefois, lorsqu'on vint à compter les suffrages, les sénateurs placés près des consuls commencèrent à se ranger du côté de Cornutus. Alors ceux qui avaient donné lieu de croire qu'ils étaient de l'avis de Colléga, repassèrent de l'autre côté, en sorte que Colléga se trouva presque seul. Il exhala son chagrin en reproches amers contre ceux qui l'avaient engagé dans ce parti, principalement contre Régulus qui n'avait pas le courage de suivre un avis dont il était l'auteur. Au fait, Régulus est un esprit si léger, qu'il passe en un moment de l'extrême audace à l'extrême crainte.
Tel fut le dénoûment de cette grande affaire. Il en reste toute fois un chef qui n'est pas de petite importance : c'est ce qui regarde Hostilius Firminus, lieutenant de Marius Priscus, qui s'est trouvé impliqué dans cette accusation, et qui a eu de terribles assauts à soutenir. Il est convaincu, par les registres de Martianus, et par la harangue qu'il fit dans l'assemblée des habitants de Leptis, d'avoir rendu d'infâmes offices à Marius, et d'avoir exigé cinquante mille deniers de Martianus. Il est prouvé, en outre, qu'il a reçu dix mille sesterces, à titre de parfumeur, titre honteux, qui ne convient pas trop mal, cependant, à un homme toujours si soigneux de sa coiffure et de la douceur de sa peau. On décida, sur l'avis de Cornutus, de renvoyer la discussion de cette dernière affaire à la séance prochaine car soit hasard, soit remords, Hostilius était alors absent.
Vous voilà bien informé de ce qui se passe à la ville. A votre tour donnez-moi des nouvelles de la campagne. Que deviennent vos arbres fruitiers, vos vignes, vos blés, vos brebis couvertes d'une si fine toison? Comptez que, si je ne reçois de vous une aussi longue lettre que celle-ci, vous n'en aurez plus de moi que de très courtes. Adieu.

XII — Pline à Arrien.
Je ne sais si nous avons bien jugé ce dernier chef, qui nous restait de l'affaire de Priscus, comme je vous l'avais mandé mais enfin nous l'avons expédié. Firminus comparut au sénat, et répondit à l'accusation dont les motifs, étaient déjà connus. Les avis se partagèrent entre les consuls désignés. Cornutus Tertullus opinait à le chasser du sénat ; Acutius Nerva, seulement à l'exclure du partage des gouvernements. Cette opinion prévalut comme la plus douce, quoiqu'elle soit plus sévère et plus fâcheuse que l'autre. Qu'y a-t-il, en effet, de plus déplorable que de s'acquitter des pénibles fonctions de sénateur, sans jouir des honneurs qui en sont la récompense? Qu'y a-t-il de plus affreux pour un homme frappé d'une telle ignominie, que de ne pouvoir pas se cacher au fond d'une solitude, et d'être obligé de rester dans cet ordre élevé qui le donne en spectacle à tous les regards? Que peut-on d'ailleurs imaginer de plus bizarre et de plus indécent, que de voir siéger au sénat un homme que le sénat a flétri? de le voir au niveau de ses propres juges? de le voir, exclus du proconsulat pour cause de prévarication dans ses fonctions de lieutenant, juger lui-même des proconsuls? de voir enfin un homme, condamné pour un crime honteux, condamner ou absoudre les autres? Mais la majorité a prononcé. On ne pèse pas les voix, on les compte et il ne faut attendre rien de mieux de ces assemblées, où la plus choquante inégalité est dans l'égalité même, puisque tous les membres ont la même autorité sans avoir les mêmes lumières.
J'ai accompli la promesse que je vous avais faite dans ma dernière lettre. Si je calcule bien le temps, vous devez l'avoir reçue car je l'ai confiée à un courrier prompt et diligent, s'il n'a point rencontré d'obstacle sur son chemin. C'est à vous aujourd'hui à me récompenser de ma première et de ma seconde lettre, par des pages aussi remplies qu'on peut les écrire dans la retraite que vous habitez. Adieu.
XIII Pline à Priscus.
Si vous saisissez avec empressement toutes les occasions de me rendre service, il n'est personne à qui j'aime mieux avoir obligation qu'à vous. Ce double motif me détermine à vous demander une grâce que je désire vivement obtenir. Vous êtes à la tête d'une puissante armée. Ce poste met à votre disposition un grand nombre de faveurs, et, depuis le temps que vous l'occupez, vous avez pu en combler tous vos amis. Daignez maintenant songer aux miens, je veux dire à quelques-uns des miens. Vous aimeriez mieux, sans doute, les obliger tous mais ma discrétion se contentera de vous parler d'un ou deux, ou plutôt d'un seul, c'est-à-dire de Voconius Romanus.
Son père s'était distingué dans l'ordre des chevaliers, et son beau-père, ou plutôt son second père (car sa bonté lui a aussi mérité ce nom), s'y était acquis une illustration plus grande encore. Sa mère tenait aux premières maisons de l'Espagne Citérieure, Vous savez quel est le bon esprit, quelle est la sévérité de mœurs de cette province. Il vient d'être créé flamine. Notre tendre amitié a commencé avec nos études. Nous logions dans la même maison à la ville et à la campagne, il partageait mes affaires et mes plaisirs. Où trouver aussi une affection plus sûre, une compagnie plus agréable? Sa conversation a un charme ravissant; sa physionomie est pleine de douceur; son esprit élevé, délicat, doux, facile, est heureusement préparé pour les exercices du barreau Les lettres qu'il écrit, semblent dictées par les Muses elles-mêmes. Je l'aime plus que je ne puis dire, et son amitié ne le cède pas à la mienne. Jeune comme lui, déjà, pour le servir, je cherchais avec empressement les occasions que notre âge pouvait me permettre. Je viens de lui obtenir, de notre bon prince, le privilège que donne le nombre de trois enfants. Quoique l'empereur se soit fait une loi de ne le conférer que rarement et avec choix, il a bien voulu me l'accorder avec autant de grâce que s'il avait choisi lui-même. Je ne puis mieux soutenir mes premiers bienfaits qu'en y ajoutant, surtout parce que sa profonde reconnaissance en appelle de nouveaux.
Je vous ai dit quel est Romanus, combien je l'estime, combien il m'est cher. Traitez-le, je vous prie, comme je dois l'attendre de votre caractère et de votre position. Veuillez surtout l'aimer. Quelque bien que vous lui fassiez, il n'en est point de plus précieux pour lui que votre amitié. C'est, pour vous prouver qu'il la mérite, et que vous pouvez l'admettre même dans votre intimité, que je vous ai tracé en peu de mots ses goûts, ses mœurs et sa vie tout entière. Je renouvellerais encore ici mes recommandations, si je ne savais que vous n'aimez pas à vous faire prier longtemps, et que je n'ai pas fait autre chose dans toute cette lettre. Car c'est, prier, et prier très efficacement, que de faire sentir la justice de ses prières. Adieu.
XIV. — Pline à Maxime.
Vous l'avez deviné : je commence à me lasser des causes que je plaide devant les centumvirs. La peine passe le plaisir. La plupart sont minces et frivoles. Rarement s'en présente-t-il une qui, par le rang des personnages, ou par l'importance du sujet, attire l'attention. D'ailleurs, il s'y trouve un très petit nombre de dignes adversaires. Le reste se compose de gens hardis et même, en grande partie, de jeunes gens obscurs qui ne viennent là que pour déclamer, mais avec si peu de respect et de retenue, que notre Attilius a eu parfaitement raison de dire : Les enfants commencent au barreau par plaider devant les centumvirs, comme, aux écoles, par lire Homère. En effet, au barreau comme aux écoles, on commence par ce qu'il y a de plus difficile.
Autrefois, à ce que disaient les vieillards, les jeunes gens, même de la plus haute naissance, n'étaient point admis à parler devant, les centumvirs, si quelque consulaire ne les présentait : tant on avait alors de vénération pour un si noble exercice! Aujourd'hui, les bornes de la discrétion et du respect sont franchies, et le champ est ouvert à tout le monde. On n'entre plus au barreau, on y fait irruption. Pareils aux avocats, viennent ensuite des auditeurs que l'on achète à beaux deniers comptants. Cette foule mercenaire se presse autour de l'agent de nos orateurs, au milieu même du palais, et là, comme dans une salle à manger, il leur distribue la portion. Aussi les a-t-on nommés assez plaisamment, en grec ao?o/.Âsï; (qui crient très bien !), et en latin laudicœni (louangeurs pour un repas).
Cette manœuvre honteuse, flétrie dans les deux langues, gagne néanmoins de jour en jour. Hier, deux de mes domestiques, de l'âge de ceux qui viennent de prendre la robe prétexte, furent forcés d'aller applaudir pour trois deniers. Voilà ce qu'il en coûte pour être un grand orateur. A ce prix, il n'y a point de bancs que vous ne remplissiez, point de lieux que vous ne couvriez d'auditeurs, point de cris d'enthousiasme que vous n'arrachiez, quand le coryphée a donné le signal. Il faut bien un signal pour des gens qui ne comprennent rien, ou qui même n'écoutent pas car la plupart ne s'en donnent pas la peine, et ce sont justement ceux-là qui approuvent le plus haut.
S'il vous arrive jamais de passer près du palais, et que vous soyez curieux de savoir comment parle chacun de nos avocats, vous n'aurez pas besoin d'entrer ni de prêter votre attention, il vous sera facile de le deviner. Sachez que plus les marques d'approbation sont bruyantes, moins l'orateur a de talent.
Largius Licinius amena le premier cette mode. Mais il se contentait de rassembler ses auditeurs. Je l'ai ouï raconter à Quintilien mon maître. « J'accompagnais, disait-il, Domitius Afer, qui plaidait devant les centumvirs avec gravité et avec lenteur : c'était sa manière. Il entendit dans le voisinage un bruit tout à fait extraordinaire. Surpris, il se tut. Quand le silence fut rétabli, il reprit le fil de son discours. Le bruit ayant recommencé, il s'arrêta encore. On fit silence. Il continua à parler une troisième fois. Interrompu de nouveau, il demanda enfin le nom de l'avocat qui plaidait. On lui répondit que c'était Licinius. Centumvirs, dit-il alors, avant de reprendre son plaidoyer, l'éloquence est perdue. C'est aujourd'hui que cet art, qui ne commençait qu'à se perdre lorsque Afer le croyait déjà perdu, est entièrement éteint et anéanti. J'ai honte de vous dire quelles acclamations sont prodiguées par nos auditeurs imberbes aux plus mauvais discours et au débit le plus monotone. En vérité, il ne manque à cette psalmodie que des battements de mains, ou plutôt, que des cymbales et des tambours. Pour des hurlements (on ne peut exprimer par un autre terme les acclamations indécentes dont retentit le barreau), nous en avons de reste. Mon âge pourtant et l'intérêt de mes amis m'arrêtent encore. Je crains que l'on ne me soupçonne de fuir ces indignités beaucoup moins que le travail. Cependant je commence à me montrer au barreau plus rarement qu'à l'ordinaire, ce qui me conduit insensiblement à l'abandonner tout à fait. Adieu.
XV. — Pline à Valérien.
Votre ancienne propriété du pays des Marses vous plaît-elle toujours? Et votre nouvelle terre, n'a-t-elle rien perdu de ses charmes, depuis que vous l'avez acquise? Cela n'est pas ordinaire, celui qui possède et celui qui désire n'ont pas les mêmes yeux. Pour moi, je n'ai pas trop à me louer des domaines que j'ai hérités de ma mère. Ils me plaisent pourtant, parce qu'ils viennent d'elle et d'ailleurs une longue habitude m'a endurci. Voilà comment se terminent les longues plaintes : à la fin on a honte de se plaindre. Adieu.
XVI. — Pline à Annien.
Vous me mandez, avec votre zèle ordinaire, que les codicilles d'Acilien, qui m'a institué héritier pour une part de son bien, doivent être regardés comme nuls, parce que son testament ne les confirme pas. Je n'ignore pas ce point de droit, connu du jurisconsulte le plus médiocre mais je me suis fait une loi particulière de respecter et d'accomplir toujours les volontés des morts, quand même les formalités y manqueraient. Les codicilles dont il s'agit sont certainement écrits de la main d'Acilien. Quoiqu'ils ne soient pas confirmés par son testament, je les exécuterai comme s'ils l'étaient, surtout n'ayant rien à craindre d'un délateur. Car peut-être devrais-je mettre plus de réserve et de prudence, si j'avais lieu d'appréhender qu'une confiscation ne détournât, au profit du trésor public, des libéralités que je veux faire. Mais, comme il est permis à un héritier de disposer à son gré des biens d'une succession, je ne vois rien qui puisse traverser l'exécution de ma loi particulière, que les lois publiques ne désapprouvent pas. Adieu.
XVII. — Pline à Gallus.
Vous êtes surpris que je trouve tant de charmes à ma villa du Laurentin, ou, si vous voulez, de Laurente. Vous reviendrez de votre étonnement, quand vous connaîtrez les agréments de cette demeure, les avantages de sa situation et sa distance de la mer.
Elle n'est qu'à dix-sept milles de Rome, et l'on peut s'y transporter après avoir achevé toutes ses affaires, sans rien prendre sur sa journée. Deux chemins y conduisent, celui de Laurente et celui d'Ostie mais on quitte le premier au quatorzième milliaire, et le second au onzième. En sortant de l'un ou de l'autre, on entre dans une voie en partie sablonneuse, où les voitures roulent avec assez de difficulté et de lenteur. A cheval, le trajet est plus court et plus doux. Ce n'est partout que paysages. Tantôt la route se resserre entre des bois, tantôt elle s'ouvre et s étend sur de vastes prairies. Là de nombreux troupeaux de brebis, de bœufs et de chevaux, dès que rimer les a chassés des montagnes, s'engraissent en paissant au sein d'une température printanière.
La villa est commode, sans être d'un entretien dispendieux. L'entrée, d'une élégante simplicité, fait face à un portique courbé en forme de D, et qui entoure une petite cour charmante. C'est une retraite précieuse contre le mauvais temps car on y est protégé par les vitres qui le ferment, et surtout par les toits qui le couvrent. Ce portique conduit à une cour intérieure fort gaie. De là on passe dans une assez belle salle à manger qui s'avance sur la mer, dont les vagues viennent mourir au pied du mur, lorsque souffle le vent du midi. De tous les côtés, cette salle est garnie de portes à deux battants et de fenêtres qui sont aussi grandes que les portes ; de manière que, à droite, à gauche et en face, on découvre comme trois mers différentes. Derrière soi, on a pour horizon la cour intérieure, le portique, l'aire, puis encore le portique, enfin l'entrée, et, dans le lointain, les forêts et les montagnes. A la gauche de cette salle à manger, est une grande pièce moins avancée vers la mer et de là, on entre dans une plus petite, qui a deux fenêtres, l'une au levant, l'autre au couchant. Celle-ci donne aussi sur la mer, que l'on voit de plus loin, mais avec plus de charme.
L'angle que forme la salle à manger avec le mur de la chambre, semble fait pour rassembler, pour concentrer tous les rayons du soleil. C'est le refuge de mes gens en hiver, c'est le théâtre de leurs exercices. Là se taisent tous les vents, excepté ceux qui chargent le ciel de nuages, et nuisent plutôt à la clarté du lieu qu'aux agréments qu'il présente. A cet angle est annexée une rotonde dont les fenêtres reçoivent successivement tous les soleils. On a ménagé dans le mur une armoire qui me sert de bibliothèque, et qui contient, non les livres qu'on lit une fois, mais ceux qu'on doit relire sans cesse. A côté sont des chambres à coucher, séparées de la bibliothèque par un conduit garni de tuyaux suspendus qui répandent et distribuent de tous côtés une chaleur salutaire. Le reste de cette aile est occupé par des affranchis ou par des valets et cependant la plupart des pièces sont tenues si proprement, qu'on pourrait y loger des maîtres.
A l'autre aile, est un cabinet fort élégant ; ensuite une grande chambre ou une petite salle à manger que le soleil et la mer égayent à l'envi. Puis on passe dans une chambre à laquelle est jointe une antichambre. Cette salle est aussi fraîche en été par son élévation, que chaude en hiver par les abris qui la préservent de tous les vents. A côté se trouve une autre pièce et son antichambre. De là on communique dans la salle des bains où est un réservoir d'eau froide. L'emplacement est grand et spacieux. Des deux murs opposés sortent en hémicycles deux baignoires si profondes et si larges, qu'on pourrait y nager. Près de là est un cabinet de toilette, une étuve et le fourneau nécessaire au service du bain. De plain-pied se succèdent deux pièces plus élégantes que magnifiques. Le bain d'eau chaude s'y rattache d'une manière si admirable, qu'on aperçoit la mer en se baignant.
Non loin de là est un jeu de paume qui, dans les jours les plus chauds, ne reçoit le soleil qu'à son déclin. D'un côté s'élève une tour, au bas de laquelle sont deux cabinets ; deux autres sont au-dessus, avec une salle à manger d'où la vue embrasse une mer immense, de vastes côtes et de délicieuses villas. De l'autre côté est une autre tour où se trouve une chambre qui regarde le levant et le couchant. Derrière est une grande cave et un grenier. Au-dessous de ce grenier est une salle à manger, où, quand la mer est agitée, on n'entend que le bruit faible et presque amorti de ses vagues. Cette salle donne sur le jardin et sur l'allée destinée à la promenade qui règne à l'entour. L'allée est bordée de buis, ou, à son défaut, de romarin : car, dans la partie où le bâtiment abrite le buis, il conserve toute sa verdure. Mais, au grand air et en plein vent, l'eau de la mer le dessèche, quoiqu'elle n'y rejaillisse que de fort loin.
Près de l'allée, croît, dans une enceinte, une vigne tendre et touffue, dont le bois ploie mollement, même sous les pieds nus. Le jardin est couvert de figuiers et de mûriers auxquels le terrain est aussi favorable qu'il est contraire à tous les autres arbres. D'une salle à manger voisine, on jouit de cet aspect, qui n'est guère moins agréable que celui de la mer dont elle est éloignée. Derrière cette salle, il y a deux appartements dont les fenêtres dominent l'entrée de la maison, et un autre jardin moins élégant, mais mieux fourni. De là se prolonge une galerie voûtée qu'on prendrait pour un monument public. Elle est percée de fenêtres des deux côtés ; mais, du côté de la mer, le nombre en est double : une seule sur le jardin répond à deux sur la mer. Quand le temps est calme et serein, on les ouvre toutes. Si le vent donne d'un côté, on ouvre, sans aucun risque, les fenêtres de l'autre. Devant cette galerie est un parterre parfumé de violettes. Le soleil, en frappant sur la galerie, en élève la température, et, la galerie, en concentrant, les ardeurs du soleil, repousse et chasse l'aquilon. Ainsi, d'une part, elle retient la chaleur, de l'autre, elle garantit du froid. Elle vous défend aussi de l'autan : de sorte que, de différents côtés, elle offre un abri contre les vents opposée L'agrément qu'elle offre en hiver augmente en été. Avant midi, l'ombre de la galerie s'étend sur le parterre ; après midi, sur la promenade et sur la partie du jardin qui en est voisine. Selon que les jours deviennent plus longs ou plus courts, l'ombre décroît ou s'allonge, soit d'un côté, soit de l'autre. La galerie elle-même ne ressent jamais moins les effets du soleil que quand ses rayons ardents tombent d'aplomb sur la voûte. Je dirai plus, par ses fenêtres ouvertes, elle reçoit et transmet les brises, et l'air qui se renouvelle n'y devient jamais épais ni malfaisant
A l'extrémité du parterre et de la galerie s'élève dans le jardin un pavillon que j'appelle mes délices, mes vrais délices. Je l'ai construit moi-même. Là j'ai une espèce de foyer solaire qui, d'un côté, regarde le parterre, de l'autre la mer, et de tous les deux reçoit le soleil. Son entrée répond à une chambre voisine, et une de ses fenêtres donne sur la galerie. Au milieu du côté qui a la mer pour horizon, j'ai ménagé un cabinet charmant qui, au moyen de vitres et de rideaux que l'on ouvre ou que l'on ferme, peut à volonté se joindre à la chambre ou en être séparé. Il y a place pour un lit et deux chaises. A ses pieds on voit la mer, derrière soi, des villas ; en face, des forêts. Trois fenêtres réunissent ces paysages sans les confondre. De là on entre dans une chambre à coucher où la voix des valets, le bruit de la mer, le fracas des orages, les éclairs et le jour même ne peuvent pénétrer, à moins qu'on n'ouvre les fenêtres. Ce qui rend le calme de cette retraite si profond, c'est qu'entre le mur de la chambre et celui du jardin il existe un espace vide qui absorbe le bruit. A cette chambre tient une petite étuve dont l'étroite fenêtre retient ou dissipera chaleur, selon le besoin. Plus loin on trouve une antichambre et une chambre que le soleil dore à son lever, et qu'il frappe encore après midi, de ses rayons obliques. Quand je suis retiré dans ce pavillon, je crois être bien loin, même de ma villa, et je m'y plais singulièrement, surtout aux Saturnales, tandis que tout le reste de la maison retentit des cris de joie autorisés par la licence de ces jours de fêtes. Ainsi je ne nuis pas plus aux plaisirs de mes gens qu'ils ne troublent mes études.
Ce qui manque à tant d'avantages, à tant d'agréments, ce sont des eaux courantes. A leur défaut, nous avons des puits ou plutôt, des fontaines : car ils sont peu profonds. La nature du terrain est merveilleuse. En quelque endroit que vous le creusiez, vous avez de l'eau à souhait, mais de l'eau pure, et dont la douceur n'est nullement altérée par la proximité de la mer. Les forêts voisines fournissent du bois en abondance, et Ostie procure toutes les autres choses nécessaires à la vie. Le village même peut suffire aux besoins d'un homme frugal, et une seule maison de campagne m'en sépare. On trouve en ce lieu jusqu'à trois bains publics : ressource précieuse, lorsque une arrivée inattendue ou un départ précipité ne permet pas de se baigner chez soi. Tout le rivage est bordé de maisons contiguës ou séparées qui charment par leur diversité, et qui, vues de la mer ou même de la côte, présentent l'aspect d'une multitude de villes. Le rivage, après un long calme, offre une promenade assez douce mais l'agitation fréquente des flots le rend souvent, impraticable. La mer n'abonde point en poissons délicats ; on y prend pourtant des soles et des squilles excellentes. La terre fournit aussi ses richesses à mon habitation. Nous avons surtout du lait en abondance : car c'est là que les troupeaux sa rendent en quittant leurs pâturages, quand ils veulent se reposer à l'ombre ou se désaltérer.
N'ai-je pas raison d'habiter, de chérir cette retraite, et d'en faire mes délices? En vérité, vous êtes trop citadin, si elle ne vous fait pas envie. Venez, je vous en prie, venez ajouter à tous les charmes de ma villa le prix inestimable qu'elle emprunterait de votre présence. Adieu.

XVIII. — Pline à Mauricus.
Quelle commission plus agréable pouviez vous me donner que celle de chercher un précepteur pour les fils de votre frère? Grâce à vous, je reviens à l'école, et je recommence, en quelque sorte, mes plus belles années. Je m'assieds, comme autrefois, au milieu des jeunes gens, et j'éprouve combien mon goût pour les belles lettres me donne de considération auprès d'eux. J'arrivai dernièrement, tandis qu'ils discutaient ensemble dans une assemblée nombreuse, en présence de plusieurs sénateurs. J'entrai. Ils se turent. Je ne vous rapporterais pas ce détail, s'il ne leur faisait plus d'honneur qu'à moi, et s'il ne vous promettait une heureure éducation pour vos neveux.
Il me reste maintenant à vous mander, ce que je pense de chacun des professeurs, quand je les aurais entendu tous. Je tacherai autant du moins qu'une lettre me le permettra, de vous mettre en état de les juger, comme si vous les eussiez entendus vous-même. Je vous dois ce témoignage de zèle et d'affection ; je le dois à la mémoire de votre frère, surtout dans une affaire de cette importance : car que pouvez-vous avoir plus à cœur, que de rendre ses enfants (je dirais les vôtres, si ceux-ci ne vous inspiraient aujourd'hui une plus grande affection), que de rendre, dis-je, ses enfants dignes d'un tel père, et d'un oncle tel que vous? Quand vous ne m'auriez pas confié ce soin, je l'aurais réclamé pour moi. Je sais que le choix d'un maître va m'exposer à des mécontentements mais, pour l'intérêt de vos neveux, il n'est point de mécontentements ni même de rancunes que je ne doive affronter avec autant de courage qu'un père le ferait pour ses propres enfants. Adieu.
XIX. - Pline à Céréalis.
Vous m'engagez à lire mon plaidoyer dans une assemblée d'amis. Je le ferai, puisque vous le désirez mais je ne m'y décide pas sans peine. Je sais qu'à la lecture les harangues perdent leur véhémence et leur chaleur, elles ne méritent presque plus le nom de harangues. Rien ne leur donne ordinairement tant d'intérêt et de feu, que la présence des juges, le concours des avocats, l'attente du succès la réputation des demandeurs et les passions diverses qui partagent l'auditoire. Ajoutez encore le geste de l'orateur, sa démarche, son action et les mouvements de tout son corps en harmonie avec les sentiments qu'il exprime. De là vient que l'action de ceux qui déclament assis, quoiqu'ils conservent d'ailleurs une partie des avantages qu'ils pourraient avoir debout, a quelque chose de faible et de languissant. Quant à ceux qui lisent, ils ne peuvent presque se servir ni des yeux, ni des mains, auxiliaires si puissants de la déclamation. Aussi ne faut-il pas s'étonner que l'attention se refroidisse, lorsque aucune séduction extérieure ne l'entraîne, lorsque aucun aiguillon ne la réveille.
Joignez à ces désavantages celui de traiter un sujet rempli de subtilités et de chicanes. Or il est naturel de croire qu'une imposition pénible sera péniblement écoutée des auditeurs. Où en trouver d'assez raisonnables pour préférer un discours grave et serre à un discours élégant et harmonieux? Il existe une différence fort peu honorable, mais qui n'en est pas moins réelle, entre les juges et les auditeurs : les uns n'aiment rien de ce qu'approuvent les autres. L'auditeur ne devrait être ému que de ce qui le toucherait lui-même, s'il était juge,
Cependant, malgré tant d'obstacles, la nouveauté pourra donner de l'attrait à mon ouvrage, j'entends la nouveauté pour nous : car les Grecs avaient un genre d'éloquence qui, avec certaines différences, ne laissait pas de ressembler à celui-ci. Quand ils combattaient une loi comme contraire à une plus ancienne, ils prouvaient la contradiction, en comparant ces lois avec d'autres qui en déterminaient le sens. Moi, ayant à défendre la disposition que je prétendais trouver dans la loi du péculat, j'ai ajoutée l'autorité de cette loi celle de plusieurs autres qui l'expliquaient. Les ignorant, ne trouveront aucun charme à un ouvrage de cette nature mais il n'en doit obtenir que plus de faveur auprès des gens instruits. Si vous persistez à vouloir que je le lise, je me composerai un auditoire des plus savants. Mais, encore une fois, examinez bien, si je dois m'engager dans cette lecture ; pesez tous les motifs que je viens de vous exposer pour et contre, et n'écoutez, pour vous déterminer, que la raison. Vous seul aurez besoin d'excuse ; je trouverai la mienne dans ma complaisance. Adieu.
XX. — Pline à Galvisius.
Que me donnerez-vous, si je vous raconte une aventure qui vaut son pesant d'or? Je vous en dirai même plus d'une : car la dernière me rappelle les précédentes et qu'importe par laquelle je commencerai? Véranie, fille de Pison (celui qui fut adoptée par Galba), était à l'extrémité. Régulus vint la voir. Quelle impudence, d'abord, à un homme qui avait toujours été l'ennemi déclaré du mari, et qui était en horreur à la femme! Passe encore pour la visite mais il s'assied près de son lit, lui demande le jour, l'heure de sa naissance. A peine a-t-elle satisfait à ses questions, il compose son visage, tient ses yeux fixes, remue les lèvres, et compte sur ses doigts, dans le seul but de tenir en suspens l'esprit de la pauvre malade. Vous êtes, dit-il, dans votre année climatérique mais vous guérirez. Pour plus grande certitude, je vais consulter un devin dont je n'ai pas encore trouvé la science en défaut. A l'instant il fait un sacrifice, et affirme que les entrailles des victimes sont d'accord avec le témoignage des astres. Cette femme crédule, comme on l'est d'ordinaire dans le danger, fait un codicille, et assure un legs à Régulus. Peu après, le mal s'aggrave, et, sur son lit de mort, elle s'écrie : Le scélérat, le perfide, qui enchérit même sur le parjure! Il avait, en effet, juré par les jours de son fils. Ce crime est familier à Régulus. Il expose sans scrupule à la colère des dieux, qu'il trompe tous les jours, la tête de son malheureux fils.
Velléius Blésus, ce riche consulaire, voulait, pendant sa dernière maladie, changer son testament. Régulus, qui se promettait quelque avantage de ce changement, parce qu'il avait su depuis peu s'insinuer dans l'esprit du personnage, s'adresse aux médecins, et les conjure de prolonger à tout prix la vie du malade. Le testament est à peine scellé, que Régulus lève le masque, et prend un autre ton. Eh! combien de temps, dit-il aux médecins, voulez-vous encore tourmenter un malheureux? Pourquoi envier une douce mort à qui vous ne pouvez conserver la vie? Blésus meurt et, comme s'il eût tout entendu, il ne laisse pas une obole à Régulus.
C'est bien assez de deux contes. M'en demandez-vous un troisième, selon le précepte de l'école? il est tout prêt. Aurélie, femme distinguée, allait sceller son testament. Elle se pare de ses plus belles robes. Régulus s'étant rendu à la cérémonie : Je vous prie, d it-il, de me léguer ces vêtements. Aurélie croit qu'il plaisante, Régulus insiste sérieusement. Enfin il la contraint d'ouvrir son testament, et de lui léguer les robes qu'elle portait. Il ne se contenta pas de la voir écrire, il examina si elle avait écrit. Il est vrai qu'Aurélie n'est pas morte mais, pour agir de la sorte, Régulus avait compté, qu'elle n'échapperait pas. Un tel homme ne laisse pas de recueillir des successions et de recevoir des legs, comme s'il le méritait. Mais pourquoi m'en indigner dans une ville où depuis longtemps la fraude et la perversité sont autant ou même plus noblement récompensés que l'honneur et la vertu? Voyez Régulus. Il était pauvre et misérable, il est devenu si riche à force d'infamies, qu'il m'a dit lui-même : Je consultais un jour les dieux pour savoir à quelle époque je parviendrais à posséder soixante millions de sesterces. Des entrailles doubles trouvées dans la victime m'en promirent cent vingt millions. Il les aura, s'il continue à dicter ainsi des testaments, la plus odieuse de toutes les manières de commettre un faux. Adieu.
LIVRE TROISIÈME. Retour
I. — Pline à Calvisius.
Je ne crois pas avoir jamais passé le temps d'une manière plus agréable que dernièrement chez Spurinna. Il m'a tellement charmé, que, s'il m'est donné de vieillir, je ne sache personne à qui je voulusse davantage ressembler dans ma vieillesse. Rien n'est mieux coordonné que son genre de vie et j'aime l'arrangement dans la vie des hommes, surtout dans celle des vieillards, comme j'aime le cours réglé des astres. S'il y a une sorte d'abandon et de laisser aller qui ne sied pas mal aux jeunes gens, rien aussi ne convient mieux aux gens avancés en âge que l'ordre et la tranquillité. Pour eux la brigue est honteuse et l'activité hors de saison. Spurinna observe scrupuleusement cette règle. Je dis plus : il suit périodiquement et successivement ce petit plan de vie, petit, si sa régularité journalière ne lui donnait du prix.
Le matin il reste au lit. À la seconde heure, il se chausse, et fait trois milles à pied. Il n'exerce pas moins son esprit que son corps. S'il est avec des amis, il développe des sujets de morale, s'il est seul, on lui lit quelque livre, on lit même quelquefois lorsqu'il y a des amis, si cela ne leur déplaît pas. Ensuite il se repose, et reprend un livre ou une conversation qui vaut mieux qu'un livre. Puis il monte en voiture avec sa femme, personne d'un rare mérite, ou avec quelqu'un de ses amis, comme dernièrement avec moi. Quelle douceur, quel charme dans ce tête-à-tête ! Quelle connaissance de l'antiquité ! Que d'actions héroïques, que de grands hommes viennent, par sa bouche, vous donner de hautes leçons! et cependant, avec quel soin sa modestie n'évite-t-elle pas les airs dogmatiques ! Quand on a parcouru sept milles, il marche encore un mille. Après cela, il prend quelque repos ou revient travailler dans son cabinet : car il excelle dans la poésie lyrique, en grec et en latin. Ses vers ont une douceur, une grâce, une gaieté merveilleuse, et la vertu de l'auteur en rehausse le prix.
Dès qu'on lui annonce l'heure du bain (c'est la neuvième en hiver, et la huitième en été), il se déshabille et se promène au soleil s'il ne fait point de vent. Ensuite il joue longtemps et avec ardeur à la paume : c'est encore un genre d'exercice qui lui sert à combattre la vieillesse. Après le bain, il se met au lit, et, en attendant le repas, il écoute une lecture agréable et légère. Pendant ce temps, ses amis ont la liberté de s'occuper de la même manière, ou de toute autre, à leur choix. Sa table, aussi élégante que frugale, est servie en argent uni et d'une simplicité antique. On y voit aussi des vases de Corinthe qui l'amusent sans l'attacher. Souvent le repas est entremêlé de comédies, afin d'associer les arts aux plaisirs. Le dîner occupe une partie de la nuit, même en été et personne ne se plaint de la longueur du repas, tant sa conversation a de charmes ! C'est ainsi qu'après soixante-dix-sept ans il jouit pleinement de la vue et de l'ouïe ; c'est ainsi qu'il conserve la force et l'agilité du corps, et qu'il n'a d'un vieillard que la sagesse.
Je souhaite une pareille vie, je la goûte déjà d'avance, et je l'adopterai avec joie, dès que l'âge m'aura permis de sonner la retraite. Cependant je suis harassé de mille travaux mais l'exemple de Spurinna me soutient et me console : car lui aussi, tant que l'honneur l'a commandé, il a rempli des charges publiques, occupé des places, gouverné des provinces, et il a acheté à force de fatigues le repos dont il jouit. Je me propose donc la même carrière, le même but, et j'en prends dès aujourd'hui, l'engagement devant vous : si vous voyez que jamais je m'emporte plus loin, citez-moi devant les juges, en vertu de cette lettre, et faites-moi condamner au repos, quand je n'aurai plus à craindre le reproche de paresse. Adieu.
II. — Pline à Maxime.
Je crois être en droit de vous demander pour mes amis ce que je vous offrirais moi-même pour les vôtres, si j'étais à votre place. Arrianus Maturius tient le premier rang parmi les Altinates. Quand je parle de rang, je ne le règle pas sur les biens de la fortune dont il est comblé, mais sur son honnêteté, sa justice, sa sagesse et ses lumières. Ses conseils dirigent mes affaires, et son goût mes études. Il a toute la droiture, toute la sincérité, toute l'intelligence que l'on peut désirer. Il m'aime (je ne puis dire rien de plus) autant que vous m'aimez. Comme il n'a point d'ambition, il s'est tenu dans l'ordre des chevaliers, quoiqu'il eût pu aisément parvenir aux premières dignités. Je n'en regarde pas moins comme un devoir pour moi de l'élever aux honneurs. Je serais heureux de lui faire obtenir quelque distinction, sans qu'il y songeât, qu'il le sût, et peut-être même malgré lui mais j'en voudrais qui eût de l'éclat, sans lui causer trop d'embarras. C'est une faveur que je vous demande pour lui, à la première occasion qui s'en présentera. Vous aurez en moi, comme en lui, un débiteur plein de reconnaissance : car, quoiqu'il ne convoite pas ces sortes de grâces, il les reçoit comme s'il les avait vivement désirées. Adieu.
III. — Pline à Corellia Hispulla.
Je ne saurais dire si j'avais plus d'admiration que d'amitié pour votre père, homme d'une probité et d'une vertu parfaites. Mais, par respect pour sa mémoire, et pour vos qualités personnelles, je vous suis entièrement attaché. Jugez par là si tous mes vœux, si tous mes efforts doivent contribuer à rendre votre fils semblable à son aïeul ; je dis à son aïeul maternel, quoique son aïeul paternel ait joui de beaucoup d'estime et de considération, et que son père et son oncle soient parvenus au plus haut degré de gloire. Votre fils marchera sur leurs traces, si on lui inculque la vertu mais il est de la plus haute importance de choisir un bon guide. Jusqu'ici son enfance l'a tenu auprès de vous, et sous la direction de ses précepteurs. Là point d'erreurs ou très peu d'erreurs à craindre. Aujourd'hui que ses études doivent dépasser le seuil domestique, il faut chercher un rhéteur dont la sévérité, la sagesse et surtout la moralité soient bien établies : car, entre autres avantages que ce jeune homme a reçus de la nature et de la fortune, il est doué d'une beauté singulière et c'est un motif, dans un âge si fragile, pour lui donner non seulement un précepteur, mais un gouverneur et un guide.
Je ne vois personne plus propre à cet emploi que Julius Génitor. Je l'aime mais l'amitié que je lui porte ne séduit point mon jugement : c'est, au contraire, de mon jugement qu'elle est née. Génitor est un homme grave et irréprochable, peut-être un peu rude et un peu sauvage, si l'on en juge d'après la licence du siècle. Quant à son éloquence, vous pouvez vous en rapporter à l'opinion publique : car le talent oratoire se manifeste de lui-même, et on l'apprécie sur-le-champ. Il n'en est pas ainsi de la moralité : le cœur humain a des abîmes et des replis ténébreux. Sous ce rapport, je me fais la caution de Génitor. Votre fils ne lui entendra rien dire dont il ne puisse faire son profit ; il n'apprendra rien de lui, qu'il eût été mieux d'ignorer. Génitor ne lui rappellera pas moins souvent que vous et moi la glorieuse image de ses ancêtres, et lui fera sentir les obligations que leurs grands noms lui imposent. N'hésitez donc pas, grâce aux dieux, à le mettre entre les mains d'un précepteur, qui formera d'abord ses mœurs, et lui apprendra ensuite l'éloquence que l'on apprend mal sans les bonnes mœurs. Adieu.

IV. — Pline à Macrin.
Quoique ceux de mes amis qui étaient ici présents, et le public même, semblent avoir approuvé ma conduite, je serai pourtant fort aise de savoir ce que vous en pensez. Comme j'eusse voulu régler par votre avis les démarches que j'avais à faire, je désire vivement connaître votre jugement sur celles que j'ai faites.
Après avoir, en qualité de préfet du trésor, obtenu un congé, je m'étais rendu en Toscane pour faire élever à mes frais un monument public. Pendant, mon absence, les députés de la Bétique vinrent supplier le sénat de me nommer leur avocat dans l'accusation qu'ils allaient intenter contre Cécilius Classicus, leur dernier proconsul. Mes collègues dans la charge de préfet du trésor, par un excès de bonté et d'amitié pour moi, représentèrent les devoirs de notre commun emploi, et tâchèrent de n'épargner cette nouvelle obligation. Le sénat prit la décision suivante qui m'est infiniment honorable, que l'on me donnerait pour avocat à la province, si les députés pouvaient m'obtenir de moi-même. A mon retour, les députés, introduits de nouveau dans le sénat, me conjurèrent de ne pas leur refuser mon ministère, en attestent le zèle que j'avais déployé contre Massa Bébius, et l'espèce d'alliance qui unit le défenseur aux clients. Aussitôt j'entendis s'élever ce murmure flatteur qui précède toujours les décrets du sénat. Pères conscrits, dis-je alors, je cesse de croire que mes excuses étaient légitimes. Le motif et la simplicité de cette réponse la firent bien accueillir.
Ce qui me détermina, ce ne fut pas seulement l'approbation du sénat (quoique cette considération fût la plus puissante de toutes), mais encore quelques autres raisons qui, pour être moindres, n'étaient pas à négliger. Je me rappelais que nos ancêtres vengeaient même leurs hôtes privés, en accusant spontanément leurs ennemis, et il me semblait d'autant plus honteux de manquer aux lois d'une hospitalité publique. D'ailleurs, en songeant à quels périls m'avait exposé la défense des peuples de la Bétique , dans la cause que je plaidai pour eux, je me croyais obligé d'assurer, par un second service, le mérite du premier. Car telle est la nature du cœur humain : vous détruisez vos premiers bienfaits, si vous n'en ajoutez de nouveaux. Obligez cent fois, refusez une, on ne se souviendra que du refus. La mort de Classicus m'invitait encore à me charger de cette cause, et en éloignait ce que ce genre d'affaires offre de plus affligeant, le danger où l'on expose un sénateur. Cette condescendance de ma part m'assurait autant de reconnaissance que si Classicus eût vécu, et ne me laissait nul ressentiment à craindre. Enfin je comptais que si l'on me chargeait une troisième fois d'une pareille mission contre quelqu'un qu'il ne me convint pas d'accuser, il me serait plus facile de m'en dispenser : car tout devoir a ses bornes, et notre complaisance prépare une excellente excuse à la liberté de nos refus.
Je vous ai informé des motifs de ma détermination : c'est à vous d'en juger. Votre sincérité ne me fera pas moins de plaisir, si vous me condamnez, que votre suffrage, si vous m'approuvez. Adieu.
V. - Pline à Macer
Je suis charmé de voir que vous lisez avec tant de soin les ouvrages de mon oncle, que vous voulez les posséder tous, les connaître tous. Je ne me contenterai pas de vous les indiquer ; je vous marquerai encore dans quel ordre ils ont été écrits : c'est une connaissance qui n'est pas sans agrément pour les amis des belles-lettres.
Il était commandant de cavalerie, lorsqu'il composa en un volume l'Art de lancer le javelot à cheval, ouvrage où le talent et le soin se font également remarquer. Il a écrit en deux livres la Vie de Pomponius Secondas, qui avait eu beaucoup d'amitié pour lui : ce fut un tribut de reconnaissance qu'il payait à sa mémoire. Il nous a laissé vingt livres sur les guerres de Germanie. Il a rassemblé toutes celles que nous avons soutenues contre les peuples de ce pays. C'est un songe qui lui fit entreprendre cet ouvrage. Il servait dans cette province, lorsqu'il crut voir, pendant son sommeil, Drusus Néron qui, après avoir poussé ses conquêtes jusqu'aux extrémités de la Germanie , y avait trouvé la mort. Ce prince lui recommandait de sauver son nom d'un injurieux oubli. Nous avons encore de lui trois livres, intitulés l'Homme de lettres, que leur étendue obligea mon oncle de diviser en six volumes. Il prend l'orateur au berceau, et le conduit à la plus haute perfection. Il composa huit livres sur les difficultés de la grammaire, pendant les dernières années de l'empire de Néron, où la tyrannie rendait dangereux tout genre d'étude plus libre et plus élevé ; trente et un pour servir de suite à l'histoire qu'Aufidius Bassus a écrite, -trente-sept sur l'histoire naturelle. Ce dernier ouvrage, aussi remarquable par son étendue que par son érudition, est presque aussi varié que la nature elle-même.
Vous êtes surpris qu'un homme si occupé ait put écrire tant de volumes, et y traiter tant de sujets si difficiles. Vous serez bien plus étonné, quand vous saurez qu'il a plaidé pendant quelque temps ; qu'il n'avait que cinquante-six ans quand il est mort, et que sa vie s'est passée dans les occupations et les embarras que donnent les grands emplois et la faveur des princes. Mais il avait un esprit ardent, un zèle infatigable, une application extrême. II commençait ses veilles aux fêtes de Vulcain, non pour en consacrer les prémices, mais pour se mettre à l'étude, dès que la nuit était tout à fait venue ; en hiver, à la septième heure, au plus tard à la huitième, souvent à la sixième. Il se livrait à volonté au sommeil, qui quelquefois le prenait et le quittait, au milieu de son travail.
Avant le jour, il se rendait chez l'empereur Vespasien qui faisait aussi un bon usage des nuits. De là il allait s'acquitter des fonctions qui lui étaient confiées. De retour chez lui, il consacrait à l'étude le temps qui lui restait. Après le repas (toujours simple et léger, suivant la coutume des anciens), s'il avait quelques moments de loisir, en été, il se couchait au soleil. On lui lisait quelque livre. Il prenait des notes et faisait des extraits : car jamais il n'a rien lu sans extraire, et il disait souvent : « Qu'il n'y a point de si mauvais livre qui ne renferme quelque chose d'utile. »
Après s'être retiré du soleil, il prenait d'ordinaire un bain froid. Il mangeait légèrement, et dormait quelques instants. Ensuite, comme si un nouveau jour eût commencé, il reprenait l'étude jusqu'au souper. Pendant ce repas, nouvelle lecture, nouvelles notes prises en courant. Je me souviens qu'un jour un de ses amis interrompit le lecteur qui avait mal prononcé quelques mots, et le fit répéter. Mais vous l'aviez compris? lui dit mon oncle. - Sans doute, répondit son ami. - Et pourquoi donc, reprit-il, le faire recommencer? Votre interruption nous coûte plus de dix lignes. V oilà comment il ménageait le temps. L'été, il sortait, de table avant la nuit et, en hiver, à la première heure, comme s'il y eût été forcé par une loi. Tout cela se faisait au milieu des occupations et du tumulte de la ville. Dans la retraite, il n'y avait que le temps du bain qui fût exempt de travail, je veux dire le temps qu'il passait dans, l'eau : car, pendant qu'il se faisait frotter et essuyer, il écoutait une lecture ou il dictait. En voyage, comme s'il eût été dégagé de tout autre soin, il se livrait entièrement à l'étude. Il avait à ses cotés son livre, ses tablettes et son secrétaire, auquel il faisait prendre ses gants en hiver, afin que la rigueur même de la saison ne pût dérober un moment au travail. C'était par cette raison qu'à Rome il n'allait jamais qu'en litière. Je me souviens qu'un jour il me blâma de m'être promené. Vous pouviez, dit-il, mettre ces heures à profit : car il comptait pour perdu tout le temps qui n'était pas employé à l'étude. C'est par cette forte application qu'il a su achever tant d'ouvrages, et qu'il m'a laissé cent soixante cahiers d'extraits, écrits sur la page et sur le revers en très petits caractères, ce qui rend la collection bien plus considérable. Il m'a dit que, lorsqu'il était intendant en Espagne, il n'avait tenu qu'à lui de la vendre à Largius Licinius quatre cent mille sesterces et alors elle était un peu moins étendue.
Quand vous songez à cette immense lecture, à cette multitude ouvrages qu'il a composés, ne croiriez-vous pas qu'il n'a jamais été ni dans les charges, ni dans la faveur des princes? Et néanmoins, quand vous apprenez combien il sacrifiait de temps au travail, ne trouverons pas qu'il aurait pu lire et composer davantage? Car, d'un côté, quels obstacles les charges et la cour n'apportent-elles point aux études et,de l'autre, que ne devait-on pas attendre d'une si constante application? Aussi je ne puis m'empêcher de rire quand on parle de mon ardeur pour le travail, moi qui, comparé à lui, suis le plus paresseux des hommes. Cependant je donne à l'étude tout ce que les devoirs publics et ceux de l'amitié me laissent de temps. Eh ! parmi ceux qui consacrent toute leur vie aux belles-lettres, quel est celui qui mis en parallèle, ne rougirait de s'être livré, pour ainsi dire, au sommeil et à la mollesse?
Quoique je n'aie eu d'autre intention que de satisfaire votre curiosité en vous apprenant quels ouvrages mon oncle a laissés, j'ai dépassé les bornes de mon sujet. Je me flatte pourtant que les détails où je suis entré ne vous feront pas moins de plaisir que les ouvrages mêmes. Ces détails peuvent non seulement vous engager à les lire, mais encore vous enflammer d'émulation, et vous inspirer le désir d'en imiter l'auteur. Adieu.
VI. —Pline à Sevérus.
Dernièrement j'ai acheté, des revenus d'une succession qui m'est échue, une statue en bronze de Corinthe. Elle est : petite, mais jolie et bien travaillée, si j'en juge d'après mes connaissances qui ne vont loin en aucune matière, mais en celle-ci moins qu'en toute autre. Je crois pourtant pouvoir apprécier le mérite de cette figurine. Comme elle est nue, elle ne cache point ses défauts, et nous étale toutes ses beautés. C'est un vieillard debout. Les os, les fuselés, les nerfs, les veines, les rides mêmes ont quelque chose de vivant. Les cheveux sont rares et tout en arrière, le front large, le visage étroit, le cou maigre, les bras pendants, les seins flasques et le ventre rentré. Le dos seul accuse son âge, autant que le dos peut l'indiquer. Le bronze, à en juger par sa couleur, est fort, ancien. Enfin tout dans cette statue peut intéresser les artistes et charmer les ignorants. C'est ce qui m'a déterminé à l'acheter, quoique je m'y entende fort peu, non pour la garder chez moi (car je ne possède encore aucun bronze de Corinthe) mais pour orner quelque lieu remarquable dans notre patrie, particulièrement le temple de Jupiter. Le présent me paraît digne du temple, digne du dieu. Veuillez donc vous charger, avec le zèle que vous mettez à vous acquitter de toutes mes commissions, de commander un piédestal de quelque marbre qu'il vous plaira. On y inscrira mon nom et mes titres, si vous jugez qu'ils doivent y trouver place. A la première occasion favorable je vous enverrai la statuette ou, mieux encore, je vous l'apporterai moi-même : car je me propose, pour peu que les devoirs de ma charge me le permettent, de faire une excursion chez vous. Je vous vois déjà sourire à cette nouvelle mais vous allez froncer le sourcil : je ne resterai que peu de jours. Les mêmes raisons qui retardent mon départ aujourd'hui, m'interdisent une longue absence. Adieu.
VII. — Pline à Caninius.
Je viens d'apprendre que Silius Italicus s'est laissé mourir de faim dans sa villa près de Naples. La cause de sa mort est sa mauvaise santé. Un abcès incurable l'a dégoûté, de la vie, et l'a fait courir à la mort avec une opiniâtre fermeté. Son bonheur ne fut troublé que par la perte de son second fils. Mais l'aîné, qui était aussi le meilleur des deux, il l'a laissé consulaire et au comble de la prospérité. Sa réputation avait reçu quelque atteinte sous le règne de Néron. Il fut soupçonné de s'être rendu volontairement délateur mais il avait usé en homme sage et obligeant de la faveur de Vitellius. Il acquit de la gloire dans le gouvernement d'Asie et, par une honorable retraite, il avait effacé la tache de son ancien métier. Il a vécu parmi les premiers citoyens de Rome, sans chercher la puissance ni exciter l'envie. On le visitait, on lui rendait des hommages. Quoiqu'il gardât souvent le lit, toujours entouré d'une foule que n'attirait point sa fortune, il passait les jours dans de savants entretiens. Quand il ne composait pas (et il composait avec plus d'art que de génie), il lisait quelquefois des vers pour sonder le goût du public. Enfin, averti par l'âge, il quitta Rome pour se retirer dans la Campanie d'où rien n'a pu l'arracher depuis, pas même l'avènement du nouvel empereur. Cette liberté fait autant d'honneur au prince sous lequel on a pu se la permettre, qu'à celui qui a osé la prendre.
Il avait pour les objets d'art un goût particulier qu'il poussait jusqu'à la manie. Il achetait dans un même pays plusieurs villas et la passion qu'il prenait pour la dernière, le dégoûtait des autres. Il se plaisait à rassembler dans chacune un grand nombre de livres, de statues, de portraits, qu'il ne se contentait pas déposséder, mais qu'il honorait d'un culte religieux, le portrait de Virgile surtout. Il célébrait la naissance de ce poète avec plus de solennité que la sienne propre, principalementà Naples, où il avait coutume de visiter son tombeau aussi respectueusement qu'un temple. Il a vécu dans cette tranquillité plus de soixante-quinze ans avec une complexion moins maladive que délicate. Dernier consul créé par Néron, il mourut aussi le dernier de tous ceux que ce prince avait honorés de cette dignité. Chose encore remarquable! Il se trouvait consul à la mort de Néron, et il a survécu à tous ceux qui avaient été élevés au consulat par cet empereur.
Je ne puis me rappeler ces détails, sans être frappé de la fragilité de notre existence. Qu'y a t'il, en effet, d'aussi court et d'aussi borné que la plus longue vie humaine? Ne vous semble-t-il pas que le règne de Néron finit à peine? Cependant, de tous ceux qui ont exercé le consulat sous lui, il n'en reste pas un seul. Mais pourquoi s'en étonner? Lucius Pison, le père de celui que Valérius Festus assassina si cruellement en Afrique, répétait naguère qu'il ne voyait plus aucun de ceux dont il avait pris l'avis dans le sénat étant consul. Dans cette multitude infinie d'hommes répandus sur la terre, la longévité elle-même est si bornée, que je n'excuse pas seulement, mais que je loue même ces nobles larmes de Xerxès qui, après avoir contemplé son, armée immense, pleura, dit-on, sur le sort de tant de milliers d'hommes qui devaient si tôt finir.
Combien cette idée ne doit-elle pas nous engager à profiter de ce peu d'instants qui nous échappent si vite! Si nous ne pouvons les employer à des actions d'éclat qui appartiennent à d'autres mains que les nôtres, consacrons-les du moins aux belles-lettres. S'il ne nous est pas permis de vivre longtemps, laissons au moins des ouvrages qui attestent que nous avons vécu. Je sais bien que vous n'avez pas besoin d'aiguillon et pourtant mon amitié m'avertit de vous exciter dans votre course, comme vous m'animez dans la mienne. La rivalité est louable, quand deux amis, par de mutuelles exhortations, s'enflamment du désir de l'immortalité. Adieu.

VIII. — Pline à Suétone.
Votre air de cérémonie avec moi ne se dément point, quand vous me priez avec tant de circonspection de faire passer à Césennius Silvanus, votre proche parent, la charge de tribun que j'ai obtenue pour vous de l'illustre Nératius Marcellus. Je n'aurai pas moins de plaisir à vous mettre en état de donner cette place qu'à vous la voir remplir vous-même. Je ne crois point qu'il soit juste d'envier à celui qu'on veut élever aux dignités le titre de bienfaiteur, qui seul vaut mieux que tous les honneurs ensemble. Je sais même qu'il est aussi beau de répandre les faveurs que de les mériter. Vous aurez à la fois cette double gloire, si vous cédez à un autre un poste où votre talent vous appelait. Je sens d'ailleurs que ma vanité est intéressée à ce qu'on sache, par votre exemple, que mes amis peuvent non seulement exercer la charge de tribun, mais même la donner. Je me conforme donc à votre désir dans une choses honorable. Heureusement votre nom n'a pas encore été porté sur le rôle public. Ainsi nous avons la liberté de mettre à la place celui de Silvanus. Puisse-t-il être aussi sensible à cette grâce qu'il reçoit de vous, que vous l'êtes au service que je vous rends! Adieu
IX.- Pline à Minucien.
Je puis enfin vous faire ici le détail de tous les travaux que m'a coûtés la poursuite judiciaire dont je me suis chargé au nom de la province de Bétique. Cette cause a duré plusieurs audiences avec des succès fort différents. Pourquoi des succès différents? pourquoi plusieurs audiences? je vais vous le dire.
Classicus, âme basse et franchement perverse, avait gouverné cette province avec autant de cruauté que d'avarice, la même année que, sous Marius Priscus, l'Afrique éprouvait semblable sort. Priscus était originaire de la Bétique , et Classicus d'Afrique. De là ce bon mot des habitants de la Bétique (car il échappe quelquefois des bons mots à la douleur) : l ' Afrique nous rend ce que nous lui avons prêté. Il y eut pourtant cette différence entre ces deux hommes, que Priscus ne fut poursuivi publiquement que par une seule ville à laquelle vinrent se joindre plusieurs particuliers, tandis que la province entière de Bétique fondit sur Classicus. Il prévint les suites de ce procès par une mort qu'il dut, soit au hasard, soit à son courage car sa mort, qui n'a d'ailleurs rien d'honorable, ne laisse pas d'être équivoque. S'il paraît vraisemblable qu'en perdant l'espoir de se justifier il ait voulu s'arracher la vie, il est étrange qu'un scélérat qui n'a pas rougi de commettre les actions les plus condamnables, ait affronté la mort pour se dérober à la honte de la condamnation. La Bétique néanmoins persistait à le mettre en jugement, malgré sa mort. La loi l'y autorisait mais cette loi était tombée en désuétude, et on la tirait de l'oubli après une longue interruption. Les peuples de cette province allaient encore plus loin : ils accusaient nommément les ministres de Classicus comme complices de ses crimes, et demandaient, justice contre eux.
Je parlais pour la Bétique , et j'étais secondé par Lucéius Albinus dont l'éloquence est à la fois abondante et fleurie. Nous avions déjà de l'amitié l'un pour l'autre mais cette communauté de ministère me l'a rendu bien plus cher encore. Il semble que les rivaux de gloire, surtout, les gens de lettres, aient quelque chose d'insociable. Cependant il n'y eut pas entre nous la moindre lutte, la moindre division. Sans écouter l'amour-propre, nous marchions d'un pas égal où nous appelait le bien de la cause. Sa grandeur et son intérêt nous parurent exiger que chacun de nous ne renfermât pas tant d'actions différentes dans un seul discours. Nous craignions que le jour, que la voix, que les poumons ne nous manquassent, si nous rassemblions, comme en un seul faisceau, tant de crimes et tant de criminels. Tous ces noms, tous ces faits divers pouvaient non seulement épuiser l'attention des juges mais même confondre leurs idées. Nous appréhendions encore que le crédit particulier de chacun des accusés
ne s'accrût en s'étendant à tous. Enfin nous voulions éviter que
le plus puissant ne livrât le plus faible comme une victime expiatoire et ne se sauvât en la sacrifiant : car jamais la faveur et la
brigue n'exercent plus d'empire que lorsqu'elles peuvent se couvrir du masque de la sévérité. Nous songions à Sertorius ordonnant au plus fort et au plus faible de ses soldats d'arracher la
queue d'un cheval. Vous savez le reste. Nous jugions de même
que nous ne viendrions à bout d'une si grande masse d'accusés
qu'en les détachant les uns des autres. La première chose que nous
crûmes devoir établir c'est que Classicus était coupable. C'était
une préparation nécessaire à l'accusation de ses officiers et de
ses complices qui ne pouvaient être reconnus criminels s'il était
innocent. Nous lui en adjoignîmes deux dès le premier moment,
Bébius Probus et Fabius Hispanus, l'un et l'autre redoutables
parleur crédit, Hispanus même par son éloquence. Classicus nous donna peu de peine. Il avait laissé un mémoire écrit de sa main, où l'on trouvait au juste ce que lui avait valu chacune de ses concussins. Nous avions même une lettre de lui pleine de morgue et d'insolence, qu'il avait écrite à une de ses maîtresses à Rome : « Victoire, victoire, lui disait-il, je reviens près de toi, libre de toute dette. J'ai enfin gagné quatre millions de sesterces sur la vente d'une partie des domaines de la Bétique. Probus et Hispanus nous embarrassèrent davantage. Avant d'entrer dans l'exposition de leurs crimes, je crus nécessaire d'établir que l'exécution d'un ordre inique était un crime, autrement j'eusse inutilement prouvé qu'ils avaient accompli les ordres de Classicus. Car ils ne niaient pas les faits dont ils étaient chargés, mais ils s 'excusaient sur la nécessité d'obéir. Habitants de la province, disaient-ils, ils étaient soumis par la crainte à toutes les volontés des proconsuls. Claudius Restitutus, qui me répliqua, a pour lui une longue habitude du barreau, et un esprit vif qui lui fournit la réponse aux arguments les moins prévus. Cependant il avoue hautement que jamais il ne fut plus troublé, plus déconcerté, que lorsqu'il se vit d'avance arracher les seules armes où il avait mis sa confiance. Voici le dénoûment. Le sénat ordonna que les biens dont Classicus jouissait, avant qu'il prit possession de son gouvernement, seraient séparés des autres. Les premiers furent abandonnés à sa fille, les seconds rendus aux peuples dépouillés. On alla plus loin : on ordonna que les créanciers qu'il avait payés restitueraient ce qu'ils avaient reçu, et l'on exila pour cinq ans Hispanus et Probus : tant on jugea coupable ce qui d'abord avait à peine semblé suffire pour motiver une accusation ! Peu de jours après, nous plaidâmes contre Clavius Fuscus, gendre de Classicus, et contre Stillonius Priscus qui avait commandé une cohorte sous Classicus. Leur sort fut différent. On bannit Priscus de L'Italie pour deux ans. Fuscus fut renvoyé absous. Dans la troisième audience, il nous sembla, plus convenable de rassembler un grand nombre de complices. Il nous parut à craindre qu'en faisant traîner plus longtemps cette affaire, le dégoût et l'ennui ne refroidissent l'attention des juges, et ne lassassent leur sévérité. Il ne restait d'ailleurs que des criminels d'une moindre importance, et que nous avions tout exprès réservés pour les derniers. J'en excepte pourtant la femme de Classicus. On avait assez d'indices pour la soupçonner, mais non assez de preuves pour la convaincre. A l'égard de sa fille aussi accusée, les soupçons même manquaient. Lors donc qu'à la fin de cette audience j'eus à parler d'elle, n'ayant plus à craindre, comme au commencement, d'ôter à l'accusation quelque chose de sa force, j'obéis à l'honneur qui me faisait une loi de ne point opprimer l'innocence. Je ne me contentai pas de le penser, je le dis librement, et de plus d'une manière. Tantôt je demandais aux députés s'ils m'avaient instruit de quelque fait qu'ils pussent se promettre de prouver contre elle tantôt je m'adressais au sénat, et le suppliais de me dire s'il croyait qu'il me fût permis d'abuser du peu d'éloquence que je pouvais avoir pour accabler une femme innocente, et pour lui plonger le poignard dans le sein. Enfin je conclus par ces paroles : On me dira: Vous vous érigez donc en juge? Non, mais je n'oublie pas que je suis un avocat tiré du nombre des juges.
Telle a été la fin de cette longue affaire. Les uns ont été absous, la plupart condamnés et bannis, ou à temps, ou à perpétuité. Le décret du sénat loue en termes fort honorables notre talent, notre zèle, notre fermeté et cela seul pouvait dignement récompenser de si grands travaux. Vous comprenez aisément à quel point m'ont fatigué tant de plaidoiries, tant de débats, tant de témoins à interroger, à raffermir, à réfuter. D'un autre côté, qu'il était difficile et embarrassant de se montrer inexorable aux sollicitations secrètes, et de résister en face aux protecteurs d'un si grand nombre de coupables ! En voici un exemple. Quelques-uns des juges eux-mêmes, au gré desquels je pressais trop un accusé des plus accrédités, se récrièrent hautement. Il n'en sera pas moins innocent, leur répliquai-je, quand j'aurai tout dit contre lui. Imaginez par là quelles luttes il m'a fallu essuyer, quelles inimitiés je me suis attirées! mais pour peu de temps, il est vrai ! car l'intégrité, qui blesse d'abord ceux auxquels elle résiste, devient bientôt l'objet de leur admiration et de leurs louanges.
Je ne pouvais pas vous exposer plus clairement toute cette affaire. Vous allez me dire : Elle n'en valait pas la peine, je me serais bien passé d'une si longue lettre. Cessez donc de me demander de temps en temps ce que l'on fait à Rome et souvenez-vous qu'une lettre n'est pas longue, lorsqu'elle embrasse tant de journées, tant d'audiences, enfin tant d'accusés et de causes différentes. Il n'était pas possible, ce me semble, de vous mander tout cela, ni en moins de mots, ni plus exactement. Mais je me vante à tort d'exactitude. Il me revient un peu tard une circonstance qui m'était échappée. Je vais la rappeler ici, quoiqu'elle n'y soit pas à sa place naturelle. Homère et tant d'habiles gens, à son exemple, n'en usent-ils pas de même? et, après tout, cela n'a-t-il pas son agrément? Moi, je l'avoue, je n'y ai pas mis cette savante intention.
L'un des témoins, ou mécontent de se voir cité malgré lui, ou suborné par quelqu'un des complices voulait désarmer l'accusation, accusa Norbanus Licinianus, l'un des députés et l'un des commissaires, de prévariquer en ce qui regardait Casta, femme de Classicus. Les lois veulent que l'on juge l'accusation principale, avant d'entrer en connaissance de la prévarication, parce que rien n'est plus propre à faire bien juger de la prévarication que l'accusation même. Cependant ni la disposition des lois, ni la qualité de député, ni la fonction de commissaire ne purent garantir Norbanus : tant on avait de haine et d'indignation contre lui! C'était un scélérat qui avait profité du règne de Domitien, comme tant d'autres, et que la province avait choisi pour informer dans cette affaire, en considération, non de sa droiture et de sa fidélité mais de sa haine déclarée contre Classicus qui l'avait fait exiler. Norbanus demandait qu'on lui accordât jour, et qu'on établit les chefs d'accusation. On n'eut pas plus d'égard à cette seconde demande qu'à la première. Il fallut répondre sur le champ. Il répondit. Son caractère fourbe et méchant ne me permet pas de décider si ce fut avec audace ou avec fermeté mais il est certain que ce fut avec beaucoup de présence d'esprit. On le chargea d'une multitude de faite particuliers qui lui firent plus de tort que la prévarication. Ce n'est pas tout. Deux consulaires, Pomponius Rufus et Libo Frugi, déposèrent contre lui que, sous le règne de Domitien, il avait plaidé pour les accusateurs de Salvius Libéralis. Norbanus fut condamné et relégué dans une île. Ainsi, lorsque j'accusai Casta, j'appuyais principalement sur le jugement de prévarication prononcé contre son accusateur mais j'appuyait inutilement car il arriva une chose toute nouvelle, et qui paraît impliquer contradiction. Les mêmes juges qui avaient déclaré l'accusateur convaincu de prévarication, prononcèrent l'absolution de l'accusée.
Vous êtes curieux de savoir quelle fut notre conduite dans cette conjoncture. Nous représentâmes au sénat, que nous tenions de Norbanus seul toutes nos instructions, et que, s'il était jugé prévaricateur, il nous fallait prendre des informations nouvelles. Après cela, pendant toute l'instruction de son procès, nous demeurâmes spectateurs. Pour lui, il continua d'assister à toutes les séances, et, montra jusqu'à la fin, la même fermeté, ou la même audace.
J'examine si je n'omets pas encore quelque chose. Oui, j'allais oublier que, le dernier jour, Salvius Libéralis parla fortement contre tous les autres députés, leur reprochant d'épargner plusieurs personnes qu'ils avaient ordre d'accuser. Comme il a du feu et de l'éloquence, il les mit en danger. Je les défendis, parce que j'étais convaincu de leur probité. Ils se montrent fort reconnaissants, et ne se lassent pas de dire que je les ai sauvés d'une terrible tempête. Ce sera, ici, pour le coup, la fin de ma lettre.Je n'y ajouterai pas une syllabe, quand même je m'apercevrais que j'ai oublié quelque chose. Adieu.

X. - Pline à Spurinna et à Coccia.
Si, la dernière fois que je me trouvai chez vous, je ne vous dis pas que j'avais composé un ouvrage à la louange de votre fils, c'est que d'abord je ne l'avais pas composé pour le dire, mais pour satisfaire à ma tendresse et à ma douleur ensuite, je croyais que ceux qui avaient entendu la lecture de mon ouvrage, et qui vous en avaient parlé (vous me l'avez dit vous-même, Spurinna), vous en auraient appris en même temps le sujet. Je craignais d'ailleurs de troubler vos jours de fête en rappelant un si cruel souvenir. J'ai même encore un peu hésité aujourd'hui pour savoir si je vous enverrais le fragment que j'ai lu et que vous me demandez, ou si je n'y ajouterais pas d'autres écrits que je destiné à un second volume : car il ne suffit pas à ma sensibilité de ne consacrer qu'un livre à une mémoire si chère et si précieuse. Pour que la gloire de votre fils s'étende aussi loin qu'elle le mérite, il faut qu'on la répande et qu'on la divise en quelque sorte. Ne sachant donc si je vous adresserais tout ce que j'ai composé sur ce sujet, ou si j'en retiendrais une partie, j'ai trouvé qu'il convenait mieux à ma franchise et à notre amitié de vous envoyer tout, principalement après la promesse que vous me faites d'en garder le secret jusqu'à ce que je veuille publier ces écrits.
Il ne me reste plus qu'a vous demander une grâce, c'est de vouloir bien me dire avec la même franchise ce que je dois ajouter, changer, supprimer. Cette tâche sans doute est difficile dans la préoccupation de votre douleur. Je le sais mais agissez avec moi comme avec un sculpteur, avec un peintre, qui travaillerait à la statue, au portrait de votre fils. Vous l'avertiriez de ce qu'il doit s'attacher à rendre et à corriger. Ayez pour moi la même attention : conduisez ma main. Elle ne trace pas une image fragile et périssable, mais immortelle, comme vous le pensez. Plus cette image sera naturelle, ressemblante, parfaite, plus elle sera durable. Adieu.
XI. — Pline à Julius Génitor.
Notre cher Artémidore a une si belle âme, qu'il exagère toujours les services de ses amis. Il est vrai qu'il a reçu de moi celui dont il vous a parlé mais, en le publiant partout, il l'estime plus qu'il ne vaut. Les philosophes avaient été chassés de Rome. J'allai le trouver dans une maison qu'il avait aux portes de la ville. J'étais alors préteur, ce qui rendait ma visite plus remarquable et plus dangereuse. Il lui fallait une somme importante pour acquitter une dette qui avait les motifs les plus honorables. Plusieurs de ses amis, riches et puissants, hésitaient. Moi, j'empruntai la somme, et je lui en fis don. A l'époque où je lui rendais ce service, on venait d'envoyer à la mort ou en exil sept de mes amis : Sénécion, Rusticus, Helvidius, à la mort, Mauricus, Gratilla, Arria et Fannia, en exil. La foudre tombée tant de fois autour de moi semblait, d'après certains signes, menacer ma tête du même sort. Cependant je ne crois pas avoir mérité la gloire éclatante qu'il m'accorde, je n'ai fait qu'éviter le déshonneur. C. Musonius, son beau-père, m'avait inspiré une grande admiration et une tendresse aussi vive que le permettait la différence de nos âges. Artemidore lui-même était déjà l'un de mes plus intimes amis, quand je servais, en qualité de tribun, dans l'armée de Syrie. C'est le premier témoignage que j'aie donné d'un naturel assez heureux pour avoir paru comprendre un sage, ou du moins pour un homme qui ressembles fort à ceux qui portent ce nom. Car parmi tous ceux qui s'arrogent aujourd'hui le titre de philosophes, vous en trouverez à peine un ou deux aussi sincères, aussi vrais que lui. Je ne vous dirai point qu'il brave également l'excès de la chaleur et du froid, qu'il est infatigable dans les travaux, qu'il n'accorde rien aux plaisirs de la table, et que ses yeux sont aussi chastes que ses désirs. Ces choses auraient de l'importance dans un autre, chez lui, elles ne sont presque rien, comparées à ses autres vertus. Il doit à ces vertus la préférence que C Musonius lui donna sur des rivaux de tous les rangs, lorsqu'il le choisit pour gendre.
Je ne puis rappeler ces souvenirs, sans être flatté des éloges dont il me comble dans le monde et auprès de vous. Toutefois (pour en revenir à mon début) je crains que son caractère généreux n'outrepasse comme toujours, la mesure. Cet homme, d'ailleurs si sage, n'a qu'un défaut, bien honorable sans doute, mais qui n'en existe pas moins, c'est d'estimer quelquefois ses amis au delà de leur valeur. Adieu.
XII. - Pline à Catilius.
J'irai souper chez vous. Mais voici mes conditions : repas court et frugal, rien en abondance que les propos philosophiques et, en cela même, point d'excès. Craignons d'être surpris avant le jour par ces clients que Caton lui-même ne rencontra pas impunément. Je sais bien que C. César, à cette occasion, le blâme et le loue tout ensemble. Il montre, en effet, ceux qui rencontrèrent Caton pris de vin, rougissant dès qu'ils lui eurent découvert le visage. On eût dit, ajoute-t-il, que Caton les avait pris en faute, et non qu'ils venaient de surprendre Caton. Quelle plus haute idée pouvait-on donner du caractère de Caton, que de représenter le respect qu'il inspirait, encore, malgré son ivresse? Pour nous, réglons la durée, aussi bien que l'ordre et la dépense de notre repas : car nous ne sommes pas de ceux que leurs ennemis ne sauraient blâmer, sans les louer en même temps. Adieu.
XIII. - Pline à Romanus.
Je vous envoie, comme vous le désiriez, le discours de remercîment que j'adresse à notre bon prince en commençant mon consulat. Vous l'auriez reçu, quand même vous ne me l'eussiez pas demandé. Ne considérez pas moins, je vous prie, la difficulté que la beauté du sujet. Dans, tous les autres, la nouveauté seule suffit pour soutenir l'attention du lecteur. Ici tout est connu, tout a été dit et répété, en sorte que le lecteur n'ayant plus à s'occuper des faits, et tranquille sur ce point, s'attache uniquement au style et le style résiste difficilement à une critique dont il est le seul objet. Plût aux dieux que l'on s'arrêtât du moins au plan, aux transitions, aux ornements du discours! Car les plus grossiers peuvent quelquefois inventer heureusement et s'exprimer en termes pompeux mais ordonner avec goût, et varier les figures, n'est du ressort que de l'art. Il ne faut pas même viser toujours à l'élévation et à l'éclat. Dans un tableau, rien ne fait tant valoir la lumière que le mélange des ombres. Il en est de même d'un discours : il faut, savoir tour à tour, en élever, en abaisser le ton. Mais que je parle à un maître. Je devrais plutôt le prier de bien vouloir me marquer les passages à corriger. Je serai plus persuadé que vous approuvez le reste, si je vois que vous critiquez les endroits faibles. Adieu.
XIV. - Pline à Acilius.
Voici un crime dont une lettre ne suffit pas pour faire sentir toute l'horreur. Les esclaves de l'ancien préteur Largius Macédo, viennent d'exercer sur lui les dernières atrocités. C'était un maître hautain, cruel, et qui avait oublié, ou plutôt qui se souvenait trop que son père avait été lui-même esclave. Il prenait un bain dans sa villa de Formies, lorsque tout à coup ses gens l'environnent. L'un le saisit à la gorge, l'autre le frappe au visage, celui-ci au ventre, celui-là à la poitrine, et (chose affreuse!) jusqu'aux parties naturelles. Lorsqu'ils crurent l'avoir tué, ils le jetèrent sur des dalles brûlantes pour s'assurer qu'il était sans vie. Soit qu'en effet il eût perdu le sentiment, soit qu'il feignit de ne rien sentir, Macédo demeure étendu et immobile, et les confirme dans la pensée qu'il est mort. Enfin ils l'emportent, comme s'il eût été suffoqué par la chaleur du bain. Ceux de ses esclaves qui n'étaient point complices s'approchent alors de lui. Ses concubines accourent en poussant de grands cris. Réveillé par le bruit, et ranimé par la fraîcheur du lieu, Macédo entr'ouvre les yeux, et, par un léger mouvement, annonce qu'il vit encore : il le pouvait alors sans danger. Les esclaves prennent la fuite. On en arrête une grande partie et l'on court après les autres. Quant au maître, ranimé à grand'peine, il meurt au bout de quelques jours avec la consolation d'être vengé, de son vivant, comme on venge les morts. Voyez-vous à quels périls, à quelles insolences et à quels outrages nous sommes exposés ! Il ne faut pas se croire en sûreté parce qu'on est indulgent et humain : car ce n'est point par raison, mais par fureur que les esclaves égorgent leurs maîtres.
C'en est assez sur ce sujet. N'y a-t-il plus rien de nouveau? Rien. Je ne manquerais pas de vous l'écrire : car j'ai encore de la place sur mes tablettes, et c'est jour de fête. J'ajouterai pourtant ce qui me revient à propos du même Macédo. Un jour qu'il prenait à Rome un bain public, il lui arriva une aventure remarquable, et de mauvais augure, comme la suite l'a prouvé. Un de ses esclaves, pour lui ouvrir passage, poussa légèrement un chevalier romain. Celui-ci, se retournant, au lieu de s'adresser à l'esclave, donna un si rude soufflet au maître, qu'il pensa le renverser. Ainsi le bain a été en quelque sorte graduellement funeste à Macédo. La première fois, il y reçut un affront, la seconde fois, il y trouva la mort. Adieu.
XV. — Pline à Proculus.
Vous me demandez de lire vos ouvrages dans ma retraite, et de vous dire s'ils sont dignes d'être publiés. Vous employez la prière, vous alléguez des exemples, vous me conjurez même de dérober à mes études une partie du loisir que je leur destine, et de la consacrer à l'examen de vos travaux, enfin, vous me citez Cicéron, qui protégeait les poêles avec une bonté extraordinaire. Vous n'aviez nul besoin de me prier et de me presser : car j'adore la poésie, et j'ai pour vous une tendresse extrême. J'obtempérerai donc à vos désirs avec autant d'empressement que de joie. Je pourrais déjà vous mander que votre ouvrage est bon, et qu'il mérite de paraître, du moins, autant que j'en puis juger par les fragments que vous avez lus devant moi, et si votre manière de lire ne m'en a point imposé : car votre débit est plein d'art et de charme. Mais j'ai assez bonne opinion de moi-même pour croire que le prestige du débit ne va point jusqu'à m'ôter le jugement. Il peut bien le séduire et le surprendre, mais non le corrompre, ni l'altérer. Ainsi j'ai déjà le droit de prononcer sur l'ensemble de l'ouvrage. La lecture m'apprendra ce que je dois penser de chaque partie. Adieu.

XVI.- Pline à Népos.
J'avais déjà remarqué, ce me semble, que, parmi les actions et les paroles des hommes et des femmes illustres, les unes ont plus d'éclat, les autres plus de grandeur réelle. L'entretien que j'eus hier avec Fannia m'a confirmé dans cette opinion. C'est la petite-fille de cette célèbre Arria qui, par son exemple, apprit à son mari à mourir sans regret. Fannia me racontait beaucoup d'autres traits d'Arria, non moins héroïques, quoique moins connus. Je pense que vous aurez autant de plaisir à lire ces actions admirables, que j'en ai eu à les entendre.
Son mari et son fils étaient en même temps attaqués d'une maladie qui paraissait mortelle. Le fils mourut. C'était un jeune homme dont la rare modestie égalait la beauté, et plus cher encore à ses parents, par ses vertus que par le nom de fils. Arria fit préparer et conduire si secrètement le deuil, que le père n'en sut rien. Je dirai plus : toutes les fois qu'elle entrait dans la chambre de son mari, elle lui faisait croire que leur fils était vivant, que même il allait mieux et, comme Pétus insistait souvent, sur l'état de sa santé, elle répondait qu'il avait bien dormi, et mangé avec appétit. Enfin, lorsqu'elle sentait que ses larmes, longtemps contenues, allaient s'échapper et la trahir, elle sortait, elle s'abandonnait à sa douleur et, après l'avoir soulagée, elle rentrait, les yeux secs, le visage serein, comme si elle eût laissé sa douleur à la porte. Il est beau, sans doute, de prendre, comme elle, un poignard, de l'enfoncer dans son sein, de l'en tirer tout sanglant, et de le présenter à son mari, en lui disant ces mots impérissables et sublimes : Pétus, cela ne fait point de mal. Mais, après tout, dans ses paroles et dans son acte, elle était soutenue par la gloire et l'immortalité présentes à ses veux. Combien n'est-il pas plus grand, en l'absence de ces brillantes illusions, de cacher ses larmes, d'ensevelir son deuil, et de jouer encore le rôle de mère, quand on n'a plus de fils !
Scribonien avait pris les armes en Illyrie contre l'empereur Claude. Pétus avait suivi le parti de la révolte, et, après la mort de Scribonien, on le traînait à Rome. On allait l'embarquer. Arria conjurait les soldats de la recevoir avec lui. Tous devez, leur disait-elle, accorder à un consulaire quelques esclaves qui le servent à table, qui l'habillent, qui le chaussent. Seule, je lui rendrai tous ces services. Sur leur refus, elle loua une petite barque de pêcheur, et se mit à suivre le grand navire. Arrivée à Rome, elle rencontra dans le palais de l'empereur la femme de Scribonien qui révélait les complices, et qui voulut lui parler. Moi, t'écouter, lui dit-elle, toi qui as vu égorger ton mari entre tes bras, et qui vis encore! Il est aisé de juger par là qu'Arria s'était décidée longtemps d'avance à sa glorieuse mort.
Un jour Thraséas, son gendre, la conjurait de renoncer à la résolution de mourir : Vous voulez donc, lui dit-il entre autres choses, si l'on me force à quitter la vie, que votre fille la quitta avec moi? - Oui, répondit-elle, quand elle aura vécu avec vous aussi longtemps, et dans une aussi parfaite union que j'ai vécu avec Pétus. Ces paroles avaient redoublé l'inquiétude de sa famille. On l'observait avec plus d'attention. Elle s'en aperçut : Vous perdrez votre temps, dit-elle. Vous pouvez, sans doute, m'épargner une mort cruelle mais il n'est pas en votre pouvoir de m'empêcher de mourir. En achevant ces paroles, elle s'élança de son siège, se frappa la tête avec une extrême violence contre le mur, et tomba sans connaissance. Revenue à elle-même, Je vous avais bien avertis, dit-elle, que je saurais trouver la mort par les voies les plus pénibles, si vous me fermiez les plus douces. Ces traits ne vous paraissent-ils pas plus héroïques encore que le Pétus, cela ne fait pas de mal, auquel d'ailleurs ils conduisent naturellement? Tout, le monde parle de ce dernier trait, les autres sont inconnus. Je conclus, ce que je disais en commençant, que parmi les belles actions les unes ont plus d'éclat, les autres plus de grandeur réelle. Adieu.
XVII. - Pline à Servien.
Tout va-t-il bien? J'en doute. Il y a si longtemps que je n'ai reçu de vos nouvelles! Si tout va bien, êtes-vous occupé? Si vous ne l'êtes pas, les occasions d'écrire sont-elles rares, ou vous manquent-elles? Tirez-moi de cette inquiétude que je ne puis plus supporter, envoyez-moi un courrier, s'il le faut. Qu'il vienne m'annoncer ce que je désire, je lui paierai son voyage, je lutterai même un cadeau. Pour moi, je me porte bien si c'est se bien porter que de vivre dans l'incertitude et dans les alarmes, que d'attendre à chaque instant, que de craindre pour la tête la plus chère tous les malheurs qui nous menacent. Adieu.
XVIII. — Pline à Sévérus.
Les devoirs du consulat m'obligeaient à remercier le prince au nom de la république. Après m'en être acquitté dans le sénat avec la brièveté qu'exigeaient le lieu, le temps, la coutume, j'ai pensé qu'en bon citoyen, je devais écrire le discours que j'avais prononcé, et donner au sujet plus de développement et d'étendue. Mon dessein a été d'abord, par un sincère éloge, de rendre à notre empereur ses vertus plus chères, et ensuite de tracer à ses successeurs, par son exemple mieux que par aucun précepte, la route qu'ils devaient suivre pour arriver à la même gloire. Car, s'il est beau d'enseigner aux princes leurs devoirs, cette tâche offre quelques difficultés et décèle quelque présomption. Mais louer un prince accompli, montrer, comme du haut d'un phare, aux empereurs futurs une lumière qui les guide, c'est être aussi utile et plus modeste.
Voici, au reste, une circonstance qui m'a été fort agréable. Quand je voulus lire cet ouvrage à mes amis, je ne les invitai point par billets ou par circulaires. Je les priai de venir, si cela ne les gênait en rien, s'ils étaient entièrement libres (et vous savez qu'à Rome on n'a jamais ou presque jamais le loisir ou la fantaisie d'assister à une lecture). Cependant, ils sont venus deux jours de suite, et par le temps le plus affreux et quand, par discrétion, je voulais borner là ma lecture, ils exigèrent, de moi une troisième séance. Est-ce à Pline, est-ce aux lettres qu'ils ont fait cet honneur? J'aime mieux croire que c'est aux lettres dont l'amour presque éteint se rallume aujourd'hui.
Mais pour quel sujet ont-ils montré tant d'empressement? Comment se fait-il que ce qui nous ennuyait pour quelques moments d'attention, même dans le sénat, où il fallait bien le souffrir, on se plaise aujourd'hui à le lire et à l'écouter pendant trois jours? Ce n'est pas que l'orateur soit plus éloquent mais son discours a été écrit avec plus de liberté, et par conséquent avec plus de plaisir. Le règne de notre prince aura donc encore cette gloire, que l'on y verra ces harangues, odieuses naguère parce qu'elles étaient faussées, devenir agréables à tous parce qu'elles sont sincères. Pour moi, je n'ai pas été moins charmé du goût de mes auditeurs que de leur empressement. Je me suis aperçu que les endroits les moins fleuris obtenaient le plus d'estime. Il est vrai que je n'ai lu qu'à peu de personnes cet ouvrage fait pour tout le monde. Cependant cette approbation éclairée me flatte singulièrement : elle semble me répondre de celle du public. Si l'on a vu jadis des musiciens enseigner à mal chanter sur nos théâtres, j'espère qu'aujourd'hui les mêmes théâtres vont enseigner à bien chanter. Car ceux qui écrivent pour plaire se règlent toujours sur le goût général. Toutefois, dans ce genre de composition, j'ai cru devoir me permettre les agréments du style, attendu que ce qu'il y a de sérieux et d'austère dans mon ouvrage pourra paraître moins naturellement amené que ce que j'ai écrit avec enjouement et avec abandon. Je n'en souhaite pas moins ardemment que ce jour vienne enfin (et fût-il déjà venu!), où le style mâle et nerveux bannira le style agréable et joli des sujets même où il règne le plus légitimement.
Voilà ce que j'ai fait pendant trois jours. Je ne veux pas que votre absence vous dérobe rien des plaisirs que votre amitié pour moi et votre goût pour les belles-lettres vous eussent donné, si vous aviez été présent. Adieu.
XIX. — Pline à Calvisius Rufus.
J'ai, selon ma coutume, recours à vos conseils pour une affaire domestique. Une terre voisine des miennes, et qui s'y trouve enclavée, est à vendre. Bien des raisons m'engagent à l'acheter, quelques autres, non moins fortes, m'en détournent. Le plaisir de joindre cette terre à celle que je possède, première amorce. Seconde tentation, l'agrément, et tout à la fois l'avantage de n'être obligé, pour les visiter toutes deux, ni à double voyage, ni à double dépense ; de les régir par un même intendant, et presque par la mêmes fermiers ; de cultiver et d'embellir l'une et de me contenter d'entretenir l'autre. Je compte encore que je m'épargne les frais d'un mobilier nouveau, des portiers, des jardiniers, d'autres ouvriers, et des équipages de chasse. Il n'est pas indifférent d'avoir à faire ces dépenses en un seul lieu ou en plusieurs.
D'un autre côté, je crains qu'il n'y ait quelque imprudence à exposer un bien si considérable aux mêmes accidents, aux influences du même climat. Il me paraît plus sûr de se précautionner contre les caprices de la fortune par la différente situation de nos terres. Et même n'est-il pas agréable de changer quelquefois de terrain et d air, et le voyage d'une villa à l'autre n'a-t-il pas ses charmes? Mais venons au point capital. Le terroir est gras, fertile, arrosé. Le bien consiste en terres labourables, en vignes et en bois dont la coupe est d'un revenu modique, mais certain. Cependant l'indigence des cultivateurs nuit à la fécondité de la terre. Le dernier propriétaire a vendu plus d'une fois tout ce qui servait à la faire valoir et, par cette vente, en diminuant pour le présent les arrérages dont les fermiers étaient redevables, il leur était tous les moyens de se relever, et les surchargeait de nouvelles dettes. Il faut donc établir un grand nombre de bons fermiers : car nulle part je n'emploie d'esclaves enchaînés, et tout le monde en use comme moi dans le pays, je n'ai plus qu'à vous instruire du prix de cette terre, il est de trois millions de sesterces. Il s'est élevé autrefois jusqu'à cinq. Mais la diminution du revenu, causée, soit par le manque de cultivateurs, soit par la misère des temps, a naturellement diminué le prix du fonds. Vous me demandez si je puis aisément rassembler trois millions de sesterces. Il est vrai que la plus grande partie de mon bien est en terres. J'ai pourtant quelque argent dans le commerce et d'ailleurs je ne me ferais pas scrupule d'emprunter, J'ai toujours une ressource prête dans la bourse de ma belle-mère où je puise aussi librement que dans la mienne. Ainsi, que cela ne vous arrête point, si le reste vous plaît. Apportez-y, je vous prie, la plus grande attention: car, en économie, comme en toutes choses, vous avez infiniment d'expérience et de sagesse. Adieu.

XX. — Pline à Maxime.
Vous avez lu souvent (vous devez vous en souvenir) quelles luttes excita la loi qui créait le scrutin secret, quels applaudissements, quels reproches elle attira d'abord à son auteur. Cependant le sénat vient de l'adopter sans contradiction, comme une mesure fort sage. Le jour des comices, chacun a demandé le scrutin. Il faut avouer que la coutume de donner son suffrage publiquement et à haute voix avait banni de nos assemblées toute bienséance. On ne savait plus ni parler à son tour, ni se taire à propos, ni se tenir en place. C'était partout des clameurs discordantes. Chacun courait de tous côtés avec les candidats qu'il protégeait. Des groupes tumultueux, formés en vingt endroits, pré sentaient la plus indécente confusion : tant nous nous étions éloignés des habitudes de nos pères chez qui l'ordre, la modestie,
le calme, répondaient à la majesté du lieu et au respect qu'il exige!
Des vieillards m'ont souvent décrit les anciens comices. Celui qui se présentait pour une charge était appelé à haute voix. Il se faisait un profond silence. Le candidat prenait la parole. Il rendait compte de sa conduite, et citait pour témoins et pour garants, ou celui sous, les ordres duquel il avait porté les armes, ou celui dont il avait été questeur, ou l'un et l'autre, s'il le pouvait. Il nommait quelques-uns de ses protecteurs. Ceux-ci pariaient en sa faveur avec autorité et en peu de mots. Ce témoignage était plus puissant que les prières. Quelquefois le candidat attaquait la naissance, l'âge ou même la moralité de son compétiteur. Le sénat écoutait avec une gravité austère, et le mérite l'emportait ainsi presque toujours sur le crédit.
Ces coutumes, altérées par l'excès de la brigue, nous ont forcés de chercher un remède dans les suffrages secrets et certainement il a été efficace, parce qu'il était nouveau et imprévu. Mais je crains que de ce remède même ne dérivent dans la suite d'autres maux, et que le mystère du scrutin ne protège l'impudeur. Combien se trouve-t-il de personnes sur qui la probité garde autant d'empire en secret qu'en public ? Bien des gens craignent l'opinion, très peu leur conscience. Mais je m'alarme trop tôt sur l'avenir. En attendant, grâce au scrutin, nous aurons pour magistrats ceux qui sont les plus dignes de l'être. Il en a été, dans cette élection, comme dans les jugements récupératoires : pris au dépourvu, nous avons été justes.
Je vous ai mandé ces détails, d'abord pour vous apprendre quelque chose de nouveau, ensuite pour n'entretenir de temps en temps avec vous des affaires de l'État. Nous devons d'autant plus profiter des occasions qui s'offrent d'en parler, qu'elles sont plus rares pour nous qu'elles ne l'étaient pour les anciens. Franchement, je suis dégoûté de ces formules banales qui reviennent sans cesse : Eh bien! comment cela va-t-il? Etes-vous en bonne santé? Donnons à notre correspondance un ton plus noble et plus élevé ; ne la renfermons pas dans le cercle de nos affaires domestiques. Il est vrai que l'empire dépend de la volonté d'un seul homme qui, en vue de l'intérêt public, se charge des soins et des travaux de tous. Cependant, par une heureuse combinaison, de cette source de bonté découlent jusqu'à nous quelques ruisseaux où nous pouvons puiser nous-mêmes, et où nos lettres doivent aider nos amis à puiser à leur tour. Adieu.
XXI.- Pline à Priscus.
J'apprends que Valérius Martial est mort, et j'en suis affligé. C'était un homme d'un esprit fin, vif et prompt, dont le style était plein de sel et de mordant, et néanmoins plein de candeur. A son départ de Rome, je lui fournis les frais de son voyage. Je ne devais pas moins à son amitié et aux vers qu'il a faits pour m oi. On accordait jadis des honneurs ou des récompenses pécuniaires à ceux qui avaient écrit à la gloire des villes ou de quelques particuliers. Aujourd'hui la mode en est passée avec tant d'autres qui n'avaient guère moins de noblesse et de grandeur. Nous méprisons la louange depuis que nous cessons de faire des actions louables. Vous êtes curieux de savoir quels étaient les vers que je crus dignes de ma reconnaissance. Je vous renverrais au livre même, si je ne me souvenais de quelques-uns. S 'ils vous plaisent, vous chercherez les autres dans le recueil. Le poète adresse la parole à sa Muse. Il lui recommande de se rendre à ma maison des Esquilles, et de m'aborder avec respect :
Mais ne va pas dès le matin
Dans la folle gaîté du vin,
Frapper brusquement à sa porte.
Car en son studieux séjour,
Minerve et sa sévère escorte
L'absorbent durant tout le jour.
C'est là qu'il compose en silence
Ces beaux discours de grand renom
Que l'on croirait de Cicéron,
Son seul rival en éloquence
Choisis plutôt l'heure du soir :
Il daignera te recevoir.
C'est l'heure du joyeux délire,
L'heure des parfums et des fleurs,
Où Bacchus échauffe les cœurs.
Où les Catons pourraient me lire.
Ne croyez vous pas que celui qui m'a loué en ces termes ait bien mérité de recevoir des marques de mon affection à son départ et de ma douleur à sa mort ? Tout ce qu'il avait de meilleur, il me l'a donné; il m'aurait donné davantage, s'il avait pu. Cependant quel don plus rare et plus précieux que celui de la gloire et de l'immortalité ? Mais les poésies de Martial seront-elles immortelles ? Peut-être ; il les a du moins écrites dans la pensée qu'elles le seraient Adieu.
LIVRE QUATRIEME. Retour
I. — Pline à Fabatus.
Vous désirez depuis longtemps nous voir ensemble, votre petite-fille et moi. Ce désir nous flatte, et certes, nous le partageons. Nous ne sommes pas moins dans la plus vive impatience de nous transporter près de vous, et nous ne différerons pas davantage. Nous faisons déjà nos paquets. Nous hâterons notre marche, autant que les chemins le permettront. Nous ne nous arrêterons qu'une fois, mais peu de temps. Nous passerons par la Toscane, non pour visiter nos terres et nos domaines (car cela peut se différer), mais pour nous acquitter d'un devoir indispensable.
Près de mes biens est un bourg qu'on appelle Tiferne, sur le Tibre. Je sortais à peine de l'enfance, que ses habitants me choisirent pour leur protecteur avec un empressement d'autant plus vif qu'il était plus aveugle. Ils fêtent mon arrivée, s'affligent de mon départ, se réjouissent de mes honneurs. Pour leur témoi gner ma reconnaissance ( car il est honteux de se laisser vaincre en affection), j'ai fait bâtir en ce lieu un temple à mes dépens. Comme il est achevé, je ne pourrais sans impiété en différer la dédicace. Nous y passerons donc le jour destiné à cette cérémonie que j'ai résolu d'accompagner d'un grand festin. Peut-être demeurerons-nous encore le jour suivant mais nous n'en ferons ensuite que plus de diligence. Puissé-je seulement vous trouver en bonne santé, vous et votre fille. Pour de la joie, je suis sûr que vous en aurez, si nous arrivons heureusement. Adieu.
II. - Pline à Clémens.
Régulus vient de perdre son fils. Il méritait tous les maux, excepté celui qu'il vient de subir, parce qu'il ne le regarde peut-être pas comme un mal. C'était un enfant d'un esprit vif, mais équivoque. Il eût pu suivre la bonne voie, s'il n'eût ressemblé à son père. Régulus l'émancipa pour lui faire recueillir la succession de sa mère. Après l'avoir acheté par ce bienfait (c'est l'expression que suggérait à chacun le caractère de l'homme), il briguait les bonnes grâces de son fils par une affectation d'indulgence aussi rare que honteuse dans un père. Cela vous paraît incroyable mais songez qu'il s'agit de Régulus.
Cependant il pleure follement. Cet enfant avait un grand nombre de petits chevaux de trait et de main, des chiens de toute taillé, des rossignols, des perroquets et des merles. Régulus a tout fait égorger sur le bûcher et ce n'était pas douleur, c'était comédie. Chose inouïe! on se rend chez lui de toutes parts. Quoiqu'on le haïsse et qu'on le déteste, ou s'empresse de lui rendre visite, comme s'il était l'objet d'une estime et d'une affection universelles, bref, pour vous dire ma pensée, en faisant la cour à Régulus, on suit son exemple. Il s'est retiré dans ses jardins au delà du Tibre, où il a rempli d'immenses portiques une vaste étendue de terrain, et couvert le rivage de ses statues : car personne ne sait mieux associer la magnificence à la lésine, la vanité à l'infamie. Il incommode toute la ville qu'il déplace dans une saison si contraire ; et, dans la peine qu'il cause, il trouve une consolation. Il dit qu'il veut se marier : nouvelle absurdité à joindre à tant d'autres. Préparez-vous à apprendre au premier jour les d'un homme en deuil, les noces d'un vieillard, quoique ce soit se marier à la fois et trop tôt et trop tard. Vous me demanderez pourquoi j'ajoute foi à cette folie? Ce n'est point parce . qu'il affirme la chose (car personne ne sait mieux mentir) mais c'est parce qu'on ne saurait douter que Régulus fera toujours ce l'on ne doit cas faire. Adieu.

III. — Pline à Antonin.
Que vous ayez deux fois géré le consulat avec autant de gloire que les consuls de l'ancienne Rome, que vous vous soyez conduit dans le gouvernement d'Asie de manière à n'avoir eu après vous qu'un ou deux imitateurs, je dirais même aucun imitateur, si votre modestie pouvait me le permettre, que vous soyez le premier de Rome par votre intégrité, comme par l'ascendant de votre âge et de vos vertus, tout cela, sans doute, mérite nos hommages et nos louanges. Cependant je vous admire bien plus dans vos délassements : il n'est pas moins beau que difficile de savoir tempérer l'austérité par la grâce, la gravité par l'enjouement et c'est à quoi vous réussissez à merveille dans vos entretiens comme dans vos ouvrages. On ne peut vous entendre parler sans se représente ce vieillard d'Homère dont les paroles coulaient plus douces que le miel ; ni vous lire, sans croire que les abeilles parfument vos ouvrages de la plus pure essence des fleurs
C'est ce qui m'est arrivé dernièrement, quand j'ai lu vos épigrammes grecques et vos iambes. Que d'élégance! que d'agrément ! que de douceur ! Quel goût de l'antiquité ! quelle finesse et quelle justesse à la fois! Je croyais lire Callimaque, Hérode, ou d'autres auteurs plus délicats encore, s'il y en a : car aucun de ces deux poètes n'a excellé ou ne s'est exercé dans ces deux genres de poésie. Est-il possible qu'un Romain parle si bien grec? En vérité, je ne crois pas qu'Athènes possède mieux l'attisme. Enfin j'envie aux Grecs la préférence que vous avez accordée à leur idiome sur le nôtre car il n'est pas difficile de deviner ce que vous pourriez faire dans vôtre propre langue, quand vous avez su écrire de si beaux ouvrages dans une langue étrangère. Adieu.
IV. – Pline à Sossius
J'ai la plus tendre pour Calvisius Népos. C'est un homme laborieux, sage, éloquent, qualité que je place en première ligne. Il est proche parent de C. Calvisius qui demeure dans la même maison que moi et qui est votre ami, c'est le fils de sa sœur. Faites lui obtenir, je vous prie, une charge de tribun pour six mois et que cette dignité l'élève à ses propres yeux et à ceux de son oncle. Vous m'obligez, vous obligerez aussi notre cher Calvisius, vous obligerez Nepos lui-même qui certainement, en fait de reconnaissance, n'est pas un débiteur moins solvable que nous. Vous avez souvent accorder des grâces mais j'ose vous assurer que vous n'en avez jamais mieux placé aucune, et à peine une ou deux aussi bien. Adieu.
V. - Pline à Sparsus.
On dit qu'un jour Eschine, à la prière des Rhodiens, lut sa harangue, et celle de Démosthène, et que l'une et l'autre excitèrent le plus vif enthousiasme. Les applaudissements que reçurent les ouvrages de ces illustres orateurs ne m'étonnent plus, depuis que, dernièrement, lisant un de mes écrits devant une réunion de savants, j'ai trouvé le même empressement, la même approbation, la même constance pendant deux jours de suite. Cependant leur attention n'était stimulée ni par le parallèle de deux ouvrages rivaux, ni par une espèce de lutte oratoire. Outre le mérite des deux discours, les Rhodiens étaient encore animés par le plaisir de les comparer. Le mien a su plaire, quoique privé de ce dernier attrait. Est-ce avec justice? vous en jugerez, quand vous aurez lu cet ouvrage dont l'étendue ne souffre pas une plus longue préface. Il faut que ma lettre soit courte, puisque je puis la faire telle, pour mériter du moins que vous m'excusiez d'avoir donné à mon ouvrage la dimension qu'exigeait au reste la nature du sujet. Adieu.
VI. - Pline à Nason.
La grêle a ravagé ma terre de Toscane. Tout abonde, m'écrit-on, dans celle qui est située au de là du Pô mais aussi tout s'y donne pour rien. Celle de Laurente est la seule qui me rapporte. Je n'y possède, il est vrai, qu'une maison et un jardin. Le reste n'est que sable et cependant c'est le seul bien qui m'offre un revenu. J'y écris beaucoup. A la place des terres que je n'ai pas, j'y cultive mon esprit. Ailleurs je puis vous montrer des granges pleines, ici un portefeuille bien garni. Si donc vous convoitez un fonds d'un produit riche et certain, venez en acheter un sur ce rivage. Adieu.
VII. — Pline à Lépide.
Je vous le répète souvent : Régulus a de l'énergie ; il poursuit opiniâtrement son but. Il s'est mis en tête de pleurer son fils : il le pleure mieux qu'homme du monde. Il lui a pris fantaisie d'en avoir une foule de statues et de portraits : tous les ateliers y travaillent. Couleurs, cire, bronze, argent, or, ivoire, marbre, tout est mis en œuvre pour le représenter. Dernièrement, devant une nombreuse assemblée, il lut la biographie de son fils, la biographie d'un entant. Peu content d'en avoir répandu mille copies dans toute l'Italie et dans les provinces, il a écrit une circulaire qui invite les décurions à choisir le lecteur le plus harmonieux pour lire ce livre au peuple. On l'a fait. Que ne pouvait-on pas attendre d'un tel homme, s'il eût tourné vers de dignes objets cette énergie, ou, si vous l'aimez mieux, cette obstination pour arriver à ses fins. Au reste, les méchants ont toujours plus d'énergie que les bons. Comme la hardiesse naît de l'ignorance du danger, et la timidité de la réflexion, l'honnête homme perd de ses avantages par la modestie, tandis que le scélérat trouve de nouvelles forces dans son audace. Régulus en est un exemple. Il a la poitrine faible, l'air embarrassé, la langue épaisse, l'imagination paresseuse, une mémoire infidèle enfin, il n'a pour tout mérite qu'un esprit extravagant. Cependant, sans autre secours que sa démence et son effronterie, il passe auprès de bien des gens pour orateur. C'est donc fort heureusement qu'Hérennius Sénécion, renversant la définition de l'orateur que Caton nous a laissée, l'applique à Régulus et dit : L'orateur est un méchant homme qui ignore l'art de parler. En vérité, Caton n'a pas mieux défini son parfait orateur, que Sénécion n'a caractérisé Régulus.
Avez-vous de quoi payer cette lettre de la même monnaie? Je vous tiendrai quitte, si vous pouvez m'apprendre que cette complainte de Régulus a été lue dans votre ville par quelqu'un de mes amis ou par vous-même, à la manière d'un, charlatan, sur la place publique, en vociférant, comme dit Démosthène, sur un ton gai d'une voix glapissante. Car cette pièce est d'une telle ineptie, qu'elle doit plutôt exciter le rire que les larmes. On la croirait composée, non pour un enfant, mais par un enfant, Adieu.
VIII. —Pline à Arrien.
Vous me félicitez de ma promotion à la dignité d'augure, et vous avez raison : d'abord, parce qu'il est glorieux d'obtenir, même dans les moindres choses, l'approbation d'un empereur aussi sage ensuite, parce que ce sacerdoce antique et religieux est consacré par un privilège, celui de ne se perdre qu'avec la vie. Il est d'autres sacerdoces dont les prérogatives sont à peu près égales. Mais si on les accorde, ils peuvent être ravis, celui-ci, la fortune ne peut que le donner. Ce qui en rehausse le prix à mes yeux, c'est que je succède à Julius Frontinus, homme du premier rang. A chaque élection, depuis plusieurs années, il me donnait son suffrage et paraissait ainsi me désigner pour son successeur. L'événement a si bien secondé ses vœux, qu'il semble que le hasard n'y soit pour rien. Mais ce qui vous plaît davantage, si j'en croîs votre lettre, c'est que Cicéron fut augure. Vous me voyez avec joie revêtu des mêmes honneurs que le personnage, que je voudrais égaler dans la carrière des lettres.
Plût au ciel qu'après être parvenu, beaucoup plus jeune que lui, au consulat et au sacerdoce, je pusse au moins dans ma vieillesse, posséder une partie de ses talents ! Mais si les faveurs dont les hommes disposent peuvent arriver jusqu'à moi et jusqu'à d 'autres, il n'est pas moins difficile d'acquérir que présomptueux de se promettre celles qui ne dépendent que des immortels. Adieu.
IX. — Pline à Ursus.
Ces jours passés, on a plaidé la causé de Junius Bassus. C'est un homme célèbre par les épreuves et par les infortunes qu'il a souffertes. Il fut accusé par deux particuliers sous Vespasien. Renvoyé au sénat, il attendit longtemps qu'on décidât de son sort. Enfin il se justifia pleinement et fut absous. Ami de Domitien, il craignit Titus, et Domitien lui-même le bannit. Rappelé par Nerva, il obtint la Bithynie , et, à son retour, il fut accusé de malversation. Aussi vivement poursuivi que fidèlement défendu, il n'a pas eu tous les juges en sa faveur. Le plus grand nombre pourtant a été de l'avis le plus doux. Rufus parla le premier contre lui avec sa facilité et sa véhémence ordinaires. II fut secondé par Théophane, l'un des députés, le chef et l'auteur de l'accusation.
Je répliquai :car Bassus m'avait chargé de jeter, pour ainsi dire, les fondements de sa défense, de faire valoir toute la considération que lui donnaient sa naissance et ses dangers, de dévoiler la conspiration des délateurs qui vivaient de ce vil métier, et de mettre au jour les motifs qui lui avaient attiré la haine des gens les plus factieux, et particulièrement de Théophane. Bassus m'avait aussi recommandé de réfuter le chef d'accusation qui l'effrayait le plus : car, sur les autres points, quoiqu'ils fussent plus graves en apparence, au lieu de châtiment, il méritait des éloges. La charge la plus forte contre lui, c'était qu'avec sa simplicité, ennemie de toute précaution, il avait reçu, à titre d'ami, quelques cadeaux des gens de la province où il avait déjà exercé la questure. Voilà ce que ses accusateurs appelaient des vols et des rapines. Pour lui, il n'y voyait que des présents: mais les présents mêmes sont interdits par la loi. Que pouvais-je faire? Quel système de défense adopter? Nier le fait? c'était reconnaître tacitement pour vol ce que l'on n'osait avouer. D'un autre côté, contester ce qui se trouvait manifestement prouvé, c'était aggraver le crime, loin de le détruire. D'ailleurs, Bassus n'en avait pas laissé la liberté aux avocats. Il avait dit à beaucoup de personnes, et même au prince, qu'il avait reçu et envoyé quelques bagatelles, le jour de sa naissance seulement et aux Saturnales. Devais-je donc recourir à la clémence? C'était enfoncer le poignard dans le sein de l'accusé. On est criminel, dès qu'on a besoin de grâce. Fallait-il soutenir que son action était innocente? Sans le justifier, je me déshonorais. Dans cet embarras, je crus qu'il était nécessaire de chercher un moyen terme et je m'imagine l'avoir trouvé.
La nuit, qui termine les combats, mit fin à mon plaidoyer. J'avais parlé pendant trois heures et demie ; il me restait encore une heure et demie à remplir : car, suivant la loi, l'accusateur avait six heures, et l'accusé neuf. Bassus avait partagé le temps entre moi et l'orateur qui devait me succéder : il m'avait donné cinq heures, et le reste à l'autre avocat. Le succès de mon discours m'invitait au silence : car il y a de la témérité à ne se pas contenter de ce qui nous a réussi. J'avais encore à craindre que, si je recommençais le jour suivant, les forces ne me manquassent. Or il est plus difficile de se remettre au travail que de le poursuivre, quand on est en haleine. Je courais même un autre risque : l'interruption pouvait rendre languissant ce qui me restait à dire, ou ennuyeux ce qu'il fallait répéter. De même qu'un flambeau, constamment agité, conserve la vivacité de sa flamme, et, une fois éteint, se rallume difficilement ; la chaleur de l'avocat et l'attention des juges se soutiennent par la continuité de l'action, et s'amortissent par l'interruption et le repos. Cependant Bassus me pressait avec instance, et presque les larmes aux yeux, : d'employer en sa faveur ce qui me restait de temps. J'obéis, et je sacrifiai mon intérêt au sien. Le succès couronna mes efforts. Je trouvai dans les sénateurs une attention si nouvelle et si vive, qu'ils paraissaient plutôt excités que rassasiés par le discours précédent.

Lucius Albinus prit la parole après moi, et avec tant d'adresse, que nos plaidoyers offraient la variété de deux morceaux différents, et semblaient n'en former qu'un par leur liaison. Hérennius Pollio répliqua avec une énergie pressante et, après lui, Théophane prit la parole pour la seconde fois. Son impudence se montra en cela, comme en toutes choses. Il voulut parler après deux personnages consulaires, après deux orateurs éloquents, et il parla longuement. Il plaida non seulement jusqu'à la nuit, mais pendant la nuit, à la lueur des flambeaux. Le lendemain, Titius Homullus et Fronton plaidèrent pour Bassus, et fixent des prodiges. Le quatrième jour, les témoins furent entendus, et on opina. Bébius Macer, consul désigné, déclara Bassus convaincu de péculat. Cépion Hispo fut d'avis que Bassus conservât son rang dans le sénat, et qu'on renvoyât l'affaire devant les juges ordinaires. Tous deux, avaient raison. Comment cela peut-il être, dites-vous, dans un si grand conflit de sentiments c'est que que Macer s'en, tenait à la lettre de la loi, et que, suivant la rigueur de cette loi, on ne pouvait se dispenser de condamner celui qui l'avait violée en recevant des présents. Cépion, au contraire, persuadé que le sénat peut étendre, ou modérer la rigueur des lois, comme effectivement il le peut, croyait avoir droit de pardonner une prévarication autorisée par l'usage. L'avis de Cépion rem porta. Il fut même prévenu, dès qu'il se leva pour opiner, par ces acclamations qui ne se font entendre ordinairement que lorsqu'on se rassoit, après avoir opiné. Jugez des applaudissements qui suivirent, son discours par ceux qui le précédèrent.
Cependant, sur cette affaire, Rome n'est pas moins partagée que le sénat. Les uns accusent Macer d'une rigueur extrême ; les autres reprochent à Cépion une faiblesse qui choque toutes les bienséances. Comment comprendre, disent-ils, qu'un homme renvoyé devant des juges, puisse garder sa place dans le sénat!
Valérius Paulinus ouvrit un troisième avis : ce fut d'ajouter à celui de Cépion, que l'on informerait contre Théophane, après qu'il aurait accompli sa mission. Paulinus soutenait que cet homme, dans le cours de l'accusation, avait lui-même, en plusieurs chefs, contrevenu à la loi qu'il invoquait pour faire condamner Bassus. Mais, quoique ce dernier avis plût fort à la majorité du sénat, les consuls le laissèrent tomber. Paulinus n'en recueillit pas moins tout l'honneur que méritaient sa justice et sa fermeté. Le sénat s'étant séparé, Bassus fut accueilli par une foule nombreuse avec de grandes acclamations et de vifs transports de joie. Le souvenir de ses anciens périls rappelé par un péril nouveau, un nom fameux par ses disgrâces, une taille élevée jointe aux dehors d'une vieillesse triste et malheureuse, tout lui avait concilié l'intérêt général.
Cette lettre vous tiendra lieu de préface. Quant au discours entier, vous attendrez longtemps : car vous comprenez qu'il ne suffit pas de retoucher légèrement et en courant un sujet de cette importance. Adieu.

X. — Pline à Sabinus.
Vous me marquez que Sabine, qui nous a fait ses héritiers, ne paraît, par aucune disposition de son testament, avoir affranchi Modestus son esclave, et que cependant elle lui laisse un legs en ces termes : Je lègue à Modestus, à qui j'ai déjà donné la liberté. Vous me demandez mon avis. J'ai parlé à des jurisconsultes. Tous prétendent que nous ne devons à cet esclave, ni là liberté, parce qu'elle ne lui a point été donnée, ni le legs qu'on lui a fait, parce qu'il est fait à un esclave. Mais moi, je ne doute pas que Sabine ne se soit trompée et je suis persuadé que nous ne devons pas hésiter à faire ce que nous ferions, si elle avait écrit ce qu'elle croyait écrire. Je me flatte que vous partagerez mon opinion, vous qui avez coutume d'être religieux observateur de la volonté des morts. Elle tient lieu de toutes les lois du monde à de dignes héritiers, dès qu'ils la peuvent entrevoir. L'honneur n'a pas moins de pouvoir sur des personnes comme nous que la nécessité sur les autres. Laissons donc Modestus jouir de la liberté, laissons-le jouir de son legs, comme si la testatrice avait suivi exactement toutes les formalités légales. C'est les prendre toutes que de bien choisir ses entiers. Adieu.
XI. — Pline à Minucien.
A vez-vous ouï dire que Valérius Licinien donne des leçons en Sicile? J'imagine que vous ne le savez pas encore, car la nouvelle est toute fraîche. Après avoir été préteur, il occupait naguère le premier rang au barreau. Quelle chute ! de sénateur, le voilà exilé ! d'avocat, le voilà rhéteur! Lui-même, dans son discours d'ouverture, en prit occasion de s'écrier d'un ton grave et triste : Fortune! ce sont là de tes jeux! tu fais passer les rhéteurs de l'école au sénat, et, du sénat, tu renvoies les sénateurs à l'école. Il y a bien du dépit et de l'aigreur dans cette pensée, et je serais tenté de croire que Licinien n'a ouvert école que pour la débiter. Lorsqu'il entra couvert d'un manteau grec (car les bannis perdent le droit de porter la toge), après avoir composé son maintien et promené ses yeux sur son vêtement : C'est en latin, dit-il, que je vais parler. Vous allez vous écrier : Quel triste et déplorable sort ! digne pourtant de celui qui a déshonoré sa profession par un inceste! Il est vrai qu'il a avoué le crime mais on ignore si c'est la crainte ou la vérité qui lui arracha cet aveu.
Domitien frémissait de rage de se voir abandonné au milieu de la haine universelle. Il s'était mis en tête de faire enterrer vive la grande vestale, Cornélie, croyant illustrer son siècle par un tel scandale. Usant de son droit de souverain pontife, ou plutôt déployant toute la cruauté d'un tyran, de son autorité impériale, il convoque les autres pontifes, non dans son palais, mais dans sa maison d'Albe. Là, par un crime plus affreux que celui qu'il voulait punir, il déclare incestueuse cette vestale, sans la citer, sans l'entendre, lui qui, non content d'avoir commis un inceste avec sa nièce, avait encore causé sa mort car, étant veuve, elle périt en se faisant avorter. Aussitôt les pontifes furent envoyés pour en ordonner l'exécution. Cornélie, levant les mains au ciel, invoque tantôt Vesta, tantôt les autres dieux, et, entre plusieurs exclamations, répète souvent celle-ci : Quoi! César me déclare incestueuse, moi dont les sacrifices l'ont fait vaincre, l'ont fait triompher! On ne sait si, par ces paroles, elle voulait flatter ou insulter le prince si le témoignage de sa conscience, ou son mépris pour l'empereur les lui suggérait. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle ne cessa de les répéter jusqu'au lieu du supplice où elle fut conduite, peut-être innocente? je l'ignore, du moins comme une criminelle. En descendant au fatal souterrain, sa robe s'étant accrochée, elle se retourna, et en ramena les plis. Le bourreau lui présentait la main. Par un dernier acte de chasteté, elle le repoussa avec horreur, comme si ce hideux contact eût pu souiller la pureté de son corps, et, accomplissant tout ce qu'exigeait la plus sévère, bienséance. Elle mit tous ses soins à tomber décemment. Ajoutez que lorsque Celer, chevalier romain, que l'on donnait pour complice à Cornélie, fut battu de verges dans le Comitium, il ne dit que ces mots , Qu'ai je fait? je n'ai rien fait.
Comme l'injustice et la cruauté de Domitien étaient criantes, il se rejeta sur Licinien, sous prétexte qu'il avait caché une affranchie de Cornélie dans ses terres. Ceux qui s'intéressaient à lui le firent avertir qu'un aveu seul pouvait lui obtenir sa grâce. Il s'y résigna. Sénécion, en portant la parole pour lui pendant son absence, égala la brièveté de ce mot d'Homère : Patrocle est mort; car il dit : D'avocat je suis devenu courrier. Licinien s'est retiré. Cette nouvelle fut si agréable à Domitien, que sa joie le trahit.
Licinien, s'écria-t-il, nous a pleinement absous. Puis il ajouta « Il ne faut pas pousser à bout sa discrétion. » Il lui permit d'emporter tout ce qu'il pourrait de ses biens, avant qu'ils fussent vendus à l'encan, et lui assigna, comme prix de sa complaisance, un lieu d'exil des plus commodes. La bonté de Nerva l'a depuis transféré en Sicile. Là il tient école aujourd'hui, et se venge de la fortune dans les exordes de ses leçons.
Vous voyez quelle est ma soumission à vos ordres, avec quel soin je vous informe, et des nouvelles de Rome, et des nouvelles étrangères, en remontant à leur origine. Je me suis douté qu'en raison de votre absence, vous auriez seulement entendu dire qu'on avait banni Licinien pour inceste. La renommée rapporte le fond des choses, mais néglige le détail. Je mérite bien qu'à votre tour vous m'écriviez ce qui se passe, soit dans votre ville, soit aux environs: car il y arrive quelquefois des événements remarquables. Enfin écrivez tout ce qu'il vous plaira, pourvu que votre lettre soit aussi longue que la mienne. Je compterai, non seulement les pages, mais encore les lignes et les syllabes. Adieu.
XII. — Pline à Arrien.
Vous aimez Égnatius Marcellinus, et vous me le recommandez souvent. Vous l'aimerez et vous me le recommanderez encore davantage, quand vous saurez ce qu'il vient de faire. Il était allé exercer la charge de questeur dans une province. Le secrétaire, que le sort lui avait donné, mourut avant que ses appointements fussent échus. Marcellinus sentit qu'il ne devait point garder ce qui lui avait été donné pour ce secrétaire. A son tour, il supplia l'empereur, et ensuite, par ordre de l'empereur, le sénat, de lui indiquer l'emploi qu'il devait faire de ces fonds. La question était peu importante, mais c'était toujours une question. Les héritiers, d'une part, de l'autre, les préfets du trésor réclamaient la somme. La cause a été plaidée des deux côtés. Cécilius Strabon a opiné pour le fisc, Bébius Macer, pour les héritiers. L'avis de Strabon a été suivi. Louez Marcellinus comme je l'ai fait sur-le-champ. Quoique l'approbation publique du prince et du sénat ne lui laisse rien à désirer, la vôtre lui fera plaisir. Tel est le caractère de tous ceux qui se passionnent pour la gloire : l'applaudissement et l'éloge, même des moindres personnes, ont pour eux le plus grand charme. Quelle impression votre jugement fera-t-il sur Marcellinus qui n'a pas moins de vénération pour vous que de confiance en vos lumières! Que dis-je? pourra-t-il apprendre que le bruit de son action a pénétré jusque dans le pays où vous êtes sans être ravi de tout le chemin que sa réputation aura fait? Car je ne sais pour! quoi les hommes sont plus touchés de l'étendue que de la grandeur de la gloire. Adieu.
XIII. — Pline à Tacite.
Je me réjouis que vous soyez de retour à Rome en bonne santé. Vous ne pouviez jamais arriver pour moi plus à propos. Je ne resterai que fort peu de jours encore dans ma villa de Tusculum pour achever un opuscule que j'y ai commencé. Je crains que, si, je l'interromps sur la fin, je n'aie de la peine à le reprendre. Cependant, afin que mon impatience n'y perde rien, je vous demande d'avance par cette lettre une grâce que je me promets de vous demander bientôt de vive voix. Mais, avant de vous exposer le sujet de ma demande, il faut vous dire ce qui m'engage à vous l'adresser.
Dernièrement, me trouvant à Côme où je suis né, un enfant de quatorze ans, fils d'un de mes compatriotes, vint me saluer. Vous étudiez? lui dis-je. - Oui, me répondit-il. - En quel lieu? —A Milan. - Pourquoi pas ici ? Son père qui l'accompagnait, et qui me l'avait présenté, prend la parole: Parce qu'ici nous n'avons point de maîtres. — Et pourquoi n'en avez-vous point? Il serait pourtant de l'intérêt de tous les pères (cela venait à propos, car beaucoup de pères m'écoutaient) de faire instruire ici leurs enfants. Où leur trouver un séjour plus agréable que la patrie? Où former leurs mœurs plus sûrement que sous les yeux de leurs parents? où les entretenir à moins de frais que chez vous? Qu'en coûterait-il donc de faire une collecte pour payer des maîtres? A peine faudrait-il ajouter aux fonds votés ce que vous dépensez en voyages et en logements : car tout s'achète, lorsqu'on n'est pas chez soi. Eh bien! moi qui n'ai pas encore d'enfants, je suis prêt, en faveur de notre patrie commune que j'aime avec la tendresse d'un fils ou d'un père, à donner le tiers de la somme que vous voudrez mettre à cet établissement. J'offrirais bien la somme entière mais je craindrais que la brigue n'abusât quelquefois de ma libéralité, comme je le vois en divers lieux où l'on a fondé les chaires de professeurs. Il n'y a qu'un moyen de prévenir ce désordre : c'est de ne confier qu'aux pères le soin d'engager les maîtres, et de les obliger à bien choisir par la nécessité de la contribution. Car ceux qui peut-être ne seraient pas attentifs au bon usage du bien d'autrui, veilleront certainement à remploi du leur et ils n'oublieront rien pour remettre en de dignes mains le fond que j'aurais fait fait, s'ils ont eux-mêmes contribue aie faire. Prenez donc une résolution commune, unissez vos efforts, et réglez-les sur les miens. Je souhaite sincèrement que la part que je devrai fournir soit considérable. Vous ne pouvez rien faire de plus honorable pour vos enfants , rien de plus agréable à votre patrie. Que vos enfants reçoivent l'éducation au lieu même où ils ont reçu la naissance. Ac coutumez-les, dès l'âge le plus tendre, à se plaire, à se fixer dans leur pays natal. Puissiez-vous choisir de si excellents maîtres, que les villes voisines peuplent vos écoles ! Puissent celles qui voient venir vos enfants étudier chez elles, envoyer bientôt les leurs étudier chez vous! J'ai repris les choses d'un peu haut pour vous mieux faire entendre combien je serais sensible au bon office que je vous impose. Je vous charge donc, en considération d'une entreprise si importante de vouloir bien, dans cette foule de savants qu'attire de tout part auprès de vous la réputation de votre esprit, me procurer des professeurs, habiles, sans toutefois, m'engager envers eux : car je laisse les pères maîtres absolus du choix. Je leur abandonne l'examen et la décision, je ne me réserve que la dépense et les soins. S'il s'en trouve quelqu'un qui ait assez de confiance en ses talents, qu'il vienne mais qu'il ne compte que sur son mérite. Adieu.
XIV. — Pline à Paternus.
Peut-être réclamez vous, comme à votre ordinaire, et attendez-vous quelque plaidoyer. Moi, je vous envoie mes jeux d'esprit, comme si c'étaient des curiosités étrangères et exquises. Vous recevrez avec cette lettre des hendécasyllabes que j'ai faits en voiture, au bain, à table, pour charmer mes loisirs. J'y exprime tour à tour la gaieté, la folie, l'amour, la douleur, la plainte, le dépit. Mes descriptions sont tantôt simples, tantôt nobles, Par cette variété, j'essaie de satisfaire les différents goûts, et d'assurer peut-être à quelques morceaux l'approbation publique.
Si par hasard vous trouvez des endroits un peu libres, votre érudition voudra bien se rappeler que les personnages les plus illustres et les plus graves qui ont écrit dans ce genre, n'ont pas été fort chastes dans le choix de leurs sujets, et qu'ils n'ont pas même reculé devant la crudité de l'expression. C'est une licence que j'évite, non que je me pique d'être plus austère (et de quel droit?), mais parce que je suis plus timide. Nous savons d'ailleurs que la véritable règle pour la poésie fugitive est donnée ainsi par Catulle.
Le poète doit être sage.
Pour ses vers, il importe peu :
Ils n'auraient ni grâce ni feu,
Sans un air de libertinage.
Voyez quel prix j'attache à votre opinion! J'ai préféré votre critique sur l'ensemble à vos éloges sur quelques passages choisis, quoique, des morceaux fort agréables cessent de le paraître, quand on les lit après d'autres du même genre. De plus, un lecteur d'esprit et de goût ne doit pas comparer ensemble des poésies de caractères différents, mais examiner chaque pièce en soi, et ne pas juger l'une inférieure à l'autre, si elle est parfaite dans son genre.
Mais pourquoi tant discourir? Vouloir, par une longue préface, justifier ou faire valoir des niaiseries, c'est de toutes les niaiseries la plus ridicule. Je crois seulement devoir vous avertir que je me propose d'intituler ces bagatelles, H endécasyllabes, titre qui n'a de rapport qu'à la mesure des vers. Vous les pouvez donc appeler épigrammes, idylles, églogues, ou simplement poésies, comme plusieurs l'ont fait, enfin, de tel autre nom qu'il vous plaira : je ne m'engage, moi, qu'à vous donner des hendécasyllabes. J'exige seulement de votre sincérité, que vous me disiez de mon livre tout ce que vous en direz aux autres et cela ne vous coûtera guère. Si cet opuscule était le seul ou le plus important qui fût sorti de mes mains, il y aurait peut-être de la dureté à me dire : Cherchez d'autres occupations mais vous pouvez, sans blesser la politesse, médire : Vous avez tant d'autres occupations! Adieu.

XV Pline à Fundanus.
Si j'ai quelque discernement, je le prouve en aimant Asinius Rufus de toute mon âme. C'est un homme rare, ami passionné des gens de bien comme moi car pourquoi ne pas me mettre du nombre? Il est encore intimement lié avec Tacite et vous connaissez le mérite d'un tel personnage. Ainsi, puisque c'est la ressemblance des mœurs qui serre le plus étroitement les liens de l'amitié, si vous avez de l'estime pour Tacite et pour moi, vous en accorderez nécessairement à Rufus. Il a plusieurs enfants : car il a compté parmi les obligations d'un bon citoyen, celle de donner des sujets à l'état et cela, dans un siècle où il est si avantageux de n'avoir pas d'enfants, que la plupart ne veulent pas même un fils unique. Il a méprisé ces bénéfices et n'a pas craint le nom d'aïeul. Il a des petit fils de Saturius Firmus, son gendre, homme que, vous aimerez autant que je l'aime, quand vous le connaîtrez autant: que je le connais.
Vous voyez quelle nombreuse famille vous obligerez à la fois par, une seule grâce. Cette grâce, nous avons été conduits à vous la demander, d'abord par un vœu que nous formons, ensuite par je ne sais quel espoir de le voir accompli. Nous vous souhaitons, et nous espérons pour vous le consulat, la prochaine année. Vos vertus et le discernement du prince nous autorisent vous faire cette prédiction.
Les mêmes raisons vous donnent pour questeur Asinius Bassus, l'aîné des fils de Rufus. C'est un jeune homme.... (je ne sais ce que je dois dire : le père veut que je dise et que je pense que son fils vaut mieux que lui, la modestie du fils me le défend). Quoique vous n'hésitiez jamais à me croire sur parole, vous lui croirez difficilement, sur ma seule assurance, l'activité, la probité, l'érudition, l'esprit, l'application, la mémoire, que l'expérience vous fera découvrir en lui. Je voudrais que notre siècle fût assez fécond en vertus pour qu'on pût trouver des jeunes gens dignes d'être préféré à Bassus. Je serais le premier à vous avertir, à vous presser d'y regarder plus d'une fois, et de peser longtemps, avant de faire penchera balance. Par malheur, aujourd'hui.... Mais je ne veux vous vanter trop mon ami, je dirai seulement qu'il mériterait que vous l'adoptassiez pour fils, selon la coutume de nos ancêtres. Ceux qui se distinguent, comme vous, par leur sagesse doivent accepter de la république des enfants tels qu'ils voudraient en avoir reçu de la nature. Ne vous sera-t-il pas honorable, lorsque vous serez consul, d'avoir pour questeur le fils d'un homme qui a exercé la préture, et le proche parent de plusieurs consulaires, sur lesquels, tout jeune qu'il est, et d'après leur avis, il répand autant d'éclat qu'il en reçoit d'eux?
Ayez donc égard à mes prières, ne négligez pas mes conseils, et surtout pardonnez à une sollicitation prématurée. L'amitié est impatiente, et court au-devant du temps par ses désirs, D'ailleurs, dans une ville où tout semble fait pour le premier qui s'en empare, on trouve que le moment d'agir est passé, si l'on attend qu'il soit venu. Enfin, il est doux de jouir par avance des succès que l'on désire. Que déjà Bassus vous respecte comme son consul : vous, aimez-le comme votre questeur et moi, qui vous chéris également l'un et l'autre, que je puisse goûter une double joie. Car, dans la tendre amitié qui m'attache à vous et à Bassus, je suis disposé à tout employer, mes soins, mes sollicitations, mon crédit, pour élever tout ensemble aux honneurs, et Bassus, quel que soit le consul dont il sera le questeur, et le questeur que vous aurez choisi, quel qu'il puisse être. Jugez donc de ma satisfaction, si mon amitié pour Bassus, d'accord avec les intérêts de votre consulat, rassemblait tous mes vœux sur lui seul ! si enfin vous me secondiez dans mes sollicitations, vous dont les avis sont d'un si grand poids, et dont le témoignage fait autorité dans le sénat! Adieu.
XVI. - Pline à Valérius Paulinus.
Réjouissez-vous pour vous, pour moi, pour notre siècle : les lettres sont encore en honneur. Dernièrement je devais plaider devant les centumvirs. La foule était immense, et je ne pus trouver passage qu'à travers le tribunal et l'assemblée des juges. Que dis-je? un jeune homme d'un rang distingué eut sa tunique déchirée, ainsi qu'il arrive souvent dans la foule. Il n'en resta pas moins, et durant sept heures entières, couvert seulement de sa toge : car je parlai sept heures avec beaucoup de fatigue et plus de succès encore. Travaillons donc, et ne donnons plus pour excuse à notre paresse l'indifférence du public. Nous ne manquerons ni d'auditeurs ni de lecteurs. Ayons soin, à notre tour, qu'ils ne manquent ni de bons discours à écouter, ni de bons livres à lire. Adieu,
XVII — Pline à Gallus.
Vous m'avertissez que C. Cécilius, consul désigné, poursuit en justice Corellia, absente en ce moment de cette ville, et vous me priez de la défendre. Je vous remercie de l'avis mais je me plains de la prière. Je dois être averti pour savoir ce qui se passe mais on ne doit pas me prier de faire ce qu'il serait déshonorant pour moi de négliger. Balancerais-je à me déclarer pour la fille de Corellius? Il est vrai que j'ai avec son adversaire, non des rapports intimes, mais des rapports d'amitié. Il jouit, je le sais, d'une grande considération, et la dignité qui l'attend exige de moi d'autant plus d'égards que j'en ai été revêtu moi-même car il est naturel de vouloir élever dans l'opinion publique les honneurs que l'on a possédés. Mais toutes ces considérations s'évanouissent, quand je songe que je vais défendre la fille de Corellius.
Je me représente cet illustre personnage, le plus grave, le plus vertueux, le plus spirituel de notre siècle. Mon attachement pour lui naquit de l'admiration qu'il m'avait inspirée et il arriva, contre l'ordinaire, que je l'admirai bien plus encore, quand je vins à le mieux connaître. Je puis dire que je l'ai connu à fond : car il partageait avec moi ses secrets, ses plaisirs, ses affaires, sa joie et ses peines. J'étais encore tout jeune, et il avait pour moi, non seulement les égards, mais, j'ose le dire, le respect qu'il aurait eu pour une personne de son âge. Je n'ai point sollicité de dignité, qu'il ne m'ait appuyé de sa voix et de son témoignage. Je n'ai pris possession d'aucune charge, qu'il ne m'ait accompagné, qu'il ne se soit mêlé à mon cortège. Je n'en ai point exercé, qu'il n'ait été mon conseiller et mon guide. En un mot, chaque fois qu'il s'est agi de mes intérêts, quoique vieux et infirme, il semblait retrouver, pour les soutenir, sa jeunesse et sa vigueur. Quel soin ne prenait-il pas, soit en particulier, soit en public, soit à la cour, pour établir ma réputation! Un jour, chez l'empereur Nerva, la conversation tomba sur les jeunes gens d'un heureux naturel. La plupart me comblèrent d'éloges. Corellius, après avoir quelque temps gardé le silence (ce qui donnait encore du poids à ses paroles ) : Pour moi, dit-il de ce ton grave que vous lui connaissez, je suis obligé de louer Pline plus sobrement car il ne fait rien que par mes conseils. Par là il m'accordait plus de gloire que je n'aurais osé le désirer : c'était proclamer la haute sagesse de toutes mes actions, que de les attribuer aux conseils du plus sage de tous les hommes. Enfin, en mourant, il dit à sa fille, qui souvent prend plaisir à le répéter : Je vous ai fait beaucoup d'amis dans le cours de ma longue viemais comptez particulièrement sur l'affection de Pline et de Cornutus.
Je ne puis me rappeler ces paroles, sans songer à tout ce que je dois faire pour n'être pas accusé de trahir sa confiance et de démentir son jugement. Corellia peut donc compter sur moi : je la défendrai, quand je devrais me faire un ennemi de son adversaire. Mais j'ose compter sur le pardon et même sur les éloges de Cécilius qui, dites-vous, hasarde ce procès dans l'espérance d'avoir affaire seulement à une femme, lorsque, pour justifier ma conduite, ou plutôt pour m'en faire honneur, j'aurai développé dans mon plaidoyer, avec la force et l'étendue que ne permet point une lettre, tout ce que je viens de vous exposer dans celle-ci. Adieu.
XVIII — Pline à Antonin.
J'ai essayé de traduire élégamment en latin quelques-unes de vos épigrammes grecques/ Puis-je mieux prouver à quel point j'en suis charmé ? J'ai bien peur de les avoir gâtées et j'en accuse avant tout la faiblesse de mon esprit, ensuite la stérilité, ou, pour parler comme Lucrèce, la pauvreté de notre langue. Si vous trouvez quelque agrément dans la traduction, qui est en latin et de ma façon, imaginez les grâces de l'original, qui est en grec et de votre main! Adieu.
XIX. — Pline à Hispulla.
Je connais votre cœur. Vous chérissez votre vertueux frère autant qu'il vous aimait lui-même, et sa fille a trouvé en vous, non seulement l'affection d'une d'une tante, mais toute la tendresse du père l'affection qu'elle a perdu. Vous apprendrez donc avec une extrême joie qu'elle est toujours digne de son père, digne de son aïeul, digne de vous, Elle a beaucoup d'esprit, beaucoup d'économie : elle m'aime, et c'es t une preuve de sa vertu. De plus, elle a du goût pour les lettres, et ce goût lui a inspiré par l'envie de me plaire. Elle a continuellement mes ouvrages entre les mains ; elle ne cesse de les lire, elle les apprend par cœur. Vous ne pouvez vous imaginer son inquiétude .avant que je plaide, sa joie après que j'ai plaidé. Elle charge toujours quelqu'un de venir lui apprendre quels applaudissements j'ai reçus, quel enthousiasme j'ai excité, quel succès a obtenu la cause. S'il m'arrive de lire un ouvrage en public, elle se tient dans le voisinage, derrière un rideau, et écoute avidement les louanges que l'on me donne. Instruite, non par un artiste habile, mais par l'amour, le meilleur de tous les maîtres, elle chante mes vers en s' accompagnant de la lyre. J'ai donc raison de me promettre que le temps ne fera que cimenter de plus en plus notre union : car ce n'est pas la jeunesse ou la beauté, dont chaque jour amortit et diminue l'éclat, mais la gloire qu'elle chérit en moi.
On ne pouvait attendre autre chose d'une personne élevée sous vos yeux, formée par vos leçons, qui n'a rien vu près de vous que des exemples de vertu et d'honneur, et qui, enfin, apprit à m'aimer en m'entendant louer de votre bouche? Vos sentiments pour ma mère, que vous respectez comme la vôtre, et la part que Vous preniez à mon éducation, vous ont accoutumée à me vanter dès ma plus tendre enfance. Vous prédisiez alors ce qu'il semble à ma femme que je sois aujourd'hui. Ainsi nous vous remercions à l'envi d'avoir uni, en nous donnant l'un à l'autre, deux personnes si bien faites pour s'aimer. Adieu.
XX. — Pline à Maxime.
Je vous ai mandé mon sentiment sur chacune des parties de votre ouvrage, à mesure que je les ai lues. Voici maintenant ce que je pense de son ensemble. Il est parfait, plein de vigueur, de véhémence, d'élévation, de variété, d'élégance, de pureté. Les ornements et l'étendue même de la composition ajoutent encore à la gloire de l'auteur. Votre esprit et votre douleur ont ensemble déployé toute leur force, et se sont réciproquement soutenus. L'esprit y donne de la magnificence et de la majesté à la douleur et la douleur donne à l'esprit de l'énergie et une tristesse amère. Adieu.
XXI. — Pline à Vélius Céréalis.
Que le sort des Helvidies est affreux et déplorable ! Ces deux sœurs sont mortes en couches, toutes deux après avoir mis au monde une fille. J'en suis profondément afflige, et je n'ai que trop de raison de l'être : tant il me parait cruel de perdre, par une malheureuse fécondité, ces deux aimables personnes dans la fleur de leur âge! Je plains de pauvres enfants, à qui le même instant donne le jour et enlève leur mère ; je plains des maris excellents, je me plains moi-même : car j'aime encore le père des Helvidies, tout mort qu'il est, avec cette vive tendresse dont mon plaidoyer et mes écrits sont de fidèles témoins. Il ne lui reste plus qu'un seul de ses trois enfants, un seul soutient maintenant sa maison, si glorieuse naguère de ses trois appuis. Ce sera néanmoins un grand adoucissement à ma douleur, si la fortune nous conserve au moins ce fils en bonne santé, si elle nous rend en sa personne son illustre père et son illustre aïeul. Je tremble d'autant plus pour sa vie et ses mœurs, qu'il est unique aujourd'hui. Vous qui connaissez ma faiblesse et mes alarmes pour les personnes que j'aime, vous ne serez pas surprisse me voir tant craindre pour un jeune homme sur lequel reposent de si hautes espérances. Adieu.
XXII. - Pline à Sempronius Rufus.
J'ai été appelé au conseil de notre excellent prince pour lui donner mon avis. On célébrait à Vienne des jeux publics, fondés par le testament d'un particulier. Trébonius Rufinus, homme d'un rare mérite, et notre ami, les abolit pendant qu'il était duumvir. On soutenait qu'il n'avait pu s'attribuer ce pouvoir. Il plaida lui-même avec autant de succès que d'éloquence. Ce qui ajouta à l'éclat de sa défense, c'est que, dans une question personnelle, il parla en Romain, en bon citoyen, avec sagesse et dignité. Lorsqu'on recueillit les avis, Junius Mauricus, dont rien n'égale la franchise et la fermeté, ne se contenta pas de dire, qu'il ne fallait pas rétablir ces spectacles à Vienne ; il ajouta : Je voudrais même qu'on put les supprimer à Rome.
C'est, direz vous, montrer beaucoup de courage et d'énergie. Mais cela n'est pas surprenant dans Mauricus, Ce qu'il dit à la table de Nerva n'est pas moins hardi. Cet empereur soupait avec, un petit nombre de ses amis. Veiento était près de lui et même penché sur son sein. Vous nommer le personnage, c'est vous en dire assez. La conversation tomba sur Catullus Messalinus qui, naturellement cruel, avait, en perdant la vue, achevé de perdre tout sentiment d'humanité. Il ne connaissait plus ni respect, ni honte, ni pitié, était, entre les mains de Domitien, comme le trait qui part et frappe aveuglément, et cet empereur barbare le lançait le plus souvent contre les citoyens vertueux. Chacun, pendant le souper, s'entretenait de la scélératesse de Messalinus et de ses conseils sanguinaires : Que pensez-vous, dit alors Nerva, qu'il lui serait arrivé, s'il vivait encore? Il souperait avec nous, répondit Mauricus.
J'ai fait une trop longue digression, mais à dessein. On prononça la suppression de ces jeux qui avaient gâté les mœurs de Vienne, comme nos jeux corrompent les mœurs de l'univers. Car les vices des Viennois sont renfermés dans leurs murailles ; les nôtres se répandent bien plus loin et, dans, le corps politique, comme dans le corps humain, la plus dangereuse des maladies, est celle qui vient de la tête. Adieu.
XXIII. — Pline à Pomponius Bassus.
J'ai ressenti un extrême plaisir quand j'ai appris, par nos amis communs que vous jouissez et disposez de votre loisir d 'une manière digne de votre sagesse, que vous habitez un séjour délicieux, que vous vous promenez souvent, soit sur terre, soit sur mer, que vous donnez beaucoup, de temps aux discussions, aux conférences, à la lecture et qu 'il n'est point de jour où vous n'ajoutiez à votre immense érudition. C'est ainsi que doit vieillir un homme qui s'est distingué dans les plus hautes fonctions de la magistrature, qui a commandé des armées, et qui s'est dévoué au service de la république, tant que l'honneur l'a voulu. Nous devons à la patrie le premier et le second âge de notre vie mais nous nous devons le dernier à nous-mêmes, les lois semblent nous le conseiller, lorsqu'à soixante ans elles, nous rendent au repos. Quand jouirai-je de cette liberté? Quand l'âge me permettra-t-il de vous imiter dans votre glorieuse retraite? Quand mon loisir ne sera-t-il plus appelé paresse, mais tranquillité? Adieu.
XXIV. — Pline à Valens.
Dernièrement, comme je plaidais devant les centumvirs, les quatre tribunaux assemblés, je me souvins que la même chose m'était arrivée dans ma jeunesse. Mes réflexions, comme de coutume, m'emportèrent plus loin. Je commençai à me rappeler ceux qui suivaient avec moi la carrière du barreau à l'une et à l'autre époque. J 'étais le seul qui se fût trouvé aux deux jugements : tant les lois de la nature, tant les caprices de la fortune amènent de changements ! Les uns sont morts, les autres bannis. L'âge ou les infirmités ont condamné celui-ci au silence, la sagesse ménage à celui-là un délicieux loisir. L'un commande une armée ; la faveur du prince dispense l'autre des devoirs de la vie civile. Moi-même, quelles vicissitudes n'ai-je point éprouvées ! Les belles-lettres m'ont élevé d'abord, exposé ensuite au péril, et enfin relevé. Mes liaisons avec les gens m'ont toujours été tour à tour avantageuses et nuisibles, elles me sont utiles aujourd'hui. Si vous comptez le années, le temps paraîtra court, si vous compter les évènements, vous croirez parcourir un siècle. Tant de changements dans une période si rapide, sont bien propre à nous apprendre à désespérer de rien, à ne compter sur rien. J'ai coutume de vous communiquer toutes mes pensées, de vous adresser les mêmes leçons, de vous proposer les mêmes exemples qu'à moi-même. Ne cherchez pas d'autre intention dans cette lettre. Adieu.

XXV. — Pline à Messius Maximus.
Je vous avais bien dit qu'il était à craindre que le scrutin secret n'amenât quelque désordre. A la dernière élection des magistrats, dans quelques billets, on a trouvé une foule de plaisanteries, et même des impertinences grossières : l'un d'eux, à la place du nom des candidats, portait le nom des protecteurs. Le sénat fit éclater son indignation, et appela à grands cris la colère du prince sur l'auteur de cette insolence. Mais il a échappé à tous ces ressentiments ; il est demeuré ignoré, et peut-être était-il un de ceux qui criaient le plus haut. Que ne doit-il pas oser chez lui, l'homme qui, dans une fonction si importante, dans une circonstance si grave, se permet des bouffonneries de ce genre, l'homme qui, en plein sénat, fait le railleur, le spirituel, l'agréable? Pour arriver à cet excès d'audace, une âme dépravée n'a besoin que de cette réflexion : Qui le saura ? Demander des tablettes, prendre la plume, baisser la tête pour écrire, ne pas redouter le témoignage d'autrui mépriser le sien, voilà tout ce qu'il faut pour en venir à ces insultes dignes de la scène et des trétaux. Que faire? Quel remède employer? le mal est plus fort que le remède. Mais ce soin regarde quelque autre plus élevé que nous, au zèle et aux travaux duquel notre inertie et notre licence effrénée préparent de jour en jour de nouveaux sujets de réforme. Adieu.
XXVI. - Pline à Népos.
Vous voulez que je m'occupe à relire et à corriger l'exemplaire de mes ouvrages que vous avez mis tant d'empressement à acheter. Je le ferai. De quel soin plus agréable pourrais-je me charger, surtout, quand vous m'en priez? Lorsqu'un homme aussi grave, aussi éclairé, aussi éloquent, et, de plus, aussi occupé que vous, croit devoir, en partant pour le gouvernement d'une grande province, emporter mes livres avec lui, avec quelle attention ne dois-je point veiller à ce que cette partie de son bagage ne l'embarrasse pas comme un fardeau inutile? Je tâcherai donc de vous rendre vos compagnons de voyage le plus agréables que je pourrai, et d'en préparer d'autres, pour votre retour, que vous désiriez joindre aux anciens : car rien ne peut m'engager plus vivement à composer de nouveaux ouvrages, qu'un lecteur tel que vous. Adieu.
XXVII- Pline à Falcon
Il y a trois jours que j'entendis avec un plaisir, extrême, et même avec admiration, la lecture des ouvrages de Sentius Augurinus. Il les appelle ses petits poèmes. Il en a de simples, de nobles, de galants, de tendres, de doux, de piquants, Il n'a rien paru, selon moi, de plus achevé dans ce genre, depuis quelques années, si je ne suis point aveuglé par l'amitié que je lui porte, ou par les louanges qu'il me donne dans une de ses pièces. Elle roule sur la fantaisie que j'ai quelquefois de composer des poésies fugitives. Vous allez vous-même apprécier mon jugement, si le second vers de cette pièce me revient car je tiens les autres. Bon ! le voilà revenu:
Qu'ai-je besoin de Calvus, de Catulle,
Quand je m'amuse à cadencer des riens ?
De Pline seul je veux être l'émule;
Pline pour moi vaut seul tous les anciens.
Ses vers, dictés par l'amoureuse ivresse, Loin du barreau prouvent qu'il sait charmer. - Pline, dis-tu se livre à la tendresse!... Graves Catons, refusez donc d'aimer.
Vous voyez quelle finesse, quelle justesse, quelle vivacité ! Le livre entier est écrit dans ce goût. Je vous en promets un exemplaire, des qu'il aura vu le jour. Aimez toujours ce jeune homme par avance, et félicitez notre siècle d'avoir produit un si beau génie, qu'accompagnent d'ailleurs toutes les vertus. Il passe sa vie tantôt auprès de Spurinna, tantôt auprès d'Antonin, allié de l'un, intime ami de tous les deux. Jugez par là du mérite d'un jeune homme qui est tant aimé de si vénérables vieillards. Car rien de plus vrai que cette maxime : On est tel que les gens qu'on aime à fréquenter. Adieu.
XXVIII. — Pline à Sévérus.
Hérennius Sévérus, homme érudit, tient beaucoup à placer dans sa bibliothèque les portraits de deux de vos compatriotes, ceux de Cornélius Népos et de Titus Cassius. Si vous avez ces portraits dans votre ville, comme cela est probable, il me prie de lui en envoyer des copies. En vous chargeant spécialement de ce soin, j'ai considéré d'abord votre amitié qui se prête avec une extrême obligeance à mes désirs, ensuite votre passion pour les belles-lettres et votre amour pour ceux qui les cultivent, enfin, le respect et la tendresse que vous inspirent tous ceux qui ont fait honneur à la patrie, non moins que la patrie elle-même. Veuillez donc choisir le peintre le plus habile : car, s'il est difficile de saisir la ressemblance d'après un original, combien ne l'est-il pas davantage d'après une copie? Tâchez, je vous prie, que l'artiste ne sacrifie pas la vérité, même pour l'embellir. Adieu.
XXIX. — Pline à Romanus.
Allons, paresseux, ne manquez pas, à la première audience qui se tiendra, de venir exercer vos fonctions de juge. Ne comptez | pas que vous puissiez vous en reposer sur moi. On no s'en dispense ï pas impunément. Le préteur Licinius Népos, personnage ferme et 1 sévère, vient de condamner à l'amende un sénateur même. Le sénateur a plaidé sa cause dans le sénat ; il l'a plaidée en homme qui. demande grâce. L'amende lui a été remise mais il l'a redoutée, mais il a prié, mais il a eu besoin de pardon. Tous les préteurs, dites! vous, ne sont pas aussi sévères. Vous vous trompez : il faut de la sévérité pour établir ou pour ramener de tels exemples. Mais quand ils sont une fois établis ou ramenés, les plus indulgents même peuvent les imiter. Adieu.
XXX. — Pline à Licinius.
Je vous ai rapporté de mon pays, pour présent, une question digne d'exercer votre profond savoir. Une fontaine prend sa source dans une montagne, coule entre des rochers, passe dans une petite salle de réunion faite de main d'homme, s'y arrête quelque temps, et enfin tombe dans le lac de Corne. Voici le merveilleux : trois fois le jour, elle s'élève et s'abaisse par un flux et un reflux réguliers. Ce phénomène frappe les yeux, et on l'observe avec un extrême plaisir. On s'assied sur le bord, on y mange, on boit même de l'eau de la fontaine, car elle est très fraîche et on la voit, à des temps fixes, monter ou se retirer graduellement. On place un anneau ou tout autre objet, à sec, sur le bord. L'eau le mouille peu à peu, et enfin le couvre tout à fait. Bientôt, il reparaît, et l'eau l'abandonne insensiblement. Si l'on prolonge ses observations, on voit le même phénomène se renouveler jusqu'à deux ou trois fois.
Quelque vent souterrain ouvrirait-il ou fermerait-il la source de cette fontaine, selon qu'il entre ou se retire avec force? C'est ce qui arrive dans les flacons et dans tous les vases dont l'ouverture se resserre, et qui n'ont pas d'abord toute leur largeur. Même quand on les penche, l'air, en s'efforçant d'y pénétrer, retarde l'écoulement de l'eau par des hoquets fréquents. Cette source aurait-elle la même propriété que l'Océan? Le flux et le reflux fait-il aussi croître ou décroître ce mince filet d'eau? Ou bien, comme les fleuves qui portent leurs eaux à la mer sont refoulés par les vents contraires ou par le reflux, y aurait-il de même quelque obstacle interne qui repousse par moments les eaux de cette fontaine? Peut-être encore les conduits secrets qui alimentent ont-ils une capacité déterminée. Tandis qu'ils rassemblent la même quantité d'eau qu'ils tiennent d'épancher. Le ruisseau diminue et coule plus lentement ; au lieu qu'il s'enfle et se précipite, lorsque ces canaux sont remplis. Enfin y aurait-il une espèce d'écluse mise en jeu par un ressort caché et inconnu qui renouvellerait l'épanchement des eaux, lorsque le bassin serait vide, et qui arrêterait et suspendrait leur cours, lorsque le bassin serait plein?
C'est à vous à découvrir les causes de ce grand phénomène. Personne ne le peut mieux que vous. Pour moi, je suis content, si j'ai bien exposé le fait. Adieu.

LIVRE CINQUIÈME. Retour
I— Pline à Sévèrus.
On vient de me faire un petit legs que j'estime plus qu'un legs considérable. Vous demandez pourquoi. Le voici, Pomponia Gratilla, ayant déshérité son fils Assudius Curianus, m'institua héritier avec Sertorius Sévérus, l'ancien préteur, et avec quelques chevaliers romains, distingués dans leur ordre. Curianus me pressa de vouloir bien lui donner ma part dans la succession, et d'établir par là un précédent en sa faveur mais en même temps il m'offrait de me laisser, par une stipulation secrète, cette même portion que je lui donnerais. Je lui répondis qu'il ne convenait pas à mon caractère d'agir en particulier autrement qu'en public ; que d'ailleurs je ne croyais pas qu'il fut honorable de faire une donation à un homme riche et sans enfants qu'enfin cette donation serait inutile à ses desseins ; qu'au contraire, un désistement de mon droit les favoriserait beaucoup, et que j'étais prêt à me désister, si j'étais bien convaincu qu'il eût été déshérité injustement. J'y consens, reprit-il, et je m'en rapporte à vous. Après avoir hésité un moment : Je le veux bien, lui dis-je car je ne vois pas pour quoi j'aurais de moi moins bonne opinion que vous-même. Mais souvenez-vous que rien n'ébranlera ma fermeté, si la justice m'en gage à décider pour votre mère. Comme vous voudrez, répondit-il car vous ne voudrez que ce qui sera juste. Je choisis donc, pour prononcer avec moi, deux des hommes qui jouissaient alors dans Rome de la plus haute estime, Corellius et Frontinus. Assis au milieu d'eux, je donnai audience à Curianus dans une chambre. Il dit tout ce qu'il crut lui être favorable. Je répliquai en peu de mots car personne n'était là pour défendre l'honneur de la testatrice. Après cela, je me retirai et ensuite, de l'avis de mon conseil, je lui dis : Il parait, Curianus, que le ressentiment de votre mère était juste.
Quelque temps après, il fait assigner mes cohéritiers devant les centumvirs, il n'excepte que moi. Le jour du jugement approchait. Tous mes cohéritiers souhaitaient une transaction ; non qu'ils se défiassent de leur cause, mais les circonstances leur faisaient peur. Ils appréhendaient (ce qu'ils avaient vu plus d'une fois arriver à d'autres), qu'au sortir d'un procès civil devant les centumvirs, ils ne tombassent dans un procès capital. Il en était plusieurs contre qui l'amitié de Gratilla et de Rusticus pouvait fournir un prétexte d'accusation. Ils me prient d'en conférer avec Curianus. Je me rends avec lui dans le temple de la Concorde. Là je lui dis : Si votre mère vous eût institué héritier pour un quart de son bien, ou si même elle vous eut fait son unique héritier mais que par des legs elle eût si fort chargé sa succession, qu'il ne vous en restât que le quart, auriez-vous droit de vous plaindre? Vous devez donc être content, si, étant déshérité par votre mère, ses héritiers vous abandonnent le quart de ce qu'ils recevront. Je veux pourtant encore y ajouter du mien. Vous savez que vous ne m'avez point assigné, et qu'une possession de deux années met ma portion d'héritage à couvert. Cependant, pour que mes cohéritiers vous trouvent plus traitable, et pour que la considération dont vous m'honorez ne vous coûte rien, je vous en offre autant pour ma part. Le témoignage secret de ma conscience ne fut pas le seul fruit que je recueillis, de cette action ; elle me fit honneur. C'est donc ce même Curianus qui m'a laissé un legs pour rendre un éclatant hommage à mon désintéressement, qui, si je ne me flatte point trop, est digne de nos ancêtres. Je vous donne ce détail, parce que j'ai coutume de m'entretenir avec vous, comme avec moi-même, de tout ce qui me cause de la peine ou du plaisir. Je crois, d'ailleurs, qu'il serait pénible de garder pour moi seul toute ma joie, et d'en frustrer mon ami : car ma sagesse ne va point jusqu'à ne compter pour rien cette sorte de récompense que la vertu trouve dans l'approbation de ceux qui l'estiment. Adieu.
II. — Pline à Flaccus.
Toutes les ressources de ma villa de Laurente et celles de la mer, par un temps si orageux, ne sauraient me fournir de quoi vous rendre l'équivalent des magnifiques grives que vous m'avez envoyées. Attendez-vous donc à une lettre stérile et franchement ingrate. Je ne veux pas même imiter l'adresse de Diomède à échanger des présents. Mais je connais votre indulgence : vous me pardonnerez d'autant plus facilement, que je me reconnais moins digne de pardon. Adieu.
III. — Pline à Ariston.
Parmi mes innombrables obligations envers vous, je compte pour une des plus grandes, que vous ayez bien voulu me raconter avec tant de franchise la longue discussion qui s'est élevée chez vous sur mes vers, et les divers jugements que l'on en porte. Vous m'apprenez que plusieurs personnes, sans trouver mes vers mauvais, me blâment, en amis vrais et sincères, d'en composer et de les lire. Ma réponse me rendra encore bien plus coupable à leurs yeux. Je fais de temps en temps des vers légers ; je compose des comédies, et je vais en écouter au théâtre, j'assiste au spectacle des mimes ; je lis volontiers les poètes lyriques ; je m'amuse même des vers sotadiques, enfin, il m'arrive quelquefois de rire, de plaisanter, de badiner et, pour exprimer en un mot tous les plaisirs innocents auxquels je me livre, je suis homme.
Je ne suis point fâché que ceux qui ignorent que les personnages les plus savants, les plus graves, les plus irréprochables ont com posé de ces bagatelles, soient surpris de me voir y consacrer quelques instants. Mais j'ose me flatter que ceux qui connaissent mes guides, me pardonneront aisément, si je m'égare sur leurs pas. Ce sont des hommes illustres, qu'il n'est pas moins glorieux d'imiter dans leurs amusements que dans leurs occupations. Je ne veux nommer personne parmi les vivants pour ne pas me rendre suspect de flatterie. Mais dois-je rougir de faire ce qu'ont fait Cicéron, C Calvus, Asinius Pollion, M. Messala, Q. Hortensias, M. Brutus, L. Sylla, Q. Catulus, Q. Scévola, Ser. Sulpicius, Varron, Torquatus, ou plutôt les Torquatus, C. Memmius, Lentulus, Gétulicus, Ann. Sénèque, et, de nos jours encore, Virginius Rufus? Si les exemples des particuliers ne suffisent pas, je citerai Jules César, Auguste, Nerva, Titus. Je ne parle point de Néron et cependant un goût ne cesse pas d'être légitime pour être quelquefois celui des méchants, tandis qu'une chose reste honorable par cela seul que les gens de bien en ont souvent donné l'exemple. Dans ce nombre on doit compter P. Virgile, Cornélius Népos, et, avant eux, Ennius et Accius. Il est vrai qu'ils n'étaient pas sénateurs mais la vertu n'admet point la distinction des rangs.
Toutefois, dira-t-on, je lis publiquement mes ouvrages, et peut-être n'ont-ils pas lu les leurs. J'en conviens. C'est qu'ils pouvaient s'en rapportera leur propre jugement. Moi, j'ai une conscience trop modeste pour croire parfait ce qui me paraît tel. Je lis donc à mes amis, et j'y trouve plus d'un avantage. D'abord, par respect pour l'auditoire qui doit l'écouter, un auteur apporte plus de soin à ses écrits ensuite, s'il a des doutes sur son ouvrage, il les résout, comme à la pluralité des voix. Enfin il reçoit différents avis de différentes personnes et, si on ne lui en donne point, les yeux, l'air, un geste, un signe, un murmure, le silence même, parlent assez clairement à quiconque ne les confond pas avec le langage de la politesse. C'est au point, que si quelqu'un de ceux qui m'ont écouté voulait prendre la peine de lire ce qu'il a entendu, il trouverait que j'ai changé ou retranché des endroits d'après son avis même, quoiqu'il ne m'en ait pas dit un mot. Et notez que je me défends, comme si j'avais rassemblé le peuple dans une salle publique, et non pas mes amis dans ma chambre. Avoir beaucoup d'amis a souvent fait honneur, et n'a jamais attiré de reproche. Adieu.
IV. - Pline à Valérien.
Voici une affaire assez mince, dont les suites peuvent avoir de l'importance. Solers, ancien préteur, a demandé au sénat la permission d'établir des marchés sur ses terres. Les députés de Vicente s'y sont opposés et Tuscilius Nominatus s'est présenté pour les défendre. L'affaire fut remise. Les Vicentins revinrent au sénat un autre jour, mais sans avocat. Ils se plaignirent d'avoir été trompés, soit qu'ils le crussent ainsi, soit que ce mot leur fût échappé. Le préteur Népos leur demanda quel avocat ils avaient chargé de leur cause. Le même, répondirent-ils, qui nous avait accompagnés la première fois. - Que lui avez-vous donné? Six mille sesterces. Ne lui avez-vous rien donné depuis? — Mille deniers. Népos a requis que Nominatus fût mandé. C'est, tout ce qui s'est passé ce jour-là. Toutefois, si je ne me trompe, cette affaire ira plus loin car il est bien des choses qu'il suffit de remuer ou de toucher légèrement pour qu'elles parcourent un grand espace. J'ai éveillé votre curiosité. Mais que de temps, que de prières ne vous faudra-t-il pas pour que je vous apprenne le reste, à moins que, pour le savoir plus tôt, vous ne veniez à Rome, et que vous n'aimiez mieux être spectateur que lecteur ! Adieu.
V. — Pline à Maxime.
On me mande que C. Fannius est mort. Cette nouvelle m'a plongé dans une profonde affliction. J'aimais sa politesse et son éloquence, et je prenais volontiers ses avis. Il était pénétrant, exercé dans les affaires et fertile en expédients. Ce qui ajoute à mes regrets, c'est sa propre infortune. Il est mort, laissant un ancien testament, dans lequel il oublie ses meilleurs amis, et comble de biens ses ennemis les plus déclarés. Mais on peut néanmoins s'en consoler. Ce qui est plus fâcheux, c'est qu'il n'a pu terminer l'excellent ouvrage auquel il travaillait. Ses affaires au barreau ne l'empêchaient pas d'écrite les aventures des malheureux que Néron avait bannis ou mis à mort. Déjà trois livres de cet ouvrage étaient achevés, et l'on y admirait la simplicité du récit, l'exactitude des faits, la pureté du style. Le ton tenait le milieu entre celui de la conversation et celui de l'histoire. L'empressement qu'on témoignait à les lire ajoutait au désir qu'il avait d'achever les autres.
Il me semble que la mort des écrivains qui consacrent leurs veilles à des œuvres immortelles, est toujours précoce et prématurée. Ceux qui, livrés aux plaisirs, vivent au jour le jour, meurent à la fin de, chaque journée mais ceux songent à la postérité et qui veulent éterniser leur mémoire, sont toujours surpris par la mort puisqu'elle interrompt toujours un travail commencé.
Il est vrai que C. Fannius eut, longtemps avant de mourir, un pressentiment de sa destinée. Il crut se voir, en songe, couché dans son lit, et dans l'attitude d'un homme qui étudie. Il avait, selon l'usage son portefeuille devant lui. Il s'imagina bientôt voir entrer Néron qui s'assit sur sa,couche, saisit le premier livre, déjà publié, où ses forfaits étaient tracés, le lut d'un bout à l'autre, prit ensuite et lut de même le second, le troisième, et se retira. Fannius, saisi de frayeur, se persuada, en interprétant ce songe, qu'il n'en écrirait pas plus que Néron n'en avait lu et son pressentiment s'est réalisé!
Je ne puis penser sans le plaindre devoir perdu tant de travaux et tant de veilles. Mon esprit se trouve naturellement ramené à l'idée de ma mort et à celle de mes écrits. Je ne doute pas que cette réflexion ne vous inspire les mêmes alarmes pour ceux auxquels vous travaillez encore. Ainsi, tandis que nous jouissons de la vie, cherchons à dérober à la mort le plus d'ouvrages que nous pourrons. Adieu.
VI. - Pline à Apollinaire.
J'ai été sensible à votre attention pour moi et à votre inquiétude, lorsque, informé que je devais aller cet été à ma villa de Toscane, vous avez essayé de m'en détourner, parce que vous ne croyez pas que l'air en soit bon. Il est vrai que le canton de Toscane qui s'étend le long de la mer est malsain et dangereux. Mais ma villa en est éloignée, que dis-je, elle est au pied de l 'Apennin dont l'air est plus pur que celui d'aucune autre montagne. Et, afin que vous soyez bien guéri de votre peur pour moi, voici quelle est la température du climat, la situation du pays et la beauté de la villa. Vous aurez autant de plaisir à lire ma description que moi à vous la faire.
En hiver, l'air y est froid et glacé. Le climat proscrit et repousse les myrtes, les oliviers et les autres espèces d'arbres qui exigent une chaleur continuelle. Cependant il souffre les lauriers auxquels il donne même le plus vif éclat. S'ils y meurent quelquefois, ce n'est pas plus souvent qu'aux environs de Rome. L'été y est d'une douceur merveilleuse. Un souffle rafraîchissant ne cesse d'agiter l 'air. Mais c'est plutôt la brise que le vent. Aussi l'on y voit beaucoup de vieillards, les aïeuls et les bisaïeuls de jeunes gens déjà faits. On entend raconter de vieilles histoires et les conversations de ses ancêtres. Quand on est en ce lieu, on se croit d'un autre siècle.
La disposition du terrain est d'une beauté ravissante. Imaginez-vous un amphithéâtre immense, tel que la nature seule peut le créer, une vaste plaine, environnée de montagnes que couronnent de hautes et antiques forêts. Toute espèce de gibier y abonde. Des taillis couvrent la pente des montagnes. Entre ces taillis sont des coteaux d'un terroir si bon et si gras, qu'il serait difficile d'y trouver une pierre, quand même on l'y chercherait. Leur fertilité ne le cède point à celle de la plaine et, quoique plus tardives, les moissons n'y mûrissent pas moins. Au pied de ces montagnes, sur le flanc des coteaux se prolongent des vignobles qui semblent se toucher et n'en former qu'un seul. Ces vignobles sont partout bordés d'arbrisseaux. Ensuite s'étendent des prairies et des terres labourables si fortes, que les meilleures charrues et les bœufs les plus robustes ont peine à en ouvrir le sol. Comme la terre est très compacte, le fer ne peut la fendre sans se charger de glèbes énormes, et, pour les briser, il faut repasser le soc jusqu'à neuf fois.
Les prés, émaillés de fleurs, y fournissent du trèfle et d'autres sortes d'herbes, toujours aussi tendres et aussi fraîches que si elles venaient d'éclore. Ils doivent cette fertilité aux ruisseaux intarissables qui les arrosent. Cependant, en des lieux où l'on trouve tant d'eaux, on ne voit point de marécages, parce que le terrain, disposé en pente, verse dans le Tibre toutes celles qu 'il n'a point absorbées. Ce fleuve qui passe au milieu des champs, est navigable, et sert en hiver et au printemps à transporter toutes les provisions de Rome. En été, il baisse si fort que son lit est presque à sec. C'est en automne qu'il reprend son nom de grand fleuve. On trouve un plaisir extrême à contempler cet horizon du haut d'une montagne. On croit voir, non des propriétés, mais un paysage dessiné d'après un modèle idéal : tant les yeux, de quel que côté qu'ils se tournent, sont charmés par la disposition et par la variété des objets!
La villa, quoique située au bas d'un coteau, a la même perspective que si elle était au sommet. Ce coteau s'élève par une pente si douce, que l'on s'aperçoit qu'on est montée sans avoir senti que l'on montait. Derrière la villa mais assez loin d'elle, est l'Apennin. Dans les jours même les plus calmes et les plus sereins, elle en reçoit des vents frais qui n' ont plus rien de vif et d'impétueux leur force s'est amortie et brisée en chemin. L'exposition est presque entièrement au midi, et semble invitée le soleil, en été vers le milieu du jour, en hiver un peu plus tôt, à venir dans une galerie fort large et longue à proportion.
Le bâtiment se compose de plusieurs ailes. L'entrée même respire le goût antique. Devant le portique se présente un par terre
divisé en plusieurs : planches bordées de buis ensuite un tapis
de verdure en talus et peu élevé, sur lequel le buis dessine des figures d'animaux opposées symétriquement l'une à l'autre. Plus bas se joue une souple et ondoyante draperie d'acanthes qu'entoure une allée d'arbres toujours verte, pressés les uns contre les autres, et diversement taillés. Puis on aperçoit une promenade circulaire, environnée de buis aux mille formes et d'arbustes qu'on a soin de tenir bas en arrêtant leur croissance. Cet ensemble est enclos de murailles qu'un buis étagé abrite et dérobe à la vue. De l'autre coté on découvre une prairie, aussi remarquable par sa beauté naturelle que les objets précédents par les efforts de l'art. Ensuite sont des champs, des prés et des arbrisseaux.
Au bout du portique se prolonge une salle à manger dont les portes donnent sur l'extrémité du parterre, et les fenêtres sur les prairies et sur une grande étendue de campagne. Par ces fenêtres on aperçoit de côté le parterre, la partie de la villa qui s'avance en saillie et le haut des arbres du manège. De l'un des côtés de la galerie et vers le milieu, on entre dans un appartement qui environne une petite cour ombragée de quatre platanes. Au milieu de la cour se trouve un bassin de marbre, d'où l'eau qui s'échappe entretient par une douce rosée la fraîcheur des platanes et des arbustes qui sont au-dessous. Dans cet appartement est une chambre à coucher où ne pénètre ni la voix, ni le bruit, ni le jour. Ensuite vient une salle à manger où l'on traite ordinairement, les intimes amis. Une autre galerie donne sur cette petite cour, et jouit de tous les horizons que je viens de décrire. Il y a encore une chambre que le voisinage d'un platane fait jouir de la verdure et de la fraîcheur. Elle est revêtue de marbre jusqu'à hauteur d'appui et, ce qui ne le cède point à la beauté du marbre, c'est une peinture qui représente des oiseaux perchés sur un branchage. Au-dessous est une petite fontaine et un bassin où l'eau, en s'échappant par plusieurs canaux, produit un délicieux murmure.
D'un coin de la galerie on passe dans une grande chambre qui fait face à la salle à manger. Elle a ses fenêtres, d'un côté sur le parterre, de l'autre sur la prairie et, immédiatement au-dessous de ses fenêtres, s'étend une pièce d'eau qui charme également les yeux et les oreilles : car l'eau tombe de haut dans un bassin de marbre, blanchissante d'écume. Cette chambre est fort chaude en hiver, parce que le soleil l'enveloppe de toutes parts. On y trouve un poêle qui, lorsque le temps est couvert, supplée par sa chaleur aux rayons du soleil. De l'autre côté est un vestiaire vaste et gai, et ensuite la salle du bain d'eau froide, garnie d'une fraîche et large baignoire. Si vous voulez un bain plus spacieux ou plus chaud, vous le trouvez dans la cour, et, tout auprès, un puits qui fournit de l'eau froide quand la chaleur incommode. A côté de la salle du bain froid est celle du bain tiède, échauffée par le soleil, mais moins que celle du bain chaud, parce que celle-ci est en saillie. On descend dans cette dernière par trois escaliers dont deux sont exposés au soleil, le troisième l'est beaucoup moins, sans être pour cela plus obscur. Au-dessus du vestiaire on voit un jeu de paume, divisé en plusieurs compartiments, pour différentes sortes d'exercices. Non loin du bain, un escalier conduit dans une galerie fermée, et, auparavant, dans trois appartements, dont l'un a vue sur la petite cour ombragée de platanes, l'autre sur la prairie, le troisième, qui donne sur des vignes, a autant de perspectives que d'ouvertures différentes. A l'extrémité de la galerie fermée est une chambre prise dans la galerie même, et qui regarde le manège, les vignes, les montagnes. Près de cette chambre s'en trouve une autre, exposée au soleil, surtout pendant l'hiver. De là on entre dans un appartement qui joint le manège à la maison. Voici l'aspect qu'il présente de face. A l'un des côtés s'élève une galerie fermée, tournée vers le midi, et où les vignes semblent être si près, que l'on croit y toucher. Au milieu de cette galerie on voit une salle à manger qui reçoit des vallées de l'Apennin une brise salutaire. La vue plonge de là sur des vignes, par de larges fenêtres et même par les portes, en traversant toute la galerie. Le côté où cette salle n'a point de fenêtres recèle un escalier dérobé destiné au service de la table. A l'extrémité est une chambre pour laquelle le coup d'œil de la galerie n'est pas moins agréable que celui des vignes. Au-dessous règne une galerie presque souterraine, et si froide en été, que sa température naturelle lui suffit, et qu'elle ne reçoit ni ne laisse désirer aucun souffle rafraîchissant. Après ces deux galeries fermées est une salle à manger suivie d'un portique, froid avant midi, chaud quelques heures après. Il conduit à deux appartements, l'un composé de quatre chambres, l'autre de trois, que le soleil, en tournant, éclaire ou laisse dans l'ombre. Devant ces bâtiments, si agréables et si bien disposés, s'étend un vaste manège, ouvert par le milieu. On l'aperçoit tout entier en entrant. Il est entouré de platanes tapissés de lierre ; en sorte qu'à la cime de ces arbres verdit leur propre feuillage, et au bas un feuillage étranger. Ce lierre circule autour du tronc et des branches, et enlace de ses guirlandes les platanes voisins. Entre ces platanes croissent des buis, et ces buis sont par dehors environnés de lauriers qui marient leur ombre à celle des platanes. L'allée du manège est droite; mais à son extrémité elle change de figure, et se termine en hémicycle. Ce manège est entouré et couvert de cyprès qui en rendent l'ombre plus épaisse et plus sombre. Les allées circulaires, en grand nombre dans l'intérieur, reçoivent le jour le plus pur. Les roses y naissent de tous côtés, et la chaleur du soleil contraste agréablement avec la fraîcheur de l'ombre. Après une infinité de labyrinthes, on rentre dans l'allée droite qui, des deux côtés, en a beaucoup d'autres séparées par des buis. Là est une petite prairie ; ici le buis même est taillé en mille figures différentes, quelquefois en lettres qui indiquent le nom du maître ou celui de l'ouvrier. Entre ces buis vous voyez s'élever tantôt de petites colonnes, tantôt des arbres chargés de fruits. A l'œuvre de l'art se mêle tout à coup l'imitation de la nature champêtre. Un double rang de petits platanes décore le milieu. Aux platanes succède l'acanthe flexible, serpentant de tous côtés, et ensuite un plus grand nombre de figures et de noms. A l'extrémité est un lit de repos de marbre blanc, abrité par une treille que soutiennent quatre colonnes de marbre de Caryste. De ce lit s'échappe l'eau, comme si le poids de ceux qui s'y couchent la faisait jaillir. De petits tuyaux la conduisent dans une pierre creusée exprès, et d e là elle est reçue dans un joli bassin de marbre, d'où elle s'écoule si imperceptiblement et dans de telles proportions, qu'il est toujours plein, sans déborder jamais. Si l'on veut manger en ce lieu, on place les mets les plus lourds sur les bords du bassin et les plus légers flottent dans des corbeilles qui figurent des barques et des oiseaux. Vis-à-vis est une fontaine jaillissante qui donne et reçoit l'eau en même temps : car l'eau, après s'être lancée, retombe sur elle-même, et, par deux ouvertures qui se joignent, elle descend et s'élève tour à tour.
En face du lit de repos, une chambre lui donne autant d'agrément qu'elle en reçoit, Elle est toute brillante de marbre, ses portes sont entourées et comme bordées de verdure. Au-dessus et au-dessous des fenêtres, on ne voit aussi que verdure de toutes parts. Immédiatement après, un petit cabinet semble à la fois s'enfoncer dans la même chambre et en être séparé. On y trouve un lit et, malgré les fenêtres qui l'éclairent de tous côtés, l'ombrage qui l'environne le rend sombre. En effet, une vigne féconde l'embrasse de ses pampres et monte jusqu'au faîte. A la pluie près, que l'on n'y sent point, on croirait être couché dans un bois. On y trouve aussi une fontaine qui se perd dans le lieu même de sa source. En différents endroits sont placés des siéges de marbre qui reçoivent, ainsi que la chambre, ceux qui sont fatigués de la promenade. Près de ces sièges sont de petits fontaines, et dans tout le manège murmurent des ruisseaux, en suivant, le long des conduits secrets, la direction qui leur est imprimée. Ainsi ils arrosent tantôt certaines plantations, tantôt d'autres, quelquefois toutes en même temps.
J'aurais abrégé depuis longtemps ces détails qui vous paraîtront minutieux, si je n'eusse résolu de parcourir avec vous, dans cette lettre, tous les recoins de ma villa. J'ai pensé que vous deviez lire sans ennui la description d'un lieu que vous auriez du plaisir à visiter, surtout étant libre d'interrompre votre lecture, de laisser là ma lettre, et de vous reposer à loisir. D'ailleurs j'ai cédé à mon penchant, et j'aime les ouvrages que j'ai commencés moi-même en grande partie, ou auxquels j'ai mis la dernière main. En un mot (car pourquoi ne pas vous découvrir mon goût, ou, si vous voulez, mon illusion?), je crois que la première obligation de tout homme qui écrit, c'est de songer à son titre. Il doit plus d'une fois se demander quel est le sujet qu'il traite, et savoir que, s'il ne s'en écarté point, il n'est jamais long mais qu'il est toujours prolixe, s'il recourt à des ornements étrangers. Voyez combien de vers Homère et Virgile emploient à décrire, l'un les armes d'Achille, l'autre celles d'Énée. Ils sont courts cependant, parce qu'ils ne font que ce qu'ils s'étaient proposé de faire... Voyez Aratus rechercher et rassembler les plus petites étoiles. Néanmoins il garde la mesure : car ce n'est point une digression de son ouvrage : c'est son sujet même. Ainsi, du petit au grand, dans la description que je vous fais de ma villa, si je ne m'égare point en détours hors du sujet, ce n'est pas ma lettre, c'est la villa elle-même qui est grande.
Je reviens à ma thèse, pour ne pas être condamné par mes propres règles, en faisant une trop longue digression. Vous voilà instruit des raisons que j'ai de préférer ma terre de Toscane à celles que je possède à Tusculum, à Tibur, à Préneste. Indépendamment des autres avantages dont je vous ai parlé, le loisir y est plus complet, plus sûr, et par conséquent plus doux. Point de cérémonial à observer ; les fâcheux ne sont point à votre porte, tout y est calme et paisible et ce profond repos ajoute encore à la salubrité du climat, à la sérénité du ciel, à la pureté de l'air. Là se fortifient à la fois mon corps et mon esprit, l'un par l'exercice de la chasse, l'autre par l'étude. Mes gens aussi jouissent en ce lieu d'une santé parfaite ; du moins, grâce aux dieux, je n'ai jusqu'ici perdu aucun de ceux que j'ai amenés avec moi. Puissent-ils me continuer toujours la même faveur, et conserver à ce séjour les mêmes privilèges ! Adieu.
VII. — Pline à Calvisius.
Il est certain que l'on ne peut, ni instituer l'État héritier, ni rien lui léguer. Cependant Saturninus, qui m'a fait son héritier, lègue à notre patrie un quart de sa succession, et ensuite fixe ce quart à une somme de quatre cent mille sesterces. Si l'on consulte la loi, le legs est nul. Si l'on s'en tient à la volonté du testateur, le legs est valable et régulier. Or la volonté du testateur (je ne sais comment les jurisconsultes prendront ceci) est pour moi plus sacrée que la loi, surtout lorsqu'il s'agit de conserver à notre patrie le bien qu'on lui a fait. Quelle apparence qu'après lui avoir donné onze cent mille sesterces de mon propre bien, je voulusse lui disputer un legs étranger qui n'est guère plus du tiers de cette somme? Je ne doute pas que vous n'approuviez ma décision, vous qui aimez notre patrie en bon citoyen. Je vous prie donc de vouloir bien, à la première assemblée des décurions, expliquer la disposition du droit, mais en peu de mots et avec simplicité. Vous ajouterez ensuite, que je suis prêt à payer les quatre cent mille sesterces que Saturninus a légués. Rendons à sa libéralité tout l'honneur qui lui est dû ; ne nous réservons que le mérite de l'obéissance.
Je n'ai pas voulu en écrire directement à l'assemblée. Ma confiance en votre amitié et en vos talents m'a fait penser que vous deviez et que vous pouviez, en cette occasion, parler pour moi comme pour vous-même. J'ai même appréhendé que ma lettre ne parût s'écarter de cette mesure qu'il vous sera aisé de garder dans le discours. L'air de la personne, le geste, le ton, déterminent le sens de ce qu'elle dit mais la lettre, privée de tous ces secours, est exposée à de malignes interprétations. Adieu.

VIII. - Pline à Capiton.
Vous m'engagez à écrire l'histoire, et vous n'êtes pas le seul : beaucoup d'autres m'ont donné ce conseil, et il est fort de mon goût. Ce n'est pas que je me flatte de réussir en ce genre (il y aurait de la légèreté à se le promettre, sans avoir essayé) mais je ne vois rien de plus glorieux que d'assurer l'immortalité à ceux qui méritent de vivre à jamais, et d'éterniser le nom des autres avec le sien. Quant à moi, rien ne me touche autant qu'une longue renommée, rien ne me paraît plus digne d'un homme, surtout de celui dont la conscience est tranquille, et qui n'a point à redouter les jugements de la postérité. Je songe donc nuit et jour par quelle voie aussi
Je pourrais m'élever au-dessus de la terre;
c'est assez pour moi ; car
De la Renommée occuper les cent voix,
c'est ce qui surpasse mon ambition. Si cependant!... mais non : je veux me contenter de ce que le genre historique semble promettre presque seul : car les harangues et la poésie ont peu d'attrait, à moins d'être excellentes, l'histoire plaît de quelque manière qu'elle soit écrite. Les hommes sont naturellement curieux, le plus simple récit des faits les intéresse à un tel point qu'ils s'amusent de contes même et de fables. Un exemple domestique m'invite encore à ce genre de composition. Mon oncle maternel, qui est aussi mon père par adoption, a écrit l'histoire avec une scrupuleuse fidélité et les sages m'apprennent que rien n'est plus beau que de marcher sur les traces de ses aïeux, quand ils vous ont ouvert la bonne voie.
Qui m'arrête donc? Le voici. J'ai plaidé de grandes et d'importantes causes. Quoique je m'en promette peu de gloire, je me propose de les retoucher, de peur qu'en leur refusant ce dernier soin, je n'expose à périr avec moi un travail qui m'a tant coûté : car, à l'égard de la postérité, rien de ce qui n'est pas achevé, n'est commencé. «Vous pouvez, direz-vous, revoir vos plaidoyers, et en même temps travailler à l'histoire. » Plût aux dieux qu'il en fût ainsi ! Mais ces deux ouvrages sont si considérables, que c'est déjà beaucoup que d'en exécuter un. J'ai plaidé ma première cause à dix-neuf ans et je ne commence qu'à peine à entrevoir, confusément encore, tout ce qu'exige la perfection de l'art oratoire. Que sera-ce si à ce fardeau j'en ajoute un autre? L'éloquence et l'histoire ont, sans doute, de grands rapports mais, dans ces rapports mêmes, il se rencontre plus d'une différence. L'une et l'autre racontent, mais diversement. La première s'accommode souvent de faits vulgaires, méprisables et communs ; la seconde aime les actions extraordinaires, brillantes, sublimes. Dans celle- là, les os, les muscles, les nerfs peuvent paraître ; l'éclat et l'embonpoint conviennent à celle-ci. L'éloquence veut de l'énergie, de la véhémence, du mordant ; l'histoire demande de la majesté, de la grâce, de la douceur. L'une et l'autre diffèrent par les ter mes, par le nombre, par la composition. Thucydide l'a dit : Autre chose est élever un monument, comme l'historien, autre chose est livrer un combat, comme l'orateur. ......
Voilà ce qui m'empêche de confondre des ouvrages si peu semblables, et que leur seule importance suffit pour séparer. Je crains que, troublé par un mélange si hétérogène, je n'aille brouiller les deux genres. En conséquence, pour parler toujours le langage du barreau, je demande un sursis. Pensez néanmoins dès à présent aux époques que nous devons aborder. Si nous choisissons les temps anciens dont nous avons déjà l'histoire, nos matériaux sont tout prêts mais la comparaison sera redoutable. Si nous entamons les temps modernes, nous nous ferons peu d'amis et beaucoup d'ennemis : car, outre que, dans une si grande corruption de mœurs, il y a bien plus d'actions à reprendre qu'à louer, on trouvera toujours que vous censurez trop ou que vous louez trop peu, lors même que vous aurez loué avec générosité et critiqué avec réserve. Mais ce n'est pas ce qui m'arrête : je me sens assez de courage pour être vrai. Tout ce que je vous demande c'est de m'ouvrir la voie que vous m'engagez à parcourir. Choisissez-moi un sujet, afin que, prêt à écrire, je n'aie plus aucun motif raisonnable de remettre et de différer. Adieu.
IX. — Pline à Saturnin.
Votre lettre a fait Sur moi des impressions diverses, car elle contenait tout à la fois d'agréables et de fâcheuses nouvelles. Les nouvelles agréables sont que vous restez à Rome. Vous en êtes fâché, dites-vous mais, moi, j'en suis ravi. Vous m'annoncez encore que vous attendez mon retour pour faire une lecture de vos ouvrages et je vous rends grâces de vouloir bien m'attendre. Les nouvelles fâcheuses sont que Julius Valens est fort malade encore, à ne consulter que son intérêt, doit-on le plaindre? il ne peut rien lui arriver de plus heureux que d'être au plus tôt délivré d'un mal incurable. Mais ce qui est vraiment triste, ce qui est déplorable, c'est la mort de Julius Avitus, au moment où il reve nait de sa questure : il a expiré dans le navire même, loin d'un frère qui l'aimait tendrement, loin de sa mère et de ses sœurs, Toutes ces circonstances ne sont plus rien pour lui, maintenant qu'il est mort mais quelles lui ont été cruelles dans ses derniers moments ! qu'elles le sont encore à ceux qui lui survivent! Quel chagrin de voir s'éteindre, dans la fleur de l'âge , un jeune homme d'une si belle espérance, et que ses vertus auraient élevé au plus haut rang, si elles eussent eu l e temps de mûrir ! Quel amour n'avait-il point pour les lettres ! que n'a-t-il point lu ? combien n'a-t-il point écrit !que de biens perdus avec lui pour la postérité? Mais pourquoi me laisser aller à la douleur ? Quand on s'y livre sans réserve, il n'est point pour elle de sujet léger. Il faut finir ma lettre, si je veux prêter le cours des larmes qu'elle me fait répandre. Adieu.
X. — Pline à Antonin.
Je ne sens jamais mieux toute la supériorité de vos vers que l orsque j'essaie de les imiter. Le peintre qui veut représenter une figure d'une beauté parfaite, sait rarement en conserver toutes les grâces. Comme lui, je reste, malgré mes efforts, au-dessous de mon modèle. Je vous en prie plus que jamais, donnez-nous beaucoup de semblables ouvrages, que tout le monde veuille imiter, et dont personne ou presque personne ne puisse approcher. Adieu.
XI. — Pline à Suétone.
Acquittez enfin la promesse de mes hendécasyllabes qui ont annoncé vos ouvrages à nos amis communs. On les souhaite, on les demande tous les jours avec tant empressement, que je crains qu'à la fin ils ne soient cités à comparaître. Vous savez que j'hésite autant qu'un autre, quand il s'agit de publier. Mais ma lenteur n'est point comparable à la vôtre. Ne différez donc plus à nous satisfaire ou craignez que je n'arrache, par des vers épigrammatiques ce que des vers flatteurs n'ont pu obtenir. Votre ouvrage est arrivé à son point de perfection. La lime, au lieu de le polir, ne pourrait plus que le gâter. Donnez-moi le plaisir de voir votre nom à la tète d'un livre ; d'entendre dire que l'on copie, qu'on lit, qu'on débite les œuvres de mon cher Suétone. Il est bien juste, dans notre mutuelle amitié, que vous me rendiez la joie que je vous ai donnée. Adieu.
XII - Pline à Fabatus.
Votre lettre m'apprend que vous avez décoré notre ville d'un superbe portique, en votre nom et en celui de votre fils ; que le lendemain, vous avez promis un fonds pour l'embellissement des portes, afin que votre première libéralité fût le commencement d'une autre. Je me réjouis premièrement de votre gloire dont une partie rejaillit sur moi par notre alliance ensuite de ce que la mémoire de mon beau-père soit assurée par de si beaux monuments enfin, je suis charmé que notre patrie reçoive des ornements de quelque main que ce soit, mais particulièrement de la vôtre. Il ne me reste qu'à prier les dieux de vous conserver dans cette disposition, et de ménager à cette disposition de longues années. Car je ne puis douter qu'après avoir achevé l'ouvrage que vous venez de promettre, vous n'en commenciez un autre. La libéralité ne sait point s'arrêter, quand une fois elle a pris son essor. Plus elle se répand, plus elle acquiert de prix. Adieu.
XIII — Pline à Scaurus.
Dans le dessein de lire un petit discours que je songe à publier, j'ai rassemblé assez d'amis pour avoir à redouter leur jugement, et assez peu pour apprendre la vérité. Car j'avais un double but dans cette lecture : le premier, de redoubler mon attention par le désir de plaire, le second, de profiler de celle d'autrui, pour découvrir des défauts que ma prévention pouvait m'avoir cachés. Mon but a été atteint : j'ai reçu des avis et moi-même j'ai marqué quelques endroits à retoucher. J'ai donc corrigé la pièce que je vous envoie. Le titre vous apprendra le sujet, et l'ouvrage vous expliquera le reste. II est bon de l'accoutumer, dès aujourd'hui, à se passer de préface pour être entendu. Mandez-moi, je vous prie, ce que vous pensez de l'ensemble du discours et de chacune de ses parties. Votre sentiment m'autorisera à le garder avec prudence, ou à le publier avec courage. Adieu.
XIV. — Pline à Valérien.
Vous me priez (et je me suis engagé à me rendre là-dessus à vos prières) de vous mander quel succès avait eu l'accusation intentée par Népos contre Tuscilius Nominatus.
On fit entrer Nominatus. Il plaida lui-même sa cause, et personne ne parla contre lui : car les députés des Vicentins non seulement ne le chargèrent point, mais l'aidèrent même à sortir d'embarras. Le précis de sa défense fut, qu'il avait manqué de courage plutôt que de fidélité, qu'il était sorti de chez lui, résolu de plaider ; qu'il avait même paru à l'audience mais qu'il s'était retiré, effrayé par les discours de ses amis, qu'on lui avait conseillé de ne pas s'opposer au désir d'un sénateur qui ne voyait plus dans l'affaire un simple établissement de marchés, mais une question qui touchait son crédit, son honneur et sa dignité, que, s'il négligeait cet avis, il devait s'attendre a un ressentiment implacable. En effet, lorsqu'il s'était retiré, quelques personnes, mais en très petit nombre, avaient applaudi à sa détermination. Il acheva sa défense par des excuses accompagnées de beaucoup de larmes et même, avec son habileté ordinaire, il avait tourné tout son discours de manière à paraître plutôt demander grâce que justice : c'était le parti le plus adroit et le plus sûr. Afranius Dexter, désigné consul, fut d'avis de l'absoudre. Il avoua que Nominatus eût mieux fait de soutenir la cause des Vicentins avec le même courage qu'il s'en était chargé mais il prétendit, que, puisqu'il n'était entré aucun artifice coupable dans la faute de Nominatus, que d'ailleurs il n'était convaincu d'aucune action punissable,il devait être renvoyé absous, sans autre condition que de rendre aux Vicentins ce qu'il en avait reçu.
Tout le monde partagea cet avis, excepté Flavius Aper. Il voulut qu'on suspendît Nominatus, pendant cinq ans, des fonctions d'avocat et, quoique son autorité n'eût entraîné personne, il demeura inébranlable dans son sentiment. Il alla même, en invoquant un règlement du sénat, jusqu'à faire jurer à Afranius Dexter (le premier qui avait opiné pour l'absolution), qu'il croyait cet avis salutaire à la république. Plusieurs se récrièrent contre cette proposition, toute juste qu'elle était, parce qu'elle semblait taxer de corruption celui qui avait opiné. Mais, avant qu'on recueillit les voix, Nigrinus, tribun du peuple, lut une remontrance pleine d'éloquence, et de force, où il se plaignait que les avocats vendissent leur ministère ; qu'ils vendissent même leur prévarication ; que l'on trafiquât des causes et qu'à la noble récompense de la gloire on substituât le revenu assuré que l'on tirait de la riche dépouille des citoyens. Il cita les lois faites sur ce sujet ; il rappela les décrets du sénat, et conclut que, puisque les lois et les décrets méprisés ne pouvaient arrêter le mal, il fallait supplier l'empereur de vouloir bien y remédier lui-même. Peu de jours après, le prince a fait publier un édit sévère et modéré tout ensemble. Vous le lirez : il est dans les archives publiques.
Combien je me félicite de n'avoir jamais fait aucune convention pécuniaire pour mes plaidoyers, et d'avoir refusé toute espèce de présents, même les plus légers! Il est vrai qu'on doit éviter le mal, non parce qu'il est défendu, mais parce qu'il déshonore. On est pourtant flatté de voir défendre publiquement ce que l'on ne s'est jamais permis. Il y aura peut-être (et il n'en faut même pas douter), il y aura moins d'honneur et moins de gloire dans mon procédé, lorsque tout le monde sera forcé d'imiter mon désintéressement volontaire. En attendant, je jouis du plaisir d'entendre les uns m'appeler devin, les autres me dire, en plaisantant, qu'on a voulu réprimer ma cupidité et mes rapines. Adieu.
XV. — Pline à Pontius.
J'étais à Come, quand j'ai appris que Cornutus Tertullus avait reçu la mission de surveiller les travaux de la voie Émilienne. Je ne puis vous exprimer combien j'en suis satisfait, tant pour lui que pour moi : pour lui, parce que, malgré sa modestie qui fuit les honneurs, il doit cependant, être flatté d'une distinction qui est venue le chercher, pour moi, parce que la gloire d'avoir été chargé des mêmes fonctions que Cornutus en double le prix à mes yeux. Car, s'il est flatteur d'être élevé en dignité, il ne l'est pas moins d'être égalé aux gens de bien. Et où trouver un homme meilleur, plus vertueux que Cornutus? Où trouver un plus parfait modèle de toutes les vertus antiques? Et ces qualités, je ne les connais pas seulement par la haute réputation dont il jouit à si bon droit; j'en parle sur la foi d'une longue expérience. Nous avons toujours eu, nous avons encore pour amis, dans l'un et l'autre sexe, presque toutes les personnes distinguées de notre temps. Cette communauté d'affection nous a très étroitement unis. Les charges publiques ont encore resserré nos nœuds. Vous savez, en effet, que le Sort, comme s'il eût entendu mes vœux, me l'a donné pour collègue dans la charge de préfet du trésor el dans le consulat. C'est alors que j'ai connu dans tout leur éclat ses vertus et ses talents. Je l'écoutais comme un maître, je le respectais comme un père; et, en cela, j'accordais bien moins à son âge qu'à la sagesse. Voilà ce qui m'engage à me réjouir, autant pour moi que pour lui, autant en public qu'en particulier, de ce qu'enfin la vertu ne conduit plus comme autrefois aux dangers, mais aux honneurs.
Je ne finirais point, si je m'abandonnais à ma joie. Je veux plutôt vous dire dans quelles occupations votre lettre m'a trouvé. J'étais avec l'aïeul, avec la tante paternelle de ma femme, et avec des amis que je n'avais point vus depuis longtemps. Je visitais mes terres. Je recevais les plaintes des paysans. Je lisais leurs comptes, en courant, et bien malgré moi : car je suis habitué à d'autres lectures, à d'autres écrits. Je commençais même à je me disposer au retour, attendu que mon congé est près d'expirer, et que la nouvelle même de la charge accordée à Cornutus me rappelle aux devoirs de la mienne. Je souhaite fort que vous quittiez votre Campanie dans le même temps, afin qu'après mon retour à Rome, il n'y ait aucun jour de perdu pour notre intimité. Adieu.
XVI. - Pline à Marcellin.
Je vous écris accablé de tristesse. La plus jeune des filles de notre ami Fundanus vient de mourir. Je n'ai jamais vu une personne plus enjouée, plus aimable, plus digne de vivre longtemps, plus digne de vivre toujours. Elle n'avait pas encore quatorze ans, et déjà elle montrait toute la prudence de la vieillesse, toute la gravité d'une femme accomplie, sans rien perdre de cette pudeur et de cette grâce naïve qui fait le charme du jeune âge. Avec quelle tendresse elle embrassait son père! avec quel abandon et en même temps quelle modestie elle recevait ceux qu'il aimait! Avec quelle équité elle partageait, son attachement entre ses nourrices et les maîtres qui avaient cultivé son esprit ou ses mœurs ! Quel goût, quelle intelligence dans ses lectures! Quelle sage réserve dans ses jeux! Quelle modération, quelle patience, quel courage même dans sa dernière maladie! Elle était docile aux ordonnances des médecins, elle consolait son père et sa sœur lors même que ses forces l'eurent abandonnée, son énergie la soutenait encore. Cette force d'âme l'a accompagnée jusqu'à sa dernière heure, sans que ni la longueur de la maladie ni la crainte de la mort aient pu l'abattre, comme pour augmenter encore notre douleur et nos regrets.
0 mort affreuse et. cruelle! ô mort que les circonstances rendent plus pénible encore ! Elle allait épouser un jeune homme distingué. Le jour des noces était fixé. Nous y étions déjà invités. Quel deuil a succédé à tant de joie! Je ne puis vous exprimer de quel coup je me suis senti frappé, quand j'ai appris que Fundanus, inspiré par la douleur, toujours féconde en tristes inventions, a ordonné lui-même que tout l'argent qui devait être dépensé en parures, en perles, en diamants, fût employé en encens, en baumes et en parfums. C'est un homme savant et sage qui s'est formé de bonne heure par les études les plus profondes. Mais aujourd'hui il méprise tout ce qu'il a entendu dire, tout ce que souvent il a dit lui-même. Il oublie toutes ses vertus, pour ne plus se souvenir que de sa tendresse. Vous lui pardonnerez, vous l'approuverez même, quand vous songerez à la perte qu'il a faite. II a perdu une fille qui, par son âme, autant que par les traits de son visage, était le vivant portrait de son père. Si donc vous lui écrivez sur la cause d'une douleur si légitime, souvenez-vous de mettre moins de raison et de force que de douceur et de sensibilité dans vos consolations. Le temps contribuera beaucoup à les lui faire goûter. Une blessure récente redoute la main qui la soigne, ensuite elle la supporte, et enfin la recherche. Ainsi une affliction vive éloigne et repousse d'abord les consolations. Bientôt elle les désire et s'y complaît, lorsqu'elles sont ménagées avec adresse. Adieu.
XVII. Pline à Spurinna.
Je sais combien vous vous intéressez à la prospérité des belles-lettres, et avec quelle joie vous apprenez que des jeunes gens d'une naissance illustre marchent dignement sur les traces de leurs ancêtres. Je m'empresse donc de vous dire que je suis allé hier entendre Calpurnius Pison. Il a lu son poème des Métamorphoses en astres, sujet profond et brillant. Il l'a traité en vers élégiaques, d'un tour coulant, gracieux et facile mais plein de majesté, quand l'occasion l'exige. Son style, par une agréable variété, s'élève et s'abaisse tour à tour. Il joint, avec un talent qui ne se dément jamais, la noblesse à la simplicité, la légèreté à la grandeur, la sévérité à l'agrément. La douceur de son accent faisait valoir son ouvrage, et sa modestie ajoutait au charme de sa voix. Il rougissait, et l'on voyait sur son visage cette crainte qui recommande si bien un lecteur. La timidité a, dans l'homme de lettres, je ne sais quelle grâce que n'a pas la confiance.
Je pourrais ajouter beaucoup d'autres particularités, aussi remarquables dans un homme de cet âge que rares dans un homme de cette condition mais il faut abréger. La lecture finie, j'embrassai Pison à plusieurs reprises et, persuadé qu'il n'y a point de plus puissant aiguillon que la louange, je l'engageai à continuer comme il avait commencé, et à illustrer ses descendants, comme il avait été illustré par ses aïeux. Je félicitai son excellente mère ; je félicitai aussi son frère qui, dans cette occasion, ne se fit pas moins remarquer par sa tendresse fraternelle, que Calpurnius par son éloquence tant son inquiétude et ensuite sa joie se manifestèrent pendant la lecture! Plaise aux dieux que j'aie souvent de semblables nouvelles à vous donner ! Car je fais tout pour que mon siècle ne soit point languissant et stérile, et je souhaite ardemment que nos patriciens n'attachent pas toute leur noblesse aux portraits de leurs ancêtres. Quant aux Pisons, il me semble que les images muettes de leurs pères les applaudissent, les encouragent, et (ce qui suffit à la gloire des deux frères) les avouent pour leur sang. Adieu.
XVIII — Pline à Macer.
Je suis content, puisque vous l'êtes. Vous avez avec vous votre femme et votre fils. Vous jouissez de la mer, de vos fontaines, de vos arbres, de vos champs, de votre délicieuse villa ; délicieuse sans doute, puisqu'elle a été la retraite d'un homme plus heureux alors que lorsqu'il fut parvenu au comble du bonheur. Pour moi, dans ma villa de Toscane, je me livre tour à tour à la chasse et à l'étude, quelquefois à l'une et à l'autre en même temps. Cependant je ne saurais encore décider lequel est le plus difficile à faire, une bonne chasse ou un bon ouvrage. Adieu.
XIX. — Pline à Paulinus.
Je vous avouerai ma douceur pour mes gens, d'autant plus franchement, que je sais avec quelle bonté vous traitez les vôtres. J'ai constamment dans l'esprit ce vers d'Homère :
II eut toujours pour eus le cœur d'un tendre père ;
et ce nom de père de famille, que parmi nous on donne aux maîtres. Mais, quand je serais naturellement insensible et dur, je serais encore touché de la maladie de mon affranchi Zosime. Je lui dois d'autant plus d'égards, qu'ils lui sont plus nécessaires. Il est honnête, complaisant, instruit. Sentaient principal, et son titre, pour ainsi dire, c'est celui de comédien. Il déclame avec feu, avec goût, avec justesse, même avec grâce, et il sait jouer de la lyre plus habilement qu'un comédien n'a besoin de le savoir. Ce n'est pas tout : il lit des harangues, des histoires et des vers aussi parfaitement que s'il n'avait jamais appris autre chose. Je suis entré dans ce détail pour vous apprendre combien cet homme seul me rend de services, et des services agréables. Ajoutez-y l'affection que j'ai pour lui depuis longtemps, et que son danger a redoublée. Car nous sommes faits ainsi : rien ne donne plus d'ardeur et de vivacité à notre tendresse que la crainte de perdre ce que nous aimons. Et ce n'est pas-la première fois que je crains pour sa vie. Il y a quelques années que, déclamant avec force et avec véhémence, il vint tout à coup à cracher le sang. Je l'envoyai en Egypte pour se rétablir et, après y avoir fait un long séjour, il en est revenu depuis peu en assez bon état. Mais, ayant voulu forcer sa voix plusieurs jours de suite, une petite toux, le menaça d'une rechute, et son crachement de sang le reprit. Pour essayer de le guérir, j'ai résolu de l'envoyer à votre terre de Frioul. Je me souviens de vous avoir souvent ouï dire que l'air y est sain, et le lait très bon pour ces sortes de maladies. Je vous prie donc d'écrire à vos gens de le recevoir dans votre maison et de fournir même aux dépenses qui lui seront nécessaires. Peu de chose lui suffira : car il est si frugal et si modéré, qu'il refuse, non seulement les douceurs que peut demander l'état d'un malade, mais les choses même que cet état semble, exiger. Je lui donnerai pour son voyage ce qu'il faut à un homme qui se rend, chez vous. Adieu.

XX.- Pline à Ursus.
Peu de temps après le jugement de Julius Bassus, les Bithyniens formèrent une nouvelle accusation contre Varénus, leur proconsul, Varénus qu'ils avaient sollicité et accepté pour avocat contre Bassus. Lorsqu'ils eurent été introduits dans le sénat, ils demandèrent l'information. Varénus, de son côté, réclama la faculté de faire entendre les témoins à décharge. Les Bithyniens s'y étant opposés, il fallut plaider. Je parlai pour lui avec succès. L'ai-je fait bien ou mal : le plaidoyer vous l'apprendra. La fortune a toujours sur l'issue d'un procès une influence propice ou funeste. La mémoire, le débit, le geste, la conjoncture même, enfin les préventions favorables ou contraires à l'accusé, donnent ou enlèvent à l'orateur beaucoup d'avantages, au lieu que le plaidoyer, à la lecture, ne se ressent ni des affections, des haines ; il n'y a pour lui ni hasard, heureux ni circonstance fatale. Fontéius Magnus, l'un des Bithyniens, me répliqua, et dit très peu de choses en beaucoup de paroles. La plupart des Grecs prennent, comme lui, la volubilité pour l'abondance. Ils lancent d'une seule haleine, avec la rapidité d'un torrent, les plus longues et les plus froides périodes. Cependant, comme dit fort bien Julius Candidus, loquacité n'est pas éloquence. L'éloquence n'a été départie qu'à un homme ou à deux, et même à personne, si l'on en croit Marc Antoine. Mais cette faconde, dont parle Candidus, est le talent de beaucoup de gens, et particulièrement celui des effrontés.
Le jour suivant, Homullus plaida pour Varénus avec adresse, avec chaleur, avec élégance. La réponse de Nigrinus fut concise, noble et fleurie. Acilius Rufus, consul désigné, permit aux Bithyniens d'informer. Il garda le silence sur la demande de Varénus, c'était assez clairement s'y opposer. Cornélius Priscus, personnage consulaire, voulut qu'on accordât également aux accusateurs et à l'accusé ce qu'ils demandaient et la majorité adopta son avis. Nous avons ainsi obtenu une décision qui n'avait pour elle ni la loi ni l'usage, et qui pourtant était juste. Pourquoi juste? je ne vous le dirai pas dans cette lettre, pour vous faire désirer mon plaidoyer car, si nous en croyons Homère,
Les chants les plus nouveaux sont les plus agréables;
et je dois faire en sorte qu'une lettre indiscrète n'enlève pas à mon petit discours cette grâce et cette fleur de nouveauté qui en font le principal mérite. Adieu.
XXI. — Pline à Rufus.
J e m'étais rendu dans la basilique Julienne pour entendre les avocats auxquels je devais répondre dans l'audience suivante. Les juges avaient pris place, les décemvirs étaient arrivés, les avocats étaient prêts, le silence régnait depuis longtemps. Enfin un envoyé du préteur se présente. On congédie les centumvirs. L'affaire est ajournée, à ma grande satisfaction : car je ne suis jamais si bien préparé, qu'un délai ne me fasse plaisir. La cause de cette remise est le préteur Népos qui fait revivre les lois du barreau. II venait de publier un édit fort court par lequel il avertissait et les accusateurs et les accusés qu'il exécuterait le décret du sénat transcrit à la suite de son édit. Par ce décret il était ordonné à tous ceux qui avaient un procès, de quelque nature qu'il fût, de prêter serment, avant de plaider, qu'ils n'avaient fait, pour le plaidoyer, ni don ni promesse, et qu'ils n'avaient exigé aucune garantie. Par ces termes, et par beaucoup d'autres, il était défendu aux avocats de vendre leur ministère, et aux parties de l'acheter. Néanmoins on permettait, une fois le procès terminé, de donner jusqu'à la concurrence de dix mille sesterces. Le préteur qui préside aux centumvirs, embarrassé par cette action de Népos, et voulant examiner s'il devait suivre son exemple, nous a donné ce loisir imprévu. Cependant toute la ville blâme ou loue redit de Népos. Beaucoup de gens s'écrient : Nous avons donc trouvé un censeur! Mais quoi! n'avions-nous point de préteurs avant lui? Quel est cet homme qui se mêle de réformer les mœurs publiques! D'autres disent : Que pouvait-il faire de plus sage en entrant en charge? il a consulté la loi, il a lu les décrets du sénat; il a aboli un trafic honteux, et ne peut souffrir que la fonction du monde la plus glorieuse soit vénale. Voilà les opinions qui se discutent dans les deux partis, et dont l'événement décidera. Rien de moins raisonnable, mais rien de plus commun, que de voir les résolutions honorables ou honteuses obtenir, suivant le succès, le blâme ou l'approbation. Aussi la même action est-elle qualifiée tour à tour de zèle ou de vanité, de liberté ou de folie. Adieu.
LIVRE VI. Retour
I.-Pline à Tiron
Tant que nous étions, vous dans le Picénum, moi au delà du Pô, je m'inquiétais moins de votre absence. Mais me voici de retour à Rome, et vous êtes encore dans le Picénum. C'est maintenant surtout que je vous regrette. Peut-être les lieux où nous avons coutume d'être ensemble me rappellent-ils plus vivement votre souvenir. Peut-être ce désir de revoir les absents augmente-t-il à mesure qu'on se rapproche d'eux, et l'impatience de posséder un bien s'irrite-t-elle d'autant plus, que l'espérance d'en jouir est plus prochaine. Quoi qu'il en soit, delivrez moi de ce tourment. Venez à Rome, ou bien je retourne aux lieux que j'ai eu l'imprudence de quitter, ne fût-ce que pour éprouver, lorsque pus vous trouverez à Rome sans moi, si vous m'écrivez du style dont je vous écris. Adieu.
II.-Pline à Arrien.
Je songe quelquefois à M. Régulus dans nos audiences : car je ne veux pas dire que je l'y regrette. Demandez-vous pourquoi j'y songe? C'est qu'il rendait hommage à l'importance de notre ministère : il tremblait, il pâlissait en parlant, il écrivait ses discours. Il est vrai qu'il ne pouvait se défaire de certaines habitudes, comme de se couvrir d'un enduit l'œil droit, s'il plaidait pour le demandeur, et l'œil gauche, s'il parlait pour le défendeur ; de transporter ainsi le bandeau blanc tour à tour de l'un à l'autre sourcil, et de céder à des superstitions ridicules en consultant toujours les aruspices sur le succès de sa cause. Mais tout cela prouvait encore la haute idée qu'il attachait à ses fonctions. Il était d'ailleurs fort agréable de plaider avec lui car il demandait, pour les plaidoiries un temps illimité, et se chargeait de réunir des auditeurs. Quel plaisir de pouvoir, sous la responsabilité d'un autre, discourir autant qu'on le veut, et parler avec faveur dans un auditoire assemblé pour lui seul !
Quoi qu'il en soit, Régulus a bien fait de mourir, et il eût mieux fait encore de mourir plus tôt. Car aujourd'hui, sous un empereur comme le nôtre, qui ne lui laisserait pas le pouvoir de nuire, sa vie n'aurait rien d'alarmant pour le public. Voilà pourquoi il est permis de penser quelquefois à lui. Depuis sa mort, la coutume s'est partout établie de ne donner, de ne demander même, pour plaider, qu'une ou deux clepsydres, et souvent qu'une demi clepsydre : car ceux qui parlent aiment mieux avoir plaidé que de plaider, et ceux qui écoutent songent plus à expédier qu'à juger : tant est grande la négligence, la paresse, le mépris de ses propres travaux, l'indifférence pour les dangers des parties ! Sommes-nous plus sages que nos ancêtres? plus justes que les lois qui accordent tant d'heures, tant de jours, tant de remises ? Nos pères étaient-ils donc si stupides et si lourds? Parlons-nous avec plus de clarté ? comprenons-nous plus vite ? jugeons-nous plus consciencieusement pour dépêcher les causes en moins d'heures qu'ils n'y employaient de jours? Où êtes-vous, Régulus, vous qui, par l'intrigue, obteniez de tous les juges ce que très peu d'entre eux accordent au devoir ?
Pour moi, toutes les fois que je suis juge (ce qui m'arrive plus souvent que d'être avocat), je donne libéralement tout le temps qu'on me demande. Je trouve qu'il y a de la témérité à deviner combien doit durer une cause que l'on n'a point entendue, à prescrire des bornes à l'explication d'une affaire qu'on ne connaît pas et je suis persuadé que la religion d'un juge doit lui faire compter la patience entre ses premiers devoirs, et pour une des plus importantes parties de la justice. Sans doute on dit beaucoup de choses inutiles. Soit mais ne vaut il pas mieux les entendre, que de ne pas laisser dire toutes celles qui peuvent être nécessaires ? D'ailleurs, comment connaître leur inutilité, quand elles n'ont point encore été dites?
Mais il vaut mieux réserver pour nos entretiens ces abus et plusieurs autres qui se font sentir à Rome. L'amour du bien public vous inspire, aussi bien qu'à moi, le désir de voir réformer des usages qu'il serait fort difficile d'abolir tout à fait. Venons maintenant à nos familles. Tout va-t-il bien dans la vôtre? Il n'y a rien de nouveau dans la mienne. Mais dû caractère dont je suis, plus je jouis d'un bien et plus il me devient précieux et plus je souffre d'un abus, plus je souffre d'un abus, plus l'habitude me le rend léger.Adieu.
III.-Pline à Varus.
Je vous remercie de vous être chargé de faire valoir la petite terre, que j'ai autrefois donnée à ma nourrice. Lorsque je lui en fis présent, elle était estimée cent mille sesterces ensuite la diminution du revenu en avait déprécié le fonds qui reprendra par vos soins sa première valeur. Souvenez-vous seulement que ce ne sont ni les arbres, la terre, que je vous recommande le plus, mais le don que j'en ai fait. Celle qui l'a reçu n'a pas plus d'intérêt à le voir fructifier, que moi qui l'ai offert. Adieu.
IV- Pline à Calpunie
Jamais je ne me suis tant plaint de mes occupations, que lorsqu'elles ne m'ont permis, ni de vous accompagner quand votre santé vous obligea de partir pour la Campanie , ni de vous suivre immédiatement après votre départ. C'est surtout alors que j'eusse désiré d'être avec vous, pour juger par mes yeux si vos forces re venaient, si ce corps délicat se rétablissait, et comment enfin votre tempérament se trouvait des plaisirs de la solitude et de la fertilité du pays. Quand vous vous porteriez bien, je ne supporterais qu'avec peine votre absence : car rien n'inquiète et ne tourmente plus que de ne recevoir quelquefois aucune, nouvelle de la personne qu'on aime le plus tendrement. Mais votre absence et votre maladie me jettent dans une profonde perplexité. Je crains tout, je me forge mille chimères et, comme il arrive quand on est dominé par les alarmes, je suppose toujours ce que je redoute le plus. Je vous prie donc instamment de prévenir mes anxiétés par une et même par deux lettres chaque jour. Je serai plus tranquille, tant que je lirai mais je retomberai dans mes premières inquiétudes, dès que j'aurai lu.. Adieu.»
V. Pline à Ursus.
Je vous ai écrit que Varénus avait obtenu la permission de faire entendre ses témoins. Ce décret a paru juste à la majorité des sénateurs mais, quelques-uns l'ont critiqué, et ont soutenu leur avis avec opiniâtreté ; entre autres, Licinius Népos qui, à rassemblée suivante où l'on délibérait, sur un autre sujet, a parlé du dernier sénatus-consulte, et a traité de nouveau la question jugée. Il a même ajouté qu'il fallait prier les consuls de demander au sénat, si son intention était qu'à l'avenir on agît à l'égard du péculat comme à l'égard de la brigue, et que, dans l'une et l'autre accusation, il fût permis à l'accusé, aussi bien qu'à l'accusateur, de produire des témoins. Cette remontrance a déplu à quelques personnes comme tardive et déplacée. Elles trouvaient qu'après avoir négligé l'occasion de s'opposer au décret, on blâmait ce qui était fait, et ce que le décret avait pu prévenir. Le préteur, Jubentius Celsus, dans un discours plein d'énergie, blâmait Népos de s'être érigé en réformateur du sénat. Népos répondit, Celsus répliqua, et ni l'un ni l'autre ne ménagea les injures. Je ne veux pas répéter ce que j'ai été fâché de leur entendre dire. Jugez si j'ai dû approuver la conduite de quelques-uns de nos sénateurs qui, entraînés par la curiosité, couraient tour à tour à Celsus et à Népos, selon que l'un ou l'autre parlait. Ils semblaient tantôt exciter et échauffer la dispute, tantôt l'adoucir et l'apaiser ; souvent ils réclamaient, comme dans un spectacle, la protection de César pour l'un ou pour l'autre et quelquefois pour tous deux.
Mais ce que j'ai trouvé de plus indigne, c'est que chacun était instruit de ce que son adversaire devait dire contre lui : car Celsus tenait à la main sa réponse écrite sur une feuille, et Népos avait sa réplique tracée sur ses tablettes. L'indiscrétion de leurs amis les a si bien servis, que ces deux hommes, qui devaient se disputer, savaient d'avance tout le détail de leur querelle, comme s'ils l'eussent concertée. Adieu.
VI. - Pline à Fundanus.
Jamais je ne vous ai tant souhaité à Rome qu'en ce moment, et je vous prie d'y venir. J'ai besoin d'un ami qui s'associe à mes désirs, à mes fatigues, à mes inquiétudes. Jules Nason aspire aux honneurs, il a beaucoup de concurrents, des concurrents pleins de mérite qu'il lui sera aussi difficile que glorieux de vaincre. A mon anxiété, à mes alternatives d'espérance et de crainte, je ne croirais pas avoir jamais été consul : il me semble que je sollicite pour la première fois les charges que j'ai remplies. Nason mérite cet empressement par l'affection qu'il m'a vouée depuis longtemps. Mon amitié pour lui n'est pas un bien qu'il ait hérité de son père, car son père et moi nous étions d'âges trop différents pour avoir pu être amis. Toutefois, dans mon enfance, on me le montrait avec les plus grands éloges. Il n'aimait pas seulement les lettres, il chérissait, ceux qui les cultivaient ; il assistait presque tous les jours aux leçons de Quintilien et de Nicètes Sacerdos, alors mes professeurs. C'était d'ailleurs un homme qui avait un nom et de la considération. Sa mémoire devrait aujourd'hui servir très utilement son fils. Mais, dans le sénat, beaucoup de personnes ne l'ont pas connu, et beaucoup d'autres, qui l'ont connu, ne font cas que des vivants. Nason doit donc, sans trop compter sur la gloire de son père, qui lui donnera plus de lustre que de crédit, ne rien attendre que de ses soins et de ses efforts, il semble qu'il ait prévu la position où il se trouve, et qu'elle ait toujours réglé sa conduite. Il s'est fait des amis, et il les a cultivés. Il s'est attaché à moi, et m'a choisi pour modèle dès qu'il a été en état de pouvoir choisir. Toutes les fois que je plaide, il s'empresse de venir m'écouter ; il assiste à mes lectures. Quand je compose quelque nouvel ouvrage, il le voit, pour ainsi dire, naître et grandir. Il partageait ma confiance avec un frère qu'il a récemment perdu, et dont je dois prendre la place. Quel sujet de regret pour moi ! l'un est fatalement enlevé avant le temps, l'autre est privé de l'appui du meilleur des frères, et abandonné à la protection de ses seuls amis.
J'exige donc de votre attachement que vous veniez au plus tôt appuyer mon suffrage du vôtre. Il est d'une grande importance pour moi de vous montrer partout, et d'aller partout avec vous. Tel est votre ascendant, que mes prières, soutenues des vôtres, seront plus efficaces, même auprès de mes amis. Rompez tous les engagements qui pourraient vous retenir. Vous devez ce sacrifice aux intérêts, à la confiance, et j'ajouterai à l'honneur d'un ami. J'ai pris le candidat sous ma protection, et tout le monde le sait. C'est donc moi qui sollicite, c'est moi qui cours des dangers. En un mot, si l'on accorde à Nason ce qu'il demande, l'avantage en sera tout à lui, s'il ne l'obtient pas, c'est moi qui subirai la honte du refus. Adieu.
VII. — Pl ine à Calpumie.
Vous me dites que mon absence vous cause beaucoup d'ennui, que votre unique consolation est de lire mes ouvrages, et souvent même de les mettre à ma place auprès de vous. Vos regrets me flattent, et la manière dont vous les calmez ne me flatte pas moins. De mon côté, je relis vos lettres, et les reprends de temps en temps, comme si je venais de les recevoir mais elles ne servent qu'à rendre plus vif le chagrin que j'ai de ne point vous voir. Quelle douceur ne doit-on point trouver dans la conversation d'une personne dont les lettres ont tant de charmes! Ne laissez pas pourtant de m'écrire souvent, quoique ce plaisir ne soit pas pour moi sans tourment. Adieu.
VIII. — Pline à Priscus.
Vous connaissez Attilius Crescens ; vous l'aimez : car y a-t-il. quelque personne un peu considérable qui ne le connaisse et qui ne l'aime? Pour moi, je ne me contente pas de l'affection que tout le monde lui porte ; je le chéris avec une tendresse particulière. Les villes où nous sommes nés ne sont qu'à une journée l'une de l'autre. Notre amitié a commencé dès nos plus jeunes ans et ce sont là les amitiés les plus vives. Le temps et la raison, loin de l'affaiblir, n'ont fait que l'augmenter. Tous ceux qui nous connaissent te savent parfaitement : car il se vante partout de mon attachement, pour lui, et je ne laisse ignorer à personne combien son honneur, son repos et sa fortune m'intéressent. C'est au point que, pour le rassurer un jour contre l'insolence d'un homme qui allait exercer la charge de tribun, je lui dis :
Nul, tant que je vivrai, je t'en donne ma foi,
Nul ici n'osera porter la main sur toi.
Pourquoi ces détails? pour vous apprendre que, de mon vivant, Attilius ne recevra jamais d'outrage. Encore une fois, me direz-vous, où voulez-vous en venir? Le voici. Valérius Varus devait de l'argent à Attilius. Il est mort en laissant Maxime pour son héritier. Quoique Maxime soit de mes amis, il est encore plus des vôtres. Je vous conjure donc, et j'exige de vous, au nom de notre amitié, que vous fassiez en sorte qu'Attilius soit entièrement remboursé de tout ce qui lui est dû, non seulement en capital, mais en intérêts échus depuis plusieurs années. C'est un homme tout à fait désintéressé, attentif à conserver son bien, et sans aucun emploi lucratif. Sa frugalité fait tout son revenu : car il ne cultive les belles-lettres, où il excelle, que pour son plaisir ou pour sa gloire. La plus petite perte lui est d'autant plus onéreuse, qu'il lui est difficile de la réparer. Délivrez-nous l'un et l'autre de cette inquiétude. Laissez-moi jouir de la douceur et des agrément, de sa conversation : car je ne puis voir dans le chagrin celui dont la gaieté dissipe ma tristesse. Enfin vous connaissez son enjouement. Prenez garde, je vous prie, qu'une injustice ne le change en amertume et en mauvaise humeur. Par la vivacité de sa tendresse, jugez quelle serait la violence de son ressentiment. Une âme si grande et si fière ne supportera pas un si outrageant préjudice et, s'il le supportait, je le poursuivrais, moi, comme une atteinte à mes propres intérêts, comme une injure personnelle, ou plutôt, j'en serais plus indigné que si j'en souffrais moi-même.
Mais pourquoi ces déclarations et ces sortes de menaces ? Il est plus sûr de finir comme j'ai commencé, et devons supplier, de vous conjurer de mettre tout en usage pour ne pas donner lieu de croire, ni à lui (ce que je crains très fortement) que j'ai négligé ses affaires, ni à moi que vous avez négligé les miennes. Vous en viendrez à bout, si vous tenez autant à remplir un de ces devoirs, que je tiens à remplir l'autre. Adieu.

IX. — Pline à Tacite.
Vous me recommandez Jules Nason qui aspire aux charges pu bliques. A moi, me recommander Nason ! c'est comme si vous me recommandiez à moi-même. Je vous excuse pourtant, et vous le pardonne : car je vous aurais fait la même recommandation, si, vous étant à Rome, j'en eusse été absent. Voilà les inquiétudes de l'amitié : elle croit tout nécessaire. Cependant, je vous le conseille, sollicitez tout autre que moi : je seconderai, je soutiendrai vos instances auxquelles je m'associe. Adieu.
X. — Pline à Albin.
J'ai été visiter ma belle-mère dans sa villa d'Alsium qui appartenait autrefois à Virginius Rufus. Ce lieu a renouvelé ma douleur et mes regrets en me rappelant un illustre et excellent homme. II se plaisait dans cette retraite qu'il avait coutume d'appeler le nid de sa vieillesse. Partout où se portaient mes pas, mon cœur et mes yeux le cherchaient. J'ai même voulu voir son tombeau, et j'ai re gretté de l'avoir vu: car il n 'est pas encore achevé, et l'on ne peut s'excuser sur la difficulté du travail. Le monument est plus que modeste : il faut accuser la négligence de celui à qui le soin en a été confié. J'éprouve à la fois l'indignation et la pitié, quand je vois, dix ans après sa mort, les restes d'un homme dont la gloire est répandue par toute la terre, abandonnés, sans inscription et sans honneur. Il s 'était pourtant occupé lui-même de son tombeau. II avait ordonné qu'on y gravât ces vers qui rappellent une action sublime et immortelle :
Ci-gitRufus, dont la victoire
De Vindex punit l'attentat, Et qui ne voulut d'autre gloire Que la liberté de l'État.
Il faut si peu compter sur les amis, et les morts sont sitôt oubliés, que c 'est à nous à bâtir nous -mêmes notre tombeau, et à devancer les soins de nos héritiers. Car comment ne pas craindre c e que nous voyons arriver à Virginius, dont la célébrité rend plus indigne et plus notoire en même temps l'outrage qu'il a reçu ? Adieu.
XI.- Pline à Maxime
O jours heureux ! Le préfet de la ville m'ayant appelé à siéger avec lui, j'ai entendu plaider, l'un contre l'autre, deux jeunes gens d' une grande espérance, d'un noble caractère, Fuscus Salinator et Numidius Quadratus. Tous deux par leur mérite feront hon neur à notre siècle et aux lettres elles-mêmes. Ils ont une intégrité parfaite qui n'ôte rien à leur énergie, un air distingué, une prononciation nette, une voix mâle, une mémoire sûre, un esprit élevé, un jugement exquis. Cet ensemble m'a causé du plaisir. Mais ce qui m'en a fait le plus, c'est qu'ils avaient les yeux attachés sur moi, comme sur leur guide, comme sur leur maître, et que les auditeurs trouvaient qu'ils voulaient m'imiter et marcher sur mes traces. 0 jour heureux ! je le répète, Ô jour que je dois compter parmi les plus beaux de ma vie! Qu'y a-t-il en effet, de plus intéressant pour le public, que de voir des jeunes gens d'une naissance illustre chercher à se faire une réputation et un nom par les lettres, et de plus délicieux pour moi, que d'être choisi comme modèle par ceux qui veulent se former au bien? Puissent les dieux me faire goûter éternellement cette joie! Puissent-ils (je vous en prends à témoin) rendre meilleurs que moi tous ceux qui me jugeront digne d'être imité ! Adieu.
XII. — Pline à Fabatus.
Vous ne devez pas me recommander timidement ceux que vous jugez dignes de votre protection. Il vous sied d'être utile à beaucoup de gens, et à moi d'acquitter toutes les obligations dont vous pouvez être chargé. Comptez que je rendrai à Vectius Priscus tous les services dont je serai capable, particulièrement sur mon terrain, c'est-à-dire, au tribunal des centumvirs. Vous me priez d'oublier les lettres que vous m'avez, dites-vous, écrites à coeur ouvert mais il n'en est point dont je conserve plus chèrement le souvenir. Elles me font vivement sentir combien vous m'aimez, lorsque je vois que vous en usez avec moi comme vous le faisiez avec votre fils. Je l'avoue même, elles m'ont flatté d'autant plus, que je n'avais rien à me reprocher : car j'avais satisfait avec le plus grand zèle à tous les devoirs que vous vouliez m'imposer. Je vous supplie donc avec instance de me traiter toujours avec la même franchise, et de ne pas m'épargner les reproches, quand vous me croirez coupable de négligence (je dis quand vous me croirez coupable, car je ne le serai jamais). Nous aurons ainsi tous deux le plaisir de savoir, moi, que ces reproches viennent, de l'excès de votre tendresse, vous, que je ne les ai pas mérités. Adieu.
XIII. — Pline à Ursus.
Avez-vous jamais vu un homme plus tourmenté, plus persécuté que mon ami Varénus? Il a été obligé de soutenir, et, pour ainsi dire, de demander encore une fois ce qu'il avait déjà obtenu avec beaucoup de peine. Les Bithyniens ont eu l'audace, non seulement de censurer et de battre en brèche auprès des consuls la décision du sénat, mais encore de l'inculper aux yeux de l'empereur, qui n'était pas présent quand ce décret fut rendu. Renvoyés par lui devant le sénat, ils n'en poursuivirent pas moins leur requête. Claudius Capito parla le premier, je ne dirai pas avec fermeté, mais sans ménagement, en homme qui accusait un sénatus-consulte dans le sénat même. Fronto Catius répondit avec autant d'énergie que de sagesse. Le sénat lui-même s'est admirablement conduit : car ceux qui, avant le décret, avaient été d'avis de rejeter les demandes de Varénus, ont déclaré qu'on ne pouvait pas refuser après avoir accordé. Ils ont pensé que, lorsque l'affaire était indécise, chacun avait pu opiner selon ses lumières mais qu'après la décision, l'avis qui avait prévalu devait être adopté par tout le monde. Il n'y eut qu'Acilius Rufus, et avec lui sept ou huit autres, soyons exacts, sept autres seulement, qui persistèrent dans leur premier sentiment. Il y en avait dans ce petit nombre auxquels la gravité de circonstance, ou plutôt, la gravité apparente semblait ridicule. Jugez pourtant, par tout ce que nous coûte ce prélude et cette escarmouche, quels assauts j'aurai à soutenir dans le véritable combat. Adieu.
XIV. - Pline à Mauricus.
Vous me pressez d'aller vous voir à votre villa de Formium. J'irai, à condition que vous ne vous gênerez en rien pour moi, condition réciproque dont je prétends bien profiter à mon tour. Car ce n'est ni la mer, ni ses rivages, c'est vous, c'est le loisir, c'est la liberté que je cherche. Sans cela, il vaudrait mieux demeurer à Rome. Il faut tout faire à son gré, ou tout au gré d'autrui. Tel est mon caractère ; je ne veux rien à demi. Adieu.
XV. — Pline à Romanus.
Voici une scène assez plaisante dont vous n'avez pas été témoin. J'étais absent aussi mais on me l'a contée à mon retour de Rome. Passiénus Paulus, illustre chevalier romain, et personnage fort savant, fait des vers élégiaques : c'est un goût de famille. I! est du pays de Properce, et même il le compte parmi ses ancêtres. Il lisait en public un ouvrage qui commençait par ces mots : Priscus, vous ordonnez... A cela, Javolénus Priscus, qui assistait à la lecture, comme intime ami de Paulus, s'empresse de répondre : moi! je n'ordonne rien. Imaginez-vous les éclats de rire et les plaisanteries qui suivirent. Javolénus n'a pas l'esprit fort sain. Cependant il prend part aux devoirs de la vie publique ; on le choisit pour conseiller dans nos tribunaux ; son opinion est même légalement admise dans les débats judiciaires, ce qui rend encore plus ridicule et plus remarquable ce qu'il fit alors. Cette extravagance, dont Paulus n'était pas responsable, ne laissa pas de refroidir un peu sa lecture : tant il importe à ceux qui doivent lire leurs ouvrages en public, non seulement d'être sensés eux-mêmes, mais encore de n'avoir que des gens sensés pour auditeurs ! Adieu.
XVI. - Pline à Tacite.
Vous me demandez des détails sur la mort de mon oncle, afin d'en transmettre plus fidèlement le récit à la postérité. Je vous en remercie : car je ne doute pas qu'une gloire impérissable ne s'attache à ses derniers moments, si vous en retracez l'histoire. Quoique dans un désastre qui a ravagé la plus belle contrée du monde, il ait péri avec des peuples et des villes entières, victime d'une catastrophe mémorable qui doit éterniser sa mémoire ; quoiqu'il ait élevé lui-même tant de monuments durables de son génie, l'immortalité de vos ouvrages ajoutera beaucoup à celle de son nom. Heureux les hommes auxquels les dieux ont accordé le privilège de faire des choses dignes d'être écrites, ou d'en écrire qui soient dignes d'être lues! plus heureux encore ceux auxquels ils ont départi ce double avantage ! Mon oncle tiendra son rang parmi les derniers, et par vos écrits et par les siens. J'entreprends donc volontiers la tâche que vous m'imposez, ou plutôt, je la réclame.
Il était à Misène où il commandait la flotte. Le neuvième jour avant les calendes de septembre, vers la septième heure, ma mère l'avertit qu'il paraissait un nuage d'une grandeur et d'une forme extraordinaire. Après sa station au soleil et son bain d'eau froide, il s'était jeté sur un lit où il avait pris son repas ordinaire, et il se livrait à l'étude. Il demande ses sandales et monte en un lieu d'où il pouvait aisément observer ce phénomène. La nuée s'élançait dans l'air, sans qu'on pût distinguer à une si grande distance de quelle montagne elle sortait. L'événement fit connaître ensuite que c'était du mont Vésuve. Sa forme approchait de celle d'un arbre, et particulièrement d'un pin : car, s'élevant vers le ciel comme sur un tronc immense, sa tête s'étendait en rameaux. Peut-être le souffle puissant qui poussait d'abord cette vapeur ne se faisait-il plus sentir, peut-être aussi le nuage, en s'affaiblissant ou en s'affaissant sous son propre poids, se répandait-il en surface. Il paraissait tantôt blanc, tantôt sale et tacheté, selon qu'il était chargé de cendre ou de terre. Ce phénomène surprit mon oncle, et, dans son zèle pour la science, il voulut l'examiner de plus près. Il fit appareiller un navire liburnien, et me laissa la liberté de le suivre. Je lui répondis que j'aimais mieux étudier, il m'avait par hasard donné lui-même quelque chose à écrire. Il sortait de chez lui, lorsqu'il reçut un billet de Rectine, femme de Césius Bassus. Effrayée de l'imminence du péril (car sa villa était située au pied du Vésuve, et l'on ne pouvait, s'échapper que par la mer), elle le priait, de lui porter secours. Alors il change de but, et poursuit par dévouement ce qu'il n'avait d'abord entrepris que par le désir de s'instruire. Il fait préparer des quadrirèmes, et y monte lui-même pour aller secourir Rectine et beaucoup d'autres personnes qui avaient fixé leur habitation sur cette côte riante. Il se rend à la hâte vers des lieux d'où tout le monde enfuyait, il va droit au danger, la main au gouvernail, l'esprit tellement libre de crainte, qu'il décrivait et notait tous les mouvements, toutes les formes que le nuage ardent présentait à ses yeux.
Déjà sur ses vaisseaux volait une cendre plus épaisse et plus chaude, à mesure qu'ils approchaient ; déjà tombaient autour d'eux des éclats de rochers, des pierres noires, brûlées et calcinées par le feu ; déjà la mer, abaissée tout à coup, n'avait plus de profondeur, et les éruptions du volcan obstruaient le rivage. Mon oncle songea un instant à retourner mais il dit bientôt au pilote qui l'y engageait : La fortune favorise le courage. Menez-nous chez Pomponianus. Pomponianus était à Stabie, de l'autre côté d'un petit golfe, formé par la courbure insensible du rivage. Là, à la vue du péril qui était encore éloigné, mais imminent, car il s'approchait par degrés, Pomponianus avait transporté tous ses effets sur des vaisseaux, et n'attendait, pour s'éloigner, qu'un vent moins contraire. Mon oncle, favorisé par ce même vent, aborde chez lui, l'embrasse, calme son agitation, le rassure, l'encourage et, pour dissiper, par sa sécurité, la crainte de son ami, il se fait porter au bain. Après le bain, il se met à table, et mange avec gaieté, ou, ce qui ne suppose pas moins d'énergie, avec les apparences de la gaieté.
Cependant, de plusieurs endroits du mont Vésuve, on voyait briller de larges flammes et un vaste embrasement, dont les ténèbres augmentaient l'éclat. Pour calmer la frayeur de ses hôtes, mon oncle leur disait que c'étaient des maisons de campagne abandonnées au feu par les paysans effrayés. Ensuite, il se livra au repos, et dormit réellement d'un profond sommeil, car on entendait de la porte le bruit de sa respiration que sa corpulence rendait forte et retentissante. Cependant la cour par où l'on entrait dans son appartement commençait à s'encombrer tellement de cendres et de pierres, que, s'il y fût resté plus longtemps, il lui eût été impossible de sortir. On l'éveille. Il sort, et va rejoindre Pomponianus et les autres qui avaient veillé. Ils tiennent conseil, et délibèrent s'ils se renfermeront dans la maison, ou s'ils erreront dans la campagne : car les maisons étaient tellement ébranlées par les effroyables tremblements de terre qui se succédaient, qu'elles semblaient arrachées de leurs fondements, poussées dans tous les sens, puis ramenées à leur place. D'un autre côté, on avait à craindre, hors de la ville, la chute des pierres, quoiqu'elles fussent légères et minées par le feu. De ces périls, on choisit le dernier. Chez mon oncle, la raison la plus forte prévalut sur la plus faible, chez ceux qui l'entouraient, une crainte l'emporta sur une autre. Ils attachent donc avec des toiles des oreillers sur leurs têtes : c'était une sorte d'abri contre les pierres qui tombaient.
Le jour recommençait ailleurs mais autour d'eux régnait toujours la nuit la plus sombre et la plus épaisse, sillonnée cependant par des lueurs et des feux de toute espèce. On voulut s'approcher du rivage pour examiner si la mer permettait quelque tentative mais on la trouva toujours orageuse et contraire. Là mon oncle se coucha sur un drap étendu, demanda de l'eau froide, et en but deux fois. Bientôt des flammes et une odeur de soufre qui en annonçait l'approche, mirent tout le monde en fuite, et forcèrent mon oncle à se lever. Il se lève appuyé sur deux jeunes esclaves, et au même instant il tombe mort. J'imagine que cette épaisse vapeur arrêta sa respiration et le suffoqua. Il avait naturellement la poitrine faible, étroite et souvent haletante. Lorsque la lumière reparut (trois jours après le dernier qui avait lui pour mon oncle), on retrouva son corps entier, sans blessure. Rien n'était changé dans l'état de son vêtement, et son attitude était celle du sommeil plutôt que de la mort.

Pendant ce temps, ma mère et moi nous étions à Misène. Mais cela n'intéresse plus l'histoire, et vous n'avez voulu savoir que ce qui concerne la mort de mon oncle. Je finis donc, et je n'ajoute plus qu'un mot : c'est que je ne vous ai rien dit, que je n'aie vu ou que je n'aie appris dans ces moments où la vérité des événements n'a pu encore être altérée. C'est à vous de choisir ce que vous jugerez le plus important. Il est bien différent d'écrire une lettre ou une histoire d'écrire pour un ami, ou pour le public. Adieu.
XVII— Pline à Restitutus.
Il faut absolument que j'exhale dans une lettre la petite indignation qui vient de me saisir chez un de nos amis, puisque je suis privé du plaisir de vous l'exprimer de vive voix. On lisait un ouvrage excellent. Deux ou trois auditeurs, hommes de talent, si l'on s'en rapporte à eux et à quelques-uns de leurs amis, écoutaient comme des sourds muets. Pas un mouvement de lèvres, pas un geste ; ils ne se levèrent pas même une fois au moins par fatigue d'être assis. Est-ce gravité? est-ce sévérité de goût? ou n'est-ce point plutôt paresse et orgueil? Quel travers ! que dis-je? Quelle folie d'employer une journée entière à blesser un homme, à s'en faire un ennemi, lorsqu'on n'est venu chez lui qu'en témoignage d'intime amitié ! Votre supériorité doit vous rendre d'autant moins jaloux : car la jalousie est un aveu d'infériorité. Que vous ayez plus de mérite, que vous en ayez moins, que vous en ayez autant, louez ou votre inférieur, ou votre maître, ou votre égal : votre maître, parce que, s'il ne mérite point d'éloges, vous n'en sauriez mériter vous-même ; votre inférieur ou votre égal, parce que votre gloire est intéressée à élever celui qui marche au dessous ou à côté de vous. Pour moi, je respecte et j'admire tous ceux qui tentent de se distinguer dans les lettres. C'est une carrière qui offre des difficultés, des peines, des dégoûts, et qui dédaigne ceux qui la méprisent. Peut-être penserez-vous différemment ; et cependant qui révère plus que vous la littérature? qui est plus indulgent pour les ouvrages d'autrui? C'est pour cela que je vous ai fait part de mon indignation, certain qu'aucun autre ne pouvait mieux la partager. Adieu.
XVIII. — Pline à Sabinus.
Vous me priez de plaider la cause des Firmiens. Je le ferai, quoique je sois surchargé d'affaires. J'ai un désir trop vif d'attacher à ma clientèle cette illustre colonie, et de vous rendre un service qui vous soit agréable. Est-ce à vous que je refuserais quelque chose, à vous qui daignez publier que vous avez recher ché dans mon amitié un honneur et un appui tout ensemble? D'ailleurs c'est pour votre patrie que vous sollicitez. Or, qu'y a-t-il de plus puissant que la prière d'un ami, et de plus glorieux que celle d'un bon citoyen? Vous pouvez donc m'engager à vos Firmiens, ou plutôt aux nôtres. Quand la considération dont jouit leur ville ne mériterait pas seul mon dévouement et mes soins, je ne pourrais me défendre d'une haute estime pour un pays qui a produit un homme aussi estimable que vous. Adieu.
XIX. - Pline à Népos.
Savez-vous que les terres ont augmentée prix, particulièrement aux environs de Rome? La cause de cette augmentation subite est un désordre dont on a souvent parlé, et qui, dans les derniers comices, avait provoqué une généreuse décision du sénat. Cette décision défendait, aux candidats de donner des repas, d'envoyer des présents et de consigner de l'argent. De ces abus, les deux premiers dégénéraient en scandale public, l'autre, quoique secret, n'était pas moins notoire. Homullus, notre ami, eut soin de profiter de cette disposition du sénat. Quand son tour d'opiner fut venu, il pria les consuls de vouloir bien faire connaître à l'empereur le vœu général, et lui demander de comprendre dans les désordres sagement arrêtés, la répression de ce nouvel abus. L'abus a été réprimé. Une loi contre la brigue a proscrit les dépenses des candidats, ces dépenses infâmes qui les déshonoraient. Elle les oblige en même temps à placer le tiers de leur bien en fonds de terre. Le prince était justement indigné que, tout en aspirant aux charges de l'État, on regardât Rome et l'Italie, non comme sa patrie, mais comme une hôtellerie, comme un séjour étranger qu'on habite en passant. De là grand mouvement parmi les candidats. Tout ce qui est à vendre, ils l'achètent et leur em pressement inspire à d'autres l'envie de vendre. Ainsi, êtes-vous dégoûté de vos terres d'Italie, saisissez cette double occasion de vous en défaire, et d'en acquérir de nouvelles dans les provinces de l'empire où nos magistrats futurs s'empressent de vendre pour acheter ici. Adieu.
XX. — Pline à Tacite.
La lettre où je vous ai donné les détails que vous me demandiez sur la mort de mon oncle, vous a inspiré, me dites-vous, le désir de connaître les alarmes et les dangers même auxquels je fus exposé à Misène ou j'étais reste car c'est là que j'avais interrompu mon récit.
Quoique ce souvenir me saisisse d'horreur,
J'obéirai ......................
Après le départ de mon oncle, je continuai l'étude qui m'avait empêché de le suivre. Vint ensuite le bain, le repas ; je dormis quelques instante d'un sommeil agité. Depuis plusieurs jours, un tremblement de terre s'était fait sentir. Il nous avait peu effrayés, parce qu'on y est habitué en Campanie. Mais il redoubla cette nuit avec tant de violence, qu'on eût dit, non seulement une secousse, mais un bouleversement général. Ma mère se précipita dans ma chambre. Je me levais pour aller l'éveiller, si elle eût été endormie. Nous nous assîmes dans la cour qui ne forme qu'une étroite séparation entre la maison et la mer. Comme je n'avais que dix-huit ans, je ne sais si je dois appeler fermeté ou imprudence ce que je fis alors. Je demandai un Tite-Live. Je me mis à le lire, comme dans le plus grand calme, et je continuai à en faire des extraite. Un ami de mon oncle, récemment arrivé d'Espagne pour le voir, nous trouva assis, ma mère et moi. Je lisais. Il nous reprocha, à ma mère son sang-froid, et à moi ma confiance. Je n'en continuai pas moins attentivement ma lecture.
Nous étions à la première heure du jour, et cependant on ne voyait encore qu'une lumière faible et douteuse. Les maisons, autour de nous, étaient si fortement ébranlées, qu'elles étaient menacées d'une chute infaillible dans un lieu si étroit, quoiqu'il fut découvert. Nous prenons enfin le parti de quitter la ville. Le peuple épouvanté s'enfuit avec nous et comme, dans la peur, on met souvent sa prudence à préférer les idées d'autrui aux siennes, une foule immense nous suit, nous presse et nous pousse. Dès que nous sommes hors de la ville, nous nous arrêtons et là, nouveaux phénomènes, nouvelles frayeurs. Les voitures que nous avions emmenées avec nous, étaient, quoiqu'en pleine campagne, entraînées dans tous les sens, et l'on ne pouvait, même avec des pierres, les maintenir à leur place. La mer semblait refoulée sur elle même, et comme chassée du rivage par l'ébranlement de la terre. Ce qu'il y a de certain, c'est que le rivage était agrandi, et que beaucoup de poissons étaient restés à sec sur le sable. De l'autre côté, une nuée noire et horrible, déchirée par des tourbillons de feu, laissait, échapper de ses flancs entr'ouverts de longues traînées de flammes, semblables à d'énormes éclairs.
Alors l'ami dont j'ai parlé revint plus vivement encore à la charge. Si votre frère, si votre oncle est vivant, nous dit-il, il veut sans doute que vous vous sauviez et, s'il est mort, il a voulu que vous lui surviviez. Qu'attendez-vous donc pour partir? Nous lui répondîmes que nous ne pourrions songer à notre sûreté, tant que nous serions incertains de son sort. A ces mots, il s'élance, et cherche son salut dans une fuite précipitée. Presque aussitôt après la nue s'abaisse sur la terre et couvre les flots. Elle dérobait à nos yeux l'île de Caprée, qu'elle enveloppait, et nous cachait la vue du promontoire de Misène. Ma mère me conjure, me presse, m'ordonne de me sauver, de quelque manière que ce soit. Elle me dit que la fuite est facile à mon âge ; que pour elle, affaiblie et appesantie par les années, elle mourrait contente, si elle n'était pas cause de ma mort. Je lui déclare qu'il n'y a de salut pour moi qu'avec elle. Je lui prends la main, je la force à doubler le pas. Elle m'obéit à regret, et s'accuse de ralentir ma marche. La cendre commençait à tomber sur nous, quoiqu'en petite quantité. Je tourne la tête, et j'aperçois derrière nous une épaisse fumée qui nous suivait en se répandant sur la terre comme un torrent. P endant que nous voyons encore, quittons le grand chemin, dis-je à ma mère, de peur d'être écrasés dans les ténèbres par la foule qui se presse sur nos pas. A peine nous étions-nous arrêtés, que les ténèbres s'épaissirent encore. Ce n'était pas seulement une nuit sombre et chargée de nuages, mais l'Obscurité d'une chambre où toutes les lumières seraient éteintes. On n'entendait que les gémissements des femmes, les plaintes des enfants, les cris des hommes. L'un appelait son père, l'autre son fils, l'autre sa femme, ils ne se reconnaissaient qu'à la voix. Celui-ci s'alarmait pour lui- même, celui-là pour les siens. On en vit à qui la crainte de la mort faisait invoquer la mort même. Ici on levait les mains au ciel ; là on se persuadait qu'il n'y avait plus de dieux, et que cette nuit était la dernière, l'éternelle nuit qui devait ensevelir le monde. Plusieurs ajoutaient aux dangers réels des craintes imaginaires et chimériques. Quelques-uns disaient qu'à Misène tel édifice s'était écroulé, que tel autre était en feu : bruits mensongers qui étaient accueillis comme des vérités.
Il parut une lueur qui nous annonçait, non le retour de la lumière, mais l'approche du feu qui nous menaçait. Il s'arrêta pourtant loin de nous. L'obscurité revint. La pluie de cendres recommença plus forte et plus épaisse. Nous nous levions de temps en temps pour secouer cette masse qui nous eût engloutis et étouffés sous son poids. Je pourrais me vanter qu'au milieu de si affreux dangers, il ne m'échappa ni une plainte ni une parole qui annonçât de la faiblesse mais j'étais soutenu par cette pensée déplorable et consolante à la fois, que tout l'univers périssait avec moi. Enfin cette noire vapeur se dissipa, comme une fumée ou comme un nuage. Bientôt après nous revîmes le jour et même le soleil, mais aussi blafard qu'il apparaît dans une éclipse. Tout se montrait changé à nos yeux troublés encore. Des monceaux de cendres couvraient tous les objets, comme d'un manteau de neige. Nous retournâmes à Misène. Chacun s'y rétablit de son mieux, et nous y passâmes une nuit entre la crainte et espérance. Mais la crainte l'emportait toujours, car le tremblement de terre continuait. La plupart, égarés par de terribles prédictions aggravaient leurs infortunes et celles d'autrui. Cependant, malgré nos périls passés et nos périls futurs, il ne nous vint pas la pensée de nous éloigner avant d'avoir appris des nouvelles de mon oncle. Vous lirez ces détails mais vous ne les ferez point entrer dans votre ouvrage. Ils ne sont nullement dignes de l'histoire et, si vous ne les trouvez pas même convenables dans une lettre, ne vous en prenez qu'à vous seul qui les avez exigés. Adieu.
XXI. — Pline à Caninius.
Je suis du nombre de ceux qui admirent les anciens, mais sans dédaigner, comme certains esprits, les génies de notre siècle. Je ne puis croire que la nature soit épuisée de fatigue et ne produise plus rien de bon. Je suis donc allé dernièrement entendre Virginius Romanus. Il lisait à un petit nombre d'amis une comédie composée sur le modèle de la comédie ancienne. L'ouvrage est si remarquable, qu'il pourra quelque jour servir lui-même de modèle. Je ne sais si vous connaissez Romanus, quoique vous deviez le connaître. C'est un homme distingué par sa probité, par l'élégance de son esprit et par la variété de ses ouvrages. Il a composé des mimïambes pleins de légèreté, de finesse, de grâce et fort éloquemment écrits dans leur genre : car il n'est point de genre où l'éloquence n'ait sa place, lorsqu'on y excelle. Il a fait des comédies dans le goût, de Ménandre et des autres poêles de cette époque. Vous pourrez marquer leur rang entre celles de Plante et de Térence. C'est la première fois qu'il s'est essayé dans la comédie ancienne, quoique ces nouvelles productions ne ressemblent pas à des essais. Force, grandeur, délicatesse, sel, douceur, grâce, rien ne lui manque. Il flétrit le vice et donne de l'attrait à la vertu. Ses allusions sont pleines de goût et, s'il nomme ses personnages, c'est avec convenance. Je n'ai à lui reprocher qu'un excès de prévention pour moi. Mais, après tout, le mensonge est permis aux poètes. Enfin je tâcherai de lui escamoter sa pièce, et je vous l'enverrai pour la lire, ou plutôt pour l'apprendre par cœur : car je suis sûr que, une fois que vous l'aurez entre vos mains, vous ne pourrez plus la quitter. Adieu.
XXII. - Pline à Tiron.
Il vient de se passer une chose qui intéresse grandement ceux qui sont destinés au gouvernement, des provinces et ceux qui se livrent aveuglément, à leurs amis. Lustricus Bruttianus, ayant découvert plusieurs crimes de Montanus Atticinus, son lieutenant, en informa l'empereur. Atticinus renchérit sur ses désordres pour accuser celui qu'il avait trompé. Le procès a été instruit. J'étais du nombre des juges. L'un et l'autre ont plaidé leur cause, mais brièvement, et en se bornant, à exposer les chefs et les arguments principaux : c'est le moyen le plus court de connaître la vérité. Bruttianus représenta son testament qu'il disait écrit de la main d'Atticinus. Rien ne pouvait mieux prouver la secrète liaison qui les unissait, et la nécessité qui forçait Bruttianus à se plaindre d'un homme qu'il avait tant aimé. Tous les chefs d'accusation parurent à la fois révoltants et d'une évidence manifeste. Atticinus, ne pouvant se justifier, récrimina contre Bruttianus. Sa défense révéla son opprobre, et ses accusations trahirent sa scélératesse. Après avoir corrompu l'esclave du secrétaire de Bruttianus, il avait surpris et altéré les registres, et poussé la lâcheté jusqu'à tourner contre son ami le crime qu'il avait commis lui-même. La conduite de l'empereur fut admirable. Sans daigner rien prononcer pour absoudre Bruttianus, il passa aussitôt à Atticinus, le condamna et le relégua dans une île. On a rendu un éclatant témoignage de l'intégrité de Bruttianus. Sa fermeté même lui a fait honneur : car, après s'être justifié en très peu de mots, il a vivement soutenu l'accusation qu'il avait intentée, et il a montré autant de vigueur que déloyauté et de franchise.
Je vous écris tout ceci pour vous avertir que, dans le gouvernement où vous êtes appelé, vous devez compter sur vous-même plus que sur tout autre et en même temps pour vous apprendre que, si l'on venait à vous tromper (ce qu'aux dieux ne plaise!), vous avez ici une vengeance toute prête. Mais prenez bien garde de n'en pas avoir besoin car il est moins doux d'être vengé, que pénible d'être trompé. Adieu.
XXIII. - Pline à Triarius.
Vous me priez avec instance de me charger d'une cause à laquelle vous prenez un grand intérêt, et qui d'ailleurs a de l'importance et de l'éclat. Je m'en chargerai mais il vous en coûtera quelque chose. Quoi! direz-vous, se peut-il que Pline.... Oui, cela se peut car le salaire que j'exige me fera plus d'honneur qu'une plaidoirie gratuite. Voici donc mon marché. Crémutius Ruson plaidera avec moi. J'ai coutume d'en user ainsi, et c'est un bon office que j'ai déjà rendu à plusieurs jeunes gens de grande famille. J'ai un désir extrême d'introduire au barreau les jeunes orateurs, et de les signaler à la renommée. Mon cher Ruson, plus que personne, avait droit à ce service : je le dois à sa naissance, je le dois à la noble affection qu'il me porte. Je m'estime heureux de le faire paraître dans les mêmes causes et plaider pour les mêmes parties que moi. Hâtez-vous de m'obliger avant qu'il plaide ; car, dès qu'il aura plaidé, vous me remercierez. Je vous garantis qu'il répondra parfaitement à vos désirs, à ma confiance et à la grandeur de la cause. Il a les plus rares dispositions, et, dès que je l'aurai produit, il sera bientôt lui-même en état de produire les autres. Car, malgré toute la supériorité du génie d'un homme, il ne faut pas .'attendre qu'il puisse percer, si le sujet, si l'occasion lui manque, ou même un protecteur et un patron. Adieu.

XXIV. - Pline à Macer.
Combien la différence des personnes n'en met-elle pas dans le jugement qu'on porte de leur conduite! Les mêmes actions sont élevées jusqu'aux nues ou ravalées, suivant le nom illustre ou obscur de leurs auteurs. Je me promenais dernièrement sur le lac de Côme avec un vieillard de mes amis. Il me montra une villa, et même une chambre qui s'avance sur le lac. C'est de là, me dit-il, qu'un jour une femme de notre pays s'est précipitée avec son mari. J'en demandai la raison. Depuis longtemps le mari était rongé d'un ulcère aux parties secrètes du corps. Sa femme le pria de permettre qu'elle examinât son mal, et l'assura que personne ne lui dirait plus sincèrement qu'elle s'il pouvait guérir. Elle ne l'eut pas plutôt vu, qu'elle en désespéra. Elle l'exhorta à se donner la mort, l'accompagna pour cet objet, lui montra le chemin, lui donna l'exemple, et le mit dans la nécessité de l'imiter, après s'être attachée avec lui, elle se jeta dans le lac. Ce fait m'est connu que depuis peu de temps, quoique je sois de la ille. Et cependant est-il moins digne de mémoire que le dévouement tant vanté d'Arria? Non, mais Arria avait un nom plus lustre. Adieu.
XXV. — Pline à Hispanus.
Vous me mandez que Robustus, illustre chevalier romain, a fait route avec Attilius Scaurus, mon ami, jusqu'à Otricoli, et que, depuis, on ne l'a plus revu. Vous me priez de faire venir Scaurus, jour nous aider, s'il est possible, à retrouver les traces de son compagnon de voyage. Il viendra mais je crains que ce ne soit inutilement. J'appréhende que Robustus n'ait eu le même sort que Métilius Crispus, mon compatriote. Je lui avais obtenu de l'emploi dans l'armée ; je lui avais même donné à son départ quarante mille sesterces pour se monter et s'équiper ; et je n'ai reçu depuis ni lettre de lui, ni nouvelles de sa mort. On ne sait s'il a été tué par ses gens, ou avec eux. Ce qui est certain, c'est que ni lui ni aucun d'eux n'a reparu. Plaise au ciel qu'il n'en soit pas ainsi de Robustus! Cependant prions Scaurus de venir : c'est le moins qu'on puisse accorder à vos instances, aux généreuses prières d'un fils, dont l'ardeur à rechercher son père est à la fois si tendre et si généreuse. Puissent les dieux le lui faire retrouver, comme il a retrouvé déjà celui qui l'accompagnait! Adieu.
XXVI. — Pline à Servien.
Je suis ravi que vous destiniez votre fille à Fuscus Salinator, et je vous en félicite. Sa famille est patricienne, son père est un homme des plus honorables, et sa mère n'a pas moins de droits à l'estime. Pour lui, il chérit l'étude, il est instruit dans les lettres il est même éloquent. Il a la simplicité d'un enfant, l'enjouement d'un jeune homme, la sagesse d'un vieillard et ma tendresse pour lui ne m'abuse point. Je l'aime infiniment, sans doute, et il s'en est rendu digne par son dévouement, par son respect. Mais mon amitié ne me rend point aveugle : je le juge d'autant plus sévèrement, que je l'aime davantage. J'ai appris à le connaître à fond, et je vous réponds que vous aurez en lui le meilleur gendre que vous puissiez même espérer. Il ne lui reste plus qu'à vous rendre bientôt grand-père de petits-enfants qui lui ressemblent. Qu'il sera doux pour moi, le temps où je pourrai prendre entre vos bras ses enfants et vos petits-enfants, pour les tenir dans les miens avec la même tendresse que s'ils étaient à moi! Adieu.
XXVII. - Pline à Sévèrus.
Vous me priez d'examiner quels honneurs vous pourriez décerner à l'empereur, lorsque vous aurez pris possession du consulat. Il est aussi aisé de trouver que difficile de choisir, car ses vertus fournissent une ample matière. Je vous écrirai pourtant ce que je pense, ou plutôt je vous le dirai de vive voix, après vous avoir exposé d'abord mon incertitude. Je ne sais si le parti que j'ai pris moi-même est celui que je dois vous conseiller. Désigné consul, je supprimai un éloge, qui sans doute n'était pas une flaterie, mais qui en avait l'apparence. En cela, je n'affectais ni liberté ni hardiesse mais je connaissais le prince, et je savais que la louange la plus digne de lui, c'était de ne lui en accorder aucune par nécessité. Je me souvenais que l'on avait prodigué les honneurs aux plus méchants princes, et qu'on ne pouvait mieux distinguer notre excellent empereur qu'en ne le traitant pas comme eux. J'énonçais ouvertement et à haute voix ma pensée, de peur que mon silence ne passât, pour oubli. Voilà ce que je crus devoir faire alors. Mais les mêmes choses ne plaisent pas et ne conviennent pas à tout le monde. D'ailleurs les motifs qui déterminent nos actions changent avec les hommes, les événements, les circonstances et l'on ne peut nier que les derniers exploits de notre grand prince n'offrent une juste occasion de lui déférer des distinctions nouvelles, des honneurs éclatants. J'en reviens donc à ce que je disais d'abord. J'ignore si je dois vous conseiller de faire ce que j'ai fait mais je sais bien que, pour vous guider dans votre conduite, j'ai dû vous rappeler celle que j'ai tenue moi-même.
XXVIII. — Pline à Pontius.
Je sais les raisons qui vous ont empêché d'arriver avant moi dans la Campanie. Mais , malgré votre absence, je vous y ai trouvé tout entier : tant on m'a prodigué en votre nom les provisions de la ville et de la campagne! Moi, en homme avide, j'ai tout pris. Vos gens me pressaient avec instance, et je craignais d'ailleurs en refusant, de vous irriter contre moi et contre eux. Une autre fois, mettez des bornes à votre profusion, ou j'en mettrai moi-même. J'ai d'avance averti vos domestiques que, s'ils m'apportaient encore tant de choses, ils remporteraient tout. Vous me direz que je dois user de votre bien, comme s'il était à moi. D'accord mais je l'épargnerai comme le mien. Adieu.
XXIX. — Pline à Quadratus.
Avidius Quiétus, qui avait pour moi la plus tendre amitié, et qui m'honorait d'une estime dont le souvenir ne m'est pas moins cher, me parlait souvent de Thraséas avec lequel il avait été intimement lié. Entre autres choses, il rappelait que ce grand homme prescrivait à l'orateur de se charger de trois sortes de causes, de celles de ses amis, des causes abandonnées, et de celles qui intéressent l'exemple. De celles de ses amis : cela n'a pas besoin d'explication, des causes abandonnées, parce que c'est là que se montrent surtout et la grandeur d'âme et la générosité d'un avocat ; des causes qui intéressent l'exemple, parce qu'il n'est pas indifférent que l'exemple donné soit bon ou mauvais. A ces trois genres de causes j'ajouterai, par orgueil peut-être, celles qui ont de l'éclat : car il est juste de plaider quelquefois pour sa réputation, pour sa gloire, c'est à dire de plaider sa propre cause. Voilà, puisque vous me demandez mon avis, quelles règles j'assigne à votre dignité et à votre délicatesse. Je sais que l'usage passe pour le meilleur maître d'éloquence et qu'il l'est en effet. Je vois même beaucoup de gens médiocres, illettrés, parvenir à bien plaider en plaidant souvent. Mais pour moi, j'éprouve la vérité de ce que disait Pollion, ou de ce qu'on lui a fait dire : « Bien plaider m'a fait plaider souvent, plaider souvent m'a fait plaider moins bien. » C'est qu'en effet l'habitude donne plus de facilité que de talent. Au lieu de confiance, c'est de la présomption qu'elle inspire. Isocrate, avec sa faible voix et sa timidité naturelle, n'a pu parler en public. En a-t-il moins passé pour un grand orateur? Lisez donc, écrivez, méditez, pour être en état de parler quand vous le voudrez, et vous parlerez quand il vous conviendra de le vouloir. Voilà la règle que j'ai presque toujours suivie. J'ai quelquefois obéi à la nécessité qui tient elle-même sa place entre les meilleures raisons. J'ai plaidé des causes par ordre du sénat. C'étaient de celles que Thraseas a comprises dans sa troisième classe, et qui étaient importantes pour l'exemple. J'ai soutenu les peuples de la Bétique contre Bébius Massa. Il s'agissait de savoir si on leur permettrait d'informer. La permission leur en fut donnée. J'ai prêté mon ministère aux mêmes peuples dans l'accusation qu'ils ont intentée contre Cécilius Classicus. Il était question d'examiner si les officiers de la province devaient être punis comme complices et ministres du proconsul. Ils l'ont été. J'ai accusé Marius Priscus. Condamné pour péculat, il se retranchait derrière une loi trop douce, et dont la sévérité était loin d'égaler l'énormité de ses crimes. Il a été exilé. J'ai défendu Julius Bassus. Je fis voir qu'il avait été plus imprudent et malavisé que coupable. On lui a donné des juges, et il a conservé sa place au sénat. Enfin j'ai plaidé dernièrement pour Varénus qui demandait à produire aussi des témoins. Il l'a obtenu. Puisse-t-on toujours ainsi ne réordonner de plaider que des causes dont je pourrais avec honneur me charger volontairement ! Adieu.
XXX. — Pline à Fabatus.
Oui, nous devons célébrer l'anniversaire de votre naissance comme la nôtre, puisque tout le bonheur de nos jours dépend des vôtres, et que, grâce à votre zèle et à vos soins, nous vous sommes redevables de notre joie à Rome et de notre sûreté à Côme, Votre villa de Campanie, ancien domaine de Camillius, a été maltraitée par le temps. Cependant les parties du bâtiment qui ont le plus de prix sont encore entières ou fort peu endommagées. Nous songeons donc à le faire parfaitement rétablir. Je crois avoir beaucoup d'amis mais de l'espèce dont vous les cherchez, et tels que l'affaire présente les demande, je n'en ai presque pas un seul. Ce sont tous gens de robe, que leurs emplois attachent à la ville, tandis que l'inspection des terres veut un robuste campagnard qui ne trouve ni la fatigue pénible, ni l'emploi vil, ni la solitude ennuyeuse. Vous avez bien raison de songer à Rufus, puisqu'il a été l'ami de votre fils. J'ignore cependant quels services il pourra nous rendre en cette occasion. Je crois seulement qu'il a le plus vif désir de nous être utile. Adieu.
XXXI. — Pline à Cornélien.
L'empereur a daigné m'appeler au conseil qu'il a tenu en son palais, nommé palais des Cent Chambres. Rien ne peut se comparer au plaisir que j'y ai goûté. Quel bonheur de voir la justice, la sagesse, l'affabilité du prince, surtout dans le secret où ces vertus se révèlent davantage ! On a jugé différents procès, propres à exercer de plus d'une manière la capacité du juge. Claudius Ariston, le plus éminent citoyen d'Éphèse, y a été entendu. C'est un homme bienfaisant, et qui, par sa popularité sans intrigue, s'est attiré l'envie. Suscité par des gens qui ne lui ressemblent guère, un délateur est venu l'accuser. Ariston a été absous et vengé. Le jour suivant, on a jugé Galitta, accusée d'adultère. Mariée à un tribun des soldats qui allait bientôt solliciter les charges publiques, elle avait déshonoré le rang de son mari et le sien par ses relations intimes avec un centurion. Le mari en avait écrit au lieutenant consulaire, et celui-ci au prince. L'empereur, après avoir pesé toutes les preuves, cassa le centurion, et l'exila. Il restait encore à punir la moitié du crime qui, de sa nature, est nécessairement le crime de deux. Mais l'amour retenait le mari dont la faiblesse fut blâmée. Car, même après avoir accusé sa femme d'adultère, il l'avait gardée chez lui, comme si c'était assez pour lui que son rival fût éloigné. On l'avertit qu'il devait achever ses poursuites : il ne les acheva qu'à regret. Mais, malgré l'accusateur, il fallait condamner l'accusée. Aussi fut-elle condamnée et abandonnée aux peines portées par la loi Julia. L'empereur, dans la sentence qu'il prononça, eut soin de nommer le centurion, et de rappeler qu'il agissait dans l'intérêt de la discipline militaire, pour ne pas paraître évoquer à son tribunal toutes les causes d'adultère.
Le troisième jour, on traita une affaire qui avait occupé et partagé les esprits. On informa relativement aux codicilles de Julius Tiron, dont une partie était reconnue vraie, et dont l'autre, disait-on, était fausse. Sempronius Sénécion, chevalier romain, et Eurythmus, affranchi de l'empereur, et l'un de ses agents, étaient accusés. Les héritiers, par une lettre écrite en commun, avaient supplié le prince, pendant son expédition contre les Daces, de vouloir bien se réserver la connaissance de cette affaire. Il se l'était réservée. De retour à Rome, il leur avait donné jour pour les entendre. Quelques-uns des héritiers ayant voulu, comme par respect, pour Eurythmus, se désister de l'accusation, l'empereur dit cette belle parole : II n'est point Polyclête, et je ne suis pas Néron. Il avait pourtant accordé un délai aux accusateurs, après lequel il voulut prononcer. Il ne parut que deux héritiers, qui se bornèrent à demander que, tous ayant intenté l'accusation, tous fussent, obligés de la soutenir, ou qu'il leur fût permis à eux-mêmes, comme aux autres, de l'abandonner. L'empereur parla avec autant de modération que de noblesse et l'avocat de Sénécion et d'Eurythmus ayant dit que l'on ne pouvait refuser d'entendre les accusés, sans les livrer à toute la malignité des soupçons : Ce qui m'inquiète, dit-il, ce n'est pas qu'ils y soient livrés, c'est de m'y voir livré moi-même. Après cela, se tournant vers nous : Voyez, dit-il, ce que nous avons à faire car ces gens-là veulent qu'on examine s'ils ont eu le droit de ne pas accuser. Alors, de l'avis du conseil, il prononça, ou que tous les héritiers seraient tenus de poursuivre l'accusation, ou que chacun d'eux produirait les motifs de son désistement sinon qu'ils seraient condamnés eux-mêmes comme calomniateurs.
Vous voyez quelles occupations nobles et austères remplissaient ces jours qui s'achevaient dans les délassements les plus agréables. L'empereur nous admettait toujours à sa table, très frugale pour un si grand prince. Quelquefois il faisait jouer des scènes fort piquantes, d'autres fois la conversation se prolongeait avec charme dans la nuit. Le dernier jour, avant notre départ, il prit soin (tant sa bonté est attentive!) de nous envoyer à chacun des présents. Autant j'étais ravi de la dignité qui règne dans ces jugements, de l'honneur d'y être consulté, de la douce et simple affabilité du prince, autant j'étais enchanté de la beauté même du lieu, Représentez-vous une magnifique villa, environnée de vertes campagnes, et dominant le rivage où un port se construit en ce moment. De solides ouvrages en fortifient la partie gauche, on travaille à l'autre côté. Devant le port s'élève une île, destinée à rompre les Ilots que les vents y poussent avec violence, et qui protège des deux côtés le passage des vaisseaux. Elle est formée avec un art digne d'attirer l'attention. D'énormes pierres y sont apportées sur un large navire. Jetées sans cesse l'une sur l'autre, elles demeurent fixées par leur propre poids, et s'amoncellent peu à peu en forme de digue. Déjà apparaît et se dresse la cime du rocher qui brise et lance au loin dans les airs les flots dont il est assailli. La mer s'agite avec fracas, blanchissante d'écume. On lie cette masse de pierres par des constructions faites pour donner un jour à cet ouvrage l'apparence d'une île naturelle. Ce port s'appellera du nom de celui qui l'a construit, et il sera fort commode car c'est une retraite sur une côte qui s'étend fort loin, et qui n'en offrait aucune. Adieu.
XXXII. - Pline à Quintilien.
Quoique vous soyez d'une modération extrême, et que vous ayez donné à votre fille l'éducation qui convenait à la fille de Quintilien et à la petite-fille de Tutilius, cependant, comme elle doit épouser Nonius Celer, homme des plus distingués et auquel ses fonctions publiques imposent une certaine représentation, il faut qu'elle règle sa toilette et son train sur le rang de son mari. Ces accessoires extérieurs n'ajoutent pas au mérite, mais ils le font valoir. Or je sais que, si vous êtes riche des biens de l'âme, vous l'êtes peu de ceux de la fortune. Je prends donc sur moi une partie de vos obligations et, comme un second père, je donne à notre chère fille cinquante mille sesterces. Je ne me bornerais pas là, si je n'étais persuadé que la médiocrité du présent pourra seule déterminer votre délicatesse à l'accepter. Adieu.

XXXIII. — Pline à Romanus.
Suspendez, leur dit-il, vos travaux commencés.
Et vous aussi, soit que vous écriviez, soit que vous lisiez, abandonnez, quittez tout pour prendre mon divin plaidoyer, comme les ouvriers de Vulcain pour forger les armes d'Énée. Pouvais-je plus fièrement débuter? Aussi s'agit-il du meilleur de mes plaidoyers : car c'est bien assez pour moi de lutter avec moi-même. Je l'ai composé pour Accia Variola. Le rang de la personne, la singularité de la cause, la solennité du jugement lui donnent de l'intérêt. Cette femme, d'une naissance illustre, mariée à un homme qui avait été préteur, s'était vue déshéritée par un père octogénaire, onze jours après qu'entraîné par une folle passion il avait donné une belle-mère à sa fille. Elle revendiquait sa succession devant, les quatre tribunaux des centumvirs réunis. Cent quatre-vingts juges siégeaient dans cette affaire : c'est tout ce qu'en ren ferment les quatre tribunaux. De part et d'autre, les avocats remplissaient en grand nombre les sièges qui leur avaient été destinés. La foule des auditeurs environnait de cercles redoublés la vaste enceinte du tribunal. On se pressait même autour des juges, et les galeries hautes de la basilique étaient encombrées, les unes de femmes, les autres d'hommes, avides d'entendre, ce qui n'était pas facile, et de voir, ce qui était fort aisé. Grande était l'attente des pères, des filles, et même des belles-mères. Les avis se partagèrent : deux tribunaux furent pour nous, et les deux autres contre. C'est chose remarquable et surprenante qu'une même cause, plaidée par les mêmes avocats, entendue par les mêmes juges, ait été dans le même temps si diversement jugée, ce semble par un effet du hasard, mais sans qu'il parût s'en être mêlé. Enfin la belle-mère a perdu son procès. Elle était instituée héritière pour un sixième. Subérinus n'a pas eu plus de succès, lui qui, après avoir, été déshérité par son père, sans avoir jamais osé se plaindre, avait l'impudence de venir demander la succession du père d'un autre. Je vous ai donné ces détails, d'abord pour que ma lettre vous apprît ce que mon plaidoyer ne pouvait vous apprendre et puis, je vous avouerai mon artifice, pour vous mettre en état de lire mon discours avec plus de plaisir, quand vous croirez moins lire un plaidoyer qu'assister à un jugement. Quoiqu'il soit long, j'espère qu'il vous plaira autant que s'il était des plus courts : car l'abondance des matières, l'ordre ingénieux des divisions, les courtes narrations dont il est semé, et la variété de l'expression semblent le renouveler sans cesse. Vous y trouverez tour à tour (je n'oserais le dire à d'autres) de l'élévation, de la vigueur, de la simplicité. En effet, j'ai souvent été obligé de mêler des calculs à ces choses nobles et véhémentes, et de demander presque des jetons et un registre si bien que le tribunal des centumvirs semblait changé tout à coup en tribunal domestique. J'ai donné l'essor à mon indignation, à ma colère, à ma douleur, et, dans une si grande cause, j'ai manœuvré, comme en pleine mer, sous plusieurs vents différents. En un mot, la plupart de mes amis regardent ce plaidoyer (je le répète) comme mon chef-d'œuvre. C'est ma harangue pour Ctésiphon. Vous en jugerez mieux que personne, vous qui connaissez si bien mes plaidoyers : il vous suffira de lire celui-ci pour le comparer à tous les autres. Adieu.

XXXIV. — Pline à Maxime,
Vous avez fort bien fait de promettre un combat de gladiateurs à nos chers habitants de Vérone qui depuis longtemps vous aiment, vous admirent, vous honorent. Votre épouse, d'ailleurs, était de Vérone. Ne deviez-vous pas à la mémoire d'une femme que vous aimiez et que vous estimiez tant, quelque monument public, quelque spectacle, et celui-ci surtout qui convient si bien à des funérailles? D'ailleurs, on vous le demandait si unanimement, qu'il y aurait eu plus de dureté que de fermeté à repousser le vœu général. Ce qui ajoute encore à votre générosité, c'est que vous y avez satisfait de si bonne grâce et avec tant d'éclat : car la noblesse de l'âme se montre jusque dans ce genre de munificence. J'aurais voulu que les panthères d'Afrique que vous aviez achetées en si grand nombre fussent, arrivées à temps. Mais, quoiqu'elles aient manqué à la fête, retenues par les orages, vous méritez pourtant qu'on vous en ait toute l'obligation, puisqu'il n'a pas tenu à vous de les y faire paraître. Adieu.
LIVRE SEPTIÈME. Retour
I. - Pline à Restitutus.
L'opiniâtreté de votre maladie m'épouvante et, quoique je vous connaisse très sobre, je crains qu'elle ne vous permette pas d'être toujours assez maître de vous. Je vous exhorte donc à résister avec courage : la tempérance est à la fois le plus noble et le plus salutaire des remèdes. Ce que je vous conseille n'est point au-dessus des forces humaines. Voici ce que j'ai toujours dit, en bonne santé, aux gens de ma maison : « Je me flatte que, s'il m'arrive d'être malade, je ne voudrai rien que je puisse rougir ou regretter d'avoir voulu. Mais si la force du mal venait à l'emporter sur ma résolution, je vous l'ordonne expressément, ne me donnez rien sans la permission des médecins et sachez-le bien, si vous cédiez à mes prières, j'en aurais autant de ressentiment contre vous, que d'autres en ont contre ceux qui leur résistent. » Je me souviens même qu'un jour, après une fièvre brûlante, dans un moment où mon corps affaibli était humide de sueur, le médecin m'offrit à boire. Je lui tendis la main, en l'invitant à la toucher et je rendis la coupe qu'il avait déjà approchée de mes lèvres. Quelque temps après, le vingtième jour de ma maladie, je me disposais à entrer dans le bain, lorsque je vis tout à coup les médecins parler bas entre eux. Je demandai ce qu'ils disaient. Ils me répondirent qu'ils croyaient, le bain sans danger, mais qu'ils ne pouvaient cependant se défendre de quelque inquiétude. Quelle nécessité de se presser? leur dis-je, et aussitôt je renonçai tranquillement à l'espoir du bain où il me semblait déjà me voir porter. Je repris mon régime d'abstinence, du même cœur et du même air que je me préparais tout à l'heure à le quitter. Je vous mande tout ceci pour soutenir mes conseils par mes exemples, et pour m'obliger moi-même par cette lettre à la retenue que je prescris. Adieu.
II. - Pline à Justus.
Comment se fait-il que vous soyez, comme vous le dites, accablé d'affaires, et qu'en même temps vous me pressiez de vous envoyer mes ouvrages qui obtiennent à peine des désœuvrés quelques moments fugitifs? Je laisserai donc passer l'été, pendant lequel les occupations vous assiègent et vous tourmentent, et lorsque enfin le retour de l'hiver me permettra de croire que vous pouvez du moins disposer de vos nuits, je chercherai parmi mes bagatelles ce que je puis vous offrir. Jusque-là ce sera assez pour moi que mes lettres ne vous soient pas importunes et comme elles ne peuvent manquer de l'être, je les ferai courtes.
III. — Pline à Présens.
Serez-vous donc éternellement tantôt en Lucanie, tantôt en Campanie? Vous êtes, dites-vous, Lucanien, et votre femme est Campaniènne. C'est un juste motif de prolonger votre absence, mais non de la perpétuer. Que ne revenez-vous donc enfin à Rome où vous rappellent et la considération dont vous jouissez, et votre gloire et vos amis de tout rang ? Jusques à quand vivrez-vous en prince? prétendez-vous toujours veiller et dormir à votre gré? passer les journées sans prendre un instant la chaussure de la ville et la toge ? jouir de votre liberté à toute heure ? Il est temps le revenir participer à nos ennuis, ne fût-ce que pour prévenir la satiété qui diminuerait vos plaisirs. Venez faire des saluts à nos citadins pour recevoir plus agréablement ceux qu'on vous fera. Venez essuyer les embarras de la foule, afin de mieux jouir ensuite d es douceurs de la solitude.
Mais (imprudent que je suis !) je vous arrête, en voulant vous appeler. Peut-être tout ce que je vous dis ne fera-t-il que vous engager davantage à vous envelopper dans votre repos. Je veux, du reste, non que vous y renonciez, mais que vous l'interrompiez temps en temps. Comme dans un repas, je joindrais à des mets doux d'autres mets apéritifs et piquants qui réveilleraient l'appétit émoussé et assoupi par les premiers ; j'agis de même, en vous conseillant d'assaisonner quelquefois de pénibles occupations les délices d'une vie tranquille. Adieu.
IV. — Pline à Pontius.
Vous avez lu, dites-vous, mes hendécasyllabes ; vous voulez même savoir comment un homme si austère, selon vous, et qui, je dois l'avouer, ne me paraît point à moi-même trop frivole, s'est avisé d'écrire en ce genre. Je vous répondrai, en reprenant les choses de plus haut, que je ne me suis jamais senti d'éloignement pour la poésie. Je fis même une tragédie grecque à quatorze ans. Quelle tragédie ? dites-vous. Je n'en sais rien ; on l'appelait une tragédie. Peu après, comme je revenais de l'armée, retenu par les vents contraires dans l'île d'Icarie, je m'amusai à faire des vers élégiaques, et contre la mer et contré l'île. J'ai aussi essayé quelquefois un poème en vers héroïques. Quant aux hendécasyllabes, ce sont ici les premiers qui m'échappent. En voici l'occasion. On me lisait, à ma villa de Laurente, l'ouvrage où Asinius Gallus établit un parallèle entré son père et Cicéron, Il se présenta, dans la lecture, une épigramme de ce dernier sur son cher Tiron. M'étant retiré ensuite, vers le milieu du jour, pour dormir (nous étions alors en été), et ne pouvant fermer l'oeil, je vins à penser que les plus grands orateurs avaient aimé la poésie, et s'étaient fait honneur de la cultiver. Je tendis les ressorts de mon esprit, et, contre mon attente, je parvins en quelques instants, malgré une si longue interruption de cet exercice, à tracer ainsi les motifs mêmes qui m'avaient engagé à écrire des vers :
Dans le livre où Gallus (Gallus! le croirait-on?)
Préfère hardiment son père à Cicéron,
J'ai vu que cet illustre et grave personnage,
Pour conformer ses mœurs aux mœurs de plus d'un sage,
Des folâtres plaisirs prisait fort l'enjoument,
Et qu'il eut pour Tiron un vif attachement.
En amant, il se plaint qu'un soir avec adresse
Tiron lui refusa quelques baisers permis.
Qui doute, dis-je alors, que d'un peu de tendresse,
Après un tel exemple, il ne nous soit permis
De dérider le front de l'austère sagesse?
Comme son affranchi, montrons que des amours
Nous connaissons aussi les larcins et les tours.
De là je passai à des vers élégiaques que je fis aussi rapidement. J'en ajoutai d'autres, séduit par la facilité que je trouvais à composer. De retour à Rome, je les lus à mes amis qui les approuvèrent. Depuis, dans mes heures de loisir, particulièrement en voyage, j'ai fait des vers de toute sorte de mesures. Enfin je me suis décidé, à l'exemple de beaucoup d'autres, à donner un volume séparé d'hendécasyllabes, et je ne m'en repens point. On les lit, on les transcrit, on les chante. Les Grecs même, auxquels cet opuscule a donné le goût de notre langue, les accompagnent tour à tour de leurs cithares et de leurs lyres. Mais pourquoi parler de moi avec tant de vanité? Que voulez-vous ? un peu de folie se pardonne aux poètes. D'ailleurs ce n'est point la bonne opinion que j'ai de mes vers, mais celle qu'en ont les autres, que je rappelle ici et leurs éloges, mérités ou non, me font plaisir. Je ne forme qu'un souhait, c'est que la postérité, à tort ou à raison, en juge comme eux. Adieu,
V. — Pline à Calpunie.
On ne saurait croire à quel point je souffre de votre absence, d'abord parce que je vous aime, ensuite, parce que nous n'avons pas l'habitude d'être séparés, De là vient que je passe une grande partie des nuits à penser à vous ; que, pendant le jour et aux heures où j'avais coutume de vous voir, mes pieds, comme on dit, me portent d'eux-mêmes à votre appartement et que, ne vous y trouvant pas, j'en reviens aussi triste et aussi honteux que si l'on m'avait refusé la porte. Le seul temps où je suis affranchi de ces tourments, c'est lorsque, au barreau, les affaires de mes amis viennent m'accabler. Jugez quelle est la vie d'un homme qui ne trouve de repos que dans le travail, de soulagement que dans les tourments et les fatigues. Adieu.
VI. — Pline à Macrinus.
Il vient de se présenter dans l'affaire de Varénus un incident rare et remarquable, quoique le dénoûment en soit encore douteux. On dit que les Bithyniens ont renoncé à leur accusation, et qu'ils la déclarent mal fondée. Mais pourquoi employer ce mot on dit? Un député est arrivé de Bithynie, apportant un décret du conseil de cette province. Il l'a remis à César ; il l'a remis à beaucoup de personnages distingués ; il nous l'a remis à nous-mêmes, avocats de Varénus. Cependant Magnus, l'accusateur dont je vous ai parlé, persiste toujours, et il pousse même obstinément Nigrinus, qui est un homme de bien. Il a exigé qu'il demandât aux consuls que Varénus fût forcé de produire ses registres. J'accompagnais Varénus, seulement comme ami, et j'avais résolu de me taire. Nommé avocat par le sénat, rien ne me semblait, plus contradictoire que de défendre, comme accusé, celui qui ne devait plus paraître tel. Les consuls ayant cependant tourné les yeux sur moi, quand Nigrinus eut fini de parler : Vous connaîtrez, leur dis-je, que nous ne nous taisons pas sans raison, quand vous aurez entendu les véritables députés de Bithynie. — A qui ont-ils été envoyés? demanda Nigrinus. A moi-même, entre autres personnes, répondis-je j'ai en main le décret de la province. Vous n'en êtes que mieux éclairé sur l'affaire, reprit Nigrinus. Si vous l'êtes, vous, dans des intérêts opposés, répliquai-je, je puis l'être aussi sur ce qu'il est à propos de faire dans l'intérêt de mon ami. Alors le député Polyénus expliqua la raison du désistement des Bithyniens, et il demanda qu'on ne préjugeât rien dans une cause soumise à l'empereur. Magnus répondit. Polyénus répliqua. J'entremêlai quelques mots à leurs discours, et du reste je gardai un profond silence. Je l'ai appris, en effet : il y a souvent autant d'éloquence à se taire qu'à parler, et je me souviens que, dans certaines affaires capitales, j'ai mieux servi les accusés par mon silence, que je n'aurais pu le faire par le discours le mieux travaillé. Qu'il me soit permis de m'arrêter sur cette vérité qui intéresse notre art, quoique j'aie pris la plume dans un autre but. Une mère, à la mort de son fils, avait accusé de faux et d'empoisonnement, devant le prince, les affranchis de ce même fils qui les avait institués cohéritiers avec elle. Julius Servianus lui fut donné pour juge. Je défendis les accusés devant une assemblée nombreuse : car la cause avait fait du bruit et devait être plaidée par des orateurs en renom. Pour terminer l'affaire, on ordonna la question, qui fut en faveur des accusés. Bientôt la mère se présenta à l'empereur, et lui assura qu'elle avait découvert de nouvelles preuves. Servianus reçut, l'ordre de revoir le procès déjà fini, et de s'assurer si en effet on produisait quelque nouvel indice. Julius Africanus plaidait, pour la mère. C'était le petit-fils de ce Julius l'orateur qui fit dire à Passiénus Crispus devant lequel il venait de parler : Bien, fort bien, en vérité mais pourquoi si bien ? Son petit-fils avait de l'esprit, mais peu d'adresse. Après avoir longtemps plaidé et rempli la mesure de temps qui lui avait été assignée, il avait dit : Je vous supplie, Servianus, de me permettre d'ajouter quelques mots. Tous les yeux se tournèrent bientôt sur moi, dans la croyance que je ferais une longue réplique : J'aurais répondu, dis-je alors, si Afri canus eût ajouté ces quelques mots qui sans doute eussent renfermé tout ce qu'il avait promis de nouveau. Je ne me souviens point d'avoir jamais reçu tant d'applaudissements en plaidant, que j'en reçus alors en ne plaidant, pas.
Aujourd'hui mon silence, dans l'affaire de Varénus a eu la même approbation et le même succès. Les consuls, comme le demandait Polyénus, ont réservé au prince l'entière connaissance, de la cause, et j'attends sa décision avec une extrême inquiétude. Car ce jour me rendra, pour Varénus, la sécurité et le repos, ou me rejettera dans mes premiers travaux et dans mes premières alarmes. Adieu.
VII. — Pline à Saturninus.
Selon vos désirs, j'ai dernièrement renouvelé deux fois à Priscus les assurances de votre gratitude et je l'ai fait de grand cœur. Je suis ravi que deux hommes de votre mérite, et que j'aime tant, soient si étroitement unis et se croient mutuellement engagés l'un envers l'autre car, de son côté, Priscus publie que rien ne lui est plus doux au monde que votre amitié. Il y a entre vous un noble combat de tendresse réciproque, et le temps ne fera que resserrer les nœuds de votre union. Je regrette bien vivement que vous soyez retenu par vos affaires, et que vous ne puissiez vous donner à vos amis. Cependant, si l'on juge un de vos procès, et que vous-même vous coupiez court à l'autre, somme vous le dites, vous pourriez jouir d'abord, dans le lieu où vous êtes, des douceurs du repos, et, après vous en être rassasié, revenir ici. Adieu.
VIII.- Pline à Priscus.
Je ne puis vous exprimer tout le plaisir que fait notre cher Saturninus en m'écrivant lettre sur lettre pour me charger, auprès de vous des témoignages de sa vive reconnaissance. Continuez comme vous avez commencé : aimez-le tendrement. C'est un excellent homme dont l'amitié sera pour vous pleine de charmes, et vous promet une longue jouissance. Car, s'il possède toutes les vertus, il est surtout d'une rare constance dans ses affections. Adieu.
IX. — Pline à Fuscus.
Vous me demandez un plan d'études à suivre dans la retraite dont vous jouissez depuis longtemps. Un des exercices les plus utiles, et que beaucoup de personnes recommandent, est de traduire du grec en latin. Par là vous acquérez la justesse et la beauté de l'expression, la richesse des figures, l'abondance des développements, et dans cette imitation des auteurs les plus excellente, vous puisez le talent d'écrire comme eux. Ajoutez qu'en traduisant, on saisit bien des choses qui eussent échappé enlisant, la traduction ouvre l'esprit et forme le goût.
Il serait bon encore de choisir dans vos lectures un morceau dont vous ne prendrez que le fond et le sujet pour le traiter vous-même avec l'intention d'établir une lutte entre l'auteur et vous. Vous comparerez ensuite son ouvrage et le vôtre, et vous examinerez soigneusement dans quel endroit vous l'avez surpassé, dans quel autre il vous est supérieur. Quelle joie d'apercevoir qu'on a eu quelquefois l'avantage ! quelle confusion, si l'on est toujours demeuré au-dessous! Vous pourrez aussi de temps en temps faire un choix des passages les plus célèbres, et chercher à les égaler. Comme cette lutte est secrète, elle suppose plus de courage que de témérité. Nous voyons même un grand nombre de personnes pour lesquelles ces sortes de combats n'ont pas été sans gloire. Elles n'aspiraient qu'à suivre leurs modèles, et, pleines d'une noble confiance, elles les ont devancés.
De plus, quand vous aurez perdu de vue votre ouvrage, vous pourrez le remanier, en conserver une partie, retrancher l'autre, ajouter, changer à votre gré. C'est sans doute une besogne pénible et fort ennuyeuse mais, malgré la difficulté, il est utile de reprendre son premier feu, de rendre à son esprit une ardeur épuisée et qu'on a laissée s'éteindre, enfin d'adapter, sans troubler l'ordre déjà établi, de nouveaux membres à un corps qui semblait achevé.
Je sais que votre étude principale est l'éloquence du barreau. Cependant je ne vous conseillerais pas de vous en tenir toujours à ce style de controverse et de combat. Comme les champs se plaisent à changer de semences, nos facultés intellectuelles demandent aussi à être exercées par différentes études. Appliquez-vous tantôt à traiter quelque sujet historique, tantôt à écrire une lettre avec soin : car, dans les plaidoyers même, il est souvent nécessaire de tracer non seulement des ta bleaux historiques, mais encore des descriptions demi poétiques. Quant aux lettres, elles nous donnent un style concis et châtié. On peut encore se délasser en composant des vers. Je ne parle pas de ces ouvrages de longue haleine qu'on ne peut achever que dans un parfait loisir, mais de ces petites pièces légères qui trouvent leur place dans l'intervalle des occupations les plus graves. C'est ce qu'on nomme des jeux mais ces jeux quelquefois ne font pas moins d'honneur que des écrits sérieux. Je vous dirai donc, pour vous conseiller en vers, de cultiver la poésie :
Ainsi que nous voyons, sous une main savante,
S'arrondir, se plier la cire obéissante,
Et, docile a son gré, devenir tour à tour
Minerve, Jupiter, Mars, Vénus ou l'Amour
Comme en de longs canaux sagement répartie,
L'onde arrose les prés et dompte l'incendie ;
Les préceptes de l'art éclairent les talents.
Préviennent leurs écarts et guident leurs élans.
C'est ainsi que s'exerçaient ou se délassaient les grands orateurs et même que les plus grands hommes ou plutôt, c'est ainsi qu'ils se délassaient, et s'exerçaient tout ensemble. On ne saurait croire combien ces opuscules raniment et reposent l'esprit. L'amour, la haine, la colère, la pitié, le badinage, enfin tout ce qu'on voit le plus souvent dans le monde, au barreau, dans les affaires, peut en fournir le sujet. Ce travail, ainsi que toute autre composition poétique, procure cet avantage, qu'après avoir été gêné par la mesure, on aime à retrouver la liberté de la prose, et qu'on écrit t avec plus de plaisir dans un genre dont la comparaison a fait ressortir la facilité.
Voilà peut-être plus de conseils que vous n'en demandiez. J'ai pourtant oublié un point essentiel : je n'ai point dit ce qu'il fallait lire, quoique ce soit l'avoir assez dit, que d'avoir marqué ce qu'il fallait écrire. Souvenez-vous seulement de bien choisir les meilleurs livres dans chaque genre : car on a fort bien dire qu'il fallait beaucoup lire, mais peu de livres. Je ne vous marque point ces livres ; ils sont si universellement connus, qu'il n'est pas nécessaire de les indiquer. D'ailleurs je me suis si fort étendu dans cette lettre, qu'en voulant vous donner des avis sur la manière d'étudier, j'ai dérobé du temps à vos études. Reprenez donc au plus tôt vos tablettes ; commencez quelqu'un des ouvrages que je vous ai proposés, ou continuez ce que vous avez commencé. Adieu.

X.-Pline à Macrinus.
Quand une fois j'ai su le commencement d'une histoire, j'aime à en connaître la fin, comme si on me l'avait dérobée. J'ai donc pensé que vous seriez bien aise, ainsi que moi, de savoir la suite : du procès de Varénus et des Bithyniens. La cause a été plaidée devant l'empereur, d'un côté par Polyénus, de l'autre par Magnus. Après leurs plaidoyers, l'empereur dit : Aucune des parties ne se plaindra du retard, J'aurai soin de m'informer des véritables intentions de la province. Cependant Varénus obtient un grand avantage. Car enfin, combien est-il douteux qu'on l'accuse avec justice, quand il n'est pas même certain qu'on l'accuse ! Ce qui reste à désirer, c'est que la province n'en revienne pas au parti qu'elle semble avoir condamné, et qu'elle ne se repente pas de s'être repentie. Adieu.
XI. —Pline à Fabatus.
Vous êtes surpris que mon affranchi Hermès, sans attendre l'enchère que j'avais ordonnée, ait vendu à Corellia mes cinq douzièmes des terres de la succession, à un prix qui établirait la valeur de toutes les terres réunies à sept cent mille sesterces. Tous ajoutez qu'on les pourrait vendre neuf cent mille, et, d'après ce calcul, vous désirez d'autant, plus savoir si je ratifie le marché. Oui, je le ratifie, et voici mes raisons car je désire que vous m'approuviez, et que mes cohéritiers m'excusent, si, pour satisfaire à un devoir plus puissant, je sépare mes intérêts des leurs. J'ai pour Corellia le plus grand respect et la plus vive amitié. D'abord elle est soeur de Corellius Rufus, dont la mémoire m'est sacrée ensuite elle était amie intime de ma mère. Une ancienne liaison m'attache aussi à Minucius Fuscus, son mari, le meilleur des hommes. Enfin son fils a été mon ami particulier, au point que, sous ma prélure, il se chargea de donner les jeux en mon nom. Corellia, au dernier voyage que je fis dans le pays me témoigna le désir de posséder quelques terres aux environs de notre lac de Côme. Je lui en offris des miennes ce qu'elle voudrait et au prix qu'elle le voudrait, exceptant toutefois les biens de mon père et de ma mère : car, pour ceux-là, je n'y puis renoncer, même en faveur de Corellia. Les terres dont il s'agit m'étant donc échues en succession, je lui écrivis qu'elles allaient être mises en vente. Hermès lui rendit ma lettre. Elle voulut qu'il lui adjugeât sur-le champ ma portion d'héritage. Il le fit. Vous voyer si je dois hésiter à ratifier un accord que mon affranchi a conclu d'après les sentiments qu'il me connaît. Il me reste à prier mes cohéritiers de trouver bon que j'aie vendu séparément ce que j'avais pleinement le droit de vendre. Rien ne les oblige à suivre mon exemple. Ils n'ont point, les mêmes engagements avec Corellia. Ils peuvent donc chercher les avantages dont l'amitié m'a tenu lieu. Adieu.
XII. — Pline à Minucius.
Je vous envoie, comme vous l'avez exigé, le mémoire que j'ai composé pour votre ami, ou plutôt pour le nôtre. Qu'y a-t-il, en effet, qui ne soit commun entre nous? Il pourra s'en servir au besoin. Je vous l'envoie plus tard que je ne vous l'avais promis, afin que vous n'ayez pas le temps de le corriger, ou, pour mieux dire, de le gâter. Après tout, vous trouverez toujours assez de temps, sinon pour le corriger, au moins pour le gâter, en retranchant, par un zèle indiscret, tout ce qu'il y a de meilleur. Si cela vous arrive, j'en ferai mon profit. Plus tard, quand l'occasion s'en présentera, j'userai de ces suppressions comme de mon bien, et je devrai à votre critique dédaigneuse de pouvoir m'en faire honneur. Tels sont les passages que vous trouverez notés, et tout ce que j'ai écrit en interligne d'un autre style que le texte du mémoire. Comme je soupçonnais que vous trouveriez enflé ce qui n'est en effet qu'éclatant et sublime, j'ai jugé à propos de vous épargner la torture d'un nouveau travail, et d'ajouter au même endroit quelque chose de plus modeste et de plus simple, ou, pour mieux dire, de plus bas et de plus médiocre, mais bien meilleur à votre goût car je ne puis m'empêcher de faire partout la guerre à votre pusillanimité.
Jusqu'ici j'ai voulu rire pour vous distraire un moment de vos occupations. Voici du sérieux. Songez à me rembourser les frais de course d'un exprès que je vous ai dépêché. Vous m'avez bien l'air, quand vous aurez lu ce passage, de condamner, non pas quelques parties du mémoire, mais le mémoire tout entier, et de ne trouver aucune valeur à une chose dont on réclame le prix. Adieu.
XIII — Pline à Férox.
Votre lettre m'assure en même temps que vous étudiez et que vous n'étudiez pas. Je vous parle par énigmes ; oui, sans doute mais je vais m'expliquer plus clairement. Vous me dites que vous n'étudiez pas, et votre lettre est si bien écrite, qu'elle ne peut l'avoir été que par quelqu'un qui étudie. S'il en est autrement, vous êtes le plus heureux des hommes d'écrire ainsi en vous jouant et sans étude. Adieu.
XIV. — Pline à Corellia.
C'est vraiment de votre part une extrême délicatesse que de me prier avec tant d'instances et d'exiger même que je reçoive le prix de mes terres, non sur le pied de sept cent mille sesterces, suivant votre marché avec mon affranchi, mais sur le pied de neuf cent mille, conformément à la vente du vingtième que le fisc vous a faite. A mon tour, je vous supplie et vous conjure, après avoir songé à ce qui est digne de vous, de songer à ce qui est digne de moi, et de souffrir qu'ici seulement ma soumission pour vous se démente par les mêmes raisons qui partout ailleurs lui servent de principe. Adieu.
XV. - Pline à Saturninus.
Vous me demandez ce que je fais. Je me livre aux occupations que vous connaissez. Je m'emploie pour mes amis, je donne quelques heures à l'étude. Combien il me serait, je n'ose pas dire mieux, mais au moins plus doux de les lui consacrer toutes ! Pour vous, je souffrirais de vous voir obligé de faire tout autre chose que ce que vous vendriez, si vos travaux étaient moins honorables. Rien de plus glorieux, en effet, que de veiller aux intérêts de l'État, et de rétablir la paix entre des amis. Je savais que la société de notre cher Priscus vous serait agréable. Je connaissais sa droiture et la douceur de son commerce. En m'écrivant qu'il se souvient avec tant déplaisir des bons offices qu'il a reçu de moi, vous m'apprenez ce qui m'était moins connu, c'est qu'il est l'homme du monde le plus reconnaissant. Adieu.
XVI, - Pline à Fabatus.
Calestrius Tiro est de mes plus intimes amis, et nous tenons l'un à l'autre par tous les liens publics et particuliers. Nous avons fait nos campagnes ensemble, nous avons été ensemble questeurs du prince. Il me devança dans la charge de tribun du peuple, par le privilège que donne le nombre des enfants, je le rejoignis dans celle de préteur, le prince m'ayant accordé la dispense d'un an qui me manquait. Je me suis souvent retiré dans ses terres ; souvent il est venu rétablir, sa santé dans les miennes. En ce moment, il va, en qualité de proconsul, prendre possession du gouvernement de la Bétique , et doit passer par Ticinum. J'espère ou plutôt je compte obtenir qu'il se détourna de sa route pour aller vous voir. Si vous voulez affranchir pleinement les esclaves auxquels vous avez en présence de vos amis, accordé dernièrement la liberté, ne craignez pas de déranger un homme qui ferait sans, peine le tour du monde pour me rendre service. Renoncez donc à cette excessive discrétion, que je vous connais, et ne consultez que votre bon plaisir. Il est aussi, agréable à Calestrius Tiro de m' obliger qu'à moi de vous obéir. Adieu.
XVII. -Pline à Céler.
Chacun a ses motifs pour faire des lectures publiques. Les miennes sont, comme je l'ai dit souvent, que, si j'ai commis quelque, faute (et il en échappe toujours), on m'en avertît. Aussi suis-je d'autant plus, surpris de ce que vous me mandez. Quelques personnes, dites-vous trouvent mauvais que je lise en public mes plaidoyers. Les ouvrages de ce genre, suivant elles, doivent donc seuls n'être pas corrigés? Je demanderais volontiers à mes censeurs, pourquoi ils conviennent (s'ils en conviennent pourtant), qu'on doit lire un ouvrage historique, dans lequel on ne cherche point l'éclat, mais l'exactitude et la vérité ; une tragédie, qui demande, au lieu d'un auditoire, une scène et des acteurs, des vers lyriques, qui veulent, non pas un lecteur, mais un chœur et un lyre ?
L'usager dira-t-on a autorisé la lecture de ces sortes de compositions. Faut-il donc condamner celui qui l'a introduit? Les Grecs et quelques Romains n'ont-ils pas lu aussi publiquement leurs plaidoyers? Mais il est inutile de lire ce que,vous avez débité en: public. Oui, si vous lisiez les mêmes choses aux mêmes personnes, si vous lisiez en sortant de l'audience. Mais si vous ajoutez, si vous changez beaucoup de passages ; si vos auditeurs ne vous ont point entendu, ou ne vous ont entendu qu'à une époque déjà éloignée, pourquoi y aurait-il moins de motifs pour lire ce que vous avez prononcé, que pour le donner au pu blic? Mais il est difficile qu'un plaidoyer fasse plaisir, quand il est lu. C'est une besogne de plus pour le lecteur, et non une raison pour ne pas lire.
Pour moi, je ne songe pas à être loué quand je lis, mais à l'être quand je suis lu. Je ne fuis donc aucune espèce de critique. D'abord je retouche moi-même ce que j'ai composé ; ensuite je le lis à deux ou trois personnes ; puis je le donne à d'autres pour faire leurs remarques, et ces remarques, si elles me laissent quelque scrupule : je les pèse avec un ou deux de mes amis. Enfin je lis devant une assemblée plus nombreuse et c'est là, je vous l'assure, que je suis le plus ardent à corriger. Mon attention est alors d'autant plus éveillée, que mon inquiétude est plus grande. Le respect, la retenue, la crainte sont d'excellents censeurs. Qu'on y songe, en effet : n'est-on pas moins troublé, si l'on doit parler devant un homme seul, quelque savant qu'il soit, que si l'on doit discourir devant plusieurs, fussent-ils ignorants? N'est-ce pas, quand on se lève pour plaider, qu'on se défie le plus de soi? qu'alors on voudrait avoir changé, je ne dis pas une partie de son discours, mais son discours tout entier, surtout si le théâtre est vaste et le cercle nombreux ? Les juges les plus vils et les plus grossiers semblent alors redoutables. Si l'on pense que le début n'a pas réussi, ne se sent-on point découragé, consterné? Le motif, selon moi, c'est qu'il y a dans le nombre même je ne sais quelle opinion imposante et générale. Chacun des auditeurs peut avoir peu de goût ; réunis, ils en ont beaucoup. Aussi Pomponius Sécundus, le fameux auteur tragique, fait-il ordinairement, lorsqu'il tenait à conserver quelque endroit de ses pièces qu'un intime ami lui conseillait de supprimer : J'en appelle au peuple et , d'après le silence ou l'approbation du peuple, il suivait l'avis de son ami ou le sien : tant il accordait au jugement de la multitude ! Avait-il tort ou raison? peu m'importe, je ne lis pas au peuple ; je lis dans une assemblée de personnes choisies dont je puisse consulter les visages, dont je suive les avis, que j'estime séparément en même temps que je les redoute réunies. Ce que M. Cicéron disait du travail écrit, je le dis de la crainte : la crainte est le plus sévère des censeurs. Cette seule pensée, que nous devons lire en public, corrige nos ouvrages. Paraître devant une assemblée, pâlir, trembler, regarder autour de soi, tout contribue à nous réformer.
Je ne me repens donc pas d'une coutume dont je recueille tant d'avantages et, loin de m'émouvoir de la malveillance de mes censeurs, je vous prie de m'indiquer quelque nouveau secret pour ajouter encore à la correction de mes écrits : car je ne suis jamais satisfait de mon travail. Je songe combien il est périlleux de livrer un ouvrage aux mains du public et je ne puis me persuader que l'on ne doive pas retoucher souvent, et en réunissant beaucoup d'avis ce qui tend à plaire toujours et à tout le monde. Adieu.
XVIII. — Pline à Caninius.
Vous me consultez pour savoir comment vous pouvez assurer
après vous la destination d'une somme que vous avez offerte à nos
compatriotes pour un festin public. Votre confiance m'honore mais le conseil n'est pas facile à donner. Compterez vous le capital à l'État? il est à craindre qu'on ne le dissipe. Engagerez vous
des biens-fonds? ils seront négligés comme propriétés publiques.
Je ne vois rien de plus sûr que les moyens que j'ai pris moi-même. J'avais promis cinq cent mille sesterces pour assurer des aliments à des personnes de condition libre. Je fis à l'agent du fisc de la cité une vente simulée d'une terre dont la valeur dépassait beaucoup cinq cent mille sesterces. Je repris ensuite cette terre, chargée envers l' État d'une rente annuelle et perpétuelle de trente mille sesterces. Par là le fonds donné à l'Etat ne court aucun risque, le revenu n'est point incertain, et le bien rendant beaucoup plus que la rente dont il est chargé, ne manquera jamais de maîtres qui prenne soin de le faire valoir. Je n'ignore pas que j'ai donné plus qu'il ne parait, puisque la charge de cette rente déprécie beaucoup la valeur d'une si belle terre mais il est trop juste de donner la préférence à l'utilité publique sur l'utilité particulière, à l'éternité sur le temps, et de prendre beaucoup plus de soin de son bienfait que de son bien. Adieu.
XIX.- Pline à Priscus.
La maladie de Fannia me désolé. Elle l'a gagnée en veillant auprès de la vestale Junia, d'abord volontairement et à titre de parente, ensuite par l'ordre même des pontifes. Car, lorsque la force du mal oblige les vestales à sortir du temple de Vesta, on les confié aux soins et à la garde de femmes respectables et c'est en remplissant religieusement ce devoir, que Fannia s'est vue atteinte à son tour. Elle a une fièvre continue, sa toux augmente, sa maigreur et sa faiblesse sont extrêmes. Il n'y a que son âme et son esprit qui aient conservé leur vigueur, et qui restent dignes d'Helvidius, son mari, et de Thraséas, son père. Le reste l'abandonne, et son état me jette non seulement dans une frayeur, mais dans une douleur mortelle. Je gémis de voir une femme si admirable disparaître de Rome où l'on ne verra peut-être jamais rien qui lui ressemble. Quelle chasteté ! quelle pureté de mœurs! quelle sagesse ! quelle fermeté ! Elle a suivi deux fois son mari en exile et elle y a été envoyée une troisième fois à cause de lui. Car, Sénécion, accusé d'avoir écrit la vie d'Helvidius, dit, pour sa justification, qu'il ne l'avait fait qu'à la prière de Fannia. Métius Carrus, l'accusateur, demanda d'un air menaçant à Fannia, si elle l'en avait prié. - Oui, répondit-elle. — Si elle avait donné des mémoires. - Oui. - Si sa mère le savait ?—Non. Enfin elle ne laissa pas échapper une seule parole qui parût inspirée par la crainte. Je dirai plus. Un décret du sénat, arraché par le malheur et la nécessité des temps, supprima l'ouvrage, exila Fannia et confisqua ses biens. Elle n'en conserva pas moins l'ouvrage supprimé, et emporta avec elle dans son exil la cause même de son exil. Qu'elle était agréable et douce ! combien, par un rare privilège, elle était digne à la fois d'amour et de respect ! Nous pourrons certaine ment un jour la proposer à nos femmes pour modèle, et trouver nous-mêmes dans sa vie de grands exemples de courage. Mainte nant qu'il nous est encore permis de la voir et de l'entendre, nous ne l'admirons pas moins que celles dont nous lisons l'histoire. Pour moi, il me semble que cette maison est ébranlée jusque dans ses fondements, et prête à tomber en ruines. Quoique Fannia laisse des descendants, par quelles vertus pourront-ils effacer l'idée que leur race a finie avec cette illustre femme?
Un surcroît de douleur et d'angoisse pour moi, c'est qu'il me semble que je perds encore une fois sa mère, la mère, dis-je, d'une si admirable femme. Cet éloge renferme tout. Comme elle la représentait et la faisait revivre à nos yeux, elle nous l'enlèvera avec elle. La mort de l'une rouvrira la plaie que l'autre avait faite au fond de mon cœur. Je les vénérais, je les chérissais toutes deux : je ne sais pour laquelle ces sentiments étaient les plus vifs et elles-mêmes ne voulaient pas de distinction. Elles ont éprouvé mon dévouement dans la prospérité, elles l'ont éprouvé dans les revers. Je les ai consolées dans leur exil, et vengées à leur retour. Je ne leur ai pourtant pas rendu tout ce que je leur dois ; c'est ce qui me fait souhaiter davantage de conserver, celle qui nous reste pour avoir le temps de m'acquitter. Voilà ce qui me préoccupe en vous écrivant. Je compterai pour rien mes alarmes, si quelque divinité vient les changer en joie. Adieu.
XX. — Pline à Tacite.
J'ai lu votre livre, et j'ai noté avec tout le soin possible ce que je crois nécessaire d'y changer ou d'en retrancher car j'ai autant l'habitude de dire la vérité, que vous aimez à l'entendre et d'ailleurs, on ne trouve point de gens plus dociles à la censure que ceux qui méritent le plus de louanges. Je m'attends qu'à votre tour vous me renverrez mon livre avec vos critiques. Quel doux, quel noble échange ! quel plaisir de penser que si la postérité s'occupe de nous, on parlera partout de notre union, de notre franchise, de notre amitié ! Ce sera un spectacle rare et intéressant que celui de deux hommes à peu près de même âge et de même rang, de quelque célébrité dans les lettres (si je n'en dis pas plus de vous, c'est que je parle en même temps de moi), qui s'animaient mutuellement dans leurs études. Pour moi, dès ma plus tendre jeunesse, en vous voyant déjà dans l'éclat de votre gloire, je désirais ardemment de vous suivre, de paraître marcher et de marcher en effet sur vos traces.
Loin de vous mais enfin, le premier après vous. Il y avait alors à Rome beaucoup d'illustres génies mais la conformité de nos esprits vous montrait à moi comme celui que je pouvais le mieux imiter, et comme le plus digne modele. Voila pourquoi je suis si flatté qu'on nous désigne ensemble dans les entretiens littéraires, et qu'on pense à moi dès qu'on parle de vous. Il est plus d'un écrivain qu'on nous préfère mais que m'importe le rang, pourvu qu'on m'y place avec vous? Venir après vous, c'est être le premier. Vous avez dû même remarquer que, dans les testaments, excepté ceux de quelques amis particuliers, on ne fait point de legs à l' un de nous qu'on n'en fasse un pareil à l'autre. Nous ne saurions donc trop nous aimer, nous que les études, les caractères, la réputation, enfin les dernières volontés des hommes unissent par tant de nœuds. Adieu.
XXI.- Pline à Cornutus.
J'obéis, mon bien cher collègue, et je prends soin de mes yeux, comme vous me l'ordonnez. Je suis arrivé ici dans une voiture fermée où j'étais comme dans ma chambre. Non seulement je n'écris point, mais je ne lis même pas. Il m'en coûté beaucoup, à la vérité, mais enfin je ne lis pas, et je n'étudie plus que par les oreilles. Avec des rideaux, mon appartement est sombre, sans être obscur. En fermant les fenêtres basses de ma galerie, j'y entretiens autant d'ombre que de lumière et, par là, j'apprends peu à peu à supporter le jour. J'use du bain, parce qu'il m'est bon, du vin, parce qu 'il ne m'est pas contraire, sobrement pourtant, selon ma coutume et d'ailleurs j'ai quelqu'un qui m'observe. J'ai reçu avec plaisir, comme venant de vous, la poularde que vous m'avez envoyée et j'ai eu les yeux assez bons, quoiqu'encore faibles, pour m'apercevoir qu'elle est fort grasse. Adieu.
XXII. — Pline à Falcon.
Vous serez moins surpris que je vous aie demandé avec tant d'instances la charge de tribun pour un de mes amis, quand vous saurez quel est cet ami, et combien il a de mérite. Je puis bien vous dire son nom, et vous faire son portrait, aujourd'hui que vous m'avez accordé ma demande. C'est Cornélius Minucianus, l'honneur de notre province, et par son caractère et par ses mœurs. Sa famille est illustre, sa fortune considérable et cependant il aime les lettres autant que s'il était pauvre. On ne peut trouver un juge plus intègre, un avocat plus zélé, un plus fidèle ami. C'est vous qui croirez m'avoir obligation quand vous le connaîtrez pleinement. Il n'est au dessous d'aucun honneur, d'aucune charge et c'est par égard pour sa modestie, que je n'en dis pas davantage. Adieu.

XXIII. - Pline à Fabatus.
Je suis charmé sans doute que vos forces vous permettent d'aller au-devant de Tiron jusqu'à Milan mais, afin que vous les conserviez plus longtemps, je vous prie de renoncer à une course pénible qui ne convient pas à votre âge. Je vous conseille même d'attendre Tiron chez vous, dans votre maison, dans votre chambre. Je l'aime comme un frère, et il ne serait pas juste qu'il exigeât d'une personne que j'honore comme un père des devoirs dont il eut dispensé le sien. Adieu.
XXIV. - Pline à Géminius.
Numidia Quadratilla vient de mourir, âgée d'un peu moins de quatre-vingts ans. Dans un corps plus solide et plus robuste que son sexe et sa condition ne semblaient le permettre, elle a joui d'une parfaite santé jusqu'à sa dernière maladie. Son testament est fort sage. Elle a institué héritiers son petit-fils pour deux tiers, sa petite-fille pour l'autre tiers. Je connais peu la petite-fille mais le petit-fils est de mes intimes amis, c'est un jeune homme d'un rare mérite, et qui n'est pas seulement aimable pour ceux auxquels rattachent les liens du sang. Il a été d'une beauté singulière, sans avoir jamais fait parler de lui, ni pendant son enfance, ni pendant sa jeunesse. A vingt-quatre ans il était marié, et il aurait pu être père, si le ciel l'eût permis. Il a vécu dans la société d'une aïeule amie des plaisirs, et il a su concilier ses complaisances pour elle avec les mœurs les plus austères. Elle avait chez elle des pantomines, et les piégeait plus qu'il ne convenait à une femme de son rang. Quadratus n'assistait jamais à leurs jeux, ni au théâtre, ni même dans la maison, et elle n'exigeait pas qu'il en fut témoin. Quelquefois, en me priant de surveiller les études de son petit-fils, elle me disait que, comme femme, et pour amuser l'oisiveté à laquelle son sexe est condamné, elle jouait souvent aux échecs, ou faisait venir ses pantomimes mais alors elle renvoyait toujours son fils à ses études. C'était, je pense, autant par respect que par tendresse pour lui.
Vous serez surpris, comme moi, de ce qu'il me dit aux derniers jeux sacrés où les pantomimes parurent sur le théâtre. Nous en sortions ensemble, Quadratus et moi : Savez-vous bien, me dit-il, que j'ai vu aujourd'hui, pour la première fois, danser l'affranchi de mon aïeule? Mais , pendant que le petit-fils en usait ainsi, des personnes étrangères,pour faire honneur à Quadratilla (j'ai honte d'avoir si mal placé le mot d'honneur), pour lui plaire par des flagorneries, parcouraient le théâtre, sautaient, battaient des mains, s'émerveillaient, et venaient en chantant répéter devant elle tous les gestes de ses bouffons. Pour prix de ces services de théâtre, ils recevront de très petits legs des mains d'un héritier qui n'a jamais assisté à leurs jeux.
Pourquoi ces détails? parce que vous aimez les nouvelles, et que je me plais à rappeler, en vous les écrivant, toute la joie qu'elles m'ont fait éprouver. J'applaudis donc à la tendresse de Quadratilla, et à la justice rendue à un jeune homme si estimable. Je me réjouis de voir enfin que la maison de Caius Cassius, ce fondateur et ce père de l'école cassienne, soit habitée par un maître qui ne le cède point au premier. Quadratus la remplira dignement, il lui rendra toute sa réputation, sa splendeur et sa gloire. A un habile jurisconsulte aura succédé un habile orateur. Adieu.
XXV. — Pline à Rufus.
Que de savants cachés et soustraits à la renommée par la modestie ou l'amour du repos ! Cependant avons-nous à parler ou à lire en public, nous ne craignons que ceux qui produisent leur savoir tandis que ceux qui se taisent n'en témoignent que mieux par le silence leur estime pour un bel ouvrage. Ce que je vous en écris, c'est par expérience. Térentius Junior, après avoir servi honorablement dans la cavalerie, et s'être dignement acquitté de l'intendance de la Gaule narbonnaise, se retira dans ses terres et préféra un paisible loisir à tous les honneurs qui l'attendaient. Un jour il m'invita à venir chez lui. J'y consentis et, le regardant comme un bon père de famille, comme un honnête laboureur, je me disposais à l'entretenir du seul sujet que je lui croyais familier. J'avais déjà commencé, lorsqu'il sut doctement ramener la conversation sur la littérature. Quelle élégance dans ses paroles ! Comme il s'exprime en latin et en grec ! Il possède si bien les deux langues, qu'il, semble toujours que celle qu'il parle est celle qu'il sait le mieux. Quelle érudition ! quelle mémoire! vous croiriez que cet homme vit à Athènes, et non pas au village. En un mot, il a redoublé mes inquiétudes, et m'a fait redouter, à l'avenir, le jugement de ces campagnards inconnus, autant que celui des hommes dont je connais la science profonde. Je vous conseille d'en user de même. Lorsque vous y regarderez de près, vous trouverez beaucoup de gens dans l'empire des lettres, comme dans les armées, qui, sous un habit grossier, cachent les plus hautes vertus et les plus rares talents. Adieu.
XVI. — Pline à Maxime.
Dernièrement l'état de maladie d'un de mes amis me fit faire cette réflexion, que nous sommes très vertueux quand nous sommes malades. Est-il un seul malade entraîné par l'avarice ou par la débauche? Il est indifférent à l'amour, il ne convoite point les honneurs, il néglige la richesse, et quelque peu qu'il possède, il en a toujours assez, persuadé qu'il doit le quitter. Il croit alors aux dieux, il se souvient alors qu'il est homme. II n'envie, il n'admire, il ne méprise personne. Les médisances ne lui font ni impression ni plaisir. Il ne rêve que bains et que fontaines : c'est là l'objet de ses vœux, le terme de ses désirs et, s'il a le bonheur d'échapper, il n'a en vue désormais qu'une vie douce et oisive, c'est-à-dire innocente et heureuse. Je puis donc, de tout ceci, tirer en peu de mots pour nous deux une leçon que les philosophes noient dans de longs discours et dans d'interminables volumes : c'est que, dans la santé, nous devons toujours être ce que nous nous promettons d'être pendant la maladie. Adieu.
XXVII. — Pline à Sura.
Le loisir dont nous jouissons, nous permet, à vous d'enseigner, à moi d'apprendre. Je serais donc curieux de savoir si vous pensez que les spectres sont quelque chose de réel, et qu'ils ont une forme qui leur soit propre si vous leur attribuez une puissance divine, ou si ce ne sont que de vains fantômes auxquels notre frayeur donne de la consistance. Ce qui me porterait à croire sérieusement qu'il existe des revenants, c'est l'aventure arrivée, dit-on, à Curtius Rufus. Encore sans fortune et sans nom, il avait suivi en Afrique le gouverneur de cette province. Sur le déclin du jour, il se promenait, sous un portique, lorsqu'une femme d'une taille et d'une beauté surhumaines se présente à lui. La peur le saisit : Je suis l'Afrique, lui dit-elle ; je viens te prédire ta destinée. Tu iras à Rome, tu rempliras les plus grandes charges, tu reviendras ensuite gouverner cette province, et tu y mourras. L'événement vérifia la prédiction. On ajoute que, lorsqu'il aborda à Carthage, et sortit de son vaisseau, le même fantôme lui apparut sur le rivage. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il tomba malade, et que, augurant de l'avenir par le passé, de son malheur par sa bonne fortune, il désespéra de sa guérison, quand tous les siens en conservaient l'espoir.
Voici une autre histoire plus effrayante encore, et non moins surprenante. Je vous la donne telle qu'elle m'a été contée. Il y avait à Athènes une maison vaste et spacieuse, mais décriée et funeste. Dans le silence de la nuit, on entendait un bruit de fer, et, en écoutant avec attention, un froissement de chaînes qui semblait d'abord venir de loin et ensuite s'approcher. Bientôt apparaissait le spectre : c'était un vieillard maigre et hideux, à la barbe longue, aux cheveux hérissés. Ses pieds étaient chargés d'entraves et ses mains de fers qu'il secouait. De là des nuits affreuses et sans sommeil pour ceux qui habitaient cette maison. A l'insomnie succédait la maladie, et, l'effroi s'augmentent sans cesse, amenait la mort. Car, même pendant le jour, quoique le fantôme eût disparu, son souvenir errait devant, les yeux, et la terreur durait encore après la cause qui l'avait produite. Aussi, dans la solitude et l'abandon auquel elle était condamnée, cette maison resta livrée tout entière à son hôte mystérieux. On y avait cependant suspendu un écriteau, dans l'espoir qu'ignorant un tel désastre, quelqu'un pourrait l'acheter ou la louer.
Le philosophe Athénodore vient à Athènes, lit l'écriteau, demande le prix dont la modicité lui inspire des soupçons. Il s'informe. On l'instruit de tout, et, malgré ses renseignements, il s'empresse d'autant plus de louer la maison. Vers le soir, il se fait dresser un lit dans la salle d'entrée, demande ses tablettes, son poinçon, de la lumière. Il renvoie ses gens dans l'intérieur de la maison, se met à écrire, et applique au travail son esprit, ses yeux, sa main, de peur que son imagination oisive ne lui représente les spectres dont on lui a parlé, et ne lui crée de vaines terreurs. D'abord un profond silence, le silence des nuits, bientôt un froissement de fer, un bruit de chaînes. Lui, sans lever les yeux, sans quitter ses tablettes, invoque son courage pour rassurer ses oreilles. Le fracas augmente, s'approche, se fait entendre près de la porte, et enfin dans la chambre même. Le philosophe se retourne. Il voit, il reconnaît le fantôme tel qu'on l'a. décrit. Le spectre était debout, et semblait l'appeler du doigt. Athéno dore lui fait signe d'attendre un instant, et se remet à écrire. Mais le bruit des chaînes retentit de nouveau à ses oreilles. Il tourne encore une fois la tête, et voit que le spectre continue à l'appeler du doigt. Alors, sans tarder davantage, Athénodore se lève, prend la lumière, et le suit. Le fantôme marchait d'un pas lent : il semblait accablé sous le poids des chaînes. Arrivé dans la cour de la maison, il s'évanouit tout à coup aux yeux du philosophe. Celui-ci entasse des herbes et des feuilles pour reconnaître le lieu où il a disparu. Le lendemain, il va trouver les magistrats, leur conseille d'ordonner de fouiller en cet endroit. On y trouva des ossements enlacés dans des chaînes. Le corps, consumé par le temps et par la terre, n'avait laissé aux fers que ces restes nus et dépouillés. On les rassembla, on les ensevelit publiquement, et, après ces derniers devoirs, le mort ne troubla plus le repos de la maison.
Cette histoire, je la crois sur la foi d'autrui. Pour moi, voici ce que je puis affirmer. J'ai un affranchi, nommé Marcus, qui ne manque pas d'instruction. Tandis qu'il était couché avec son jeune frère, il crut voir quelqu'un assis sur son lit qui approchait des ciseaux de sa tête, et qui lui coupait les cheveux au-dessus du front. Au point du jour, on s'aperçut qu'il avait le haut de la tête rasé, et ses cheveux furent trouvés épars autour de lui. Peu de temps après, une nouvelle aventure du même genre vint confirmer la vérité de l'autre. Un de mes jeunes esclaves dormait avec ses compagnons dans leur dortoir. Deux hommes vêtus de blanc (c'est ainsi qu'il le raconte) vinrent par les fenêtres, lui rasèrent la tête pendant son sommeil, et s'en retournèrent, par la même voie. Le lendemain, dès que le jour parut, on le trouva également rasé, et les cheveux, qu'on lui avait coupés, étaient répandus sur le plancher. Ces aventures n'eurent aucune suite remarquable, si ce n'est que je ne fus point accusé devant Domitien qui régnait alors. Je ne l'eusse point échappé, s'il eût vécu plus longtemps : car on trouva dans son portefeuille un mémoire de Carus contre moi. De là on peut conjecturer que la coutume des accusés étant, de laisser, croître leurs cheveux, les cheveux coupés de mes esclaves m'annonçaient un péril heureusement écarté. Je vous supplie donc de mettre en œuvre toute votre érudition. Le sujet est digne d'une méditation longue et profonde, et peut-être mérité-je que vous me fassiez part de vos lumières. Si, selon votre coutume, vous pesez les deux opinions contraires, faites pourtant que la balance penche de quelque côté pour me tirer de la perplexité où je suis, car je ne vous consulte que pour m'en délivrer. Adieu.
XXVIII.- — Pline à Septicius.
Vous prétendez qu'on me reproche de louer mes amis en toute occasion, et sans mesure. J'avoue mon crime, et j'en fais gloire : rien de plus honorable que de pécher par excès d'indulgence. Quels sont, au reste, ceux qui connaissent mieux mes amis que moi- même? et, quand ils les connaîtraient, mieux, pourquoi m'envier une si douce erreur? Si mes amis ne sont pas tels que je le dis je suis toujours heureux de le croire. Que ces critiques portent donc ailleurs leur fâcheuse délicatesse. Assez d'autres, sous le nom de justice font la satire de leurs amis. Pour moi, on ne me persuadera jamais que j'aime trop les miens. Adieu.
XXIX. — Pline à Montanus.
Vous allez rire, vous indigner, et rire encore, en lisant ceci : car vous ne pourrez y croire sans l'avoir lu. On voit sur le chemin de Tibur, à un mille de Rome (j'en ai fait la remarque dernièrement), un tombeau de Pallas avec cette inscription : Pour récompenser son attachement et sa fidélité envers ses maîtres, le sénat lui a décerné les marques de distinction réservées aux préteurs, et le don de quinze millions de sesterces. Et il s'est contenté de la distinction honorifique. Je n'ai jamais été surpris de ces élévations où la fortune a souvent plus de part que le mérite. Je l'avoue pourtant, à la vue d une telle épitaphe, j'ai songé combien il y avait d'hypocrisie et d'absurdité dans les inscriptions que l'on prostitue quelquefois à ces âmes sales, pétries de boue et d'ordure, dans les distinctions que cet infâme scélérat ose accepter, ose refuser, en se proposant même à la postérité pour un exemple de modération. Mais pourquoi m'indigner? il vaut mieux rire, afin que les favoris de la fortune ne s'applaudissent pas d'être montés bien haut, lorsqu'elle n'a fait que les exposer à la risée publique. Adieu.
XXX. — Pline à Génitor.
Je suis profondément affligé que vous ayez perdu un disciple de la plus haute espérance. Sachant avec quelle exactitude vous remplissiez tous vos devoirs, et quel attachement vous avez pour ceux que vous estimez, je ne m'étonne point que sa maladie et sa mort aient dérangé vos études. Quant à moi, les embarras de la ville me poursuivent jusqu'ici. Un grand nombre me prend pour juge ou pour arbitre. Ajoutez à cela les plaintes des paysans qui profitent, amplement du droit qu'ils ont de se faire écouter après une si longue absence. D'ailleurs je suis occupé du soin de chercher des fermiers, nécessité fâcheuse, car il est très rare d'en trouver de bons. Je ne puis donc étudier qu'à la dérobée. J'étudie pourtant, car je lis et je compose. Mais, lorsque je lis, la comparaison me fait sentir combien je compose mal. Il ne tient pas à vous que vous ne me consoliez, quand vous comparez l'ouvrage que j'ai composé pour venger la mémoire d'Helvidius à la haran gue de Démosthène contre Midias. Il est vrai de dire, qu'en y tra vaillant, je lisais sans cesse l'œuvre de Démosthène. Je n'aspirais pas à l'égaler (il y aurait de la témérité, pour ne pas dire de la folie à y prétendre) mais je me proposais de l'imiter et de marcher sur ses traces, autant que le permettaient la différence des sujets et la distance d'un génie du premier ordre à un esprit du dernier. Adieu.
XXXI. —Pline à Cornutus.
Claudius Pollion souhaite fort d'être de vos amis. II m'en paraît digne, puisqu'il vous aime car il n'arrive guère de demander l'amitié de quelqu'un sans lui avoir déjà donné la sienne. C'est d'ailleurs un homme droit, intègre, doux, modeste à l'excès, s'il est vrai qu'il se puisse trouver de l'excès dans la modestie. Je l'ai connu quand nous étions ensemble à l'armée, et plus intimement qu'on ne connaît un simple compagnon d'armes. Il commandait une aile de cavalerie. Je fus chargé par le lieutenant du consul d'examiner les comptes des escadrons et des cohortes. Je fus aussi frappé de sa probité parfaite et de son exactitude scrupuleuse, que du désordre extrême et de la basse cupidité de quelques autres. Élevé ensuite aux plus brillants emplois, il n'a pas une seule fois démenti l'amour de la modération qui semble né avec lui. Jamais il ne fut enflé de ses succès ; jamais on ne le vit étourdi par la diversité de ses occupations, cesser un instant d'être affable et poli. Il a porté dans les plus grands travaux la force d'esprit qu'il montre maintenant dans la retraite. Il l'a quittée quelque temps, et c'est avec beaucoup de gloire. Notre cher Corellius, chargé de l'achat et du partage des terres que l'on devait à la munificence de l'empereur Nerva, l'associa à ses travaux et quelle gloire, d'avoir mérité qu'un si grand personnage, dont le choix pouvait s'arrêter sur tant d'autres, lui donnât la préférence ! Si vous voulez savoir quelle est sa fidélité, sa tendresse pour ses amis, consultez les testaments de quelques-uns d'entre eux, et particulièrement celui de Musonius Bassus, si distingué par son mérite. Pollion ne se contente pas d'honorer sans cesse sa mémoire, et de publier partout ce qu'il lui doit ; il a même écrit sa vie : car il n'a pas moins de goût pour les lettres que pour les autres arts. C'est un trait vraiment digne d'estime, et d'autant plus louable qu'il est rare de notre temps ; on ne se souvient guère des morts que pour s'en plaindre. Agréez donc, croyez-moi, l'amitié d'un homme si avide de la vôtre : acceptez-la avec empressement, ou plutôt recherchez la avec ardeur. Aimez-le, comme si la reconnaissance vous y engageait. Dans le commerce de l'amitié, c'est peu de rendre, on doit du retour à celui qui a commencé le premier. Adieu.

XXXII. - Pline, à Fabatus.
Je suis charmé que la visite de mon cher Tiron vous ait fait plaisir mais je suis ravi surtout que la présence du proconsul ait, comme vous me l'écrivez, fourni l'occasion d'affranchir un grand nombre d'esclaves. Je souhaite que notre patrie s'accroisse en toutes choses, mais particulièrement en citoyens. C'est là le plus solide rempart d'une ville. Vous ajoutez que l'on nous a comblés de remercîments et d'éloges. Je m'en félicite, sans que la vanité y ait part. Xénophon l'a dit : « La louange flatte délicieusement les oreilles, surtout quand on croit la mériter. » Adieu.
XXXIII. — Pline à Tacite.
J'ai le pressentiment (et je ne me trompe pas), que vos histoires seront immortelles. C'est, je l'avoue ingénument, ce qui m'inspire un désir plus ardent d'y trouver une place. Si nous aimons que notre portrait soit tracé de la main du plus habile artiste, ne devons-nous pas aussi souhaiter que nos actions trouvent un historien et un panégyriste tel que vous? Je vous signale donc un fait qui ne peut échapper à votre attention, puisqu'il est dans les registres publics. Je vous la signale néanmoins : tant il me sera agréable qu'une action, dont le péril a doublé l'intérêt, reçoive de votre témoignage un nouveau lustre!
Le sénat nous avait donnés, Hérennius Sénécion et moi, pour avocats à la province de Bétique, contre Bébius Massa. Il fut condamné, et ses biens furent placés sous la surveillance publique. Peu après, Sénécion apprit que les consuls devaient donner audience sur les requêtes qui leur étaient présentées. Il vint me trouver. Puisque nous avons été si parfaitement d'accord, dit-il, en soutenant ensemble l'accusation dont nous étions chargés, allons du même pas nous présenter aux consuls, et demandons que ceux auxquels on a confié la garde des biens ne souffrent pas qu'on les dissipe. Faites attention, lui répondis-je, que nous avons été nommés avocats par le sénat, qu'il a prononcé, et que, par son jugement, toute la mesure de notre obligation parait remplie. -Vous pouvez, reprit-il, donner à vos devoirs telles bornes qu'il vous plaira, vous qui n'avez aucune autre liaison avec cette province que par le service que vous venez de lui rendre. Je ne puis en faire autant, moi qu'elle a vu naître, moi qu'elle a vu questeur. — Si votre résolution est ferme et inébranlable, lui répliquai-je, je vous seconderai, pour que les conséquences, s'il y en a de fâcheuses, ne pèsent pas sur vous seul. Nous nous adressâmes aux consuls. Sénécion dit ce qui convenait. J'ajoutai peu de mots. A peine avions-nous cessé de parler, Massa se plaignit que Sénécion ne remplissait plus le ministère d'un avocat, mais qu'il faisait éclater toute la fureur d'un ennemi et en même temps il l'accusa d'impiété. Cet excès indigna tout le monde. Alors je repris la parole : Illustres consuls, dis-je, j'ai à craindre que Massa, en ne m'accusant pas aussi, ne me rende, par son silence, suspect de prévarication. Ces paroles, recueillies aussitôt, furent bientôt après dans la bouche de tout le monde. Nerva, encore homme privé, mais déjà attentif à ce qui se faisait de bien dans le public, m'écrivit à ce sujet une lettre fort honorable. Il me félicitait, il félicitait aussi mon siècle d'un trait qui, disait-il, rappelait les vertus antiques. Voilà les faits, et, quels qu'ils soient, votre plume en rehaussera l'éclat, la renommée, la grandeur. Je ne vous demande point cependant d'en exagérer l'importance : car l'histoire ne doit pas sortir des bornes de la vérité, et la vérité honore assez les belles actions. Adieu.
LIVRE HUITIEME. Retour
I. — Pline à Septicius.
Mon voyage a été assez heureux. Cependant la santé de quelques-uns de mes esclaves a souffert de l'extrême chaleur. Encolpius, mon lecteur, qui m'est si précieux pour mes occupations comme pour mes délassements, a eu la gorge irritée par la poussière, et a craché le sang. Quel accident fâcheux pour lui et cruel pour moi, s'il faut qu'il devienne inhabile à exercer l'art qui fait tout son mérite ! Où trouverai-je, après lui, quelqu'un qui .lise si bien mes ouvrages, qui les aime autant, et que j'aie autant de plaisir à entendre? Mais, grâce aux dieux, j'ai meilleur espoir. Le crachement de sang a cessé ; la douleur s'est calmée. D'ailleurs il est sobre, je suis attentif, et les médecins sont pleins de zèle. Je puis ajouter que la pureté de l'air, la retraite, le repos lui promettent autant de santé qu'il aura de loisir. Adieu.
II. — Pline à Calvisius.
D'autres vont à leurs terres pour en revenir plus riches ; moi, je vais aux miennes pour en revenir plus pauvre. J'avais vendu mes vendanges à des marchands qui avaient enchéri à l'envi, déterminés par le prix auquel on l'offrait et par celui qu'ils espéraient en obtenir. Leur attente a été trompée. J'aurais pu sur-le-champ leur faire à tous une égale remise mais ce n'était pas assez pour la justice. Je ne trouve pas moins glorieux de la rendre dans ma maison qu'au tribunal, dans les petites affaires que dans les grandes, dans les miennes que dans celles d'autrui. Car si l'on prétend que toutes les fautes sont égales, il faudra dire que toutes les bonnes actions le sont aussi. Je leur ai donc remis à tous la huitième partie du prix dont nous étions convenus, afin qu'il n'y en eût aucun qui n'emportât des marques de ma libéralité. Après cela, j'ai eu des égards particuliers pour ceux qui avaient placé en achats les plus grosses sommes. Leurs acquisitions avaient été plus utiles pour moi et plus onéreuses pour eux. Outre la remise commune du huitième, je leur ai fait encore celle d'un dixième de tout ce qu'ils étaient obligés de payer au delà de dix mille sesterces Je ne sais si je m'explique assez : je vais rendre ce calcul plus sensible. Celui qui avait acheté pour quinze mille sesterces, je lui remettais, outre son huitième de cette somme, la dixième partie de cinq mille sesterces. J'ai considéré d'ailleurs que, sur leur marché, les uns avaient plus payé, les autres moins, quelques-uns rien et je n'ai pas cru raisonnable de traiter avec une égale bonté, dans la remise, ceux qui ne m'avaient pas traité avec une égale exactitude dans le paiement. J'ai donc encore remis à ceux qui m'avaient avancé leurs deniers le dixième de ce qu'ils m'avaient avancé. Par là je crois avoir trouvé le moyen de satisfaire, pour le passé, à ce que chacun, selon son mérite, pouvait attendre de moi, et de les décider tous davantage, pour l'avenir, soit à acheter, soit à payer.
Cette facilité, ou, si vous voulez, cette équité, me coûte cher ; mais elle vaut bien ce qu'elle me coûte. On ne parle, dans tout le pays, que de la nouveauté de cette remise, et de la manière dont elle a été faite : tout le inonde la loue. Dans ceux mêmes que je n'avais pas appréciés, comme l'on dit, à la même mesure mais avec la distinction et la proportion convenables, je trouve d'autant plus de reconnaissance, qu'il y a plus de vertu et de probité : ils me savent gré d'avoir témoigné que, chez moi,
Le lâche et le vaillant n'ont point le même honneur.
III. — Pline à Sparsus.
Vous me mandez que, de tous mes ouvrages, le dernier que je vous ai envoyé est le meilleur, à votre avis. C'est aussi l'opinion d'une autre personne très éclairée. J'en ai d'autant plus de penchant à croire que vous ne vous trompez ni l'un ni l'autre, soit parce qu'il n'est pas vraisemblable que vous vous trompiez tous deux, soit parce que j'aime à me flatter. Je veux toujours que mon dernier ouvrage soit le meilleur. C'est par cette raison que je me déclare aujourd'hui contre celui que vous possédez déjà, en faveur d'un discours que je viens de donner au public, et que je ne manquerai pas devons communiquer, dès que j'aurai trouvé un messager diligent. Je vous ai promis beaucoup, et je crains bien que, lorsque vous lirez mon discours, il ne réponde pas à votre attente. Cependant attendez-le comme s'il devait vous plaire : peut-être vous plaira-t-il. Adieu.
IV. — Pline à Caninius.
C'est un fort beau sujet que la guerre contre les Daces. Vous n'en pouviez trouver un plus nouveau, plus riche, plus étendu, plus poétique, et où l'exacte vérité ressemblât davantage à la fable. Vous peindrez les nouveaux fleuves s'élançant à travers les campagnes, les nouveaux ponts jetés sur les fleures, les camps suspendus à la cime des monts, un roi, toujours plein de confiance , chassé de son palais, et réduit à se donner la mort. Vous nous représenterez deux triomphes, dont l'un a été le premier que l'on eût remporté sur une nation jusque là invincible, l'autre sera le dernier. Il n'y a qu'une difficulté mais elle est très grande, c'est d'égaler votre style à ces exploits. C'est un effort immense, même pour votre génie qui sait si bien s'élever et s'agrandir avec le sujet qu'il embrasse. Ce ne sera pas encore une chose facile que de faire entrer dans des vers grecs, sans en détruire l'harmonie, des noms durs et barbares, surtout celui du roi. Mais il n'est point d'obstacle que le travail et l'art ne parviennent à surmonter, ou du moins à affaiblir. D'ailleurs, si l'on permet à Homère, pour rendre les vers plus coulants, d'abréger, d'étendre, de modifier des mots grecs, naturellement si doux, pourquoi vous interdirait-on une pareille licence, quand ce n'est plus seulement le plaisir de l'oreille, mais la nécessité qui la réclame ? Ainsi donc, lorsque, suivant le droit des poètes, vous aurez invoqué les dieux, sans oublier celui dont vous allez nous raconter les desseins, les exploits, les succès, lâchez les câbles, déployez les voiles, et donnez plus que jamais l'essor à votre génie, Car pourquoi ne prendrais-je pas aussi le style poétique avec un poète ?
Toute la grâce que je vous demande aujourd'hui, c'est que vous m'envoyiez les premiers essais de votre ouvrage, à mesure qu'ils seront achevés, ou plutôt avant qu'ils le soient, dès qu'ils auront reçu leur première forme, et qu'ils ne seront encore qu'ébauchés. Vous me direz qu'il n'est pas possible que les morceaux détachés aient l'agrément d'une pièce suivie, ni l'ouvrage commencé les grâces d'un ouvrage fini. Je le sais ; je les regarderai donc comme des ébauches, comme des fragments qui attendront leur dernière perfection dans mon portefeuille. A tant de témoignages de votre amitié, daignez en ajouter un nouveau, en me confiant ce que vous ne voudriez confier à personne. En un mot, il est possible que, plus vous mettrez de lenteur et de réserve à m'envoyer vos écrits plus je les aime et plus je les loue. Mais, plus vous y mettrez de promptitude et de confiance, plus vous obtiendrez pour vous-même mes éloges et mon amitié. Adieu.
V. — Pline à Géminius.
Notre cher Macrinus vient d'être frappé d'un coup bien cruel : il a perdu sa femme dont la vertu eût été admirée même parmi les anciens. Leur union a duré trente-neuf ans, sans trouble et sans nuage. Quel respect n'avait-elle pas pour son mari, elle qui était si digne d'être respectée! Que de vertus éminentes, propres aux différents âges, se réunissaient et s'associaient en elle ! Sans doute c'est une grande consolation pour Macrinus, d'avoir si longtemps possédé un tel trésor mais il n'en ressent que plus vivement la douleur de l'avoir perdu : car, plus la possession a de charmes, plus la perte coûte de regrets. Je serai donc inquiet pour un homme que j'aime tant, jusqu'à ce qu'il puisse trouver quelque distraction à sa peine, et que sa blessure soit cicatrisée. C'est ce qu'il faut attendre surtout de la nécessité, du temps et de l'épuisement de la douleur. Adieu.
VI. — Pline à Montanus.
Ma dernière lettre doit vous avoir appris que j'ai remarqué dernièrement une inscription sur le tombeau de Pallas, conçue en ces termes : Pour récompenser son attachement et sa fidélité envers ses maîtres, le sénat lui a décerné les marques de distinction réservées aux préteurs, et le don de quinze millions de sesterces. Et il s'est contenté de la distinction honorifique. Cela m'inspira l'idée de rechercher le décret même qui devait être fort curieux. Je l'ai découvert et Pallas y est si honorablement traité, que cette fastueuse épitaphe est, en comparaison, des plus modestes et des plus humbles. Que nos illustres Romains (je ne parle pas de ceux des siècles éloignés, des Africains, des Numantins, des Achaïques), mais que ceux des derniers temps, les Marius, les Sylla, les Pompée (je ne veux pas pousser les citations plus loin), viennent se comparer à Pallas : leur gloire pâlira auprès de la sienne.
Faut-il attribuer ce décret à la plaisanterie ou au malheur? Je serais du premier avis, si la plaisanterie convenait au sénat. Il faut donc s'en prendre au malheur. Mais est-il un malheur assez terrible pour réduire à une telle indignité? C'était peut-être ambition et désir de s'avancer? Mais serait-il possible qu'il y eût quelqu'un assez fou pour vouloir s'avancer aux dépens de son propre honneur et de celui de la république, dans une ville où l'avantage du poète le plus élevé était de pouvoir donner, comme sénateur, les premières louanges à Pallas?
Qu'on offre les prérogatives de la préture à Pallas, à un esclave ; je n'en dis rien : ce sont des esclaves qui les offrent. Je ne relève point l'avis émis par eux, que l'on ne doit pas seulement exhorter, mais même forcer Pallas à porter des anneaux d'or. Il eût été contre la majesté du sénat qu'un homme revêtu des ornements de préteur eût porté des anneaux de fer. Ce ne sont là que des bagatelles qui ne méritent pas que l'on s'y arrête. Voici des faits bien plus dignes d'attention : Les sénateurs, au nom de Pallas (et la curie n'a pas encore été purifiée!), les sénateurs, au nom de Pall as, remercient l'empereur d'avoir parlé de son affranchi en termes si honorables, et de leur avoir permis de lui témoigner aussi leur bienveillance. En effet, que pouvait-il arriver de plus glorieux au sénat, que de ne paraître pas ingrat envers Pallas? On ajoute dans ce décret : Qu'afin que Pallas, à qui chacun en particulier reconnaît avoir les plus grandes obligations, puisse recevoir les justes récompenses de ses glorieux travaux et de sa rare fidélité.... Ne croiriez-vous pas qu'il a reculé les frontières de l'empire, ou sauvé les armées de l'État ? On continue.... Le sénat et le peuple romain ne pouvant trouver une plus agréable occasion d'exercer leurs libéralités qu'en augmentant la fortune du gardien le plus fidèle et l e plus désintéressé des finances du prince.... V oilà où se bornaient alors tous les désirs du sénat et toute la joie du peuple ; voilà l'occasion la plus précieuse d'ouvrir le trésor public : il faut l'épuiser pour enrichir Pallas. Écoutez ce qui suit : Que le sénat ordonnait qu'on tirerait de l'épargne quinze millions de sesterces pour les donner à Pallas et que, moins son âme était accessible au désir des richesses, plus il fallait, redoubler ses instances auprès du père commun pour en obtenir qu'il obligeât Pallas de déférer au v œu du sénat. Il ne manquait plus, en effet, que de traiter, au nom du public, avec Pallas, que de le supplier de céder aux empressements du sénat, que d'interposer la médiation de l'empereur pour surmonter cette insolente modération, et pour faire en sorte que Pallas ne dédaignât pas quinze millions de sesterces. Il les dédaigna pourtant. Refuser de si grandes richesses offertes par l'État, c'était le seul parti qui lui restait pour montrer plus d'orgueil qu'à les accepter. Le sénat cependant semble se plaindre de ce refus, et le comble en même temps d'éloges en ces termes : Mais l'empereur et le père commun ayant voulu, à la prière de Pallas, que le sénat lui remît l'obligation de satisfaire à cette partie du décret qui lui ordonnait de recevoir du trésor public quinze millions de sesterces, le sénat déclare, que c'est avec plaisir et avec justice, qu'entre les honneurs qu'il avait commencé de décerner à Pallas, il avait mêlé le don de cette somme pour reconnaître son zèle et sa fidélité que cependant le sénat se conformerait encore en cette occasion à la volonté du prince, qui doit être toujours respectée.
Imaginez-vous Pallas qui s'oppose à un décret du sénat, qui modère lui-même ses propres honneurs, qui refuse quinze millions de sesterces, comme si c'était trop, et qui accepte les marques de la dignité de préteur, comme si c'était moins. Représentez-vous l'empereur qui, à la face du sénat, obéit aux prières, ou plutôt aux ordres de son affranchi : car un affranchi qui, dans le sénat, prie son patron, lui commande en effet. Figurez-vous le sénat qui déclare partout qu'il a commencé, avec autant de plaisir que de justice, à décerner cette somme et de tels honneurs à Pallas et qu'il persisterait encore, s'il n'était obligé de se soumettre aux volontés du prince qu'il n'est permis de contredire en rien. Ainsi, pour ne point forcer Pallas de prendre quinze millions de sesterces dans le trésor public, on a eu besoin de sa retenue et de la soumission du sénat, qui n'aurait pas obéi, s'il lui eût été permis de résister en rien aux volontés de l'empereur.
Vous croyez être à la fin ; attendez et écoutez le plus beau : Dans tous les cas, comme il est utile de faire connaître partout les insignes faveurs dont le prince a honoré et récompensé ceux qui le mentaient, et particulièrement dans les lieux où l' on peut engager à l'imitation les personnes chargées du soin de ses affaires et que l'éclatante fidélité et la probité de Pallas sont les modèles les plus propres à exciter une noble émulation, il a été résolu que le discours prononcé dans le sénat par l'empereur, le vingt-huit janvier dernier, et le décret du sénat à ce sujet, seraient gravés sur une table d'airain qui sera appliquée près de la statue représentant Jules César en habit de guerre.
Il ne suffisait pas que le sénat eût été témoin de ces honteuses bassesses, on a choisi le lieu le plus fréquenté pour les exposer aux yeux de notre siècle et des siècles futurs. On a pris soin de consigner sur l'airain tous les honneurs d'un dédaigneux esclave, ceux même qu'il avait refusés, mais qu'il avait possédés cependant, autant qu'il dépendait de la volonté des auteurs du décret. On a gravé sur les monuments publics, pour en conserver à jamais la mémoire, qu'on avait déféré à Pallas les marques de distinction réservées aux prêteurs, comme on y gravait autrefois les anciens traités d'alliance, les lois sacrées. L'empereur, le sénat, Pallas lui-même ont eu assez de.... (je ne sais quel mot employer), pour vouloir qu'on étalât à tous les yeux l'insolence de Pallas, la faiblesse de l'empereur et l'avilissement du sénat. Eh ! quoi, le sénat n'a pas eu honte de chercher des prétextes à son infamie ? La belle, l'admirable raison, que l'envie d'exciter une noble émulation dans les esprits par l'exemple des récompenses dont était comblé Pallas ! Voyez par là dans quel mépris tombaient les honneurs, je dis ceux même que Pallas ne refusait pas. On trouvait pourtant, des hommes d'une naissance distinguée qui demandaient, qui convoitaient ce qu'ils voyaient accorder à un affranchi et promettre à des esclaves. Que j'ai de joie de n'être point né dans ces temps qui me font rougir, comme si j'y avais vécu ! Je ne doute point que vous ne pensiez de même. Je connais votre délicatesse, votre grandeur d'âme. Je suis donc persuadé que, malgré quelques endroits où l'indignation m'a emporté au delà des justes bornes d'une lettre, vous aurez plus de penchant à croire que je ne me plains pas assez, qu'à penser que je me plains trop. Adieu.

VII. - Pline à Tacite.
Ce n'est point comme de maître à maître, ni comme de disciple à disciple, ainsi que vous me le mandez, mais comme de maître à disciple, que vous m'avez envoyé votre livre : car vous êtes le maître et moi l'élève aussi me rappelez-vous à l'école, moi qui prolonge encore les Saturnales. Je ne pouvais vous faire un compliment plus embarrassé, et vous mieux prouver par là, que loin de passer pour votre maître, je ne mérite pas même le nom de votre disciple. Toutefois je vais essayer le rôle de maître, et j'exercerai sur votre livre le droit que vous m'avez donné. J'en userai d'autant plus librement, que je ne vous enverrai pendant ce temps rien sur quoi vous puissiez vous venger. Adieu.

VIII. - Pline à Romanus.
N'avez-vous jamais vu la source du Clitumne? Je ne le crois, car vous m'en auriez parlé. Voyez-la donc. Je viens de la visiter, et je regrette d'y avoir songé si tard. Du pied d'une petite colline, couronnée d'un bois touffu d'antiques cyprès, jaillit une fontaine dont les eaux se font jour par plusieurs veines inégales, et forment ensuite un large bassin, si pur et si limpide, que l'on peut compter les pièces de monnaie qu'on y jette, et les cailloux qu'on y voit reluire. De là elle se précipite, moins par la pente qu'elle trouve, que par sa propre abondance et par son propre poids. A peine est-elle sortie de sa source, qu'elle devient un grand fleuve navigable, et où se rencontrent sans obstacles les bateaux qui montent et ceux qui descendent. Ses eaux sont si fortes, que la rame est inutile, en suivant la pente, quoiqu'elle soit presque insensible, et qu'on lutte difficilement contre le courant avec les rames et les avirons. Ceux qui naviguent par amusement se plaisent, selon leur direction, à faire succéder le repos au travail, et le travail au repos. Les rives sont bordées de frênes et de peupliers qui réfléchissent si clairement leur verdoyante image au fond du canal, qu'on peut les y compter. Ses eaux, froides comme la neige, en ont aussi la blancheur.
Près de là est un temple antique et respecté. Le Clitumne lui-même y paraît couvert et orné de la prétexte. C'est un dieu secourable qui dévoile l'avenir et qui rend des oracles. Le temple est environné de chapelles : chacune a son dieu, son culte et son nom particulier. Quelques-unes même ont leurs fontaines : car, outre la principale, qui est comme la mère des autres, il s'en trouve encore plusieurs dont la source est différente, mais qui se perdent dans le fleuve. On le passe sur un pont qui sépare les lieux sacrés des lieux profanes. Au-dessus du pont, il n'est permis que de naviguer ; au-dessous, on peut se baigner. Les Hispellates, auxquels Auguste a concédé ce lieu, offrent gratuitement le bain ¦et l'hospitalité. Les deux rives sont parsemées de maisons de campagne où l'on jouit de la beauté du fleuve. Tout vous charmera dans ce lieu. Vous pourriez même vous y occuper à lire les nombreuses inscriptions tracées sur toutes les colonnes et sur tous les murs en l'honneur de la source et du dieu qui y préside. Vous en louerez plusieurs, vous rirez de quelques autres ou plutôt, je connais votre bonté, vous ne rirez d'aucune. Adieu.
IX. — Pline à Ursus.
Depuis longtemps je n'ai rien lu, je n'ai rien écrit. Depuis longtemps je ne connais plus le loisir, ni enfin le bonheur de ne rien faire, de n'être rien, état d'inertie qui a pourtant son charme. La multitude d'affaires dont je suis chargé pour mes amis m'éloigne de la retraite et de l'étude : car il n'y a point d'étude, quelque précieuse qu'elle soit, qu'on ne doive sacrifier aux devoirs de l'amitié que les belles-lettres elles-mêmes enseignent à compter au nombre des plus sacrés. Adieu.
X. — Pline à Fabatus.
Plus vous désirez que nous vous donnions des arrière-petite-fils, plus vous aurez de chagrin d'apprendre que votre petite-fille a fait une fausse couche. Ignorante, comme toutes les jeunes femmes, elle ne se doutait pas qu'elle fût enceinte. Aussi a-t-elle négligé les précautions qu'exigeait son état, et s'est-elle permis ce qu'il lui défendait. C'est une faute qu'elle a bien expiée par son accident, et qui l'a exposée au plus grand danger. Si vous devez donc vous affliger de voir votre vieillesse frustrée d'une postérité dont elle semblait déjà jouir, vous devez aussi rendre grâces aux dieux de ce qu'en vous ôtant aujourd'hui des arrière-petits-fils, |ils paraissent vouloir vous en donner d'autres en vous conservant une petite-fille. C'est une espérance qui me paraît d'autant mieux fondée, que cette couche, toute malheureuse qu'elle est, est un gage de fécondité. Je vous donne en ce moment les mêmes consolations dont je me sers pour me fortifier et me soutenir moi-même. Vous ne souhaitez pas des arrière-petits-fils avec plus d'ardeur que je ne désire des enfants. Je me flatte que, soit de votre côté, soit du mien, ils trouveront une route facile aux honneurs. Les noms qui les attendent ne sont point inconnus, et leur noblesse ne sera point l'ouvrage d'un caprice soudain de la fortune. Puissent-ils naître seulement, et changer ainsi notre tristesse en joie ! Adieu.
XI. — Pline à Hispulla.
Quand je songe à la tendresse que vous avez pour votre nièce, et qui surpasse même celle d'une mère pour sa fille, je sens qu'il faut vous écrire l'état où nous sommes, avant de vous mander cei lui où nous avons été, afin qu'une joie anticipée ne laisse plus de place au chagrin. Je tremble même encore que vous ne reveniez de la joie à la crainte, et qu'en vous félicitant de savoir votre nièce hors de danger, vous ne frémissiez au récit de celui qu'elle a couru. Enfin sa gaieté renaît, enfin, rendue à elle-même et à moi, elle reprend ses forces, et revient à la vie en remontant la route qui l'en avait éloignée. Elle a couru le plus grand danger, et, il faut le dire, ce n'est point sa faute, c'est celle de son âge. De là viennent et sa fausse couche et les tristes suites d'une grossesse, ignorée. Ainsi, quoique vous ne puissiez pas vous consoler de la perte de votre frère par la naissance d'un petit neveu ou d'une petite-nièce, souvenez-vous que c'est, un bien qui n'est que différé, et non pas perdu, puisque la personne dont nous avons le droit d'en attendre nous reste encore. Excusez donc, auprès de votre père, un malheur que les femmes, sont toujours prêtes à pardonner. Adieu.
XII. - Pline à Minutien.
Je vous prie de m'excuser, pour aujourd'hui seulement. Titinius Capito lit en public un de ses ouvrages. J'irai l'entendre, par devoir peut-être autant que par plaisir. C'est un homme vertueux, et qu'on doit regarder comme un des principaux ornements du siècle. Il cultive les lettres; il aime les littérateurs, il les protége, il les élève; il est l'asile, la ressource, le bienfaiteur de la plupart de nos écrivains et l'exemple de tous ; enfin il est l'appui, le restaurateur des lettres dans leur décadence. II prête sa maison à ceux qui ont une lecture à faire. Personne n'écoute avec une plus merveilleuse complaisance ceux qui lisent soit chez lui, soit ailleurs. Tant qu'il s'est trouvé à Rome, il est toujours venu m'entendre.
Il serait donc d'autant plus honteux d'être ingrat, qu'il s'offre une occasion plus honorable de montrer sa reconnaissance.
Quoi ! si j'avais un procès, je me croirais redevable à ceux qui m'accompagneraient à l'audience ; et aujourd'hui que je fais mon unique affaire des belles-lettres, que j'y consacre tous mes soins, je croirais devoir moins à un homme qui s'en occupe avec tant de zèle, et qui me rend les Services auxquels je tiens uniquement !
D'ailleurs, quand je ne lui devrais aucun retour en égards et en bons offices, ce serait encore, pour aller l'entendre, un puissant attrait que son génie si beau, si puissant, si doux dans son austérité, et que la noblesse du sujet qu'il a choisi. Il écrit la mort d'hommes illustres dont plusieurs m'ont été bien chers. C'est donc, en quelque sorte, m'acquitter d'un pieux devoir, que d'assister aux éloges funèbres de ceux dont il ne m'a pas été permis d'honorer les obsèques; éloges un peu tardifs, mais qui n'en sont que plus sincères ! Adieu.
XIII. - Pline à Génialis.
Vous avez bien fait de lire mes ouvrages avec votre père. Vous ne pouvez manquer de profiter beaucoup en apprenant d'un personnage si éclairé ce qu'il faut louer, ce qu'il faut reprendre. Formé par ses leçons, vous vous accoutumerez aussi à dire la vérité. Vous avez sous les yeux celui dont vous devez suivre fidèlement la trace. Que vous êtes heureux de trouver un vivant modèle dans l'objet de vos plus tendres affections, et d'avoir à imiter homme auquel la nature vous a fait si semblable ! Adieu.
XIV. - Pline à Ariston.
Comme vous n'êtes pas moins versé dans la connaissance du droit public, dont le droit des sénateurs fait partie, que dans celle du droit privé, je désire apprendre de vous si dernièrement je n'ai pas commis une erreur dans le sénat. Il sera trop tard pour la réparer; mais je saurai à l'avenir ce que je dois faire, s'il se présente quelque chose de semblable.
Vous me direz : Pourquoi demander ce que vous deviez savoir La servitude des derniers temps a fait oublier les droits du sénat aussi bien que les autres sciences utiles, et nous a plongés dans l'ignorance. Est-il un homme assez patient pour vouloir apprendre ce qui ne lui doit être d'aucun usage ? D'ailleurs, comment retenir ce qu'on apprend, si on ne le pratique jamais quand on l'a appris? Quand la liberté revint, elle nous trouva donc novices et inexpérimentés, et l'impatience de goûter les douceurs qu'elle offre nous force d'agir avant de connaître.
Les anciennes règles voulaient que nous vissions faire, que nous entendissions dire à ceux qui nous devançaient en âge, ce que bientôt nous-mêmes nous avions à faire et à dire, et ce que nous devions, à notre tour, transmettre à ceux qui viendraient après nous. De là cette coutume d'engager les jeunes gens à servir dans l'armée, dès leur plus tendre jeunesse, afin qu'en obéissant ils apprissent à commander, et qu'en suivant les autres ils se rendissent capables de marcher à leur tête. De là vient que ceux qui songeaient à s'élever aux charges demeuraient debout à la porte du sénat, obligés d'être spectateurs avant d'être acteurs dans le conseil public. Chacun avait son père pour maître; et celui qui n'avait point de père en trouvait un dans le plus illustre et le plus ancien des sénateurs. C'est ainsi qu'ils apprenaient par l'exemple, le plus sûr de tous les guides, quel était le pouvoir de celui qui proposait, le droit de celui qui opinait; l'autorité de chaque magistrat, la liberté de tous les autres citoyens; quand il fallait céder ou résister, quand on devait se taire, et comment on devait parler; comment se faisait la distinction des avis contraires: comment il était permis d'ajouter quelque chose à ce qu'on avait déjà dit ; en un mot, l'ordre qu'on devait observer au sénat.
Pour nous, il est vrai que nous avons servi dans les camps pendant notre jeunesse; mais alors la vertu était suspecte, le vice honoré; alors nulle autorité dans les chefs, nulle retenue dans les soldats ; alors on ne connaissait ni commandement, ni obéissance; la licence, le désordre régnaient partout ; on ne voyait rien qui ne fût bouleversé, rien enfin qui ne méritàt plutôt d'être oublié que d'être retenu. Alors, nous en fûmes témoins, le sénat était tremblant et muet: on ne pouvait, sans péril, y exprimer ce qu'on pensait, et sans infamie, ce qu'on ne pensait pas. Quelle instruction, quelles leçons utiles pouvait-on recevoir dans un temps où l'on n'assemblait le sénat que pour n'y rien faire, ou pour décider quelque grand crime; dans un temps où on ne le convoquait que pour se jouer de lui ou pour le contrister ; où les délibérations n'avaient jamais rien de sérieux, et où les résolutions étaient souvent funestes? Nous avons vu les mêmes maux se perpétuer durant plusieurs années, depuis que, devenus sénateurs, nous en avons pris et ressenti si cruellement notre part de douleur, que nos esprits en ont été abattus, consternés, anéantis. il n'y a que fort peu de temps (car plus les temps sont heureux, plus ils sont courts) qu'il nous est permis de savoir, qu'il nous est permis d'être ce que nous sommes.
J'ai donc le droit de vous prier d'abord d'excuser mon erreur, si j'en ai commis une ; ensuite, de m'éclairer par votre savoir. Je sais qu'il embrasse le droit public et le droit privé, l'histoire ancienne et l'histoire moderne, les faits les plus rares et les plus communs. Le cas que je vous soumets est même si extraordinaire, à mon gré, que les hommes auxquels l'usage et l'expérience des affaires ne laissent rien ignorer, pourraient bien, ou n'en être pas instruits, ou ne l'être pas assez. Nous en serons d'autant plus dignes, moi de pardon, si je me suis trompé, et vous de louanges, si vous pouvez enseigner ce que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'apprendre.
Le sénat traitait l'affaire des affranchis du consul Afranius Dexter. On l'a trouvé tué chez lui, et l'on ignore s'il a été tué de sa main ou de la main des siens, par leur crime ou par leur obéissance. L'un de nous (voulez-vous savoir qui? c'est moi; mais qu'importe?) a été d'avis qu'après avoir souffert la question, ils fussent renvoyés absous; l'autre, qu'il fallait les reléguer dans une île ; un troisième, qu'ils devaient être punis de mort. Ces avis étaient si opposés, qu'il n'était pas possible de les concilier entre eux : car que peuvent avoir de commun la mort et le bannissement? rien de plus, sans doute, que le bannissement et l'absolution. Encore la proposition d'absoudre se rapproche-t-elle un peu plus de celle du bannissement, que la proposition de condamner à mort car les deux premiers s'accordent à laisser vivre, et le dernier prive de la vie. Cependant ceux qui opinaient à la mort et ceux qui opinaient au bannissement, suspendant pour quelques instants leur désaccord, feignirent de s'entendre, et se rangèrent du même côté. Je soutenais que chacun des trois avis devait être séparément compté, qu'on né devait point souffrir que deux des trois s'unissent à la faveur d'une trêve de quelques moments. Je prétendais donc que ceux dont les voix condamnaient à mort fussent séparés de ceux qui se contentaient de bannir, et que, tout prêts à se contredire, ils ne formassent pas un même parti contre ceux qui voulaient absoudre, parce qu'au fond il importait peu qu'ils rejetassent tous l'absolution, s'ils n'admettaient pas tous la même condamnation. Je trouvais fort étrange que celui qui avait opiné à punir de mort les esclaves et à reléguer les affranchis, fût obligé de diviser son opinion en deux parties, et que cependant on réunit, dans un même avis, celui qui voulait que les affranchis fussent relégués et celui qui voulait qu'on les fit mourir. S'il fallait diviser l'avis d'une même personne, parce qu'il renfermait deux choses, je ne concevais pas comment on pouvait unir les avis de deux personnes qui, sur la même chose, pensaient d'une manière si contraire. Permettez-moi donc, je vous supplie, aujourd'hul que l'affaire est décidée, de vous rendre raison de mon sentiment, comme si elle était encore indécise ; permettez-moi de vous exposer avec ordre et à loisir ce que je fus obligé de dire alors au milieu de mille interruptions.
Supposons que l'on eùt nommé seulement trois juges pour prononcer sur cette affaire; que l'un deux e^tt été d'avis de condamner les affranchis au dernier supplice; l'autre, de les reléguer; le troisième, de les absoudre. Les deux premières opinions, réunissant leurs forces, l'emporteront-elles sur la dernière? ou plutôt chacune des trois ne vaudra-t-elle pas séparément autant que l'autre, sans que l'on puisse joindre plutôt la première à la seconde, que la seconde à la dernière? Il faut donc de même, dans le sénat, compter comme contraires les avis que l'on y a donnés comme différents. Si un seul et même homme opinait tout à la fois au bannissement et à la mort, pourrait-on, selon cet avis, les bannir et leur ôter la vie? enfin, regarderait-on comme une seule opinion celle qui rassemblerait des choses si incompatibles? Comment donc est-il possible qu'on regarde comme un seul avis les avis de deux personnes, dont l'une veut que les affranchis perdent la vie, l'autre qu'ils soient exilés, lorsqu'il faudrait les regarder comme deux avis différents, s'ils étaient proposés par une seule personne?
La loi ne nous enseigne-t-elle pas clairement qu'il faut distinguer l'avis du bannissement de celui de la mort, lorsqu'elle veut que, pour recueillir les voix, on se serve de ces termes : Vous qui êtes d'une telle opinion, passez de ce côté; vous qui êtes d'une opinion toute différente, rangez-vous du côté opposé avec ceux dont vous approuvez l'avis? Examinez et pesez chaque mot : Vous qui êtes d'un tel avis, c'est-à-dire, vous qui pensez qu'on doit reléguer les affranchis, passez de ce côté-là, c'est-à-dire du côté où est assis l'auteur de cet avis. D'où il résulte évidemment que ceux qui opinent à la mort ne peuvent pas demeurer du même côté. Vous qui êtes de tout autre avis, vous voyez que la loi ne s'est pas contentée de dire d'un autre, mais de tout autre. Or, peut-on douter que celui qui ne veut que reléguer est de tout autre avis que celui qui veut que l'on fasse mourir ? Rangez-vous du côté opposé avec ceux dont vous approuvez l'avis. La loi ne semble-t-elle pas elle-même appeler, pousser, entrainer de différents côtés ceux qui sont d'avis différents ? Le consul n'indique-t-il pas, non seulement par une formule authentique, mais du geste et de la main, la place où chacun doit rester ou passer ? Mais, dit-on, si l'on sépare les voix pour le bannissement, des voix pour le dernier supplice, il arrivera que l'opinion qui absout prévaudra. Qu'importe pour les opinants ? certainement il leur siérait mal de mettre tout en usage pour s'opposer au triomphe de l'opinion la plus douce. Il faut pourtant, ajoute-t-on, que ceux qui condamnent à la peine capitale, et ceux qui bannissent, soient d'abord comparés ensemble avec ceux qui veulent absoudre, et qu'ensuite on les compare eux-mêmes entre eux. Il en est comme de certains pectacles où le sort sépare et réserve quelqu'un qui doit combattre contre le vainqueur. Il y a dans le sénat un premier combat, puis un second ; et l'avis qui l'emporte sur un autre doit encore soutenir les efforts d'un troisième qui l'attend. Mais que dis-je?
Lorsqu'un avis a prévalu, tous les autres ne tombent-ils pas d'eux-mêmes?
Le moyen donc de réunir dans un seul avis deux avis qui ne doivent être comptés pour rien? Je m'explique plus clairement.
Si celui qui opine à la mort ne se sépare de celui qui opine au banissement, au moment même où celui-ci donne son avis, c'est vainement qu'il voudra ensuite qu'on distingue son sentiment de celui du parti auquel il s'est naguère associé.
Mais j'ai bonne grâce de m'ériger ici en maître, moi qui ne désire que d'apprendre. Dites-moi donc s'il fallait partager ces opinions, de sorte qu'elles n'en fissent que deux, ou s'il fallait les compter comme trois opinions différentes. J'ai obtenu ce que je demandais; mais je voudrais savoir si j'ai eu raison ou non de le demander. Et comment l'ai-je obtenu ? Celui qui proposait le dernier supplice, vaincu par mes raisons, a renoncé à son premier avis (j'ignore s'il en avait le droit), et s'est réuni à ceux qui demandaient le bannissement, dans la crainte que, si l'on divisait les trois opinions, ce qui paraissait inévitable, celle de l'absolution ne vint à l'emporter: car il y avait bien plus de suffrages pour cet avis que pour chacun des deux autres séparément. Alors tous ceux qui, entraînés par son autorité, s'étaient attachés à son opiion, voyant qu'il les abandonnait, quittèrent un avis auquel son auteur renonçait lui-même, et suivirent comme transfuge celui qu'ils suivaient auparavant comme chef. Ainsi les trois avis ont été réduits à deux; et de ces deux, l'un a prévalu ; le troisième, qui a été rejeté, n'ayant pu forcer les deux premiers à lui céder, a choisi du moins celui des deux auquel il céderait lui-même. Adieu.
XV. - Pline à Junior.
Je vous ai sans doute accablé en vous envoyant tant de volumes à la fois mais je vous en ai accablé parce que vous me les avez demandés. Et d'ailleurs vous m'avez écrit que vos vendanges étaient si maigres, qu'il m'a été facile de comprendre que vous aviez assez de loisir, comme on dit communément, pour lire un livre. Je reçois les mêmes nouvelles de mes terres. J'aurai donc le temps d'écrire des ouvrages que vous puissiez lire, si pourtant j'ai de quoi acheter du papier Mais s'il est rude, ou s'il boit, il faudra se résoudre, ou à ne point écrire, ou à écrire des choses qui, bonnes ou mauvaises, s'effaceront sans nécessité à mesure que je les écrirai. Adieu.

XVI. - Pline à Paternus.
Les maladies et la mort même de quelques-uns de mes gens à la fleur de leur âge m'ont accablé de tristesse. J'ai deux sujets de consolation, trop faibles sans doute pour une telle douleur, mais qui cependant m'aident à la supporter : le premier, c'est ma facilité à les affranchir (car ceux qui sont morts libres ne me semblent pas, en quelque façon, être morts avant le temps), le second, c'est la permission que je donne aux esclaves mêmes de faire une espèce de testament que j'observe aussi religieusement que s'il était légitime. Ils consignent, à leur gré, leurs dispositions et leurs prières : ce sont des ordres auxquels j'obéis. Ils partagent, ils donnent, ils lèguent, pourvu que ce soit à quelqu'un de la maison : car la maison est comme la république et la patrie des esclaves.
Cependant, quoique je trouve dans ces consolations un adoucissement à mon chagrin, l'humanité même qui m'a dicté ces complaisances pour eux m'abat et m'accable au souvenir de leur perte. Je ne voudrais pas en devenir moins sensible, quoique tant d'autres ne voient dans de pareils malheurs qu'une perte d'argent, et qu'avec de tels sentiments ils se croient de grands hommes et des sages. Pour moi, je ne sais s'ils méritent ce double titre; mais ils ne sont point hommes. L'homme doit être accessible à la douleur, la sentir, la combattre pourtant, écouter les consolations, et non n'avoir pas besoin d'être consolé. Peut-être en ai-je dit plus que je ne devais ; mais c'est encore moins que je n'aurais voulu. Il y a je ne sais quel charme à se plaindre, surtout quand on répand ses larmes dans le sein d'un ami toujours prêt à vous accorder son approbation ou son indulgence. Adieu.
XVII - Pline à Macrinus.
Avez-vous aussi dans le climat que vous habitez une températerre rude et cruelle? On ne voit à Rome qu'orages et qu'inondations. Le Tibre est sorti de son lit et s'est répandu sur ses rives basses. Quoique le canal que la sage prévoyance de l'empereur a fait faire en ait reçu une partie, il remplit les vallées, il couvre les campagnes partout où il trouve des plaines, elles disparaissent sous ses eaux. De là il resulte que, rencontrant les rivières qu'il a coutume de recevoir, de confondre et d'entraîner avec ses ondes, il les force à retourner en arrière, et couvre ainsi de flots étrangers les terres qu'il n'inonde pas de ses propres flots.
L'Anio, la plus douce des rivières, et qui semble comme invité et retenu par les belles villas bâties sur ses bords, a déraciné et emporté les arbres qui le couvraient de leur ombrage. Il a renversé des montagnes, et, se trouvant arrêté par leur chute en plusieurs endroits, il a cherché le passage qu'il s'était fermé, il a abattu des maisons, et s'est élevé sur leurs ruines. Ceux qui habitent les lieux élevés, à l'abri de l'inondation, ont vu flotter, ici de riches débris et des meubles précieux, là des ustensiles de campagne; d'un côté, des boeufs, des charrues, des bouviers ; de l'autre, des troupeaux abandonnés à eux-mêmes ; et, au milieu de tout cela, des troncs d'arbres, des poutres et des toits. Les lieux même où la rivière n'a pu monter ont eu leur part de ce désastre. Une pluie continuelle et des tourbillons échappés des nues ont fait autant de ravages que le fleuve. Les clôtures qui entouraient de magnifiques villas ont été ruinées et les monuments funèbres renversés. Un grand nombre de personnes ont été noyées, estropiées, écrasées, et le deuil général accroît encore la douleur de ces pertes. Je crains que, là où vous êtes, vous n'ayez essuyé quelque malheur semblable, et je mesure ma crainte à la grandeur du danger. S'il n'en est rien, rassurez-moi au plus vite, je vous en supplie; s'il en est autrement, mandez-le-moi toujours. Car il y a peu de différence entre redouter un malheur et le souffrir : seulement le mal a ses bornes, la crainte n'en a point. On ne s'afflige qu'à proportion de ce qui est arrivé mais on craint tout ce qui peut arriver. Adieu.
XVIII. - Pline à Rufin.
Il n'est pas vrai, comme on le croit communément, que le testament des hommes soit le miroir de leurs moeurs, puisque Domitius Tullus vient de se montrer en mourant beaucoup meilleur qu'il n'avait paru pendant sa vie. Après s'être livré à toutes les obsessions, il a institué son héritière la fille de son frère qu'il avait adoptée. Il a fait beaucoup de legs, et de legs fort riches à ses petits-enfants, et même à un arrière-petit-fils. En un mot, la tendresse paternelle règne partout, dans son testament, et surprend d'autant plus qu'on s'y attendait moins. On en parle donc fort diversement à Rome. Les uns le traitent de fourbe, d'ingrat, d'oublieux, et, en se déchaînant contre lui, se trahissent eux-mêmes par un honteux aveu. On dirait, à leurs invectives, que c'était un homme sans parents ; tandis qu'il était père, aïeul et bisaïeul. Les autres, au contraire, l'élèvent jusqu'au ciel pour avoir frustré les sordides espérances de cette espèce d'homme qu'il est sage de tromper ainsi, dans un siècle corrompu. Ils ajoutent qu'il n'était pas libre de laisser un autre testament ; il était redevable de ses grands biens à sa fille, et qu'il les lui a moins donnés que rendus. Car Curtilius Mancia, prévenu contre Domitius Lucanus, son gendre (c'est le frère de Tullus), avait institué héritière sa fille, petite-fille de Curtius, à condition que son père l'émanciperait. Domitius l'avait émancipée, et aussitôt Tullus son oncle, l'avait adoptée. Ainsi Domitius, qui vivait en corrmunauté de biens avec son frère; avait, par une émancipation artificielle, éludé l'intention du testateur, et remis sa fille, avec de très grandes richesses, sous sa puissance, après l'avoir émancipée. Il semble d'ailleurs que la destinée de ces deux frères ait été de s'enrichir en dépit de ceux qui les ont enrichis. Car Domitius Afer, qui les adopta, est mort sans autre testament que celui qu'il avait fait de vive voix, dix-huit ans auparavant, et sur lequel il avait depuis si fort changé de sentiment, qu'il avait poursuivi la confiscation des biens de leur père. Sa disgràce est aussi surprenante que leur bonheur : sa disgràce ; il avait adopté pour héritiers les enfants de son ennemi capital, qu'il avait fait retrancher du nombre des citoyens : leur bonheur; il avait retrouvé un père dans celui qui leur avait ôté le leur. Mais il était juste qu'après avoir été institué héritier par son frère, au préjudice de sa propre fille à laquelle celui-ci voulait ménager l'appui de son oncle, il rendit à cette même fille la succession d'Afer, ainsi que les autres biens que les deux frères avaient acquis ensemble.
Ce testament mérite d'autant plus de louanges, que la nature, la fidélité, l'honneur l'ont dicté; que chacun, selon son degré d'affinité, selon ses services, y a trouvé des marques d'affection et de reconnaissance, la femme de Tullus comme les autres. Cette femme, d'une vertu, d'une patience singulière, et qui devait être d'autant plus chère à son mari, que son mariage l'a exposée à de reproches, a eu pour sa part de très belles villas et une somme d'argent considérable. Il semblait qu'avec de la naissance et de bonnes moeurs, sur le déclin de l'âge, après une longue viduité, après avoir été mère autrefois, elle se fût oubliée en prenant pour mari un vieillard riche, accablé d'infirmités assez repoussantes pour dégoûter la femme même qui l'eût épousé jeune et plein de santé. Perclus et paralytique de tout son corps, il ne jouissait de sa richesse que des yeux, et ne se remuait même dans son lit, que par le secours d'autrui. Il fallait, par la plus humiliante et la plus triste des nécessités, qu'il donnât sa bouche à laver et ses dents à nettoyer. On l'a plus d'une fois entendu déplorer le misérable état où il était réduit, et se plaindre que, plusieurs fois le jour, il sentait dans sa bouche les doigts de ses esclaves. Il viva pourtant, et voulait vivre, soutenu principalement par la vertu de sa femme. Elle avait rendu honorable pour elle une union qu'on lui avait d'abord reprochée.
Voilà tout ce qu'il y a de nouveau à Rome. Les tableaux de Tullus sont à vendre : on n'attend que le jour des enchères. Il était tellement fourni de ces raretés, et il en avait tant d'oublié dans ses garde-meubles, que, le jour même où il acheta d'immenses jardins, il put les remplir d'une foule de statues très anciennes. A votre tour, si vous savez quelque chose digne d'une lettre, prenez la peine de me l'écrire : car, outre que les nouvelles font plaisir, rien ne forme tant que les exemples. Adieu.
XIX. - Pline à Maxime.
Les belles-lettres sont pour moi une jouissance et une consolation. Il n'est rien de si agréable qui le soit plus qu'elles; il n'est rien de triste qui ne devienne moins triste par elles. Dans le trouble que me causent l'indisposition de ma femme, la maladie de mes gens, la mort même de quelques-uns, je ne trouve d'autre remède que l'étude. Sans doute elle me fait mieux comprendre toute la grandeur du mal mais elle m'apprend à le supporter avec plus de patience. Or, j'ai coutume, quand je destine quelque ouvrage au public, de le soumettre auparavant à la critique de mes amis, et particulièrement à la vôtre. Si donc vous avez quelquefois accordé votre attention à mes ouvrages, donnez-la tout entière à celui que je vous envoie ci-joint; car je crains que la tristesse n'aît affaibli la mienne. J'ai bien pu prendre assez sur ma douleur pour écrire, mais non pour écrire d'un esprit libre et content. Et pourtant, si l'étude dispose à la gaieté, à son tour la gaieté influe heureusement sur l'étude. Adieu.
XX. - Pline à Gallus.
Nous avons coutume de nous mettre en voyage, de passer les mers pour voir des choses que nous négligeons lorsqu'elles sont sous nos yeux; peut-être parce que nous sommes naturellement insoucieux de ce qui est près de nous, et pleins de curiosité pour ce qui en est loin peut-être aussi parce que tous les désirs qu'il est aisé de satisfaire sont toujours tièdes peut-être enfin parce que nous différons toujours de voir ce que nous pouvons voire quand il nous plaira. Quoi qu'il en soit, il y a à Rome, il y a près de Rome beaucoup de choses que non seulement nous n'avons jamais vues, mais dont nous n'avons même jamais entendu parler, et que nous aurions vues, dont nous parlerions, que nous irions visiter; si elles étaient en Grèce, en Égypte, en Asie, ou dans tout autre pays fécond en merveilles et enthousiaste de ses beautés.
Ce qu'il y a de vrai, c'est que je viens d'apprendre une chose qui m'était inconnue, de voir ce que je n'avais point encore vu. L'aïeul de ma femme m'avait engagé à visiter sa terre d'Amérie. Tandis que je m'y promenais, on me montra, dans un fond, un lac appelé Vadimon, et dont on me raconta des prodiges. Je m'en approche. La forme de ce lac est celle d'une roue couchée. Il est partout égal, sans aucun recoin, sans aucun angle, tout y est uni, mesuré, taillé, creusé, comme par la main d'un artiste. La couleur de ses eaux est plus pâle que celle des eaux ordinaires : elles sont d'un jaune foncé, tirant sur le vert. Elles ont l'odeur et le goût d'eaux sulfureuses, et guérissent les fractures. Le lac, quoique petit, s'agite et s'enfle au gré des vents.
On n'y trouve point de bateaux, parce qu'il est consacré; mais on y voit flotter des îles de verdure, couvertes de roseaux, de joncs, de tous les produits des marais les plus fertiles, et aux extrémités mêmes du lac. Chacune a sa forme et sa grandeur particulière ; toutes ont les bords nus, parce que souvent elles s'entre-choquent, ou heurtent la rive. Elles ont toutes une égale profondeur, une égale légèreté. Terminées en coques de navire, elles s'enfoncent assez peu dans le lac. Elles se montrent de tous côtés, également plongées sous les eaux et nageant à leur surface. Quelquefois elles se rassemblent et forment une espèce de continent; quelquefois des vents opposés les dispersent; parfois aussi, au sein du calme, elles flottent séparément. Souvent les plus petites s'attachent aux plus grandes, comme des esquifs aux vaisseaux de charge. Tantôt les grandes et les petites semblent lutter à la course; tantôt, arrivant toutes au même point, elles longent la rive; puis, flottant cà et là, elles envahissent le lac et l'abandonnent tour à tour. Ce n'est que lorsqu'elles en occupent le milieu, qu'il paraît dans toute sa grandeur. On a vu des troupeaux s'avancer, en broutant l'herbe de la prairie, jusque dans ces îles qui leur semblaient l'extrémité de la rive, et ne s'apercevoir que le terrain était mouvant, que lorsque, éloignés de la terre, ils se sentaient avec terreur comme emportés au milieu du lac qui les environnait. Bientôt ils abordaient où il plaisait au vent de les porter, et ils descendaient sur le bord aussi insensiblement qu'ils s'en étaient éloignés. Ce même lac se décharge dans un fleuve, qui, après s'être montré quelque temps, se précipite dans une grotte. Il continue son cours sous la terre, et si, avant qu'il s'y précipite, on jette quelque chose dans les eaux, il le conserve, et le rend quand il sort.
Je vous ai donné tous ces détails, parce que j'ai pensé qu'ils ne vous sembleraient ni moins neufs, ni moins intéressants qu'à moi car nous prenons tous deux un extrême plaisir à connaître les ouvrages de la nature. Adieu.
XXI. - Pline à Arrien.
Je suis persuadé que, dans les études, comme dans la vie, rien n'est si beau, et plus conforme à la nature humaine que de tempérer la gravité par l'enjouement, en sorte que l'une ne dégénère pas en tristesse, et l'autre en folle joie. Voilà pourquoi, après avoir travaillé des ouvrages sérieux, je m'amuse à composer quelques bagatelles. J'ai choisi, pour les mettre au jour, le temps et le lieu le plus convenable. Afin de les accoutumer dès à présent à être entendues par des oisifs et dans la salle des repas, j'ai pris le mois de juillet, c'est-à-dire le temps où il se plaide le moins d'affaires, et j'ai placé mes amis sur des siéges disposés devant les lits des convives.
Le hasard a voulu que ce jour-là même on vînt le matin me demander à l'improviste de plaider une cause. Cette circonstance me fournit un préambule. Je suppliai l'auditoire de penser que, bien que j'eusse à faire une lecture devant des amis, et des amis en petit nombre, je n'avais pas cru témoigner peu d'intérêt pour cette séance, en me livrant ce même jour aux affaires et au barreau où d'autres amis m'appelaient. Je les assurai que j'en usais toujours ainsi en écrivant; que je sacrifiais toujours les plaisirs aux devoirs, l'agréable à l'utile, et que j'écrivais d'abord pour mes amis, et ensuite pour moi-même. Au reste, l'ouvrage dont je leur ai fait part est diversifié, non seulement par la nature des sujets, mais encore par la mesure des vers. C'est ainsi que, dans la défiance où je suis de mon esprit, j'ai coutume de me précautionner contre l'ennui. J'ai lu pendant deux jours pour satisfaire à l'empressement des auditeurs. Cependant les autres passent ou retranchent certains endroits, et pensent qu'on doit leur en savoir gré; moi, je ne passe, je ne retranche rien, et j'en avertis ceux qui m'écoutent. Je lis tout pour être en état de tout corriger, ce que ne peuvent faire ceux qui ne lisent que des morceaux choisis. Peut-être marquent-ils en cela plus de défiance d'eux-mêmes, et plus de respect pour leurs auditeurs; mais du moins je montre plus de franchise et plus d'amitié. C'est agir en ami, que de compter assez sur l'affection de ses auditeurs pour ne pas craindre de les ennuyer. D'ailleurs, quelle obligation leur a-t-on, s'ils ne s'assemblent que pour se divertir? Il faut être égoïste et presque indifférent pour aimer, mieux entendre un bon ouvrage, que de contribuer à le rendre tel.
Votre amitié pour moi ne me permet pas de douter que vous ne souhaitiez de lire au plus tôt cette pièce dans sa nouveauté. Vous la lirez, mais retouchée : car c'est pour la retoucher que je l'ai lue. Vous en connaissez déjà pourtant une bonne partie. Que ces passages aient été perfectionnés depuis, ou qu'à force de les corriger ils en soient devenus plus mauvais, comme cela arrive souvent, ils vous paraîtront nouveaux. Car, lorsque presque tout est changé, il semble que l'on ait refait les endroits même que l'on a conservés. Adieu.
XXII. Pline à Géminius.
Ne connaissez-vous point de ces gens qui, esclaves de toutes leurs passions, s'élèvent contre les vices d'autrui comme s'ils en étaient jaloux? Ceux qu'ils punissent le plus sévèrement, sont ceux qu'ils imitent le plus. Et cependant rien ne fait tant d'honneur que l'indulgence aux hommes même qui peuvent dispenser tout le monde d'en avoir pour eux. Le meilleur et le plus parfait, selon moi, est celui qui pardonne aux autres comme s'il commettait lui-même des fautes continuelles, et qui les évite comme s'il ne pardonnait à personne. Soyons donc en particulier, en public, et dans toute la conduite de notre vie, inexorables pour nous, indulgents pour les autres, même pour ceux qui ne savent excuser qu'eux. N'oublions jamais ce que disait souvent Thraséas, l'homme le plus humain, et par cela même le plus grand : "Celui qui hait les vices, hait les hommes". Vous demandez à qui j'en veux en écrivant ceci? Un individu, ces jours derniers ---. Mais il sera mieux de vous conter l'affaire de vive voix, ou plutôt de me taire. Je crains que poursuivre, blâmer, rapporter une action que je désapprouve, ne soit contraire à la tolérance que je prescris. Quel que soit donc cet homme, ne le nommons point. Il serait peut-être utile, pour l'exemple, de le faire connaître; mais il importe beaucoup, pour l'indulgence, de ne le point signaler. Adieu.
XXIII. - Pline à Marcellin.
Études, soins, distractions, tout cède à la douleur extréme que me cause la mort de Junius Avitus : elle m'enlève et m'arrache tout. Il avait pris chez moi le laticlave. Je l'avais aidé de mon suffrage, lorsqu'il sollicitait les charges publiques. Il m'aimait, il me respectait comme le guide de sa conduite; il m'écoutait comme son maître. C'est une disposition fort rare dans nos jeunes gens. En est-il beaucoup qui veuillent bien déférer, ou à l'âge, ou à l'autorité? dès qu'ils entrent dans le monde, ils sont parfaits, ils savent tout; ils ne respectent, ils n'imitent personne, et se suffisent à eux-mêmes. Avitus était bien éloigné de ces sentiments. Il mettait surtout sa sagesse à croire toujours les autres plus sages que lui, et sa science à vouloir s'instruire. Sans cesse il consultait, ou sur les belles-lettres, ou sur les devoirs de la vie. Il ne vous quittait jamais, sans avoir profité ; et il en valait davantage, en effet, ou par ce qu'il avait appris, ou pour avoir voulu apprendre. Quel attachement n'a-t-il pas marqué pour Servianus, l'un des hommes les plus accomplis de ce siècle? lorsque celui-ci, en qualité de lieutenant du proconsul, passait de Germanie en Pannonie, Avitus, alors tribun, comprit si bien tout son mérite, et le captiva si bien lui-même, qu'il le suivit, non comme compagnon d'armes, mais comme attaché à sa personne, comme ami. Quelle habileté et quelle modération n'a-t-il pas montrées sous les consuls dont il a été le questeur (car il l'a été de plusieurs) ! quel agrément, quelle satisfaction, quel avantage n'ont-ils point tiré de ses services ! cette charge d'édile, dont une mort imprévue l'empêche de jouir, par combien de démarches, par combien de zèle ne l'avait-ils pas achetée ! et c'est ce qui aigrit le plus ma douleur. Je me représente tant de peines perdues, tant de prières inutiles, et une dignité qui lui échappe, après qu'il l'a si bien méritée. Je me rappelle que c'est chez moi qu'il a pris le laticlave; je me rappelle mes premières, mes dernières sollicitations en sa faveur, nos entretiens, nos discussions. Je suis touché de sa jeunesse, du malheur de ses parents. Il avait une mère fort àgée, une femme qu'il avait épousée depuis moins d'un an, une fille qu'il venait de voir naître. Quel changement un seul jour apporte à tant d'espérances, à tant de joie ! édile nouveau, nouveau mari, nouveau père, il laisse une charge sans l'avoir exercée, une mère sans appui, une femme veuve, une fille dans l'enfance, qui n'a jamais connu ni son aïeul, ni son père. Pour comble de chagrin, je l'ai perdu pendant mon absence. J'ai appris en même temps sa maladie et sa mort, et lorsque je m'y attendais le moins, comme si l'on eût appréhendé que la crainte ne me familiarisât avec une si cruelle douleur. Tels sont les tourments que j'éprouve en vous écrivant, tout plein d'un seul objet. En l'état où je suis, je ne puis ni m'occuper ni parler d'autre chose. Adieu.
XXIV. - Pline à Maxime.
Mon amitié pour vous m'oblige, non pas à vous instruire (car vous n'avez pas besoin de maître), mais à vous avertir de ne pas oublier ce que vous savez déjà, de le pratiquer, ou même de travailler à le savoir encore mieux. Songez que l'on vous envoie dans l'Achaïe, c'est-à-dire dans la véritable, dans la pure Grèce, où, selon l'opinion commune, la civilisation, les lettres, l'agriculture même, ont pris naissance; songez que vous allez gouverner des cités libres, c'est-à-dire des hommes vraiment dignes du nom d'hommes, des hommes libres par excellence, dont les vertus, les bienfaits, les alliances, les traités, la religion ont eu pour principal objet la conservation du plus beau droit que nous tenions de la nature. Respectez les dieux qui ont créé cette contrée, et les noms mêmes de ces dieux; respectez l'ancienne gloire de cette nation, et cette vieillesse des villes, aussi sacrée que celle des hommes est vénérable. Rendez honneur à leur antiquité, à leurs exploits extraordinaires, à leurs fables même. N'entreprenez rien sur la dignité, sur la liberté, ni même sur la vanité de personne. Rappelez-vous toujours que nous avons puisé nos lois chez ce peuple ; qu'il ne nous les a pas imposées en vainqueur, mais qu'il les a cédées à nos prières. C'est dans Athènes que vous allez entrer ; c'est à Lacédémone que vous devez commander. Il y aurait de l'inhumanité, de la cruauté, de la barbarie à leur ôter l'ombre et le nom de liberté qui leur restent. Voyez comment en usent les médecins. Relativement à leur art, il n'y a point de différence entre l'homme libre et l'esclave; cependant ils traitent l'un plus doucement et plus humainement que l'autre. Rappelez-vous ce que fut autrefois chaque ville, mais non pour mépriser ce qu'elle est aujourd'hui.
Soyez sans fierté, sans orgueil, et ne redoutez pas le mépris. Peut-on mépriser celui qui est revêtu du pouvoir et qui porte les faisceaux, s'il ne montre une âme sordide et basse, et s'il ne se méprise pas le premier ? un magistrat éprouve mal son pouvoir en insultant autrui. La terreur est un mauvais moyen de s'attirer la vénération, et l'on obtient ce qu'on veut bien plus aisément par l'amour que par la crainte. Car, pour peu que vous vous éloigniez, la crainte s'éloigne avec vous, mais l'affection reste; et, comme à la première succède la haine, la seconde se change en respect. vous devez donc, je le répète, vous rappeler sans cesse le titre de votre charge, et l'importance de vos devoirs quand il s'agit d'organiser des cités libres. Qu'y a-t-il qui exige plus d'humanité que le gouvernement? qu'y a-t-il de plus précieux que la liberté? Quelle honte serait-ce d'ailleurs de transformer la règle en désordre et la liberté en esclavage !
je dirai plus : vous avez à vous mesurer avec vous-même. Vous avez à soutenir l'excellente réputation que vous vous êtes acquise dans l'emploi de trésorier de Bithynie, l'estime du prince, l'honneur que vous ont fait les charges de tribun, de préteur, et enfin ce gouvernement même qui est la récompense de tant de travaux. Mettez toute votre gloire à ce qu'on ne puisse pas dire que vous avez été plus humain, plus intègre et plus habile dans une province éloignée, qu'aux portes de Rome, parmi des peuples esclaves, que chez des hommes libres; désigné par le sort, que choisi par nos concitoyens; inconnu et sans expérience, qu'éprouvé et honoré. D'ailleurs n'oubliez pas ce que souvent vous avez lu, ce que vous avez souvent entendu dire, qu'il est bien plus humiliant de perdre l'estime que de n'en pas acquérir.
Veuillez prendre tout ceci, comme je vous l'ai dit d'abord, non pour des leçons, mais pour des conseils, quoiqu'après tout, quand ce seraient des leçons, je ne craindrais pas qu'on me reprochât d'avoir porté l'amitié à l'excès. Car on ne doit point appréhender qu'il y ait de l'excès dans ce qui doit être si grand. Adieu.

LIVRE NEUVIÈME. Retour
I. — Pline à Maxime.
Je vous ai souvent conseillé de publier au plus tôt les ouvrages que vous avez composés, ou pour votre défense, ou contre Planta, ou tout à la fois, et pour vous et contre lui car le sujet le voulait ainsi. Mais aujourd'hui que je viens d'apprendre sa mort, je joins mes exhortations à mes conseils. Quoique vous les ayez lus et que vous les ayez donnés à lire à beaucoup de personnes, je serais fâché, qu'après les avoir achevés de son vivant, on put soupçonner que vous ne les avez commencés qu'après sa mort. Soutenez l'opinion qu'on a conçue de votre courage. Or vous la soutiendrez, en faisant connaître à tout, homme, équitable ou non, que ce n'est point seulement après la mort d'un ennemi que vous avez osé écrire, mais que cette mort a prévenu la publication toute prête de votre ouvrage. Vous éviterez en même temps ce reproche :
C'est une impiété que d'insulter aux morts.
Car ce qu'on a composé, ce qu'on a lu contre un homme vivant, c'est presque le publier pendant sa vie, que le publier au moment même de sa mort. Ajournez donc tout travail, si vous faites quelqu'autre ouvrage, et mettez la dernière main à celui-ci. Il me parut achevé à l'époque où vous me le donnâtes à lire. Mais aujourd'hui il doit vous paraître tel à vous-même, qui ne pouvez plus vous permettre aucun retard. Votre ouvrage n'en a pas besoin, et la circonstance vous le défend. Adieu.
II— Pline à Sabinus.
Vous me faites plaisir de me presser si fort, non seulement de vous écrire souvent, mais encore de vous écrire de très longues lettres. Je les ai jusqu'ici ménagées, d'abord, pour ne pas vous détourner de vos occupations, et ensuite, parce que j'étais moi-même dérangé par des affaires qui, toutes frivoles qu'elles sont, ne laissent pas de captiver et de fatiguer l'esprit. De plus, je manquais de matière pour écrire une longue lettre car je n'ai pas les ressources qu'avait Cicéron dont vous me proposez l'exemple. Indépendamment de la fécondité de son génie, il était abondamment entretenu, soit par la diversité, soit par la grandeur des événements. Quant à moi, vous savez assez, sans que je vous le dise, dans quelles bornes je me trouve resserré, si je ne veux pas vous envoyer une de ces lettres oiseuses et qui sentent le rhéteur. Mais rien ne me semble moins convenable, quand je vous vois dans un camp, au milieu des clairons et des trompettes, couvert de sueur et de poussière, et tout brûlé du soleil. Voilà mon excuse. Je ne sais trop pourtant si je voudrais qu'elle vous parût bonne car, malgré les raisons les plus légitimes, la tendre amitié ne pardonne point la brièveté d'une lettre. Adieu.
III. — Pline à Paulinus.
Chacun juge différemment du bonheur d'autrui. Pour moi, je regarde comme le plus heureux des hommes, celui qu'enivre l'espoir d'une grande et immortelle renommée, et qui, sûr des suffrages de la postérité, jouit d'avance de toute la gloire qu'elle lui destine. Je l'avoue, si je n'avais un tel prix devant les yeux, je n'aimerais rien tant que l'indolence d'un repos complet.
Car enfin je crois que tous les hommes doivent songer à l'immortalité ou à la mort. Ceux qui aspirent à la première doivent s'appliquer et travailler sans cesse, les autres doivent chercher le plaisir et le repos. Il ne faut pas qu'ils fatiguent, par d'inutiles travaux, une vie éphémère. C'est, ce que font bien des gens qui, abusés par une vaine et déplorable apparence d'activité, n'aboutissent qu'à se mépriser eux-mêmes. Je vous communique des réflexions que je fais tous les jours, pour cesser de les faire, si elles ne sont pas de votre goût. Mais j'ai peine à croire que vous ne les approuviez pas, vous dont l'esprit n'est jamais occupé de rien que de grand et d'immortel. Adieu.
IV. — Pline à Macrinus.
Je craindrais fort que le plaidoyer qui accompagne cette lettre ne vous parût trop long, s'il ne semblait, par un caractère qui lui est particulier, commencer et finir plus d'une fois car chaque accusation renferme en quelque sorte une cause. Vous pourrez donc, par quelque endroit que vous commenciez, et en quelque endroit que vous vous arrêtiez, reprendre votre lecture, comme si vous la commenciez, ou comme si vous la poursuiviez. Je vous paraîtrai prolixe dans l'ensemble et bref dans les détails. Adieu.
V. — Pline à Tiron,
Continuez (car je m'en informe) de rendre la justice aux peuples de votre gouvernement avec une extrême douceur. Le principal effet de cette justice, c'est d'honorer les personnes d'un rang élevé, et, en vous faisant aimer des petits, de vous attirer la considération des grands. La plupart des gens en place, de peur qu'on ne les soupçonne de trop flatter la puissance, se font passer pour malveillants et grossiers. Je sais combien vous êtes éloigné de ce défaut mais je ne puis m'empêcher de joindre le conseil à la louange, et de vous exhorter à garder cette juste mesure qui assigne aux différents ordres ce qui leur est dû. On ne peut les déplacer, les mêler et les confondre, sans tomber, par cette égalité même, dans une extrême injustice. Adieu.
VI. — Pline à Calvisius.
J'ai passé tous ces derniers jours dans la plus douce tranquillité, entre mes tablettes et mes livres. Comment, dites-vous, cela se peut au milieu de Rome? C'était le temps des spectacles du Cirque qui n'ont pas pour moi le moindre attrait. Je n'y trouve rien de nouveau, rien de varié, rien qu'il ne suffise d'avoir vu une fois. C'est ce qui me fait trouver d'autant plus étrange ce désir puéril que tant de milliers d'hommes éprouvent de revoir de temps en temps des chevaux qui courent et des hommes qui conduisent des chars. Encore, s'ils étaient attirés par la vitesse des chevaux ou par l'adresse des hommes, leur curiosité aurait quelque motif. Mais non, ils ne s'attachent qu'à la couleur des combattants, c'est là tout ce qu'ils aiment. Que dans le milieu de la course ou du combat, on fasse passer d'un côté la couleur qui est de l'autre, on verra leurs goûts et leurs vœux changer tout à coup avec elle, et abandonner les hommes et les chevaux qu'ils connaissent de loin, qu'ils appellent par leurs noms : tant une vile casaque fait impression, je ne dis pas sur la populace, plus vile encore que ces casaques, mais sur des hommes graves ! Quand je songe qu'ils ne se lassent point de revoir avec tant d'ardeur des choses si vaines, si froides et si communes, je trouve une satisfaction secrète à n'être point sensible à ces bagatelles, et c'est avec un grand plaisir que je consacre aux belles-lettres un loisir que les autres perdent dans de si frivoles amusements. Adieu.
VII. — Pline à Romanus.
Vous me mandez que vous bâtissez. J'en suis ravi : voilà de quoi me justifier. Je bâtis aussi, et sans doute j'ai raison, puisque je vous imite. Je vous ressemble même en ce point, que vous bâtissez près de la mer, moi près du lac de Côme. J'ai sur ses bords plusieurs villas mais deux, entre autres, me donnent à la fois plus de plaisir et d'embarras.
L'une, bâtie dans le genre de celles que l'on voit à Baïes, s'élève sur des rochers et domine le lac, l'autre, bâtie de la même manière, est baignée par ses eaux. J'appelle donc habituellement ! l'une la tragédie, l'autre la comédie, la première, parce qu'elle semble avoir chaussé le cothurne, la seconde le brodequin Elles ont chacune leurs agréments, et cette diversité même ajoute à leur beauté pour celui qui les possède toutes deux. L'une jouit du lac de plus près, l'autre en a une vue plus étendue. Celle-là, par son gracieux hémicycle, forme une espèce de golfe, celle-ci en présente deux par son roc élevé qui s'avance dans le lac. Là vous avez une promenade droite qui, par une longue allée, s'étend le long du rivage ; ici la promenade suit une allée spacieuse et qui tourne un peu. Les flots n'approchent point de la première de ces villas, ils viennent se briser contre la seconde. De l'une vous voyez pêcher, de l'autre vous pouvez pêcher vous-même, sans sortir de votre chambre, et presque de votre lit, d'où vous jetez l'hameçon comme d'un bateau.
Voilà pourquoi je veux ajouter ce qui manque à chacune en faveur de ce qu'elles ont déjà. Mais pourquoi vous expliquer les raisons de ma conduite? la vôtre vous les dira de reste. Adieu.
VIII. - Pline à Augurinus.
Si je réponds à vos éloges en vous louant, je crains que mes louanges ne paraissent moins l'expression de mon jugement que celle de ma reconnaissance. Mais, dût-on avoir cette pensée, tous vos ouvrages me semblent admirables, surtout ceux que vous avez composés pour moi. Une seule et même raison me fait juger ainsi, c'est que tout ce que vous écrivez en l'honneur de vos amis est excellent, et que je trouve parfait tout ce qu'on écrit à mon éloge. Adieu.
IX. — Pline à Colon.
J'approuve fort la profonde douleur que vous cause la mort de Pompéius Quinctianus : vos regrets font voir que votre amitié lui survit. Vous n'êtes pas comme la plupart des hommes qui n'aiment que les vivants, ou plutôt qui feignent de les aimer, et qui même ne se donnent cette peine que pour ceux qu'ils voient dans la prospérité car Ils confondent dans le même oubli les malheureux et les morts. Quant à vous, votre attachement est à l'épreuve du temps, et votre constance en amitié est si forte, qu'elle ne peut finir qu'avec vous. Aussi Quinctianus méritait-il l'amitié dont il était un parfait modèle. Il aimait ses amis dans la bonne fortune, il les soutenait dans la mauvaise, il les regrettait quand ils n'étaient plus. Comme la probité respirait sur son visage ! que de réserve dans ses discours! quel judicieux mélange de gravité et d'enjouement! quel amour pour les lettres! quel goût exquis! quelle pitié filiale envers un père qui lui ressemblait si peu! comme il a su paraître bon fils, sans cesser d'être homme de bien !
Mais pourquoi augmenter vos regrets? quoique pourtant, si l'on considère la tendresse que vous aviez pour lui, mes éloges doivent vous être plus agréables que mon silence, surtout si vous pensez qu'ils peuvent illustrer sa vie, étendre sa renommée, et lui rendre, en quelque sorte, cette fleur de jeunesse à laquelle il vient d'être enlevé. Adieu.

X. — Pline à Tacite.
J'aurais grande envie de suivre vos leçons mais les sangliers sont si rares ici, qu'il n'est pas possible d'accorder Minerve avec Diane, quoique, selon vous, on les doive servir toutes deux ensemble. Il faut donc se contenter de rendre ses hommages à Minerve, et avec ménagement, comme il convient à la campagne et pendant l'été. J'ai composé en voyage quelques bagatelles assez peu dignes d'être conservées. Aussi n'y ai-je donné d'autre application que celle qu'on donne en voiture aux conversations ordinaires. Depuis que je suis dans ma villa, j'y ai ajouté quelques chose, n'ayant pas trouvé à propos de m'attacher à d'autre ouvrage. Je laisse donc reposer les poésies que vous croyez ne pouvoir être plus heureusement achevées qu'à l'ombre des bois. J'y ai retouché une ou deux petites harangues, quoique ce genre d'exercice, sans agrément et sans attrait, tienne plus des travaux qi des plaisirs de la vie champêtre. Adieu.
XI. — Pline à Géminus.
Votre lettre m'a charmé, surtout parce que vous y exprimez 1e désir d'avoir quelque chose de moi à insérer dans votre ouvrage Nous trouverons un sujet, ou celui que vous m'indiquez, ou quelqu'autre plus convenable. Il y a, en effet, à redire dans celui dont vous me parlez. Regardez-y bien, et vous le verrez. Je ne savait pas qu'il y eût des libraires à Lyon, et c'est avec d'autant plus de plaisir que j'ai appris par votre lettre que mes ouvrages s'y vendent. Je suis bien aise qu'ils conservent dans ces pays étrangers la faveur qu'ils se sont acquis à Rome. Je commence à estime un ouvrage sur lequel des hommes de climats si différents sont de même avis. Adieu.
XII. — Pline à Junior,
Un père châtiait son fils parce qu'il faisait trop de dépense en chevaux et en chiens. Quand le fils fut sorti, je dis au père : N 'avez-vous donc jamais rien fait dont votre père eût lieu de vous reprendre? plus d'une fois, sans doute. Ne vous échappe-t-il pas souvent telle faute sur laquelle votre fils, s'il devenait tout à coup votre père, pourrait vous réprimander avec la même sévérité? Tous les hommes n'ont-ils pas leur faible? Celui-ci ne se pardonne-t-il pas telle erreur, celui-là telle autre? L'amitié qui nous lie m'a engagé à vous communiquer ces réflexions et cet exemple d'une sévérité excessive, pour vous engager vous-même à ne point traiter votre fils avec trop de dureté et de rigueur. Songez qu'il est enfant, et que vous l'avez été, et, en usant de l'autorité paternelle, n'oubliez pas que vous êtes homme, et le père d'un homme. Adieu.
XIII. — Pline à Quadratus.
Vous avez lu mon ouvrage sur la vengeance d'Helvidius avec tant d'empressement et d'ardeur, que vous me priez avec instance de vous mander toutes les particularités qui ne se trouvent pas dans mon livre et celles qui sont relatives à mon livre. Vous voulez savoir toute la suite de cette affaire dont votre extrême jeunesse vous a dérobé la connaissance.
Lorsque Domitien eut été mis à mort, je jugeai, après de mûres réflexions, qu'il se présentait une grande et belle occasion de poursuivre le crime, de venger le malheur et d'illustrer son nom. Dans le grand nombre de forfaits commis par tant de gens, je n'en voyais pas de plus atroce que celui d'un sénateur qui, dans le sénat même, avait attenté aux jours d'un sénateur qui, après avoir été préteur, s'était attaque à un consulaire qui, lors même qu'il était juge, avait porté ses mains sur l'accusé. J'avais d'ailleurs été lié avec Helvidius d'une amitié aussi étroite qu'on le pouvait être avec un homme obligé, dans un temps de terreur, à cacher dans la retraite un grand nom et de grandes vertus. J'avais toujours été des amis d'Arria et de Fannia, dont l'une était la belle-mère d'Helvidius, ayant épousé son père, et dont l'autre était la mère de sa belle-mère. Mais les droits de l'amitié me déterminaient moins que l'intérêt public, la monstruosité du fait et l'utilité de l'exemple.
Dans les premiers jours où la liberté nous fut rendue, chacun par des cris tumultueux et confus, s'était empressé d'accuser et d'accabler à la fois ses amis, mais seulement ceux de moindre importance. Pour moi, je crus qu'il y aurait plus de sagesse et de courage à terrasser un criminel si abominable sous le poids non de la haine commune, mais de son propre crime. Lorsque le premier feu se fut un peu ralenti, et que la colère, qui se calmait de jour en jour, eut fait place à la justice, quoiqu'alors 1a perte de ma femme m'eût plongé dans la douleur, j'envoyai chez Antéia, veuve d'Helvidius, et je la suppliai de vouloir bien me venir voir, parce que mon deuil tout récent ne me permettait p as de sortir. Dès qu'elle fut entrée chez moi : J'ai résolu, lui
dis-je, de venger la mort de votre mari. Portez-en la nouvelle à Arria et à Fannia (elles avaient été rappelées de leur exil). Consultez-vous, consultez-les, et voyez si vous voulez vous associer à mon entreprise. Ce n'est pas que j'aie besoin de soutien mais je ne suis pas assez jaloux de ma gloire pour refuser de la partager
Antéia leur rapporta ce que je lui avais dit, et elles n'hésitèrent pas . Le sénat devait fort à propos s'assembler trois jours après, et ne faisais jamais rien sans consulter Corellius que j'ai toujours regardé comme l'homme le plus sage et le plus habile de notre siècle. Cependant, en cette occasion, je ne consultai que moi-même dans la crainte qu'il ne voulût m'empêcher d'agir en effet, il était timide et circonspect. Mais je ne pus prendre sur moi, le jour même de l'exécution, de ne pas lui communiquer mon dessein, sans lui demander pourtant ce que je devais faire. Car sais par expérience que, sur ce que vous avez bien résolu, il ne faut point consulter les personnes dont les conseils deviennent pour vous des ordres. Je me rendis au sénat. Je demandai la permission de parler. Mes premières paroles furent très bien accueilles. Mais, à peine eus-je dit un mot de l'accusation, à peine eus-je désigné le coupable, sans pourtant le nommer encore, qu'on s'écria contre moi de tous côtés. L'un s'écria : Sachons contre qui vous prétendez faire cette poursuite extraordinaire. Un autre : Quel est celui qu'on accuse ainsi, avant que le sénat l'ait permis? u n autre : Laissez en sûreté ceux qui ont échappé. J'écoutai sans m'inquiéter, sans me troubler : tant la justice de l'entreprise de force pour vous soutenir dans l'exécution ! tant il est différent pour vous donner de la confiance Ou de la crainte, que les hommes ne veuillent pas que vous fassiez ce que vous faites, ou qu'ils ne l'approuvent pas.
Il faudrait trop de temps pour vous raconter tout ce qui fut décidé sur ce sujet de part et d'autre. Enfin le consul m'adressant parole : Pline, me dit-il, vous direz ce qu'il vous plaira, quand votre tour d'opiner sera venu. - Vous me permettez, lui répondis-je, ce que jusqu'ici vous n'avez refusé à personne. Je m'assis, l'on traita d'autres affaires. Un consulaire de mes amis m'avertit tout bas et en termes délicats, que je m'étais exposé avec trop de courage et trop peu de prudence. Il me reprit, il me gronda, il me pressa de me désister, il ajouta même que je me rendais redoutable aux empereurs à venir. « Tant mieux, lui dis-je, pourvu que ce soit aux méchants empereurs. » A peine m'eut-il quitté, qu'un autre revint à la charge : «Qu'osez-vous entreprendre? pourquoi vous perdre? à quels périls vous exposez-vous? Quelle imprudence de vous fier au présent, sans être sûr de l'avenir ! Vous offensez un trésorier de l'épargne qui dans peu sera consul. D'ailleurs, de quel crédit, de quel patronage n'est-il point appuyé? Il me désigna un personnage qui alors commandait en Orient une puissante armée, et sur le compte duquel couraient des bruits assez peu favorables. A ces discours je répondais :
J'ai tout prévu, mon cœur est raffermi d'avance.
si la fortune l'ordonne ainsi, je suis prêt à porter la peine d'une action glorieuse. Enfin on commença à opiner. Domitius Apollinaris, consul désigné, prit la parole ; après lui, Fabricius Véiento, Fabius Postumius, Vectius Proculus, collègue de Publicius Certus, que l'affaire regardait, et beau-père de l'épouse que je venais de prendre ; ensuite Ammius Flaccus, Tous firent l'apologie de Certus, comme si je l'avais nommé, quoique je n'eusse point encore prononcé son nom. Tous entreprirent de le justifier d'une accusation générale et qui ne tombait encore sur personne. Il n'est pas nécessaire de vous raconter ce qu'ils dirent. Vous le trouverez dans mon ouvrage, j'y ai rapporté leurs propres termes. Avidius Quiétus et Tertullus Cornutus furent d'un sentiment contraire. Quiétus représenta que rien n'était plus injuste que de ne vouloir pas écouter les plaintes de ceux qui se prétendent offensés, qu'il ne fallait donc pas priver Arria et Fannia du droit de se plaindre, ne pas considérer le rang de la personne, mais examiner la cause, Cornutus dit que les consuls l'avaient donné pour tuteur à la fille d'Helvidius, sur la demande que leur en firent sa mère et le mari de sa mère ; qu'il ne pouvait, en cette occasion, manquer aux devoirs de sa charge mais qu'en les remplissant il saurait modérer la douleur, et se conformer aux nobles sentiments de ces femmes vertueuses qui se contentaient de rappeler au sénat les sanglantes manipulations de Publicius Certus, et de demander que, si on lui remettait la peine due à son crime, il demeurât au moins flétri par le sénat, comme s'il l'avait été par le censeur. Alors Satrius Rufus prenant, en termes obscurs, je ne sais quel parti moyen : Sénateurs! dit-il, nous serions injustes envers Publicius Certus, si nous ne le regardions pas comme innocent. Il n'a encore été nommé que par les amis d'Arria, de Fannia, et par ses propres amis. Mais jusqu'à ce qu'il ait quelque chose de prouver contre lui, vous pourrez, ce me semble, le déclarer innocent.
Chacun parla de cette sorte à son tour. Le mien arriva. J'entrai en matière, ainsi que je l'ai dit dans mon livre. Je répondis à tout ce qu'on avait avancé. Je ne saurais vous dire avec quelle attention, avec quels applaudissements ceux même qui peu auparavant se récriaient, accueillirent mon discours : tant fut subit le changement que produisit, ou l'importance de la cause, ou l'énergie des paroles, ou le courage de l'accusateur! Je finis. Véiento commença à répondre. On ne put le supporter ; on murmura, on| l'interrompit. Alors il s'écria : Je vous supplie, pères conscrits! de ne me pas forcer à implorer le secours des tribuns. Aussitôt le tribun Muréna, reprenant la parole, dit : Je vous permets de parler, illustre Véiento. Mais on ne s'en éleva pas moins contre lui. Cependant le consul, ayant achevé de faire l'appel nominal et de prendre les voix, congédia le sénat. Il laissa Véiento debout et s'efforçant toujours de parler. Véiento se plaignit avec amertume de ce traitement qu'il appelait une injure, et s'appliqua ce vers d'Homère :
Ces jeunes combattants outragent ta vieillesse.
Il n 'y eut presque personne dans le sénat qui ne vînt m'embrasser, baiser, et me louer à l'envi de ce que, à mes risques et périls, j'avais rétabli la coutume, si longtemps interrompue, de délibérer en commun sur les intérêts publics, et lavé enfin le sénat du reproche que lui faisaient les autres ordres, de réserver contre eux, toute sa sévérité, tandis que les sénateurs s'épargnaient seuls entre eux, et s'accordaient mutuellement un silence indulgent. Tout cela se passa en l'absence de Certus. Car, soit qu'il se méfiât de quelque chose, soit, comme on le disait pour l'excuser, qu'il fût indisposé, il ne parut point au sénat. L'empereur n'ordonna pas au sénat d'achever l'instruction du procès. J'obtins cependant ce que je m'étais proposé. Le collègue de Certus parvint au consulat auquel il avait été destiné mais un autre fut nommé à la place de Certus. Ainsi fut accompli le vœu qui terminait mon discours : Qu'il rende sous le meilleur des princes la récompense qu'il a reçue du prince le plus méchant! Depuis j'ai recueilli dans mes livres, le mieux que j'ai pu, tout ce que j'avais dit et j'y ai ajouté beaucoup de choses nouvelles. Il est survenu, par hasard, un événement qui semble cependant ne rien tenir du hasard. Peu de jours après la publication de cet ouvrage, Certus tomba malade, et mourut. J'ai ouï dire que, pendant sa maladie, son imagination me représentait sans cesse à lui ; sans cesse il croyait me voir le poursuivre l'épée à la main. Je n'oserais assurer que cela soit vrai mais il importe, pour l'exemple, que cela le paraisse. Voilà une lettre qui, pour une lettre, n'est pas moins longue que l'ouvrage que vous avez lu. Mais vous ne vous en prendrez qu'à vous-même qui ne vous êtes pas contenté de l'ouvrage. Adieu.
XIV. — Pline à Tacite.
Vous n'êtes pas homme à vous flatter, et moi je n'écris rien avec tant de franchise que ce que j'écris sur vous. Je ne sais si nous fixerons les regards de la postérité ; du moins nous le méritons, je ne dis pas par notre esprit (il y aurait de l'orgueil à le prétendre), mais par notre application, par notre travail, par notre respect pour elle. Continuons notre route. Si par là peu de gens sont parvenus à l'illustration et à la renommée, beaucoup du moins se sont dérobés à l'obscurité et à l'oubli. Adieu.
XV. — Pline à Falcon.
Je m'étais réfugié dans ma terre de Toscane pour jouir d'une entière liberté. Mais point de liberté pour moi, même en Toscane, tant je suis persécuté de tous cotés par les plaintes et les requêtes des paysans, que je lis avec un peu plus de répugnance que mes ouvrages. Et néanmoins ce n'est pas volontiers que je lis mes ouvrages. Je retouche quelques petits plaidoyers, travail qui, après un certain temps, est froid et désagréable. Cependant on ne se presse pas plus de me rendre compte, que si j'étais absent. Je monte pourtant quelquefois à cheval et tout ce que je fais du rôle de propriétaire, c'est de parcourir quelque partie de mes domaines, mais seulement pour me promener. Quant à vous, conservez votre habitude, et daignez informer un campagnard de c e qui se passé à la ville. Adieu.

XVI. - Pline à Mamilien.
Je ne suis pas surpris que vous ayez trouvé un plaisir infini à une chasse si abondante, où, comme vous me le mandez en style d'historien, il est impossible de compter les morts. Pour moi, je n'ai ni le loisir, ni l'envie de chasser : le loisir, parce que nous faisons vendanges, l'envie, parce que ces vendanges sont trop modiques. Mais je vous ferai porter, en guise de vin nouveau, de petits vers nouveaux de ma façon. Vous me les demandez de si bonne grâce, que je vous les enverrai dès que la fermentation me paraîtra calmée. Adieu.
XVII. — Pline à Génitor.
J'ai reçu la lettre où vous vous plaignez de l'ennui que vous ont causé dans un festin, d'ailleurs somptueux, des bouffons, des débauchés et des fous qui voltigeaient autour des tables. Ne voulez-vous donc jamais vous dérider le front? Je n'ai point de ces sortes de gens à mon service mais je tolère ceux qui en ont. Pourquoi donc n'en ai-je point? C'est que, s'il échappe à un débauché quelque parole obscène, à un bouffon quelque impertinence, à un fou quelque ineptie, cela ne me fait aucun plaisir, parce que cela ne me cause aucune surprise. Je vous allègue mon goût mais ce n'est pas une raison. Aussi combien n'y a-t-il pas de gens qui regardent comme sottes et insupportables beaucoup de choses qui nous plaisent et nous enchantent? Combien ne s'en trouve-t-il pas qui, dès qu'un lecteur, un joueur de lyre ou un comédien paraît, prennent congé de la compagnie ou qui, si elles demeurent à table, n'ont pas moins d'ennui que vous en ont fait souffrir ces monstres (car c'est le nom que vous leur donnez)? Ayons donc de l'indulgence pour les plaisirs d'autrui, si nous voulons en obtenir pour les nôtres. Adieu.
XVIII. - Pline à Sabinus.
Votre lettre me prouve avec quel soin, avec quelle attention et quelle heureuse mémoire vous avez lu mes ouvrages. C'est donc vous-même qui vous attirez un embarras, lorsque vous m'invitez et m'engagez à vous en communiquer le plus que je pourrai. Je le ferai volontiers, mais successivement et avec ordre. J'ai à craindre de fatiguer, par un travail trop assidu et par la multitude des sujets, une mémoire à laquelle je dois déjà tant. Je ne veux point la surcharger, l'accabler, la forcer à laisser échapper chaque ouvrage en cherchant à les embrasser tous, et à quitter les premiers pour courir après les derniers. Adieu.
XIX. — Pline à R ufon.
Vous me mandez que, dans une de mes lettres, vous avez lu que Virginius Rufus ordonna qu'on gravât ces vers sur son tombeau :
Ci-gît Rufus, dont la victoire
De Vindex punit l'attentat
Et qui ne voulut d'autre gloire
Que la liberté de l'État.
Vous le blâmez de l'avoir ordonné. Vous ajoutez que Frontinus fit bien mieux, lorsqu'il défendit qu'on lui éleva aucun tombeau. Vous finissez par me prier de vous dire ce que je pense de tous les deux. J'ai tendrement aimé l'un et l'autre, et celui que vous blâmez est celui que j'admirais le plus. Je l'admirais au point de ne pas croire qu'on pût jamais le louer assez et me voilà réduit à prendre sa défense ! Je vous avoue que tous ceux qui ont fait quelque chose de grand et de mémorable me paraissent dignes, non seulement d'excuse, mais d'éloge, lorsqu'ils recherchent l'immortalité, et qu'ils s'efforcent d'éterniser par des inscriptions un nom qui ne doit jamais périr. Je ne trouve guère que Virginius qui, après avoir tout fait pour la gloire, ait parlé si peu de ce qu'il a fait. Je puis l'attester : quoiqu'il m'accordât sans réserve son amitié et sa confiance, je ne l'ai jamais entendu parler de lui-même qu'une seule fois. Il racontait que Cluvius lui avait un jour tenu ce discours : Vous savez, Virginius, quelle fidélité on doit à l' histoire. Pardonnez-moi donc, je vous en supplie, si vous lisez, dans celle que j'écris, quelque chose que vous ne voudriez pas y lire. A cela Virginius répondit : Vous ne savez donc pas, Cluvius, que, dans tout ce que j' ai fait, je n'ai eu qu'un but : c'était de vous assurer, à vous autres historiens, la liberté d'écrire tout ce qu'il vous plairait.
Maintenant comparons-lui Frontinus en cela même où ce dernier vous paraît plus modeste et plus retenu. Il a défendu qu'on lui élevât un tombeau mais en quels termes? La dépense d'un tombeau est inutile. Mon nom ne périra point, si ma vie est digne de mémoire. Donner à lire à tout l'univers que la mémoire de notre nom durera, est-ce donc plus modeste que de marquer par deux vers, dans un coin du monde, une action que l'on a faite? Je n'ai pourtant pas l'intention de blâmer le premier, mais de défendre le second et comment le faire avec plus d'avantage qu'en lui comparant celui que vous lui avez préféré? A mon avis, ni l'un ni l'autre ne mérite de reproches. Tous deux, avec une égale ardeur, et par des routes différentes, ont recherché la gloire, l'un en réclamant les titres qui lui sont dus, l'autre en aimant mieux montrer qu'il les a méprisés. Adieu.
XX. — Pline à Venator.
Plus votre lettre était longue, plus elle m'a fait plaisir, parce qu'elle roulait tout entière sur mes ouvrages. Je ne suis point surpris qu'ils vous plaisent, puisque vous n'aimez pas moins tout ce qui vient de moi, que vous ne m'aimez moi-même. Je suis ici principalement occupé à faire mes vendanges. Elles sont assez maigres, mais plus abondantes que je ne l'espérais si toutefois c'est vendanger, que de m'amuser à cueillir une grappe de raisin, que de visiter mon pressoir, de goûter le vin doux dans la cuve, et de m'approcher de mes domestiques de ville qui, pour avoir l'œil sur nos campagnards, m'abandonnent à mes lecteurs et à mes secrétaires. Adieu.
XXI. - Pline à Sabinien.
Votre affranchi, contre lequel vous m'aviez dit que vous étiez en colère, est venu me trouver. Il s'est jeté à mes pieds, et il y est resté attaché, comme si c'eût été aux vôtres. Il a beaucoup pleuré, beaucoup prié, longtemps aussi il a gardé le silence, en un mot, il m'a convaincu de son repentir. Je le crois véritablement corrigé, parce qu'il reconnaît sa faute. Je sais que vous êtes irrité, je sais que vous l'êtes avec raison. Mais jamais la modération n'est plus louable que quand la colère est plus, juste. Vous avez aimé cet homme, et j'espère que vous lui rendrez un jour votre bienveillance. En attendant, il me suffit que vous m'accordiez son pardon. Vous pourrez, s'il le mérite encore, reprendre votre colère. Après s'être laissé désarmer une fois, elle sera bien plus excusable. Accordez quelque chose à sa jeunesse, à ses larmes, à votre bonté naturelle. Ne le tourmentez pas davantage, ne vous tourmentez plus vous-même : car, avec un caractère si doux, c'est vous tourmenter que de vous fâcher. Je crains de ne pas avoir l'air de prier, mais d'exiger, si je joins mes supplications aux siennes. Je les joindrai néanmoins, avec d'autant plus d'instance et d'abandon, que les réprimandes qu'il a reçues de moi ont été plus vives et plus sévères. Je l'ai menacé très positivement de ne jamais intercéder en sa faveur. Mais cette menace n'était que pour lui, qu'il fallait intimider, et non pour vous. Peut-être, en effet, serai-je encore une autrefois obligé de vous demander grâce, et vous de me l'accorder, si la faute est telle que nous puissions honnêtement, moi intercéder, et vous pardonner. Adieu.
XXII. —Pline à Sévèrus
La maladie de Passiénus Paulus m'a donné de vives inquiétudes, et pour plusieurs raisons, toutes fort légitimes. C'est, un excellent homme, d'une exacte probité et plein d'amitié pour moi. D'ailleurs, dans ses écrits, il imite les anciens, il prend leur physionomie, et, nous rend leurs beautés, surtout celles de Properce, dont il descend. Il est vraiment de sa famille, et lui ressemble surtout dans ce qu'il a de mieux. Si ses vers élégiaques vous tombent entre les mains, vous lirez des vers polis, tendres, agréables, et qui sortent réellement de la maison de Properce. Depuis peu, il s'est livré à la poésie lyrique, et il a, dans ce genre, reproduit Horace aussi heureusement qu'il a rendu Properce dans l'autre. On le croirait parent d'Horace, si la parenté est de quelque influence dans les lettres. Ses écrits sont pleins de grâces légères et de variété. Il parle d'amour comme s'il aimait ; il se plaint en homme désolé ; il loue avec une bonté charmante ; il badine avec l'enjouement le plus délicat ; en un mot, il est aussi parfait dans, tous les genres, que s'il n'excellait que dans un seul. Un tel ami, d'un si rare génie, ne m'avait pas moins rendu malade d'esprit, qu'il l'était de corps. Enfin nous sommes guéris tous deux. Félicitez-moi, félicitez les lettres mêmes qui ont couru autant de péril pendant sa maladie qu'elles tireront de gloire de sa santé. Adieu.
XXIII — Pline à Maxime.
Il m'est souvent, arrivé, quand j'ai plaidé, que les centumvirs, après avoir gardé longtemps cet air de gravité et de dignité qui convient aux juges, se sont subitement levés tous ensemble, comme par un mouvement involontaire, et m'ont félicité. J'ai souvent remporté du sénat tout, la gloire que je pouvais désirer. Mais jamais rien ne m'a autant fait de plaisir, que ce que m'a dit Tacite ces jours derniers. Il me contait qu'il s'était trouvé aux spectacles du Cirque, assis près d'un chevalier romain. Après une conversation savante et variée, le chevalier lui demanda : E tes vous d'Italie ou de quelque autre province? — Vous me connaissez, lui répondit Tacite ; c'est un avantage que je dois aux lettres. — Sériez-vous reprit celui-ci, ou Tacite ou Pline? Je ne puis vous exprimer combien je suis flatté que les lettres rappellent le souvenir de son nom et du mien, comme si ce n'étaient pas des noms d'hommes, mais les noms des lettres mêmes, et que, grâce à elles, nous soyons tous deux connus de gens qui d'ailleurs ne nous connaissent point. Il m'arriva dernièrement quelque chose de semblable. J'étais à table auprès de Fabius Rufinus, personnage très distingué. Audessus de lui était un de ses compatriotes qui venait d'arriver à Rome pour la première fois. Rufinus,me montrant du doigt, lui dit: V oyez-vous cet homme? Et ensuite il l'entretint de mon goût pour la littérature. — C'est Pline, dit l'autre. Voilà, je vous l'avoue, la plus douce récompense de mes travaux. Si Démosthène a pu légitimement se réjouir qu'une vieille femme d'Athènes l'ait désigné en disant : Voilà Démosthène ! ne dois-je pas aussi être charmé que mon nom soit connu? Je m'en applaudis donc, et je ne le cache pas car je ne crains pas de paraître vain, en racontant, non ce que je pense de moi, mais ce que le public en pense, surtout à vous qui ne portez envie à la gloire de personne, et qui vous intéressez à la mienne. Adieu,
XXIV. — Pline à Sabinien.
Je vous remercie d'avoir, à ma recommandation, reçu dans votre maison un affranchi que vous aimiez autrefois, et de lui avoir rendu vos bonnes grâces. Vous aurez à vous en féliciter, pour moi, je suis charmé de vous voir traitable dans la colère, et reconnaître que vous en avez, ou tant de déférence pour mes sentiments, ou tant d'égards pour mes prières. Je vous loue donc et je vous rends grâces. Mais en même temps je vous conseille d'avoir, à l'avenir, de l'indulgence pour les fautes de vos gens, quand même ils manqueraient d'intercesseur auprès de vous. Adieu
XXV. - Pline à Mamilien.
Vous vous plaignez d'être accablé de vos occupations à l'armée, et, comme si vous jouissiez d'un profond loisir, vous lisez les bagatelles que je compose en m'amusant. Vous les aimez, vous les demandez avec instance, et vous m'inspirez une pressante envie de ne m'en pas tenir là. Car depuis que ces opuscules ont l'approbation d'un homme aussi savant, aussi sage, et surtout aussi sincère que vous, je commence à croire qu'outre le plaisir, je puis encore trouver quelque gloire. Je suis maintenant chargé de causes qui, sans m'accabler, me donnent pourtant quelque embarras. Dès que j'en serai quitte, ma muse ira vous faire, encore quelques confidences, puisque vous les accueillez si bien. Vous ferez voler mes passereaux et mes colombes parmi vos aigles, si la bonne opinion que vous en avez conçue répond à leur confiance. Si vous les trouvez téméraires, vous aurez soin de les renfermer dans la cage ou dans le nid. Adieu.
XXVI. - Pline à Lupercus,
Je me suis exprimé, je crois, avec justesse, quand j'ai dit d'un orateur judicieux et sage de notre temps, mais trop timide et trop circonspect : Il n'a qu'un défaut, c'est de n'en point avoir. En effet, l'orateur doit s'élever, s'élancer, quelquefois s'échauffer, se laisser emporter, et souvent s'avancer jusqu'au bord du précipice. Il n'est guère de hauteur et de sommité qui ne soit voisine d'un abîme. Le chemin est plus sûr à travers la plaine, mais il est plus bas et plus obscur. Ceux qui rampent ne risquent point de tomber comme ceux qui courent mais il n'y a pour ceux-là nulle gloire à ne pas tomber : ceux-ci en acquièrent même en tombant. Les dangers ont leur prix dans l'éloquence, comme dans les autres arts. Lorsque nos funambules semblent le plus près de la chute, c'est alors qu'ils excitent les plus vives acclamations. Ce que nous admirons surtout, c'est ce qui passe notre attente, ce qui a été le plus hasardé, ce qui, dans la langue des Grecs, s'exprime mieux encore par le mot de «So .ov. Voilà pourquoi l'habileté du pilote est moins estimée dans le calme que dans la tempête. Dans le calme, il entre au port sans être admiré, sans être loué : point de gloire pour lui. Mais, quand les cordages sifflent, quand le mât plie, quand le gouvernail gémit, c'est alors qu'on le proclame illustre et qu'on l'égale presque aux dieux de la mer.
Pourquoi ces réflexions ? C'est que vous avez noté dans mes écrits quelques endroits où vous trouvez de l'enflure, et où je
ne trouvais, moi, que de l'élévation ; d'autres qui vous
paraissent forcés, et qui ne me semblaient que hardis, d'autres où vous voyez du luxe, et où je ne voyais que de la richesse. Il y a une grande différence entre les endroits défectueux et les endroits saillants. Chacun est frappé de tout ce qui a de la grandeur et de l'éclat Mais il faut un discernement bien fin, pour juger si c'est grandeur ou exagération, hauteur ou boursouflure. Et, pour parler d'abord d'Homère, qui ne remarquera pas, dans un sens ou dans l'autre, les passages suivants :
La terre s'en ébranle, et l'Olympe en mugit....
Et : Sur un nuage épais, sa lance est appuyée…
et tout ceci.
Ainsi que des torrents descendus des montagnes Remplissent les vallons, inondent les campagnes.
Mais il faut une mesure et une balance bien justes pour décider si c'est là du phébus et de l'amphigouri, ou bien du magnifique et du divin. Ce n'est pas que je m'imagine avoir dit ou pouvoir dire quelque chose de semblable : je ne suis pas assez fou pour le croire. Je veux seulement faire entendre qu'il faut quelquefois laisser un libre essor à l'éloquence, et ne pas renfermer dans un cercle trop étroit les mouvements impétueux du génie. Mais, dira-t-on, le style des orateurs n'est pas celui des poètes. Comme si, en effet, Cicéron était moins hardi! Je ne m'arrête pas à ses ouvrages, parce qu'il n'y a pas, je pense, de doute à son égard. Mais Démosthène lui-même, ce type, ce modèle de l'orateur, songe-t-il à mesurer et à contraindre son essor dans ce passage si connu : Ames de boue, vils flatteurs, détestables fléaux? Rappelez-vous encore cet endroit : Non, ce n'est point avec des briques ni avec des pierres que j'ai fortifié Athènes. Et bientôt après : Voici les remparts dont j'ai couvert l'Attique, autant que le pouvait la prudence humaine. Et ailleurs : Pour moi, je crois, Athéniens, oui, je crois qu'il est enivré de la grandeur de ses exploits. Est-il rien de plus hardi que cette éloquente et longue digression : U n mal contagieux...? Le trait suivant est plus court, mais n'est pas moins hardi : On ne me vit pas alors céder à l'insolence de Python qui se répandait en invectives contre vous. Ceci est du même caractère : Quand un homme s'élève par l'ambition et la perversité, comme Philippe, le moindre prétexte, le moindre revers suffit pour tout ébranler et tout dissoudre. Ce qui suit est pareil : Exclus de tous les droits de citoyen par les décisions de trois tribunaux.... Et dans le même discours : Sous ce rapport, Aristogiton, vous les avez frustrés de la compassion ; que dis-je? vous l'avez éteinte dans tous les cœurs. Ne vous réfugiez donc pas dans les sports que vous avez comblés vous-même et dont vous vous êtes fermé l'entrée. Il avait déjà dit : Je crains que vous ne paraissiez ouvrir la carrière à tout méchant déterminé : car le méchant est faible par lui-même. Et plus bas : Pour celui que j'accuse, je ne vois nulle part d'accès au pardon et à la pitié : tout est escarpé, tout est abime et précipice. Ce n'est pas tout : Je ne pense pas que nos ancêtres nous aient construit ces tribunaux pour y implanter des hommes d'un tel caractère, mais plutôt pour les réprimer, les punir, et empêcher ainsi que leur exemple n'excite dans les autres une funeste émulation. Il dit encore : Mais s'il commerce et trafique de méchanceté.... Et mille autres traits pareils, pour ne rien dire de ce qu'Eschine appelait, non des expressions, mais des prestiges. Je parle contre moi, quand je rappelle les reproches qu'Eschine lui adresse. Mais voyez l'avantage de l'écrivain critiqué sur celui qui le critique : cet avantage est fonde sur les passages même qui sont blâmés. Car si l'énergie est empreinte en d'autres parties des ouvrages de Démosthène, c'est en celles-ci qu'éclate la sublimité de son génie.
Et Eschine lui-même est-il exempt des défauts qu'il relève dans Démosthène? // faut, Athéniens, que l'orateur parle comme la loi. Mais si la loi et l'orateur ont un langage diffèrent, on doit donner son suffrage à l'équité de la loi, et non à l'impudence de l'orateur. Ailleurs : Ensuite il fait voir clairement que tout son décret n'a d'autre motif que le vol, lorsqu'il veut que les députés exigent des habitants d'Oréum qu'ils paient leurs cinq talents, non à vous, mais à Callias. Pour preuve que je dis vrai, laissant là l'emphase, les galères et la forfanterie de son décret, lisez. Et dans un autre endroit : Ne soufrez pas qu'il s'écarte par des faux fuyants du sujet de contravention à la loi .... Ce qu'il a si fort approuvé, qu'il ajoute : Toujours en observation et sur vos gardes dam ce jugement, obligez-le de se renfermer dans sa cause, et défiez-vous de ses détours artificieux. Est-il plus mesuré, et plus timide lorsqu'il dit : Chaque jour vous nous faites de nouvelles blessures, et vous vous inquiétez plus du succès de vos discours que du salut de l'Etat ? Ce qui suit est encore plus énergique : Ne chasserez-vous pas l e fléau commun de la Grèce ? ou plutôt, ne saisirez vous point, pour le punir, cet usurpateur du gouvernement qui nous maîtrise avec des paroles ? Et beaucoup d'autres endroits.
Je suis sûr que vous allez critiquer certains passages de cette lettre, ainsi que vous avez censuré ceux de l'ouvrage que je cherche à justifier, comme le gouvernail qui gémit ; le pilote comparé aux dieux de la mer : car je m'aperçois qu'en voulant défendre ce que vous blâmez, je suis retombé dans la même faute. Mais critiquez tant qu'il vous plaira, pourvu que vous me donniez un jour où nous puissions discuter de vive voix et vos anciennes et vos nouvelles critiques. En effet, ou vous me rendrez moins téméraire, ou je vous rendrai plus hardi. Adieu.

XXVII. – Pline à Paternus.
J'ai souvent senti, mais jamais autant que ces jours derniers, la puissance, la grandeur, la majesté, et, en quelque sorte la divinité de l'histoire. Quelqu'un avait lu en public une relation très sincère, et en avait réservé une partie pour un autre jour. Plusieurs de ses amis vinrent le prier, le supplier de ne point lire le reste : tant ceux qui n'avaient pas rougi de faire ce qu'ils entendaient, rougissaient d'entendre ce qu'ils avaient fait! Il leur accorda leur demande, et il le pouvait sans trahir la vérité. Cependant l'histoire demeure aussi bien que l'action, et elle demeurera et elle sera lue avec d'autant plus d'empressement, qu'elle le sera plus tard. Car rien n'excite la curiosité des hommes, comme une longue attente. Adieu.
XXVIII. — Pline à Romanus.
J'ai enfin reçu trois de vos lettres à la fois, toutes des plus élégantes, toutes pleines de tendresse, et telles que je devais les espérer de vous, surtout après les avoir si longtemps attendues. Dans l'une, vous me chargez d'une fort agréable commission, de faire porter vos lettres à Plotine, cette femme si respectable par ses vertus. Je m'en acquitterai. Ensuite vous me recommandez Popilius Artémisius. J'ai satisfait immédiatement à ce qu'il souhaitait. Vous me marquez aussi que vos vendanges ont été chétives. En cela nous avons eu la même chance, quoique nos climats soient fort différents. Dans la seconde lettre, vous me mandez que tantôt vous dictez, tantôt vous écrivez beaucoup de choses qui me rendent présent à votre esprit. Je vous en remercie, et je vous en remercierais davantage, si vous aviez bien voulu me communiquer ce que vous dictez, ou ce que vous écrivez. En effet, il était juste qu'ayant eu communication de mes écrits, vous me fissez part des vôtres, quand même ils seraient destinés à d'autres qu'à moi. Vous me promettez, en finissant, qu'aussitôt que vous aurez appris le plan de vie que je me suis proposé, vous vous déroberez à toutes vos affaires domestiques pour vous rendre ici. Regardez-vous, donc déjà comme lié par des nœuds indissolubles. Dans la dernière, vous me dites que vous avez reçu mon plaidoyer pour Clarius, et qu'il vous a paru plus riche en développements que quand vous me l'avez entendu prononcer. Il est vrai qu'il est plus étendu, car j'y ai intercalé beaucoup de choses. Vous ajoutez que vous m'avez écrit d'autres lettres un peu plus travaillées. Vous demandez si je les ai remues. Non, et je meurs d'envie de les recevoir. Ne manquez donc pas de me les envoyer à la première occasion, avec les intérêts du retard. Je vous les compterai (et je ne le puis à moins) sur le pied de douze pour cent. Adieu.
XXIX. - Pline à Rusticus.
S'il vaut mieux exceller en une chose que d'être médiocre en plusieurs, du moins vaut-il mieux être médiocre en plusieurs, quand on ne peut exceller en une seule. C'est pour cette raison que je m'exerce à différents genres d'études, n'osant méfier à mes talents dans un genre unique. Quand donc vous lirez divers ouvrages de ma façon, ayez pour chacun l'indulgence que leur nombre vous demande. Est-il juste que, dans les autres arts, la quantité des ouvrages soit un titre à l'indulgence, et que dans les lettres, où il est bien plus difficile d'arriver à la perfection, on subisse une loi plus dure? Mais ne dois-je point vous paraître ingrat, lorsque je vous demande de l'indulgence ! Car si vous recevez les derniers ouvrages avec la même bonté que les premiers, je dois attendre des éloges, plutôt que de demander grâce. Il me suffit pourtant qu'on me fasse grâce. Adieu.
XXX. — Pline à Géminius.
Vous louez souvent dans vos conversations, et aujourd'hui dans vos lettres, votre ami Nonius, pour sa libéralité envers certaines personnes. Je le loue aussi, pourvu qu'il ne la borne pas à ces personnes. Je veux qu'un homme vraiment libéral donne à sa patrie, à ses parents, à ses alliés, à ses amis mais à ses amis qui sont dans le besoin, et non comme ces gens qui ne donnent, jamais tant qu'à ceux qui peuvent donner le plus. Ce n'est pas là, selon moi, donner son bien ; c'est, avec des présents trompeurs qui cachent l'hameçon et la glu, dérober le bien d'autrui. Il y a des personnes d'un caractère semblable, qui ne donnent à l'un que ce qu'elles enlèvent à l'autre, et qui obtiennent la réputation de générosité par leur avarice. La première règle, c'est de se contenter de ce que l'on a, après cela, d'embrasser, comme dans un cercle, selon l'ordre que la société prescrit, tous ceux qui ont besoin de protection et d'assistance. Si votre ami suit ces règles, on ne peut trop le louer. S'il en observe seulement quelques unes, il mérite moins d'éloges mais il en mérite toujours. Un modèle de libéralité, même imparfait, est aujourd'hui si rare! La soif de l'or a tellement saisi les hommes, qu'on dirait qu'ils ne possèdent pas leurs richesses, mais qu'ils en sont possédés. Adieu.
XXXI. — Pline à Sardus.
Depuis que je vous ai quitté, je n'en ai pas moins été avec vous. J'ai lu votre livre et, pour ne vous point mentir, j'ai lu particulièrement les endroits où vous parlez de moi, et où vous vous êtes si longuement étendu. Quelle abondance ! quelle variété ! Combien, sur un même sujet, de choses qui sans être les mêmes, ne sont pourtant pas différentes ! Mêlerai-je mes éloges à mes remercîments? Je ne puis m'acquitter dignement et des uns et des autres et si je le pouvais, je craindrais encore qu'il n'y eût de la vanité à vous louer d'un ouvrage dont je vous remercierais. J'ajouterai seulement que toutes les parties de votre ouvrage m'ont paru d'autant plus dignes d'éloge, qu'elles m'étaient plus agréables, et qu'elles m'ont d'autant plus charmé, qu'elles étaient plis parfaites. Adieu.
XXXII.- Pline à Titien
Que faites-vous? Qu'avez vous dessein de faire? Pour moi, je mène la vie la plus délicieuse, c'est-à-dire la plus oisive. De là vient que je ne veux point écrire de longues lettres, mais que j'aime à en lire. L'un convient à mon indolence, l'autre à mon loisir. Car rien n'est si paresseux qu'un homme indolent, et rien de si curieux qu'un homme oisif. Adieu.
XXXIII. - Pline à Caninius.
J'ai trouvé un sujet dont le fond est vrai, quoiqu'il ait tout l'air d'une fable. Il mérite d'être traité par un génie aussi fertile, aussi élevé, aussi poétique que le vôtre. J'en ai fait la découverte à table où chacun contait à l'envi son prodige. L'auteur passe pour très véridique (et, après tout, qu'importe la vérité à un poète?). Cependant c'est un auteur auquel vous ne refuseriez pas d'ajouter foi, si vous écriviez l'histoire.
Près de la colonie d'Hippone, en Afrique, sur le bord de la mer, on voit un étang navigable, d'où sort, comme un fleuve, un large canal, tour à tour entraîné dans la mer, et repoussé dans l'étang par le flux et le reflux. Tous les âges viennent y prendre le plaisir de la pèche, de la navigation, du bain ; les enfants surtout qui en ont le goût et le temps. Ils mettent leur gloire et leur courage à s'avancer le plus loin qu'ils peuvent du rivage. Celui qui s'en éloigne le plus, et qui laisse derrière lui tous les autres, est le vainqueur. Dans cette sorte de lutte, un enfant plus hardi que ses compagnons s'étant aventuré fort loin, un dauphin se présente, le suit, tourne autour de lui, se glisse sous son corps, le laisse, le reprend et l'emporte tout tremblant, d'abord en pleine mer mais bientôt après, il revient à terre, et le rend au rivage et à ses camarades.
Le bruit s'en répand dans la colonie. On accourt en foule. Cet enfant est une merveille qu'on ne peut trop regarder. On l'interroge, on l'écoute, on raconte son aventure. Le lendemain, on assiège le rivage. Tous les yeux sont fixés sur la mer ou sur ce qui lui ressemble. Les enfants se mettent à la nage, et parmi eux celui dont je vous parle, mais avec plus de précaution. Le dauphin revient à la même heure, et s'adresse au même enfant. Celui-ci prend la fuite avec les autres. Le dauphin, comme s'il voulait le rappeler et l'attirer, saute, plonge et fait cent tours différents. Même scène le lendemain, le jour suivant, et plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que ces jeunes gens, presque élevés sur la mer, rougissent de leur crainte. Ils approchent du dauphin, ils l'appellent, ils jouent avec lui, ils le touchent, et il semble s'offrir à leurs mains. Cette épreuve les encourage. L'enfant surtout qui en avait fait le premier essai, ose nager auprès du dauphin, et sauter sur son dos. Il est porté et rapporté. Reconnu, aimé de son compagnon, il l'aime à son tour. Ils n'éprouvent plus, ils n'inspirent plus de crainte : la confiance de l'un s'augmente avec la douceur de l'autre. Les enfants même nagent autour de lui, et l'animent par leurs paroles et par leurs cris. Notre dauphin était accompagné d'un autre (et ceci n'est pas moins merveilleux), qui se contentait de le suivre et de le regarder. Il ne partageait point ses jeux, il ne souffrait point qu'on l'y mêlât : il le conduisait et le ramenait, comme les enfants conduisaient et ramenaient leur camarade.
On ne pourra le croire (et pourtant ceci n'est pas moins vrai que ce qui précède), le dauphin, en portant cet enfant et en jouant avec lui, s'avançait ordinairement jusque sûr le rivage. Après s'être séché sur le sable, dès qu'il sentait la chaleur, il se rejetait à la mer. On dit qu'Octavius Avitus, lieutenant du proconsul, cédant à une superstition, profita du moment où le dauphin était sur le rivage pour faire répandre sur lui des parfums dont l'odeur inconnue le chassa en pleine mer. Plusieurs jours s'écoulèrent sans qu'il parût. Enfin il revint, d'abord languissant et triste. Bientôt après, avec ses forces, il reprit sa première gaieté, et recommença ses jeux ordinaires. Tous les magistrats des lieux voisins accouraient à ce spectacle. Leur arrivée et leur séjour engageaient cette ville, assez pauvre, à de nouvelles dépenses, qui achevaient de l'épuiser. Enfin elle y perdait les douceurs de la tranquillité et de l'isolement. On prit donc le parti de tuer secrètement l'objet de cette curiosité générale.
Quelle compassion sa mort n'excitera-t-elle pas dans vos vers! Avec quelle éloquence, avec quelle grâce n'embellirez-vous pas cette histoire, quoiqu'elle n'ait besoin ni d'art ni d'inventions nouvelles, et qu'il suffise de ne rien ôter à la vérité ! Adieu.
XXXIV. —Pline à Suétone.
Tirez-moi d'un embarras. On me dit que je lis mal les vers, les vers seulement car, pour les harangues, je les lis assez bien, et c'est précisément pour cela que je réussis moins à la lecture des vers. Je songe donc à en faire lire quelques pièces à mes amis par mon affranchi, dont j'essaierai le talent en cette occasion. C'est agir, je le sens, avec la liberté d'un ami, que de choisir un lecteur qui n'est pas excellent ; mais il lira toujours mieux que moi, pourvu qu'il ne se trouble pas car il est aussi nouveau lecteur, que moi nouveau poète. Ce qui m'embarrasse, c'est le personnage qu'il me faudra faire pendant qu'il lira. Dois je demeurer assis, les yeux baissés, muet, et comme un homme oisif ou bien dois-je, comme on fait quelquefois, accompagner sa lecture de l 'œil, du geste ou de la voix? Mais je ne sais pas mieux gesticuler que je ne sais lire. Je vous le répète donc, tirez-moi d'embarras, et écrivez-moi sincèrement s'il vaut encore mieux dire très mal, que de faire ou ne pas faire ce que je vous dis. Adieu.
XXXV.- Pline à Appius.
J'ai reçu le livre que vous m'avez envoyé : je vous en remercie. Il m'a trouvé fort occupé, et, par cette raison, je ne l'ai pas encore lu, quoique d'ailleurs j'en aie le plus vif désir. Mais je dois ce respect aux belles-lettres et à vos écrits, de croire que je ne pourrais, sans une espèce d'irréligion, en approcher avec un esprit qui ne serait pas entièrement libre. J'approuve très fort votre zèle à retoucher vos écrits : il faut cependant qu'il ait des bornes. On affaiblit un ouvrage à force de le polir et puis ce travail ne permet pas d'en entreprendre un autre : il ne rend pas meilleurs nos anciens ouvrages, et nous empêche en même temps d'en commencer de nouveaux. Adieu.
XXXVI. - Pline à Fuscus.
Vous demandez comment je règle ma journée en été dans ma villa de Toscane? Je m'éveille quand je puis, ordinairement vers la première heure, quelquefois avant, rarement plus tard. Je tiens mes fenêtres fermées : car le silence et les ténèbres laissent à l'esprit toute sa force. N'étant pas distrait par les objets extérieurs, il demeure libre et maître de lui-même. Je ne veux pas assujettir mon esprit à mes yeux ; j'assujettis mes yeux à mon esprit : car ils ne voient, que ce qu'il voit, tant qu'ils ne sont pas attentifs à autre chose. Si j'ai quelque ouvrage commencé, je m'en occupe, Je dispose jusqu'aux paroles, comme si j'écrivais et corrigeais. Je travaille, tantôt plus, tantôt moins, selon que je me trouve plus ou moins de facilité à composer et à retenir. J'appelle un secrétaire, je fais ouvrir les fenêtres, et je dicte ce que j'ai composé. Il me quitte ; je le rappelle encore une fois, et je le renvoie. A la quatrième ou cinquième heure (car mes moments ne sont pas régulièrement distribués), selon le temps qu'il fait, je vais me promener dans une allée ou dans une galerie. Je continue de composer et de dicter. Ensuite je monte en voiture et là, mon attention étant ranimée par le changement, je reprends l'ouvrage entrepris pendant que j'étais couché ou que je me promenais. Je dors un peu, puis je me promène. Je lis à haute voix une harangue grecque ou latine, moins pour me fortifier la voix que la poitrine mais la voix elle-même en profite. Je me promène encore une fois, on me frotte d'huile , je fais de l'exercice, je me baigne. Pendant le repas, si je mange avec ma femme ou avec un petit nombre d'amis, on fait une lecture. Au sortir de table vient un comédien ou un joueur de lyre. Après quoi je me promène avec mes employés, parmi lesquels il y en a de fort instruits. La soirée se prolonge ainsi par une conversation variée, et les jours, quoique fort longs, s'écoulent rapidement.
Quelquefois je m'écarte un peu de cet ordre. Car si je suis resté au lit, ou si je me suis promené longtemps après mon sommeil et ma lecture, je ne monte pas en voiture, mais à cheval : je vais plus vite, et reviens plus tôt. Mes amis viennent me voir des villes voisines, et m'occupe une partie de la journée. Ils me délassent quelquefois par uns utile diversion. Je chasse de temps en temps, mais jamais sans mes tablettes, afin que si je ne prends rien, je rapporte au moins quelque chose. Je donne aussi quelques heures à mes fermiers, trop peu à leur avis. Mais leurs plaintes rustiques ne servent qu'à me donner plus de goût pour les lettres et pour les occupations de la ville. Adieu.
XXXVII. — Pline à Paulinus.
Vous n'êtes pas homme à exiger de vos amis, et contre leurs intérêts, les devoirs de convention, de pure cérémonie, et je vous aime trop pour craindre que vous ne jugiez mal de moi, si je manque à vous féliciter sur votre consulat le jour même des calendes. Je suis retenu ici par la nécessité de trouver des fermiers : il s'agit de mettre des terres en valeur pour longtemps, et de changer tout le plan de leur régie. Car, les cinq dernières années, mes fermiers sont demeurés fort en resté, malgré les grandes remises que je leur ai faites. De là vient que la plupart négligent de diminuer leur dette, désespérant de pouvoir l'acquitter entièrement. Ils arrachent même et consument tout ce qui est déjà sur terre, persuadés que ce ne serait pas pour eux qu'ils épargneraient. Il faut donc aller au-devant d'un désordre qui augmente tous les jours, et y remédier. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de ne point affermer en argent, mais en nature à partager dans la récolte avec le fermier, et de préposer quelques-uns de mes gens pour avoir l'œil sur la culture des terres, pour exiger ma part dans les fruits, et pour les garder. D'ailleurs il n'est pas de revenu plus légitime que celui qui nous vient de la terre, du ciel et des saisons mais il exige une probité parfaite, des yeux vigilants et beaucoup de bras. Je veux pourtant essayer de tenter, comme dans une maladie invétérée, tous les secours que le chan gement des remèdes pourra me donner. Vous voyez que ce n'est pas pour mon plaisir, que je m'abstiens d'assister à votre installation dans le consulat. Je vous promets pourtant d'en célébrer le jour par mes vœux, par ma joie, par mes félicitations, comme si j'étais présent. Adieu.

XXXVIII. — Pline à Saturnin.
Si je loue notre ami Rufus, ce n'est point parce que vous m'en avez prié, mais parce qu'il en est très digne. J'ai lu son livre qui est parfait et mon amitié pour l'auteur lui prêtait encore un charme de plus. Cependant je l'ai bien jugé : car, pour être bon juge, il ne suffit pas de lire avec des intentions malignes. Adieu.
XXXIX. — Pline à Mustius.
Je me vois obligé, par l'avis des aruspices, de reconstruire et d'agrandir un temple de Cérès qui se trouve dans mes terres. Quoique vieux et petit, il est très fréquenté à une époque fixe : aux ides de septembre, le peuple s'y rassemble de tous les pays d'alentour. On y traite beaucoup d'affaires ; on y fait, et on y acquitte beaucoup de vœux. Mais, près de là, l'on ne trouve aucun abri contre le soleil ou contre la pluie. J'imagine donc qu'il y aura tout à la fois piété et munificence à élever un temple somptueux, et à joindre au temple un portique ; l'un pour la déesse, l'autre pour les hommes. Je vous prie donc de m'acheter quatre colonnes de marbre, de telle espèce qu'il vous plaira, et tout le marbre qui peut être nécessaire pour paver le temple et en incruster les murs. Il faut aussi commander ou se procurer une statue de la déesse. Le temps a mutilé dans quelques parties la statue de bois que l'on y avait anciennement placée. Quant au portique, je crois ne devoir rien faire venir du pays où vous êtes. Je vous prie seulement de m'en tracer la forme. Il n'est pas possible de le construire autour du temple, environné d'un côté par le fleuve, dont les rives sont fort escarpées, de l'autre par le grand chemin. Au delà du chemin est une vaste prairie, où il me semble qu'on pourrait fort bien élever le portique en face du temple, à moins que vous n'ayez à me proposer quelque chose de mieux, vous dont l'art sait si bien surmonter les obstacles que lui oppose la nature. Adieu.
XL. — Pline à Fuscus.
La lettre où je vous racontais de quelle manière je règle ma journée en été dans ma maison de Toscane, vous a fait, dites-vous, beaucoup de plaisir. Vous désirez savoir ce que je change à cet ordre en hiver, quand je suis à ma villa de Laurente. Rien, si ce n'est que je me retranche la méridienne, et que je prends beaucoup sur la nuit, soit avant que le jour commence, soit après qu'il est fini. S'il survient quelque affaire pressante, ce qui est fréquent en hiver, je congédie après le repas le comédien et le joueur de lyre. Je revois de temps en temps ce que j'ai dicté, et, en corrigeant souvent, sans rien écrire, j'exerce d'autant ma mémoire. Vous voilà instruit de mon régime d'hiver et d'été, vous pouvez ajouter encore de l'automne et du printemps. Dans ces saisons moyennes, comme je ne perds rien du jour, je ne gagne presque rien sur la nuit. Adieu.
LIVRE DIXIÈME. Retour
I. - Pline à l'empereur Trajan.
Votre piété, vertueux empereur, vous avait fait désirer de ne succéder que fort tard à votre père; mais les dieux immortels sont hâtés de remettre en de si nobles mains les rênes d'un empire déjà confié à vos soins. Je vous souhaite donc, et, par vous, au genre humain, toutes sortes de prospérités, c'est-à-dire, tout ce qui est digne de votre règne. Excellent prince, je fais des voeux publics et particuliers pour le bonheur et la santé de votre personne sacrée.
II. Pline à l'empereur Trajan.
Je ne puis exprimer, seigneur, de quelle joie vous m'avez comblé en me jugeant digne du privilége réservé aux pères de trois enfants. Je sais que vous avez accordé cette grâce aux sollicitations de Julius Servianus, homme d'une rare probité, et qui vous aime tendrement; mais, je n'en puis douter aux termes du rescrit : vous avez cédé d'autant plus volontiers à sa demande que j'en étais l'objet. Je n'ai plus de voeux à former, quand vous daignez, dès le commencement de votre heureux principat, me témoigner une bienveillance particulière. Cette faveur redoublera en moi le désir d'avoir des enfants. J'en ai souhaité sous le plus malheureux de tous les règnes, ainsi que l'attestent les deux mariages que j'ai contractés; mais les dieux en ont mieux ordonné en réservant à vos bontés le pouvoir de tout m'accorder. Je serai plus content d'être père, aujourd'hui, que je puis me promettre de vivre heureux et tranquille.
III. - Pline à l'empereur Trajan.
La bienveillance dont vous m'honorez, seigneur, et dont je reçois tant de preuves, m'enhardit à vous demander des grâces, même pour mes amis, entre lesquels Voconius Romanus tient le premier rang. Dès notre plus jeune âge, nous avons été élevés et nous sommes toujours demeurés ensemble. Ces raisons m'avaient engagé à supplier votre auguste père de vouloir bien lui donner place dans le sénat.
Mais il a été réservé à votre bonté de me faire cette faveur, parce que la mère de Romanus ne lui avait pas encore assuré avec les solennités requises le don des quarante millions de sesterces qu'elle avait déclaré lui faire dans les lettres qu'elle avait écrites à l'empereur votre père. Elle a depuis satisfait à tout, selon mes avis. Elle lui a cédé des fonds de terre, en observant dans cette cession les formalités nécessaires. Ainsi, aujourd'hui que l'obstacle qui retardait nos espérances est levé, c'est avec une grande confiance que je sollicite pour mon ami. Je vous réponds de ses moeurs que relèvent encore son goût pour les nobles études et sa tendresse pour ses parents. C'est à cette tendresse qu'il doit la libéralité de sa mère, l'avantage d'avoir recueilli sur-le-champ la succession de son père, celui d'avoir été adopté par son beau-père. Ajoutez l'éclat de sa naissance et des richesses de sa famille. J'espère assez en vos bontés pour penser que mes prières donneront quelque poids à ces motifs. Daignez donc, seigneur, me mettre à même de le féliciter sur l'accomplissement de ce que je souhaite tant pour lui et, par votre condescendance pour mes affections, que j'ose croire honorables, faites que je puisse me glorifier de votre estime, non-seulement pour moi, mais encore pour mes amis.
IV. - Pline à l'empereur Trajan.
Une cruelle maladie, seigneur, pensa m'emporter l'année dernière. J'eus recours à un médecin dont je ne puis dignement reconnaître le zèle et les services, si vos bontés ne m'aident à m'acquitter. Je vous supplie donc de lui accorder le droit de cité: car, ayant été affranchi par une étrangère, il est lui-même étranger. Il s'appelle Harpocras. Celle qui lui a donné la liberté s'appelait Thermutis, femme de Théon, morte il y a longtemps. Je vous supplie encore d'accorder le même droit, au premier degré, à Hélia et à Antonia Harméridés, affranchies d'Antonia Maximilla, femme d'un mérite distingué. Je ne vous adresse cette prière qu'à la sollicitation de leur maîtresse.
V. - Pline à l'empereur Trajan.
Je ne puis vous exprimer, seigneur, de quelle joie m'a comblé votre lettre, en m'apprenant que vous avez daigné accorder aussi le droit de cité d'Alexandrie à mon médecin Harpocras, quoiqu'à l'exemple de vos prédécesseurs vous vous fussiez fait une loi de ne la conférer qu'avec choix. Harpocras est du nome de Memphis. Je vous supplie donc, seigneur, de vouloir bien m'envoyer, comme vous me l'avez promis, une lettre pour Planta, gouverneur d'Égypte, votre ami. Je compte aller au-devant de vous pour jouir plus tôt du bonheur de votre présence, si impatiemment désirée, et je vous demande la permission d'aller à votre rencontre aussi loin qu'il me sera possible.
VI. - Pline à l'empereur Trajan.
Seigneur, le médecin Posthumius Marinus m'a tiré de ma dernière maladie. Je ne puis m'acquitter envers lui que par le secours des grâces que votre bonté ne refuse pas ordinairement à mes prières. Je vous supplie donc de vouloir bien conférer le droit de cité romaine à ses proches parents, Chrysippe, fils de Mithridate, et à sa femme Stratonice, fille d'Épigone; de concéder aussi la même faveur à Épigone et à Mithridate, enfants de Chrysippe, de manière qu'ils soient en la puissance de leur père, et qu'ils conservent leur droit sur leurs affranchis. J'ajoute une dernière supplication, c'est d'accorder le plein droit de cité romaine à Lucius Satrius Abascantius, à Publius Césius Phosphorus, et à Pancharie Sotéridès. C'est du consentement de leurs patrons que je vous le demande.
VII. - Pline à l'empereur Trajan.
Seigneur, je sais que ma demande est gravée dans votre mémoire, toujours si fidèle, quand il s'agit de faire du bien. J'ose cependant, comme vous me l'avez permis quelquefois, vous faire souvenir, et en même temps vous supplier de nouveau d'accorder la charge de préteur, qui est vacante, à Accius Sura. Quoiqu'il l'attende sans impatience, il fonde l'espoir de l'obtenir sur l'éclat de sa naissance, sur une vertu demeurée intègre dans une fortune plus que médiocre, et, avant tout, sur les circonstances heureuses qui engagent tous les citoyens dont la conscience est pure à rechercher et à briguer vos bonnes grâces.

VIII. - Pline à l'empereur Trajan.
Persuadé, seigneur, que rien ne peut donner une si haute opinion de mon caractère que les témoignages d'estime dont m'aura honoré un si bon prince, je vous supplie de vouloir bien ajouter la dignité, ou d'augure, ou de septemvir (car elles sont toutes deux vacantes), à celle où votre faveur m'a déjà élevé. Le sacerdoce me donnera le droit d'adresser publiquement aux dieux les voeux que je leur adresse sans cesse en particulier pour votre prospérité.
IX. - Pline à l'empereur Trajan.
Excellent prince, je félicite et la république et vous-même de la victoire si grande, si belle, si mémorable, que vous venez de remporter. Je prie les dieux immortels d'accorder un aussi heureux succès à toutes vos entreprises, pour que vous renouveliez et accroissiez par vos rares vertus la gloire de cet empire.
X. - Pline â l'emperur Trajan.
Servilius Pudens, que vous m'aviez envoyé, seigneur, est arrivé à Nicomédie le vingt-quatre novembre, et m'a enfin délivré de l'inquiétude d'une longue attente.
XI. - Pline à l'empereur Trajan.
Vos bienfaits, seigneur, m'ont très étroitement lié à Rosianus Géminus. Je l'ai eu pour questeur pendant mon consulat, et je l'ai toujours trouvé plein d'égards pour moi. Il continue, depuis que je suis sorti de charge, à me donner tant de marques de déférence, que son attachement particulier met le comble aux preuves publiques que j'avais déjà de son amitié. Je vous supplie donc de vouloir bien l'élever selon son mérite. Si vous daignez vous en fier à moi, vous lui accorderez même votre bienveillance. Il saura bien, par son exactitude à exécuter vos ordres, s'acquitter des charges les plus importantes. Si je m'étends moins sur son éloge, c'est que je me flatte que son intégrité, sa probité, son talent vous sont connus par les emplois qu'il a exercés sous vos yeux à Rome, et par l'honneur qu'il a eu de servir dans les mêmes armées que vous. Mais ce que je ne crois pas avoir fait autant que le veut mon amitié pour lui, c'est de vous supplier, seigneur, avec les dernières instances, de me donner au plus tôt la joie de voir croître la dignité de mon questeur, c'est-à-dire la mienne en sa personne.
XII. - Pline à l'empereur Trajan.
Il serait difficile, seigneur, d'exprimer la joie que j'ai éprouvée en voyant qu'à la prière de ma belle-mère et à la mienne, vous ayez bien voulu accorder le gouvernement de cette province à Célius Clémens, après son consulat. Quand je reçois de vous, avec toute ma maison, des témoignages d'une bienveillance si complète, je comprends parfaitement quelle est l'étendue de la faveur dont vous m'honorez. Quoique je sente bien à quelles actions de grâces elle m'oblige, je n'ose me hasarder à payer ma dette. C'est donc aux voeux que j'ai recours, et je prie les dieux de ne me rendre jamais à vos yeux indigne des faveurs dont vous me comblez chaque jour.
XIII. - Pline à l'empereur Trajan.
Lycormas, votre affranchi, m'a mandé, seigneur, que, s'il passait par ici des ambassadeurs du Bosphore pour aller à Rome, je les retinsse jusqu'à son arrivée. Il n'est encore venu, au moins dans la ville où je suis, aucun ambassadeur de ce pays-là; mais il y est arrivé un courrier de Sarmatie. J'ai cru devoir profiter de cette occasion pour le faire partir avec celui que Lycormas a envoyé et qui a pris les devants, afin que vous sachiez en même temps, et par les lettres de Lycormas et par celles du roi des Sarmates, les nouvelles qu'il vous importe peut-être de savoir tout à la fois.
XIV. - Pline à l'empereur Trajan.
Le roi des Sarmates m'a écrit qu'il vous mandait certaines choses dont il était important que vous fussiez instruit au plus tôt. Par cette raison, et pour lever tous les obstacles qu'aurait pu trouver sur la route le courrier qui vous porte ses dépêches, je lui ai donné un passe-port.
XV. - Pline à l'empereur Trajan.
L'ambassadeur du roi des Sarmates, seigneur, s'étant volontairement arrêté deux jours entiers à Nicée où il m'avait trouvé, je n'ai pas cru devoir y prolonger son séjour; premièrement, parce que je ne savais pas encore quand arriverait votre affranchi Lycormas, et puis parce que je partais moi-même, appelé par des affaires indispensables en d'autres endroits de la province. Je me crois obligé de vous mander ceci, parce que je vous avais écrit dernièrement que Lycormas m'avait prié de retenir jusqu'à son arrivée les ambassadeurs qui pourraient venir du Bosphore. Je ne vois aucune raison plausible de me conformer plus longtemps à cet avis, d'autant plus que les lettres de Lycormas, dont je n'ai pas voulu retarder le courrier, ainsi que je vous l'ai déjà mandé, auront devancé l'ambassadeur de quelques jours.
XVI. - Pline à l'empereur Trajan.
Apuléius, soldat de la garnison de Nicomédie, m'a écrit, seigneur, qu'un nommé Callidrome, arrêté par Maxime et Denys, boulangers, au service desquels il s'était engagé, avait cherché un asile aux pieds de votre statue. Conduit devant le magistrat, il avait déclaré qu'autrefois, et pendant qu'il était esclave de Labérius Maximus, il avait été pris par Susagus dans la Moesie, et donné par Décébale à Pacore, roi des Parthes; qu'il l'avait servi plusieurs années; qu'ensuite il s'était échappé, et s'était sauvé à Nicomédie. Amené devant moi, il m'a fait la même déclaration, et j'ai cru alors devoir vous l'envoyer. J'ai un peu différé, parce que je faisais rechercher une pierre précieuse où était gravée l'image du roi Pacore avec ses ornements royaux : on la lui avait volée, disait-il. Je voulais, si on eût pu la trouver, vous l'envoyer, comme je vous ai envoyé un lingot de métal qu'il disait avoir apporté du pays des Parthes. Je l'ai scellé de mon cachet dont l'empreinte est un quadrige.
XVII - Pline à l'empereur Trajan.
Pendant tout le temps, seigneur, que j'ai demeuré avec Maxime, votre affranchi et votre intendant, je l'ai toujours trouvé homme de bien, habile, appliqué, et aussi attaché à vos intérêts que rigoureux observateur de la discipline. C'est un témoignage que je lui rends avec plaisir, et avec toute la fidélité que je vous dois.

XVIII. - Pline â l'empereur Trajan.
J'ai trouvé, seigneur, dans Gabius Bassus, commandant sur la côte du Pont, toute l'intégrité, toute la probité, toutes les lumières possibles, accompagnées de beaucoup de déférence pour moi, et je ne puis lui refuser mes voeux et mon suffrage : je les lui accorde avec toute la fidélité que je vous dois. Car j'ai bien reconnu qu'il s'était formé en servant sous vous, et qu'il était redevable à la sévérité de votre discipline de tout ce qui lui a fait mériter votre bienveillance. Les soldats et les bourgeois ont si bien connu sa justice, qu'ils se sont empressés à l'envi de s'en louer en public et en particulier. C'est ce que je vous certifie avec toute la fidélité dont vos bontés m'ont fait un devoir.
XIX.- Pline à l'empereur Trajan.
Seigneur, Nymphidius Lupus le primipilaire, et moi, nous avons servi ensemble. J'étais à la tête d'une légion, et il commandait une cohorte : ainsi commença notre liaison. Le temps accrut ensuite notre mutuelle amitié. Je l'ai donc tiré de sa retraite, et je l'ai engagé à m'assister de ses conseils en Bithynie. C'est ce qu'il a fait d'une manière très obligeante; c'est ce qu'il continuera de faire, sans écouter ce que la vieillesse et l'amour du repos lui peuvent demander. Aussi je m'associe à toutes ses affections, et surtout à sa tendresse pour son fils, Nymphidius Lupus. C'est un jeune homme plein de droiture, de talent, et bien digne d'un père si distingué. Il saura répondre à votre bienveillance. Nous en avons pour garants la conduite qu'il a tenue comme chef de cohorte, et les honorables témoignages que lui ont accordés des hommes tels que Julius Férox et Fuscus Salinator. Je trouverai, seigneur, dans l'élévation du fils, un nouveau sujet de joie et de reconnaissance.
Correspondance de Pline et de Trajan
XX.- Pline à l'empereur Trajan.
Aussitôt que votre bienveillance, seigneur, m'a élevé à la place de préfet du trésor de Saturne, j'ai entièrement renoncé à plaider, ce qu'au reste je n'ai jamais fait indistinctement et sans choix. J'ai voulu me livrer tout entier aux devoirs de mon nouvel emploi. Voilà pourquoi, lorsque les peuples d'Afrique me demandèrent au sénat pour avocat contre Marius Priscus, je m'en excusai, et mon excuse fut reçue. Mais lorsque ensuite le consul désigné eut déclaré que ceux dont l'excuse avait été admise n'en étaient pas moins soumis à la puissance au sénat, et qu'ils devaient souffrir que leurs noms fussent jetés dans l'urne avec les autres, j'ai cru qu'on ne pouvait moins faire, sous un empire aussi doux que le vôtre, que de céder aux sages décrets de cette illustre compagnie. Je souhaite que vous approuviez les raisons de mon obéissance : car je ne veux rien faire, ni rien dire, qu'une prudence aussi éclairée que la vôtre puisse condamner.
XXI. - Trajan à Pline.
Vous avez rempli tous les devoirs d'un bon citoyen et d'un bon sénateur en déférant à ce que le sénat désirait justement de vous. Je ne doute pas que vous ne remplissiez avec fidélité le ministére dont vous avez été chargé.
XXII. - Pline à l'empereur Trajan.
Je vous rends gràces, seigneur, d'avoir bien voulu si promptement accorder le droit de bourgeoisie romaine aux affranchis d'une dame de mes amies, et à Harpocras, mon médecin. Mais lorsque j'ai voulu faire enregistrer son âge et son revenu, ainsi que vous me l'aviez ordonné, des gens habiles m'ont averti qu'avant de lui obtenir la bourgeoisie romaine, je devais lui obtenir celle d'Alexandrie, parce qu'il est Égyptien. Comme je ne croyais pas qu'il y eût de différence entre les Égyptiens et les autres peuples étrangers, je m'étais contenté de vous mander qu'il avait été affranchi par une étrangère, et que cette étrangère était morte, il y avait déjà longtemps. Je ne me plains pas pourtant de mon ignorance, puisqu'elle me donne lieu de recevoir de vous plus d'une grâce pour un même homme. Je vous supplie donc, afin que je puisse jouir de votre bienfait selon les lois, de lui accorder le droit de cité d'Alexandrie et de Rome. Pour ne rien laisser qui pût retarder le cours de vos bontés, j'ai envoyé son âge et l'état de ses biens à vos affranchis, comme vous me l'aviez commandé.
XXIII. - Trajan à Pline.
J'ai résolu, en suivant la coutume de mes prédécesseurs, de n'accorder qu'avec beaucoup de circonspection le droit de cité d'Alexandrie. Mais, après vous avoir déjà donné, pour Harpocras, votre médecin, le droit de bourgeoisie romaine, je ne puis me résoudre à vous refuser ce que vous me demandez encore pour lui. Faites-moi donc savoir à quel nome il appartient, afin que je vous envoie une lettre pour Pompéius Planta, gouverneur d'Égypte, mon ami.
XXIV. - Pline à l'empereur Trajan.
Après que votre auguste père eut invité tous les citoyens à la munificence par un magnifique discours et par de glorieux exemples, je lui demandai la permission de transporter dans ma ville adoptive les statues des empereurs qui m'étaient venues par différentes successions, et que, je gardais, telles que je les avais reçues, dans des terres éloignées. Je le suppliai de souffrir que j'y ajoutasse la sienne. Dès qu'il y eut consenti, en y joignant beaucoup de témoignages de satisfaction, j'en écrivis aux décurions, afin qu'ils marquassent le lieu où je pourrais bâtir un temple à mes frais. Ils crurent devoir, par honneur pour mon entreprise, me laisser le choix du lieu. Mais ce que je n'ai pu encore entreprendre, retenu d'abord par ma maladie, ensuite par celle de votre auguste père, et enfin par les devoirs de la charge que vous m'avez confiée, je crois pouvoir aisément l'exécuter aujourd'hui : car mon mois de service finit au premier septembre, et il y a beaucoup de fêtes dans le mois suivant. Je vous supplie donc, avant toute autre chose, de souffrir que votre statue ait sa place dans le temple que je vais bâtir ; ensuite, pour me mettre en état d'y travailler au plus tôt, de m'accorder un congé. Mais il ne convient pas à ma franchise de vous dissimuler qu'en m'accordant cette grâce, vous servirez beaucoup mes intérêts particuliers.
Il m'est tellement impossible de différer la location des terres que je possède dans ce pays, et dont le bail d'ailleurs passe quatre cent mille sesterces, que le fermier qui entrera en jouissance doit tailler les vignes aussitôt après la prochaine vendange. La continuelle stérilité m'oblige de plus à faire des remises que je ne puis bien régler, si je ne suis présent. Je devrai donc, seigneur, à vos bontés, et le prompt accomplissement du religieux devoir que je me suis imposé, et la satisfaction de placer mes statues, si vous voulez bien m'accorder un congé de trente jours : car un temps plus court ne me serait d'aucun usage, puisque la ville et les terres dont je parle sont à plus de cent cinquante milles de Rome.

XXV. - Trajan à Pline
Vous m'avez expliqué, pour obtenir votre congé, toutes les raisons tirées de l'utilité publique et de votre intérêt particulier; mais une seule me suffisait : c'est que vous le désiriez. Car je ne doute point qu'aussitôt que vous le pourrez, vous ne vous rendiez à un emploi qui exige tant d'assiduité. Je vous permets de placer ma statue dans le lieu que vous lui destinez, quoique j'aie résolu d'être fort réservé sur ces honneurs. Je ne veux pas avoir l'air de gêner l'expression de votre dévouement pour moi.
XXVI. - Pline à l'empereur Trajan.
Comme j'ose croire, seigneur, que cette nouvelle vous intéresse, je vous annonce que je suis arrivé à Éphèse avec toute ma suite, après avoir passé le cap Malée. En dépit des vents contraires, je me dispose à me rendre d'ici dans mon gouvernement, en employant tour à tour des bâtiments légers et des chariots: car si les chaleurs sont incommodes par terre, les vents Étésiens ne permettent pas non plus de faire toute la route par mer.
XXVII. - Trajan à Pline.
Votre avis m'a fait plaisir, mon cher Pline. Il importe à mon affection pour vous de savoir par quel chemin vous vous rendez dans votre gouvernement. Vous faites sagement d'user tantôt de chariots, tantôt de barques, selon que les lieux vous y invitent.
XXVIII. - Pline à l'empereur Trajan.
Ma navigation, seigneur, avait été très heureuse jusqu'à Éphèse. Mais dès que j'ai fait usage des voitures, l'extrême chaleur, et même quelques accès de fièvre m'ont forcé de m'arrêter à Pergame. M'étant rembarqué, j'ai été retenu par les vents contraires, et je suis arrivé en Bithynie un peu plus tard que je l'avais espéré, c'est-à-dire le quinzième jour avant les calendes d'octobre. Cependant je ne puis me plaindre de ce retard puisque je suis entré dans mon gouvernement assez tôt pour y célébrer le jour de votre naissance, ce qui est pour moi le plus favorable de tous les présages. J'examine actuellement l'état des affaires publiques des Prusiens, leurs charges, leurs revenus, leurs dettes. Plus j'avance dans cet examen, plus j'en reconnais la nécessité. D'un côté, plusieurs particuliers retiennent, sous divers prétextes, ce qu'ils doivent à cette république; et, de l'autre, on la surcharge par des dépenses qui ne sont guère légitimes. Je vous ai écrit tout ceci, seigneur, presque en arrivant. Je suis entré dans la province le quinzième jour avant les calendes d'octobre. Je l'ai trouvée dans les sentiments de soumission et de dévouement pour vous que vous méritez de tout le genre humain. Voyez, seigneur, s'il serait à propos que vous envoyassiez ici un architecte. Il me semble que si les ouvrages publics sont fidèlement mesurés, on pourra obliger les entrepreneurs de rapporter des sommes considérables. Au moins cela me parait ainsi, par l'examen que je fais avec Maxime des comptes de cette république.
XXIX. - Trajan à Pline.
Je voudrais que vous eussiez pu arriver en Bithynie sans que votre santé en souffrit, non plus que celle de vos gens, et que votre route depuis Éphèse vous eût été aussi commode que votre navigation avait été heureuse. Votre lettre m'apprend, mon cher Pline, quel jour vous êtes entré dans la Bithynie. Je ne doute pas aue ces peuples ne sentent bientôt que je m'occupe de leur bonheur. En effet, je suis sûr que vous n'oublierez rien de ce qui pourra prouver, qu'en vous choisissant j'ai choisi l'homme le plus propre à tenir ma place chez eux. Vous devez commencer par examiner les comptes des affaires publiques, car on dit qu'elles sont dans un grand désordre. Quant aux architectes, à peine en ai-je ici ce qu'il en faut pour les ouvrages publics qui se font à Rome et aux environs. Mais il n'y a point de province où il ne s'en trouve en qui l'on puisse avoir confiance. Vous n'en manquerez donc pas, si vous vous donnez bien la peine d'en chercher.
XXX. - Pline à l'empereur Trajan.
Je vous supplie, seigneur, d'éclairer mes doutes sur un point. Dois-je faire garder les prisons par des soldats, ou, comme on l'a pratiqué jusqu'ici, par des esclaves publics? Je crains qu'elles ne soient pas assez sûrement gardées par des esclaves, et que ce soin n'occupe un grand nombre de soldats. Cependant j'ai renforcé de quelques soldats la garde ordinaire des esclaves publics. Mais je m'aperçois que cette précaution a ses inconvénients, et qu'elle peut fournir aux esclaves et aux soldats une occasion de se négliger dans l'espérance de pouvoir rejeter les uns sur les autres une faute commune.
XXXI. - Trajan à Pline.
Il n'est pas nécessaire, mon cher Pline, d'employer les soldats à la garde des prisons. Tenons-nous en à l'usage toujours observé dans cette province, d'en confier le soin à des esclaves publics.
C'est à votre zèle et à votre sévérité à faire en sorte qu'ils s'en acquittent fidèlement. Car il est surtout à craindre, comme vous me le mandez, que si on les mêle ensemble, ils ne s'en reposent les uns sur les autres, et n'en deviennent plus négligents. Souvenons-nous d'ailleurs qu'il faut, autant qu'on le peut, ne point éloigner les soldats de leurs drapeaux.
XXXII. - Pline à l'empereur Trajan.
Gabius Bassus, qui commande sur la côte du Pont avec beaucoup de zèle et de dévouement pour votre service, est venu me trouver, seigneur, et est demeuré plusieurs jours avec moi. C'est, autant que je l'ai pu connaître, un homme distingué et digne de votre bienveillance. Je lui ai communiqué l'ordre que j'avais de ne lui laisser, de toutes les troupes dont il vous a plu de me donner le commandement, que dix soldas bénéficiaires, deux cavaliers et un centurion. Il m'a répondu que ce nombre ne lui suffisait pas, et qu'il vous en écrirait. Cela m'a empêché jusqu'ici de rappeler ceux qu'il a de plus.
XXXIII. - Trajan à Pline.
Gabius Bassus m'a écrit aussi que le nombre de soldats que je lui avais destiné ne lui suffisait pas. Vous demandez quelle a été ma réponse. Afin que vous en soyez bien informé, je la fais transcrire ici. Il importe beaucoup de distinguer ce qui est exigé par les circonstances, et ce qui est réclamé par les hommes avides d'étendre leur pouvoir. Quant à nous, l'utilité publique doit être notre seule règle, et nous devons, autant que possible, prendre garde que les soldats ne quittent point leurs drapeaux.
XXXIV. - Pline à l'empereur Trajan.
Les Prusiens, seigneur, ont un bain vieux et en mauvais état. Ils voudraient le rétablir, si vous le permettez. Je crois, après examen, qu'il est nécessaire d'en construire un nouveau, et il me semble que vous pouvez leur accorder leur demande. Les fonds pour le construire se composeront d'abord des sommes que j'ai obligé les particuliers à restituer, et puis de l'argent qu'ils avaient coutume d'employer à l'huile du bain, et qu'ils ont résolu de consacrer à la construction. C'est, d'ailleurs, ce que semblent exiger à la fois la beauté de la ville et la splendeur de votre règne.
XXXV. - Trajan à Pline.
Si la construction d'un nouveau bain n'est point à charge aux Prusiens, nous pouvons leur accorder ce qu'ils souhaitent, pourvu qu'ils n'imposent aucune contribution pour cet ouvrage, et qu'ils ne prennent rien sur leurs besoins ordinaires.

XXXVI. - Pline à l'empereur Trajan.
Maximus, votre affranchi et votre intendant, m'assure, seigneur, qu'outre les dix soldats que, par votre ordre, j'ai donnés à l'honorable Gémellinus, il en a besoin aussi pour lui. J'ai cru lui devoir laisser provisoirement ceux qui étaient déjà attachés à sa commission, surtout le voyant partir pour se procurer des blés en Paphlagonie. J'y ai même ajouté deux cavaliers qu'il m'a demandés pour sa garde. Je vous supplie de m'apprendre ce que vous voulez dans la suite que je fasse.
XXXVII. - Trajan à Pline.
Vous avez bien fait de donner des soldats à mon affranchi qui partait pour aller chercher des blés : car il s'acquittait en cela d'une commission extraordinaire. Quand il sera revenu à son premier emploi, il aura assez des deux soldats que vous lui avez donnés, et des deux qu'il a reçus de Virbius Gémellinus, mon intendant, auquel il sert de second.
XXXVIII. - Pline à l'empereur Trajan.
Sempronius Coaelianus, jeune homme plein de mérite, m'a envoyé deux esclaves qu'il a trouvés parmi les soldats de recrue. J'ai différé leur supplice, afin de vous consulter sur le genre de peine à leur infliger, vous le créateur et le soutien de la discipline militaire. Pour moi, j'ai quelque scrupule, parce que, bien qu'ils eussent prété serment, ils n'étaient encore enrôlés dans aucune légion. Ayez donc la bonté, seigneur, de me prescrire vos intentions dans une occasion qui doit faire exemple.
XXXIX. -Trajan à Pline.
Sempronius Coelianus a exécuté mes ordres, quand il vous a envoyé des hommes dont il fallait juger le crime en connaissance de cause, pour savoir s'il était capital. Mais il faut bien distinguer s'ils se sont offerts volontairement, ou s'ils ont été choisis, ou enfin s'ils ont été donnés pour en remplacer d'autres. S'ils ont été choisis, c'est la faute de l'officier chargé des levées; s'ils ont été donnés pour en remplacer d'autres, il faut s'en prendre à ceux qui les ont donnés si, quoique instruits de leur état, ils sont venus volontairement s'offrir, il faut les punir. Il importe peu qu'ils n'aient été encore distribués dans aucune légion : car, le jour qu'ils ont été engagés, ils ont dû déclarer leur origine.
XL. - Pline à l'empereur Trajan.
Puisque vous m'avez donné, seigneur, le droit de vous consulter sur mes doutes, il faut, sans déroger à votre grandeur, que vous descendiez aux moindres soins qui m'embarrassent. Dans la plupart des villes, particulièrement à Nicomédie et à Nicée, des hommes condamnés, soit aux mines, soit aux combats de gladiateurs, soit à d'autres peines semblables, servent comme esclaves publics, et reçoivent même des gages en cette qualité. J'en ai été averti mais j'ai beaucoup hésité sur ce que je devais faire. D'un côté, je trouvais trop rigoureux de renvoyer au supplice, après un long temps, des hommes dont la plupart sont vieux maintenant, et dont la conduite, m'assure-t-on, est sage et réglée, de l'autre, je ne croyais pas convenable de retenir au service de la république des criminels condamnés; mais aussi je jugeais qu'il lui serait inutile de les nourrir oisifs, et dangereux de ne les nourrir pas. J'ai donc été contraint de suspendre ma décision jusqu'à la vôtre. Vous demanderez peut-être comment il a pu se faire qu'ils se soient dérobés à leur condamnation. Je m'en suis informé, sans en avoir pu rien découvrir que j'ose vous certifier. Les décrets de leur condamnation m'ont été représentés; mais je n'ai vu nul acte qui prouve que la peine leur ait été remise. Il y en a pourtant quelques-uns qui m'ont dit que, sur leurs instantes supplications, les gouverneurs ou leurs lieutenants les avaient fait mettre en liberté. Ce qui pourrait donner lieu de le penser, c'est qu'il n'est pas croyable qu'on eût osé l'entreprendre sans y être autorisé.
XLI. - Trajan à Pline.
Souvenez-vous que si vous avez été envoyé dans cette province, c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup d'abus à réformer. L'un des plus grands qui doivent disparaître, c'est que des criminels condamnés à des peines capitales, non seulement en aient été affranchis sans ordre supérieur, mais encore qu'on leur rende les privilèges des esclaves irréprochables. Il faut donc faire subir leur condamnation à ceux qui ont été jugés dans le cours des dix dernières années, et qui n'en ont pas été valablement déchargés. S'il s'en trouve de plus anciennement jugés, des vieillards, dont la condamnation remonte à plus de dix ans, il faut les employer à des travaux qui se rapprochent de leurs peines. Ordinairement on charge ces malheureux de soigner les bains, de nettoyer les égouts, de travailler aux réparations des grands chemins et des rues.
XLII. - Pline à l'empereur Trajan.
Perdant que je visitais une autre partie de ma province, un incendie affreux a consumé à Nicomédie, non seulement plusieurs maisons particulières, mais même deux édifices publics, la Maison-de-Ville et le temple d'Isis, quoique la voie les séparât. Ce qui a contribué à en étendre les ravages, c'est d'abord la violence du vent, ensuite l'insouciance du peuple : car il parait certain que, dans un si grand désastre, il est demeuré spectateur oisif et immobile. D'ailleurs, il n'y a dans la ville, pour le service public, ni pompes, ni crocs, enfin aucun des instruments nécessaires pour éteindre le feu. J'ai donné des ordres pour qu'il y en ait à l'avenir. C'est à vous, seigneur, d'examiner s'il serait bon d'établir une communauté de cent cinquante artisans. J'aurai soin, en effet, que l'on n'y reçoive que des artisans, et qu'on ne fasse point servir à autre chose le privilége accordé. Il ne serait pas difficile de surveiller une association aussi peu nombreuse.
XLIII. - Trajan à Pline.
Vous avez pensé qu'on pouvait établir une communauté à Niconédie, à l'exemple de plusieurs autres villes. Mais n'oublions pas combien cette province et ces villes surtout ont été troublées par les sociétés de ce genre. Quelque nom que nous leur donnions, quelque raison que nous ayons de former un corps de plusieurs personnes, il s'y établira, au moins passagèrement, des intelligences de confrérie. II sera donc plus prudent de se procurer tout ce qui peut servir à éteindre le feu, d'engager les posseseurs des biens de ville à en arrêter eux-mêmes les ravages, et, si les circonstances l'exigent, d'y employer le concours de la multitude.
XLIV. - Pline à l'empereur Trajan.
Nous avons acquitté, seigneur, et renouvelé nos voeux solennels pour votre conservation à laquelle est attaché le salut de l'empire; nous avons en même temps prié les dieux de permettre que ces voeux soient toujours accomplis, et que le témoignage en subsiste toujours.
XLV. - Trajan à Pline.
J'ai appris avec plaisir, par votre lettre, mon cher Pline, que vous aviez acquitté, avec le peuple de votre gouvernement, les voeux faits aux dieux immortels pour ma santé, et que vous en aviez fait de nouveaux.
XLVI. - Pline à l'empereur Trajan.
Les habitants de Nicomédie, seigneur, ont dépensé pour se construire un aqueduc, trois millions trois cent vingt-neuf mille sesterces, et cet ouvrage a été laissé imparfait; il est même détruit. On en a depuis commencé un autre, et l'on y a dépensé deux millions de sesterces. Il a été encore abandonné; et, après avoir si mal employé tout cet argent, il faut faire une nouvelle dépense, si l'on veut avoir de l'eau. J'ai trouvé une source très pure, d'où il semble que l'on en pourra tirer, ainsi que l'on avait d'abord tenté de le faire, par un ouvrage cintré, afin que l'eau ne soit pas seulement portée à la basse ville. Il nous reste encore quelques arcades de cet ouvrage. On peut en élever d'autres: les unes, avec de la pierre carrée, tirée du premier édifice; d'autres, je crois, pourront être bâties en briques ce qui sera plus aisé et moins coûteux. Il est surtout nécessaire que vous veuillez bien nous envoyer un ingénieur ou un architecte pour éviter ce qui est arrivé. Je puis seulement vous répondre que, par son utilité et par sa beauté, cette entreprise est tout à fait digne de votre règne.
XLVII. - Trajan à Pline.
Il faut avoir soin de faire conduire de l'eau à Nicomédie. Je suis très persuadé que vous dirigerez cette entreprise avec tout le zèle nécessaire. Mais, en vérité, vous n'en devez pas moins apporter à découvrir par la faute de qui les habitants de Nicomédie ont perdu de si grandes sommes, et si ces ouvrages commencés et laissés ne leur ont point servi de prétexte à se faire des gratifications mutuelles. Vous me ferez savoir ce que vous en aurez appris.

XLVIII. - Pline à l'empereur Trajan.
Le théâtre de Nicée, bâti en très grande partie, mais encore inachevé, a déjà coûté, seigneur, plus de dix millions de sesterces. C'est du moins ce que l'on me dit, car je n'en ai pas vérifié le compte. Je crains que cette dépense ne soit inutile. Le théâtre s'affaisse et s'entr'ouvre déjà, soit par la faute du terrain, qui est humide et mou, soit par celle de la pierre, qui est mince et sans consistance. Il y a lieu de délibérer si on l'achèvera, si on l'abandonnera, ou même s'il faut le détruire : car les appuis et les constructions dont on l'étaie de temps en temps me paraissent moins solides que dispendieux. Des particuliers ont promis un grand nombre d'accessoires, des basiliques autour du théâtre, des galeries qui en couronnent les derniers gradins. Mais ces travaux sont ajournés, depuis qu'on a suspendu la construction du théâtre qu'il faut d'abord achever. Les mêmes habitants de Nicée ont commencé, avant mon arrivée, à rétablir un gymnase que le feu a détruit; mais ils le rétablissent beaucoup plus considérable et plus vaste qu'il n'était. Cela leur coûte encore, et il est à craindre que ce ne soit sans utilité: car il est irrégulier, et les parties en sont mal ordonnées. Outre cela, un architecte (à la vérité, c'est le rival de l'entrepreneur) assure que les murs, quoiqu'ils aient vingt-deux pieds de large, ne peuvent soutenir la charge qu'on leur destine, parce qu'ils ne sont, point liés avec du ciment et flanqués de briques.
Les habitants de Claudiopolis creusent aussi, plutôt qu'ils ne bâtissent, un bain immense dans un bas-fond dominé par une montagne. Ils y emploient l'argent que les sénateurs surnuméraires que vous avez daigné agréger à leur sénat, ont déjà offert pour leur entrée, ou paieront dès que je leur en ferai la demande. Comme je crains que les deniers publics dans une de ces entreprises, et que dans l'autre vos bienfaits (ce qui est plus précieux que tout l'argent du monde) ne soient mal placés, je me vois obligé de vous supplier d'envoyer ici un architecte pour déterminer le parti à prendre à l'égard et du théâtre et des bains. Il examinera s'il est plus avantageux, après la dépense qui a été faite, d'achever ces ouvrages d'après le premier plan, ou bien de changer ce qui doit l'être, de déplacer ce qui doit être déplacé. Car il faut craindre, en voulant conserver ce que nous avons déjà dépensé, de perdre ce que nous dépenserons encore.
XLIX. - Trajan à Pline.
C'est à vous, qui êtes sur les lieux, d'examiner et de régler ce qu'il convient de faire relativement au théâtre de Nicée. Il me suffira de savoir à quel parti vous vous êtes arrêté. Le théâtre achevé, n'oubliez pas de réclamer des particuliers les accessoires qu'ils ont promis d'y ajouter. Les Grecs aiment beaucoup les gymnases, et ce goût excessif pourrait bien leur avoir fait entreprendre indiscrètement celui-ci. Mais il faut sur ce point qu'ils se contentent du nécessaire. Quant aux habitants de Claudiopolis, vous leur ordonnerez ce que vous jugerez le plus à propos sur le bain dont ils ont, dites-vous, si mal choisi l'emplacement. Vous ne pouvez manquer d'architectes. Il n'est point de province où l'on ne trouve des gens entendus et habiles à moins que vous ne pensiez qu'il soit plus court de vous en envoyer d'ici, quand nous sommes obligés de les faire venir de Grèce.
L. - Pline à l'empereur Trajan.
Quand je songe à votre rang et à votre grandeur d'âme, il me semble que c'est un devoir de vous proposer des ouvrages dignes de votre gloire et de l'immortalité de votre nom, des ouvrages dont l'utilité égale la magnificence. Sur les confins du territoire de Nicomédie est un lac immense dont on se sert pour transporter jusqu'au grand chemin, à peu de frais et sans beaucoup de peine, le marbre, les fruits, le bois et toute sorte de matériaux. De là on les conduit jusqu'à la mer sur des chariots, ce qui coûte beaucoup de travail et plus encore d'argent. Pour remédier à cet inconvénient, il faudrait beaucoup de bras; mais ils ne manquent pas ici. La campagne et la ville surtout sont fort peuplées, et l'on peut compter que tout le monde s'empressera de travailler à un ouvrage utile à tout le monde. Il faudrait seulement, si vous le jugez à propos, envoyer ici un ingénieur ou un architecte qui examinât de près si le lac est plus haut que la mer. Les experts de ce pays soutiennent qu'il est plus élevé de quarante coudées. J'ai trouvé près de là un bassin creusé par un roi. Mais on ne sait pas trop si c'était pour recevoir les eaux des champs d'alentour, ou pour joindre le lac à un fleuve voisin: car ce bassin est demeuré imparfait. On ignore également si cet ouvrage a été abandonné parce que ce roi fut surpris par la mort, ou parce qu'il désespéra du succès. Mais je désire ardemment pour votre gloire (vous excuserez une telle ambition) de vous voir achever ce que les rois n'ont fait que commencer.
LI. - Trajan à Pline.
La jonction de ce lac à la mer peut me tenter; mais il faut avant tout s'assurer complétement qu'en l'y joignant il ne s'y écoulera pas tout entier. Instruisez-vous de la quantité d'eau qu'il reçoit, et d'où elle lui vient. Vous pourrez demander à Calpurnius Macer un ingénieur; et moi, je vous enverrai d'ici quelque artiste habile dans ces sortes d'ouvrages.
LII. - Pline à l'empereur Trajan.
En examinant les dépenses publiques des Byzantins, dépenses qui se montent très haut, j'ai appris, seigneur, que pour vous offrir leurs hommages et vous en porter le décret, ils vous envoyaient tous les ans un député auquel ils donnaient douze mille sesterces. Attentif à l'exécution de vos desseins, j'ai retenu le député, et je vous envoie le décret, épargnant ainsi les deniers de la province, sans nuire à l'accomplissement des devoirs publics. La même ville est chargée de trois mille sesterces, qu'elle paie tous les ans pour frais de voyage à celui qui va de sa part saluer le gouverneur de Mésie. J'ai cru qu'il fallait retrancher ces dépenses à l'avenir. Je vous supplie, seigneur, de vouloir bien me faire connaître votre avis, et de daigner me confirmer dans ma pensée ou corriger mon erreur.
LIII. - Trajan à Pline.
Vous avez très bien fait, mon cher Pline, d'épargner aux Byzantins les douze mille sesterces alloués au député qu'ils m'envoient tous les ans pour me renouveler les assurances de leur soumission. Le décret seul que vous m'adressez y suppléera suffisamment. Le gouverneur de Mésie voudra bien aussi leur pardonner, s'ils ne lui font pas leur cour à si grands frais.
LIV. - Pline à l'empereur Trajan.
Je vous supplie, seigneur, de me marquer vos intentions sur les passe-ports dont le terme est expiré; si c'est votre volonté qu'ils continuent, et pour combien de temps. Dans l'incertitude où je suis, je crains de me tromper dans l'un ou dans l'autre sens, soit que j'autorise des choses défendues, soit que j'en défende de permises.
LV. - Trajan à Pline.
Les passe-ports dont le terme est expiré ne doivent plus servir, et je me fais un devoir particulier d'en envoyer dans toutes les provinces, avant qu'elles puissent en avoir besoin.
LVI. - Pline à l'empereur Trajan.
Lorsque j'ai voulu, seigneur, connaitre les débiteurs publics d'Apamée, ses revenus et ses dépenses, on m'a représenté qu'ils souhaitaient tous que je discutasse les comptes de leur ville ; que cependant aucun des proconsuls ne l'avait fait avant moi; que c'était pour eux un privilége et une ancienne coutume d'administrer à leur discrétion les affaires publiques. J'ai voulu qu'ils exposassent dans une requête tout ce qu'ils ont dit et rappelé. Je vous l'ai adressée telle que je l'ai reçue, quoiqu'ils l'aient remplie de détails dont la plupart sont étrangers à la question. Je vous supplie de vouloir bien me prescrire ce que je dois faire car j'ai peur d'avoir dépassé les bornes, ou de n'avoir pas rempli toute l'étendue da mon devoir.
LVII. - Trajan à Pline.
La requête des habitants d'Apamée, jointe à votre lettre, m'a dispensé de l'obligation d'examiner les raisons qui ont empêché, disent-ils, les proconsuls d'examiner leurs comptes, puisqu'ils ne refusent pas de vous les communiquer. Pour récompenser leur droiture, je veux donc qu'ils sachent que l'examen que vous en ferez par mon ordre ne dérogera ni ne préjudiciera point à leurs priviléges.
LVIII. - Pline à l'empereur Trajan.
Avant mon arrivée, les habitants de Nicomédie avaient entrepris d'ajouter une nouvelle place publique à l'ancienne. Dans un angle se trouve un temple de Cybèle qu'il faut reconstruire ou transférer ailleurs, par la raison surtout qu'il se trouve aujourd'hui beaucoup trop bas, auprès du nouvel ouvrage dont l'élévation est considérable. Je me suis informé s'il y avait eu quelque acte de consécration, et j'ai appris qu'elle se faisait ici autrement qu'à Rome. Je vous supplie donc, seigneur, d'examiner si un temple, qui n'a point été solennellement consacré, peut être transféré sans offenser la religion. Rien ne sera plus facile, si la religion le permet.
LIX. - Trajan à Pline.
Vous pouvez, sans scrupule, mon très cher Pline, si la situation des lieux le demande, transporter le temple de Cybèle de l'endroit où il est à celui qui lui convient mieux. S'il ne se trouve point d'acte de consécration, c'est une circonstance qui ne doit pas vous arrêter : le sol d'une ville étrangère ne comporte pas la consécration selon les rites de notre patrie.

LX. - Pline à l'empereur Trajan.
Nous avons célébré, seigneur, avec tout l'enthousiasme que vous devez inspirer, ce jour où, vous chargeant de l'empire, vous l'avez sauvé. Nous avons prié les dieux de conserver votre personne sacrée et vos vertus au genre humain dont elles font le repos et la sûreté. Vos troupes et tout le peuple ont renouvelé entre mes mains leur serment de fidélité dont je leur ai dicté la formule, d'après la coutume ordinaire, et tous ont à l'envi signalé leur zèle.
LXI. - Trajan à Pline.
J'ai appris avec plaisir par votre lettre, mon cher Pline, que vous avez, à la tête des troupes et du peuple, célébré avec autant de joie que de zèle le jour de mon avènement à l'empire.
LXII. - Pline à l'empereur Trajan.
Je crains, seigneur, que les deniers publics que j'ai déjà fait recouvrer par vos ordres, et que l'en recouvre encore actuellement, ne demeurent sans emploi. On ne trouve pas l'occasion d'acheter des fonds de terre, ou du moins elle est fort rare. On ne trouve pas, non plus, des gens qui veuillent devoir à une république, principalement pour lui payer des intérêts à douze pour cent par an, et sur le même pied qu'aux particuliers. Examinez donc, seigneur, s'il serait à propos de les prêter à un intérêt plus bas, et d'inviter par là des débiteurs solvables à les prendre; ou si, en supposant qu'avec cette facilité on n'en puisse encore trouver, il ne faudrait point obliger les décurions à s'en charger, chacun pour sa part, sous bonne et suffisante caution. Quelque fâcheux qu'il soit de les contraindre, il le sera toujours moins quand l'intérêt sera plus modique.
LXIII. - Trajan à Pline.
Je ne vois, comme vous, mon cher Pline, d'autre remède que de baisser le taux de l'intérêt pour trouver à placer plus aisément les deniers publics. Vous en règlerez le cours sur le nombre de ceux qui se présenteront pour les demander. Mais il ne convient pas à la justice qui doit honorer mon règne, de forcer quelqu'un à emprunter un argent qui pourrait lui être inutile.
LXIV. - Pline â l'empereur Trajan.
Je vous rends mille grâces, seigneur, d'avoir daigné, au milieu de tant d'importantes affaires, m'éclairer sur celles que j'ai soumises à vos lumières. Je vous demande encore aujourd'hui la même faveur. Un homme est venu me trouver, et m'a fait connaître que ses adverses parties, condamnées par l'illustre Servilius Calvus à un bannissement de trois ans, séjournaient encore dans la province. Ceux-ci ont soutenu, au contraire, qu'ils avaient été réhabilités par Calvus lui-même, et m'en ont lu le décret. En conséquence, j'ai cru nécessaire d'en référer à votre sagesse: car vos instructions portent bien que je ne dois pas relever de leur condamnation ceux qui auront été condamnés, soit par moi, soit par un autre; mais il n'y est rien dit de ceux qu'un autre aura condamnés et rétablis. J'ai donc cru, seigneur, qu'il fallait savoir de vous ce qu'il vous plaisait que je fisse, non seulement de ces gens, mais même de ceux qui, après avoir été bannis à perpétuité hors de la province, y sont toujours demeurés, quoiqu'ils n'aient point été relevés de la condamnation : car j'ai à décider aussi sur cette espèce. On m'a amené un homme banni à perpétuité par Julius Bassus. Comme je sais que tout ce qui a été fait par Bassus a été cassé, et que le sénat a donné à tous ceux que Bassus avait condamnés le droit de réclamer et de demander un nouveau jugement dans les deux ans, j'ai demandé au banni, si dans les deux ans il s'était adressé au gouverneur, et l'avait instruit de l'affaire. Il m'a répondu que non. J'ai donc à vous consulter sur ceci : dois-je lui faire subir la peine qui lui était destinée, ou le condamner à une peine plus grande? et, dans ce dernier cas, quelle peine lui imposer, à lui et à ceux qui se trouveront dans une pareille position? je joins à cette lettre le jugement rendu par Calvus, et l'acte qui l'annule. Vous y trouverez aussi le jugement prononcé par Bassus.
LXV. - Trajan à Pline.
Je vous manderai prochainement ce qu'il faut faire de ceux qui ont été bannis pour trois ans par P. Servilius Calvus, et qui, après avoir été réhabilités par ses édits, sont restés dans la province. Je veux apprendre d'abord, de Calvus même, les motifs qui l'ont fait agir ainsi. Quant à celui qui, banni à perpétuité par Julius Bassus, pouvait, s'il se croyait injustement condamné, réclamer pendant deux ans, et qui, sans l'avoir fait, est toujours demeuré dans la province, vous l'enverrez lié aux préfets du prétoire : car il ne suffît pas de faire exécuter contre un coupable la condamnation à laquelle il a eu l'audace de se soustraire.
LXVI. - Pline à l'empereur Trajan.
Comme je convoquais des juges pour tenir ma séance, Flavius Archippus a demandé une dispense en qualité de philosophe. Quelques personnes ont prétendu qu'il fallait, non pas l'affranchir de l'obligation de juger, mais le retrancher tout à fait du nombre des juges, et le rendre au supplice auquel il s'était dérobé en se sauvant de prison. On rapportait la sentence de Vélius Paulus, proconsul, qui le condamne aux mines comme faussaire. Archippus ne présentait aucun acte qui l'eût réhabilité, mais il prétendait y suppléer, et par une requète qu'il avait adressée à Domitien, et par des lettres honorables de ce prince qui le réhabilitaient, et parr une délibération des habitants de Pruse. Il joignait à tout celaa des lettres que vous lui aviez écrites, un édit de votre auguste père, et une de ses lettres, par laquelle il confirmait toutes les grâces que Domitien avait accordées. Ainsi, malgré les crimes qu'on lui imputait, j'ai cru devoir ne rien résoudre sans avoir su vos intentions sur une affaire qui me paraît digne d'être décidée par vous-même. Je renferme dans ce paquet tout ce qui a été dit de part et d'autre.
LETTRE DE DOMITIEN A TÉRENCE MAXIME.
Flavius Archippus, philosophe, a obtenu de moi qu'on lui achetât aux environs de Pruse, sa patrie, une terre de six cent mille sesterces, avec le revenu de laquelle il pût nourrir sa famille. Je vous ordonne de lui faire payer cette somme, et de la porter en dépense dans le compte de mes libéralités.
LETTRE DU MÊME A LUCIUS APPIUS MAXIMUS.
Je vous recommande Archippus, philosophe, homme de bien, qui n'est point au-dessous de sa profession, et qui soutiendrait même une plus grande élévation. Accordez-lui, mon cher Maxime, une entière bienveillance pour toutes les demandes raisonnables qu'il pourra vous adresser.
ÉDIT DE NERVA.
Romains, il est, sans contredit, certaines choses dont le bonheur seul des circonstances fait un devoir, et dont il ne faut pas faire honneur à la bonté du prince. Il suffit de me connaître; il suffit de s'interroger. Il n'est pas un citoyen qui ne puisse répondre que j'ai sacrifié mon repos particulier au repos public, afin d'être en état de répandre de nouvelles grâces, et de maintenir celles qui ont été accordées avant moi. Cependant, pour que l'allégresse générale ne soit troublée ni par la crainte de ceux qui les ont obtenues, ni par la mémoire de celui qui les a données, j'ai cru qu'il était bon et nécessaire de prévenir tous ces doutes en expliquant ma volonté. Je ne veux pas qu'on pense que, si l'on a obtenu de mes prédécesseurs quelque privilège ou public ou particulier, je puisse l'annuler pour qu'on me doive de l'avoir rétabli.. Tous ces privilèges sont reconnus et confirmés. Il ne faudra pas renouveler les remerciements pour une grâce déjà obtenue de la bienveillance d'un empereur. Qu'on me laisse m'occuper de bienfaits nouveaux, et qu'on ne sollicite que ce qu'on n'a pas.
LETTRE DU MÊME A TULLIUS JUSTUS.
La résolution que j'ai prise de respecter tout ce qui a été fait par mes prédécesseurs veut que l'on défère aussi aux lettres de Domitien.
LXVII - Pline à l'empereur Trajan.
Flavius Archippus m'a conjuré, par vos jours sacrés et par votre gloire immortelle, de vous envoyer la requête qu'il m'a présentée. Je lui ai accordé ce qu'il demandait, mais après en avoir averti la personne qui l'accuse. De son côté, elle m'a donné une requête, que je joins aussi à cette lettre, afin que vous puissiez prononcer, comme si vous aviez entendu les deux parties.
LXVIII. - Trajan à Pline.
Domitien a bien pu ignorer le véritable état d'Archippus, lorsqu'il écrivait tant de choses honorables pour lui. Mais il est plus conforme à mon caractère de croire que ce prince, par ces marques d'estime, a voulu le réhabiliter. Ce qui me confirme dans cette opinion , c'est l'honneur des statues qui lui a été tant de fois décerné par ceux qui n'ignoraient pas le jugement que Paulus, leur gouverneur, avait rendu. Ce que je vous écris, mon cher Pline, ne doit pourtant pas vous empêcher de le poursuivre, si on l'accuse de quelque nouveau crime. J'ai lu les requêtes de Furia Prima, accusatrice, et celles d'Archippus, que vous aviez jointes à votre lettre.
LXIX. - Pline à l'empereur Trajan.
Votre sage prévoyance, seigneur, vous fait craindre que le lac, une fois uni au fleuve, et par conséquent à la mer, ne s'y écoule tout entier. Mais moi, qui suis sur les lieux, je crois avoir trouvé un moyen de prévenir ce danger. On peut, par un canal, conduire le lac jusqu'au fleuve, mais sans l'y introduire. Il restera une côte qui l'en séparera, et qui contiendra les eaux. Ainsi, sans le réunir au fleuve, nous jouirons du même avantage que si leurs eaux se confondaient : car il sera aisé de transporter sur le fleuve, par cette rive étroite, tout ce qui aura été chargé sur le canal. C'est le parti qu'il faudra prendre, si la nécessité nous y force; mais je ne crois pas que nous devions le craindre. Le lac par lui-même est assez profond, et de l'extrémité opposée à la mer sort un fleuve.
Si l'on en arrête le cours dans cette direction pour le porter du côté où nous en avons besoin, il versera dans le lac, sans aucune perte, toute l'eau qu'il en détourne aujourd'hui. D'ailleurs, sur la route qu'il faut creuser au canal, coulent des ruisseaux qui, recueillis avec soin, augmenteront encore la masse d'eaux fournies par le lac. Toutefois si l'on aimait mieux prolonger et resserrer le canal, le mettre au niveau de la mer, et, au lieu de le conduire dans le fleuve, le verser dans la mer même, le reflux de la mer arrêterait les eaux du lac, et les lui conserverait. Si la nature du lieu ne nous permettait aucun de ces expédients, il nous serait facile de nous rendre maîtres du cours des eaux par des écluses.
Tout cela sera mieux conçu et calculé par l'ingénieur que vous devez m'envoyer, seigneur, comme vous me l'avez promis : car cette entreprise est digne de votre magnificence et de vos soins.
J'ai écrit, suivant vos ordres, à l'illustre Calpurnius Macer de m'envoyer l'ingénieur le plus propre à ces travaux.
LXX. - Trajan à Pline.
Il paraît, mon cher Pline, que vous n'avez négligé ni soins ni recherches pour le succès de l'entreprise du lac, puisque vous avez rassemblé tant d'expédients pour éviter qu'il ne s'épuise, et pour nous le rendre d'un usage plus commode. Choisissez donc celui que la nature des lieux vous fera juger le plus convenable. Je compte que Calpurnius Macer vous fournira un ingénieur, car les provinces où vous êtes ne manquent pas de ces hommes habiles.
LXXI. - Pline à l'empereur Trajan.
L'état et l'entretien des enfants, appelés ici du nom de g-Threptoi (nourris), sont la matière d'une grande question qui intéresse toute la province. Comme, dans les constitutions de vos prédécesseurs, je n'ai trouvé sur ce sujet aucune décision, ni générale ni particulière, qui s'appliquât à la Bithynie, j'ai cru devoir vous consulter sur vos intentions à cet égard : car je ne pense point qu'il me soit permis de me régler par des exemples dans ce qui ne doit être décidé que par votre autorité. On m'a lu un édit qu'on me disait être d'Auguste pour Annia, des lettres de Vespasien aux Lacédémoniens, de Titus aux mêmes et aux Achéens et enfin de Domitien aux proconsuls Avidius Nigrinus, Arménius Brocchus, et aux Lacédémoniens. Je ne vous les envoie point, parce que ces pièces ne me paraissent pas en assez bonne forme; quelques-unes même ne me semblent pas authentiques. Je sais d'ailleurs que les véritables originaux sont en bon état dans vos archives.
LXXII. - Trajan à Pline.
On a souvent traité la question relative aux enfants nés libres, exposés, recueillis ensuite par quelque citoyen, et élevés dans la servitude. Mais, parmi les constitutions de mes prédécesseurs, il ne s'en trouve sur ce sujet aucune qui regarde toutes les provinces. Il est vrai qu'il existe des lettres de Domitien à Avidius Nigrinus et à Arménius Brocchus, sur lesquelles on pouvait peut-être se régler. Toutefois parmi les provinces dont elles parlent il n'est point fait mention de la Bithynie. Je ne crois donc pas, ni que l'on doive refuser la liberté à ceux qui la réclameront sur un tel fondement, ni qu'on les puisse obliger à la racheter par le remboursement des aliments qu'on leur aura fournis.
LXXIII. - Pline à l'empereur Trajan.
Plusieurs personnes m'ont demandé permission de transporter d'un lieu dans un autre les cendres de leurs parents dont les tombeaux ont été détruits, ou par l'injure des temps, ou par des inondations, ou par d'autres accidents et elles se sont fondées sur les exemples de mes prédécesseurs. Mais, comme je sais qu'à Rome on n'entreprend rien de semblable sans en avoir référé au collége des pontifes, j'ai cru devoir vous consulter, seigneur, vous souverain pontife, pour conformer ma conduite à vos volontés.
LXXIV. - Trajan à Pline.
Il y aurait de la dureté à contraindre ceux qui demeurent dans les provinces de s'adresser aux pontifes, lorsque, par des raisons légitimes, ils désireront transporter, d'un lieu dans un autre, les cendres de leurs parents. Vous ferez donc bien mieux de suivre l'exemple de vos prédécesseurs, et d'accorder ou de refuser cette autorisation, suivant la justice des demandes.
LXXV. - Pline à l'empereur Trajan.
Je cherchais à Pruse, seigneur, une place où l'on pût commodément élever le bain que vous avez permis à ses habitants de bâtir. J'en ai trouvé une qui me convient. On y voit encore les ruines d'une maison qui, dit-on, a été fort belle. Je trouve ainsi, le moyen d'embellir la ville que ces ruines défigurent, et même d'en accroître la grandeur. Je ne démolis aucun bâtiment, et je répare, au contraire, ceux que le temps a détruits. Voici ce que j'ai appris de cette maison. Claudius Polyénus l'avait léguée à l'empereur Claude auquel il voulut que l'on dressât un temple dans une cour environnée de colonnes, et que le reste fût loué. La ville en a touché quelque temps le revenu. Ensuite le pillage et la négligence ruinèrent peu à peu toute cette maison, ainsi que le, péristyle, de sorte qu'il n'en reste presque plus rien que la place.
Si vous daignez, seigneur, ou la donner ou la faire vendre aux Prusiens qui y trouveront un emplacement commode, ils en seront reconnaissants comme du plus grand bienfait. S'ils obtiennent ce qu'ils demandent, je me propose d'établir le bain dans cette cour, vide aujourd'hui, d'entourer de galeries et de siéges les lieux où étaient autrefois les bâtiments, enfin de vous consacrer cet ouvrage dont la ville sera redevable à vos bontés, et qui, par sa magnificence, sera digne de votre nom. Je vous envoie une copie du testament, quoiqu'elle soit peu correcte. Vous verrez que Polyénus, outre la maison, avait laissé, pour l'embellir, bien des choses qui ont péri comme elle. J'en ferai pourtant la plus exacte recherche que je pourrai.

LXXVI. - Trajan à Pline.
On peut se servir, pour bâtir le bain des Prusiens, de cet emplacement, et de cette maison tombée en ruine, qui est vide comme vous me le mandez. Mais vous ne me marquez point assez nettement si l'on a élevé un temple à Claude dans la cour environnée de colonnes. Car si le temple a été élevé, quoique depuis il ait été détruit, la place demeure toujours consacrée.
LXXVII. - Pline à l'empereur Trajan.
Plusieurs personnes m'ont pressé de prononcer sur les questions d'état relatives à la reconnaissance des enfants et à leur rétablissement dans tous les droits de leur naissance suivant une lettre de Domitien à Minutius Rufus, et conformément à l'exemple de mes prédécesseurs. Mais, ayant examiné le décret du sénat sur cette matière, j'ai trouvé qu'il ne parle que des provinces qui sont gouvernées par des proconsuls. Par cette raison, j'ai tout suspendu, jusqu'à ce qu'il vous ait plu, seigneur, de me faire savoir vos intentions.
LXXVIII. - Trajan à Pline.
Quand vous m'aurez envoyé le décret du sénat qui a causé vos doutes, je déciderai s'il vous appartient de prononcer sur ce qui regarde les reconnaissances des enfants, et leur rétablissement dans tous les droits de leur naissance.
LXXIX. - Pline à l'empereur Trajan.
Julius Largus, de la province du Pont, que je n'avais jamais vu, dont je n'avais même jamais entendu parler, estimant en moi l'homme de votre choix, seigneur, m'a chargé, en mourant, des derniers hommages qu'il a voulu rendre à votre personne sacrée. Il m'a prié, par son testament, d'accepter sa succession, d'en faire le partage, et, après en avoir retiré pour moi cinquante mille sesterces, de remettre le surplus aux villes d'Héraclée et de Thiane, pour qu'il soit employé, selon que je le trouverais plus à propos, ou à des ouvrages qui vous seraient consacrés, ou à des jeux publics que l'on célébrerait tous les cinq ans, et. que l'on appellerait les jeux de Trajan. J'ai cru, seigneur, vous en devoir informer, pour savoir ce qu'il faut choisir.
LXXX. - Trajan à Pline.
Julius Largus vous a choisi pour placer en vous sa confiance, comme s'il vous eût parfaitement connu. C'est donc à vous, pour immortaliser son nom, à examiner et à faire ce qui conviendra le mieux, selon les moeurs du pays.
LXXXI. - Pline à l'empereur Trajan.
Dans votre sage prévoyance, seigneur, vous avez donné ordre à l'illustre Calpurnius Macer d'envoyer un centurion légionnaire à Byzance. Daignez examiner si les habitants de Juliopolis ne mériteraient point une pareille faveur. C'est une très petite ville, qui supporte pourtant de très grandes charges, et qui est d'autant plus foulée qu'elle est plus faible. D'ailleurs le bien que vous ferez aux habitants de Juliopolis, vous le ferez à toute la province: car ils sont à l'entrée de la Bithynie, et fournissent le passage aux nombreux vovageurs qui la traversent.
LXXXII. - Trajan à Pline.
La ville de Byzance est si considérable par le concours de ceux qui y abordent de toutes parts, que nous n'avons pu nous dispenser, à l'exemple de nos prédécesseurs, de lui accorder un centurion légionnaire pour veiller à la conservation des priviléges de ses habitants. Accorder la même grâce à ceux de Juliopolis, ce serait nous engager par un exemple imprudent. D'autres villes nous demanderaient la même faveur avec d'autant plus d'instances qu'elles seraient plus faibles. J'ai confiance dans vos soins, et vous n'oublierez rien, j'en suis sûr, pour préserver les habitants de Juliopolis de toute injustice. Si quelqu'un agit contre mes ordonnances qu'il soit réprimé aussitôt. Dans le cas où la faute serait trop grave pour qu'on la punît sur-le-champ, si le coupable était soldat, vous en informeriez ses chefs; s'il devait venir à Rome, vous m'en donneriez avis.
LXXXIII. -- Pline à l'empereur Trajan.
La loi Pompéia, donnée à la Bithynie, défend d'exercer aucune magistrature, et d'entrer au sénat avant trente ans. La même loi veut que ceux qui auront été magistrats, soient de plein droit sénateurs. Auguste a publié depuis un édit qui permet, à vingt-deux ans accomplis, d'exercer les magistratures inférieures. On demande donc si les censeurs peuvent donner place au sénat à celui qui a été magistrat avant trente ans; et, en cas qu'ils le puissent, si, par une suite naturelle de la même interprétation, il ne leur est pas permis d'y donner entrée à ceux qui ont atteint l'âge auquel ils pourraient avoir été créés magistrats. C'est ce qu'on prétend être autorisé par l'usage et même par la nécessité, puisqu'il est plus convenable de remplir le sénat de jeunes gens de grande famille, que de personnes d'une naissance obscure. Les censeurs m'ont demandé ce que j'en pensais. Je leur ai dit qu'il me semblait que, selon l'édit d'Auguste et la loi Pompéia, rien n'empêchait ceux qui, avant trente ans, avaient été magistrats, d'avoir entrée au sénat avant leur trentième année, parce qu'Auguste permettait d'exercer la magistrature avant trente ans, et que la loi Pompéia voulait que ceux qui avaient exercé la magistrature fussent sénateurs. Mais j'ai plus longtemps hésité sur ceux qui ont atteint l'âge où les autres ont été magistrats, sans pourtant l'avoir été eux-mêmes. C'est ce qui m'oblige, seigneur, à vous soumettre cette question. Je joins à cette lettre les titres de la loi et l'édit d'Auguste.
LXXXIV. - Trajan à Pline.
J'approuve votre interprétation, mon cher Pline, et je pense que l'édit d'Auguste a dérogé à la loi Pompéia, en permettant à ceux qui ont vingt-deux ans accomplis, d'exercer la magistrature, et à ceux qui l'auraient exercée, d'entrer dans le sénat de chaque ville. Mais je ne crois pas que ceux qui sont au-dessous de trente ans, et qui n'ont point été magistrats, puissent, sous prétexte qu'ils pourraient l'avoir été, demander entrée dans le sénat.
LXXXV. - Pline à l'empereur Trajan.
Pendant que j'étais à Pruse, près du mont Olympe, seigneur, et que j'expédiais quelques affaires dans la maison où je logeais, me disposant à partir ce jour-là même, Asclépiade, magistrat, m'apprit que Claudius Eumolpe demandait à paraître devant mon tribunal. Coccéianus Dion avait demandé, dans le sénat de cette ville, que l'on reçût l'ouvrage qu'il avait exécuté. Alors Eumolpe, plaidant pour Flavius Archippus, dit qu'il fallait faire rendre compte à Dion de l'ouvrage avant de le recevoir, parce qu'il l'avait exécuté autrement qu'il ne le devait. Il ajouta que dans le même lieu on avait élevé votre statue, et enterré les corps de la femme et du fils de Dion. Il demandait que je voulusse bien décider la cause en audience publique. Je déclarai que j'étais tout prêt et que je différerais mon départ. Alors il me pria de remettre à en juger dans au autre temps et dans une autre ville. J'indiquai Nicée. Comme j'y prenais séance pour connaître de cette affaire, Eumolpe, sous prétexte de n'être pas encore préparé, me supplia d'accorder un nouveau délai. Dion, au contraire, insista pour être jugé. On dit de part et d'autre beaucoup de choses, même sur le fond de l'affaire. Mais, comme je pensais qu'il ne fallait rien précipiter, et qu'il était à propos de vous consulter sur une question si importante pour l'exemple, je dis aux parties de me remettre entre les mains leurs requêtes. Je voulais que vous fussiez instruit par elles-mêmes de leurs prétentions et de leurs raisons. Dion déclara qu'il me donnerait la sienne; Eumolpe dit qu'il expliquerait ce qu'il demandait pour la république; que du reste, quant aux sépultures, il n'était point l'accusateur de Dion, mais l'avocat de Flavius Archippus, auquel il avait seulement prêté son ministère. Archippus, pour qui Eumolpe plaidait comme pour la ville de Pruse, dit qu'il me remettrait ses mémoires. Cependant, quoiqu'un temps considérable se soit écoulé depuis, Eumolpe et Archippus ne m'ont rien donné. Dion seul m'a remis son mémoire que j'ai joint à cette lettre. Je me suis transporté sur le lieu. On m'y a montré votre statue dans une bibliothèque. Quant à l'endroit où la femme et le fils de Dion sont enterrés, c'est unegrande cour, enfermée de galeries. Je vous supplie, seigneur, de vouloir bien m'éclairer dans le jugement d'une affaire de ce genre. Tout le monde en attend ici la décision qui d'ailleurs est nécessaire, soit parce que le fait est certain et publiquement reconnu, soit parce qu'on allègue pour le défendre plus d'un exemple.
LXXXVI. - Trajan à Pline.
Vous ne deviez pas hésiter, mon cher Pline, sur la question que vous me proposez. Vous savez fort bien que mon intention n'est point de m'attirer le respect par la crainte et par la terreur, ou par des accusations de lèse-majesté. Laissez donc là cette information que je ne permettrais pas quand il y en aurait des exemples; mais prenez connaissance de ce qui regarde l'ouvrage entrepris par Coccéianus Dion, et réglez les contestations formées sur ce point, puisque l'utilité de la ville le demande, et que Dion s'y soumet, ou doit s'y soumettre.
LXXXVII. - Pline à l'empereur Trajan.
Les Nicéens, seigneur, m'ont conjuré, par tout ce que j'ai et dois avoir de plus sacré, c'est-à-dire par vos jours et par votre gloire immortelle, de vous faire connaître leurs prières. Je n'ai pas cru qu'il me fût permis de refuser. J'ai joint à cette lettre la requète qu'ils m'ont remise.
LXXXVIII. - Trajan à Pline.
Les Nicéens prétendent tenir d'Auguste le privilége de recueillir la succession de ceux de leurs citoyens qui meurent sans avoir fait de testament. Examinez cette affaire en présence des parties intéressées avec Virbius Gémellinus et Epimachus, mon affranchi, tous deux mes intendants; et, après avoir pesé toutes les raisons, de part et d'autre, ordonnez ce qui vous paraitra le plus juste.
LXXXIX. - Pline à l'empereur Trajan.
Je souhaite, seigneur, que cet heureux anniversaire de votre naissance soit suivi de beaucoup d'autres aussi heureux; que vous jouissiez, dans une longue et parfaite santé, de cette immortelle gloire que vous ont méritée vos vertus, qu'elle puisse croître de plus en plus par des exploits sans nombre.
XC. - Trajan à Pline.
Je suis sensible, mon cher Pline, aux vœux que vous faites le jour de ma naissance pour m'obtenir des dieux une longue suite d'autres anniversaires au milieu de la gloire et du bonheur de la république.
XCI. - Pline à l'empereur Trajan.
Les habitants de Sinope, seigneur, manquent d'eau. Il y en a de fort bonne et en grande abondance, à peu près à seize milles de là, que l'on y pourrait conduire. Il se trouve cependant, près de la source, un endroit long de mille pas environ, dont le terrain humide ne me paraît pas sùr. J'ai donné ordre que l'on examinât ce qu'il est possible de faire à peu de frais, si le sol peut soutenir un ouvrage solide. J'ai rassemblé l'argent nécessaire. Il ne nous manquera pas, si vous approuvez, seigneur, ce dessein en faveur de l'embellissement et de la salubrité de la colonie qui a vraiment besoin d'eau.
XCII. - Trajan à Pline.
Examinez avec soin, comme vous avez commencé, mon cher Pline, si ce lieu qui vous est suspect peut porter un aqueduc. Car il n'est point douteux que l'on doive fournir de l'eau à la colonie de Sinope, si, par ses propres moyens, elle peut se procurer un avantage qui doit contribuer beaucoup à son agrément et à sa salubrité.
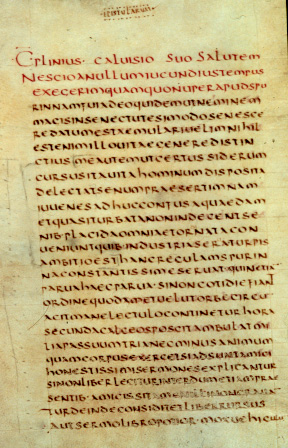
XCIII. - Pline à l'empereur Trajan.
Grâce à votre indulgence, 1a ville d'Amise, libre et alliée de Rome, se gouverne par ses propres lois. J'y ai reçu une requête relative à leurs contributions volontaires. Je l'ai jointe à cette lettre, afin que vous vissiez, seigneur, ce que l'on pouvait sur cela tolérer ou défendre.
XCIV. - Trajan à Pline.
Si les habitants d'Amise, dont vous avez joint la requête à votre lettre, peuvent, aux termes de leurs lois autorisées par le traité d'alliance, s'imposer des contributions, nous ne pouvons les empêcher de le faire, et moins encore s'ils emploient les impôts qu'ils lèvent, non à former des cabales et à tenir des assemblées illicites, mais à soulager les pauvres. Dans toutes les autres villes sujettes à notre obéissance, il ne faut point le souffrir.
XCV. - Pline à l'empereur Trajan.
Suétone, le plus intègre, le plus honorable, le plus savant de nos Romains, seigneur, partage depuis longtemps ma maison.
J'aimais en lui son caractère, son érudition, et, plus je l'ai vu de près, plus je me suis attaché à lui. Il peut appuyer d'un double motif ses droits au privilége dont jouissent ceux qui ont trois enfants. Il mérite d'abord tout l'intérêt de ses amis, et ensuite son mariage n'a pas été heureux. Il faut qu'il obtienne de votre bonté ce que lui a refusé l'injustice de la fortune. Je sais, seigneur, combien est importante la grâce que je sollicite. Mais c'est à vous que je la demande, à vous dont j'ai toujours trouvé la bienveillance si facile à mes désirs. Vous pouvez juger à quel point je souhaite cette faveur: si je ne la désirais que médiocrement, je ne demanderais pas de si loin.
XCVI. - Trajan à Pline.
Vous savez, mon cher Pline, combien je suis avare de ces sortes grâces. Vous m'avez entendu souvent assurer le sénat que je n'ai point encore dépassé le nombre dont je lui ai déclaré que je me contenterais. J'ai néanmoins souscrit à vos désirs. Et afin que vous ne puissiez douter que vous n'ayez obtenu pour Suétone le privilège de ceux qui ont trois enfants, sous la condition accoutuée, j'ai ordonné que le brevet en fût enregistré.
XCVII. - Pline à l'empereur Trajan.
Je me suis fait un devoir, seigneur, de vous consulter sur tous mes doutes. Car qui peut mieux que vous me guider dans mes incertitudes ou éclairer mon ignorance? Je n'ai jamais assisté aux informations contre les chrétiens aussi j'ignore à quoi et selon quelle mesure s'applique ou la peine ou l'information. Je n'ai pas su décider s'il faut tenir compte de l'âge, ou confondre dans le même châtiment l'enfant et l'homme fait s'il faut pardonner au repentir, ou si celui qui a été une fois chrétien ne doit pas trouver de sauvegarde à cesser de l'être si c'est le nom seul, fût-il pur de crime, ou les crimes attachés au nom, que l'on punit. Voici toutefois la règle que j'ai suivie à l'égard de ceux que l'on a déférés à mon tribunal comme chrétiens. Je leur ai demandé s'ils étaient chrétiens. Quand ils l'ont avoué, j'ai réitéré ma question une seconde et une troisième fois, et les ai menacés du supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés : car, de quelque nature que fût l'aveu qu'ils faisaient, j'ai pensé qu'on devait punir au moins leur opiniâtreté et leur inflexible obstination. J'en ai réservé d'autres, entêtés de la même folie, pour les envoyer à Rome, car ils sont citoyens romains.
Bientôt après, les accusations se multipliant, selon l'usage, par la publicité même, le délit se présenta sous un plus grand nombre de formes. On publia un écrit anonyme, où l'on dénonçait beaucoup de personnes qui niaient être chrétiennes ou avoir été attachées au christianisme. Elles ont, en ma présence, invoqué les dieux, et offert de l'encens et du vin à votre image que j'avais fait apporter exprès avec les statues de nos divinités; elles ont, en outre, maudit le Christ (c'est à quoi, dit-on, l'on ne peut jamais forcer ceux qui sont véritablement chrétiens). J'ai donc cru qu'il les fallait absoudre. D'autres, déférés par un dénonciateur, ont d'abord reconnu qu'ils étaient chrétiens, et se sont rétractés aussitôt, déclarant que véritablement ils l'avaient été, mais qu'ils ont cessé de l'être, les uns depuis plus de trois ans, les autres depuis un plus grand nombre d'années, quelques-uns depuis plus de vingt ans. Tous ont adoré votre image et les statues des dieux; tous ont maudit le Christ.
Au reste ils assuraient que leur faute ou leur erreur n'avait jamais consisté qu'en ceci, ils s'assemblaient, à jour marqué, avant le lever du soleil, ils chantaient tour à tour des hymnes à la louange du Christ, comme en l'honneur d'un dieu; ils s'engageaient par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol, de brigandage, d'adultère, à ne point manquer à leur promesse, à ne point nier un dépôt; après cela, ils avaient coutume de se séparer, et se rassemblaient de nouveau pour manger des mets communs et innocents. Depuis mon édit, ajoutaient-ils, par lequel, suivant vos ordres, j'avais défendu les associations, ils avaient renoncé à toutes ces pratiques. J'ai jugé nécessaire, pour découvrir la vérité, de soumettre à la torture deux femmes esclaves qu'on disait initiées à leur culte. Mais je n'ai rien trouvé qu'une superstition extraordinaire et bizarre. J'ai donc suspendu l'information pour recourir à vos lumières. L'affaire m'a paru digne de réflexion, surtout à cause du nombre que menace le même danger. Une multitude de gens de tout âge, de tout ordre, de tout sexe, sont et seront chaque jour impliqués dans cette accusation. Ce mal contagieux n'a pas seulement infecté les villes, il a gagné les villages et les campagnes. Je crois pourtant que l'on y peut remédier, et qu'il peut être arrêté. Ce qu'il y a de certain, c'est que les temples, qui étaient presque déserts, sont fréquentés, et que les sacrifices, longtemps négligés, recommencent. On vend partout des victimes qui trouvaient auparavant peu d'acheteurs. De là on peut aisément juger combien de gens peuvent être ramenés de leur égarement, si l'on fait grâce au repentir.
XCVIII. - Trajan à Pline.
Vous avez fait ce que vous deviez faire, mon cher Pline, dans l'examen des poursuites dirigées contre les chrétiens. Il n'est pas possible d'établir une forme certaine et générale dans cette sorte d'affaires. Il ne faut pas faire de recherches contre eux. S'ils sont accusés et convaincus, il faut les punir; si pourtant l'accusé nie qu'il soit chrétien, et qu'il le prouve par sa conduite, je veux dire en invoquant les dieux, il faut pardonner à son repentir, de quelque soupçon qu'il ait été auparavant chargé. Au reste, dans nul genre d'accusation, il ne faut recevoir de dénonciation sans signature. Cela serait d'un pernicieux exemple et contraire aux maximes de notre règne.
XCIX. - Pline à l'empereur Trajan.
La ville d'Amastris, seigneur, qui est belle et bien bâtie, compte parmi ses principaux ornements une place magnifique et d'une vaste étendue, le long de laquelle se trouve ce qu'on appelle une rivière, niais ce qui n'est en effet qu'un cloaque impur, dont l'aspect est aussi choquant que les exhalaisons en sont dangereuses. Il n'importe donc pas moins à la santé des habitants qu'à la beauté de leur ville de le couvrir d'une voûte. C'est ce que l'on fera, si vous le permettez. J'aurai soin que l'argent ne manque pas pour un ouvrage si grand et si nécessaire.
C. - Trajan à Pline.
Il est juste, mon cher Pline, de couvrir d'une voûte ce cloaque dont les exhalaisons sont préjudiciables à la santé des habitants d'Amastris. Je suis très persuadé que votre diligence ordinaire ne laissera pas manquer l'argent nécessaire à cet ouvrage.
CI. - Pline à l'empereur Trajan.
Nous nous sommes acquittés, seigneur, avec beaucoup d'enthousiasme et de joie des voeux que nous avions faits pour vous les années précédentes, et nous en avons fait de nouveaux. Les troupes et les peuples y ont également signalé leur zèle. Nous avons prié les dieux pour votre santé et pour la prospérité de votre empire; et nous les avons conjurés de veiller à votre conservation avec cette bonté que vous avez méritée d'eux par tant de hautes vertus, mais particulièrement par votre piété et par le culte religieux que vous leur rendez.
CII. - Trajan à Pline.
J'apprends avec plaisir par votre lettre, mon cher Pline, qu'à la tête des troupes et des peuples vous avez, avec allégresse, acquitté vos anciens voeux, et que vous en avez formé de nouveaux pour ma santé.

CIII. - Pline à l'empereur Trajan.
Nous avons solennisé avec zèle le jour où une heureuse succession vous a chargé de la tutelle du genre humain; et nous avons recommandé aux dieux qui vous ont donné l'empire l'accomplissement des voeux publics auquel est attachée toute notre joie.
CIV. - Trajan à Pline.
J'ai appris avec plaisir par votre lettre, mon cher Pline, qu'à la tête des troupes et des peuples vous avez célébré avec zèle et avec joie le jour de mon avénement à l'empire.
CV. - Pline à l'empereur Trajan.
Valérius Paulinus, seigneur, m'a confié ses affranchis, à l'exception d'un seul, avec droit pour eux de cité latine. Je vous supplie aujourd'hui de vouloir bien accorder le droit de cité romaine seulement à trois d'entre eux : car je craindrais qu'il n'y eût trop d'indiscrétion à demander à la fois la même grâce pour tous. Plus vous me prodiguez votre bienveillance, plus je dois la ménager. Ceux pour qui je vous adresse ma prière, sont C. Valérius Estiéus, C. Valérius Dionysius et C. Valérius Aper.
CVI. - Trajan à Pline.
La prière que vous m'adressez en faveur de ceux que Valérius Paulinus a confiés à votre foi fait honneur à vos sentiments. J'ai donné le droit de cité romaine à ceux pour qui vous l'avez demandé, et j'en ai fait enregistrer l'acte, prêt à accorder la même grâce à tous les autres, si vous la demandez pour eux.
CVII. - Pline à l'empereur Trajan.
Publius Accius Aquila, centurion de la sixième cohorte à cheval, m'a prié de vous envoyer sa requête où il implore votre bienveillance pour sa fille. J'ai cru qu'il y aurait de la dureté à le refuser, sachant avec quelle douceur et avec quelle bonté vous écoutez les prières des soldats.
CVIII. - Trajan à Pline.
J'ai lu la requête que vous m'avez envoyée au nom de Publia Accius Aquila, centurion de la sixième cohorte à cheval. J'ai accordé, à sa prière, le droit de cité romaine pour sa fille, et je vous en ai envoyé le brevet pour le lui remettre.
CIX. - Pline à l'empereur Trajan.
Je vous supplie, seigneur, de m'apprendre quel droit il vous plaît qu'on accorde aux villes de Lithynie et du Pont pour le recouvrement des sommes qui leur sont dues, soit pour loyers, soit pour prix de ventes ou autres causes. Je trouve que la plupart des proconsuls leur ont accordé la préférence sur tous les créanciers, et que cela s'est établi comme une loi. Je crois pourtant qu'il serait à propos que vous voulussiez bien établir sur cela quelque règlement certain qui assurât à l'avenir leur état. Car ce que d'autres ont ordonné, quoique avec sagesse, ne se soutiendra pas, si votre autorité ne le confirme.
CX. - Pline à Trajan.
Le droit à accorder aux villes de Bithynie et du Pont sur les biens de leurs débiteurs doit être déterminé par les lois particulières à chacune d'elles. Car si elles ont un privilége qui leur assure une préférence sur tous les autres créanciers, il le leur faut conserver; si elles n'en ont pas, je ne dois pas le leur donner au préjudice des particuliers.
CXI. - Pline à l'empereur Trajan.
Le procureur syndic de la ville des Amiséniens a poursuivi devant moi Jules Pison pour la restitution de quarante mille deniers environ qui lui ont été donnés par la ville, il y a plus de vingt ans, du consentement de leur sénat, et s'est fondé sur vos édits qui défendent ces sortes de donations. Pison a soutenu, au contraire, que la ville lui devait beaucoup, et qu'il avait presque épuisé tout son bien pour elle. Il s'est retranché d'ailleurs dans l'espace de temps qui s'est écoulé depuis, et a demandé qu'on ne lui arrachât pas, avec l'honneur, ce qui lui avait été accordé depuis tant d'années, et ce qui lui avait tant coûté. J'ai cru, par ces raisons, que je devais suspendre mon jugement jusqu'à ce que j'eusse appris, seigneur, vos intentions.
CXII. - Trajan à Pline.
Il est vrai que mes édits défendent les largesses qui se font des deniers publics. Mais, d'un autre côté, la tranquilité du grand nombre de particuliers dont la fortune serait dérangée, si l'on révoquait toutes les donations de cette espèce, faites depuis un certain temps, exige qu'elles soient respectées. Laissons donc subsister les actes de cette nature faits il y a plus de vingt ans. Car je ne veux pas prendre moins de soin du repos des habitants de chaque ville, que de la conservation des deniers publics.
CXIII. - Pline à l'empereur Trajan.
La loi Pompéia, seigneur, qui s'observe dans la Bithynie et dans le royaume du Pont, n'assujettit point ceux qui sont choisis par les censeurs pour être admis au sénat à donner de l'argent. Mais ceux qui n'y sont entrés que par votre faveur, et par la permission que vous avez accordée à quelques villes d'ajouter de nouveaux sénateurs aux anciens, ont payé au trésor public, les uns mille deniers, les autres deux mille. Dans la suite, le proconsul Anicius Maximus a voulu que ceux même qui seraient choisis par les censeurs payassent en quelques villes une certaine somme, les uns plus, les autres moins. C'est à vous, seigneur, à régler si à l'avenir tous ceux qui seront choisis pour sénateurs paieront également dans toutes les villes une somme fixe pour leur entrée. Il vous appartient d'établir les lois destinées à subsister toujours, vous, seigneur, dont les paroles et les actions sont destinées à l'immortalité.
CXIV. - Trajan à Pline.
Je ne puis faire pour toutes les villes de la Bithynie une loi générale qui décide que pour être admis au sénat il faut, ou non, payer une certaine somme et en déterminer la quotité. Il me semble donc que, pour nous tenir à ce qui est toujours le plus sûr, il faut suivre la coutume de chaque ville contre ceux qui sont nommés sénateurs malgré eux. Je pense que les censeurs feront en sorte que ceux qui sont disposes à contribuer volontairement soient préférés aux autres.
CXV. - Pline à l'empereur Trajan.
La loi Pompéia, seigneur, permet aux villes de Bithynie de donner le droit de cité à leur gré, pourvu que ce soit à des citoyens, non d'une ville étrangère, mais de quelque autre ville de la province. La même loi énonce les raisons qui autorisent les censeurs à exclure guelqu'un du sénat, et il n'y est point fait mention de celui qui n'est pas citoyen du lieu. Quelques censeurs ont pris de là occasion de me demander s'ils devaient exclure un homme qui était citoyen d'une ville étrangère. J'ai cru, seigneur, qu'il fallait savoir vos intentions sur cette affaire car, si la loi défend d'agréger un citoyen qui n'est pas d'une ville de la province, elle n'ordonne pas que l'on retranche du sénat celui qui n'est pas citoyen. D'ailleurs plusieurs personnes m'ont assuré qu'il n'y avait point de ville où il ne se trouvât grand nombre de sénateurs dans ce cas, et que l'on troublerait beaucoup de villes et de familles, sous prétexte d'une loi qui, dans ce chef, semblerait depuis longtemps abolie par un consentement tacite. J'ai joint à cette lettre les divers titres de la loi.
CXVI. - Trajan à Pline.
C'est avec raison, mon cher Pline, que vous avez hésité sur la réponse à faire aux censeurs qui vous demandaient s'ils pouvaient choisir pour sénateurs des citoyens d'autres villes que de la leur, mais de la même province car vous pouviez être partagé entre l'autorité de la loi et l'ancienne coutume qui avait prévalu. Voici le tempérament que je crois devoir prendre. Ne touchons point au passé. Laissons dans leur état ceux qui ont été faits sénateurs, quoique contre la disposition de la loi, et de quelque ville qu'ils soient; mais suivons exactement, à l'avenir, la loi Pompéia, dont nous ne pourrions faire remonter l'observation aux temps passés, sans causer beaucoup de troubles.
CXVII. - Pline à l'empereur Trajan.
Ceux qui prennent la robe virile, qui célèbrent un mariage, qui entrent en exercice d'une charge, ou qui consacrent quelque ouvrage public, ont coutume d'y inviter tout le sénat de la ville même un grand nombre de personnes du peuple, et de donner à chacun un ou deux deniers. Je vous supplie de m'apprendre si vous approuvez ces cérémonies, et jusqu'à quel point on doit les souffrir. Pour moi, comme j'ai cru, et peut-être avec raison, qu'il fallait permettre d'inviter, principalement en ces occasions solennelles, je crains aussi que ceux qui invitent quelquefois jusqu'à mille personnes et plus, ne passent toutes les bornes permises, et ne donnent lieu à l'accusation de former un attroupement défendu.
CXVIII. - Trajan à Pline.
Vous n'avez pas tort, mon cher Pline, de craindre que ces assemblées si nombreuses où l'on invite, pour des rétributions publiques, non les personnes que l'on connaît, mais, pour ainsi dire, des corps entiers de citoyens, ne semblent bientôt dégénérer en attroupements. J'ai compté sur votre prudence pour réformer les abus de cette province, et y fonder les institutions qui peuvent lui procurer une perpétuelle tranquillité.
CXIX. - Pline à l'empereur Trajan.
Les athlètes, seigneur, prétendent que le prix que vous avez établi pour les vainqueurs, dans les combats isélastiques, leur est dû dès le jour qu'ils ont reçu leur couronne; qu'il importe peu quel jour ils font leur entrée solennelle dans leur patrie; qu'il ne faut songer qu'au jour où ils ont vaincu, et à celui, par conséquent, où ils ont pu la faire. Pour moi, au contraire, le nom même d'isélastique me fait pencher à croire qu'il ne faut compter que du jour où ils ont fait leur entrée. Ces athlètes demandent encore leur rétribution pour le combat que vous avez depuis rendu isélastique, quoiqu'il ne le fût pas encore au temps où ils ont remporté la victoire. Ils allèguent que, si on ne leur donne rien pour ces combats qui ont cessé d'être isélastiques depuis qu'ils ont vaincu, il est juste de leur donner pour ceux qui le sont devenus. Je me trouve encore fort embarrassé sur ce point. Je doute que l'on doive faire remonter les prix avant leur établissement, et les donner à ceux à qui ils n'avaient point été proposés, quand ils ont vaincu. Je vous supplie donc, seigneur, de résoudre mes doutes, ou plutôt de vouloir bien interpréter vos grâces.
CXX. - Trajan à Pline.
La récompense assignée au vainqueur dans les combats isélastiques ne me paraît due que du jour où il a fait son entrée dans sa ville. Les rétributions pour les combats qui, avant que je les eusse rendus isélastiques, ne l'étaient point, ne peuvent remonter au temps où elles n'étaient point établies. Et les changements survenus, soit dans les combats qui ont commencé à être isélastiques, soit dans ceux qui ont cessé de l'être, ne décident rien en faveur des athlètes car, bien que la nature de ces combats change, on ne leur fait point rendre ce qu'ils ont une fois reçu.
CXXI. - Pline à l'empereur Trajan.
Jusqu'à présent, seigneur, je n'ai accordé aucun passeport de faveur, ni pour d'autres affaires que pour les vôtres. Une nécessité imprévue m'a forcé de violer cette loi que je m'étais faite. Sur la nouvelle que ma femme a reçue de la mort de son aïeul, elle a souhaité de se rendre au plus tôt près de sa tante. J'ai cru qu'il y aurait de la dureté à lui refuser des passe-ports. Le mérite d'un devoir si légitime consiste dans l'empressement à le remplir, et je savais d'ailleurs que vous ne désapprouveriez pas un voyage entrepris par piété. Je vous mande ces détails, seigneur, parce que je me serais accusé d'ingratitude, si, parmi tant de gràces que je dois à votre bienveillance, j'avais dissimulé celle-ci. C'est la confiance que j'ai en elle qui m'a fait faire, comme si vous me l'aviez permis, ce que j'eusse fait trop tard, si j'eusse attendu votre permission.
CXXII. - Trajan à Pline.
Vous avez eu raison, mon cher Pline, de compter sur mon affection. S'il vous eût fallu me consulter et attendre ma réponse pour délivrer à votre femme les passe-ports nécessaires à son voyage, et que vous pouvez accorder par un privilège que j'ai attaché à vos fonctions, ces passe-ports, sans contredit, eussent mal servi son dessein. C'était une obligation pour elle d'ajouter par sa diligence au plaisir que son arrivée devait causer à sa tante.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|
Voir aussi "Etude sur Pline le Jeune" par T. Mommsen (ICI)