LA
MARINE DES PTOLEMÉES
ET LA
MARINE DES ROMAINS
LA MARINE DE GUERRE
PAR
LE VICE-AMIRAL
JURIEN DE LA GRAVIÈRE
MEMBRE DE L'INSTITUT
1885
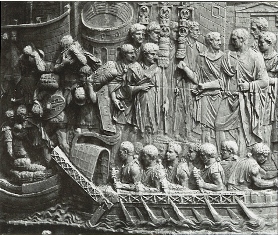
TABLE DES MATIÈRES.
CHAPITRE PREMIER.
Les vaisseaux gigantques. Le navire d'Archias. La
tessaracontère. La Dévastation. Le Duilio. La
Grande Serpente.
CHAPITRE II.
Combat de Salamis, dans les eaux de Chypre
CHAPITRE III.
La marine des Romains pendant la première guerre punique. Combats d'Ecnome et des îles Egades.
CHAPITRE IV.
Rivalité d'Octave et d'Antoine.- Bataille d'Actium.
CHAPITRE V.
Ce que peut et ce que doit faire de nos jours une marine
maîtresse de la mer
CHAPITRE VI.
La marine des empereurs.
CHAPITRE VII.
Les expéditions maritimes de Claude et de Septime Sévère.
CHAPITRE VIII.
Les premières invasions.
CHAPITRE IX.
Les flottilles des Goths.
CHAPITRE X.
Les exercices de débarquement.
CHAPITRE XI.
Claude II le Gothique,Aurélien et Probus.
CHAPITRE XII.
Fondation de l'empire byzantin.
CHAPITRE XIII.
Les pilotes au cinquième sièclede notre ère.
CHAPITRE XIV.
Les navires éclaireurs
CHAPITRE XV.
La tactique navale des Byzantins et la tactique navale de
nos jours.
Le choix du champ de bataille.
LES VAISSEAUX GIGANTESQUES LE NAVIRE D'ARCHIAS.
LA TESSARACONTRE, LA DÉVASTATION, LE DUILIO,
L'INFLEXIBLE, LA GRANDE SERPENTE.
La marine des Ptolémées et la marine des Romains avaient grandi à l'écart l'une de l'autre; elles se sont rencontrées pour un conflit suprême, et c'est à la marine romaine, représentée par ses Liburnes, qu'est échu un triomphe qui devait donner l'empire du monde au vainqueur. L'histoire des successeurs d'Alexandre et celle des guerres puniques ne sont pour un marin que le prologue du drame dans lequel Antoine et Cléopâtre ont succombé, parce qu'ils commirent la faute de prendre, en fait de constructions navales, l'énormité pour la force. Ce fut encore de Sicile que vint l'exemple de ces constructions démesurées dont les quinquérèmes de Denys le Tyran avaient été le premier échelon. Hiéron II, roi de Syracuse, de l'année 269 à l'année 215 avant Jésus-Christ, fit construire, nous assure un contemporain de Marc-Aurè!e, le grammairien Athénée, qui écrivait au deuxième siècle de notre ère, sur la foi de Moschion, historien peut-être familier à nos érudits, mais dont je n'avais pour ma part jamais entendu prononcer le nom, un navire gigantesque destiné au transport des blés. Archias de Corinthe en dressa les plans; Archimède lui-même ne dédaigna pas d'assumer la direction supérieure des travaux. L'Etna fournit le bois, et si toute une forêt de la duchesse de Rohan disparut sous la hache des charpentiers qui firent descendre, en 1648, le vaisseau la Couronne des chantiers de la Roche-Bernard, la caraque d'Archias, de son côté, absorba plus de sapins qu'il n'en eût fallu pour bâtir une flotte de soixante galères. Les cordages vinrent d'Espagne et des pays qui confinent au Rhône; on doubla la carène de feuilles de plomb, et l'on fixa les bordages sur les membres avec des clous de cuivre; trois cents charpentiers travaillèrent sans relâche à l'achèvement de ce monstrueux édifice. C'était une grosse affaire que de le mettre à flot. Pour rendre l'opération moins chanceuse, on résolut de procéder au lancement du navire aussitôt que les oeuvres vives seraient terminées : il serait temps de porter la main aux oeuvres mortes, quand la partie du vaisseau destinée à être immergée se trouverait solidement amarrée au milieu du port. Archimède, qui se vantait de pouvoir mettre le ciel et la terre en branle pour peu qu'on lui assurât un point fixe, se fit un jeu de conduire la gigantesque coque de la cale à la mer. Philéas de Taormine le seconda dans cette entreprise, et le lancement eut lieu avec un plein succès. Moschion nous affirme qu'il fallut requérir peu de bras pour accomplir ce délicat prodige de mécanique. Le navire d'Archias avait quatre mâts. Le beaupré, le mât d'artimon et le mât de misaine se trouvèrent sans peine en Sicile; on dut aller chercher le grand mât dans les montagnes du Brutium, où un porcher fit la découverte d'un arbre assez gros pour satisfaire au voeu des ingénieurs. Ainsi préparé à marcher à la voile, l'Alexandrin, car tel fut le nom que reçut la caraque quand on eut décidé son départ pour l'Egypte, n'en était pas moins ponts étagés l'un au-dessus de l'autre : le pont inférieur recouvrait le lest et la cargaison; on le destina au logement des soldats; sur le second pont, une double rangée de chambres, occupant tout l'espace compris entre la coursie et la muraille, comprenant quatre lits par cabine, recevrait les passagers désireux de faire le voyage d'Egypte : les calicrs, ainsi que les matelots chargés de la manoeuvre des voiles et des ancres, trouveraient place dans ce même compartiment. Le pont supérieur restait libre: on y fit asseoir les rameurs. Le navire d'Archias était un navire à vingt rangs de rames; si nous supposons qu'on ait placé dix files de rameurs de chaque bord, nous retrouvons à peu de chose près l'appareil moteur de la galéasse vénitienne restituée avec autant de patience que d'habile industrie par l'amiral Pâris, et qui vaut bien la peine que, pour la contempler, on se résigne à gravir les escaliers du Louvre jusqu'aux combles sous lesquels reposent les richesses trop peu connues encore de notre musée naval. Le fourrage des chevaux fut sur l'Alexandrin rangé le long du bord. De fortes pièces de bois projetées en saillie formaient cependant tout autour du navire une galerie extérieure; on crut devoir réserver cette galerie aux bûchers, aux cuisines, aux moulins et aux fours. Quant à la défense militaire, on la jugea suffisamment assurée par l'établissement de huit tours auxquelles, pour nous donner l'illusion du blockhaus moderne, il semble n'avoir manqué que des canons. Faute de canons, Archimède y avait placé des lithoboles qui lançaient à la distance de près d'une encablure des pierres du poids d'environ quatre-vingts kilogrammes et des traits de cinq mètres et demi de long. Deux de ces tours s'élevaient sur la poupe, deux autres, non moins hautes, se dressaient à la proue; quatre occupaient le centre du bâtiment. Laissons de côté l'aphrodisium, avec ses trois lits : c'est là un détail de construction tout antique qui n'eut sa raison d'être qu'au temps où la fille de Jupiter avait plus de temples sur les côtes que nous n'y comptons aujourd'hui de phares et de sémaphores. Muni de quatre ancres de bois et de huit ancres de fer, l'Alexandrin se trouvait en mesure de soutenir bravement l'assaut de la tempête au mouillage; si quelque fissure se déclarait dans la carène trop rudement secouée, la vis sans fin, inventée par Archimède, intervenait sur l'heure pour élever l'eau introduite dans la cale et la rejeter à la mer. Tout était prévu, et jamais armement ne fut plus complet. La caraque, partie de Syracuse pour Alexandrie, arriva sans encombre devant le port; elle ne franchit, il est vrai, les passes que traînée à la remorque par d'autres galères plus agiles, mais ne fallut-il pas aussi remorquer à Lépante les grosses galéasses de Venise pour les conduire à leur poste de bataille ! Presque à la même époque, Ptolémée Philopator enchérissait encore sur la tentative déjà bien hardie d'Archimède et d' Archias; il faisait mettre en chantier une tessaracontère. Comment disposa-t-on les quatre mille rameurs qui furent chargés d'imprimer le mouvement au colosse? Sur un pont long de cent trente mètres environ et large de dix-huit entre les deux chemins latéraux, avec des rames garnies de plomb à la poignée, rames dont la longueur dépassait dix-sept mètres, la solution la plus simple est naturellement celle qui se présente la première à l'esprit : cent avirons de chaque bord espacés d'un mètre et vingt hommes sur chaque aviron, dix placés en avant, dix rangés en arrière, fournissent, à un homme près, le complet emploi de la chiourme; il ne nous reste plus qu'à distribuer sur le catastroma, sorte de spar-deck qui s'étendait d'une extrémité à l'autre du navire au-dessus de la vogue, les quatre cents matelots qui manoeuvreront les voiles et les ancres, et les deux mille huit cent cinquante épibates qui n'auront à se préoccuper que du combat. Sous les bancs se tiendra encore, au dire de Callixène, " une troupe assez considérable", dont l'office consiste à tirer les vivres de la cale pour les distribuer aux rameurs. Je reconnais là les non-combattants affectés de nos jours au passage des poudres. Un équipage de près de huit mille hommes! verrons- nous jamais sur nos villes flottantes population semblable? Du sommet de l'acrostolion de proue à la mer, ce Léviathan mesurait plus de vingt-deux mètres; il en comptait près de vingt quatre et demi des aphlastes de la poupe à la flottaison : pour consolider sa charpente, on l'avait entourée de douze énormes préceintes mesurant chacune deux cent soixante dix-sept mètres environ de circuit. Des figures de cinq et six mètres de haut décoraient l'avant et l'arrière. Je ne vois guère que les grands cuirassés italiens, le Duilio, le Dandolo l'Itali le Lepanto, que l'on puisse comparer au vaisseau de Ptolémée, et encore ! Le Great-Eastern lui-même, ce monstre dont le déplacement dépasse vingt-sept mille tonneaux et près duquel les navires à vapeur ordinaires passeront comme des pygmées, n'aurait pas, sans être obligé de les serrer un peu, recélé dans son sein les érètes et les épibates de la tessar acontère. Le navire égyptien eût pu à la rigueur se passer d'éperon; sa masse lui suffisait pour écraser une flotte; on le hérissa néanmoins de sept rostres, énormes dents de fer qui garnirent tout l'avant à partir des épotides et présentèrent au centre, encastravé sur l'étrave, un dernier dard plus long que les six autres, destiné à percer la carène ennemie. Ce qu'il entra de bois dans ce vaisseau se devine aisément, quand on songe que la construction seule du ber qui servit à le lancer exigea plus de matériaux qu'il n'en eût fallu pour bâtir cinquante quinquérèmes. Si solide que soit une carène, elle n'en reste pas moins soumise à un prompt dépérissement, et, pour la réparer, il faut de toute nécessité la replacer dans les conditions où elle se trouvait avant que l'Océan l'enveloppât de son humide ceinture. Il n'y a cependant que les esquifs de faibles dimensions qui puissent, sans trop d'efforts, remonter la pente d'où on les a fait descendre. Essayerait-on de tirer à terre cette coque plus pesante que tous les obélisques jadis charriés à travers le désert par les sujets dociles des Pharaons? Le problème, à coup sûr, n'était pas insoluble, et l'antiquité s'entendait mieux que nous à remuer les masses; néanmoins, il était à craindre que les flancs du navire souffrissent de la traction. Un Phénicien imagina le moyen de mettre la tessaracontère à sec sans qu'il fùt besoin de recourir, pour atteindre ce résultat, aux cabestans. Il fit creuser sur le rivage une fosse assez vaste et assez profonde pour que la tessaracontère s'y trouvât aussi à l'aise qu'un enfant dans son berceau. Le fond dela cuvette fut en outre revêtu d'une maçonnerie entièrement composée de pierres de taille, dont l'épaisseur, variant de deux à trois mètres, résisterait victorieusement à la poussée des infiltrations. Sur cette maçonnerie on posa un plancher transversal de grosses poutres qui laissaient en dessous un espace vide de deux mètres environ de hauteur. Quand la fosse fut prête, on y introduisit l'eau de la mer et l'on y amena la tessaracontère; puis on ferma l'entrée par un barrage et l'on mit en action les machines pour épuiser l'eau. Les Chinois que j'ai vus à l'oeuvre en 1849 n'agirent pas autrement quand on les chargea de réparer à Wampoa la coque d'un des plus grands clippers de la maison Russell et Cic. Soutenu de chaque côté par les étais qu'on dressait au fur et à mesure le long de ses flancs, le géant du Nil s'assit peu à peu sur le lit de madriers qui l'attendait. Les calfats et les charpentiers commencèrent à l'instant leur besogne. L'espace qui leur avait été ménagé sous la quille leur donnait un facile accès au fond même du navire, et ils n'auraient certes pas travaillé plus à l'aise si la lessaracontère eût été, comme une simple trière, remontée sur la cale de construction qui l'avait vue naître et grandir. Tel est le premier bassin de radoub dont l'histoire fasse mention. Ai-je donc eu si grand tort d'aller chercher les origines de la marine moderne chez les Hellènes et chez les Égyptiens? La plupart de nos prétendues inventions n'ont été, j'en suis convaincu, que des réminiscences. Il est bon cependant de se garder d'une foi trop aveugle vis-à-vis de ces textes mutilés, souvent même altérés, qui nous sont venus, après de longues et aventureuses pérégrinations, de Rome et de Byzance. Où l'un lit katholken, la traction en bas, l'auire se croira fondé à lire anholken la traction en haut. Pour modifier du tout au tout un chiffre, il suffira qu'une lettre, un imperceptible upsilon, puisse être soupçonnée d'être restée en chemin. Intercidit autem numerus centenarius. Les grammairiens grecs sont assurément des gens consciencieux, des savants incapables d'abuser à dessein de notre crédulité, mais les récits contemporains qu'ils se bornent la plupart du temps à reproduire, méritent- ils bien la confiance absolue que nous leur accordons? Callixène et Moschion ont-ils vu, de leurs propres yeux vu, les vaisseaux qu'ils décrivent? S'ils les ont vus, en ont-ils su comprendre l'architecture compliquée et le mécanisme? J'ai peut-être pris involontairement quelques libertés avec le texte passablement obscur du Banquet des sophistes; je ne répondrais pas que le célèbre auteur de ce précieux ouvrage n'en ait pris de plus grandes avec les devis que son érudition téméraire se croyait de force à interpréter. La chose ne serait pas tout à fait sans exemple. M. Hubert, le directeur des constructions navales de Rochefort en 1830, n'était pas seulement le plus éminent des ingénieurs; il s'entendait aussi à merveille à décrire tous les procédés du grand art dont un consentement unanime le reconnaissait alors le maître. Un jour d'été, au mois de juin, je crois, un visiteur muni des recommandations les plus hautes lui est adressé de Paris. M. Hubert le promène d'un bout de l'arsenal à l'autre, le fait entrer dans les ateliers, lui fait toucher du doigt les outils et les appareils; puis il le conduit au chantier sur lequel reposait à cette époque le vaisseau à trois ponts la Ville de Paris. Là, il expose avec sa lucidité habituelle l'opération autrefois si critique, aujourd'hui si simple, si facile et si sûre, du lancement. Pendant l'explication où son zèle s'oublie, maint sourire d'acquiescement vient lui prouver qu'il ne perd pas sa peine. Du chantier, on passe par une transition naturelle an bassin de radoub. La construction de cette grande cage de pierre, le jeu des portes, le mode d'aspiration des pompes d'épuisement, l'accorage du navire, exigent de plus minutieux détails encore. En homme bien élevé, et un peu de fatigue peut-être s'en mêlant, l'étranger commence à se demander si, tandis qu'il prolonge ainsi outre mesure cette curieuse inspection de nos richesses navales, il ne court pas le risque de devenir indiscret. Combien d'heures n'a-t-il pas déjà dérobées à un homme qui sait en faire un si utile et si glorieux usage ! " J'abuse vraiment, dit-il, de votre temps et de vos bontés. N'insistez pas! j'ai parfaitement compris. Le vaisseau que vous m'avez montré a été construit dans ce bassin; pour l'achever, vous l'avez monté sur la cale; dès qu'il sera complètement terminé, vous le remettrez à l'eau". M, Hubert eut assez d'empire sur lui-même pour ne rien laisser voir de son étonnement. " Sans aucun doute!" répondit-il avec le plus grand sang-froid. Singulière méprise! direz-vous. Remarquez que cette méprise remonte à une époque où la plupart de nos compatriotes ne connaissaient la mer que par ouï-dire. Bien des gens, dont l'intelligence n'était certes pas suspecte, éprouvèrent alors un plaisir sans mélange à lire les romans maritimes de Cooper dans des traductions qui auraient été du grec ou de l'hébreu pour nos maîtres d'équipage. Il serait assurément plus facile de nier l'existence de la tessaracontère que de se figurer comment pareille machine a jamais pu quitter le port d'Alexandrie. Le doute malheureusement, après la description si complète d'Athénée, ne saurait être permis; on n'entre pas dans tant de détails, quand on n'a pour base de son récit qu'un caprice d'imagination ou une imposture. La tessaracontère a vécu; de plus habiles que moi expliqueront comment elle est parvenue à se mouvoir. Il ne faudrait peut-être pas une bien grande convulsion sociale pour engloutir cette civilisation dont nous avons sujet, je ne le conteste point, d'être fiers. Si les générations auxquelles, après un long intervalle de barbarie, incomberait la tâche de reprendre à nouveau l'oeuvre interrompue des siècles, essayaient de reconstituer notre marine à vapeur d'après les documents épars dans nos histoires, tous les livres techniques ayant disparu, j'estime qu'on verrait surgir de bien singulières solutions de ce problème offert aux érudits. Avez-vous jamais entendu parler de la Grande Serpente? Cet étrange navire apparut tout à coup, au dire des romanciers espagnols, dans les eaux où le preux chevalier qui parcourait le monde à la façon d'Hercule « pour protéger le faible et venger l'opprimé », le vaillant Amadis des Gaules (s'il faut l'appeler par son nom), s'apprêtait, armé de pied en cap, à combattre le roi Lisvart. Un merveilleux bruit et clameur du peuple s'est fait entendre en dehors du palais. Lisvart envoie incontinent un de ses chevaliers s'informer de la cause de ce tumulte : on lui rapporte qu'on vient de découvrir en mer « un feu le plus épouvantable qu'on vit oncques, lequel s'approchoit du port à vue d'oeil» Les chevaliers font querir leurs chevaux et courent au rivage; les dames montent au plus haut des tours. " Lors fut vu de tous en mer un haut rocher ardent, poussé du vent et des ondes, par telle impétuosité que si fortune eût couru, et, ce qui augmenta leur crainte, ils l'aperçurent peu après muer en un serpent horrible, lequel étendoit ses ailes plus loin qu'un bon archer ne pourroit traire. Mais, si cela leur donnoit ébahissement, le demourant du monstre ne leur en apportoit guères moins, car il venoit droit à eux, ayant la tête élevée comme la hune d'un vaisseau, jetant par les narines une fumée si épaisse que, de très grande obscurité, on le perdoit de vue par intervalles, puis, tout soudain, on l'oyoit siffler et faire hurlemens, tels qu'oncques dyablerie pareille n'avoit été entendue." " De rato en rato, dit le chroniqueur espagnol, à qui nos romanciers du seizième siècle ont emprunté ce récit, ecliaba por las narices agllel muy negro laimo que fasla el cielo subia y desque se cubria todo; daba los roncos y silbos tan fuertes è tan espantables que no parescia sino la mar se queria fundir." Ce n'est pas tout: le monstre vomissait aussi par la bouche des torrents d'eau capables de submerger le navire, si grand qu'on le suppose, qui eût commis l'imprudence de s'en approcher : Echaba por la boca las gorgozadas del agua tan recto è tan lejos, que ninguna nave, por grande que fuese, a ella se podria llegar, que no fuese anegada. Le commun peuple, estimant estre punicion divine et chose envoyée de Dieu pour les endommager, s'enfuit en amont l'isle, etle semblable advint aux chevaliers, combien que ce fut malgré eux, car leurs chevaux épouvantés se mirent à ronfler et petiller, et, finablement, à prendre leurs mors aux dénis et courir à travers pays". Les sauvages qui virent pour la première fois un bateau à vapeur auront-ils décrit leurs impressions dans un autre langage? Eux aussi, j'en suis sûr, ils ont dû raconter qu'ils avaient aperçu « un rocher ardent » s'avançant sur les eaux que ne ridait aucun souffle avec la vitesse d'une pirogue de guerre emportée par le vent en poupe; le noir panache de fumée, qui, par instants, envahissait le ciel, les mugissements de la vapeur lâchée qui se condensait en torrents d'eau dans les airs, auront été pour eux, comme pour les chevaliers du roi Lisvart, d'inexplicables et terrifiants prodiges. Quand Fulton coçut la grande idée de son bateau à feu, fut-il donc, à son insu sans doute, le plagiaire de quelque génie méconnu dont le vaisseau sombra, aux âges lointains, sous l'indifférence publique, pour revivre un beau jour dans un de ces romans naïfs où le merveilleux ne fait bien souvent que nous dérober le vague souvenir d'un fécond essai avorté? La baguette de nos enchanteurs est en train de transformer le monde; mais il a existé de puissants sorciers avant eux, et la Grande Serpente me paraît avoir des droits incontestables à se dire l'ancêtre du Duilio, de la Dévastation et de l'Inflexible, comme le vaisseau de Ptolémée Philopator a été celui du Great-Eastern.
COMBAT DE SALAMIS DANS LES EAUX DE CHYPRE
La marine égyptienne, dont la baie d'Actium
devait engloutir les derniers vaisseaux, avait pris
sous les Ptomélées un développement qui nous
paraîtrait incroyable si la puissance navale de l'Angleterre
n'était là pour attester ce qu'on peut attendre
d'une nation enrichie par le commerce des
Indes. Appien et Athénée ont fait le relevé de la
flotte de guerre de Ptolémée Philadelphe, le premier
successeur du lieutenant d'Alexandre. Appien
lui attribue deux mille actuaires, quinze cents vaisseaux
longs et huit cents grosses nefs. Athénée, de
son côté, nous affirme que Ptolémée Philadelphe
posséda deux vaisseaux à trente rangs de rames, un
de vingt, quatre de treize, deux de douze, quatorze
de onze, trente de neuf; trente-sept avaient sept
rangs, cinq en armaient six; dix sept, ou quatre
cent dix-sept, si l'upsilon comme le suppose Schweighauser, s'est réellement figé au bout du
calamus scriptorius du copiste, n'étaient que des
quinquérèmes, autrement dit des pentères; trente quatre,
ou huit cent trente-quatre, formaient
un dernier groupe composé de tétrères, de trières,
de dières et d'hémiolies. Ptolémée Philadelphe
comptait, en outre, dans ses arsenaux près de quatre
mille navires de commerce qu'il envoyait aux îles
et jusque sur les côtes plus éloignées encore de la
Libye ou, suivant une autre version, de la Lycie,
province asiatique qui relevait alors de l'autorité
des rois d'Egypte.
Le fondateur de cette puissante marine fut le fils
de Lagus. Le premier des Ptolémées témoigna de
bonne heure un goût tellement prononcé pour les
choses de la mer que ses compétiteurs l'appelaient
ironiquement le capitaine de vaisseau. Ce lieutenant
aimé d'Alexandre, qui connaissait si bien le chemin
de la victoire, débuta néanmoins dans la guerre
maritime par une défaite. Le sort lui opposa sur
ce théâtre sujet aux perfidies un adversaire qu'il
avait vaincu à Gaza, mais qui prit sa revanche dans
les eaux de Chypre: cet adversaire, presque imberbe
encore, était Démétrius, le fils aîné d'Antigone,
satrape de la Phrygie, Démétrius, à qui son habileté dans la conduite des sièges valut plus tard le surnom
de "preneur de villes". Plutarque a cru pouvoir
établir un parallèle entre Démétrius Poliorcète et
le triumvir Antoine. Il y a cependant entre ces deux
personnages d'humeur également ouverte et joyeuse
une différence marquée : l'un est un homme de
mer, un navarque consommé; l'autre trébuche
gauchement dès qu'il quitte la terre pour mettre le
pied sur un vaisseau. Venez, mauvais sujet, qui
avez tous les vices qu'on reprochait si injustement
à votre maître, je vous reconnais pour un des nôtres,
et je suis sûr qu'aux champs Elysées je vous rencontrerais
causant canons rayés, brûlots et torpilles
avec Thémistocle, avec don Juan d'Autriche, avec
Duguay-Trouin, Suffren, Nelson et Canaris. Vous
regrettez peut-être de n'avoir pas eu à votre disposition
ces terribles engins contre lesquels vous auriez
si volontiers échangé toutes vos hélépoles; navigateur
à rames, vous n'en êtes pas moins fait pour donner
à cette marine nouvelle qui se passe du secours du
vent des leçons que nous demanderions vainement
aux vainqueurs de Rio-Janeiro, de Tritiquemalé ou
de Trafalgar.
Antigone, le père de Démétrius, avait si bien
arrondi la satrapie qui lui était échue dans le partage des États d'Alexandre, qu'il était déjà le roi de l'Asie
avant que ses soldats eussent songé, dans un jour de
triomphe, à lui décerner ce titre Ses armées étaient
nombreuses, aguerries et fidèles; il ne lui manquait
que des vaisseaux. Les flottes, au quatrième
siècle avant notre ère, se construisaient vite; elles
disparaissaient tout aussi rapidement. Celles qu'avait
jadis rassemblées Alexandre n'étaient plus,
quelques années à peine après sa mort, que du bois
pourri. A la voix du satrape, les cèdres du Liban
et les hauts sapins du Taurus ont repris le chemin
du rivage; les charpentiers de Rhodes, de Sidon,
de Biblos et de Tripoli se sont remis à l'oeuvre, et
bientôt les mers de la Cilicie voient se ranger, de
la baie d'Issus au promontoire Sacré, deux cent
quarante bâtiments à rames auprès desquels les
trières d'Athènes n'auraient été que des avisos. On
rencontrait dans cette flotte née d'hier des vaisseaux
à quatre, à cinq, à neuf et jusqu'à dix rangs de
rames, sans compter cent trente navires non pontés. En véritable lieutenant d'Alexandre, Antigone s'était
du premier coup, proposé de faire grand. La flotte phrygienne fut placée sous les ordres de
Démétrius; Antigone l'envoya porter la liberté aux
Athéniens, asservis par Cassandre. La liberté,
comme un dieu propice, prit plaisir à enfler ses
voiles : en quelques jours, Démétrius, constamment
secondé par un vent favorable, eut franchi l'espace
qui le séparait de l'Attique. Personne n'avait encore
entendu parler de la flotte d'Antigone; la garnison
de Munychie crut voir arriver la flotte de Ptolémée;
le port du Pirée s'ouvrit sans méfiance devant les
libérateurs. L'an 306 avant Jésus-Christ, Athènes
rejeta une fois de plus loin d'elle la faction oligarchique
et, dans l'ivresse de sa reconnaissance, érigea
des statues d'or à Antigone et à Démétrius, leur
décernant le titre de dieux sauveurs.
Qui possède l'Asie Mineure ou l'Egypte ne saurait
se passer de Chypre: cette île est une annexe que
se disputeront éternellement les maîtres de la Syrie
et les dominateurs de la vallée du Nil. Démétrius
et Ptolémée se rencontrèrent sur la côte orientale
de Chypre, en vue de Salamis et non loin des lieux
où s'élève aujourd'hui Famagouste. Le frère de
Ptolémée, Ménélas, occupait Salamis, ville et port
de grande importance. Là régna jadis Evagoras et
se réfugia Conon après la défaite d'Ægos-Potamos. Démétrius assiégeait Ménélas: le roi d'Egypte accourut
en personne au secours de son frère assiégé.
Il amenait cent quarante vaisseaux de guerre et deux
cents bateaux plats sur lesquels il avait embarqué
douze mille hommes d'infanterie; le fils d'Antigone
pouvait mettre en ligne cent dix-huit navires.
A l'exception des trente galères athéniennes qui
n'étaient que des quadrirèmes, tous les autres
vaisseaux de Démétrius portaient cinq rangs au
moins de rames; les galères phéniciennes étaient,
en majeure partie, des septirèmes.
Les deux flottes sont rangées par leurs chefs en
bataille; les céleustes se lèvent et invoquent les
dieux; les équipages répètent à haute voix ces
prières. Démétrius et Ptolémée ont compris qu'il
s'agit en ce jour d'une lutte mortelle; "leur coeur,
nous dit Diodore de Sicile, bat violemment". Cinq
cents mètres environ séparent les deux lignes. C'est
de cette distance que les flottes d'ordinaire prennent
leur élan; sur terre, les hoplites se rapprochent
davantage: la Béotie a vu les Lacédémoniens attendre
pour immoler la chèvre propitiatoire qu'ils
fussent à cent quatre-vingts mètres à peine de l'ennemi.
On perd moins vite haleine à ramer qu'à
courir. Démétrius, le premier, donne au chef des signaux l'ordre d'élever au-dessus de sa tête le
bouclier doré: ce signal est salué par les acclamations
de toute la flotte. Ptolémée, à son tour, a cessé
de retenir ses vaisseaux: les trompettes sonnent la
charge, les cris se répondent, l'air frémit déchiré
par de discordantes clameurs. Tous les combats
de galères désormais se ressemblent; on ne sait
plus se servir de l'éperon avec l'élégante habileté
des Athéniens. Que ce soient les Doria et les Barberousse,
les Dandolo et les Pisani, les Roger de
Lauria et les princes de Salerne, ou les lieutenants
d'Alexandre qui combattent, on retrouvera toujours
les mêmes épisodes: au début, une grêle de traits,
de javelots et de pierres, quand ce ne sera pas une
volée d'artillerie, puis, sur-le-champ et sans plus
de manoeuvre, la mêlée, le choc debout au corps,
l'abordage, la lutte acharnée et terrible. Ce sont
d'ardents athlètes impatients de s'étreindre, ce ne
sont plus des marins appelant à leur aide toutes les
ressources d'une tactique ingénieuse et savante que
nous avons sous les yeux. Comment d'ailleurs, connussent-
ils cette tactique, en feraient-ils usage avec
les lourdes masses qui ont si brusquement succédé
aux trières? Démétrius est debout sur la poupe de
sa septirème. Enveloppé d'ennemis, il frappe les uns à coups de lance, abat les autres de son épée.
Les traits qu'on lui lance, il les évite en se jetant
de côté ou les reçoit sur son bouclier. Trois écuyers
lui font un rempart de leur corps: l'un tombe mortellement
atteint par le fer d'une pique; les deux autres gisent devant lui grièvement blessés. Les
rames sont brisées, les vaisseaux dérivent lentement
enchaînés l'un à l'autre par les grappins de fer. Que
de noyés cependant encore! Combien d'hoplites,
perdant leur équilibre, sont tombés tout armés
entre les deux carènes! Le champ de bataille, rougi
de flots de sang, se couvre en même temps de débris
et offre à la fois l'aspect d'un étal de boucher
et d'un vaste naufrage. Avec les galères, les combats
meurtriers ont disparu; Aboukir et Trafalgar
ne seront que des escarmouches.
Démétrius a enfin réussi à rompre et à disperser:
l'aile droite de la flotte égyptienne : ce premier
succès devient, qui l'aurait cru? un succès
décisif. Vainqueur à l'aile gauche, Ptolémée fait de
vains efforts pour rétablir le combat. Il voit bientôt
ses vaisseaux consternés chercher leur salut dans la
fuite et tomber l'un après l'autre aux mains de
l'ennemi. Il ne lui reste plus qu'un parti à prendre :
il s'éloigne à toutes rames et parvient à gagner le port allié de Citium. Démétrius n'a pas eu vingt
navires endommagés; il s'est emparé de quarante
vaisseaux longs et de cent bâtiments de transport
chargés de près de huit mille hommes. Quatre vingts
navires avariés qu'ont abandonnés leurs
équipages sont remorqués par ses quinquérèmes
jusqu'à la plage où il a établi son camp: Salamis,
atterrée, se soumet aux lois du vainqueur.
Voilà ce qu'en quelques années les Macédoniens
avaient fait de la marine: un champ clos pour les
hommes d'armes, une arène fermée à l'art des
pilotes. La nature semblait les avoir formés pour se
mesurer avec les soldats de Duilius; ils auraient
trouvé de plus dangereux adversaires dans les soldats
d'Octave. Un jour vint où, maîtresse du monde,
Rome put opposer aux légions montées sur ces
lourdes carènes qu'avait illustrées la victoire de
Salamis d'autres légions servies par des navires
plus alertes. Ce jour-là on put croire que la marine
athénienne allait renaître, et on l'eût vue, en effet,
jeter certainement sur les mers réjouies un nouvel
éclat si Octave ne fût devenu Auguste et n'eût pour
la première fois et pour de longs siècles fermé les
portes du temple de Janus.
LA MARINE DES ROMAINS PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE PUNIQUE. - COMBATS D'ECNOME ET DES ILES ÆGADES.
A Rome, vers la fin de la dernière guerre punique, tous les citoyens étaient obligés de servir dix ans dans la cavalerie ou seize ans dans l'infanterie; ceux qui ne possédaient pas plus de 400 drachmes, 368 francs, on les réservait pour la marine. Il en devait être autrement quand la république mettait en action dans une seule bataille plus de cinq cents quinquérèmes montées par près de cent cinquante mille rameurs; il est très probable qu'on ne s'arrêtait pas alors à ces catégories injurieuses, et que les flottes n'étaient pas réduites, pour former leurs équipages, à se contenler du rebut des armées: the foolest of the family (1).
(1) Il existe en Angleterre, dit le capitaine Marryat, dans son délicieux roman de Peter Simple, une coutume païenne consacrée par un long usage. Le moins intelligent de la famille- the greatest fool of the famity- doit être offert en sacrifice à la grandeur et à la suprématie navale du pays.
Chacun prenait la rame et courait sus aux Carthaginois. «Ah! quand
on admire, nous dit avec raison Polybe, les batailles
et les flottes d'Antigone, de Ptolémée, de Démétrius,
avec quel étonnement ne doit-on pas, à plus
juste titre, assistera ce grand conflit de Rome et de
Carthage! Quelle immense distance entre les
quinquérèmes qui tinrent alors la mer et les galères
dont les Perses firent usage pour combattre les
Grecs! Les vaisseaux que s'opposèrent mutuellement
les Athéniens et les Lacédémoniens approchaient-
ils eux-mêmes des navires sur lesquels se
livrèrent les batailles des guerres puniques? Cinq
cents, sept cents vaisseaux entrent en lice dans une
seule journée : douze cents sont détruits par l'ennemi
ou submergés par la tempête dès la première
guerre. Le corbeau de Duilius y est pour peu de
chose: ce n'est vraiment pas un bien merveilleux
trait de génie que de venir jeter un pont volant
garni de parapets sur la galère qu'on aborde;
gardons notre enthousiasme pour l'audace de ces
fantassins qui ne reculent pas à la seule pensée
d'affronter sur son élément un peuple fait à tous les hasards de la mer, pour l'opiniâtreté de ce rude
sénat qui s'obstine à vouloir ravir à Carthage la
suprématie maritime, bien héréditaire de la
grande colonie phénicienne.
Agathocle avait surpris la descente en Afrique;
les consuls Marcus Attilius, Régulus et Lucius
Manlius voulurent l'opérer à poitrine découverte;
ils forcèrent le passage. Je ne vois rien à reprendre
aux dispositions qu'ils adoptèrent pour arriver à ce
résultat; c'est ainsi, suivant moi, que devrait manoeuvrer
une armée navale qui aurait pour mission
de protéger la marche d'un puissant convoi. Trois
cent trente vaisseaux romains, tous vaisseaux pontés,
dont l'équipage ne comprend pas moins de
trois cents rameurs et de cent vingt soldats, sont
partis de Messine emportant une armée de cent
quarante mille hommes. Ils ont doublé le cap Passaro
et longent la côte qui regarde l'Afrique avant de s'aventurer "à faire canal", en d'autres termes,
à couper droit sur le cap Bon. Prévenus à temps,
les Carthaginois accourent de Lilybée, cherchez
sur nos cartes modernes Marsala, le port où prit
terre Garibaldi. Leurs chefs, Amilcar et Hannon,
sont parvenus à rassembler trois cent cinquante
navires; c'est une grande bataille rangée qui s'annonce. Les adversaires ne sont ni l'un ni l'autre
pris à l'improviste; chacun d'eux peut mûrir à
loisir son plan de combat.
La flotte romaine se partage en quatre escadres :
les deux escadres à la tête des quelles marchent les
consuls sont rangées sur deux lignes convergentes
de relèvement. Les sommets des deux colonnes se
touchent, les deux files forment éventail, tous les
vaisseaux font des routes parallèles : la tactique
moderne appellera cette formalion qui semble si
propre à l'attaque et dont la marine à voiles a souvent
fait usage, l'angle aigu de chasse. Le triangle
est fermé par une troisième escadre chargée de
remorquer les vaisseaux de transport. La quatrième
division constitue la réserve; développée en ordre
de front, derrière tout cet ensemble, elle couvre à
la fois, et les vaisseaux que traîne la troisième escadre,
et les colonnes d'attaque qui s'avancent pour
s'enfoncer comme un coin dans le centre ennemi.
La division de réserve a, dès ce moment, son rôle
marqué pour l'offensive; elle marche en ordre
ouvert, développant sa ligne de façon à déborder
les ailes qui comptent sur son intervention, si l'ennemi
essayait de les menacer. On sait, en effet, que
ce sera toujours par le flanc qu'une flotte composée de bâtiments à rames ou de navires à vapeur demeurera,
quelque formation qu'elle adopte, particulièrement
vulnérable. Les Carthaginois n'ont pas
un instant songé à recevoir le choc de cette masse
immense qui vient à leur encontre; au lieu de vouloir
lui barrer la route, ils ouvrent leurs rangs et
la laissent passer, mais c'est pour se rabattre soudain
à droite et à gauche. La journée est à eux s'ils
savent tirer parti de l'embarras dans lequel ils vont
ainsi jeter les Romains: on ne retourne pas une
armée de cent quarante mille hommes comme un
gant.
Lancées en avant de toute l'énergie de leurs
rames, les deux divisions que conduisent les consuls
n'ont trouvé devant elles que des vaisseaux
prompts à vider la place; la troisième et la quatrième
escadre, au contraire, menacées sur leurs
flancs, ont eu, dès le début, le sentiment d'une
situation critique : ce sont elles qui ont le soin du
convoi. A quoi sert d'avoir forcé le passage si
l'arrière-garde est mise dans l'impuissance de
suivre? Inquiets de la tournure que vient de prendre
tout à coup le combat, les consuls ont déjà suspendu
leur élan: essayeront-ils de virer de bord,
de reprendre, par un brusque mouvement de tête à queue, le terrain perdu! Les vaisseaux qui pliaient
devant eux, ces vaisseaux qu'ils croyaient n'avoir
plus qu'à poursuivre, ne leur permettront pas de
faire ainsi volte-face; la mêlée s'engage, et les deux
divisions dont les consuls se sont imprudemment
séparés ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes.
Deux batailles distinctes vont se livrer
simultanément, l'une au large, l'autre presque à
portée de trait de la terre.
L'aile gauche des Carthaginois rencontre cependant
un accueil qui la refroidit; l'aile droite, que
commande Hannon, attaque avec plus d'impétuosité.
Négligeant les vaisseaux qui restent déployés sur
une longue ligne oblique, négligeant le convoi et
les navires de guerre qui le remorquent, elle va
droit à la quatrième division. Ne sait-elle pas qu'un
secours inattendu viendra jeter bientôt en sa faveur
un poids décisif dans la balance ? Le long de terre,
en effet, s'est dissimulée une puissante embuscade :
toute une escadre attend, cachée entre les roches,
que le convoi romain arrive à sa hauteur. A peine
la quatrième division a-t-elle été assaillie par les
vaisseaux d'Hannon que le corps détaché qui guette
l'inslant propice fond de toute sa vitesse sur la troisième
division et sur les transports. La troisième division n'hésite pas; elle coupe les remorques et
laisse le convoi qui paralysait ses mouvements abandonné
au milieu de l'arène. Au point où en sont
venues les choses, les combinaisons tactiques seraient
de peu de secours. Les vaisseaux d'Amilcar
ont à lutter contre les deux consuls; ils supportent
le gros de l'action, Hannon tient en échec la quatrième
escadre; la troisième se trouve serrée contre le rivage par la réserve carthaginoise, qui a réussi
à la tourner. Le premier groupe qui fléchira décidera
par sa faiblesse du sort des deux autres.
Tant qu'ils ont manoeuvré, les Carthaginois ont
eu l'avantage; leur astre pâlit du moment qu'ils
attaquent à fond. En venir à l'abordage, c'est replacer
les soldats sur leur terrain : la corvette la Bayonnaise
n'eût probablement pas pris la frégate anglaise
l'Embuscade si elle n'avait eu à son bord une compagnie
de l'ancien régiment de Flandre, et, à Trafalgar
même, nos vaisseaux entourés faillirent sur
plus d'un point, grâce aux troupes passagères qu'ils
portaient, faire repentir l'ennemi d'avoir osé les
serrer de trop près. Amilcar avait tout lieu d'espérer
la victoire; quelques-uns de ses vaisseaux, trop
empressés à se dégager d'une étreinte fatale, ont
donné par malheur le signal de la fuite. Que peut un général dans un pareil désordre? Se couvrir de
signaux? on n'en tiendra pas compte. Redoubler
d'énergie? payer de sa personne? C'est au début de
l'action que cet exemple entraîne; au fort de la
mêlée, on ne s'en aperçoit même pas. Amilcar
vaincu, Hannon n'a plus qu'à se retirer en toute hâte.
Pendant que Manlius attache à la poupe de ses
vaisseaux les galères ennemies dont le pont a été
forcé l'épée à la main, Régulus s'occupe de venir
en aide à la quatrième escadre d'abord, à la troisième
ensuite. La défaite des Carthaginois devient irrémédiable:
trente de leurs navires ont été coulés bas,
soixante-quatre sont amarinés. Les Romains n'ont
à regretter que la perte de vingt-cinq galères.
Telle fut l'issue du grand combat livré en vue
d'Ecnome, entre Agrigente et Géla, au printemps
de l'année 257 avant Jésus-Christ. Six cent cinquante
navires de guerre et plus de trois cent mille combattants
y prirent part. Nulle barrière n'existait plus
entre les Romains et le cap Bon; les soldats de
Manlius et de Régulus débarquèrent, et tout le pays
environnant en un clin d'oeil fut à eux. Il y avait
plus d'un demi-siècle que la Libye se reposait de l'invasion d'Agathocle: les somptueuses villas, les
fermes opulentes avaient reparu; le butin fut immense et le dégât affreux. Le consul Manlius rentra
dans Rome avec vingt mille esclaves. Pendant ce
temps, Régulus, en possession déjà d'une place
d'armes, Clypea, ville située à l'orient du cap
Bon, s'emparait de Tunis. C'était invariablement
alors par la prise de Tunis qu'on préparait l'investissement
de Carthage; mais Régulus, à qui Rome
venait de retirer la majeure partie de ses troupes,
n'était plus de force à tenter une attaque sérieuse
contre la grande cité. Réussirait-il même bien
longtemps à se maintenir dans la campagne? Les
Carthaginois envahis avaient eu recours à leur expédient
habituel: ils levaient de tous côtés des mercenaires.
La Grèce leur envoya un général; formé à
l'école de la discipline lacédémonienne, ce général
valait à lui seul une armée. A peine Xantliippe eut-il
mis le pied sur la côte libyenne que la guerre prit
soudain un nouvel aspect. Les Romains, harcelés
dans leurs positions, obligés de descendre dans la
plaine pour se procurer des vivres, se virent contraints
d'accepter la bataille en pays plat: Xanthippe
les étourdit par les assauts réitérés de sa cavalerie
et finit par les écraser sous le poids de ses éléphants.
Bien peu de soldats échappèrent au désastre;
Régulus lui-même fut fait prisonnier. Il n'était point dans les habitudes de Rome de
rester accablée sous une défaite; aussitôt qu'un nouveau
printemps eut rouvert le chemin de l'Afrique,
une autre flotte partit des ports de la Sicile et
se présenta devant Clypea, dent les Carthaginois
tenaient la garnison assiégée. Trois cent cinquante
vaisseaux cette fois en combattirent deux cents;
cent quatorze galères carthaginoises furent le prix
de la victoire que remportèrent les consuls Marcus
Æmilius et Servius Fulvius à la hauteur du cap Bon.
La garnison de Clypea était sauvée, mais l'Afrique
n'était pas pour cela conquise. Les Romains reculèrent
devant les hasards d'une expédition prolongée: ils avaient mesuré les forces de leur ennemi
et savaient maintenant que, tant qu'ils n'auraient
pas tari les sources où s'alimentait la richesse de
Carthage, le monde entier fournirait à leur implacable rivale des soldats. Sans s'arrêter sur ces côtes
déjà saccagées et qui ne pouvaient plus leur offrir
qu'un maigre butin, ils reprirent le chemin de la
Sicile. On venait d'entrer dans la seconde quinzaine
du mois de mai; la constellation d'Orion commencait à se montrer à l'orient vers le lever du
jour; le Chien disparaissait le soir à l'occident,
peu de temps après le coucher du soleil. Sans être aussi périlleuse que la saison d'automne, cette
période amène cependant fréquemment d'impétueuses
bourrasques. C'est au mois de mai que
Nelson vit sa flotte dispersée dans le golfe de Lyon,
le vaisseau qu'il montait démâté et poussé par le
vent sur la côte de Sardaigne, où il faillit se perdre.
Si l'on en croit Végèce et le capitaine Pautero Pantera,
la saison pendant laquelle il fut jadis permis
aux bâtiments à rames de tenter des expéditions ne
laissait pas d'être assez limitée. " Du 20 mars au
20 mai, nous dit le savant auteur de l'Armata
navale, la saison, dans la Méditerranée, reste encore
équivoque; elle se lient alors entre la sécurité et le
péril; du 20 mai au 24 septembre, la mer s'aplanit
et la navigation devient beaucoup plus sûre; du
24 septembre au 22 novembre, il faut une nécessité
absolue pour qu'on ose s'engager dans quelque
entreprise importante." La flotte romaine avait déjà
fourni sans encombre la majeure partie de sa course;
les côtes de Sicile venaient d'être signalées par les
vigies; encore quelques heures, et les vaisseaux
atterrissaient, quarante milles env iron à l'ouest du
cap Passaro. Les consuls avaient dès lors le choix
entre deux partis : ils pouvaient, à leur gré, se
retirer, ainsi que le conseillaient les pilotes, sur la côte qui s'étend du cap Passaroà Messine, et attendre,
avant de quitter ces parages féconds en abris,
que la période douteuse fût passée, ou continuer
hardiment leur route et profiter du prestige que
leur assurait une victoire récente pour soumettre
la plupart des villes répandues sur la côte qui
regarde l'Afrique entre le cap Passaro et Lilybée.
Ce fut malheureusement ce dernier parti que les
consuls adoptèrent. La tempête les surprit devant
Camarina. Il était trop tard pour essayer de doubler
le promontoire qui les eût protégés; le vent battait
en côte et poussait les galères sur les hauts-fonds
dont cette partie du littoral est semée. De trois
cent soixante-quatre vaisseaux, il n'en échappa que
quatre-vingts; le reste fut submergé ou alla se
briser contre les roches. Tout le rivage qui s'étend
vers Sélinonte et vers Lilybée était couvert de débris
et de cadavres.
Si jamais nous devons embarquer nos soldats sur
des flottilles, nous les placerons dans de meilleures
conditions : il peut y avoir sur une coque de noix,
quand elle est bien construite, tout autant de sécurité
que sur un trois-ponts. Après avoir recommandé
la prudence aux bâtiments à rames, le capitaine
Pantero Pantera se croit obligé d'ajouter : « Ces conseils ne concernent pas les galions et les naves
qui peuvent naviguer de tous temps avec moins de
danger. « Le Père Fournier nous fait cependant
observer avec raison que, dans les mers étroites
et sur les côtes dépourvues d'abri, ce ne sont pas
les plus gros navires qui se tirent le plus aisément
d'affaire. Si Ruyter, quand il partit de Berghen,
après sa fameuse croisière dans les mers du Nord,
eût commandé une escadre semblable à celles que
nous employâmes au blocus de l'Escaut en 1831
et au blocus de la Jahde en 1870, il n'eût pu se
réfugier dans l'Ems pour laisser passer le terrible
coup de vent qui avait déjà désemparé une partie
de ses vaisseaux; il n'eût pas davantage, quelques
années plus tard, remonté la Tamise jusqu'à l'embouchure
de la Medway et incendié l'arsenal de
Chatham. Toute l'histoire de la marine ancienne
n'est qu'un long plaidoyer contre les dimensions
exagérées du navire de guerre; l'histoire de la
marine moderne n'est pas plus favorable à l'adoption
des grands tirants d'eau.
Les leçons ne profitent qu'à ceux qui les comprennent
: les Romains s'en prirent follement aux
dieux d'un désastre qui n'était dû qu'à l'inexpérience
de leurs consuls; les dieux, pour les punir, leur infligèrent un second naufrage. Une nouvelle flotte,
composée de deux cent vingt vaisseaux, venait d'être construite en trois mois. Cette flotte, après
avoir soumis la ville de Panorme en Sicile, crut devoir
reprendre encore une fois la route de l'Afrique;
elle alla maladroitement s'échouer à Zerbi. Un
retour de marée, car il existe une marée, bien
que faible, dans le golfe de Gabès, la remit à
flot. Trop heureux d'être sortis à si peu de frais de
péril, les Romains s'empressèrent de regagner le
golfe de Palerme. De Panorme, située au fond de
ce golfe, ils se lancèrent, sans côtoyer plus longtemps
la Sicile, en pleine mer Tyrrhénienne. Cette
aventureuse traversée leur coûta cent cinquante
vaisseaux. «Ils furent assaillis, nous dit Polybe,
par une tempête violente» ; mais tout était tempête
pour les quinquérèmes. Les consuls se trompèrent
et jugèrent mal de l'apparence du temps: la faute
chez des consuls n'est-elle pas excusable? Le grand
Duquesne lui-même, Nelson, si constamment hardi,
parce qu'il fut constamment heureux, l'amiral
Hugon, le marin le plus consommé qu'ait connu
notre époque, ne se sont-ils pas laissé prendre,
comme de simples légionnaires, à ces brusques
trahisons de la Méditerrané ? Duquesne conduisait une flotte composée de vaisseaux
et de galères en Italie; il commandait directement
les vaisseaux, les galères obéissaient aux
ordres du duc de Mortemart. La flotte partit des
côtes de Provence avec un vent de nord-ouest assez
frais; quand elle fut par le travers du golfe Jouan,
le vent tomba et passa au sud-ouest. "M. Duquesne,
raconte le capitaine Barras de la Penne embarqué
à cette époque sur une des galères, fut tenté d'entrer
dans ce port; cependant, comme le vent le
portait toujours à sa route, il la continua. Les galères
le suivirent jusque par le travers de Villefranche, où
M. le duc de Mortemart alla mouiller, quoique le
vent fût encore assez bon pour aller plus loin; mais
outre que la mer était fort grosse, M. le duc jugea
très prudemment, par des signes presque indubitables,
qu'il trouverait bientôt le vent contraire s'il continuait sa route. C'est ce qui arriva effectivement
à M. Duquesne. Il ne fut pas plus tôt sur le cap de
Noli qu'il trouva des repaires violents. Tous les vaisseaux
se séparèrent et furent contraints de courir,
qui d'un côté, qui d'un autre, ce qui ne se passa
pas sans beaucoup de débris. L'un fut démàté,
l'autre eut tout son avant emporté; M Duquesne
lui-même perdit sa chaloupe qu'il traînait à la remorque, avec dix-huit matelots. On peut juger, par
ce que les vaisseaux souffrirent, le danger qu'eussent
couru les galères si M. le duc de Mortemart eût
ignoré que, quand on part des côtes de Provence
pour aller à l'est, avec un vent de nord-ouest, que
l'on trouve ensuite le sud-ouest et que, par le travers
de Villefranche, on voit les montagnes couvertes
de nuages qui ne font aucun mouvement, le ciel
sombre du côté de l'est et de plus orageux, comme
il était alors, on doit mouiller dans Villefranche."'
Science de nos ancêtres, combien vous pourriez
nous être utile encore, si nous avions jamais à conduire
quelque grande opération de débarquement !
« Les quartiers à la mer, la nouvelle lune à terre! »
voilà ce que nous recommandent à l'envi Végèce,
Ptolémée, Roberto Vallurio et le capitaine Pantero
Pantera. « Les dau phins, nous apprend ce dernier,
qui semble avoir condensé dans son livre toute la
science conjecturale des augures anciens et des
pilotes modernes, les dauphins sautent au lieu de
nager contre le courant, les crabes saisissent dans
leurs pinces le gravier du rivage, les canards battent
des ailes, les chiens, de leurs pattes de devant,
creusent le sol, les goélands se rassemblent dans le
port, le coq chante au coucher du soleil, la vache regarde le ciel et aspire le vent par les naseaux,
l'âne secoue la tête ou les oreilles, sans qu'il soit
cependant inquiété par les mouches; les chèvres,
les agneaux, les moutons montrent une avidité
plus grande que de coutume; ils cherchent avec
ardeur le pâturage, et on ne les écarte qu'avec peine
de l'herbe; les hirondelles rasent l'eau de leur poitrine; les passereaux s'appellent et se retirent
près des maisons; les corbeaux font grand bruit;
les oiseaux des fleuves abandonnent l'eau pour courir
dans les prés; le cormoran crie sur son écueil; le
pic d'hiver chante le matin; les grenouilles coassent;
les mouches, les cousins et les puces se montrent
altérés de sang humain; les fourmis emportent
leurs oeufs; les taupes soulèvent la terre; la paille,
les feuilles, les toiles d'araignée voltigent dans l'air;
les articulations deviennent douloureuses; les yeux
brûlent; les mains sont rugueuses et âpres; on
entend les bois murmurer; la faux, après avoir
coupé l'herbe, reste noire; les fleurs, les plantes,
les eaux exhalent leurs senteurs avec plus d'énergie;
le sel se liquéfie, les murs suintent; vous avez vu
en songe des oiseaux: tenez-vous sur vos gardes,
la tourmente est proche. »
La météorologie a fait de nos jours de grands progrès; mais une flotte en action est-elle en mesure
de recevoir les avertissements que les observatoires
et le télégraphe nous prodiguent? Nous avons donc
tort de dédaigner les vieux pronostics. Les vents
qui s'élèvent la nuit, si nous en croyons l'auteur de
l'Armata navale, durent beaucoup moins que ceux
qui prennent naissance pendant le jour. Une grande
pluie, surtout quand elle est soudaine, abat ordinairement
la fureur de la tempête; une pluie fine,
au contraire, alimente la brise, comme l'eau en
poussière paraît avoir le don d'entretenir et d'attiser
la flamme. Si, au moment du lever ou du
coucher du soleil, on aperçoit autour de cet astre
un cercle coloré, le vent soufflera de la partie du
cercle qui se dissipera la première. Découvrez-vous,
aux lueurs naissantes du jour, du côté de l'orient,
des nuages épais, le soleil s'est-il levé pâle ou vous
apparaîl-il avec un double globe, reconnaissez là les
signes évidents d'une prochaine tempête. Un soleil
gonflé est toujours un indice de fâcheux augure,
surtout quand il laisse derrière lui, à l'endroit où il
vient de disparaître, de gros nuages que percent
en divers endroits des taches couleur de sang.
La lune a ses présages aussi bien que l'astre du
jour: ce n'est pas sans motif qu'elle nous présente une face rubiconde. L'avis est plus menaçant encore
quand à la teinte rouge se mêle le noir ou le bleu
foncé. Des cercles lunaires séparés l'un de l'autre
par des intervalles égaux prédisent de grands vents
et des vents variables. Dieu vous préserve surtout
d'une lune vous offrant, à son seizième jour, un
éclat semblable à celui de la flamme! L'influence
de la lune sur le temps est bien discréditée aujourd'hui;
il n'est pas impossible que la lune en appelle.
Ne craignons donc pas d'enregister, ne fût-ce que
dans un intérêt historique, ce que pensaient à ce
sujet les anciens. Le moment de la conjonction était
tenu par eux comme un moment critique. Certains
observateurs allaient jusqu'à prétendre que le troisième
jour avant ou après l'opposition n'avait guère
moins d'importance que le troisième jour qui précédait
ou suivait la nouvelle lune. Toutes ces observations,
ingénieuses ou crédules, n'auraient pas été
faites par le chêne; elles eurent leur origine dans
les préoccupations bien naturelles du roseau. Tant
qu'il ne s'agira que de traverser les mers avec nos
puissants cétacés, les soucis des vieux triérarques
pourront ne nous arracher qu'un sourire; le jour où le
succès d'une descente dépendra d'un caprice de la
brise, nous les examinerons peut-être de plus près Les Romains se lassèrent de perdre leurs navires
sans combattre. Durant deux années consécutives,
ils abandonnèrent à Carthage l'empire et l'occupation
de la mer: Carthage en profita pour inonder
la Sicile de ses éléphants. Rome comprit le danger
qu'elle allait courir et se ravisa. Elle arma sur lechamp
une flotte considérable qui vint mettre le
blocus devant Lilybée. Des batailles, passe encore!
mais un blocus! comment s'imaginer qu'il pourra
être maintenu efficacement par des soldats? Pour
guetter l'occasion favorable, les Carthaginois n'avaient
qu'à jeter l'ancre sous les îles Ægades, à
Levanzo, à Maritimo, à Favignana. La première
grande brise qui soufflait du canal de Malte les
emportait à travers les flottes romaines impuissantes
à leur interdire l'accès de ce rivage tout semé
d'écueils. On vit jusqu'à des galères isolées forcer
en plein jour le blocus. Le chenal qui menait au
port était sinueux sans doute, mais pour des pilotes
familiers avec ces parages, ce n'en était pas moins
un chemin praticable; pour le suivre, il suffisait de
bien choisir et de bien se rappeler ses amers. Venant
de Levanzo, on avait trois tours en vue: il fallait se
diriger d'abord sur la tour qui s'élevait le plus près
du rivage, du côté du nord; dès que les deux autres tours, ces deux tours étaient situées sur la côte
qui fait face à l'Afrique, se trouvaient dans le
même alignement, en langage de marin, l'une
par l'autre, on changeait brusquement de route.
Tant qu'on ne sortait pas de la ligne ainsi tracée,
le vaisseau restait dans les eaux profondes.
Le Carthaginois qui déjoua le premier la surveillance
de la flotte romaine appartenait-il à la grande
famille des Barca? La chose est peu probable, car
on ne risque pas d'ordinaire des suffètes ou leurs
proches parents dans de telles aventures : le hardi
marin se nommait cependant Annibal. On le distinguait
du fils d'Amilcar par le surnom d'Annibal le
Rhodien. Il avait tant de fois traversé impunément
la croisière ennemie que les Romains finirent par
renoncer à l'espoir de l'intercepter au passage; ils
se résignèrent à lui laisser l'entrée du port ouverte,
se promettant de l'attendre à la sortie. Dix vaisseaux,
choisis parmi les plus rapides, allèrent se
poster des deux côtés du goulet. Les rames levées,
ils se tenaient constamment prêts à donner la chasse
au Rhodien, quand cet intrépide forceur de blocus
tenterait de regagner les îles AEgades. Le Rhodien
ne prit même pas la peine de chercher à dérober
ses mouvements à des ennemis dont il dédaignait les poursuites; il sortit du port en plein jour et passa
comme une flèche au milieu des Romains stupéfaits.
Sa confiance dans la supériorité de sa marche était
telle qu'à peine hors de portée des traits, on le vit
s'arrêter soudain et lever hors de l'eau, en signe de
défi ses avirons. Les Romains, haletants, déployaient
pour l'atteindre toute la force que les dieux avaient
mise dans les bras de leurs chiourmes; le Rhodien,
toujours immobile, prenait un malicieux plaisir à les laisser approcher jusqu'à la distance où les
armes de jet auraient pu devenir dangereuses; puis,
tout à coup, laissant retomber ses rames, il distançait
de nouveau en quelques palades les lourdes
quinquérèmes dont les équipages harassés étaient
moins que jamais en mesure de lutter avec des
rameurs qui venaient de reprendre haleine.
Ces affronts répétés causaient le plus vif dépit aux
consuls; ils résolurent de fermer l'entrée du port
par une jelée : la mer, comme à Tyr, dispersa les
blocs. Sur un seul point où les travailleurs rencontrèrent
un banc de sable, déjà presque à fleur d'eau,
on réussit à consolider la première amorce de la
digue. Par le plus heureux des hasards, une quadrirème
sortant de Lilybée alla donner sur cet écueil
récent dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Elle y resta échouée: les Romains accoururent et
s'emparèrent du bâtiment que la fortune, presque
toujours propice à la ténacité, leur livrait. Sur la
galère aux formes effilées, d'une architecture à la fois solide et légère, ils embarquèrent un équipage
d'élite. Quelques jours plus tard, le Rhodien voulut
répéter la manoeuvre qui lui avait jusqu'alors si
bien réussi; il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il
n'avait plus affaire à des vaisseaux construits aux
bords du Tibre; la quadrirème le gagnait rapidement.
Ne pouvant plus trouver son salut dans la
fuite, il fit bravement volte-face et alla de lui-même
au-devant du combat. Sa carrière de corsaire était
terminée : accablé par le nombre de ses adversaires,
il dut céder au sort et se rendre prisonnier.
Les Romains possédaient dès lors deux vaisseaux
rapides; il ne dépendait que d'eux d'en reproduire
le type; à partir de ce jour, la marine romaine
commence à se transformer. Les fils de Romulus
n'en furent pas moins battus une fois encore devant
Drapani. Cette race de laboureurs n'avait, il est
vrai, besoin que de toucher la terre pour reprendre
des forces; vaincue, elle revenait peu de temps
après à la charge: son opiniâtreté finit par lasser
les Carthaginois. Si les Romains avaient été moins rebelles à la science que pratiquaient si bien leurs
adversaires, s'ils avaient su seulement se garder du
naufrage, le siège de Lilybée n'aurait probablement
pas duré huit ans. Les avertissements du ciel étaient
par malheur lettre close pour des soldats enlevés à
leur élément: les nuages s'amoncelaient, la houle
venait battre sourdement le rivage, leur esprit demeurait
obstinément fermé à ces pronostics. Il n'y
avait pas un consul, s'appelât-il Marcus Æmilius,
Servius Fulvius, Aulus Allilius, Lucius Cornélius
ou Junius, qui comprît le danger de rester sur une
côte qu'allait infailliblement assaillir bientôt la tempête.
Pourvu que, comme Panurge, "ils eussent
un pied en ferre et que l'autre n'en fût pas loin",
il leur semblait qu'ils n'avaient rien à craindre
des menaces du firmament. Le lieutenant d'Adherbal,
l'habile Carthaginois se hâta de passer à l'est du
cap Passaro et de mettre ainsi sa flotte à couvert.
Les vaisseaux de Junius eurent le sort de
ceux que Marcus AEmilius et Servius Fulvius, cinq
ans au paravant, ramenaient d'Afrique. Dans les
mêmes parages et dans des conditions tout à fait
analogues, la flotte de Junius fut anéantie. De cent
navires de guerre et de quatre cents bâtiments de transport, la tempête ne laissa au malheureux consul
que quelques épaves. Ce marin maladroit était
en revanche un soldat de la plus haute valeur: il
répara sa faute en allant s'emparer du plateau
d'Éryx, position presque inaccessible d'où les
Carthaginois essayèrent vainement de le déloger.
La dix-huitième année de la première guerre
punique, l'année 245 avant Jésus-Christ, venait de
s'ouvrir : Amilcar Barca avait établi son camp
entre Éryx et Panorme; de continuels combats
occupèrent trois années encore. Il fallait en finir.
Les Romains qui, depuis cinq ans, se tenaient complètement
à l'écart de la mer, résolurent de reparaître
en force sur ce théâtre d'où ils s'étaient exclus
eux-mêmes à la suite de leur dernier désastre. Ils
équipèrent rapidement, grâce aux largesses de quelques
patriciens, une flotte de deux cents quinquérèmes
construites sur le modèle des galères capturées
devant Lilybée. Ces deux cents quiquérèmes
tranchèrent victorieusement la question: elles firent
ce que n'avaient pu faire ni l'occupation d'Eryx, ni
les longues lignes de circonvallation creusées sous
les murs de Lilybée; elles prirent Amilcar au dépourvu
et, dans une seule journée, conquirent
cette paix qui fuyait constamment devant les armées. Rome, après avoir débuté dans la guerre
de Sicile par une victoire navale, allait encore, par
une victoire navale, porter aux Carthaginois le
coup mortel. La plus grande leçon qu'elle ait
léguée au monde, c'est l'art de couronner par un
triomphe suprême une longue succession de défaites et de catastrophes. L'empire appartient fatalement
aux plus entêtés.
Retranché entre Éryx et Panorme, sans l'appui
d'aucune ville alliée, sans l'espoir même de se faire
des alliances dans une île qui obéissait presque
tout entière aux Romains, Amilcar ne vivait que
des convois de la mère patrie ou du produit de ses
courses sur les côtes italiennes : l'arrivée soudaine
du consul Lutatius le menaçait d'une prochaine
famine; il demanda des secours à Carthage. On lui
envoya de Carthage une flotte chargée de blé. Hannon
commandait ces vaisseaux de guerre, momentanément
convertis en transports, comme nos superbes
vaisseaux de la mer Noire que nous vîmes
revenir un jour du Bosphore bondés jusqu'à mi haubans
de balles de foin. Il alla jeter l'ancre sous
Maritimo. C'était des îles AEgades la plus éloignée
de Lilybée. Craignant sans doute de compromettre
la garnison qu'il eût fallu y laisser, les Romains, maîtres de Favignana et de Levanzo, avaient négligé
de prendre possession de cette troisième île, dans
laquelle ils auraient eu peine à faire passer, le cas
échéant, de prompts secours. Hannon, dès qu'il
eut rassemblé sa flotte au mouillage resté libre de
Marilimo, n'eut plus qu'une pensée: profiter du
premier vent qui soufflerait du large pour surprendre
la vigilance des Romains et pénétrer à travers
leurs lignes jusqu'au camp d'Amilcar. Là il comptait
alléger ses vaisseaux de leur cargaison et renforcer
les équipages avec l'élite des soldats mercenaires
: il serait alors en mesure de livrer bataille
et de reconquérir, si le sort le favorisait, l'empire de
la mer que Carthage, appauvrie par les dépenses
d'une guerre aussi prolongée, avait compromis en
laissant peu à peu dépérir ses flottes.
L'intérêt de Lutatius était, au contraire, de combattre
sur l'heure et d'arrêter les galères encore
alourdies des Carthaginois au passage: il prit poste
à Favignana. De cette île, la plus orientale du groupe,
il surveillait à la fois Maritimo, Lilybée et Drapani.
La circonstance qu'attendait Hannon ne tarda pas à
se présenter; le vent d'ouest si fréquent, on pourrait
presque dire si constant en été, dans le canal
de Malte, s'éleva dès le point du jour. Bientôt la brise acquit une grande violence. Les Carthaginois
déployèrent leurs voiles: Lutatius les vit s'avancer
comme un de ces nuages précurseurs de l'orage qui
chassent devant eux la poussière. Il douta un instant
qu'il pût réussir à ranger en bataille sur cette mer
tumultueuse sa flotte dont les équipages se composaient
en majeure partie de soldats; mais laisserait-
il donc passer le tourbillon qui allait porter
l'abondance et rendre la vigueur à un camp affamé?
Lutatius prit le parti de tenter l'aventure, espérant
que le pied peu marin de ses troupes s'affermirait
au moment du danger et pensant que le mal de
mer lui-même a peu de prise sur des gens animés
par la vue d'un ennemi qu'ils abhorrent. Il quitta
l'abri de Favignana et courut se placer entre les Carthaginois
et la terre. Les Carthaginois arrivaient à
toutes voiles; ils amenèrent soudain leurs antennes,
et, prenant leurs rames, se préparèrent à livrer
un combat dans les règles. Ce fut certainement une
faute: mieux eût valu pour eux continuer de courir
vers la côte à toute vitesse, dussent-ils, pour assurer
le passage d'un convoi si impatiemment attendu,
sacrifier la moitié de la flotte. La mêlée s'engagea;
la fortune, par un de ces caprices qui lui sont familiers,
vint tout à coup au secours des Romains : le vent d'ouest tomba brusquement. Dès que le
plancher redevint solide, les vaillants soldats de
Rome rentrèrent en possession de tous leurs avantages.
Ils prirent à l'ennemi soixante-dix vaisseaux
et en coulèrent cinquante. La brise qui soufflait
alors directement de terre sauva seule quelques
débris de la flotte carthaginoise, en les ramenant vers Maritimo. Lutatius, pendant ce temps, reprenait
le chemin du camp de Lilybée et y débarquait
dix mille prisonniers.
Cette bataille des îles AEgades est remplie pour
nous d'enseignements. Le représentant du peuple
Jean Bon-Saint-André, au combat du 1er juin 1794,
plus connu dans l'histoire sous le nom de combat
du 13 prairial, exigea de l'amiral Villaret- Joyeuse
qu'il abandonnât le champ de bataille et six vaisseaux
désemparés aux Anglais. Comment essaya-t-il
de justifier cette retraite désastreuse? Il prétendit
qu'il avait voulu avant tout garder la faculté d'assurer
le passage du grand convoi de blé qu'attendait
d'Amérique la France, à cette époque en
proie à la disette. Jean Bon-Saint-André eût mieux
atteint, je crois, ce résultat en prolongeant la lutte
et en réduisant ainsi à une longue impuissance la
flotte britannique. La situation d'Hannon n'était pas celle de l'amiral Villaret-Joyeuse. Sa flotte n'était
elle-même qu'un immense convoi: un convoi n'est
pas fait pour combattre; il est fait pour passer. Son
rôle n'est pas d'accepter les engagements auxquels
on le provoque, mais de renverser à tout risque les
barrières que l'ennemi lui oppose, trop heureux s'il
parvient, en semant son chemin d'épaves, à sauver
de la capitulation imminente la place ou l'armée
qu'il a mission de ravitailler.
Les conséquences du combat des îles AEgades
furent immenses. Amilcar comprit sur-le-champ la
portée décisive de cette défaite. Carthage luttait
depuis vingt-quatre ans; elle était à bout de ressources
et d'énergie. Sur le conseil d'Amilcar, le
sénat demanda la paix. Les conditions imposées par
Rome étaient dures; la continuation de la guerre ne
pouvait que les rendre plus cruelles encore. Une
génération nouvelle ferait peut-être mieux; il fallait
lui laisser le temps de grandir. Les Romains avaient
perdu sur mer, pendant cette longue guerre, sept
cent quatre-vingt-quatre quinquérèmes et plus de
trois cent mille hommes; les Carthaginois, deux cent
vingt mille hommes et cinq cent quatorze vaisseaux.
Il est triste, profondément triste de songer que la
guerre, si heureuse qu'elle soit, ne conclut jamais rien. Amilcar vaincu légua comme héritage sa haine
à son fils. Les vainqueurs devraient y regarder à
deux fois avant de provoquer par leurs exigences le
serment d'Annibal. Je n'ai point à m'occuper de la
seconde, ni de la troisième guerre punique : la
marine n'y joua qu'un rôle effacé. Si j'étudiais les
phases de cette lutte sanglante qui faillit ne pas
tourner à l'avantage des Romains, il me serait facile
de montrer où peut conduire l'abus de la victoire.
Quand, après la bataille de Cannes, l'armée carthaginoise
campait aux portes de Rome, le sénat eut
raison de mettre héroïquement en vente le champ
où Annibal avait dressé ses tentes; mais tout l'héroïsme
du sénat romain n'aurait pas sauvé la ville
éternelle : Rome dut son salut aux dissensions qui
choisirent ce moment pour éclater à Carthagc. Recueillons-
nous ici et faisons en silence un retour sur
nous-mêmes : quelques faveurs que lui octroie le
sort, toute maison divisée, l'Evangile nous l'apprend,
est fatalement destinée à périr. La leçon est
banale; elle n'a cependant, que je sache, profité,
ni dans les temps anciens, ni dans les temps modernes,
à aucun peuple en proie aux fureurs des partis.
Ce qui serait non moins digne de remarque,
c'est la fortune de Rome, dès que Rome n'eut plus de
rivale à craindre. Toutes les vertus civiques du
peuple-roi en quelques années s'évanouirent, et, de
sa vieille ardeur guerrière, il ne resta plus à ce
peuple gâté par la victoire que les transports jaloux
d'une nation mûre pour la guerre civile.
RIVALITE D'OCTAVE ET D'ANTOINE. BATAILLE D'ACTIUM.
La guerre civile a aussi ses annales; je voudrais ne pas être obligé d'ajouter qu'elle a eu, comme la guerre étrangère, ses gloires. César et Pompée firent assaut de manoeuvres habiles : l'évacuation de Brindes par Pompée est assurément un des mouvements les mieux combinés dont l'histoire fasse mention. Un port barré, une ville infidèle, un ennemi prêt à escalader les murs, tels sont les obstacles dont il fallait triompher. Pompée s'échappa cependant de la place investie avec vingt cohortes, sans même laisser à César le moyen de le suivre. La facilité avec laquelle les anciens transportaient le théâtre de leurs opérations d'un rivage à l'autre aurait lieu de nous surprendre si nous ne savions que, pour eux, l'instrument de transport était en même temps l'instrument de débarquement. Lorsque éclatèrent les premiers démêlés entre Octave et Antoine, les efforts d'Octavia, femme d'Antoine et soeur chérie d'Octave, réussirent un instant à rapprocher les deux triumvirs. Une entrevue eut lieu dans le golfe de Tarente : Antoine, toujours confiant, toujours chevaleresque, ne songeant qu'à dompter les Parthes, eut l'imprudence d'échanger, contre deux légions que son rival lui céda, cent galères et vingt brigantins. Il donnait ainsi au neveu de César ce qui lui manquait: une flotte de guerre. A dater de ce jour, son arrêt fut signé. Le monde a beau être vaste, il est trop étroit pour deux ambitieux. Octave, de retour à Rome, n'a plus d'autre pensée que de soulever le peuple contre Antoine. Il connaît la puissance de l'opinion publique et ne néglige rien pour la mettre de son côté. Idole des soldats, Antoine, au contraire, ne songe pas assez à ménager la fierté des Romains; l'affection de son armée lui suffit. On a souvent comparé de son vivant ce brillant lieutenant de César à Hercule : du demi-dieu victime de Déjanire, si l'histoire, telle que l'ont écrite les amis de Brutus et les flatteurs d'Auguste, ne nous abuse pas étrangement, Antoine aurait eu surtout les faiblesses. Il accourt à Ephèse avec Cléopâtre : huit cents vaisseaux, seize légions, 120 millions de francs, les deux complices semblent avoir tout rassemblé pour s'emparer à coup sûr de l'empire. La force, sans le moindre doute, est pour eux; mais la majesté romaine, que leur alliance offusque, prend parti pour Octave. D'Ephèse, Antoine et Cléopâtre se portent à Samos; les préparatifs de guerre de part et d'autre s'accélèrent. Des confins de l'Egypte au Palus-Méotide, l'Asie est en mouvement; l'Europe n'est pas moins active: les levées d'hommes et d'impôts par lesquelles Octave répond aux efforts de son adversaire ont failli un instant indisposer l'Italie; la levée faite et l'argent versé, comme l'a remarqué avec un profond bon sens le vieux Plutarque, tout redevient tranquille. La plus grande faute, dans les temps de crise, n'est pas de hasarder sa popularité; la faute sans remède consiste à manquer d'argent et de soldats. Antoine a fait preuve de résolution et d'activité; Octave montrera la ténacité qu'il tient de ses ancêtres unie à la dissimulation que lui ont départie les dieux. On a souvent dépeint ce caractère froid, qui ne donnait rien aux satisfactions vulgaires et dont tous les actes ne dénotent qu'un but: demeurer le maître. Le monde a trouvé enfin un grand politique; ce sont rarement les natures aimables qui le sauvent. La guerre est décrétée : Antoine et Cléopâtre ont tourné par mer le Péloponèse. Réduite à cinq cents navires de guerre, leur flotte est mouillée à l'entrée du golfe d'Ambracie, aujourd'hui le golfe d'Arta; la flotte d'Octave reste encore concentrée à Tarente et à Brindes. Elle ne compte que deux cent cinquante vaisseaux. Du poste qu'il occupe sur la limite de l'Acarnanie et de l'Épire, Antoine pourra aisément porter la guerre en Italie; seulement, il faut que son armée qui s'achemine péniblement par terre vers les lieux où il lui a donné rendez-vous l'ait rejoint tout entière. Les moyens de transport ne lui manqueront pas: la flotte de l'Asie, grossie du contingent formidable de l'Egypte, a rempli tout le golfe de sa masse imposante. On voit dans ses rangs des octères, des décères, mesurant du plat bord à la surface de la mer près de dix pieds de hauteur, chargées de tours, de balisles et de catapultes, équipées avec une magnificence que ne connurent jamais les escadres du premier des Ptolémées, ni celles que commandait Démétrius Poliorcète. Cette flotte n'a qu'un tort; elle est, plus qu'aucune autre, difficile à mettre en mouvement : Cléopâtre s'en apercevra quand elle essayera d'en faire traîner les débris jusque dans la mer Rouge, à travers l'isthme de Suez. Pour combler les vides de ses équipages, on a été obligé de recourir à la presse: voyageurs, muletiers, moissonneurs, tout ce que les sergents recruteurs sont parvenus à saisir est, en dépit des supplications et des murmures, dirigé en hâte sur les vaisseaux à court depuis trop longtemps de rameurs. La Grèce est épuisée : il faut cependant qu'elle subisse encore cette saignée nouvelle. Des hommes! des hommes! des hommes! Sans cesse il en arrive et il en manque toujours. Songez-y donc! La flotle d'Antoine, ne fùt-elle qu'une flotte de trirèmes, demanderait, pour être armée au complet, plus de cent mille hommes; il lui en faut le double, si elle est composée en majeure partie de quinquérèmes. Toute l'armée de terre y passerait: les seize légions de Canidius; les troupes de la Libye, de la haute Cilicie, de la Paphlagonie, de la Comagène, de la Thrace et de la Cappadoce qu'ont amenées leurs rois en personne; celles du Pont, de la Galatie, de la Lycaonie et de la Judée envoyées par Polémon, par Malchus, par Amyntas, par Hérode. Une flotle aussi exigeante ne laisse pas que d'être un gros embarras. On reproche à Antoine de n'avoir pas su profiter des mécontentements passagers de l'Italie, de s'être endormi dans les fêtes, d'avoir sacrifié le soin de son salut à ses plaisirs. Le malheureux! qu'on apprécie mal les difficultés de sa situation! Les renforts sur lesquels il se croyait en droit de compter se dissipent en route ou fondent en chemin; au lieu de ces renforts, c'est Octave avec ses liburnes qui arrive. Les liburnes, ce sont les trières de l'Illyrie; une marine de pirates que feront revivre au moyen âge les Uscoques. Aux corsaires de Sextus Pompée Octave n'a pu opposer avec succès que ces navires agiles qui franchissent avec plus de facilité que les trières d'Athènes l'isthme de Corinthe sur des rouleaux, l'isthme d'Ambracie sur des peaux de boeuf enduites de matières grasses: il en a formé le gros de sa flotte. Deux années de campagne les ont aguerris; un véritable homme de mer, Agrippa, les commande. Antoine avait mouillé sa flotte à l'entrée du golfe, sous le promontoire d'Actium. L'apparition soudaine de l'ennemi le prend en défaut; la plupart de ses galères sont encore dégarnies de soldats. Il paye résolument d'audace, fait prendre sur-le-champ les armes aux épibates et défourneler les rames. Pendant que sur les ponts étincelle le fer fourbi des piques, les avirons poussés en dehors donnent aux vaisseaux l'apparence d'une flotte qui n'attend que le signal de son chef pour appareiller. Le stratagème est habile et fait, suivant moi, grand honneur au sang-froid du général surpris. Octave, qui se préparait à l'allaque, reste intimidé; il recule devant un pareil déploiement de forces et se contente d'aller asseoir son camp en face du camp d'Antoine, sur la pointe opposée du goulet. C'est là que s'élèvera un jour la ville de la victoire, Nicopolis. Lorsqu'en 1855, les transports russes eurent évacué les établissements du Kamtchatka, ils trouvèrent sur les côtes de la Tartarie chinoise, dans la baie de Castries reconnue pour la première fois par La Pérouse, un refuge où ils avaient tout lieu de penser qu'aucun croiseur ennemi ne viendrait les troubler. Un capitaine anglais finit cependant par découvrir leurs traces, et des forces supérieures apparurent à l'entrée de la baie. Les Russes se sauvèrent alors, comme se sauva Antoine en l'année 31 avant Jésus-Christ, par leur bonne contenance. Ils surent donner à leurs navires de charge, incapables d'opposer à un assaut hardi une résistance sérieuse, l'apparence menaçante de vaisseaux de guerre. Les Anglais hésitèrent et voulurent se réserver le temps de rassembler des moyens d'attaque plus puissants; lorsqu'ils revinrent, les Russes avaient franchi les bancs d'un canal que jusqu'alors on avait cru un isthme et se reposaient de leurs justes alarmes dans le fleuve Amour. Semblables ruses réussissent à la guerre bien plus souvent qu'on ne pense: il faut applaudir à l'esprit ingénieux qui sait ainsi se sortir du péril; mais on aurait grand tort de juger avec une rigueur extrême la prudence qui s'est laissé prendre à une apparence trompeuse. Il est difficile d'apprécier exactement des forces qu'on ne peut approcher sans se mettre dans l'impossibilité de reculer, et la méprise anglaise ne mériterait guère d'être rapportée, si elle n'était la justification de l'amiral Linois abusé par un stratagème analogue dans les eaux de Poulo-Aor. Ganteaume, si sévère pour son camarade en cette occasion, eut-il la vue plus claire devant Minorque? Il était donc permis à Octave de s'abuser sur la situation réelle d'Antoine; dans le camp ennemi, les fidélités chancelantes ne s'y trompaient pas. Elles devinaient, avec cet instinct qui ne manque jamais à la trahison, que la cause pour laquelle les avaient armées un dévouement trop prompt et un zèle irréfléchi était, depuis l'arrivée d'Octave en Epire, une cause tout à fait désespérée. Domitius, le premier, monte sur une barque légère, se glisse hors du port et va offrir ses services à César. Antoine ne s'indigne pas, il ne maudit pas la fortune : il renvoie au transfuge ses équipages et ses serviteurs que Domitius n'a pas pris le temps d'emmener. Que de douceur envers le sort contraire ! Que d'indulgence pour un si cruel abandon ! L'histoire ne se laissera-t-elle pas un peu attendrir en faveur de ce géant naïf qui, après avoir été un lieutenant fidèle, rencontre chez ses lieutenants une si grande hâte à déserter ses drapeaux? Le branle est donné: deux rois à leur tour passent à l'ennemi. Le temps presse, il faut se résoudre à prendre un parti, avant que l'armée se dissolve. La Grèce n'est plus tenable; on l'a trop pressurée. Gagner la Thrace ou la Macédoine, ainsi que le conseille Canidius, pour y combattre avec les secours que promet le roi des Gètes, implique d'abord le sacrifice de la flotte. Quand on aura fait l'abandon des vaisseaux à demi désarmés, trouverat- on le roi des Gètes exact au rendez-vous? Ce barbare a pensé sans doute s'engager envers le plus fort; peut-on espérer qu'il se trouvera lié envers l'infortune? C'est donc au métier de fugitif que Canidius ose convier le plus brillant soldat de Rome! Cléopâtre a raison quand elle conjure Antoine de reporter le théâlre de la guerre en Asie. Les vétérans se soucient médiocrement, il est vrai, de s'en fier de leur salut à la mer; s'il faut mourir, ils voudraient au moins mourir debout, les armes à la main, mourir sur un terrain qui ne trahira pas leur courage. Ce n'est qu'avec la plus vive répugnance qu'ils s'embarquent. Antoine les rassure: la physionomie du héros a gardé le vaillant sourire qui soutenait l'armée assaillie sur les bords du lac Thospitis par les Parfhes; le danger n'était-il pas plus grand encore quand on dut se frayer un chemin à travers les montagnes de l'Arménie? S'il garde quelque inquiétude, Antoine a depuis longtemps appris à dominer les secrètes angoisses de son coeur. Sa résolution est irrévocable : il forcera le passage, dût-il laisser une partie de sa flotte sur le champ de bataille. Pour premier sacrifice, il fait brûler tous les vaisseaux égyptiens, à l'exception de soixante qu'il juge en état, par leur construction et par leur armement, de le suivre. Il possédait, quand il vint mouiller sur la rade d'Actium, cinq cents vaisseaux de guerre; il lui en restera trois cent soixante, tous galères à trois rangs au moins de rames : plusieurs en comptent de cinq jusqu'à dix. Sur ces galères, Antoine fait monter vingt mille fantassins et deux mille hommes de trait. Sa résolution de pousser en avant à tout prix, à tout risque, est si bien arrêtée qu'il refuse de laisser à terre les grandes voiles qui vont charger inutilement les antennes, embarrasser les ponts sans profit. Si Antoine ne se proposait que de combattre, pourquoi résisterait-il obstinément sur ce point aux instances réitérées des pilotes? Ses navires sont plus lourds que les vaisseaux d'Octave; il faut de graves motifs pour négliger de les alléger. Mais prétend-on passer d'Acarnanie en Égypte avec le seul secours des rames? C'est en Égypte que la flotte va se rendre; ses voiles lui sont indispensables pour accomplir une si longue traversée. La saison cependant s'avance : la mer, si l'on n'y prend garde, sera bientôt fermée; déjà, pendant quelques jours, de grandes brises ont soufflé du large sans interruption. Le 2 septembre, le vent tombe et la mer s'aplanit. La position choisie par Antoine pour défendre l'entrée du golfe d'Ambracie était excellente. On n'arrive en effet au promontoire d'Actium que par un goulet qui n'a guère plus d'un demi-mille de large, et encore ce passage, que nous désignons aujourd'hui sous le nom de détroit di Prévésa, est-il rétréci dans son étendue par de nombreux hauts-fonds. C'était un avantage, quant on voulait rester sur la défensive; le chenal encombré et sinueux devient au contraire un fâcheux obstacle, le jour où l'on s'apprête à déboucher du golfe pour franchir de vive force les lignes ennemies. Dans une passe dont la partie navigable n'excède pas en largcur un kilomètre, il est à peu près impossible de ranger plus de vingt-cinq ou trente galères de front. Une seule galère, les rames étendues, n'occupera-t-elle pas un espace de vingt-six mètres, si l'on veut bien nous concéder que, sous ce rapport, les vaisseaux des anciens n'ont pas dû différer très sensiblement des bâtiments à rames du quinzième et du seizième siècle? Trois cent cinquante navires ne sortiront pas à la fois du golfe d'Ambracie, à moins qu'ils se résignent à se ranger sur douze ou quinze files de profondeur. La phalange sera forte, sera-t-elle manoeuvrante ? Antoine n'a que trop prévu ce grave inconvénient. « Méfiezvous surtout, dit- il au pilote, de la bouche étroite du port. « Il espérait qu'en le voyant lever l'ancre, Octave se déciderait à venir à sa rencontre : il combattrait alors appuyé au rivage, et les deux flottes auraient également à souffrir des hauts-fonds. Voilà pourquoi, après l'appareillage, il s'avance lentement vers la haute mer, si lentement, qu'Octave douta un instant que la flotte ennemie eût en réalité levé l'ancre. Le neveu de César a quitté à son tour le mouillage de la côte d'Épire; il se gardera bien d'aller se placer sur un terrain où il perdrait la faculté de manoeuvrer. N'est-ce pas à l'agilité de ses liburnes qu'il se confie pour racheter l'infériorité de leurs masses? Il attend Antoine à l'issue de la passe, avec tous ses vaisseaux rangés en bataille, les maintenant à une distance de mille cinq cents mètres environ de la plage. C'est presque toujours à midi que s'engagent les grandes batailles navales. C'est à midi que les flottes se sont jointes dans les journées de Lépante et de Trafalgar; à midi que nous avons attaqué Sébastopol et Kinburn. La matinée se trouve fatalement absorbée par le temps passé à se reconnaître mutuellement, à se rapprocher, à se disposer au combat. Le 2 septembre de l'année 31 avant notre ère, à midi précis, les vaisseaux d'Antoine se trouvèrent massés à l'entrée du golfe et prêts à s'élancer sur la flotte ennemie. Les deux chefs font, en ce moment, accoster le long du bord leurs chaloupes. Jamais général prudent n'a donné le signal de l'attaque sans avoir, quand les circonstances le permettent, passé une dernière fois la revue de ses troupes. Don Juan d'Autriche ne manquera pas plus à ce devoir qu'Antoine et Octave. Les deux généraux romains se sont donc embarqués dans les légers esquifs qu'ils traînent à la remorque. Il parcourent rapidement la ligne, insistant sur leur derniers ordres, renouvelant leurs exhortations montrant à tous un front qu'aucun nuage n'assombrit et portant l'assurance de la victoire dans leur regard. Pendqnt ce temps, l'ordonnance générale se rectifie, les bâtiments tombés en travers se redressent, les vides se comblent et les divisions trop espacées se serrent l'une contre l'autre. La brise du large vient de s'élever; un léger clapoti blanchit la crête des vagues. Tout est prêt: Antoine et Octave sont remonté: à bord de leurs galères prétoriennes. Les troupes laissées à terre couvrent, de chaque côté du goulet, les deux promontoires : Canidius, à droite, a rangé sur la côte de l'Acarnanie ce qui lui reste des légions asiatiques; Taurus occupe, à gauche, avec les soldats venus de Tarente, la pointe que projette en avant le rivage de l'Épire. La flotte d'Antoine, d'un élan vigoureux, s'ébranle la première. Antoine est en tête avec Publicola; Coelius a été placé à l'arrière-garde; Marcus Octavius et Marcus Justeius conduisent le centre. La ligne d'Octave serait trop facilement percée si elle essayait d'opposer son front mince à cette avalanche. Ses vaisseaux, ne l'oublions pas, sont des vaisseaux de construction légère: ce n'est pas seulement proue contre proue qu'ils ne peuvent lutter; frapperaient-ils par le flanc les galères phéniciennes que leur éperon ne réussirait probablement pas à les percer. Les rostres romains ne se sont jamais attaqués qu'à des carènes fragiles; on les a vus reculer devant la grossière architecture des Vénètes. C'est précisément l'aile droite, commandée par Octave, que menace la masse imposante qui débouche en ce moment du golfe: cette aile se rejette, brusquement et par un mouvement d'ensemble, en arrière. L'arène, d'abord étroite, insensiblement s'élargit. Les vaisseaux d'Antoine ne gagnent cependant qu'avec peine et avec une lenteur infinie du terrain; ils ont à refouler une fraîche brise du nord, et les hautes tours dont leur pont est chargé offrent au vent une fâcheuse résistance. Octave n'en aurait pas moins tort de plier trop longtemps devant cette escadre empêchée; il lui laisserait ainsi la faculté de se dégager peu à peu des entraves du détroit et de se développer sur un front tellement étendu qu'il deviendrait impossible de la déborder. Déjà Publicola tient avec l'avant-garde Agrippa en échec : Agrippa faisait mine de vouloir l'entourer; pour déjouer ce mouvement, Publicola n'a pas craint de se séparer du centre. Octave voit sur ce point la mêlée engagée, il reporte, sans plus hésiter, l'aile droite en avant. On est trop porté à traiter dédaigneusement les armes de jet des anciens : nous savons le grand rôle qu'ont joué dans les combats de mer du moyen âge les arcs anglais et les arbalètes catalanes; la bataille d'Actium ne fut pas un combat de choc; ce fut, comme la bataille de l'Ecluse et comme la bataille de Salerne, un combat d'artillerie; les archers et les autres gens de trait emportèrent l'avantage. Les liburnes d'Octave profitèrent habilement de leur marche supérieure, de leur facilité de manoeuvre pour tenir les galères ennemies à distance. Elles se réunissaient en groupes de trois ou quatre navires, et s'attaquant ainsi à une seule quinquérème, l'accablaient de flèches, de pierres et de javelots. « L'action, nous dit Plutarque, demeurait indécise, quand Cléopâtre et Antoine prirent la fuite. » Je n'ai que l'autorité de Plutarque lui-même pour contester un fait qui a depuis longtemps acquis droit de cité dans l'histoire; je n'en repousse pas moins énergiquement l'assertion qui a tant contribué à flétrir la mémoire du lieutenant de César. Qu'on ne m'accuse pas de vouloir faire ici du roman, de me complaire à des réhabilitations impossibles. Je crois absolument ce que j'écris : si je me suis donné tant de peine pour fouiller tous ces textes qui m'étaient restés jusque là étrangers, c'est que ma veine se tarit à l'instant quand elle cesse de s'alimenter aux sources de la certitude. Je puis, à coup sûr, m'égarer dans ces sinueux dédales où je m'obstine à poursuivre une conviction qu'aucun scrupule n'obscurcisse, mais je n'affirmerai pas que je suis convaincu quand je ne rapporterai de mes patientes recherches qu'un doute découragé. Or, après avoir étudié soigneusement toutes les phases de la bataille d'Aclium et les incidents qui l'ont précédée, je n'hésite plus: j'affirme, avec la conscience de posséder enfin la vérité, qu'Antoine n'a pas fui et que toute sa conduite, dans cette grande occasion, ne fut que l'effet d'un dessein longuement prémédité. Marchons dans cet examen pas à pas, car chaque mouvement aura son importance : je vais m'efforcer d'élucider les faits, la carte hydrographique publiée en 1865 par le capitaine Maxwel et le récit de Plutarque sous les yeux. Le vent du nord est le vent habituel dans ces parages. Dès qu'une flotte a vidé le détroit de Prévésa, elle n'a qu'à céder au vent; le vent l'emportera rapidement au large de Leucade, au large de Céphalonie, vers les côtes du Péloponèse. Le centre d'Antoine était vivement pressé par Arrontius; Antoine en personne combattait contre Octave. Les soixante vaisseaux de Cléopâtre, placés à l'arrière- garde, sortaient les derniers du golfe; nul ennemi, en ce moment, ne leur fermait la route : toute la flotte d'Octave était occupée. A peine ces vaisseaux ont-ils doublé la pointe extrême de l'Acarnanie qu'on les voit déployer leurs voiles et passer comme un nuage à travers les combattants. Était-ce là une fuite? n'y reconnaissons-nous pas plutôt l'exécution du plan arrêté, après mûre délibération, en conseil? Je n'ai certainement que des présomptions à opposer sur ce point à l'opinion admise depuis des siècles; je n'insisterai donc pas. Cléopâtre s'est enfuie, je le veux bien, quoique l'accusation me semble souverainement injuste, mais Antoine! Si l'âme d'un amoureux a jamais, selon l'expression du vieux Caton, "abandonné sa demeure habituelle pour aller résider dans un corps étranger ", c'est, on n'en peut douter, l'âme de Nelson. Croit-on que Nelson eût un instant songé à déserter le champ de bataille de Trafalgar, pour courir après lady Hamilton? Antoine cependant a quitté sa galère prétorienne et est monté à bord d'une quinquérème : il vole à la suite de celle qui le perd; il fuit, abandonnant les soldats dont il est l'idole et qui meurent pour lui! Je le demande aux juges les plus prévenus : est-ce vraisemblable? est-ce possible? Il importait peut-être à la paix du monde qu'Antoine fût calomnié. Écrasez tant qu'il vous plaira, pour que la patrie épuisée respire, tous les souvenirs qui vous gênent, mais laissez au moins à la postérité le droit de douter. Eh bien! moi, je doute et je doute très fort de la lâcheté d'Antoine. Les vaisseaux ronds en grand nombre, dit Plutarque, suivent Antoine; des galères à leur tour le rejoignent. Selon mon sentiment, ce sont là les navires qui ont obéi aux ordres donnés avant la bataille; les autres ne l'ont pas voulu ou ne l'ont pas pu. "Traversez la ligne ennemie, si la ligne ennemie veut vous barrer la route!" le premier consul demandait-il autre chose à Ganteaume quand il l'envoyait porter des renforts et des munitions à l'armée d'Egypte? N'est-ce donc pas la manoeuvre qu'exécuta Tegethoff à Lissa? Pourquoi voudrait-on qu'Antoine, bloqué en quelque sorte dans le golfe d'Ambracie, ne l'eût pas tentée à la journée d'Actium? S'il eût réussi, ne déconcertait-il pas tous les plans d'Octave? Et quel meilleur parti croit-on qu'il pût tirer d'une flotte considérable, mais à court de rameurs, dont le seul espoir devait être de s'ouvrir un chemin à la voile? « Tous les grands événements de ce globe, remarque avec raison Voltaire, sont comme ce globe même, dont une moitié est exposée au grand jour et l'autre dans l'obscurité. Dès qu'un empereur romain a été assassiné par les gardes prétoriennes, les corbeaux de la littérature fondent sur le cadavre de sa réputation. L'intérêt du genre humain est que tant d'horreurs aient été exagérées, elles font trop de honte à la nature. » Plutarque n'est pas méchant, mais son bisaïeul Nicarque lui a conté de singulières histoires; puis sont venues, transmises de bouche en bouche, les dépositions d'affranchis. Le beau témoignage, en vérité! Savez-vous qui j'en aurais voulu croire à la place de Plutarque, si toutes les voix contraires à la version que propageaient les partisans d'Auguste n'eussent été, dans un dessein trop facile à comprendre, soigneusement étouffées? J'en aurais cru Lucilius. A la bataille de Philippes, Lucilius se donna pour Brutus et laissa ainsi au grand conspirateur vaincu le temps de s'échapper. Ce même Lucilius fut sauvé d'un trépas imminent par Antoine : jusqu'au dernier moment, à partir de ce jour, il suivit la fortune du lieutenant de César et lui resta fidèle. On n'inspire pas à des Lucilius un aussi constant dévouement quand on est le misérable que n'a pas craint de nous montrer Plutarque. La bataille d'Actium dura quatre heures : il y périt, au rapport de Plutarque, environ cinq mille hommes. C'était une faible perte pour de si nombreuses flottes et pour une journée de cette importance. D'autres calculs ont porté, il est vrai, la durée du combat à quatorze heures, le faisant commencer à cinq heures du matin et finir à sept heures du soir : une action navale est rarement aussi prolongée. Orose a également évalué les pertes de la seule flotte d'Antoine à douze mille morts et six mille blessés: Orose n'est pas d'accord avec les souvenirs d'Auguste lui-même. Ce qui demeure certain, c'est que trois cents vaisseaux, le 2 septembre de l'année 31 avant Jésus-Christ, se rendirent à Octave; sept jours après, les soldats de Canidius faisaient également leur soumission au vainqueur. Pendant que la Grèce, délivrée du poids qui l'oppressait, acclamait avec enthousiasme Octave, Antoine allait débarquer en Libye; Cléopâtre continuait sa route vers l'Egypte. Le signal des défections par malheur était donné; les rois, les lieutenants, les soldats, ceux même dont un reste d'affection pour leur intrépide général avait paru un instant ranimer le courage, tous, l'un après l'autre, se détachaient d'une cause qui semblait irrévocablement perdue. Octave était arrivé en Syrie; Antoine alla rejoindre en Egypte le seul allié qui, dans sa détresse suprême, ne l'abandonnât pas. « Voici, dit-il uu jour, après une escarmouche heureuse, le plus brave de mes cavaliers; c'est lui qui, dans cette affaire, s'est le mieux battu. » Cléopâtre félicite le vaillant champion; elle fait apporter sur-le-champ un casque et une cuirasse d'or; de ses propres mains, elle en arme la bravoure fidèle. Le soldat se retire, emportant le prix de son courage: dans la nuit même, il se rend au camp de César. Près d'une année s'écoule dans cette lente agonie; enfin le dernier espoir et la dernière fidélité s'évanouissent ; pour échapper à la servitude, Antoine n'a plus que le moyen qui a sauvé Caton, que la ressource invoquée après la défaite par Brutus. Il se frappe de son épée; Cléopâtre ne le fait pas trop longtemps attendre dans la tombe. Voilà certes deux grandes victimes des troubles civils; la pensée du devoir ne semble jamais les avoir beaucou p inquiétés; mais où était le devoir à cette heure? Quelle âme, au milieu du désordre affreux des idées, en avait conservé la juste notion? Les dieux étaient partis, et un peuple qui n'a plus de dieux n'a plus de loi morale. Heureux les coeurs qui, lorsque le ciel est vide, trouvent encore dans leur bonté native l'essence de quelques vertus, qui restent généreux, compatissants, fidèles, parce que tel est leur instinct! Antoine n'est certes pas un exemple à offrir; il a pourtant reçu de la nature certains dons qui impriment à ses erreurs et à ses infortunes je ne sais quoi de touchant. Dans un siècle où la duplicité et la férocité basse se donnaient si largement carrière, je regrette de voir les sévérités de l'histoire s'acharner sur ce bon sauvage. Antoine ma rappelle les héros de l'Arioste, Renaud de Montauban et Roland le Furieux. Quant à Cléopâtre, si elle a donné à son amant un philtre, si elle a causé la ruine du malheureux Antoine en le provoquant à offenser la majesté romaine, elle est du moins restée jusqu'à sa dernière heure digne de ses aïeux grecs, car elle a gardé pour elle le poison.
CE QUE PEUT ET CE QUE DOIT FAIRE DE NOS JOURS UNE MARINE MAÎTRESSE DE LA MER.
Pas plus que Salamine, Actium n'a le droit d'élever
un trophée " à la gloire des masses". Je
verrais bien plutôt, pour ma part, dans les péripéties
de ce grand combat, un nouvel encouragement
à rompre avec les tendances de notre architecture
babylonienne. La marine de l'avenir s'ignore encore
elle-même; l'intérêt de la France est de lui révéler
le plus tôt possible ses destinées et de la pousser
résolument dans la voie des faibles tirants d'eau, La
France, en effet, possède, sur la partie même de
son littoral qu'en croirait le plus déshéritée, d'excellents
et nombreux abris d'où nos flottes ne se
trouveraient pas exclues si la profondeur du chenal
qui y conduisait autrefois les vaisseaux de Guillaume
le Conquérant et ceux de Philippe le Bel n'avait
cessé d'être en rapport avec les dimensions exagérées de nos constructions navales. La France est,
en outre, le seul pays au monde qui puisse nourrir
l'espoir de mettre en communication par un réseau
fluvial la Méditerranée, l'Océan et la Manche. Ce
réseau ne me paraît pas destiné à recevoir jamais
des navires de guerre pareils à ceux que nous construisons
en ce moment; il sera très-probablement
accessible dès demain à des bâtiments dont le tirant
d'eau en pleine charge n'excéderait pas deux mètres :
semblables bâtiments peuvent aller jusqu'en Amérique.
Avec la vapeur, les conditions de navigabilité
ne sont pas les mêmes qu'avec le moteur capricieux
dont nous nous sommes contentés si longtemps :
nous n'avons plus besoin d'opposer de grands
plans de dérive aux forces obliques qui jetaient le
navire à voiles sous le vent de sa route; nous ne
louvoyons plus, nous ne nous traînons plus sous
cette allure exigeante et pénible qu'on appelait le
plus près; de quelque point que vienne à souffler
la brise, nous marchons droit devant nous; les
résistances latérales de la carène nous sont devenues
inutiles; elles ne feraient que ralentir notre vitesse
par le frottement. L'ampleur inusitée des carènes
actuelles n'a donc qu'une excuse: elle est motivée
par la nécessité de donner à nos vaisseaux de guerre un déplacement qui leur permette de porter des
cuirasses dont le poids s'aggrave tous les jours.
Que la cuirasse disparaisse, et le problème changera
soudain de face.
Le monde maritime est aujourd' hui en proie à
une anxiété qu'il n'avait jamais connue jusqu'à
présent; mille doutes assiègent les esprils les plus
éclairés et les caractères les plus résolus. En Italie,
on croit sage de consacrer toutes les ressources
dont dispose le budget naval à la construction de
quelques navires gigantesques qui ne puissent rencontrer
leurs égaux sur les mers: le Duilio de
onze mille six cents tonneaux a engendré l'ltalia de
quatorze mille trois cent quatre vingt-dix. Emue
non sans raison, l'Angleterre s'est hâtée de mettre
en chantier cinq vaisseaux cuirassés de dix mille
six
cents à onze mille cinq cents tonneaux : le Nortlntrnherland, Agincourt, le Minotaur, le Dreadnought, l'Inflexible. La France pouvait-elle se
défendre d'obéir, elle aussi, à cette marche progressive? Les frégates de cinq mille huit cent dix-neuf tonneaux, telles que la Provence citée dans son
remarquable travail par M. le vice-amiral italien
Saint-Bon, font place à l'Océan d'abord de sept
mille sept cent quarante-neuf tonneaux, au Friedland ensuite de huit mille neuf cent seize, à la
Dévastation de neuf mille six cent trente-neuf, au
Duperré de dix mille six cent quatre-vingt-six, au
Formidable de onze mille quatre cent quarante et
un. Puis tout à coup un mouvement inattendu
d'opinion se produit : provoqué par un de nos
officiers les plus distingués et les plus regrettés, par
le vaillant, par le savant amiral Touchard, ce mouvement
se propage et, de proche en proche, finit
par gagner l'Angleterre. Le major Arthur Parnell,
du corps du génie anglais, vient lui prêter l'appui
de son incontestable compétence et propose de constituer
la marine britannique sur un plan entièrement
nouveau. On aura trois flottes : la flotte de siège
composée de navires cuirassés d'un faible tirant
d'eau; la flotte de combat, sans voiles et sans cuirasse,
ne comprenant que des navires d'un déplacement
de quatre mille tonneaux au plus, mais
fortement armée et portant un très-grand approvisionnement
de charbon; la flotte de croisière
enfin destinée à couvrir les mers et à en conserver
la jouissance exclusive au commerce anglais ou au
commerce des amis de l'Angleterre. Dans cette
troisième flotte on fera entrer les vieux cuirassés
qui peuvent marcher à la voile comme à la vapeur, et on leur adjoindra les frégates, les corvettes à
voiles, les bâtiments même plus légers qui ont gardé
quelque force militaire. La défense des côtes fort
exposées à de soudaines attaques, car les côtes
de la Grande-Bretagne présentent un développement
de deux mille sept cent vingt milles, sera
confiée à une nombreuse flottille de canonnières,
d'avisos et de hateaux-torpilles.
Quel parti va-t-on prendre? On versera bien des
flots d'encre encore, en attendant peut-être les flots
de sang, puisse le ciel nous les épargner!
avant d'avoir arrêté le programme définitif de cette
marine, qui n'est, suivant une expression de la
philosophie allemande, qu'un décevant et perpétuel
devenir. Hésitons! tâtonnons! je n'y mets pas obstacle,
car ma propre pensée ne serait fixée que le
jour où l'on m'apprendrait d'une façon certaine à
quel but invariable tend notre politique. Hésitons!
tâtonnons! je le répéterai volontiers, mais défendons nous,
de grâce, des ruineuses et inefficaces retouches
où s'est trop souvent englouti le plus clair
de notre argent. Ce sont ces transformations incessantes,
oserai-je risquer le mot? ces ressemelages
qui déroutent, compromettent et finiraient
par exaspérer la science de nos ingénieurs. Est-il juste de venir, au moindre propos, placer leur
oeuvre, cette oeuvre qui fait leur gloire, dans des
conditions tout autres que celles qu'ils avaient prévues?
En 1858, apparaît la Bretagne. C'était, sans
contredit, un admirable navire. Il prend fantaisie à
nos officiers d'échanger les canons de 30 de la
batterie basse pour des pièces de 36 et des obusiers :
la surcharge est considérable; la Bretagne enfonce
d'autant dans l'eau, et on se plaint qu'elle n'ait pas
assez de hauteur de batterie! Le Magenta et le
Solferino avaient-ils leurs pareils au monde, quand
ils sortirent du port avec leurs cinquante pièces de
0m16? Ne risqua-t-on pas de les gâter, le jour où
l'on voulut charger leurs ponts, incapables de
porter semblable fardeau, des bouches à feu tout
récemment fondues de 0m,24? Les qualités nautiques
de ces vaillants vaisseaux étaient si remarquables
qu'ils sortirent victorieux de la cruelle
épreuve. Il fallut cependant, pour étayer les ponts
qui gémissaient, enterrer dans la cale une forêt
d'épontilles. La science marche : suivez-la, mais
d'une façon franche et non pas en quelque sorte
détournée. Les vieux types peuvent avoir en plus
d'une circonstance, pour certaines expéditions
spéciales, leur utilité; tenez-les donc, tels qu'ils sont venus au monde, en réserve, et, pendant ce
temps, prenez soin que les types nouveaux ne soient
pas déjà hors de mode, quand la mer les recevra.
Ceux-là, faites-les au moins descendre, jeunes
encore, des chantiers ! Vous le pouvez, si vous consentez
à vous interdire de distraire jamais, pour
les appliquer à des travaux de transformation, les
ouvriers promis aux constructions neuves.
Il n'entre certes pas dans ma pensée de conseiller
dès à présent cette mesure extrême du décuirassement
qui a ses partisans habiles et convaincus,
qui melaisserait cependant fort inquiet si je la voyais,
au point où en sont les choses, brusquement
adoplée. Il n'existe point, pour le moment, de
véritable flotte de guerre sans cuirasse, et la preuve
en est dans le soin judicieux que nous prenons
toujours d'assurer à nos stations les plus lointaines
l'appui de quelques bâtiments cuirassés. On ne
peut toutefois méconnaître que la science nous
ouvre, à chaque instant, des horizons nouveaux.
Si nous demeurons attentifs à ses découvertes, il
n'est pas impossible que, dans quelques années, les
moyens d'attaque aient subi des modifications assez
radicales pour que l'hoplite, se sentant visé désormais
au talon, juge superflu de charger son bras du bouclier. Toute invention qui menace le canon
de déchéance doit compter d'avance sur nos sympathies,
car c'est le canon, avec ses portées prodigieuses,
avec ses pénétrations incroyables, avec la
précision jusqu'ici inconnue de son tir, qui nous
impose les remparts de fer derrière lesquels matelots
et machines se réfugient. Suspendre aux flancs du
vaisseau de combat des enclumes capables de résister
à d'aussi vigoureux coups de marteau, ou enfermer
dans la cale du navire désarmé une force latente
qui lui prête, le cas échéant, des ailes pour la
retraite, voilà l'alternative à laquelle nous ont acculés
les récents progrès de l'artillerie. Armure ou chaudières,
il n'y a que des léviathans dont le déplacement
s'accommode de cet encombrement ou de cette
surcharge. Nos vaisseaux de combat sont grands,
nos croiseurs deviendront énormes. Connaissez-vous
pourtant d'autre moyen d'occuper la haute
mer ou d'inquiéter par des pointes hardies ceux
qui voudraient en conserver l'empire? Acceptez-vous
la responsabilité de conduire au combat une
flotte sans cuirasse contre une flotte cuirassée?
Vous figurez-vous la guerre de course possible avec
des navires dépourvus d'un vaste approvisionnement
de charbon qui les dispense de recourir trop souvent à la bienveillance douteuse des ports
neutres? Si telle est votre audace, je l'admirerai
peut-être, je ne l'imiterai pas. La haute mer sera
toujours, suivant moi, le domaine des vaisseaux
qui pourront braver le canon, soit par la résistance
de leurs murailles, soit par la rapidité de leurs
allures : elle appartient aujourd'hui sans conteste
aux gros bâtiments. Mais les gros bâtiments ont de
grands tirants d'eau; l'approche du littoral, surtout
d'un littoral baigné par des eaux basses, les condamne,
dès les premiers pas, à une marche circonspecte.
Au fur et à mesure que le terrain devient
plus scabreux, la paralysie dont les membres du
géant sont atteints fait de rapides progrès; on s'en
aperçoit à l'incertitude croissante de ses mouvements;
l'occasion ne saurait manquer de le harceler
avec avantage. Les bateaux-torpilles n'ont
aujourd'hui qu'un rayon d'action excessivement
borné: ils n'ont pu obtenir la vitesse qui leur est
nécessaire qu'à ce prix. Les chaloupes, si nous les
réduisons à servir d'affût aux canons monstrueux
que nous leur confierons, auront bien moins encore
la faculté de s'éloigner du rivage. Néanmoins, ces
chaloupes canonnières et ces bateaux-torpilles préparent
déjà plus d'une nuit sans sommeil aux capitaines qui, pour ménager un combustible difficile
à transborder, laisseront devant le port bloqué
tomber l'ancre. La flottille aurait donc son utilité,
alors même que la puissance prépondérante de
l'ennemi interdirait tout espoir d'offensive à la flotte:
son rôle s'agrandit, si la prépondérance se déplace.
J'ai souvent insisté sur la facilité avec laquelle
les anciens opéraient des transports de troupes et
des débarquements : la mer était alors, de tous les
chemins, le plus fréquenté par les armées; pourquoi
nos bataillons l'ont-ils si complétement désertée
aujourd'hui? Pouvons-nous expliquer cet
abandon par l'encombrant bagage que le moindre
corps de troupes traîne de nos jours après lui, ou ne devons nous pas plutôt l'attribuer à l'autonomie
jalouse de ces deux classes de combattants qui ne
peuvent, en plus d'une occasion, s'entr'aider sérieusement
qu'à la condition de se confondre? Il ne
faudrait pas rester toujours trop rigoureusement à
cheval sur sa spécialité; il serait bon de pouvoir
au besoin quitter la rame pour le mousquet, et,
réciproquement, de savoir, en plus d'une circonstance,
déposer le mousquet pour saisir, d'une
main qui ne croirait pas déroger, l'aviron. Est-il
bien naturel, en effet, d'entasser des soldats dans une embarcation et de les conduire comme un
troupeau inerte à la plage? Le beau but que nous
offrons ainsi à la mitraille, et que nous prenons bien
le moyen de franchir avec rapidité la zone périlleuse
ou d'affronter, sans courir le risque d'être submergé,
l'agitation imprévue de la mer! Il serait
très facile, je crois, de rassembler le matériel et
le personnel propres à une opération de descente,
si, au lieu d'écarter systématiquement ce retour aux
anciennes pratiques, on lui faisait sa place dans
tous les plans de mobilisation. Qu'était-ce autrefois
que les épibates et les classiarii milites, sinon cette
armée coloniale dont la création s'impose à notre
nouvelle organisation militaire? Des marins fusiliers
et des fusiliers marins, pourquoi n'en trouverait-on
pas, puisque, sans remonter jusqu'à l'antiquité,
nous savons qu'avant d'aller à Ulm, nos grenadiers
de 1805 mettaient un joyeux amour-propre à montrer
qu'ils pourraient au besoin se passer du secours
des matelots pour se rendre de Boulogne à Douvres?
Et le matériel? Je l'ai dit bien souvent, le matériel,
il convient pour plus d'une raison de l'improviser.
S'est-on jamais demandé quel parti on pourrait
tirer de la batellerie fluviale, des barques,
mieux appropriées encore à nos besoins, que la pêche côtière et le cabotage ne se font guère scrupule
d'envoyer au-devant de la tempête? a-t-on
jamais songé à faire le recensement de toutes ces
embarcations à rames et à vapeur qui sillonnent nos
rivières ou qui sortent à chaque marée par essaims
de nos ports? Croyez-vous qu'il fut impossible
d'indiquer un type à ces constructions privées, de
leur imposer même certaines conditions qui permissent
de les convertir rapidement en bateaux
capables de recevoir des chevaux et des fantassins?
L'organisation de la flottille rencontrera, ne le mettez
pas en doute, plus d'un concours précieux et
inattendu dès qu'on en admettra seulement l'utilité
éventuelle : on le verrait bien, si le grand empereur
était venu au monde cinquante ou soixante ans
plus tard !
Fouillez, je ne vous demande pas autre chose,
la maison de Sylla; vous y trouverez encore« le javelot
qu'il avait à Orchomène et le bouclier qu'il
porta sur les murailles d'Athènes ». L'Empereur
faisait embarquer en deux heures, sur sa flottille
composée de mille deux cent cinquante bateaux
plats, trois cents péniches, et un millier de bateaux
de transport qui furent empruntés, les uns au cabotage,
les autres à la grande pêche, cent trente-deux mille hommes et huit mille chevaux rassemblés,
en vue de la grande invasion, dans les camps d'Etaples,
de Boulogne, de Vimereux et d'Ambleteuse :
en deux marées il eût pu les jeter sur les côtes
d'Angleterre. Si le fameux tunnel en voie d'exécution
existait sous la Manche, combien faudrait-il de wagons,
de convois et de temps pour accomplir semblable
besogne? Chaque fois qu'il s'agira d'un transport
considérable de troupes, les chemins de fer,
opérassent-ils du centre à la circonférence, auront
une infériorité notable vis-à-vis des flottilles.
On ne saurait trop distinguer les opérations de
guerre tentées à de faibles distances de ces expéditions
lointaines dans lesquelles la longueur de la
traversée et les risques de mer commandent forcément
l'emploi des navires de haut bord. La flottille
batave transporta, en 1805, d'Anvers à Boulogne,
sur ses trois cent cinquante bateaux plats, trente sept
mille hommes et mille cinq cents chevaux; les
bateaux-boeufs du capitaine Hugon débarquèrent
en 1830 sur la plage de Sidi-Ferruch la majeure
partie des chevaux de l'expédition d'Alger. Pour
descendre en Écosse avec douze cents hommes
d'armes, vingt mille sergents et quatre mille
chevaux, le roi de France Philippe de Valois ne comptait employer « que deux cents grosses nefs de
cent quatre-vingts tonneaux, soixante nefs pescheresses
de quarante-huit tonneaux et trente galées ».
Son illustre adversaire, Édouard III, parti d'Orwell
à l'embouchure de la Tamise, amena en un jour,
le 24 juin de l'année 1340, sur la côte de Flandre
et dans les eaux du port de l'Ecluse, quatre mille
hommes d'armes et douze mille archers, qu'il avait
embarqués sur cent vingt vaisseaux, « nefs, balengiers
et passengiers ", dit Froissart, sur « cent
vingt cocche » , prétend Villani.
La flottille, pour des traversées aussi courtes,
n'est pas tenue de tout emporter dans un seul
voyage. Il suffit que la mer soit libre pour que les
convois se répètent et se succèdent à très bref délai.
Dans un temps où l'on n'hésite pas à mettre les
chemins de fer dans son jeu, il semblerait étrange
qu'on reculât devant l'emploi des flottilles. Sans
doute il faut des flottes, j'ajouterai même, tant
que la torpille n'aura pas fait plus sérieusement
échec au canon et à la cuirasse, des flottes cuirassées.
Il faut des flottes pour occuper la mer;
mais pour tirer parti de cette occupation, il est
indispensable de posséder, en même temps que
la flotte, une flottille. Sans flottille, on régnera sur le vide, et, depuis que le continent se suffit à lui-même,
les blocus ont perdu l'efficacité qui nous les
rendit jadis si redoutables; ils ne pourraient plus
affamer que l'Angleterre. N'oublions pas d'ailleurs
qu'il est certaines mers et surtout certains mois,
les mois noirs, où les blocus ne sont pas
précisément faciles. On peut consulter à cet égard
les marins. Si l'on entend imposer pareille surveillance
à nos flottes, on fera bien de les faire nombreuses
et de leur préparer des relais, car je garantis
qu'elles auront quelque peine à se ravitailler et
à renouveler leur approvisionnement de charbon à
la mer.
Je comprends que l'Empereur ébranlé par toutes
les critiques de détail, par tous les doutes, par
tous les avis timides qui l'assiégeaient, ait reculé
devant sa première pensée et se soit résigné à ne
tenter le passage de la Manche que lorsqu'il aurait
pu occuper ce détroit avec les flottes réunies de
Villeneuve et de Ganteaume. Des deux plans successivement
éclos dans sa tête puissante je ne veux
retenir que le plan qui laissait le moins de prise au
hasard. Je rentre donc ici dans le programme banal
des descentes protégées par une flotte victorieuse
ou par l'ascendant moral qui écarte de l'arène les escadres ennemies. Je ne propose l'étude, la constitution
en principe de la flottille qu'après avoir
pris soin de mettre hors de question notre suprématie
navale; je demande en même temps que
cette flottille soit conçue de façon à pouvoir traverser
rapidement, en profitant de nos fleuves et
de nos canaux, le vaste territoire qui, par une faveur
inappréciable de la Providence, a des débouchés
sur trois mers.
La suprématie navale ! voilà, je le répète, toute
la base de mon raisonnement. Cette suprématie,
je la concède sans compétition et sans jalousie à la
puissance qui en a fait la loi même de son existence;
je ne reconnais pas à d'autres le droit d'y aspirer.
Contemplez les richesses qui s'étalent au soleil sur
tout votre littoral : voulez-vous les livrer aux chances
ou tout au moins à l'appréhension constante d'un
bombardement ? " Mais qui donc, direz-vous, oserait
aujourd'hui songer à bombarder une place inoffensive?
" Pouvez-vous me citer un acte international
qui le défende? Je ne connais qu'un fait à l'appui
de la conviction consolante que je voudrais bien
partager : c'est la fameuse dépêche expédiée par le
télégraphe de Paris à Balaldava aussitôt après la
prise de Kinburn : « Défense de l'Empereur d'agir contre Odessa. » Un seul exemple d' humeur chevaleresque
ne suffit pas pour me rassurer. On n'a pas
toujours, si je ne me trompe, épargné les villages
et les villes ouvertes; pourquoi me flatterais-je
qu'on respectera mieux les cités maritimes? « Les
pavillons neutres pourront, m'a t-on fait observer,
les couvrir. » Je crains que les pavillons neutres ne
se hâtent, au contraire, à l'approche ou à la première
sommation de l'ennemi, de les déserter.
En ai-je dit assez pour me faire comprendre, et
le moment n'est-il pas enfin venu de concentrer en
quelques lignes bien claires le programme que je
recommande? L'état présent comporte, je dirai
plus, exige deux espèces de flotte: la flotte de haute
mer et la flotte consacrée à la défense des côtes.
Il n'est pas impossible que, dans un avenir beaucoup
moins éloigné peut-être qu'on ne suppose,
ces deux flottes en arrivent à s'associer intimement,
sinon à se confondre: semblable combinaison serait
pour nous la plus importante des conquêtes. Je ne
ferai certes pas à nos magnifiques vaisseaux de combat
l'injure de les comparer aux galères d'Antoine;
ce n'est pas l'agilité qui leur manque. Ils ont la
vitesse, la giration rapide, et se meuvent, malgré
leur longueur, dans un cercle qu'on ne les eût jamais soupçonnés de pouvoir décrire; ce que je leur
reproche, c'est d'être venus dans un monde qui n'a
pas été créé pour eux: Dieu, quand il fit les mers
ne les destina pas à être labourées par « ces cyclades
flollanles » Penser que de Cherbourg à Brest on
ne peut plus trouver un port assez profond pour
recevoir et pour abriter nos vaisseaux! Saint-Malo,
la rivière de Pontrieux, les baies de Morlaix et de
l'Abervrach demeurent, par le manque d'étendue
plus encore que par le défaut de profondeur, fermés
à nos escadres. Ne livrons pas de batailles de
la Hougue, car Cherbourg, à lui seul, ne sauverait
probablement pas mieux qu'aux jours de Tourville
les débris de notre flotte. Il faut avoir le refuge
sous la main, on eût dit autrefois sous son écoute,
quand on se retire, dispersé et désemparé, d'une
action douteuse. D'un autre côté, sera-ce la flottille
qui se chargera de défendre nos colonies lointaines,
notre commerce au long cours, nos grandes pêches?
On ne va pas si loin quand on a les jambes courtes.
Il faut donc se garder des brusques sacrifices, des
renoncements soudains et irréfléchis, mais il faut de tout notre pouvoir poursuivre parallèlement deux
fins particulières convergeant au même but: accroître
le rayon d'action et d'efficacité militaire de la flottille, diminuer autant que possible le tirant
d'eau de la flotte. Toute invention qui nous achemine
vers ce résultat, toute nouveauté qui menace
les colosses et tend à émanciper les moucherons
est un progrès dont la marine française ne saurait
trop tôt s'emparer, car il n'en faut pas plus pour
doubler en quelques années ses forces et sa puissance.
LA MARINE DES EMPEREURS.
Les grands combats de mer, combats bien plus
sanglants autrefois qu'aujourd'hui, car ils étaient
la plupart du temps des combats corps à corps,
sont heureusement fort rares. A la journée d'Actium,
suivant l'énergique expression de Bossuet, " toute
la puissance de Rome s'est mise sur mer" :
d'Actium à Lépante, il s'écoulera un peu plus de
mille six cents ans. Combien de siècles sépareront
Trafalgar d'un nouveau débat pour la suprématie
maritime? Des éléments encore inconnus inlerviendront
alors, et il est difficile de prévoir quelles
nations, à cette époque, se disputeront le sceptre et
jetteront les dés; ce qui reste indubitable, ce sont les
surprises que la science réserve à nos petits-neveux :
la science est l'arme des nations qui perdent peu à
peu leur virilité; elle les protège pendant un certain
temps contre l'invasion des barbares, et nous ne saurions oublier les services que le feu grégeois
a rendus à l'empire byzantin. Ne nous arrêtons
donc pas dans nos recherches : perfectionnons nos
armes, faisons progresser notre stratégie, et prenant
pour devise le magnifique mot d'ordre de l'empereur
romain, travaillons! Laboremus.
Les successeurs d'Auguste auraient à peine eu
besoin de marine s'ils n'avaient voulu étendre leur
police vigilante jusque sur les mers. Il fallait, dans
le plan de la politique impériale, que la paix et le
bon ordre régnassent partout. Des stations navales
échelonnées sur l'immense littoral de l'empire prévenaient
à la fois les mouvements séditieux des
provinces encore mal soumises et les déprédations
des pirates. On entretenait une flotte à l'entrée du
golfe de Naples: c'était la grande flotte, la flotte
du cap Misène, celle que commanda sous Néron un
des meurtriers d'Agrippine, l'affranchi Anicetus,
et, quelques années plus tard, sous un règne moins
affreux, Pline l'Ancien. Une autre flotte demeurait
constamment rassemblée à Ravenne, sur l'Adriatique.
Rome avait des vaisseaux dans le port de
Fréjus; elle en avait également dans le port d'Aquilée,
à l'entrée du labyrinthe que formaient les
lagunes des Vénètes; une division de quarante navires de guerre, montés par trois mille hommes, navires
qui se portaient, suivant les circonstances, de Byzance
à Cyzique et de Cyzique à Trapézonte ou à
Dioscurias, répondait, avec la flottille du Danube,
de la sécurité du Pont-Euxin. La flotte de Syrie et
la flotte d'Egypte s'appuyaient au besoin sur une
station intermédiaire placée à Carpathos, dans les
eaux de la grande île de Rhodes; la flotte de Bretagne
comptait comme auxiliaires la flottille de la
Somme et la flottille du Rhin. Sur aucun point la mer
n'était sans surveillance : gardée de tous côtés par
une force permanente, elle appelait le commerce
rassuré contre la piraterie, à reprendre ses anciennes
allures et lui rouvrait, après une longue interruption,
le chemin à demi oublié de ses vieux entrepôts.
Arrien nous montrera la marine romaine au
cours de ses occupations habituelles : surveillant
les côtes, inspectant les postes militaires, ne rencontrant
sur mer d'ennemis nulle part et devant,
par conséquent, s'abandonner peu à peu à une
fatale langueur. Telle la connut Arrien, telle nous
la décrira deux cent soixante-six ans plus tard l'auteur
des Institutions militaires Flavius Vegetius
Renatus, autrement dit Végèce. Aucun progrès
sensible n'a marqué le long espace de temps qui s'est écoulé depuis la bataille d'Actium. « Il y avait
flottes montées chacune par une légion. » Ces
deux légions étaient le rebut de l'armée : quand
Didius Julianus voulut opposer aux légions de la
Pannonie les soldats de marine tirés de la flotte de
Misène, la populace de Rome ne put s'empêcher
d'insulter aux évolutions ridicules de ces troupes
novices qui prétendaient prendre place à côté des
prétoriens. Le préfet de la flotte de Misène
commandait les liburnes dans les mers de la Campanie,
celui de la flotte de Ravenne étendait ses
croisières jusqu'à l'extrémité de la mer Ionienne.
Chaque liburne avait son navarque, qui en était à
la fois, comme les triérarques d'Athènes, le patron
et l'armateur : au navarque incombait le soin
d'exercer journellement les pilotes, les rameurs et
les soldats.
Végèce énumère les diverses espèces de liburnes
dont on faisait usage: unirèmes, birèmes, trirèmes,
quadrirèmes, quinquérèmes : " Qu'on ne s'étonne
point, ajouie-t-il, de rencontrer tant de rangs de
rameurs à bord d'un vaisseau. N'a-t-on pas vu
combattre à la journée d'Actium de bien plus gros
navires, des sexirèmes et peut-être mieux encore? Les trirèmes seules sont dans la juste mesure."
Les grandes liburnes étaient d'ordinaire accompagnées
de brigantins ou de frégates, scaphae
exploratoriae. Ces navires légers, qui semblent
avoir été originaires des côtes de Bretagne, étaient
des galères non pontées à vingt rames de chaque
bord. Les Romains les nommèrent les bateaux peints.
On s'est efforcé, en effet, de dissimuler leur approche
quand ils vont à la découverte, en leur donnant
la couleur de la mer: coque, voiles, gréement,
casaques des matelots ou tuniques des soldats, on
a tout peint en vert.
Le succès dans les batailles navales dépend, suivant
Végèce, du zèle du navarque, de l'habileté des
pilotes, de la vigueur de la chiourme : " Ces batailles,
remarque-t-il avec raison, se livrent généralement
en temps calme; les liburnes n'y déploient
pas leurs voiles; ce sont les bras des rameurs qui
mettent la masse en mouvement; c'est l'impulsion
des rames qui enfonce le rostre dans le flanc du
navire ennemi, c'est encore elle qui soustrait la
liburne au choc dont on la menace. L'énergie de
la vogue et l'adresse du pilote à manoeuvrer le gouvernail
décident de la victoire."
L'émule de Turenne, le célèbre Montecuculli, et le chevalier de Folard faisaient, paraît-il, grand cas
du livre de Végèce; je n'accorderai pas, pour ma
part, la même estime au livre V de cet ouvrage,
livre dans lequel Végèce traite de la science navale.
Végèce me paraît confesser, dès le début du premier
chapitre, son incompétence sur un sujet qui
ne fut jamais, d'ailleurs, familier aux Romains :
« La mer, dit-il, est depuis si longtemps pacifiée
que je puis passer rapidement sur ce qui la concerne.
» La rapidité ne devrait pas exclure, en
pareille matière, la précision et l'exactitude. Végèce
nous apprend cependant qu'on se sert dans les
combats de mer de toutes les sortes d'armes dont
on fait usage sur terre; « on y emploie même,
ajoute-t-il, les machines qui garnissent, pour la
défense des places, les murailles et les tours» Les
soldats sont aussi munis d'armes défensives; ils
portent généralement l'armure complète, ou tout au
moins la demi-cuirasse, avec le casque et les jambières.
Leurs boucliers doivent être assez solides
pour résister aux volées de pierres dont l'équipage
sera très probablement assailli, assez larges pour
préserver ceux qui les portent de l'atteinte des
faux et des harpons. Le combat débute généralement
par une grêle de flèches, de cailloux, de balles de plomb, que font pleuvoir sur le vaisseau ennemi
tous les engins de guerre connus: frondes,
fustibales, onagres, balistes, scorpions. L'abordage
n'en est pas moins, la plupart dn temps, le seul
moyen d'en finir. Le capitaine qui ne veut s'en fier
qu'à son courage accroche hardiment sa liburne au
vaisseau de son adversaire, jette un pont d'un navire
à l'autre et passe avec son équipage à bord du bâtiment
qu'il est décidé à réduire. On combat alors
corps à corps, le bouclier au bras et l'épée au poing.
La mêlée s'engage et se prolonge: des poutres ferrées
des deux bouts, pendant du haut du mât, à la
façon d'une longue antenne, sont mises en branle
à l'aide de cordages fixés à l'une des exlrémités.
Ces béliers marins abattent et renversent tout ce qui
se rencontre sur leur passage: hommes, murailles
ou tours. Des faux au fer tranchant taillent en
même temps, de droite et de gauche, le gréement;
des soldats intrépides vont, dans de petits canots,
couper les saisines du gouvernail. Si l'on ne réussit
point à forcer l'ennemi l'épée à la main, on veut
tout au moins le mettre hors d'état de nuire en
l'immobilisant. Les grandes liburnes ne sont pas
faciles à enlever: elles ont de hauts pavois et des
tours d'où leurs soldats peuvent dominer l'ennemi et lui tuer beaucoup de monde. Aussi, n'osant ni
les joindre, ni les approcher, essaye-t-on souvent
de les incendier de loin. Après avoir entouré d'étoupe
le bois des flèches, on trempe ces traits,
suivis d'une longue queue flottante, dans un mélange
d'huile, de soufre et de bitume; puis, à l'aide
des balistes, on les lance tout en feu sur la liburne
qui a défié l'éperon et l'abordage. Le fer s'enfonce ;
profondément dans les planches enduites de poix,
de résine ou de cire. Ce n'est pas miracle si l'étoupe
enflammée y propage aisément l'incendie.
Voilà bien des engins en action; nos combats
modernes seront à peine plus compliqués. L'éperon
continuera de jouer son rôle, cette fois avec une
formidable puissance; les feux de bordée, le lancement des torpilles automotrices remplaceront avantageusement
le jeu des balistes et celui de la poutre
ferrée; les torpilleurs seront bien autrement à
craindre que les petits bateaux qui allaient, pendant
la mêlée, couper sournoisement les cordages dont
la boucle servait de gonds au gouvernail. Quant à
l'abordage, malgré tous les instruments de destruction que la science a mis dans nos mains, je ne
crois pas qu'il ait encore dit son dernier mot. Ce
sera peut-être, pour le vaisseau frappé dans ses oeuvres vives d'un coup clandestin, le suprême
expédient et la dernière ressource.
Si peu redoutable, si peu exercée que fût la
flotte romaine, cette réunion de liburnes, grandes
et petites, était cependant pour l'époque une puissante
flotte de guerre : l'équivalent de nos vaisseaux
cuirassés. Elle n'empêcha pas les Goths, au temps
de Valérien et de son successeur, de se répandre
du fond du Pont-Euxin jusqu'aux extrémités de la
mer Egée. Quels services, en dehors d'un service
de police, avait-elle rendus jusque-là? Quels faits
d'armes signalèrent, pendant près de trois siècles,
son existence? A quelles expéditions les Césars, les
Flaviens et les Antonins, sans compter les usurpateurs,
la convièrent-ils à prendre part? Un résumé
rapide du règne des vingt-six empereurs qui succédèrent
à Claude et qui précédèrent Valérien nous
permettra d'apprécier le rôle dévolu aux flottes
impériales durant cette période.
LES EXPÉDITIONS MARITIMES DE CLAUDE ET DE SEPTIME SÉVÈRE.
L'histoire grecque se déroule avec la rapidité de l'éclair; l'histoire romaine entasse siècles sur siècles, et sa durée même en exclut l'unité. Depuis Auguste, on pourrait presque dire depuis Marius et Sylla, Rome n'est plus dans Rome; elle est tout entière dans les camps. Montesquieu a comparé l'empire romain à une espèce de république irrégulière, telle à peu près que l'aristocratie d'Alger: « Peut-être, ajoute-t-il, est-ce une règle assez générale que le gouvernement militaire est, à certains égards, plutôt républicain que monarchique. » Ce qui me frappe, même chez les Antonins, quand je les contemple au Musée du Louvre, avec leur tête carrée, leur froct bas, leur corps gigantesque et massif, c'est la prédominance de la matière sur l'esprit, prédominance qui s'accuse d'une façon si visible dans les moindres détails d'une structure faite pour décourager le ciseau de Phidias. Tous ces colosses semblent écraser le monde sous leur large pied brutal. Quelle distance entre ces Hercules et les Apollons que divinisa le génie des Grecs! Mais si les héritiers de César pèsent lourdement sur la terre fatiguée d'un pareil fardeau, il faut avouer aussi que le vieil Allas eût pu s'en fier à eux du soin de le remplacer. Les empereurs romains ont, pendant trois cents ans, porté le poids du ciel sur le fer de leurs piques : l'univers chancelant reprenait toujours, grâce à cet appui, son équilibre. Les deux ou trois siècles qui nous sont généralement représentés sous des couleurs si sombres ont été, la chose est incontestable, de toutes les périodes historiques, celle où le double fléau de la guerre et de l'anarchie a le plus légèrement effleuré le front des peuples. Le tempérament légal du Romain facilitait d'ailleurs singulièrement la tâche des empereurs. Nous vivons encore aujourd'hui des lois que Rome nous a léguées, et, bien que ce peuple dur et implacable ne soit pas fait pour inspirer à qui s'est épris d'un idéal plus pur une bien vive sympathie, nous serions injustes si nous méconnaissions de quel trésor sans prix la société moderne lui demeure redevable. De Rome nous est venue la science la plus indispensable, celle qui maintient les hommes dans le respect mutuel de leurs biens et de leurs droits, les empêchant ainsi de retourner par une pente insensible à l'anthropophagie : je veux parler de la science du gouvernement. Il est dans la destinée de la race humaine de ne pouvoir se promettre, fût-ce aux époques les plus favorisées par la Providence, que de courts intervalles d'une existence tranquille; néanmoins, quand les Goths firent trembler l'empire romain sur sa base, deux cent quarante-six ans s'étaient déjà écoulés depuis la mort d'Auguste, cinq années de plus que nous n'en comptons entre notre époque et l'avénement de Louis XVI au trône; de bons et de mauvais princes avaient exercé le pouvoir; la confiance du monde dans les fortes institutions qui lui garantissaient, avec la paix sociale, l'exacte administration de la justice, était telle encore que l'inondation des barbares éveillait à peine dans l'empire ravagé quelques doutes sur l'éternité d'une puissance si nécessaire à la conduite de l' humanité. Quand le grand évêque de Meaux entretenait le jeune dauphin de France « de la folie cruelle et brutale" de Caligula, «de la stupidité de Claude» , du règne de Néron, « le persécuteur du genre humain» ; quand il montrait à cet enfant destiné au trône, Galba, Othon et Vitellius périssant successivement dans l'espace de moins d'une année, semblables à ces buveurs que terrassent l'un après l'autre les vapeurs de l'orgie; quand il lui parlait « de la courte joie » apportée à l'empire par Vespasien et par son fils Titus, quand il faisait revivre Néron dans la personne de Domitien et ne laissait « respirer de nouveau le monde, que sous Nerva, sous Trajan, sous Adrien lui-même, bien que le règne d'Adrien ait été « mêlé de bien et de mal » ; quand il dépeignait Antonin le Pieux, « toujours en paix, mais toujours prêt, dans le besoin, à faire la guerre, Marc Aurèle, en revanche, « toujours en guerre et toujours prêt à donner la paix à ses ennemis et à l'empire , Lucius Verus « endormi dans la mollesse» , Commode démentant « par ses brutalités» le sang glorieux d'où il était sorti, Pertinax immolé à la fureur de soldats licencieux, l'empire mis à l'encan et trouvant dans le jurisconsulte Didius Julianus un acheteur, Sévère l'Africain triomphant en Syrie, en Gaule et dans la Grande- Bretagne, Caracalla marchant à une mort tragique par un chemin tout semé de carnage, le Syrien Héliogabale étonnant l'univers « par ses infamies» , Alexandre Sévère « vivant trop peu pour le bien du monde, , le tyran Maximin, issu de race gothique, osant porter la main sur le sceptre des Césars, les deux Gordiens et l'Arabe Philippe, Dèce, Gallus, Volusius, Émilien, défilant au fond du tableau comme des ombres, et « ce vénérable vieillard », Valérien, à qui la souveraine puissance fut déférée dans un jour d'alarme, livré aux Perses par la trahison, Gallien, le fils et le collègue du monarque captif, a achevant de tout perdre par son inaction, il allait à son but par une route inflexible. Sa logique chrélienne ne voulait, à travers tous ces événements dont il arrêtait par quelques traits de feu les grands contours, discerner qu'une lumière : la poursuite des desseins de Dieu sur son église. La critique moderne ne saurait accompagner l'éloquent prélat dans cette voie; Montesquieu et Gibbon ont refusé, aussi bien que Voltaire, de l'y suivre. « La brièveté des règnes, écrit Montesquieu, les divers partis politiques, les différentes religions ont fait que le caractère des empereurs est venu à nous extrêmement défiguré. » Je n'essayerai pas de réformer les jugements de l'histoire sur ce point je tiens à me renfermer exclusivement dans mon sujet technique, et je pense bien moins à savoir sous quel régime le monde a vécu depuis l'avénement d'Auguste en l'an 31 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'élévation de Claude II le Gothique en l'année 268 de notre ère, qu'à grouper de mon mieux tous les faits maritimes, sans acception de pays ou de siècle, pour en chercher la loi et pour leur demander d'utiles enseignements. César, suivant l'expression de Tacite, n'avait fait que montrer la Bretagne aux Romains; il ne la leur avait pas donnée. Eût-il même conquis ce territoire si profondément séparé du reste du monde, qu'il eût probablement hésité à en garantir la paisible possession au sénat : « Le Gaulois, disait-il, est prompt et ardent à prendre les armes; il manque de fermeté dans les revers; le Breton, au contraire, est tenace; il faut revenir souvent à la charge pour le soumettre. » Cette soumission définitive, Claude voulut l'entreprendre dès le début de son règne. Déjà Caligula y avait songé: le poignard de Chéréas ne lui laissa que le temps d'élever à l'entrée du port de Boulogne un phare qui put du moins faciliter l'exécution du plan de campagne arrêté par son successeur. Claude alla s'embarquer à Ostie. Deux fois, avant d'avoir réussi à gagner Marseille, il faillit sombrer sous une bourrasque de mistral en vue de la côte ligurienne d'abord, près des îles d'Hyères ensuite. Ce premier pas n'avait certes rien d'encourageant; plus d'un Romain serait rentré chez lui : Claude continua sa route. De Marseille il atteignit Gesoriacum par terre, en traversant les Gaules. Gesoriacum, c'était autrefois Boulogne-sur-Mer, comme les îles Stéchades étaient les îles d'Hyères. Arrivé à Gesoriacum, l'empereur ne se borna pas, comme son prédécesseur, s'il nous faut croire le moins croyable de tous les historiens, à emporter pour tout trophée des coquillages ramassés sur la plage; il exposa sans crainte son auguste personne à de nouveaux hasards. La flotte leva l'ancre, et les blanches falaises de l'autre côlé du détroit apparurent bientôt. En peu de jours, sans combat, sans une goutte de sang versé, Claude achevait la réduction de la partie de l'île qu'il tenait à soumettre. Ce résultat était plus positif que la pointe militaire tentée en courant par César; elle témoigne incontestablement d'un plan bien conçu, de préparatifs sagement ordonnés, et surtout d'une remarquable habileté politique. Six mois nprès le départ de Claude, la ville de Rome le voyait revenir triomphant. Le triomphe pouvait être plus mal décerné: Claude ne s'était pas contenté de ramener l'Angleterre insurgée sous le joug; il avait, au rapport d'Orose, conduit ses frêles vaisseaux jusqu'à la hauteur des Orcades. A qui donc, si vous la lui refusez, accorderez vous la couronne navale; et pourriez-vous citer de plus grandes victoires remportées jusque-là sur l'Océan? La Bretagne, l'île Iverne, « qui est presque aussi étendue et dont l'herbe savoureuse rassasie en quelques heures les troupeaux » , l'île Thulé, où le soleil, à l'époque du solstice d'été, ne cache jamais son disque sous l'horizon, toutes ces contrées à demi fabuleuses avant cette campagne n'avaient plus de mystères pour les géographes romains. En voyant partir Claude, Pomponius Mela en eut le pressentiment : « On ne tardera pas, disait-il, à parler de la Bretagne et de ses habitants d'une façon plus sûre et plus positive. Le plus grand des princes va nous ouvrir ce pays si longtemps fermé. » Oui, que le ciel conserve Claude à Rome, que ses successeurs gardent ses traditions, et un temps viendra où, suivant la parole du poëte, la vaste barrière formée par l'Océan ouvrira un passage vers d'autres continents et vers de nouveaux mondes; les rivages reculés de Thulé ne seront plus considérés comme la dernière demeure de l' homme» Il y a deux Claude dans l'histoire : celui qui, dans les luttes du champ de Mars, faisait, d'un coup de poing, sauter toutes les dents à son adversaire, et celui que son grand-oncle Auguste n'osait pas montrer au peuple romain, de peur qu'il ne prêtât à rire aux mauvais plaisants (1). L'avorton que la nature, assurait sa mère Antonia, n'avait pas pris le temps de finir, ne fut pourtant pas un si mauvais prince. Ses ennemis les plus acharnés n'ont pu nous dissimuler l'importance des travaux auxquels il présida, et tous sont tombés d'accord pour lui reconnaître un esprit singulièrement cultivé. On cite de cet empereur, déclaré bien lestement, à mon sens, stupide, des jugements qui eussent fait honneur à la sagacité de Sancho Pança. Montesquieu en a fait à bon droit la remarque : « Les places que la postérité donne sont sujettes, comme les autres, aux caprices de la fortune. » Comme le roi Louis XVI, auquel il n'a manqué que le don de séduire, Claude Ier adorait la géographie.
(1) Claude Ier régna de l'année 41 à l'année 54 de notre ère; Claude II, dit le Gothique,montasur le trône en l'année 268.
La seule expédition mililaire qu'il ait commandée en personne tourna surtout au profit des géographes, dont elle accrut considérablement le domaine. Malheureusement, les héritiers successifs du pouvoir, depuis la mort de Claude jusqu'à l'avènement d'Adrien, furent loin de montrer le beau feu du petit-fils de Livie; ils négligèrent la mer et ne contribuèrent pas d'une façon bien marquée aux progrès qui excitaient toute la sollicitude du souverain célébré par Pomponius Mêla. Néron seul eut une grande pensée : il conçut le projet de percer l'isthme de Corinthe. Les historiens n'y ont vu qu'une preuve irréfutable « de son extravagance » L'opposition ne traitait pas mieux M. Guizot quand l'illustre orateur osait prévoir le jour où l'on ouvrirait un passage aux vaisseaux de l'Atlantique à travers l'isthme de Panama. « Connaissez-vous, monsieur, lui criait-on alors, beaucoup d'isthmes qui aient été percés?» Qu'aurait dit le peuple le plus spirituel de la terre s'il eût vu le premier ministre du roi Louis-Philippe " haranguer les prétoriens pour les exhorter à ce grand ouvrage, et, au signal donné par la trompette, enfoncer le premier la pioche en terre, remplir la corbeille des débris du sol et en charger, comme un simple manoeuvre, ses épaules" ? Voilà cependant ce que fit Néron en présence des troupes qui l'avaient accompagné dans l'Achaïe. Je crois qu'il leur donnait, en cette occasion, un très louable exemple, car les soldats de Rome ont dû en partie leurs succès à l'habitude du travail, et s'ils n'avaient ouvert autant de routes qu'ils ont soumis de peu ples, leur domination ne se serait pas étendue si rapidement sur la surface du globe. L'isthme de Corinthe ne fut pas percé: ce fut un malheur plein de conséquences; personne n'osa plus s'atlaquer aux isthmes. Ce qu'on aurait donc pu reprocher à Néron, ce n'est pas d'avoir entrepris cet utile travail, c'est de ne pas l'avoir achevé. Il n'est vraiment que juste de faire honneur aux princes des grandes choses qui s'accomplissent sous leur règne, car on n'hésite guère à leur imputer les catastrophes dont le ciel se plaît quelquefois à punir la démence commune. Quand une éclipse de soleil menace les Chinois de leur ravir la lumière du jour, le souverain du Céleste Empire, pénétré des lourdes responsabilités qui pèsent sur sa tête, fait en tremblant son examen de conscience; il se demande, le front courbé jusqu'à terre, quel si grand péché il a pu commettre pour qu'une semblable calamité vienne visiter ses peuples. L'empereur de Chine est de l'avis des écrivains de l'Histoire auguste; il croit que le dispensateur suprême des biens et des maux ne s'occupe que de l'être chétif dont la main tient le sceptre, et que les nations, quoi qu'elles fassent, ne provoquent jamais par elles-mêmes sa justice. Ce système simplifie peut-être l'étude de l'histoire; il a l'inconvénient de ne point tenir compte des honnêtes intentions et de ne réserver que le blâme aux courageux efforts, lorsque le succès leur manque Claude Ier, Tiberius Drusus Claudius, fils de Drusus et oncle de Caligula, Claude Ier, honoré du double surnom de Germanique et de Britannique, était mort en l'année 54 de notre ère, d'un trépas trop subit pour qu'il n'en courût pas dans Rome quelques méchants bruits : il fallut attendre près de soixante-dix ans avant de retrouver un empereur géographe. Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien, Nerva, Trajan lui-même, n'ont peut-être pas été tout à fait indifférents à la marine; l'histoire n'a pas gardé trace des services qu'ils ont pu rendre à la géographie. Galba, Othon et Vitellius n'en auraient pas eu, il est vrai, le loisir, mais Vespasien eut plus de temps devant lui : pendant ses dix années de règne, Vespasien se contenta de naviguer sur le lac de Génésareth; il y défit les Juifs et leur tua plus de six mille hommes. Ce triomphe lui donnait sans doute le droit de faire frapper une médaille; c'était, à mon sens, aller un peu loin que de vouloir consacrer le souvenir de la défaite des Israélites par le bronze ambitieux qu'ont recueilli nos numismates. Ce bronze représente, en effet, une Victoire montée sur la proue d'un vaisseau, une couronne et une palme à la main, avec cet exergue: Victoria navalis. Les victoires navales, ce sont celles qu'on remporte sur l'eau salée. Il y a eu de très-beaux combats livrés sur les grands lacs de l'Amérique, des lacs auprès desquels le lac de Génésareth paraîtrait à peine un élang; ces combats n'ont jamais pu cependant arriver à la notoriété du combat du Shannon et de la Chesapeake : ce qui se passe sur l'eau douce est affaire de mariniers. Sous le règne de Titus, la flotte d'Agricola fit le tour de l'Angleterre par le nord; elle reconnut de nouveau les Orcades et l'Irlande. Peut-être Agricola eût-il poussé plus loin, peut-être l'eût-on vu, après avoir visité les sept îles Emodes, en face de la Germanie. le golfe Codan avec sa grande île occupée par les Teutons, aller aborder aux rivages de Thulé ; Domitien, que l'espoir de ces grandes découvertes touchait peu et qui n'avait qu'un goût très-médiocre pour l'hydrographie, se hâta de rappeler Agricola et de le condamner à une obscure vieillesse. Trajan aurait sans doute montré plus de penchant pour ces grandes entreprises. A peine eut-il battu les Daces et mérité par ses victoires en Asie le surnom de Parthique, qu'il voulut s'avancer jusqu'à l'embouchure commune de l'Euphrate et du Tigre. Cet empereur qui faisait sculpter des birèmes sur sa colonne, sans soupçonner qu'il allait ainsi fournir un nouveau thème à des discussions assoupies se borna, qui l'eût cru? à contempler l'océan du rivage. Un vaisseau cependant était là, se balançant doucement sur ses ancres, n'attendant qu'un souffle favorable pour déployer ses voiles et se diriger vers les Indes. « J'aurais volontiers entrepris moi-même ce voyage, dit l'empereur, si j'étais dans un âge moins avancé. » Christophe Colomb comptait plus de soixante-six ans au moment où il partit pour sa dernière expédition; Trajan n'en avait que soixante-trois lorsqu'il recula devant la traversée du golfe Persique. L'excuse invoquée par l'empereur me paraît cependant valable. Quant au successeur que Trajan se donna un peu à regret, s'il est permis de lui adresser quelque reproche, ce n'est pas celui d'avoir été un empereur sédentaire. Adrien passa presque tout entière sa vie sur les routes: il se croyait tenu d'imiter le soleil et de réchauffer successivement de ses rayons les diverses parties d'un empire dont la superficie comprenait près de six fois et demie la surface de la France. Le souverain qui avait visité l'Angleterre, la Sicile et l'Afrique, affronté les neiges de la Calédonie et les plaines embrasées de la haute Egypte, laissa son héritage à un sénateur de cinquante ans, Antonin le Pieux. Antonin, durant vingt-trois années de règne, ne fit d'autre voyage que celui de Rome à Lanuvie. Le monde ne s'en trouva pas plus mal; l'hydrographie y perdit beaucoup. Adrien n'avait pas la chasteté de Claude, « le seul des quinze premiers Césars dont les amours, a dit Gibbon, n'aient pas fait rougir la nature» ; il partageait du moins avec le petit-neveu d'Auguste le désir d'étendre le domaine d'une science qu'on n'a jamais cultivée sans en retirer de grands profits. En même temps qu'il reprenait les sages traditions d'Auguste et songeait à resserrer l'Empire dans ses limites naturelles, Adrien se proposait de chercher d'amples compensations aux agrandissements douteux qu'il sacrifiait, dans le nouvel essor imprimé au commerce. Il faisait reculer pour la première fois le dieu Terme; il vouait, en revanche, un culte particulier à Mercure. On ne lui plaisait pas moins en rédigeant des routiers et des portulans qu'en soutenant quelque thèse ingénieuse, ou en alignant de jolis petits vers. C'est à cette heureuse tendance que nous devons la célèbre lettre qui lui fut adressée par Arrien, alors gouverneur de la Cappadoce. Cette lettre contient, sous le nom de Périple du Pont-Euxin, une description fort intéressante des deux rives de la mer Noire. Je ne vois aucun fait maritime à relever pendant les règnes de Marc-Aurèle, de Commode et de Pertinax; avec Septime Sévère, qui monta sur le trône en l'année 193, nos annales se rouvrent. L'expédition de Septime Sévère contre les Bretons et les Calédoniens doit avoir coûté à l'empire, si les écrivains contemporains n'ont rien exagéré, plus de cinquante mille hommes. Travaillé de la goutte à ce point qu'on était obligé de le porter en litière, Septime alla mourir à York dans la soixante-sixième année de son âge, terminant sous les armes un règne de dix-huit ans à la fois glorieux et prospère. Avant de rendre le dernier soupir, il prononça ce mot resté célèbre : « J'ai été tout ce qu'on peut être; à quoi cela me sert-il aujourd'hui? Omnia fui, et nihil expedit. » Cela vous sert, souverain sceptique, souverain injuste à cette dernière heure envers vous-même, à laisser un nom honoré dans l'histoire. Le jour où les Romains compteront cet avantage pour peu de chose, c'en sera fait, croyez le bien, de leur grandeur.
 |
 |
LES PREMIÈRES INVASIONS.
Après le règne glorieux de Septime Sévère et le
règne odieux de Caracalla, suivi du pouvoir éphémère
de Macrin, l'Orient eut la satisfaction de voir
deux de ses enfants,Héliogabale et Alexandre Sévère,
assis sur le trône d'Auguste. Héliogabale fut massacré
par les prétoriens, le 10 mars 222; son
cousin, le fils de Mammée, fit goûter à l'empire les
douceurs d'un règne de treize ans, tout empreint
d'une mansuétude et d'une suavité presque chrétiennes.
Le revenu général des provinces s'élevait
alors à près de 400 millions de francs. Les labeurs
ingrats d'une expédition dirigée contre la Perse
compromirent le prestige du jeune empereur. Il
était difficile à cette époque de maintenir la discipline;
pour réprimer l'esprit séditieux de ses
soldats, Alexandre crut qu'il suffirait de faire appel
à leur amour-propre : du haut de sa grandeur, il les appela des bourgeois; si je ne craignais d'user
d'un terme trop familier, je dirais des "pékiins".
« Retirez-vous, Quirites, leur cria-t-il, et déposez
les armes. » Les Quirites obéirent; ils gardèrent un
mortel souvenir de l'injure. Pendant qu'Alexandre
Sévère commandait en personne une armée considérable
rassemblée sur le Rhin, une sédition plus
grave éclata. Un propos dédaigneux ne réussit pas
à la calmer : Sévère fut égorgé par quelques centurions
dans sa tente. Tel était, depuis Auguste, le
sort de beaucoup d'empereurs romains. Héliogabale et le doux Sévère étaient un anachronisme
: Rome revint, par instinct, à ce culte
de la force physique qu'elle avait paru un instant
abjurer. Le successeur que les soldats mutinés
donnèrent à Sévère mesurait près de huit pieds
romains de haut: 2m,35. Il lui arriva souvent de
boire dans un jour vingt-six litres de vin et de
manger jusqu'à soixante livres de viande; on le
disait de force à terrasser sept des plus vigoureux
soldats de l'armée. Ce géant, doué de l'appétit de
Polyphème, n'était pas un Romain; Maximin reconnaissait
pour auteurs de ses jours deux barbares;
son père était de race gothique, sa mère appartenait
à la nation des Alains. Qu'était donc devenue la cour élégante et polie d'Auguste? On n'apprécie
pas à sa juste valeur l'immense service que nous a
rendu l'invention de la poudre; elle a soustrait le
monde à la domination des butors.
En l'année 235, les butors trouvaient aisément
à qui parler : les régions du Nord laissaient alors
descendre peu à peu vers le monde romain une
nouvelle famille de peuples qui semblait vouloir
rendre à la race humaine les proportions gigantesques
des temps héroïques. Si, comme on l'a
prétendu avec une grande apparence de raison, les
régions polaires, refroidies les premières, ont été
aussi les premières à présenter des conditions
d'existence possibles, il est tout naturel que la
péninsule scandinave ait mérité le nom que lui
donne Jornandès, de fabrique des nations et de
réservoir des peuples. A une époque qui doit être
postérieure à l'âge de la pierre polie, puisque déjà
l'on construisait des vaisseaux, trois bateaux partirent
de cette île Scanzia, qui, suivant le géographe
Ptolémée, affecte la figure d'une feuille de cèdre,
et vinrent aborder au rivage opposé de l'Océan, non
loin de l'embouchure de la Vistule. Un de ces vaisseaux,
moins bon marcheur que les deux autres,
était resté en arrière. On donna par dérision à ceux qui le montaient le nom de Gépides, ou traînards : gépanta signifiant, dans la langue de ces aventuriers,
paresseux. Les Gépides formèrent plus tard une
des puissantes tribus de la grande nation des Goths.
Des siècles s'écoulèrent : les Goths s'étaient insensiblement
portés des bords de la Vistule à ceux du
Borysthène. Ils suivirent, poussant devant eux leurs
troupeaux, le cours de ce grand fleuve et occupèrent,
sans rencontrer de résistance sérieuse, les
immenses plaines de l'Ukraine. Au début du troisième
siècle de notre ère, sous le règne du successeur
d'Héliogabale, ils apparurent sur le littoral
du Pont-Euxin, avec leurs boucliers ronds, leurs
épées courtes, et leurs rois héréditaires. On les
prit d'abord pour des Scythes, et longtemps on ne
leur donna pas d'autre nom: c'était pourtant une
tout autre race qui venait réclamer sa part au
soleil. « Les Goths, dit Jornandès, dépassaient les
Romains en taille et en bravoure. » On redouta
bientôt leur fureur guerrière dans le combat.
Malgré sa vigueur incomparable, Maximin ne
put échapper au destin de ses prédécesseurs; il
périt bientôt, assassiné avec le jeune césar son fils.
Dans l'espace de quelques mois, six princes disparurent,
successivement frappés par le glaive. Les Goths cependant avançaient toujours, ravageant
la Dacie, inquiétant la Moesie, marquant chacun de
leurs progrès par d'incroyables massacres. Les
Perses en Asie n'étaient guère moins menaçants.
Un professeur de rhétorique, Misithée, donna sa
fille à un empereur de dix-neuf ans, le jeune
Gordien, et marcha lui-même, sous le titre de préfet
du prétoire, à la tête des armées. Les Perses
reculèrent devant ce général improvisé. La vigueur
d'âme d'un Sourdis, d'un Richelieu ou d'un Mazarin
vaut bien pour la conduite d'un empire la force
corporelle d'un Maximin. La fatalité, cependant,
s'en mêlait : Misithée mourut de la dyssenterie,
et Gordien, victime d'un attentat militaire, alla
rejoindre dans la tombe Maxime et Balbin, les
deux Gordien de Carthage, Maximin lui-même et
Alexandre Sévère.
Est-ce un Romain du moins qui recueillit alors
la pourpre impériale? Non! ce fut encore un barbare
: Philippe l'Arabe, né à Bostra, sur les confins
de la Mésopotamie, fut appelé à l'empire par les
soldats. Les trente-cinq tribus du peuple romain,
dit Gibbon, s'étaient entièrement fondues dans la
masse commune du genre humain. Le vulgaire
aveugle comparait la puissance de Philippe à celle d'Adrien ou d'Auguste : la forme était la même, le
principe vivifiant n'existait plus; tout annonçait un
dépérissement universel. » Ce que les légions
d'Asie avaient fait, les légions d'Europe pouvaient
le défaire : l'armée de Moesie élut à son tour son
empereur. Placé entre l'alternative de la pourpre
ou de la mort, Dèce se résigna; il choisit le pouvoir.
Philippe fut tué, dès la première bataille;
Dèce, universellement reconnu par les provinces et
par le sénat, n'eut plus à combattre que les Goths.
Ces Goths qui avaient vaincu et subjugué toutes
les tribus placées sur leur chemin étaient des
ennemis bien autrement redoutables que les premières
hordes contre lesquelles avaient eu jadis à
combattre Trajan et Arrien : la tactique que leur
opposèrent les généraux romains ne paraît pas
cependant avoir différé beaucoup de celle dont
Arrien recommandait l'usage contre la tribu guerrière
des Alains, tribu qui habitait alors, au nord
du Caucase, les vastes steppes du gouvernement
disait le gouverneur de la Cappadoce, vos troupes
en bataille, infanterie, cavelerie, artillerie, en profitant
de tous les accidents du terrain; puis attendez,
ainsi préparé, l'attaque dans vos positions. Le plus grand silence doit régner dans les rangs, tant que
l'ennemi n'est pas à portée de trait: à ce moment,
mais à ce moment seulement, s'élèvera, d'un bout
de la ligne à l'autre, une clameur formidable; les
flèches, les javelots, les pierres, les traits énormes
que dardent les balistes, pleuvront de tous côtés.
Cette grêle de projectiles empêchera vraisemblablement
les barbares d'aborder corps à corps la
phalange. Supposons cependant que les Scythes,
malgré tout, arrivent à nous joindre : les trois
premiers rangs, se touchant des épaules, se couvrant
de leurs boucliers, soutiendront, sans broncher, le
choc; le quatrième rang enverra ses traits par dessus
la tête des trois autres. Dès que l'ennemi
fera mine de reculer, on lancera contre lui la
cavalerie. La phalange prendra en même temps le
pas accéléré et suivra la cavalerie d'aussi près que
possible, pour la soutenir au besoin. »
Les provinces romaines étaient déjà envahies
quand Dèce monta sur le trône. Ce vaillant général
ne pouvait laisser dévaster impunément le territoire
de l'empire : il dut prendre l'offensive. Dèce trouva
les barbares occupés au siège de Nicopolis, ville
fondée par Trajan sur le Jaterus en Moesie. Les
Goths, à son approche, se retirent : ils se retirent de la Moesie, mais c'est pour aller assaillir la
Thrace. Philippopolis, qu'ils investissent, est emporté
d'assaut; près de cent mille hommes y périssent.
Dèce revient à la charge: il attaque les Goths
sous les murs d'une bourgade de la Moesie. Une
bataille des plus sanglantes s'engage : Dèce et son
fils y succombent. Le successeur que l'armée leur
donne achète la paix et la retraite des barbares d'un
prix ignominieux; Gallus consent à payer un tribut
annuel aux Goths. Rome, à ce coup inattendu, s'indigne;
le gouverneur de la Pannonie et de la Moesie,
Emilien, renie l'odieux traité et ranime le courage
des troupes; les barbares sont chassés au delà du
Danube. La victoire a fait d'Emilien un empereur;
Gallus est immolé par ses propres soldats. Mais
déjà Valérien est en route à la tête des légions de la
Gaule et de la Germanie : Valérien se propose de
venger Gallus. Le règne d'Emilien aura duré quatre
mois; l'armée qui lui donna la pourpre sur le
champ de bataille n'hésite pas à tremper ses mains
dans le sang d'un souverain dont elle est déjà lasse.
Le trône est maintenant occupé par un général de
soixante ans. Le sénat montrait d'ordinaire un goût
prononcé pour les vieux empereurs, le soldat aimait
mieux les jeunes. Maxime avait soixante ans, Balbin soixante-quatorze quand le sénat les choisit,
Gordien treize ans seulement quand le peuple exigea
qu'on lui déférât le titre de césar, quelques mois de
plus à peine quand les prétoriens l'appelèrent à
remplir le trône vacant. Pour tout concilier, Valérien
associa son fils Gallien à l'empire. Valérien
brilla, nous assure l'histoire, d'un très-vif éclat,
tant qu'il eut la sagesse de se contenter du second
rang: on vantait son courage, sa piété, la douceur
de ses moeurs, l'étendue de ses connaissances.
Monté sur le faîte, il ne fit que déchoir. Il ne fut
pas plus heureux en Orient que son fils Gallien sur
les bords du Rhin, et, pour la première fois, les
barbares déployèrent leurs étendards presque à la
vue de Rome.
Ces barbares n'étaient pas des Goths; c'étaient
des Suèves, nation plus puissante encore, dont les
nombreuses tribus s'étendaient des bords de l'Oder
jusqu'à ceux du Danube. L'empire se trouvait sapé
de trois côtés à la fois; les Perses, traversant l'Euphrate,
saccageaient Antioche, Tarse et Césarée;
les Suèves envahissaient la Gaule et la Lombardie;
les Goths campaient sur les bords du Danube. Les
constantes incursions des Goths avaient heureusement
aguerri les habitants de ces provinces romaines que Rome ne savait plus défendre. Les
barbares de l'Est, arrêtés par une résistance inattendue,
cherchèrent une roule nouvelle pour envahir
l'empire; la mer devint leur chemin. L'ère
des flottilles commence: les flottilles des Goths
vont précéder de deux cents ans au moins les
flottilles normandes. Les Goths, si je ne me
trompe, auront réalisé les premiers la pensée que
je poursuis avec obstination : trouvant la voie
barrée du côté de la terre, ils s'embarquent en
masse, et font ainsi rentrer, trois siècles environ
après la bataille d'Actium, la marine, investie d'une
nouvelle puissance, « dans le jeu des armées» Il
est donc impossible que je ne m'occupe pas d'eux.
LES FLOTTILLES DES GOTHS.
Que de fois, quand la défaite ouvrait notre territoire aux masses profondes du Nord, n'avons-nous pas entendu ce cri désolé: « Nous sombrons, et la marine ne fait rien! » Nos meilleurs amis eux-mêmes s'étonnaient de notre inaction et semblaient craindre de se trouver à court d'arguments pour l'excuser : Pendant qu'à Paris, écrivait M. Louis Reybaud, enfermé à cette époque dans la capitale investie, les marins détachés tiennent un si bon rang, que devient la flotte? Une telle force rester inactive, tant de canons muets, tant d'équipages assistant, les bras croisés, aux luttes désespérées de la patrie, c'est ce qu'on ne peut ni concevoir, ni admettre. Beaucoup s'en affligent, quelques-uns s'en indignent, aucun ne demeure indifférent. Il ne faudrait pourtant pas, dans ces heures d'amertume, se laisser aller à des accusations injustes. Voici, par exemple, une note qu'écrivait de Toulon, le 1erjuin 1870, c'est-à-dire en pleine paix, deux mois avant les événements, un officier général de la marine : moule invariable, devront céder le pas à des navires et d'un moindre tirant d'eau, plus agiles, moins « coûteux et tout aussi redoutables. Ces escadres relèvent trop d'un passé qui nous enlace encore de ses iraditions et de ses nécessités factices. Nous avons la manie des monuments; nous monumentons toujours, s'il est permis d'employer cette expression, et notre flotte, avant d'être une force militaire, est un monument. Nous nous extasions devant sa fausse grandeur sans nous rendre bien compte des opérations auxquelles nous pourrions a la faire servir. Il faut tenir grand compte du peu de it fond que présentent certains bassins stratégiques. Si nos colosses ne peuvent n'y pénétrer, n'y s'y mouvoir, il peut y avoir là un vice capital qui nous réduirait, en telle circonstance donnée, à l'impuissance ! Ces paroles, ajoutait M. Reybaud, étaient presque une prophétie. En effet, notre flotte s'est heurtée à un double écueil: d'un côté, en lui enlevant sa troupe de débarquement, on avait diminué de beaucoup son importance; de l'autre, en lui donnant des bâtiments mal appropriés au service des mers où elle devait agir, on l'a paral ysée. » Qu'il me soit permis de prendre la parole après cet avocat aussi affectueux qu'éloquent et habile. « La marine ne fait rien , disiez-vous? N'était-ce rien que d'assurer, pendant un rude hiver, à nos vaisseaux marchands, encore épars sur tous les points du globe, le libre chemin des mers? Pour peu que la constitution de la flotte s'y fût prêtée, la marine aurait fait certainement davantage. Le grand tirant d'eau des navires dont elle disposait ne lui permit à aucun moment d'opérer sur le littoral ennemi une diversion qui offrît, en regard des risques à courir, le moindre intérêt; les procès-verbaux de tous les conseils de guerre, qui se réunirent alors sous la présidence de nos amiraux, en font foi. Tout au plus la marine eût-elle pu bombarder à distance des villes ouvertes: pareille intervention, odieuse et sans danger, n'est pas heureusement dans nos habitudes. Tant qu'il n'y aura pas, à côté de la flotte, une flottille, nous resterons ainsi au cours d'une guerre purement continentale, complètement désarmés. Les flottilles des pirates du Pont-Euxin, composées de misérables barques, ont mis l'empire romain à deux doigts de sa perte; une flottille française bien organisée eût peut-être, directement ou indirectement, débloqué Paris. Ce sont les incursions maritimes des Goths, précurseurs des Normands, que je voudrais ici raconter : j'espère trouver dans ce simple récit l'occasion de soutenir et de développer encore une fois la thèse dont je n'abandonnerai la défense que le jour où j'aurai vu l'inébranlable conviction qui m'anime pénétrer dans l'esprit de nos jeunes marins. Pour convaincre, il est indispensable de se répéter : la répétition était la seule figure de rhétorique à laquelle l'empereur Napoléon comprenait que l'on pût attacher quelque importance. Strabon décrivait déjà, au temps d'Auguste, les barques dont se servaient les pirates du Pont-Euxin. « Ce sont, disait-il, de petites embarcations très légères, pouvant contenir de vingt à trente hommes tout au plus. » Les Grecs les appelaient camaras chariots couverts, probablement parce qu'on les recouvrait, quand la mer était forte, d'un petit toit incliné. J'ai traversé plus d'une fois la lagune de Manille sur des pirogues protégées de la même façon: un Espagnol, notre compagnon de voyage, comparait en riant ces embarcations, au fond desquelles nous demeurions blottis, à un porte-cigares. Les camaras s'en prenaient d'ordinaire aux vaisseaux marchands; il leur arrivait néanmoins, de temps en temps, de se réunir et de s'attaquer alors à une province ou à une ville. «Il ne manque à ces pirates, remarque Strabon, que des ports, car il n'en existe guère sur la côte qu'ils habitent: les contreforts du Caucase descendent là jusqu'au rivage, et toute cette portion du littoral est abrupte; mais les écumeurs de mer du Pont-Euxin trouvent des complices et des recéleurs dans la Chersonèse Taurique. » On sait combien étaient cruelles les moeurs de ces populations, que leurs relations avec les Grecs ne purent civiliser qu'à demi. L'isolement inhospitalier dont elles s'étaient fait une loi favorisa plutôt qu'il ne retarda la création au fond de la mer Noire, sur les confins de l'Asie et de l'Europe, d'un petit Etat indépendant qui prit, dans les premières années du cinquième siècle avant notre ère, le nom de royaume du Bosphore. En l'année 108 avant Jésus-Christ, Milhridale s'emparait de ce royaume, qui confinait à son territoire; vainqueurs de Mithridate, les Romains firent du pays que la trahison de Pharnace leur livrait l'apanage d'un prince qui se reconnut sur-le-champ leur tributaire. Les Bosphoriens, nous l'avons dit, fournissaient aux pirates du Caucase ce qui leur manquait: des ports, un marché et toutes les facilités possibles pour partager à loisir leur butin. Rentrés chez eux, les pirates chargeaient leurs embarcations sur leurs épaules et les emportaient dans les forêts, qui leur servaient de repaires. « Quand revient la saison favorable, dit Strabon, ils remettent leurs péniches à la mer. Sur les côtes qu'ils ont l'habitude de dévaster, aussi bien que sur celles qu'ils habitent, ils connaissent des retraites où ils vont cacher leurs embarcations. Puis, de jour et de nuit, ils font la chasse à l'homme, poussant l'impudence jusqu'à traiter ouvertement avec les autorités du pays du rachat de leurs prisonniers. Dans les parages où quelque prince étranger commande, on peut à la rigueur obtenir justice et réparation des dommages subis en s'adressant aux magistrats, car il arrive souvent que les pirates sont traqués à leur tour et capturés avec leurs bateaux; là, au contraire, où le territoire est soumis à notre influence, il faut se résigner, tant la négligence des préfets envoyés de Rome dans ces contrées lointaines est grande et ennemie de toute répression. » Ce fut, ne craignons pas de le répéter, dans ce royaume du Bosphore et sur cette côte du Caucase que les Goths trouvèrent les vaisseaux, ou plutôt les embarcations dont ils avaient besoin pour transporter leurs armées au sein des provinces romaines de l'Asie. La limite de ces provinces avait été portée, depuis l'époque où Arrien côtoyait le littoral du Pont-Euxin, de Dioscurias à Pityus, « ville pourvue d'un bon port et défendue par une forte muraille» Procope compte deux jours de navigation entre Pityus et Dioscurias; Muller reconnaît l'emplacement de Pityus dans la localité moderne de Pitsiounta, située à trente milles environ de Soukoum Kaleh, débouché maritime dont le nom se retrouvera souvent dans l'histoire des luttes que les Russes n'ont cessé de soutenir contre les armées du sultan. Les Romains avaient confié la garde de la frontière asiatique à un officier d'une valeur éprouvée, Successianus. Malgré la faiblesse de la garnison de Pityus, Successianus parvint à repousser les attaques des Goths. Faire un siège sans machines n'était guère plus facile à cette époque que d'enlever aujourd'hui sans canons la plus chétive place. Tout l'effort des hommes de guerre qui s'occuperont un jour de rendre les descentes par mer efficaces devra, je l'affirme hardiment, porter sur ce point: créer une artillerie maniable, légère, et susceptible d'être embarquée sur de très petits vaisseaux. Il faudra découvrir la torpille terrestre pour en faire l'auxiliaire de cette torpille maritime qui menace déjà nos énormes vaisseaux cuirassés de déchéance. Je ne saurais trop insister sur ce sujet, car, dans ma pensée, les descentes doivent être avant tout des surprises, et elles ne pourront jamais être tentées avec quelque chance de succès que par des flottilles. Malheureusement pour les Romains, Successianus ne tarda pas à être appelé à un poste jugé plus important : les Goths reparurent à l'instant sous les murs de Pityus, enlevèrent d'assaut cette place forte et, pour qu'elle ne gênât plus à l'avenir leurs progrès, la rasèrent, puis de Pityus, en suivant le rivage de la Colchide, passèrent à Trapézonte. Cette ville était une ancienne colonie grecque. En lui donnant un port, l'empereur Adrien lui avait donné la richesse : Trapézonte prit soudain un grand développement et s'entoura d'une double enceinte; les marchands y affluèrent en foule. A la première annonce de la mise en marche des Barbares, Valérien s'était empressé de renforcer la garnison de Trapézonte. Ce ne furent probablement pas des soldats d'élite qui entrèrent dans la place, car la négligence de ces dix mille hommes, le renfort, on le voit, était sérieux, allait préparer un succès funeste et facile aux assiégeants. Envoyer au-devant de l'ennemi ses bonnes troupes et confier la garde de ses forteresses à des réserves qui ont désappris la discipline peut être souvent une nécessité; seulement il ne faut pas compter que les cités ainsi défendues opposeront toute la résistance qu'on est en droit d'attendre d'une troupe appartenant à l'armée régulière. Les Goths profitèrent de la nuit pour surprendre une garnison dont la vigilance n'était que trop aisée à endormir. Ils avaient rassemblé une énorme quantité de fascines: ils en comblent soudain le fossé, escaladent les murs et se répandent dans la ville avec de grands cris. L'épouvante fait tout fuir devant eux. En un instant, ils sont maîtres d'une place qui eût pu les retenir des années entières sous ses murs. Les Goths ne pouvaient, vu leur nombre restreint, avoir la prétention de garder une si grosse conquête. Ils se contentèrent de la mettre au pillage et reprirent la mer avec un butin immense. Toute la côte du Pont fut ravagée dans cette première campagne. Des milliers de captifs allèrent conduire la charrue sur un sol que les Goths, peuple pasteur et nomade, auraient laissé en friche; les plus robustes furent réservés pour manier la rame sur les vaisseaux. Partout où ces essaims de Barbares passaient, ils ne laissaient rien à glaner à ceux qui viendraient après eux; l'invasion, quand elle se répéta, chercha donc un terrain nouveau. La côte occidentale de la mer Noire n'avait pas encore été dévastée; vers cette rive intacte, les Goths se portèrent d'emblée dès leur seconde campagne. Ils passèrent rapidement devant l'entrée du Dniester et devant les bouches du Danube: le plus fructueux butin qu'ils recueillirent, sur ce rivage qui leur était depuis longtemps connu, consista en un supplément de bateaux. Leur flotte augmentait ainsi à vue d'oeil; leur troupe ne tarda pas à se grossir également. Tous les gens sans aveu accoururent à leur appel, impatients de prendre part au pillage de l'empire romain. Le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie fut franchi par cette flottille, que les fortifications de Byzance, rasées jadis par Septime Sévère, n'étaient plus en mesure d'arrêter; les habitants des bords de la Propontide virent avec effroi l'invasion menacer leurs rivages. La gnrnison de Chalcédoine, alors campée près du temple de Jupiter Urius, fut la première à. lâcher pied. Chalcédoine, Nicomédie, Nicée, Pruse, Apamée, Cios tombèrent successivement aux mains des pirates. Ces villes, depuis des siècles, se croyaient à l'abri de tout danger; leurs murailles s'écroulaient et n'offraient plus guère que des ruines; il était trop tard pour songer à les relever, personne n'eut l'idée de les défendre. Ceux qui purent fuir se crurent trop heureux de n'avoir à sacrifier que leurs richesses; les autres courbèrent la tête sous l'ouragan. Le progrès des Goths ne fut suspendu que par le débordement du Rhyndacus, qui protégea, comme par une intervention miraculeuse, la ville de Cyzique. Les Goths ne se souciaient pas d'exposer leur flottille aux rigueurs de l'automne qui annonçait, par ces pluies prématurées, son approche. Ils ajournèrent à l'année suivante leurs déprédations et regagnèrent la côte d'Europe à la hauteur d'Héraclée. Mais déjà la saison était peu propice au retour. Les populations de toutes parts avaient couru aux armes; Venerianus, le commandant de la flotte romaine, annonçait l'intention de fermer le passage aux hordes qui se hâlaient de rejoindre leurs repaires. Un combat s'engagea non loin de l'entrée du Bosphore; les Goths en sortirent vainqueurs, et Venerianus y trouva, suivant l'expression de Trebellius Pollion, un des écrivains de l'Histoire auguste, la mort d'un soldat. Le naufrage, les pertes subies pendant les fourrages qu'il fallait faire pour se procurer des vivres vengèrent cependant largement les Romains. La flottille ne rentra dans les ports de la Chersonèse Taurique que considérablement diminuée. Les pirates ne se découragent pas pour si peu. Une troisième expédition fut immédiatement entreprise: elle comptait plus de cinq cents voiles. Les Goths ne s'attardèrent pas, cette fois, à piller les côtes du Pont-Euxin; ils allèrent droit du Bosphore Cimmérien au Bosphore de Thrace. Bien qu'ils eussent le courant pour eux, le vent contraire les rejeta d'abord du milieu du détroit dans la mer Noire; le lendemain, le vent changeait; quelques heures d'une brise favorable portaient les envahisseurs jusque sous les murs de Cyzique. Enlever et détruire cette place qui avait résisté aux armes de Sparte d'abord, à celles de Mithridate ensuite, fut pour eux l'affaire d'un instant. Enivrés par ce premier succès, ils conçurent le dessein de pousser plus loin leurs ravages. C'est presque toujours un habile calcul de porter le théâtre de la guerre surun point où l'on n'est pas attendu: la surprise et l'effroi combattent alors pour vous. Les Goths franchirent résolûment l'Hellespont, jetèrent la terreur dans la mer Egée et parurent tout à coup devant Athènes, dont les murailles n'avaient pas été réparées depuis le jour où Sylla était entré par la brèche dans la ville de Minerve. Les barbares se rendirent bientôt maîtres de la place : Athènes subit le sort de toutes les villes où le fléau dévastateur pénétrait. Combien de monuments durent alors périr; et qu'il faut remonter loin, on le voit, pour rencontrer la date des premières mutilations infligées aux chefs-d'oeuvre dont nous déplorons si amèrement la perte! Trebellius Pollion nous affirme que les Goths furent enfin vainçus par les Athéniens marchant sous la conduite de Dexippe, écrivain peu connu de cette époque obscure. Que Trebellius Pollion n'a-t-il ait vrai! Ce serait du moins une consolation pour nous de savoir que les premiers qui osèrent porter la main sur ces merveilles de l'art, immortel honneur de l'esprit humain, en ont été punis comme ils méritaient de l'être. L'art appartient à l'humanité tout entière; les profanateurs, qu'il soient Goths ou Vandales, n'y peuvent loucher sans s'attirer l'exécration de la postérité la plus reculée. Malheureusement la victoire de Dexippe ne dut pas être bien décisive, car, quelques jours après, les Goths se répandaient dans l'Epire, dans l'Acarnanie et dans la Béotie. Thèbes, Argos, Corinthe, Sparte furent à leur tour saccagées. Valérien était, en ce moment, prisonnier de Sapor; son fils Gallien venait de se faire inscrire parmi les citoyens d'Athènes. Gallien se glorifiait d'avoir obtenu, dans une cité qui commandait toujours le respect, la charge honorable d'archonte : comment ne serait-il pas sorti de sa mollesse léthargique au bruit de ce flot d'hommes dont l'irruption menaçait de tout inonder? Gallien accourut avec une armée. Les Goths comptaient parmi leurs alliés les Hérules, tribu sarmate qu'ils ramassèrent, dit-on, sur leur passage quand ils descendirent du bassin de la Vistule dans le bassin de l'Hypanis et du Borysthène. Le chef des Hérules se laissa gagner par Gallien et entra au service de Rome. L'empereur lui fit des conditions dignes de la nation belliqueuse qu'il tenait à détacher, à cette heure critique, de la confédération des Barbares: il le revêtit de la dignité consulaire. Rome n'existait plus que par ces compromis; l'empire ne pencha jamais plus visiblement vers sa chute. Les Goths, déjà rassassiés de butin et de carnage, ne songeaient cependant qu'à opérer leur retraite. La retraite est le moment difficile de ces pointes audacieuses où la guerre ne peut être qu'une succession de hasards; heureusement pour le salut de la plupart d'entre eux, les pirates du Pont-Euxin n'avaient pas brûlé leurs vaisseaux. Quelques-uns commirent l'imprudence de vouloir regagner les plaines de l'Ukraine à travers la Moesie; ils trouvèrent sur leur chemin l'armée de Marcien et des populations ardentes à la vengeance. Gallien commença par battre ces bandes dispersées dans l'Illyrie; Marcien acheva le massacre en les poursuivant jusque dans les défilés du mont Gessacus. La majeure partie des Goths avait, nous l'avons dit, eu la sagesse de se rembarquer. La flottille brûla, en passant, le temple de Diane à Éphèse, temple sept fois incendié et sept fois rebâti, ravagea la côte de la Troade et entra enfin dans l'Hellespont. A partir de cet instant, les Goths purent se regarder comme sauvés; aucune force navale n'était de taille à leur barrer la route. Ils traversèrent sans encombre la Propontide, le Bosphore de Thrace, et, ce qui prouve la sécurité complète de leurs mouvements, allèrent se reposer de leurs fatigues à Anchiale, ville de Thrace bâtie sur le littoral, au pied du mont Hémus. Jornandès prétend qu'ils y firent une cure d'eaux, " les eaux thermales qui sortent d'une source située à quinze milles romains d'Anchiale étant réputées les plus efficaces que l'on connaisse au monde pour rendre la santé et la vigueur aux malades". De cette station balnéaire, les Goths eurent peu de peine à remonter le long du rivage jusqu'aux bouches du Borysthène. L'effroi que cette irruption sans précédent, plus terrible cent fois que celle de Xerxès, sema sur sa route, n'a pas permis aux historiens de nous en transmettre un récit circonstancié et fidèle; c'est plulôt un cri d'horreur qu'une relation détaillée qui est parvenue jusqu'à nous. " L'incendie, écrit Ammien Marcellin, s'est promené sur la Macédoine entière; Thessalonique et Cyzique se sont vues bloquées par des myriades d'hommes; Anchiale et Nicopolis ont été saccagées; Philippopolis fut détruite de fond en comble. L'Epire, la Thessalie, toute la Grèce enfin, subirent les effroyables rigueurs de l'invasion." Les irruptions par terre, les dévastations maritimes, tout se confond dans la pensée de l'éloquent écrivain. Pour nous, il n'est qu'un fait qu'il nous importe de retenir : c'est le trouble que doit jeter, dans la défense d'un vaste territoire, l'action d'une flottille quand elle porte une armée.
LES EXERCICES DE DEBARQUEMENT.
L'empire russe, pendant la guerre de 1854, ne
s'est trouvé vulnérable que sur deux des points de
son grand développement de côtes : Bomarsund et
Sébastopol. Si les hostilités se fussent prolongées,
il n'est point impossible que, les préparatifs des
alliés étant devenus plus sérieux et mieux combinés,
la capitale même, la ville de Pierre le Grand, n'eut
point été tout à fait à l'abri d'un débarquement. La
revue navale de Portsmouth, qui suivit de si près
la conclusion de la paix, montra du moins que
les Anglais n'avaient rien négligé pour se mettre
en mesure de porter au besoin ce cou p décisif.
Toute une flottille de canonnières fut improvisée
dans le court espace d'un printemps: la paix signée,
on remonta sur des cales couvertes ces escadrilles
dont on ne savait plus que faire. Assurée de pouvoir
les préserver ainsi d'un trop prompt dépérissement, l'Angleterre les garda pour une autre
occasion, ne désespérant peut-être pas de faire
naître cette occasion un jour. L'événement trompa
son attente : les canonnières ne sont plus, très probablement,
à cette heure, que du bois pourri.
Les arsenaux britanniques n'en avaient pas moins
fourni la preuve incontestable de leur prodigieuse
puissance de production. L'effet moral a eu, je
n'hésite pas à l'affirmer, sur les négociations qui se
poursuivaient une influence notable.
Ce que les Anglais auraient pu faire, les Allemands,
prétendent certains stratégistes, seraient,
grâce à leur voisinage des États du Tsar, en bien
meilleure situation pour le tenter. Une descente
opérée sur la rive méridionale du golfe de Finlande
aurait-elle quelques chances de réussir? Elle jetterait
en tout cas l'alarme dans le camp ennemi et
constituerait une diversion de la plus haute importance.
Les risques à courir, dans une opération de
ce genre, ne sauraient être méconnus: à la guerre,
il faut bien s'y résoudre, on n'obtient d'avantages
qu'à la condition d'affronter quelques risques. Les
Russes, sans s'exagérer le danger auquel les exposerait
l'esprit ingénieux et entreprenant d'un adversaire
exalté par de récentes victoires, ont voulu néanmoins étudier pratiquement la question, et,
si je puis m'exprimer ainsi, en avoir le coeur net.
Le 27 juillet 1883, en présence de l'Empereur
et des principaux membres de la famille impériale,
le simulacre d'un débarquement de vive force a été
exécuté sur la côte d'Esthonie. Deux corps d'armée,
une escadre de quinze cuirassés, et toute une flottille
de canonnières, ont pris part à cet exercice :
un des corps d'armée devait accomplir la descente,
l'autre était chargé de la repousser. De part et
d'autre, les manoeuvres paraissent avoir approché,
autant que possible, de la réalité; aucun détail n'a
été omis: ni les reconnaissances préliminaires, ni l'appui que l'artillerie des vaisseaux doit prêter en
pareille occurrence aux troupes qui débarquent.
Les bataillons placés à terre se sont tenus masqués
jusqu'au dernier moment; ils n'ont révélé leur présence
que lorsque le débarquement était déjà prononcé.
Retraite convenue à l'avance, retour offensif,
rien n'a manqué à un programme qu'on tenait à
dresser si complet, que le combat simulé faillit un
instant dégénérer en bataille sanglante.
Quelle a été, quand tout fut terminé, l'impression
générale des juges compétents? Le correspondant
du journal le Soleil était sur les lieux: pour lui, si je l'ai bien compris, les assaillants auraient été
fondés à s'attribuer la victoire. Je me plais surtout
à enregistrer cette observation : « Les Cosaques,
ivres d'enthousiasme, lançaient à l'eau leurs montures,
et, à peine parvenus au rivage, exécutaient
des fantasias échevelées. » Avis à nos cavaliers !
Qu'ils nous aident un peu et ne se montrent pas
trop exigeants quand, avec les moyens bien imparfaits
dont nous disposons aujourd'hui, nous essayons
si laborieusement de les mettre à terre.
Le général duc de Rovigo a raconté, dans ses
intéressants Mémoires, comment il s'y prit pour débarquer
sur la plage d'Alexandrie les chevaux de
l'expédition d'Egypte. Il en fit d'abord transporter
quelques-uns dans des chaloupes et ordonna qu'on
les rangeât sur le rivage, la tète tournée du côté de
la mer; pour les autres, après les avoir hissés au
bout de vergue, il les descendit simplement à l'eau.
Des embarcations les attendaient; les cavaliers, qui
y avaient pris place, saisissaient les chevaux par
la longe, leur soutenaient la tête à peu près à la
hauteur du plat-bord, et le convoi se mettait en
marche. Dès que les canots touchaient le fond et se
trouvaient arrêtés par la déclivité de la plage, les
conducteurs abandonnaient les animaux à eux mêmes: l'instinct du cheval le poussait à rejoindre
ses compagnons. Savary nous affirme que le débarquement
de la cavalerie s'opéra de cette façon
avec une rapidité surprenante : le général Desaix
lui en adressa les plus vifs compliments. Dans un
port, ce procédé expéditif doit en effet réussir; sur
une côte battue par la moindre mer du large, il
pourrait donner lieu à plus d'un mécompte: le
cheval a horreur des brisants. C'est, du reste, une
question à étudier.
Il y en aurait bien d'autres à éclaircir, si nous
voulions suivre l'exemple des Allemands et des
Russes. La création d'une flotlille pouvant se suffire
à elle-même ne me paraît pas chose impraticable,
et cette solution du problème est celle vers laquelle
j'inclinerais de grand coeur, ne fût-ce qu'à cause
de sa simplicité et de ses immenses avantages;
mais je prévois sans peine toutes les objections
qu'un pareil projet soulèverait. Nous n'aimons pas,
en France, à être troublés dans nos habitudes :
l'idée d'exposer des troupes sur des esquifs qu'un
seul coup de mer peut submerger n'est plus de
notre époque; il faudrait avoir l'âme de Germanicus
ou celle d'un hetman de Cosaques Zaporogues pour
se lancer gaiement dans pareille aventure Embarquons donc les esquifs eux mêmes; nous écarterons
ainsi toute chance contraire. Combien de péniches
de vingt, de trente, de quarante ou de cinquante
avirons suppose-t-on qu'un de nos grands transports
pourrait recevoir, s'il était aménagé pour prendre
à son bord non plus des bateaux-torpilleurs, mais
des embarcations longues, étroites et légères? Cent
péniches, est-ce trop? Mettons-en donc cinquante.
A ce taux, dix transports pourront conduire sur
les lieux où vous vous proposerez de tenter une
descente cinq cents bateaux à rames: ces bateaux
donneront très aisément passage à dix mille hommes.
Voilà déjà une grosse division d'infanterie jetée à
terre promptement et d'un seul coup, à une condition
cependant, c'est que l'aviron sera aux mains
du soldat et que le soldat aura, de longue date,
appris à le manier. Avec vingt transports, dix
pour porter les hommes, dix pour charger le matériel
flottant de la descente, on peut s'épargner
les dangers d'une iraversée dans des barques à
demi pontées. L'artillerie et la cavalerie exigeront,
il est vrai, des navires d'une construction spéciale :
je ne mets pas en doute que ces navires, on n'arrive
à les faire assez plats de varangues pour qu'ils
puissent, dans beaucoup de parages, s'accoster presque à terre. Si quelque scrupule retient encore
ici nos ingénieurs et nos officiers, nous ferons pour
l'artillerie et pour la cavalerie ce que nous avons
fait pour l'infanterie : nous nous résignerons au
transbordement. Seulement le problème dès ce
moment se complique. Tout projet de descente qui
emprunte le concours des navires de haut bord
suppose la possession incontestée de la mer; la
flottille pourrait, à la rigueur, se passer de la protection
des escadres. Avant de prendre parti,
essayons d'abord la force de résistance de ces engins
maniables dont nous suspectons peut-être à tort les
facultés.
Depuis bientôt dix ans je le répète : tant qu'on
n'aura pas créé une école de débarquement, on ne
saura pas ce qu'on peut demander à une flottille.
Si cette école avait son siége en Algérie, les études
que je recommande trouveraient à la fois plus de
secret, de loisir et de recueillement. Dans notre
grande colonie militaire, les troupes sont toujours
sur le pied de campagne; plus disponibles qu'en
France, elles montreraient peut-être moins de
répugnance pour les nouveautés. On serait agréablement
surpris, j'en suis convaincu, de voir peu
à peu, et dans le court espace de quelques années, ce
qui semble aujourd'hui une chimère prendre
corps, se développer, et réclamer sa place dans la
plupart des plans de mobilisation. Une école de
débarquement n'exige pas un personnel bien nombreux
: une simple compagnie d'infanterie, un
peloton de cavaliers, deux canons attelés feraient
au besoin l'affaire. L'important serait de perfectionner
par des essais intelligents et sans cesse
renouvelés le matériel destiné à des pérations que
nous avons compliquées à plaisir. J'ai pris ma part
du débarquement d'Oldfort, j'ai dirigé celui de
Kertch et celui de Kinbourn : je déclare formellement
que de longues études ne seront pas nécessaires
pour faire mieux. En tout élat de cause, je
ne crains pas d'assumer ici le rôle de prophète : si
nous hésitons trop longtemps à entrer dans la voie nouvelle que j'indique, la lumière nous viendra du
Nord.
CLAUDE Il LE GOTHIQUE AURÉLIEN ET PROBUS.
Les Goths n'ont pas été les seuls à tenter de
longues traversées dans de petites barques : une
colonie de Francs, transplantée vers la fin du troisième
siècle sur les bords du Pont-Euxin, voulut,
en l'année 282 de notre ère, profiter du désarroi
dans lequel l'esprit séditieux de l'armée jetait alors
l'empire; elle s'empara tout à coup de quelques
vaisseaux marchands. Partis de l'embouchure du
Phase, ces hardis révoltés ne trouvèrent pas d'obstacle
sur leur route : ils franchirent le Bosphore,
traversèrent la Propontide, descendirent l'Hellespont
et portèrent le ravage en Asie, en Grèce, en
Sicile, en Afrique. Que faisait donc pendant ce
temps la flotte de Ravenne? Existait-elle encore?
Une poignée d'aventuriers pouvait non-seulement
saccager les rivages sans défense qui se présentaient
sur son chemin, elle prenait des villes, des cités telles que Syracuse, dont la résistance faillit briser
jadis la puissance, alors en pleine floraison, de la
république d'Athènes. Fort heureusement les Francs
songeaient encore moins à grossir leur butin qu'à
se rouvrir le chemin de la patrie. Les colonnes
d'Hercule les virent passer avec étonnement, l'Océan
les reçut comme des brebis revenant au bercail: il
garda pour d'autres ses colères. S'accrochnnt à la
côte de la péninsule Ibérique et à celle des Gaules,
les nouveaux Argonautes finirent par atteindre
l'embouchure du Rhin et le rivage des Bataves.
Que pensez-vous de cette traversée? Les galères
de Venise, quand, au moyen âge, elles se rendaient
du fond de l'Adriatique à Anvers et à Bruges,
étaient-elles plus hardies que ces bateaux des
Francs? Dépassaient-elles avec plus d'audace les
limites que les Grecs n'osèrent jamais franchir? Ne
suivaient-elles pas, avec une prudence qui n'avait
garde de se démentir, le littoral dans tous ses
détours? Des pilotes les conduisaient de cap en
cap, à travers les écueils des côtes de Bretagne, au
milieu des bancs de sable de la côte de Flandre :
livrées à elles-mêmes, elles n'auraient pas accompli
sans peine l'odyssée dont les historiens romains
nous ont, en quelques lignes, transmis le souvenir. Prenez une de nos tartanes, un de nos chassemarée,
confiez-les à un de nos jeunes officiers et
donnez-leur à recommencer ce long itinéraire;
faites-les passer de Sébastopol ou de Nicolaïef à
l'embouchure de la Somme ou à celle de l'Escaut,
vous verrez si la tàche paraîtra aujourd'hui plus
facile qu'au temps d'Aurélien et de Probus. On cite
encore comme un trait d'intrépidité confiante le
voyage des galères de Marseille, qui, sous le règne
de Louis XIV, allèrent rejoindre l'escadre de Tourville
dans la Manche et l'aidèrent à brûler les vaisseaux
anglais dans le port de Darmouth. L'habitude
de monter d'énormes navires nous a rendus suspects
les petits bâtiments; nous ne savons plus
affronter la tempête sur des coques de noix. J'ai
commandé un cotre dans ma jeunesse; j'avais pour
équipage l'élite des gabiers du vaisseau le Nestor;
quand nous prîmes la mer, nous étions tous,
matelots et capitaine, aussi empruntés les uns que
les autres: il nous fallut refaire complètement notre
apprentissage. Les marins de haut bord ne vaudront
jamais rien pour armer des flottilles; ces sortes de
navires, il convient de les remettre aux mains de
gens qui les connaissent, de gens qui aient passé
leur vie sur des bateaux semblables, à des pécheurs et non à des matelots de long cours. Qnant aux
capitaines, il n'est certes pas besoin que leur éducation
se soit faite au delà des tropiques et qu'ils
aient gagné leur brevet d'aspirant à l'École navale.
Réservez les mathématiciens pour vos flottes
cuirassées, donnez vos flottilles à conduire à des
caboteurs, car ce seront des opérations de cabotage
que vous leur demanderez. J'entrevois d'ici, je
l'ai déjà dit bien souvent et je veux cependant le
redire encore, j'entrevois deux marines à l'oeuvre
dans les guerres futures : une marine savante et
une marine essentiellement pratique. La première
gardera le grand chemin des mers, la seconde
tirera parti de cette suprématie dont, avec vos gros
bâtiments, vous êtes inhabiles à obtenir le moindre
avantage. Le siècle de Louis XIV a vu ainsi marcher
côte à côte la marine des escadres et la marine des
brûlots. Ne vous effrayez pas des nouveautés, ces
prétendues nouveautés ne sont la plupart du temps
qu'un heureux retour aux sages idées de nos pères.
N'encombrez donc pas d'un bagage de science
inutile vos flottilles de torpilleurs, de péniches et
de chaloupes canonnières; jetez sans hésiter à la
mer tout ce qui les surchage. Ce sera là une marine
de sacrifices : il n'est pas nécessaire pour y faire figure d'avoir appris le latin, l'anglais, l'histoire,
la géographie, le dessin, la géométrie, la statique,
l'arithmétique, l'algèbre, la trigonométrie rectiligne,
la. géométrie descriptive, la physique, la
chimie, de savoir raconter, dans une composition
de concours, comment « la jeune princesse Rosamonde,
non moins capricieuse qu'agile à la course,
après avoir évincé bien des prétendants malheureux,
fut enfin vaincue et conquise par les ruses d'Abibas. Un pilote qui aura le coeur bien placé, un
bon quartier-maître, encore jeune et alerte, se
trouvera fort à l'aise sur ces barques, où l'existence
serait presque impossible pour un officier qui
aurait passé sa jeunesse sur nos vaisseaux. Toute la
science de l'encyclopédie moderne est à peine suffisante
quand il s'agit de diriger nos léviathans; elle
ne serait qu'une gêne sur des bateaux dont l'appareil
moteur doit être aussi peu compliqué que
possible, et qui, de plus, ne seront jamais appelés,
par le service spécial auquel on les destine, à
perdre la terre de vue.
L'éducation d'un parfait officier coûte cher à
l'Etat : pourquoi donc s'imposer des frais inutiles? La marine des enfants perdus n'a pas besoin de
tant de sollicitude: elle réclame surtout des hommes de métier, durs à la fatigue, insensibles aux intempéries
et indifférents au danger. J'admettrai toutefois
la nécessité de sectionner cette marine, d'en
former des divisions commandées par un certain
nombre d'officiers de haut bord. Il ne saurait être
inutile de rechercher, pour la direction supérieure,
des hommes que leur éducation première et toutes
les habitudes de leur vie aient imbus de longue
date du grave sentiment de la responsabilité. Ma
voix, je le sais, ne crie pas dans le désert; elle a
déjà rencontré plus d'un écho: il ne s'agit donc
que de passer du domaine des utopies à l'exécution.
Encore quelques années, et les flottilles auront
repris leur rang si important sur les mers.
Nous avons vu quels ravages put exercer, pendant
la captivité de Valérien, grâce à la négligence
ou au dépérissement de la marine impériale, une
flottille composée d'environ cinq cents voiles.
Quelques mois à peine après la terrible invasion,
les tribus de la Germanie et de la Sarmatie s'unissaient
aux Goths du Borysthène pour préparer une
expédition bien plus formidable encore. « Les
affaires de l'empire, suivant l'énergique expression
de Hossuet, se brouillaient déjà d'une terrible manière.
Cette époque est celle que les historiens ont désignée sous le nom de période des trente
tyrans: elle ne dura heureusement que quelques
mois.
La plus impardonnable des faiblesses pour tout
esprit qui affiche la prétention de gouverner autre
chose que son foyer consiste à s'exagérer la portée
des épreuves que l'État traverse. « Jamais pareilles
calamités n'ont affligé la république! » s'écrient,
dans leur épouvante, ceux qui n'ont pas feuilleté
les vieilles annales ou qui les ont oubliées. L'écrivain
romain leur répond : « Détrompez-vous! le
sentiment trop vif des maux présents vous égare :
des événements de même nature, des crises tout
aussi graves se sont renouvelés plus d'une fois. Le
mal a passé, etles choses n'ont pas tardé à reprendre
leur niveau. Res in integrum sunt restitutae. »
La situation cependant était vraiment critique en
l'année 268 de notre ère : le fils de Valérien,
l'empereur Gallien, venait d'être tué devant Milan,
pendant qu'il assiégeait un général factieux, le
fameux Auréole; presque au même moment trois
cent vingt mille Barbares, portés, s'il faut en
croire Zonare, par six mille bateaux, construits et
rassemblés à l'embouchure du fleuve que nous
nommons aujourd'hui le Dniester, faisaient à la fois irruption sur les côtes de l'Europe et sur celles
de l'Asie. Rome, la république, comme on
l'appelait encore, était épuisée; elle n'avait plus
de boucliers, plus d'épées, plus de javelots; un
autre usurpateur, Tetricus, était maître des Gaules
et des Espagnes; tous les archers servaient sous
Zénobie. Il fallait un grand homme pour sauver la
situation; le sénat crut l'avoir trouvé: « Claude
Auguste, vous êtes le modèle des frères, des pères,
des amis, des sénateurs et des princes! Claude Auguste, délivrez-nous d'Auréole! Claude Auguste,
délivrez-nous des Palmyréens ! » Auréole, nous
l'avons déjà dit, était ce général dont le triomphe
eût eu la signification d'un ordre d'exil ou de mort
pour la plupart des pères conscrits; quant aux Palmyréens,
leur alliance avec les Perses, les avantages
qu'ils avaient déjà remportés, mettaient en
sérieux péril la domination romaine en Orient.
Claude fut donc acclamé: " Il avait la valeur de
Trajan, la piété d'Antonin et la modération d'Auguste."
Sa première dépêche fut courte: on en
eût difficilement rédigé de plus concluante; en la
lisant, madame de Sévigné aurait cru reconnaître le
style de Turenne. Nous avons, se contenta d'écrire
Claude, détruit trois cent vingt mille Goths, coulé à fond deux mille navires. Les fleuves sont couverts
de boucliers, partout sur le rivage on rencontre des
épées et des lances, les champs disparaissent sous
les ossements dont ils sont jonchés; pas un chemin
qui ne soit encombré par l'immense bagage que
l'ennemi abandonne; nous avons pris tant de femmes
que chaque soldat en a eu pour sa part deux ou
trois."
Exterminés par Claude II, les Goths léguèrent en
mourant la peste aux Romains. Claude « quitta le
séjour des mortels pour celui des dieux, où l'appelaient
ses vertus» ; son frère Quintilius régna
dix-sept jours. Les légions du Danube avaient conféré
la puissance impériale à Aurélien; Quintilius
ne se sentit pas de taille à engager la lutte, il
prévint le sort qui l'attendait en s'ouvrant les veines.
Aurélien était le fils d'un paysan d'Illyrie : les
habitants de la Dalmatie, nommez-les à votre
gré Illyriens ou Serbes, ont montré de tout
temps un très vif penchant et une rare aptitude
pour la guerre. Le « divin Aurélien" prenait le
pouvoir dans des temps difficiles, le sceptre par
bonheur tombait en bonnes mains. Claude le
Gothique buvait peu, en revanche il mangeait beaucoup;
Aurélien possédait à la fois le goût du vin et celui de la bonne chère; il ne montrait de dédain
et d'indifférence que pour les plaisirs de l'amour;
ses repas se composaient surtout de viandes rôties;
son vin de prédilection était le vin rouge. Certains
empereurs aimèrent les histrions, Aurélien préférait
d'autres divertissements. Voir un de ses parasites
dévorer dans un seul repas tout un sanglier, cent
pains, un mouton et un cochon de lait, puis avaler
d'un trait la contenance d'un tonneau, le reposait
des soins qu'il accordait à l'expédition des affaires.
Ce vaillant rejeton d'un rustre de Sirmium reçut
assurément en partage une nature énergique, on
ne dira jamais que ce fut une nature délicate. Les
troupes l'avaient surnommé main de fer. Malheur
au soldat qui dérobait un poulet ou qui détournait
une brebis! Toucher à une grappe de raisin, exiger
indûment de l'habitant chez lequel on logeait, de
l'huile, du bois ou du sel, était aux yeux d'Aurélien
un crime irrémissible; violenter la femme de
son hôle lui semblait, à bon droit d'ailleurs, un
forfait pour l'expiation duquel les supplices habituels
ne suffisaient pas: il en fallait inventer de
nouveaux. Aurélien se montrait sur ce point aussi
ingénieux que féroce.
L'histoire des empereurs est remplie de semblables détails, et c'est toujours ainsi que la victoire
s'annonce. Il rétablit la discipline voilà le
début; la discipline restaurée, il marche sans
crainte à l'ennemi et le met en fuite, voilà le
dénoûment infaillible. Nous avons tué dans un
seu combat mille Francs et mille Sarmates; maintenant
conduisez-nous contre les Perses, nous les
tuerons aussi par milliers : mille, mille, mille et
mille! Cela devait se chanter sur l'air de la Casquette
du père Bugeaud. C'est avec ce refrain de
guerre que l'armée d'Aurélien se mit en marche
pour l'Asie. Aurélien a traversé l'Illyrie et la
Thrace; il passe de Byzance en Bithynie, se porte
sur le plateau du Taurus, s'empare de Tyane et va
recevoir la soumission d'Antioche, le grand marché
syrien, la seule rivale que reconnaissent Rome et
Alexandrie. Quelle activité! quelles marches ! Ces
enjambées rapides sont bien dignes des troupes
qui, sous Septime Sévère, venaient en quarante
jours des environs de Vienne à Rome, parcourant
d'une seule traite une distance de onze cent quatrevingt-
deux kilomètres, faisant, par conséquent, des
étapes de vingt-neuf kilomètres par jour. Près d'Emesse, où Ibrahim-Pacha vaincra un
jour
les Turcs, Aurélien livre bataille à Zénobie, met les troupes de cette reine et celles de ses alliés
en complète déroute, puis, sans perdre un instant,
court assiéger Palmyre. Le siège fut laborieux.
« Point d'espace sur les murs, écrivait Aurélien au
sénat, qui ne soit garni de deux ou trois balistes; des feux même sont lancés sur nous par les machines:
ignes etiam iormentis jaciuntur. » Les
Palmyréens possédaient-ils donc le feu grégeois?
Puisque Palmyre était le grand entrepôt de l'Orient,
et que le feu grégeois est venu avec la poudre à
canon de la Chine, la chose n'aurait rien en soi
d'invraisemblable. Suivant M. Ludovic Lalanne, un
des savants bibliothécaires de l'Institut, la composition
de la poudre de guerre et celle du feu grégeois
étaient identiques. M. Lalanne remarque en
outre que les Romains, du temps de Claudien,
c'est-à-dire les Romains de la fin du quatrième
siècle, connaissaient déjà une poudre d'artifice.
D'où auraient-ils pu recevoir ce secret, si ce n'est
de la Chine? Aussi, entre tous les noms que les
écrivains byzantins donnèrent plus tard au feu grégeois,
trouve-t-on le nom de feu mède: les Mèdes
servirent probablement d'intermédiaires entre l'extrême
Orient et l'empire. Il est hors de doute que
les effets de ce mélange détonant dont le traité de Marcus Graecus, rédigé du neuvième au douzième
siècle, nous a donné la composition, étaient connus
des Chinois plusieurs centaines d'années avant
Jésus-Christ : sous quelle forme les Chinois l'employaient-
ils? Si c'était sous forme de fusées, le feu
grégeois, ce feu magique, qui, suivant la chronique
russe de Nestor citée par M. Lalanne, « fend
l'air avec la rapidité de l'éclair » , était-il autre
chose qu'une fusée s'échappant à grand bruit de
son tube d'airain? Mais les Chinois se servaient
aussi de pots à feu, et, il n'est pas inutile de le
noter, ils s'en servent encore. Une nuit, pendant
que la corvette la Bayonnaise, que je commandais
alors, était mouillée dans la rivière de Canton,
devant le village de Wampoa, une jonque chinoise
fut attaquée presque sous notre canon par les pirates.
La seule approche de nos embarcations mit ces malfaiteurs en fuite, et notre intervention se
borna forcément à recueillir les blessés, que nous
envoyâmes se faire panser à bord de la corvette.
Plusieurs de ces pauvres diables, je crois les
voir encore, avaient le crâne presque à nu; le
cuir chevelu était entièrement brûlé. D'où pouvaient
provenir ces horribles blessures? Les Chinois
nous l'apprirent. En sautant à bord de la jonque, les pirates leur lancèrent toute une bordée de pots
à feu et les atteignirent en plein visage. Le pot à
feu était en 1849 l'arme favorite des pirates de la
province de Canton: ils en faisaient un plus fréquent
usage que du canon.
La composition incendiaire dans laquelle le
soufre entrait pour une partie, le charbon de saule
pour deux, le salpêtre pour six ou pour cinq,
avait beau être connue des Romains et des Byzantins,
qui l'employaient dans leurs représentations
théâtrales, le Moyen Age lui-même ne paraît guère,
jusqu'à la fin du treizième siècle, avoir soupçonné
la puissance de projection dont l'investissait le
mélange décrit par Marcus Graecus et par Albert le
Grand. Les Arabes se servaient de fusées de guerre
en 691 au siège de la Mecque; en 1147, au siège
de Lisbonne; en 1249, contre l'armée de saint
Louis; mais ce n'est pas avant l'année 1300 que le
roi de Tunis et le roi maure de Séville combattront
sur mer « avec des tonneaux de fer lançoant des
tonnerres de feu. Ces tonnerres étaient-ils encore
des fusées? En 1305, Rondaest bombardée par les
Maures; Gibraltar l'est, en 1308, par les Espagnols,
qui se sont approprié l'usage des maquinas de
truenos. En 1311, nous voyons des mortiers figurer au siège de Brescia; en 1326, au siége de Forli;
en 1331, au siège d'Alicante; en 1338, au siège
de Puy-Guilhem; en 1340, au siège du Quesnoy;
en 1370, au siège de Pise. Je laisse de côté les
études de Constantin Anklitzen, en 1256, les expériences
du moine fribourgeois Berthold Schwartz,
qui découvrit, dit-on, vers l'année 1280, les propriétés
explosives de la poudre; je ne parlerai pas
davantage des foudres dirigées en 1343 par les
Maures contre le roi de Castille Alphonse XI, ni
des bombardes placées en 1346 à Crécy, entre les
rangs des archers anglais: je tiens à ne citer que
des faits avérés. Personne, au contraire, ne contestera,
si je suis bien informé, qu'en 1356 le
commerce des canons ne fût devenu à Nuremberg
un commerce courant. On peut vraiment dire,
alors, ce que Pétrarque laissait déjà entendre en
1344 : « L'emploi des vases à feu était rare; il est
aujourd'hui commun. » La France, à cette époque,
ne compte pas seulement parmi ses ofifciers " un
grand maître de l'artillerie"; elle possède aussi
" un capitaine général des poudres". En 1370,
on coule à Augsbourg des bombardes « de fonte
verte » ; celles dont les Vénitiens, en 1380, font
usage contre les Génois, ont un nom qui nous est parvenu: elles s'appellent la Victoire et la Trévisane.
En 1403, on trouve de l'artillerie à bord des
galères castillanes : le fameux corsaire Pedro Nino
jette dans la place d'Oran ses tonnerres, en même
temps que ses artifices de goudron enflammé. En
1412, sous le règne de Charles VI, la Griote fait
pleuvoir sur la ville de Bourges des quartiers de
roche aussi gros que la meule d'un moulin; en
1418, les flottes du royaume d'Aragon suivent
l'exemple des flottes du royaume de Castille; enfin,
en 1515, le grand vaisseau anglais le Henry
Grâce-à-Dieu porte vingt et une pièces de bronze
et deux cents pièces de fer: la marine moderne
est fondée. Ne prolongeons pas cette digression; il
faudrait être Plutarque pour se faire pardonner de
courir ainsi à travers la campagne. A quel propos
d'ailleurs insisterais-je? La question que j'expose
n'a-t-elle pas été cent fois traitée déjà, et de la
façon la plus approfondie? Le général Favé, entre
autres, avec cette compétence qui le met hors de
pair, a pour longtemps, je crois, épuisé le sujet.
M. Lalanne est d'avis que les effets réels du feu
grégeois se bornaient à peu de chose: cette terrible
invention dont les Byzantins firent un secret
d'État, jouait surtout, suivant lui, dans les combats de mer, le rôle d'épouvantail. Aurélien n'était
pourtant pas un homme facile à épouvanter, et
les feux lancés du haut des murailles de Palmyre
paraissent lui avoir causé une assez vive impression.
Grâce à tous ces engins, Zénobie tenait ferme:
ses réponses aux sommations menaçantes que lui
adressait Aurélien étaient aussi fières que son courage.
Elle les faisait écrire en syrien, mais on prétend
que le philosophe grec Longin les dictait ou
les inspirait. Quand Palmyre succomba enfin sous
des assauts vingt fois répélés, la reine essaya de
gagner la Perse en se jetant dans le désert avec ses
dromadaires : des cavaliers lancés à sa poursuite
la prirent de vitesse et la ramenèrent au camp
d'Aurélien. Les soldats réclamaient à grands cris
le supplice de l'illustre captive; Aurélien leur refusa
cette satisfaction : il protégea la vie de Zénobie.
Clémence bien incomplète, car, en même
temps qu'il réservait la reine pour son triomphe,
l'implacable empereur immolait sans le moindre
scrupule à la vengeance de l'armée le rhéteur
Longin.
Le triomphe d'Aurélien fut un des plus magnifiques
dont le spectacle ait jamais été offert à
Rome: on y vit des rennes traînant un char qui avait appartenu au roi des Goths, des éléphants, des
tigres, des girafes, des prisonniers de tous les pays
du monde: Blémyes, Axomites, Arabes, Eudémons,
Indiens, Bactriens, Ibères, Sarrasins, Perses,
Goths, Alains, Roxolans, Sarmates, Francs, Suèves,
Germains et Vandales, marchant deux à deux, les
mains liées derrière le dos, sans compter huit cents
couples de gladiateurs et dix amazones prises les
armes à la main. Toute cette pompe montrait bien
jusqu'où Rome avait porté sa domination sanglante;
elle eût dû rappeler aussi à un peuple enivré
quelles colères, quelles rancunes, devaient couver
depuis des siècles chez ces multitudes qui s'amassaient
lentement autour des frontières de l'empire.
La foule cependant s'étouffait dans la rue Neuve,
sur le marché aux boeufs, dans la halle aux poissons;
elle se pressait non moins dense au forum
d'Auguste et sur la place Trajane. Les sénateurs
s'étaient joints au cortège; l'encombrement fut tel
qu'on ne put arriver avant la neuvième heure au
Capitole.
Est-il nécessaire de le rappeler? entre le Capitole
et la roche Tarpéienne la distance n'est pas grande.
Aurélien, singulièrement attaché à la discipline et
toujours prêt à tirer l'épée, était pour ses familiers d'un commerce difficile. Son propre secrétaire,
Mnesthée, noua contre lui une conspiration : tout
était prêt; Mnesthée n'attendait qu'une occasion
favorable pour mettre à exécution son complot.
Le vainqueur de Zénobie, non content d'avoir
réduit les Palmyréens, voulut aussi assujettir, ou
tout au moins refouler au loin les Perses. C'était
son devoir de général et d'empereur. Il rassemble
une armée formidable et se met de nouveau en
marche pour l'Asie: il ne devait pas même arriver
à Byzance. Un certain Mucapor, soudoyé par Mnesthée,
assassina le vainqueur de Palmyre dans une
bourgade obscure, à mi-chemin de Byzance et
d'Héraclée. « Ainsi finit, dit son historien, ce prince
plus utile que bon. « C'est déjà quelque chose,
quand l'empire tremble sur sa base, d'être un prince
utile. Aurélien régna six ans moins quelques jours.
Au temps où il vivait, pareille fortune pouvait
compter pour un long règne.
Le sénat et le peuple mirent six mois à le remplacer:
jamais conclave ne fut aussi long à prendre
une résolution. On cherchait, on hésitait; on
eût voulu trouver un empereur sans défaut. Les
soldats demandaient un prince au sénat, le sénat
renvoyait ce choix à l'armée. « Songez donc enfin à vous décider! disait très sensément le consul de
Rome; croyez-vous que le monde puisse se passer
de maître? Nommez à tout hasard un empereur :
l'armée ratifiera votre élection, ou elle en fera une
autre. » Sur cette injonction, qui eût pu prendre
bientôt l'accent de la menace, un sénateur, Tacite,
se préparait à émettre son avis: on lui
ferma la bouche. Que les dieux vous protègent
Tacite! c'est vous que nous faisons empereur.
Mais je suis un vieillard, protestait le malheureux. Regardez ces bras: les croyez-vous de force à lancer
un javelot, à brandir une lance, à soutenir le
poids d'un bouclier? Serai-je même capable de
monter à cheval, de donner l'exemple aux soldats?
C'est à peine si je puis encore remplir mon devoir
de sénateur. Tacite, c'est la tête et non le corps
qui commande; c'est votre âme et non votre corps
que nous voulons élire : les soldats combattront
pour vous; il suffira que vous leur ordonniez de
combattre.
Tacite avait soixante-dix ans quand il fut élu
empereur. Il s'était enfui à Baïes, dans l'espoir d'éviter
le périlleux honneur qu'on lui décernait : les
sénateurs allèrent le chercher à Baïes, le ramenèrent
à Rome et le présentèrent aux troupes. Le respectable vieillard, souverain malgré lui, harangua
les soldats qui déjà l'acclamaient. « Mes chers
camarades, leur dit-il, je ferai mon possible pour
répondre à votre confiance: si je ne puis vous promettre
de brillants faits d'armes, je vous donnerai
du moins de bons conseils. » Il les donna six mois,
ces conseils, aussi sages, aussi prudents qu'on
pouvait les attendre de son expérience; puis, découragé
par la persistance incorrigible des factions,
il mourut. S'il fût parvenu à se soustraire au
fardeau dont on l'accabla, il aurait probablement
prolongé ses jours jusqu'à une grande vieillesse
les excès de table ne les auraient cerlainement pas
abrégés, car Tacite était un homme sobre et d'habitudes
très simples. Sept litres de vin par jour,
des légumes en abondance, des laitues surtout,
" qui, disait-il, le faisaient dormir", un chapon,
une hure de sanglier et des oeufs à son principal
repas, il ne lui fallut jamais davantage. Le
plus marquant, le plus utile des actes par lesquels
Tacite signala son passage au pouvoir fut l'ordre
de déposer dans toutes les bibliothèques les oeuvres
de l'illustre historien dont il prétendait descendre,
et d'en dresser chaque année dix copies. Si tous
les hommes de lettres dont les ouvrages ne sont point arrivés jusqu'à nous avaient eu dans leur famille
un empereur, les annales de l'antiquité et
l'histoire de l'esprit humain présenteraient probablement
moins de lacunes.
Je m'écarte trop de mon sujet: que me font, après
tout, ces souverains qui ne se sont jamais occupés
de marine? Trajan, du moins, s'embarqua sur le
Tigre, Vespasien navigua sur le lac de Génésareth,
mais Probus ! où sont les médailles qui nous parlent
de ses exploits sur mer? A-t-il jamais eu le droit
d'accoler à son effigie une Victoire montée, comme
celle de Vespasien, sur la proue d'un vaisseau?
Probus n'a point à son dossier de semblables triomphes;
tout fait présumer cependant que, s'il eût
vécu, il eût donné ses soins à l'extension du commerce
maritime. Qu'aurait-il, sans cela, pu faire
de son activité? Probus ne savait honorer que le
travail : jamais il ne consentit à laisser ses troupes
oisives. Le soldat, disait-il, ne doit pas être nourri
pour rien. » Aussi employait-il l'armée, quand il
eut repoussé les Sarmates et les Francs, à creuser
des canaux, à dessécher des marais, même à planter
des vignes. Les vins de Bourgogne et de Champagne
en France, ceux de Tokay en Hongrie, lui
doivent, au dire de Casaubon, leur existence. Est-il beaucoup d'empereurs, même en Chine, qui aient
élevé, pour tenir les Barbares en respect, des murailles
d'un développement de trois cent vingt-deux
kilomètres? Probus appuya un des côtés de son
mur, fortifié par des tours, au Danube, l'autre
côté au Rhin. Il eût peut-être mieux fait de prêter quelque attention à sa flotte; les Francs n'auraient
pas, pendant qu'il restait campé dans la Pannonie,
saccagé la Sicile et pillé Syracuse.
Cet empereur, « qui ne voulait pas nourrir le
soldat pour rien, méditait, assure-t-on, dans le
secret de sa pensée intime, le licenciement d'une
armée qu'il croyait avoir rendue à peu près inutile.
Pour son malheur, il laissa pénétrer trop tôt son
dessein, encore quelques années d'efforts, s'était-
il écrié un jour, et la république n'aura plus
besoin de soldatsl. Les soldats, mécontents, le
tuèrent dans la cinquième année de son règne. Il
avait, comme nous l'avons dit plus haut, refoulé de
tous côtés les ennemis de Rome, repris la Gaule
sur les Germains, dompté en Illyrie les Sarmates,
accablé Saturnin dans l'Orient, Proculus et Bonose,
tous rebelles, à Cologne. Le nombre des guerres
qu'il a faites dans toutes les parties du monde est
si grand qu'on s'étonne qu'un seul homme ait pu se trouver à tant de batailles. Probus a payé de sa
personne en soldat dans une foule de circonstances,
et sous lui se formèrent d'excellents généraux qui
purent, jusqu'à un certain point, consoler les
Romains de sa perte. Ce grand et honnête empereur
introduisit pourtant, à son insu, dans un empire
déjà rongé au coeur, le premier germe de la
dissolution finale: en obligeant les nations vaincues
à fournir à l'armée romaine un contingent de
seize mille hommes, qu'il distribua par fractions
de cinquante ou soixante dans les troupes nationales,
Probus ruina d'un coup l'édifice vermoulu
des vieilles institutions militaires. Probus ne faisait
cependant qu'imiter sur ce point Alexandre: la
même fatalité s'impose à tous les conquérants,
à toutes les nations qui ont exclusivement grandi
par la guerre. Napoléon avait un corps d'armée
saxon à Leipzig: n'eût-il pas mieux valu, et pour
lui et pour nous, qu'il mît en ligne trente ou quarante
mille hommes de moins? La Turquie ne pouvait plus vivre avec les janissaires : son démembrement
a commencé le jour où les sultans ont
anéanti cette inquiète milice. Les citoyens de Rome
avaient seuls, dans le principe, le droit et le devoir
de défendre la patrie; on commença par leur adjoindre des affranchis et bientôt des esclaves ;
quand on leur eut associé des barbares, l'honneur
qui s'attachait au noble métier des armes en demeura
subitement amoindri, Il est souvent indispensable,
il n'est pas toujours sans danger de créer
une armée coloniale, la force matérielle et la vigueur
morale peuvent facilement passer du côté
de ces troupes dans lesquelles on n'a voulu chercher
que des auxiliaires.
FONDATION DE L'EMPIRE BYZANTIN.
La transformation militaire accomplie par Probus touchait aux parties vitales de l'empire : aussi fut-elle le signal d'une refonte générale des institutions; " de républicain qu'il était, l'empire ne tarda pas à prendre la forme résolûment monarchique". Dioclétien employa ses vingt et une années de règne à opérer et à consolider cette réforme. Dioclétien est le favori de Gibbon; ce n'est pas celui de Bossuet. Toute indignation religieuse à part, j'inclinerais fort à me ranger ici à l'avis du grand évêque de Meaux: le persécuteur des chrétiens me paraît avoir, dans son rigorisme impérial, bien mal apprécié son devoir. Verser un sang si pur pour retarder de moins d'un quart de siècle le triomphe d'une cause qui, dès cette époque, pouvait invoquer en sa faveur la justice et le nombre, constitue tout au moins une impardonnable erreur politique. La suprême puissance est tenue d'avoir la vue plus perçante et de ne pas se méprendre à ce point sur la direction du courant. La rapide diffusion de la croyance nouvelle indiquait aux yeux les moins clairvoyants un besoin social d'une irrésistible puissance. En appelant à son aide le Dieu des chrétiens, Constantin s'assura les voeux et le concours de tout ce qui avait, dans celte société romaine si mal équilibrée, à se plaindre de son sort. La situation ne comportait pas de demi-mesures; en quelques jours, la défaite du passé fut complète: la concentration de pouvoirs réalisée par le génie organisateur de Dioclétien aida singulièrement d'ailleurs à la rendre définitive. Le nouveau système politique et la nouvelle foi religieuse s'adaptaient merveilleusement l'un à l'autre; la croyance en un seul Dieu semblait pour ainsi dire justifier la soumission absolue à un seul maître. Telle sera la double formule de l'empire entré dans sa seconde phase. Nous trouvons Constantin " ballotté d'âge en âge entre Marius et César". « Comparable aux meilleurs princes dans les commencements de son règne, dit Eutrope, il ressembla aux plus médiocres dans ses dernières années. » « S'il adopta la religion chrétienne, nous assure Zosime, c'est parce que, meurtrier de son fils et de sa femme Fausta, il lui fallait une religion qui eût des pardons pour tous les crimes (1). « «Il ruina l'empire, ajoute ce païen invétéré. «Il le sauva plutôt", prononcera tout juge impartial. En se mettant d'accord avec l'esprit de son temps, au lieu de s'obstiner à vouloir lui faire rebrousser chemin, Constantin put donner au pouvoir qu'il avait conquis une base plus solide que l'assentiment capricieux de quelques légions : il régna sur le peuple par le peuple. Son règne de trente ans est là pour affirmer la sagesse mondaine de ses préférences religieuses. Néanmoins, lorsqu'à l'âge de soixante-six ans, l'empereur Constantin termina, dans les faubourgs de Nicomédie, une vieillesse plus chagrine et plus sombre encore que celle de Louis XIV, la cause du christianisme n'était qu'à moitié gagnée: la frivole entreprise du dernier rejeton de Constance Chlore scella pour un éternel avenir le triomphe du Galiléen.
(1) Il paraît très douteux cependant que l'impératrice Fausta ait précédé son mari dans la tombe. Gibbon fait remarquer que deux oraisons prononcées sous le règnede Constance semblent décharger la mémoire du premier empereur chrétien d'un des deux meurtres au moins qui lui sont imputés.L'une de ces oraisons célèbre la beauté, la vertu et le bonheur de l'impératrice Fausta; l'autre affirme que la mère du jeune Constantin,qui fut tué trois ans avant la mort de son père Constantinle le Grand, vécut pour pleurer la perte de son fils .
L'apostasie
de Julien eut un résultat diamétralement opposé à
celui qu'il en attendait : elle affermit le peuple
alarmé dans sa foi hésitante.
On peut jusqu'à un certain point comprendre le
désir qu'éprouva Julien de ranger de nouveau les
aigles romaines sous la protection de ces dieux
superbes qui leur avaient jadis donné l'empire du
monde; mais Julien, si épris qu'il pût être de la
grandeur de Rome, n'avait que le nom de Romain:
son coeur et son esprit étaient grecs. Comment ce
doux rêveur, incliné par les malheurs publics et
par ses longues adversités personnelles au mysticisme
des Alexandrins, eût-il pu ranimer des passions
étroites et farouches qu'il ne partageait pas?
Sa nature répugnait aux brutales manifestations de
la force, sa conduite et ses moeurs étaient une
protestation constante contre l'injustice des temps
qu'il voulait faire renaître. S'il ne fut pas chrétien,
Julien, à tous les titres, se montra digne de l'être.
Aussi devons-nous regretter qu'il ait usé ses forces
et ses facultés admirables à une oeuvre qui ressemble
de loin à une fantaisie d'archéologue. On ne réagit pas contre les grands mouvements de l'esprit
humain.
Voici donc l'empire byzantin fondé. Cet empire,
avouons-le, a de tristes annales. La ligue achéenne,
la Rome des derniers Césars, gardaient encore,
comme les vieillards d'Homère, je ne sais quoi
d'auguste et d'imposant qui les faisait respecter
dans leur décrépitude; ici ce ne sont pas des vieillards,
ce sont de vieux enfants que nous voyons
prolonger, par mille artifices, une existence précaire
et sans dignité. L'empire romain, lorsqu'il
eut été partagé entre les deux fils de Théodose,
n'exista plus en réalité que par ses deux capitales :
Constantinople et Ravenne. La mer baignait alors
les remparts de l'une et de l'autre ville; dans leurs
plus mauvais jours, la mer les préserva d'un investissement
complet. Sans cette ceinture, qu'on ne
saurait trop bénir, la civilisation aurait manqué
d'asile contre l'épée des Barbares; l'oeuvre des
siècles, une fois le flot passé, eût été à reprendre
jusque dans ses fondements. Nous devons donc
quelque reconnaissance aux flottes du Bas-Empire,
bien que ces flottes aient, comme les honnêtes
femmes, très peu fait parler d'elles.
La marine, qui compta dans ses rangs la tessaracontère de Ptolémée, s'est évanouie à la bataille
d'Actium; ni Constantin, ni Théodose, ni l'empereur
Léon ne la feront revivre: ils se contenteront
d'armer des triacontores, des liburnes, des
dromons, si même ces galères ne leur paraissent
encore trop lourdes. L'ère des flottilles est alors
dans son plein; c'est avec une flottille déjà que
Seplime Sévère s'emparait de Byzance; avec une
flottille aussi que Constantin va faire la guerre à
Licinius. Les gros vaisseaux, cependant, ne lui
manquaient pas: il se souvint à temps que la flotte
de son adversaire avait péri en partie sur les côtes
de l'Hellespont parce qu'elle se composait de navires
peu maniables. Cent trente vaisseaux, poussés
par le vent du midi, allèrent, sans que tous les
efforts de la chiourme réussissent à les écarter du
rivage, se briser sur les rochers, et cinq mille
hommes trouvèrent, en cette occasion, la mort
dans les flots. Fort affaibli par un si grand
désastre, Licinius s'était retiré à Chalcédoine;
Constantin se disposa sur-le-champ à l'y attaquer,
il se garda bien cependant d'exposer ses pesants
transports et ses quinquérèmes aux surprises que
pouvait leur réserver la côte de Bithynie : il fit
construire à la hâte des bàtiments plus légers et y embarqua ses troupes. A vingt milles de Chalcédoine,
cité considérable sur l'emplacement de laquelle
est bâti aujourd'hui le village de Kadikeui,
se projette en mer, formant un des côtés du Bosphore
de Thrace, à l'endroit où ce canal débouche
dans le Pont-Euxin, un promontoire qu'au temps
des Romains et des Grecs on appelait le promontoire
Sacré: l'armée de Constantin, insouciante
désormais des échouages, y prit terre. Elle n'eut
qu'à sauter sur la plage pour se trouver, sans
désordre, sans manoeuvres, rangée du même coup
en bataille. Les anciens nous auraient donné des
leçons pour l'exécution de ce mouvement difficile :
tout les y préparait, des exercices constants et une
habitude journalière. « Les matelots, de la proue,
les proyers (npopazai), dit un vieux traité de tactique
navale retrouvé par le docteur Charles Müller
dans la bibliothèque Ambrosienne de Milan ,
montent à bord les derniers quand l'équipage
s'embarque ; ils sont en tête quand on descend à
terre. » "Il importe, ajoute l'auteur du précieux manuscrit
auquel nous aurons plus d'une fois recours, de débarquer toujours en bon ordre et de façon à
pouvoir se former rapidement en phalange.
Licinius manda sur-le-champ
à son aide Martinien, son principal lieutenant, qu'il
avait laissé à Lampsaque, harangua ses troupes et
leur promit de les conduire à l'ennemi en personne.
Il y eut, au rapport de Zosime, un rude
combat livré, en l'année 324 de notre ère, entre
Chalcédoine et le promontoire Sacré. J'ai visité ces
lieux, et je sais qu'entre Kadikeui et l'éminence qui
porte encore les ruines d'un vieux château génois,
il existe en effet un superbe champ de bataille,
terrain accidenté qui se prête admirablement aux
manoeuvres d'une bonne infanterie. Gibbon, d'après
l'autorité d'Eusèbe, reporte plus à l'ouest le lieu de l'action; la bataille décisive se donna, suivant
lui, sur les hauteurs de Chrysopolis, aujourd'hui
Scutari. Que ce soit le comte du cinquième
siècle ou l'évêque du quatrième qui, en cette
affaire, ait raison, il n'en reste pas moins établi
que l'armée de Constantin, composée en majeure
partie de vieux soldats des Gaules, remporta sur
les troupes moins aguerries de son adversaire un
éclatant avantage. De cent mille hommes que Licinius
venait de mettre en ligne, trente mille à peine
échappèrent au fer de l'ennemi. Les habitants de
Byzance tenaient encore pour Licinius : après une
telle victoire, il ne leur restait plus qu'à ouvrir
leurs portes au vainqueur. Constantin entra dans
Byzance et en fit, dès ce jour, la capitale du
monde. La ville aux sept collines était découronnée;
l'empire latin faisait place à un empire grec: il ne
faut pas s'étonner que cet empire nouveau soit
redevenu un empire marin.
LES PILOTES AU CINQUIÈME SIÈCLE DE NOTRE ERE.
C'est surtout en marine que l'on peut vraiment dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouvrez le livre du Père Fournier, aumônier du vaillant archevêque de Sourdis dans la campagne de 1642, et auteur fort apprécié en son temps de l'Hydrographie de la mer (1) essayez ensuite de déchiffrer les feuillets incomplets du manuscrit byzantin que vient de découvrir l'infatigable érudition du docteur Charles Millier et de traduire pour la première fois en langue moderne un savant professeur de Livourne, le chevalier Francesco Corazzini, vous retrouverez dans les deux ouvrages les mêmes idées, bien souvent exprimées d'une façon identique.
(1) George Fournier,prêtre de la Compagniede Jésus,né à Caen en 1595, mort à la Flèche le 13avril 1652, a laissé,entre autres ouvrages,un précieux in-folio intitulé : l'Hydrographie,contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de lanavigation. Paris, 164
Le manuscrit de Milan date cependant,
tout le fait présumer, du cinquième
ou du quatrième siècle de notre ère. La
charge du pilote, nous dit le Père Fournier, est de
donner la route et d'éviter les écueils. Il est
toujours le second officier, pour l'honneur des
sciences qu'il professe. Dans un bon vaisseau il
faut deux pilotes, outre celui de la route, qui doit
connaître parfaitement le ciel et bien faire les
observations. Si par faute du pilote un vaisseau
du roi périt, le pilote est infailliblement pendu. »
« Il est absolument nécessaire, proclame de son
côté l'écrivain grec, dont le nom ne nous est
malheureusement pas parvenu, que le stratège ait
à ses côtés un homme bien au courant des mers
dans lesquelles la flotte navigue, ou vers lesquelles
on suppose qu'elle pourra se diriger. Cet homme
doit connaître les vents qui soulèvent la mer du
large et ceux qui soufflent généralement de terre,
les écueils, les brisants, la configuration des côtes,
les îles qui les avoisinent, les ports et les distances
comptées d'un port à l'autre, les ressources du
pays, ainsi que les aiguades. Ce n'est pas seulement
sur le vaisseau du stratège qu'il convient de mettre un de ces hommes pratiques; chaque vaisseau
est tenu d'avoir également son pilote, car la
tempête peut disperser la flotte, et le capitaine
séparé du stratége serait dans l'embarras s'il lui
fallait aller chercher seul un abri. »
L'importance des pilotes s'est perpétuée à travers
les âges, et c'est seulement de nos jours qu'on
a pu croire un instant que la perfection de nos
cartes, l'instruction supérieure de nos officiers, les
notables progrès apportés dans nos méthodes de
navigation allaient rendre à peu près superflu le
recours à ces hommes pratiques dont la science
ne s'étend guère au delà des limites d'un horizon
fort borné. On est bien revenu aujourd'hui de cette
illusion : pour se passer des services d'un pilote,
les meilleures cartes ne sauraient suffire; il faudrait
être un pilote soi-même. Le contre-amiral Bouvet,
le célèbre capitaine de la Minerve, de l'Iphigénie et de l'Aréthuse, voulait que « nul ne pût
être admis à faire partie du corps des officiers de
la marine royale, s'il n'était en état de répondre
d'une manière satisfaisante à un examen sévère
sur la pratique des côtes de France, l'entrée des
ports, les sondes des passes et des baies, les mouillages,
etc. Je m'associerais volontiers à ce voeu, dont personne mieux que moi n'apprécie l'immense
intérêt. Y pourrait-on pourtant de bonne foi satisfaire
sans alléger, d'autre part, des mémoires et
des intelligences qui succombent déjà sous le fardeau
de jour en jour plus pesant qu'on leur
impose?
La marine espagnole, la première marine européenne
qui ait, avec la marine portugaise, constitué
de grandes flottes marchandes pour l'exploitation
du commerce d'outre-mer, s'en était
rigoureusement tenue aux pratiques de l'antiquité.
A côté du commandement militaire elle plaçait et
multipliait les conseillers chargés de diriger la
route. La casa de contratacion chambre de
commerce de Séville payait fort cher et sans
marchander ses pilotes, ainsi que le font d'ailleurs
de nos jours nos grandes compagnies maritimes.
En retour, elle exigeait d'eux une instruction complète,
instruction attestée par les plus sérieux
examens. Si cela était bien gardé, observe avec
raison le Père Fournier, on ne verrait tant de naufrages
comme l'on voit, plusieurs se croyant assez
capables, lorsque pour trois ou quatre bouteilles
de vin d'Espagne, ils ont obtenu leurs lettres de
pilotes et croient qu'ils ont une suffisante excuse lorsqu'ils se voient échoués par leur ignorance, de
dire que c'a été par non-vue ou par des courants
de mer inconnus. »
L'aspirant pilote espagnol devait adresser sa
requête au pilote-major de la casa de contratacion,
Ce pilote, en l'année 1585, s'appelait le senor
Alonso de Chiavez. Les aspirants pilotes ne comparaissaient
devant lui qu'avec terreur. Il leur fallait
d'abord établir par des pièces probantes qu'ils
étaient nés dans les royaumes d'Espagne, qu'ils
n'avaient dans les veines ni sang nègre ni sang
moresque ou juif. Cette preuve faite, le pilote major
les admettait à produire les attestations de
cinq ou six pilotes jurés, constatant que le candidat
était bon marin et suffisamment instruit dans le
pilotage; puis, après avoir bien examiné, bien pesé
leurs certificats, il les livrait au professeur de
navigation, le senor Rodriguez Zamorano. Ce dernier
se chargeait de parfaire en deux mois une
éducation déjà si avancée. Au bout de deux mois
de leçons et d'exercices, les candidats sont appelés
devant la commission d'examen, commission présidée
par le pilote-major et qui ne compte pas moins
de vingt-cinq membres, tous pilotes jurés.
« Sur quelle partie des Indes voulez-vous être examiné? demande au candidat le président. Est-ce
Nombre-de-Dios, sur Saint-Domingue, sur Puerto-
Rico, sur Cuba? » Le futur pilote doit avoir fait
son choix à l'avance, car il ne saurait prétendre à
exercer les fonctions difficiles auxquelles il aspire
dans toutes les mers qui baignent les vastes possessions
de Sa Majesté Catholique; il s'offre à prendre
la conduite du vaisseau pour tel ou tel voyage,
et non pas pour une traversée indéterminée. Le
pilote-major prend acte de sa déclaration, et, lui
montrant du doigt une carte marine étendue sur la
table: « Partez de San Lucar, lui dit-il, et faites
route pour les Canaries; des Canaries, rendez-vous
aux Indes; revenez ensuite des Indes en Espagne
et ramenez votre vaisseau à l'entrée du Guadalquivir.
» Des mains du pilote-major, le patient,
sans avoir le loisir de reprendre haleine, passe
successivement sous la férule des vingt-cinq autres
pilotes. L'un lui demande: " Si, dans le cours
de votre navigation, il survient du gros temps et
un vent contraire, quelles précautions prendrez vous
pour diminuer la fatigue du navire? » Un
autre l'interroge « sur les règles du soleil et de
l'étoile polaire, sur la manière d'employer la déclinaison du soleil à toutes les époques de l'année"
; un troisième veut entendre la description
complète des côtes et des amers qui se trouvent
sur la route, depuis le point de départ jusqu'au
point d'arrivée. Les questions peu à peu se pressent
et se compliquent : ce n'est plus un aspirant
pilote, c'est un apprenti capitaine qu'on semble
examiner. «Si une tempête vient à briser vos mâts,
que ferez-vous? Si une voie d'eau se déclare? Si
le gouvernail est démonté?» Pour être reçu pilote,
il faut avoir réponse à tous ces incidents. «Un bon
pilote, dit le Père Fournier, fait à dessein son
estime toujours plus grande qu'il ne se persuade
qu'elle est. Par exemple, s'il croit que son vaisseau
a fait deux lieues par heure, il comptera demiquart
de lieue davantage, aimant mieux être vingt
lieues en arrière que trop tôt en avant, de peur de
se trouver à terre et en danger de se perdre,
croyant en être encore bien loin. S'il faut doubler
quelque cap la nuit ou durant la brume, il prendra
toujours un demi-quart de vent plus vers l'eau
pour éviter la terre, ou, si quelque marée portait
dessus, prendra toujours un rhumb tout entier,
plus ou moins, suivant la violence des marées. En
temps de brume, il ne marchera que la sonde en la main, car la sonde, à proprement parler, appartient
au pilote, et son devoir est d'avertir le maître
de mouiller quand il juge à propos. » Les pilotes
espagnols étaient payés par voyage et proportionnellement
au tonnage du navire dont ils avaient
pris charge. Pour un bâtiment de 100 tonneaux,
leur salaire était fixé à 200 ou 250 ducats, à 400
ou 500 si le tonnage atteignait un de ces deux
chiffres.
La marine française possède depuis quelques
années une institution précieuse : l'institution des
pilotes d'arrondissement. La conception première
de cette création si utile remonte à l'année 1855;
l'honneur de l'avoir présentée sous une forme
immédiatement réalisable et pratique revient tout
entier à un officier général éminent, M. le vice amiral
Pellion, qui était alors préfet maritime à
Brest. Ces pilotes d'arrondissement ne sont en
aucune façon des pilotes hauturiers comme l'étaient
ceux de la casa de contratacion de Séville: ces
derniers n'ont guère d'analogie qu'avec les masters
de la marine anglaise. Les anciens pilotes espagnols
et nos pilotes actuels d'arrondissement ont
cependant un trait commun qui les rapproche :
leur spécialité ne s'étend qu'à une portion bien déterminée des côtes. Nous revenons insensiblement,
on le voit, aux traditions du Moyen Age et
à celles de l'antique monarchie. Tel pilote est
déclaré apte à conduire un vaisseau de Rochefort
à Brest, tel autre s'en chargera pour la traversée
de Brest à Dunkerque. Sa présence à bord ne dispense
pas cependant le capitaine de recourir, en
certaines circonstances, aux services d'une autre
classe de pilotes, sorte de micrographes qu'on
appelle les pilotes lamaneurs. Ceux-là ne sont tenus
de posséder que la connaissance approfondie d'une
étendue de mer très restreinte, d'une entrée de
port ou de rade, d'un goulet, d'une passe, d'un
canal. Ils distinguent les roches à leur aspect
et à leur gisement; au besoin, si la brume survenait,
ils les reconnaîtraient à leur voix, car, pour
ces oreilles exercées, toutes les roches ne rendent
pas le même son sous la vague qui les bat: les
unes ont un mugissement sourd et caverneux, les
autres répercutent un son clair, comme l'écho
lointain du canon. Ce n'est pas dans les livres que s'apprennent ces distinctions subtiles, et voilà pourquoi
le pilote, malgré toute notre science, n'a pas
cessé d'être en mainte occasion un des rouages les
plus indispensables de la grande machine navale. La vapeur, avec les vitesses prodigieuses qu'elle
permet, je serais presque tenté de dire qu'elle
impose, ne nous laisse guère le temps de recourir,
comme nous le faisions autrefois, à nos cartes, à
nos compas, à nos rapporteurs. Fixer sa position
à l'aide de relèvements pris à la boussole ou d'angles
observés au sextant était bon pour le navigateur
à voiles qui s'en allait d'un pas tranquille et lent à
son but: quand on dévore l'espace, il faut avoir
pour se diriger de bons alignements gravés dans la
mémoire, des l'un par l'autre, disait, dans son
langage pittoresque de vieux marin breton, le brave
amiral Tréhouart. Aussi, lorsqu'un de mes voeux
les plus opiniâtres se trouva heureusement accompli,
lorsque je pus saluer d'une approbation joyeuse
la création des pilotes d'arrondissement, ne me
tins-je encore que pour à demi satisfait. Je réclamai
avec la même énergie l'extension de cette institution
si utile, si remplie d'avenir, à nos stations
extérieures. Je voulais que, dans toutes les mers
où nous entretenons des divisions navales, on s'occupât,
sans s'arrêter aux frais, de constituer sur un
des navires de la station un véritable dépôt de pilotes
français que j'appelais à dessein, pour les bien distinguer
des pilotes lamaneurs du pays et pour spécifier en quelque sorte leur rôle, des pilotes militaires, j'aurais volontiers dit des pilotes à responsabilité
limitée. Cette institution nous eût, à bref
délai, donné un avantage immense sur les marines
étrangères, qui ne se seraient pas hâtées de nous
imiter. Plus le théâtre des opérations eût été dangereux,
plus la chance de primer nos adversaires
de manoeuvre aurait eu de probabilité et de prix.
Trouver, en quelque lieu que nous nous présentions,
ces pilotes d'arrondissement qui nous rendent sur nos côtes de si grands services, voilà ce
que j'ambitionnais. Avais-je tort? N'allais-je pas
m'exposer au risque, quelques-uns de mes contradicteurs
l'appréhendaient, de faire désapprendre
à nos officiers la partie la plus sérieuse du
métier, de les affranchir du soin de la route et de
les réduire si bien à des fonctions purement militaires
qu'au bout de quelque temps on ne rencontrerait
plus sur nos vaisseaux que des soldats?
Devant un tel péril, je m'explique aisément qu'on
ait reculé. Aujourd'hui, on doit s'être convaincu que
la crainte était chimérique. Les pilotes d'arrondissement
ont gagné haut la main leur procès; les
pilotes militaires n'auraient pas eu longtemps à
plaider le leur. S'il y eût eu danger d'amollisssement pour nos capitaines trop bien secondés, le
remède n'était-il pas facile? Il fallait leur inculquer
de bonne heure, comme le demandait l'amiral
Bouvet, le goût du pilotage. Pilotes eux-mêmes,
ils n'auraient jamais songé à laisser à d'autres
le soin de les conduire; ils se seraient bornés à
consulter ces hommes familiarisés de longue date
avec des parages qu'ils abordaient eux-mêmes
pour la première fois; ils les auraient, la circonstance
exigeant un surcroît de précautions, envoyés
la nuit au bossoir. Un pilote sait veiller; il sait
reconnaître au premier coup d'oeil la portée de l'indice
qui vient à frapper sa vue; mais quand vous
prenez un de ces braves gars de la Normandie ou
de la Bretagne qui, hier encore, avait en main le
timon de la charrue, et que vous lui criez: Ouvre
l' oeil au bossoir ! vous faites sans vous en douter du
fatalisme. Ce ne sont pas seulement les idoles des
Philistins qui ont des yeux pour ne point voir. Un
capital de 20 ou 25 millions de francs, lancé à
toute vitesse dans la nuit obscure, se trouve sous
la garde d'un Argus qui n'aura de sa vie aperçu un
brisant, ou que la rapide et soudaine approche d'un
navire, émergeant tout à coup des ténèbres, paralysera. Il y a des siècles que nous n'avons fait une guerre
maritime; si le souvenir de ces opérations qui
exigent tant de veilles, entraînent tant de fatigues,
n'était complètement effacé de nos mémoires, on
songerait un peu plus à laisser au chef militaire
toute sa liberté d'esprit, à lui épargner les soins
secondaires du pilotage, ne fût-ce que pour ménager
son sommeil et ses forces. L'amiral Roussin
m'a souvent conté qu'embarqué dans les mers de
l'Inde sur la frégate la Sémillante, que commandait
alors le capitaine Motard, il avait pu juger de l'effet
désastreux que le corps surmené peut exercer sur la machine morale et intellectuelle. Trois fois la
Sémillante avait rencontré des frégates anglaiscs,
trois fois elle les avait battues : pour obtenir une
victoire complète, pour réaliser la capture imminente,
il n'eût fallu qu'insister sur le premier avantage,
que reprendre le combat le lendemain. Les
anxiétés de la nuit, la privation de sommeil avaient
le lendemain transformé le capitaine héroïque ;
toute son ardeur s'était évanouie, il demandait
moins la victoire que le repos."« La Dédaigneuse et la Terpsichore ont dû, m'a souvent répété l'amiral
Roussin, leur salut à la lassitude trop facile à
comprendre de notre admirable commandant." L'amiral aurait pu ajouter que, dans le dernier
engagement, celui qui eut lieu le 16 février
1808, le capitaine Motard avait été blessé à la
tête et à l'épaule. « L'activité déployée par le capitaine
Motard dans ses croisières, écrivait de son
côté le célèbre hislorien de la marine anglaise,
William James, l'habileté remarquable dont il fit
preuve lorsqu'il lui fallut traverser avec sa frégate
les canaux les moins connus et les moins explorés
des mers de l'Inde, sont au-dessus de tout éloge. »
, Si actif, si habile marin qu'on puisse être,
quand l'effort se prolonge, on succombe infailliblement
à la peine. Des capitaines ont voulu se passer
dans l'Archipel grec de pilotes, sous prétexte qu'ils
étaient de force à en remontrer à tous les pilotes
de Milo. Leur confiance n'avait certes rien de présomptueux,
l'opinion qu'ils entretenaient de leur
savoir n'était pas exagérée. Seulement, comme ils
ne pouvaient passer la nuit et le jour sur le pont,
dormir sur le gaillard d'avant enveloppés dans le
traditionnel caban du pilote, il leur est arrivé plus
d'une mésaventure, et l'on a vu échouer sur les
bancs de l'Hermus, à l'entrée même de la baie de
Smyrne, un brick qui avait cependant pour capitaine
le meilleur officier de la station du Levant. Je n'aurais pas moi-même talonné avec le Furet
sur les roches de la baie de Cadix si je n'avais imprudemment
refusé les services du pilote venu à
notre rencontre.
Je le répète donc, puisque l'antiquité elle-même
m'y convie : « Il est absolument nécessaire que le
stratège ait près de lui des gens qui connaissent les
parages dans lesquels il navigue aussi bien que ceux
vers lesquels il pourra se diriger » Les officiers
qui ont pris part aux croisières de l'année 1870
sur notre escadre de la mer du Nord ou sur celle
de la Baltique seront unanimes, je pense, à reconnaître
la sagesse de ce conseil.
LES NAVIRES ÉCLAIREURS.
Toutes les institutions du monde ne remplaceront
pas le génie militaire; c'est le caractère du chef
qui remporte avant tout la victoire. La même
marine donnera des résu ltats très différents, quand
ce sera un d'Orves ou un Suffren qui tiendra le
gouvernail. Néanmoins le propre des institutions
est de permettre à la médiocrité même de faire
encore assez bonne figure: sur le trône, si la fortune
l'appelle à régner; sur le champ de bataille,
si le sort lui donne des armées à conduire. Il ne
faut pas, autant que possible, rendre l'intervention
du génie nécessaire, car le génie fut rare en tous
les temps.
Je viens d'exposer les immenses avantages que
présenterait une forte et complète constitution du
pilotage: la sécurité d'une grande flotte ne serait
cependant pas suffisamment garantie par l'emploi des meilleurs pilotes, si la route à suivre n'était
préalablement éclairée au loin par toute une avant garde
de bâtiments légers. Les avisos sont, en
quelque sorte, notre cavalerie navale; ce sont
eux qui doivent, suivant l'expression consacrée,
établir le contact. " Si l'on m'ouvrait le coeur, disait
Nelson avant Aboukir, on y lirait ces mots: Des
frégates! des frégates!" Ce manque de frégates a
de tout temps causé de cruelles insomnies aux
navarques. « Souvent, dit l'auteur byzantin, qui
semble en savoir plus long à ce sujet que l'empereur
Léonet Végèce, ignorant où sont les ennemis, nous
les rencontrons à l'improviste. » Accident semblable,
si fondées qu'aient pu être, à un moment
donné, les plaintes de Nelson, est rarement arrivé
à une flotte anglaise. Chaque fois que j'ai eu la
bonne fortune de pouvoir naviguer de conserve
avec les escadres de nos alliés d'outre-Manche,
j'ai été frappé de la puissance des traditions dont
s'était imprégnée une marine qui, durant vingt
années, ne prit ses quartiers d'hiver qu'à l'abri de
quelques pâtés de roches semés au large de nos
côtes. J'aurais été bien étonné si l'on m'eût dit
alors que toutes les précautions judicieuses que
j'admirais, non sans en éprouver peut-être une secrète envie, n'étaient que la stricte application des
principes universellement admis dans la marine
byzantine dès le cinquième siècle : « A la mer
comme à terre, professaient, à cette époque, les
Byzantins, il faut faire explorer le terrain devant
soi. Sur mer, ce seront les vaisseaux les plus légers
et les plus rapides que l'on chargera de cette mission.
On leur donnera des rameurs vigoureux, des
équipages d'un courage éprouvé et capables de
soutenir un long effort. L'office de ces ex plorateurs
n'est pas de combattre; ce qu'on attend d'eux, c'est
qu'ils reconnaissent l'ennemi et viennent rendre
compte de ce qu'ils ont découvert. En employant
quatre explorateurs échelonnés à des intervalles
réguliers, le stratège peut aisément s'éclairer à six
milles au moins de distance : les vaisseaux les
plus rapprochés de la flotte répéteront les signaux
des vaisseaux les plus avancés. Les signaux de mer
se font à l'aide de pavillons ou de colonnes de
fumée. Le pavillon se détache mieux sur l'eau; la
fumée s'aperçoit de plus loin, car elle peut s'élever très-haut dans les airs. Si la flotte se trouve
placée entre les explorateurs et le soleil, il existe
un moyen plus sûr encore de lui transmettre les
avis qu'on veut porter à sa connaissance. Un miroir tourné vers le vaisseau auquel le signal s'adresse,
une épée nue agitée rapidement projettent leurs
éclats à de grandes distances. »
Eh quoi! déjà des signaux optiques! Les Byzantins
sont ici en avance sur nous, car les signaux
optiques dont la géodésie fait depuis quelque temps
un si utile usage, nos flottes neles ont jusqu'à présent
employés que comme signaux de nuit. En
revanche, ce n'est pas à 6 milles, mais à 20, mais
à 30, à 60, à 80 même, que nos amiraux veulent
être éclairés. Voici le principe généralement admis:
un premier aviso part en avant à la découverte;
au moment où il va se trouver par son éloignement
hors de la portée des signaux, un second
aviso détaché de la flotte reçoit l'ordre de le suivre;
un troisième éclaireur, expédié aussitôt que
le second a pris une avance suffisante, continue la
chaîne; cette chaîne se prolongerait au besoin de la
côte de Provence à la côte de l'Algérie. Pour la
rendre complète, il y faudrait employer beaucoup
moins de navires qu'on ne pense. Lord Exmouth
tranquillement mouillé, au cours de la dernière
guerre maritime, dans le port de Mahon, apprenait
chaque matin ce qui s'était passé depuis la veille
sur la rade de Toulon. Dès le lever du jour, une frégate s'approchait du goulet, comptait nos vaisseaux,
observait l'état plus ou moins avancé de leur
armement : l'examen terminé, elle reprenait le
large et se dirigeait à toutes voiles vers le sud. Aussitôt
qu'elle apercevait seulement le haut des mâts
d'une seconde frégate placée en vedette pour attendre
et recueillir les avis apportés de la côte, elle
commençait à se couvrir de signaux. La.seconde
frégate, j'entends par là le capitaine et les gens
qui la montaient: le navire est pour nous autres marins un être animé (1), avait à peine compris
les informations qui flottaient dans l'air qu'elle
tournait rapidement à son tour sur ses talons et
allait porter à une troisième frégate prête à remplir
vis-à-vis d'un quatrième croiseur le même office,
ce renseignement journalier qui arrivait à sa destination
avec une régularité qu'aurait, à cette époque,
enviée la malle-poste.
Une flotte exactement informée a toujours sur un
adversaire moins bien servi par ses éclaireurs un
grand avantage: il dépend d'elle d'engager ou de
refuser le combat.
(1) L'habitude ne date pas de nosjours : «Les galères qui voguaient vers l'Egypte,ditThucydide,abordèrent à labouche Mendésicnne, ne sachant rien de ce qui était arrivé.
La marine byzantine ne se piquait pas d'audace; elle considérait la prudence comme la meilleure partie de la valeur. « Il importe beaucoup, lui répétaient souvent ses tacticiens, de bien connaître nos forces et celles de l'ennemi, de savoir combien nous avons de navires et combien l'ennemi en possède; de quelle sorte de vaisseaux se compose sa flotte, si ses équipages proviennent de nouvelles levées ou se composent de marins aguerris; s'ils montrent une inclination marquée à combattre. Les espions et les déserteurs doivent être consultés sur ces divers points. Gardons-nous d'ailleurs de nous en rapporter à un seul témoignage; rassemblons autant de dépositions que nous pourrons : si ces déclarations concordent, tenons nous alors pour suffisamment renseignés. Sommes nous supérieurs en force à l'ennemi, livrons-lui hardiment bataille, sans le mépriser cependant, car souvent qui s'est fié au nombre n'en a pas moins été battu. Les forces sont-elles égales, si l'ennemi ne prend pas l'offensive, ne la prenons pas non plus; contentons-nous de conserver nos positions, à moins que l'ennemi ne veuille profiter de notre inaction pour insulter et dévaster notre territoire. En cas d'infériorité nnmérique, nous refuserons sans hésiter le combat. Et pourtant, il n'est pas toujours impossible de vaincre un ennemi supérieur en nombre: les vents peuvent nous venir en aide; un canal étroit peut rendre la multitude dont notre adversaire dispose, inutile. Il arrive en outre très souvent que les forces ennemies, dispersées au début des hostilités, aient besoin de se réunir pour tirer parti de leur supériorité numérique. Un général habile saura les surprendre pendant qu'elles opèrent leur concentration ; il fera ainsi tourner l'avantage du nombre en sa faveur. Notre territoire est-il envahi, portons nous-mêmes la guerre sur le territoire de l'envahisseur, nous l'obligerons à se rembarquer pour venir défendre son propre sol. En résumé, ne combattez jamais des forces supérieures tant que la protection de vos villes de commerce ou de vos places de guerre ne vous en imposera pas l'obligation. » Voilà qui est clair. Si, avec de pareilles instructions, les stratèges byzantins commettent quelque imprudence, c'est que chez eux, par une chance imprévue, le sang de Miltiade aura parlé plus haut que le respect des ordres de l'empereur. « Avez-vous résolu, après mûre réflexion, de livrer bataille, convoquez sur-le-champ vos capitaines et haranguez-les pour les exciter à faire leur devoir. Ne craignez pas alors de déprécier les forces de l'ennemi et d'exaller les vôtres. Menacez des plus grands châtiments tout capitaine qui oserait déserter le combat. Ce n'est pas sur sa tête seulement que tomberait la colère du prince: sa femme, ses enfants, tout ce qui lui tient par les liens du sang serait victime de sa lâcheté; on les chasserait de leur foyer, on les bannirait du sol de la patrie, on les enverrait habiter une terre inhospitalière. Qui donc, après de telles menaces, ne s'exposera pas courageusement au péril? Qui ne préférera la mort à la vie? Pour sauver ses petits, la bête fauve n'hésite pas à braver le chasseur. Lorsque des animaux dépourvus de raison nous donnent un tel exemple, peut-on croire que des êtres raisonnables se préoccuperont moins du sort de leurs enfants? Celui qui n'aura pas eu souci de son Dieu, de sa foi, qui aura oublié sa femme, sa famille, ses vieux parents, ses frères, ses coreligionnaires, doit s'attendre à subir les plus cruels supplices. Ce n'est pas par le fer qu'on le fera mourir; il est digne du feu, et c'est par le feu qu'il périra. » Si nous n'avions sous les yeux le texte grec exhumé par Müller, nous croirions entendre une harangue chinoise. Jamais nous n'avons mieux mesuré la distance qui sépare Byzance de Rome et d'Athènes. Héros de Salamine, d'Ecnome, de Lilybée, est-ce là le langage qu'on vous tenait? Etait-il besoin de vous montrer en perspective la hache du licteur pour vous obliger à combattre? Eût-on jamais osé vous adresser ces indignes menaces et rendre les êtres innocents qu'on vous savait chers responsables à l'avance de votre conduite? Il fallait des otages à Byzance pour qu'elle comptât sur le courage de ses troupes! Qu'on s'étonne, après un tel aveu, de l'empressement du prince à ouvrir les rangs de l'armée aux barbares! « Je sais bien, ajoutera, il est vrai, le stratège, changeant tout à coup de thème et s'adressant à l'amour-propre de ses capitaines, que nul d'entre vous n'aura un seul instant la pensée de fuir. » L'assemblée, consultée, n'en décrétera pas moins d'une voix unanime la peine de mort contre les fuyards, puis, avant de se séparer, elle appellera par une prière fervente la protection du ciel sur ses armes. Au moment de faire sortir sa flotte du Texel, sous les ordres de l'amiral van Gent, le prince d'Orange n'en disait pas si long aux capitaines des Provinces-Unies : "Si la flotte est battue, les commandants qui rentreront au port trouveront la terre natale plus périlleuse pour eux que le champ de bataille." Ces quelques mots, sortant de la bouche du prince taciturne, ont très probablement produit plus d'effet que les longs discours recommandés au statége byzantin. Les défections étaient pourtant moins faciles à déguiser et à excuser dans une flotte à rames que dans une réunion de navires à voiles. Avec la rame, on n'a point pour rester en arrière le prétexte captieux du calme ou du vent; si l'on manque à son poste, si l'on sort de la ligne, le refus de concours est bien manifeste. La marine à vapeur aurait peut-être plus mauvaise grâce encore à vouloir se plaindre d'avoir été trahie par la brise; elle peut l'être, un illustre maréchal se permettait d'en rire, par a le fonctionnement défectueux de ses clapets : la trière, la liburne, le dromon, la galère du moyen âge, comme celle du dix-septième siècle, n'ont pas même ce motif à invoquer quand on leur adresse le reproche d'être restés en arrière. Est-ce la nonchalance de la chiourme qui les a .retenus? Le nerf de boeuf de l'argousin fut précisément inventé pour rendre, en ces circonstances, au navire attardé des ailes.
LA TACTIQUE NAVALE DES BYZANTINS ET LA TACTIQUE NAVALE DE NOS JOURS.
Toutes les nations arrivées à un certain degré de culture intellectuelle ont attaché une grande importance à l'ordonnance de leurs troupes ou de leurs vaisseaux. Moins elles comptent sur l'élan de leurs soldats, plus elles inclinent à exagérer la valeur des combinaisons tactiques. Quant à moi, je n'essayerai pas de m'en défendre, j'ai peu de confiance dans l'efficacité des figures géométriques qu'on qualifie à tort d'ordres de bataille. Il y a bien longtemps déjà que j'ai défini la tactique navale : « l'art de naviguer sans se séparer et sans s'aborder. » Tout le reste, à mon sens, est pure chinoiserie. Le jour du combat, quelle que soit la disposition préalable dans laquelle l'action imminente trouvera les vaisseaux rangés, je ne vois rien de mieux à prescrire, à rappeler à tous une dernière fois que cette règle si simple et si profonde de l'amiral Émériau : « Tout vaisseau qui n'est pas au feu n'est pas à son poste. » C'est avec cette tactique que les Tromp, les Ruyter, les Nelson, les Cochrane, les Jean Bart, les Duguay-Trouin, les Suffren, ont remporté leurs victoires. Je l'affirme aujourd'hui; si Dieu me prête vie, j'espère, par d'irréfutables exemples, le prouver demain. Les signaux ne sont guère de mise dans ces moments si courts où deux escadres se précipitent à l'encontre l'une de l'autre, et sans signaux, pas d'évolutions ! Soyons donc de notre temps. La plus grande faute à commettre en stratégie comme en politique, c'est un anachronisme: Hands off! disait M. Gladstone : "Bas les lisières! "dirai-je à mon tour. Cette souplesse, cette spontanéité que je recommande depuis quinze ans à nos formidables escadres composées de quelques unités monstrueuses, je n'en ai plus que faire dès qu'il s'agit de réunions de mille et de deux mille bateaux. Ici je redeviens sérieusement tacticien, et la géométrie n'a pas de plus fervent adepte que le transfuge qui reniait tout à l'heure, avec une entière liberté d'esprit, le vieux drapeau usé des d'Orvilliers et des Rodney. Dans ces armées de myrmidons, que nous sommes destinés à voir un jour ou l'autre grouiller sur l'eau comme autant de fourmilières, l'ordre reprend ses droits; la confusion volontaire serait un crime. Si je me prépare à mettre à terre une troupe quelconque, j'entends la débarquer, à l'exemple du grand Constantin et en m'inspirant des préceptes du manuscrit de Milan, toute formée en bataille; longtemps avant qu'elle ait touché la plage. La phalange navale sera l'image de la phalange décrite par Arrien et par Xénophon. Je ne souffrirai pas que, durant la traversée, les bataillons ou les escadrons embarqués se croisent et se mêlent. Dans cette grande masse d'hommes, de chevaux et de matériel, chacun gardera son rang, et les compagnies d'un même régiment, les pièces d'une même batterie n'auront pas à courir l'une après l'autre comme elles le firent sur le plateau de l'Alma, quand elles eurent gravi la falaise escarpée du cap Loukoul. L'amiral Bouët-Willaumez, et, après lui, l'amiral Desfossés et l'amiral Chopart, avaient, dès les débuts de la marine de guerre à hélice, élaboré un admirable code de signaux et d'évolutions. Tous les changements de route, tous les ploiements et les déploiements de colonnes s'exécutaient dans cet ingénieux système avec une précision vraiment mathématique. Non moins régulières, non moins uniformes dans leur marche qu'une horloge sortie des mains de Winnerl ou de Bréguet, les machines continuaient, quelle que fût la manoeuvre à exécuter, de battre le même nombre de coups de piston. Jamais d'altération de vitesse, tel était le principe. Le mécanicien n'avait pas à s'inquiéter de ce qui se passait là-haut; il était convenu que sous aucun prétexte les valves d'admission de la vapeur n'auraient à s'ouvrir ou à se fermer; les chauffeurs pouvaient jeter de côté leurs ringards; les machines ne devaient, dans le cours du mouvement prescrit, ni accélérer, ni ralentir leur allure. Le tacticien prenait pour base ce régime invariable et obtenait les modifications de route ou de formation voulues par une série de mouvements à angle droit et de contre-marches. Les vaisseaux n'étaient plus que des fantassins; un colonel les aurait fait mouvoir. Par le flanc droit! Par file à gauche ! Par le flanc droit! encore; il n'en fallait pas davantage pour passer d'une ligne de bataille ou de front, marchant déployée vers le nord, à une ligne de bataille faisant route à l'est. Pour se développer ainsi à loisir, il faut évidemment avoir de l'espace et du temps devant soi, mais on conçoit aisément quelle régularité de semblables manoeuvres maintiendront dans l'ordonnance et la navigation d'une armée nombreuse. L'amiral Bouët fut le premier à renoncer à l'application de son système quand il commanda une escadre composée de six bâtiments cuirassés. Il reconnut l'inconvénient d'offrir, pendant une partie des évolutions, le flanc de ses vaisseaux, faits pour combattre de pointe, à l'éperon ennemi. Prompt à se décider, il proposa sur l'heure de substituer, pour tout changement de route ou de formation, les mouvements obliques aux mouvements quadrangulaires. C'était, en réalité, revenir aux principes que j'avais toujours préconisés : les vaisseaux n'évoluaient plus; ils chassaient leur poste. Chasser son poste, c'est, ainsi que je le définissais déjà en 1858, se rendre au poste qu'on doit occuper dans l'ordonnance nouvelle par le chemin le plus court, si la chose est possible; avant tout, par le chemin le plus sûr. Tout danger de collision est conjuré du moment qu'on observe strictement, religieusement, devrais-je dire, les règles internationales destinées à prévenir, en cas de rencontre imprévue, les abordages. Longtemps combattues parmi nous, accueillies, au contraire, avec une faveur marquée en Angleterre et aux États-Unis, ces idées, dépourvues d'artifice, ne sont pas loin, je crois, de triompher dans notre marine même, quel que puisse être le goût prononcé et héréditaire de notre race pour les solutions méthodiques. Si la chasse du poste tend à devenir la seule tactique de nos escadres, c'est une raison de plus pour que j'insiste sur les mérites du remarquable travail sorti des délibérations de la commission de 1857. Ce travail, unique en son genre, il faut le conserver dans son intégrité, sans amendements et sans mutilations. Nous nous réserverons ainsi la faculté de manoeuvrer, suivant les circonstances, par voie de formations ou par voie d'évolutions régulières; nous aurons à notre disposition deux tactiques : la tactique simplifiée, qui convient à des flottes de haut bord; la tactique rigoureusement géométrique, dont l'emploi s'impose aux grandes flottilles de l'avenir. Ces grandes flottilles, qu'en voulons-nous donc faire? « Les Français, s'écriait récemment un des collaborateurs de la Rivista maritlima, écrivain qui n'est probablement pas le premier venu, ne s'occupent plus guère d'autre chose, quand ils portent leur attention sur des questions maritimes, que d'étudier et de formuler des plans de descente. » Nos voisins des Alpes sont vraiment trop portés à nous attribuer des projets sinistres; ils s'exagèrent beaucoup, en tout cas, les ressources dont nous disposons pour opérer une diversion navale. Sommes-nous donc en mesure, comme ils l'affirment, de jeter sur leur littoral, dès l'ouverture des hostilités, si jamais des hostilités pouvaient éclater entre deux nations que tant de souvenirs et d'intérêts communs devraient étroitement unir, un corps d'armée de quarante ou de cinquante mille hommes, corps suivi, à un intervalle très rapproché, d'une autre armée infiniment plus nombreuse? « En moins de seize heures, disent-ils, les forces assemblées à Toulon seraient mouillées devant la plage de Vadoj vingt-trois heures de marche les porteraient de Toulon sur la rade de Livourne; trente-sept, quarante-six, cinquante, cinquante-huit heures suffiraient pour les amener dans les baies de Cività-Vecchia, de Gaëte, de Naples ou de Palerme. » La France posséderait en ce moment, suivant des calculs que j'abrège, vingt huit vaisseaux ou frégates cuirassés, soixante neuf, affirme le capitaine de vaisseau Cottrau, vingt-six croiseurs et soixante-douze transports, tous navires à flot, tous navires disponibles et prêts à prendre, au premier ordre venu de Paris, armement. Les torpilleurs et les bâtiments de flottille, au nombre de cent soixante-deux, offriraient un appoint qui ne serait pas à dédaigner, et le port de Marseille, mettant au service de l'État sa flotte marchande, fournirait à lui seul un contingent de quatre-vingt-quatorze mille tonneaux. Avec de tels moyens, et forts de l'expérience que nous avons acquise en Crimée, au Mexique, au Tonkin, dans le golfe de Gabès, pourquoi ne serions- nous pas de taille à renouveler « les expéditions de Xerxès, de Pyrrhus, des Carthaginois, des Romains ? » Ainsi raisonnent des inquiétudes que rien ne justifie. L'amiral sir Thomas Symonds démontre, de son côté, que la flotte anglaise est aujourd'hui inférieure à la flotte française, en nombre, en armement et en construction ». Il nous attribue trente-deux vaisseaux cuirassés, tandis que l'Angleterre n'en possède, suivant lui, que vingt six. Nos propres journaux, quand ils font la revue de nos forces, nous accordent généralement : 22 cuirassés d'escadre, 10 cuirassés de station, 8 garde-côtes, 6 batteries flottantes, 9 croiseurs à batterie, 17 croiseurs à barbette, 21 éclaireurs d'escadre, 26 avisos et canonnières de station, 67 torpilleurs, sans compter les transports, les canonnières de flottille, les chaloupes-canonnières, en tout 329 bâtiments à vapeur. Que signifie cette longue énumération? Quelle est la valeur militaire de chaque groupe? Quel est le degré de vétusté de chacun des navires qui le composent? On s'est, depuis trente ans, livré à bien des calculs pour établir sur des bases certaines une comparaison entre les diverses marines de l'Europe; il n'y a qu'un moyen aujourd'hui d'apprécier l'efficacité relative des flottes : il faut connaître, pour chacune des unités dont on veut tenir compte, le prix de revient et la date de la mise à l'eau. Cette date est de toute importance, car elle indiquera le dépérissement probable et le déclassement résultant des progrès de l'architecture navale. Des expériences du plus haut intérêt ont eu lieu récemment dans la Baltique. L'officier russe qui les dirigeait, le capitaine Verkovski, se croit en droit de conclure que« devant l'attaque combinée de plusieurs torpilleurs contre un seul navire, ce dernier doit infailliblement succomber, malgré ses canons à tir rapide» « Il est temps, ajoute-t-il, de tirer les conséquences budgétaires de cette supériorité de la torpille sur le cuirassé. » L'avenir évidemment appartient de plus en plus aux flottilles; les Anglais construisent, en ce moment, neuf cents bateaux pour remonter le Nil, et ce seront, comme je le demande depuis si longtemps, les soldats qui tiendront l'aviron : mais l'avenir appartient aussi, grâce à Dieu, à la paix européenne. D'un bout du monde à l'autre, les problèmes militaires sont, depuis quelques années, à l'étude; chacun conspire tout haut l'anéantissement de son voisin. C'est une raison de plus pour dormir tranquille: on parlerait moins si l'on avait l'intention d'agir. Le chien qui aboie ne mord pas, disent les Espagnols. Poursuivons donc, sans nous préoccuper de fugitives alarmes qui ne se sont probablement jamais prises elles-mêmes au sérieux, le cours très pacifique de nos meurtrières recherches. Chacun a la passion de son art : je voudrais perfectionner l'art de la guerre maritime. On ne me reprochera pas, du moins, de travailler dans l'ombre et de faire mystère de mes découvertes.
LE CHOIX DU CHAMP DE BATAILLE
Les navires de guerre byzantins, semblables sur
ce point à ceux de notre époque, variaient beaucoup
dans leurs dimensions. Les uns, dit l'auteur
anonyme de la Bibliothèque Ambrosienne, sont
très grands, très fortement armés, mis en mouvement
par un nombreux équipage; leur marche, par
compensation, est très lente et en raison inverse
de leur force; d'autres sont petits et légers; une
chiourme peu considérable leur suffit; quelques-uns
tiennent le milieu entre les grands vaisseaux
et les petits. Il faut se servir des grands vaisseaux
dans les combats qui se livrent sur mer, quelquefois
aussi sur les lacs, rarement dans les actions
qui ont les fleuves pour théâtre; la pesanteur de
ces gros navires ne leur permet pas de se retourner
aisément, surtout quand le rivage est occupé par « De cette variété de dimensions dans les éléments
dont se compose la flotte, résulte la nécessité
de distribuer les vaisseaux suivant un ordre déterminé
à l'avance, car il importe de ne pas opposer
les parties faibles de sa ligne à des chocs qu'elles
seraient impuissantes à soutenir. Une armée navale
rangée en bataille constitue en quelque sorte une
phalange marine: les plus gros navires doivent,
comme les lochages, supporter le premier effort
de l'ennemi. Nous les rangerons donc en avant de
tous les autres, et nous donnerons à leurs équipages
de plus fortes armures que les armures ordinaires.
»
Ne reconnaissez-vous pas ici le rôle attribué aux
galéasses dans la célèbre bataille de Lépante? Que
les traditions sont vivaces, et quel empire elles
exercent encore sur ceux mêmes qui se figurent le
plus naïvement n'obéir qu'aux inspirations de leur
génie! L'homme est perfectible sans doute, et c'est
bien par ce trait surtout qu'il se distingue des autres
ouvrages du Créateur; néanmoins sa perfectibilité
ne le sépare jamais complètement du passé; il y
tient, comme l'arbre au sol, par mille racines.
L'écrivain byzantin attache une importance majeure
à la conservation de l'ordre dans lequel les
vaisseaux ont été rangés; il veut que cet ordre
soit maintenu, non-seulement pendant le combat,
mais aussi durant le cours de la navigation. Les
armées habituées à marcher en ordre, écrit-il, se
trouvent tout naturellement ordonnées pour combattre
quand arrive le moment d'engager l'action.
Toute formation qui présente à l'ennemi la phalange
déployée doit être considérée comme un ordre de
bataille. Le déploiement en ligne droite est évidemment,
de tous les ordres de bataille, le plus
simple. Il permet de déborder rapidement l'ennemi
en augmentant tout à coup les intervalles, de détacher
même de chaque aile quelques vaisseaux
légers qui iront prendre la ligne de l'adversaire à
dos. Néanmoins, quand nous serons conduits par
une considération quelconque à livrer bataille à
un ennemi supérieur en force, il conviendra peut-être
de courber la phalange de manière à lui
donner la figure d'une faux ou d'un croissant.
L'ennemi hésitera certainement à s'engager dans
l'intérieur de la courbe; il y serait accablé par les
flèches qui lui viendraient de droite et de gauche.
Dans cette formation, le centre étant flanqué, protégé par les ailes, c'est au centre qu'il sera bon
de placer les navires les plus faibles; les extrémités
de la ligne devront être, au contraire, occupées
par les vaisseaux les plus forts et les mieux
armés. Il importe toutefois que la courbe ne soit
pas trop profonde; si elle dégénérait en demi cercle,
l'ennemi pourrait se porter en nombre sur
une des extrémités de la phalange et l'écraser
avant que les vaisseaux du centre arrivassent au
secours de l'aile menacée.
« Dans le cas où vous adopterez l'ordre concave,
il sera parfaitement inutile de courber longtemps
à l'avance la phalange: ce serait inviter l'ennemi
à prendre ses dispositions en conséquence. L'ennemi
rangerait probablement alors ses meilleurs
vaisseaux aux extrémités de sa ligne, se partagerait
peut-être en deux groupes dont l'un contiendrait
nos ailes pendant que l'autre se jetterait de toute
sa vitesse sur l'intérieur du croissant. Il ne serait
même pas impossible qu'il adoptât, pour répondre
à notre ordre concave, l'ordre convexe. Dans cet
ordre, les plus gros vaisseaux sont postés au
centre, les plus faibles aux ailes. L'ennemi, refusant
ses ailes, se trouverait en mesure d'enfoncer
notre centre avec ses gros vaisseaux. Il ne faut donc pas lui laisser le temps de modifier sa formation,
et voilà pourquoi il est essentiel de lui
dissimuler jusqu'au dernier moment nos projets.
Que le centre suspende tout à coup sa marche,
pendant que les ailes continuent à se porter en
avant, chaque vaisseau diminuant, progressivement
et suivant le poste qu'il occupe, de vitesse, le
croissant se trouvera tout naturellement formé. Le moment d'engager le combat venu, les uns
sont d'avis que la flotte se porte en avant d'un
mouvement rapide; ils voient dans cet élan un
moyen assuré de donner du coeur aux équipages;
d'autres pensent qu'il vaut mieux conserver une
marche lente et régulière. Le meilleur parti à
prendre dépendra des dispositions que montreront
les matelots. S'ils paraissent hésitants, intimidés,
il faut les précipiter tête baissée sur l'ennemi, afin
de les enlever à leurs réflexions; si, au contraire,
on les voit exaltés, ardents à l'attaque, il convient
de contenir leur furie et de les obliger par une
allure mesurée à ne pas rompre l'ordonnance de
la flotte. De toute façon, l'assaut doit être donné à
toute vogue et avec de grands cris. Si l'on possède
un plus grand nombre de vaisseaux que l'ennemi,
on aura soin de placer en arrière du centre le surplus de sa flotte, constituant ainsi une réserve qui
puisse soutenir à propos les vaisseaux engagés et
rétablir le combat sur les points où notre ligne
paraîtrait faiblir."
Nous avions déjà les galéasses de Lépante; voici
maintenant la réserve du marquis de Santa-Cruz;
notre auteur byzantin parle en vrai sergent de
bataille : l'archevêque de Sourdis aurait pu lui
offrir la survivance du capitaine de Caën.
Maintenant, quel terrain faudra-t-il choisir pour
combattre? « Sur la côte ennemie, évitons la proximité
du rivage, efforçons-nous d'attirer autant que
possible notre adversaire en haute mer; sur nos
côtes, au contraire, rapprochons-nous de terre.
Si nous sommes battus, il nous restera du moins
un dernier refuge; nous aurons, en outre, la
chance d'être soutenus par les troupes, qui ne
manqueront pas, surtout si nous les avons prévenues
à l'avance, d'accourir. » Louis XIV avait
envoyé dans le Cotentin, au mois d'avril 1692,
douze bataillons irlandais, neuf bataillons français, douze escadrons de cavalerie et de dragons. Ces
troupes, qui devaient passer en Angleterre avec le
roi Jacques et le maréchal de Bellefonds, n'ont pas
empêché le désastre de la Hougue; elles y ont assisté " comme à un feu d'artifice tiré pour une
conquête du Roi". Le conseil byzantin mérite donc
réflexion: peut-être était-il de saison au cinquième
siècle; au neuvième, l'empereur Léon ouvrait déjà
un avis différent. " Évitez, disait-il, de donner
bataille près de vos propres côtes; le soldat montre
moins de fermeté et de résolution quand il sent
près de lui un asile assuré. Ne lui offrez pas la
tentation d'aller planter sa pique à terre." Nous
dirions aujourd'hui : «de couper ses câbles. » La
chose s'est vue souvent, et tel combat glorieux que
je pourrais citer aurait eu très probablement une
issue plus favorable encore si quelques matelots
effrayés n'avaient, dans leur panique, coupé, à
l'insu du capitaine, les amarres du vaisseau sur la
bitte. Les chefs les plus intrépides, entraînés par
l'émotion générale, sont, dans ces occasions, exposés
à perdre eux-mêmes leur sang-froid.
Il est bien certain que les vaisseaux de Tourville
ne se défendirent plus avec le même héroïsme
quand on les eut mouillés dans la baie de la
Hougue. Après un conseil tenu en présence du roi
Jacques et du maréchal de Bellefonds, Tourville
prit le parti de les échouer. Les ennemis, qui
n'avaient jusque-là osé s'en approcher" à cause de leur bonne contenance", ne les voient pas
plus tôt sur le côté qu'ils commencent l'attaque.
Du mouillage extérieur qu'ils occupent, ils lâchent
dans la baie leurs brûlots et les font soutenir par
deux cents chaloupes. « A partir de ce moment,
écrivait à M. de Pontchartrain l'intendant général
Nicolas-Joseph Foucault, ce fut une confusion à
faire pitié; personne ne donna ordre à rien. Le
Roi est bien à plaindre d'être si mal servi! » Le
résultat final de l'audacieuse entreprise des Anglais
fut l'incendie de douze vaisseaux de guerre et
d'un bâtiment-hôpital. Cent vingt ans plus tard, les
brûlots de Cochrane renouvelleront cette attaque
hasardeuse sur la rade de l'ile d'Aix; ils la renouvelleront
avec un succès non moins funeste à nos
armes. On se méfie trop des flottilles; il faudra les
exploits de quelque capitaine entreprenant pour
qu'on apprenne enfin ce que des chaloupes bien
conduites sont capables de faire. Dans la matinée
désastreuse qui suivit la journée si glorieuse de la
Hougue, « lorsque les ennemis eurent mis le feu à
six vaisseaux, ils s'approchèrent si près du rivage
que le cheval du bailli de Montebourg, qui était
aux côtés du roi d'Angleterre, eut la jambe cassée
d'un coup de mousquet tiré des chaloupes anglaises» De l'audace! de l'audace! les gros vaisseaux
ont souvent les meilleures raisons pour en
manquer; les bâtiments de flottille n'en montreront
jamais trop. Du 12 mai au 28 décembre
1877, les chaloupes russes ont attaqué huit fois,
avec des torpilles portées au bout d'une hampe, les
navires de guerre turcs mouillés dans le Danube
ou à l'ancre sur la côte de Circassie. Les torpilleurs
changeront, dans un avenir très prochain,
les conditions de la guerre maritime. Un Canaris
va pouvoir de nouveau mettre, à lui seul, un
colosse en péril et une flotte en désordre : le
plus difficile sera de trouver des Canaris.
L'auteur du manuscrit dont nous avons essayé
d'éclaircir les leçons par nos commentaires, ne laissait pas lui-même de garder au fond du coeur
quelque inquiétude sur les conséquences de ses
préceptes. « Bien des personnes, dit-il, condamneront
le combat près de terre; elles craindront
que le troupeau effrayé ne se sauve à la nage. Je
ne crois pas que nous ayons à redouter de semblables
faiblesses si le stratège observe exactement ce
que nous lui avons prescrit » , en d'autres termes,
si le stratége n'oublie pas de haranguer ses
troupes. Hélas! les beaux discours n'ont guère
d'effet quand la panique s'en mêle et que le salut
est à portée. L'empereur Léon doit en avoir fait,
dans le cours de son règne, la douloureuse expérience,
car les Institutions militaires, ouvrage
dont la rédaction savante valut à son auteur le
beau nom de philosophe, recommandent au stratége
" de bien connaître le degré de courage,
l'empereur Napoléon disait le tirant d'eau, de
chacun de ses soldats". Il placera sur le pont les
braves qui doivent en venir aux mains avec l'ennemi;
il gardera en réserve sous la couverte les
hommes dont la valeur lui sera suspecte.
Se proposer de vaincre " par stratagème ou par
surprise, ne livrer de batailles rangées que dans
les cas de nécessité extrême", tel est, au neuvième
comme au cinquième siècle, le fond de la
tactique byzantine. Les aigles romaines ont suivi
Constantin à Byzance; la valeur romaine est morte,
avec Probus, sur les bords du Danube. La gloire
du nom romain n'en doit cependant pas trop souffrir
: quel est le peuple dont la virilité ait jamais
eu la vie aussi longue?
FIN DE L'OUVRAGE

![]()