

Gallia
tableau sommaire de la Gaule sous la domination romaine
par
Camille Jullian
1902
 |
 |
PRÉFACE
Ce petit livre n'a d'autre prétention que de chercher à n'être pas inutile. Il s'adresse d'abord et surtout aux étudiants des Lycées et des Facultés : peut-être leur servira-t-il à compléter leurs manuels et leurs livres de lectures historiques. — On a aussi pensé, en le faisant, aux archéologues de la province : on voudrait qu'il pût les encourager à explorer notre sol et à accroître les richesses de nos musées et les documents de notre histoire. — Enfin il a été souvent écrit en vue des gens du monde, de ceux qui aiment le passé de notre chère France.
On ne nous en voudra pas d'ajouter qu'il a été fait avec amour: on ne s'est pas défendu, toutes les fois que la vérité historique n'en souffrait pas, de parler avec sympathie de nos ancêtres et des fondateurs de notre patrie; en racontant les destinées de la Gaule, on s'est attaché à montrer en quoi elles annonçaient celles de la France. On a ajouté au texte un très grand nombre de figures : toutes, sauf trois ou quatre, reproduisent des monuments gallo-romains; on a pu faire ainsi de ce livre un album d'antiquités nationales.
Nous avons indiqué avec soin, dans ce volume, tout ce qui pouvait intéresser les grandes villes de la France, en particulier Lyon, la capitale romaine, et Paris, la capitale française.
Les citations empruntées à des auteurs modernes sont assez nombreuses. Quand nous étions d'accord avec eux, il nous a paru inutile de chercher à dire autrement ce qu'ils avaient déjà parfaitement dit.
Peut-être quelques-uns des maîtres qui ont inspiré et souhaité ce petit livre lui feront-ils l'honneur de le parcourir. Qu'ils veuillent bien l'accueillir avec beaucoup d'indulgence et un peu de confiance, Tout appareil scientifique en a été soigneusement exclu : qu'ils croient cependant que les textes ont été lus, les inscriptions et les monuments consultés, et qu'il y a dans ces pages le résultat de quelques recherches personnelles.
CAMILLE JULL1AN.
Bordeaux, 1" juillet 1892.
(1) M. Salomon Reinachm'a indiqué quelques corrections à faire en vue de cette seconde édition. Je l'en remercie. — Bordeaux, 3 juin 1902.
GALLIA
TABLEAU SOMMAIRE
DE
LA GAULE SOUS LA DOMINATION ROMAINE
AVANT-PROPOS
COMMENT NOUS CONNAISSONS LA GAULE
1. Les écrits. — Ce n'est pas par les Gaulois que nous connaissons le passé de notre pays : il n'est rien resté ni de leurs poésies populaires, ni de leurs annales politiques. C'est par leurs vainqueurs les Romains ou par les Grecs, que nous savons leur plus ancienne histoire.
L'ouvrage fondamental sur les origines gauloises est précisément le livre des Commentaires écrits par l'homme qui a conquis notre pays, Jules César : il y raconte ses guerres, il y décrit les mœurs politiques, sociales et religieuses de la Gaule en termes sobres, nets, précis. On peut lui reprocher cependant d'avoir souvent parlé plus en politique et en orateur qu'en érudit et en historien. Il a interprété à la manière romaine les institutions gauloises plutôt qu'il n'a fourni sur elles des renseignements sûrs et authentiques; il a volontiers arrangé les choses pour leur donner un tour littéraire ou pour les plier à ses idées philosophiques.
Le géographe Strabon, qui écrivait en grec dans les premières années du règne de Tibère, est moins complet que César, mais plus sur et peut-être aussi précieux. C'est un homme fort consciencieux; sans doute, il n'a point visité la Gaule, mais il a recouru pour la décrire à des documents officiels ou à des historiens de tout repos. Il est probable que, comme tant d'écrivains de son temps, il a beaucoup emprunté à Posidonius, le philosophe grec du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Posidonius était intelligent, instruit, d'une véritable valeur scientifique : on doit se fier aux renseignements qui viennent de lui. Grâce à Strabon, nous pouvons ainsi jeter parfois un coup d'œil assez net sur la Gaule d'avant la conquête romaine.
Les autres écrivains du 1er et du 2ème siècle ne donneront plus sur la Gaule romaine que des notions assez vagues ou des détails trop arides. Tacite a raconté les insurrections du 1er siècle, mais d'une façon trop oratoire : on chercherait en vain à se faire, d'après lui, une idée nette du caractère de ces événements. Pline l'Ancien nous donne des documents statistiques de premier ordre. Plutarque, Lucain, Méla, Josèphe, Suétone, d'autres encore, ajoutent de précieux détails ou d'instructives anecdotes à la connaissance de la Gaule depuis César jusqu'à Domitien.
L'histoire de la Gaule au IIème siècle va nous échapper complètement. Il faudra se contenter, pour cette époque, des récits épars chez Dion Cassius et chez Hérodien, et des sèches nomenclatures géographiques du Grec Ptolémée.
C'est, en effet, la littérature géographique qui offre le moins de lacunes pour la connaissance de la Gaule romaine. Elle nous fournit, au commencement du IIIème siècle, deux documents d'une importance capitale : l'Itinéraire Antonin et la Table de Peutinger nous donnent le tableau des principales routes de la Gaule, le nom de tous les relais et le chiffre des distances qui les séparent; le premier sous la forme de guide, la seconde sous la forme de carte. Grâce à tous ces travaux géographiques, nous saurons toujours mieux la topographie que l'histoire de la Gaule.

Table de Petinger (1)
— Les événements du IIIème siècle ne nous sont connus que par quelques pages insignifiantes des compilateurs de l'Histoire Auguste.
Au IVème siècle, l'histoire de la Gaule nous est enfin racontée d'une façon large et vivante : de tous les âges de la Gaule romaine, c'est évidemment celui que nous ignorons le moins.
(1) La Table de Peutinger indique les stations des routes et les distances en lieues ou en milles qui les séparent. Les villes importantes sont marquées par des vignettes. On lit sur ce fragment : Aquis Sestis pour Aquœ Sextiœ, Aix; Pisavis, station sur la voie Aurélienne à 18 milles d'Aix; Masilia (pour Massilia) Grecorum, Marseille, à 18 milles d'Aix; ad Fines, station sur la voie Domitienne; à 10 milles à l'est, Apta Julia, Apt; à 12 milles d'Apt, Catu[iaca], sur la même route. La Table de Peulinger aplatit les projeclions géographiques dans le sens de la latitude. La rivière indiquée est la Durance, trop rapprochée vers l'Ouest. Remarquez l'expression de Gretia, Graecia, pour la région entre Marseille et Aix. — La Table de Peutinger est conservée à la Bibliothèque de Vienne (Autriche).
Nous avons, en particulier, l'œuvre si sincère et si solide d'Ammien Marcellin, les écrits de l'empereur Julien, sans parler des Notices officielles des Dignités et des Villes, des historiens grecs et des chroniqueurs chrétiens du Vème siècle. En ce temps-là aussi, ce sont enfin des Gaulois qui nous parlent de la Gaule et qui la font revivre à nos yeux : les panégyriques d'Autun, les poésies et les lettres d'Ausone, nous font pénétrer fort avant dans la vie politique, littéraire et privée de la Gaule sous les derniers empereurs; Rutilius Namatianus, Paulin de Pella, d'autres encore, nous feront admirablement connaître l'état d'esprit des Gaulois à la veille de l'invasion. Or c'est précisément cette vie intérieure que les historiens romains ou grecs des premiers siècles nous avaient laissé le plus ignorer (1).
2. Les inscriptions. — On peut suppléer en partie à cette lacune à l'aide des inscriptions. Extrêmement nombreuses dans les trois premiers siècles, elles deviennent fort clairsemées au IVème précisément à l'époque où abondent en Gaule les écrits de toute sorte. Plus de douze mille peut-être nous sont parvenues de tous les points de la Gaule, mais surtout des villes et du Midi ; les villes de Narbonne, de Nîmes, de Lyon, de Bordeaux, d'Arles et de Vienne sont les plus riches en inscriptions. On dira plus loin quels services elles nous ont rendus (2) : c'est grâce à elles que nous connaissons les croyances de la Gaule romaine, les noms de ses dieux et les titres de ses magistrats, son organisation provinciale et militaire, ses coutumes privées et le culte qu'elle rendait à ses morts.
(1) Presque tous les textes anciens concernant la Gaule romaine ont été réunis et imprimés dans le tome 1er du Recueil des historiens des Gaules et de la France, soit de l'édition originale par dom Bouquet, soit de la réimpression faite par M.. Léopold Delisle.
(2) Chapitre XIV du présent livre.
Les inscriptions de la Gaule ont même sur les historiens un incomparable avantage. L'historien le plus sincère, comme Ammien, nous donne le fait tel qu'il le comprend ou tel qu'il le sait, non pas tel qu'il est ; l'inscription ne raconte pas, elle est un document, ou plutôt elle est le fait lui-même. Elle nous apprend parfois fort peu de chose, sans doute, mais ce peu de chose a une valeur irréductible. — On trouve dans une vallée reculée de la Provence une inscription du temps d'Auguste consacrée au Jupiter du Capitole, Jovi Optimo Maximo; l'autel qui la porte a été sculpté et gravé à l'endroit même : il est en pierre du pays. Ne doit-on pas conclure de là que, dès le temps d'Auguste, le culte du grand dieu de Rome avait pénétré jusque dans ce coin perdu de terre gauloise? Voilà un fait, contre lequel rien ne prévaudra. Assurément, ce fait est d'importance minime et n'intéresse que la Provence. Mais, si l'on trouve des inscriptions semblables un peu partout dans la Gaule, à Bordeaux, à Paris, ailleurs encore, le fait s'étend, s'élargit, et tout de suite nous sommes en présence d'un chapitre capital de l'histoire de la Gaule, la diffusion, dès le début de l'empire, des cultes romains par tout le pays.
L'épigraphie, ou la science des inscriptions, permet ainsi de faire l'histoire comme on établit les lois physiques et naturelles, par une série d'observations et d'hypothèses, et parfois même d'expériences. Deux exemples pourront le montrer. — En publiant les inscriptions de la colonie de Narbonne, M. Hirschfeld a remarqué un très grand nombre de noms propres terminés en enus ou enius, comme Usulenus, Lafrenus, Servenius ; or ces noms, rares dans le reste de l'empire, sont très fréquents dans l'Italie centrale, en Ombrie, en Étrurie, dans le Picénum. On peut expliquer cette coïncidence, dit M. Hirschfeld, en supposant que les premiers colons de Narbonne, envoyés par César ou Auguste, étaient originaires de ces pays. — Voici une autre hypothèse qui a pu se vérifier plus complètement. Le même M. Hirschfeld a relevé, dans les inscriptions nîmoises, des traces de souvenirs égyptiens : culte d'Isis, noms propres d'aspect singulier, institutions municipales analogues à celles d'Alexandrie. Ces observations l'ont amené à supposer qu'Auguste établit à Nîmes des colons venus d'Egypte. A ces faits et à cette supposition, il a pu joindre une sorte d'expérience : en examinant les monnaies de la colonie nîmoise, il a constaté la présence, comme symbole ou armoirie de la ville, d'un crocodile enchaîné, souvenir de l'Egypte vaincue. Voilà l'hypothèse vérifiée et fortifiée (1).
3. Les monuments. — Enfin, pour connaître la civilisation matérielle de la Gaule, ses progrès dans les arts, la richesse de son industrie, la beauté de ses villes et de ses villas, nous avons les monuments restés debout sur notre pays, ou les fragments et les bijoux retrouvés dans les ruines.
Des monuments s'élèvent encore dans les anciennes villes romaines, surtout dans les colonies du Midi, à Nîmes, Arles, Orange, Vienne, Fréjus; dans le Nord, Trêves, dans l'Ouest, Saintes, sont presque aussi riches à cet égard.
(1) Les inscriptions de la Gaule Narbonnaise forment le tome XII du Corpus inscriptionum latinarum, publié par l'Académie royale de Prusse ; les textes lapidaires de l'Aquitaine et de la Lyonnaise forment la première partie du tome XIII : ces deux volumes, qui sont l'œuvre de M. Hirschfeld, ont paru en 1888 et 1899. M, Bonn a publié en 1901 la première partie des marques de fabrique trouvées dans les Trois Gaules et les deux Germanies. — un peut consulter aussi les recueils locaux : en première ligne, ceux de MM. Allmer et Dissard. pour lemusée de Lyon; en seconde ligne, ceux de MM. Auiliat, pour Saintes; Bludé, pour Agen et la Novempopulanie; de Buissieu, pour Lyon; lirunibacli, pour Trêves et les pays du Kbin; Espérandieu, pour Saintes, Poitiers, Limoges, l'érigueux, Lectoure; Jullian, pour Bordeaux; Lejay, pour Dijon; Mowat, pour Paris, Langres et Dijon; Robert et Gagnât, pour Metz; Sacaze, pour les Pyrénées, etc. ; les articles d'Allmer dans la Revue épigraphique du midi de la France; de MM. Héron de Villefosse et Thédenat dans la Revue archéologique, et les Mémoires de la Société des antiquaires de France; de M. Mowat dans le Bulletin épigrapliique de la Gaule, etc. — Les inscriptions chrétiennes de la Gaule ont été données par Le Blant; les marques de fabrique, par M. Schuermans.
Les monuments sont moins nombreux et moins bien conservés dans les autres villes; mais il est rare qu'une grande cité française n'ait pas une ruine importante de l'époque romaine. Dans les campagnes mêmes, et quelquefois dans des pays perdus, on est émerveillé de rencontrer des édifices encore superbes, mausolées, aqueducs, théâtres, villas. Ce qui s'est construit sur notre sol du Ier au IIIème siècle est incroyable. Seul, peut-être, le moyen âge gothique, du XIIIème au XVème siècle, a pu rivaliser d'activité et de richesse avec l'ère romaine. Encore s'est-il relativement peu perdu de cette partie du moyen âge : et depuis quinze siècles les édifices romains ont été pillés et détruits sans relâche. Les barbares du IIIème siècle ont commencé leur ruine; mais les générations modernes l'ont achevée. On accuse volontiers les Germains du Vème siècle et les chrétiens du moyen âge de celle œuvre de dévastation, On pourrait aisément disculper les uns et les autres. Les vrais coupables, après les Francs et les Alamans de la première invasion, ont été les gouvernements modernes. Un des plus beaux édifices de la Gaule, le temple de Tutelle de Bordeaux, a été détruit par ordre de Louis XIV ; la Révolution a laissé éventrer l'amphithéâtre de cette ville. Le phare romain de Boulogne, appelé la Tour d'Ordre, fut complètement démoli vers 1645. Le mausolée et les tours d'Aix en Provence ont disparu sous Louis XVI. Le moyen âge a pu dégrader les derniers siècles ont rasé.
Les fragments ou les objets de moindre importance peuvent être groupés en deux catégories, suivant la manière dont ils nous sont parvenus. — Les uns ont été trouvés dans le sol, au milieu des débris du monument auquel ils appartenaient : les bijoux et les poteries, par exemple, dans les décombres des villas et des maisons; les stalues et les ex-voto, sur l'emplacement des temples; les tombeaux, le long des anciennes routes ou dans les vieilles nécropoles. — Les autres nous ont été conservés par un singulier hasard. Au IIIème siècle, la première invasion germanique détruisit la presque totalité des villes des Trois Gaules : la Gaule Narbonnaise fut seule à l'abri de cette gigantesque dévastation. Vers l'an 300, les villes détruites furent reconstruites et entourées de murailles; or le gros œuvre de ces murailles fut précisément bâti avec les débris des édifices renversés par les barbares, fûts et tambours de colonnes, chapiteaux, sculptures, tombeaux, autels, statues même. Et de nos jours, quand on démolit ces murailles romaines, tous ces débris réapparaissent, véritables témoins de la vie des cités gallo-romaines aux deux premiers siècles (1).
Beaucoup de pans de ces murailles sont encore intacts : le jour où on le voudra, de nouvelles richesses en inscriptions et en sculptures viendront orner nos musées. A Saintes, à Dax, à Bordeaux, à Nantes, à Bourges, dans cinquante autres villes de ce qui fut la Gaule propre, il y aura longtemps encore, dans ces fragments de murs romains, une abondante carrière de matériaux pour l'histoire de notre passé.
Ajoutons à cela qu'il reste à fouiller les ruines de nombreuses villas, d'oppida gaulois abandonnés au Ier siècle, et même de villes qui furent grandes et florissantes. Que de choses à trouver encore sur les plateaux de Gergovie et de Bibracte, dans ce merveilleux Fréjus, qui est presque notre Pompéi, dans ces villes créées par la Gaule romaine et réduites depuis quinze siècles au rang de bourgades, Jublains, Bavai, Vieux, Corseul, Javols, Lillebonne et, par-dessus tout, Vaison! Avec un peu d'énergie et de patience, et sans trop de dépenses, de belles découvertes seraient réservées à nos archéologues, de grandes conquêtes à notre histoire nationale.
(1) Le principal ouvrage sur la Gaule romaine, celui auquel nous avons fait le plus d'emprunts, est la Gaule romaine de Fustel de Coulanges, qui forme le tome Ier de son Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Il faut le compléter par le tome II et le tomeV du même ouvrage, l'Invasion et l'Alleu. Nous devons placer sur le même rang l'admirable premier livre de Michelet dans son Histoire de France. — L'histoire détaillée de la Gaule indépendante et romaine a été donnée dans les ouvrages si consciencieux d'Amédée Thierry, Histoire des Gaulois et Histoire de la Gaule sous la domination romaine, auxquels il faut joindre les recherches de Lenain de Tillemont sur l'Histoire des empereurs et de belles pages de Duruy dans son Histoire des Romains. — De très bons tableaux de la civilisation gallo-romaine ont été donnés par M. Mommsen dans le tome V de son Histoire romaine et par M. Hirschfld dans des revues allemandes : Alliner les a traduits ou résumés, et accompagnés de recherches personnelles de premier ordre dans son excellente Revue épigraphique du midi de la France. — Pour l'époque primitive, on doit consulter Bertrand, la Gaule avant les Gaulois. — Les travaux de MM. Gaidoz et d'Arbois de Jubainville et la collection de la Revue celtique sont très précieux pour la connaissance de la langue et des institutions celtiques; nous ne saurions dire en particulier quel plaisir peut apporter la lecture du petit opuscule de M. Gaidoz sur la religion gauloise et quel profit les recherches de M. d'Arbois de Jubainville sur les institutions celtiques au temps de César. — Pour les institutions politiques, les livres abondent : outre ceux de Fustel de Coulanges, nous recommandons surtout Guiraud, les Assemblées provinciales dans l'empire romain, le livre et les articles de M. Lécrirain sur le sénat du bas-empire, les travaux de M. Beurlier et de Beaudouin sur le Culte impérial, de M. Gagnat sur les Impôts indirects, sans parler des Manuels de M. Bouché-Leclereq et de Moinmsen et Marquardt. — Pour le culte et la vie privée, on a cité souvent les deux beaux livres de M. Boissier sur la Religion romaine et la Fin du paganisme, et la Cité antique de Fustel de Coulanges. — Les origines du christianisme ont été traitées en partie à l'aide des Apôtres et de Marc-Aurèle, qui sont peut-être les deux chefs-d'œuvre de Renan, des livres de Le Blant sur les sarcophages chrétiens d'Arles et de la Gaule, et du récent travail de M. Duchesne sur les origines de l'épiscopat en Gaule. — On a consulté, pour la géographie, les livres de Desjardins sur la Géographie de la Gaule romaine et l'Atlas historique de la France de M. Longnon. — En archéologie, nous possédons un ouvrage vieilli, mais encore utile, l'Abécédaire de de Caumont; on doit étudier avec soin les remarquables recherches de M. Keinach, ses catalogues précieux du musée de Saint-Germain, le charmant livre de M. Pottier sur les Statuettes en terre cuite, les recueils de M. Blanchet sur les terres cuites gallo-romaines et sur les découvertes de monnaies romaines, de bons travaux de MM. de Villefosse et Thédenat dans la Gazette archéologique, et un certain nombre d'articles du Dictionnaire des antiquités. Il y a de bonnes choses sur l'art au IIème siècle dans l'Antonin de M. Lacour-Gayet.— Enfin la Revue d'Allmer, continuée par M. Espérandieu, et la Revue archéologique renferment d'utiles études sur les villes de la Gaule.
CHAPITRE PREMIER
LA GAULE AU MOMENT DE LA CONQUÊTE
1. Nom, populations et limites de la Gaule. — A la fin du IIème siècle avant l'ère chrétienne, les Romains entamèrent la conquête de notre pays. On commençait, en ce temps-là, à donner le nom de Gaule, Gallia, à la vaste contrée qui s'étendait des Alpes aux Pyrénées et de la mer Méditerranée jusqu'aux rives lointaines de l'Océan. Ce nom lui venait de la principale nation qui l'habitait, celle des Gaulois ou Celtes, Galli, Celtœ. Celte ou Gaulois étaient d'ailleurs à ce moment deux termes synonymes. Les Celtes s'appelaient ainsi dans leur langue; les Romains leur donnaient volontiers le nom de Gaulois, comme ils donnaient aux Hellènes celui de Grecs, comme nous donnons aux Deutschen celui d'Allemands.
La Gaule ne formait pas à cette époque un seul État; elle n'était même pas habitée tout entière par des peuples appartenant à la même race. A côté des Gaulois, qui lui donnaient son nom, d'autres populations moins importantes y étaient établies. — Au Sud-Ouest, entre la Garonne et les Pyrénées, étaient les Aquitains, Aquitani : ils passaient pour ressembler aux Ibères, leurs voisins, qui peuplaient une grande partie de l'Espagne, et qui avaient valu à la presqu'île son nom d'Ibérie. —Au Sud-Est, le long de la Méditerranée, on rencontrait les Ligures, qui s'étendaient aussi sur les côtes italiennes jusqu'à l'embouchure de l'Arno. Ibères et Ligures avaient autrefois possédé une bien plus grande partie de la Gaule ; mais les Celtes les avaient refoulés au Midi, il y avait deux ou trois siècles à peine. — Du côté du Rhin, les Gaulois avaient jadis débordé dans les grandes plaines de l'Allemagne du Nord. En ce moment ils se trouvaient rejetés en deçà du fleuve par les Germains, leurs voisins immédiats et souvent leurs ennemis : le pays que nous appelons l'Alsace avait été conquis par ces derniers, sans doute depuis peu de temps. Le Rhin n'avait jamais servi de barrière entre les deux races. Toutefois, la nature avait fait de ce fleuve la frontière véritable de la Gaule, et dès que les géographes grecs ou romains s'occuperont de cette contrée, c'est le Rhin qu'ils lui assigneront comme limite orientale.
2. Anciennes destinées des Gaulois. — La grande nation qui occupait le centre de la Gaule avait autrefois étendu son empire bien au delà des bornes de ce pays. Elle avait été, quelques siècles auparavant, la principale nation conquérante de l'occident et du nord de l'Europe. Sous la suprématie de sa peuplade la plus centrale, les Bituriges (qui habitaient le pays de Bourges), elle avait vu sa domination rayonner au loin par le monde : de grandes migrations d'hommes étaient parties de la Gaule, portant la terreur du nom celtique aux Grecs et aux Romains et aux autres barbares. En Espagne s'était formée la population mixte des Celtibères; les îles Britanniques étaient devenues à peu près gauloises; en Italie, une seconde Gaule, Gallia Cisalpina, s'était créée dans la vallée du Pô, et les Celtes, vainqueurs des Romains à la bataille de l'Allia (300av. J.-C.), ne s'étaient arrêtés qu'au pied du Capitole. D'autres avaient occupé la vallée du Danube; on en avait, vu piller la Grèce, et, plus loin encore, les Gaulois avaient fondé en Asie un petit Etat que les Grecs appelaient la Galatie. Au delà du Rhin, ils s'étaient répandus jusqu'aux bords de la Vistule. Bien des grandes villes européennes doivent leur origine aux Celtes : Cracovie en Pologne, Vienne en Autriche, Coïmbre en Portugal, York en Angleterre, Milan en Italie ont des noms qui viennent du gaulois : ce sont des fondations d'hommes de notre pays et de notre race.
Cette immense étendue de terres s'était jadis appelée « la Celtique ». Mais peu à peu les Gaulois avaient vu leur empire se démembrer et leur nom se limiter à la Galatie asiatique, à la Gaule Cisalpine et à la Gaule Transalpine. Puis, sur tous ces points, ils durent reculer, et toujours devant les Romains. Au IIème siècle, les Romains achevèrent la conquête de la Cisalpine, écrasèrent les Galates et, vers l'an 125, pénétrèrent en conquérants dans la Gaule Transalpine.
3. Principales peuplades gauloises. — Les Celtes de la Gaule n'étaient pas encore arrivés à l'unité politique. On distinguait chez eux deux groupes de peuples qui ne parlaient pas le même dialecte et n'avaient ni les mêmes mœurs, ni les mêmes usages : les Gaulois proprement dits, entre la Garonne, la Seine et la Marne; et les Belges, Belgœ, entre la Marne et le Rhin. Ces derniers, arrivés sans doute plus récemment en Gaule, étaient plus guerriers et plus sauvages que les autres Celtes.
Gaulois et Belges comprenaient environ quatre-vingts peuplades, gentes. Chacune d'elles, établie à demeure sur un territoire bien délimité, avait ses villes, sa constitution, ses magistrats et son indépendance; elle formait un véritable État politique, une nation autonome. C'est à ces petites nations gauloises que la France doit ses premières cités et ses plus anciennes divisions géographiques : elles sont l'origine de nos provinces, de nos pays et de nos grandes villes, qui pour la plupart conservent encore le nom de ces peuplades
Monnaie des Allobroges, chamois et roue |
Monnaie Allobroges, (hippocampe) |
Les principales étaient les Bituriges, Bituriges (Bourges et le Berry), les Éduens, Aedui (Autun), les Arvernes, Arverni (Auvergne), les Séquanes, Sequani (Besançon), les Helvètes, Helvetii (Suisse), au centre de la Gaule; au Nord-Est, les Rèmes, Remi (Reims), les Trévires, Treveri (Trêves), les Nerviens, Nervii (Hainaut); au Sud-Ouest, les Santons, Santones (Saintes et Saintonge), les Pictons, Pictones (Poitiers et Poitou).
 |
Monnaie d'or attribuée aux Arvernes (1)
La petite peuplade des Parisiens, Parisii, fort peu importante en ce temps-là, avait pour principale ville Lutèce, Lutetia, dans une île de la Seine : plus tard, Lutèce prendra le nom de Paris.
(1) Tête d'homme laurée ; au revers, guerrier sur un char.
peuple qui l'a habitée. Au Sud, les Volques, Volcœ, s'étendaient des Pyrénées au Rhône; les Allobroges, Allobroges, du Rhône aux Alpes. Au Nord-Ouest, les nations comprises entre la Loire et la Seine formaient, sous le nom d'Armorique, Armorica, une confédération particulière. Les autres peuplades se groupaient d'ordinaire autour des États les plus forts, comme les Arvernes, les Eduens ou les Séquanes, et ces ligues étaient en lutte incessante l'une contre l'autre. Comme il n'y avait aucune nation assez puissante pour imposer longtemps sa suprématie à ses voisines et à ses rivales, la Gaule était, au IIème siècle, en pleine anarchie.
4. Institutions politiques. — L'anarchie se retrouvait à l'intérieur de chacun de ces petits Etats. Les querelles politiques y maintenaient la discorde dans les villes, dans les campagnes, dans les familles même. Le gouvernement était à peu près partout aristocratique ; le pouvoir appartenait à un sénat nombreux, composé sans doute des hommes les plus riches et les plus influents, il élisait un chef suprême, annuel ou viager, qui s'appelait assez souvent, semble-t-il, « le juge », vergobret en gaulois. Ce magistrat avait à peu près les mêmes droits que les premiers consuls de Rome, qui, eux aussi, s'étaient nommés des juges, judices.
Dans beaucoup de peuplades il s'était formé un parti démocratique autour de quelques chefs plus riches et plus ambitieux : ce parti tenait l'aristocratie en échec et amenait parfois la création d'une royauté populaire. Toutes les nations gauloises se trouvaient dans un état de crise et de formation politique assez semblable à celui qui précéda, à Rome et à Athènes, l'établissement définitif du régime républicain. La puissance effective était partout entre les mains de quelques nobles, riches en terres et en clients.
5. Les druides. — Le clergé était, avec la noblesse, la classe dominante. La Gaule possédait un corps de prêtres appelés « druides », qui tenaient la première place dans la vie publique et sociale des nations. Les druides dirigeaient la religion officielle et le culte privé. Ils instruisaient la jeunesse et lui apprenaient, nous dit César, « le cours des astres, la grandeur du monde et des terres, la force et la puissance des dieux. Ils lui enseignaient surtout que l'âme ne meurt point, mais qu'après la mort elle passe d'un corps à un autre ». L'enseignement était donné sous forme de longs poèmes, qu'ils n'écrivaient jamais et que l'on se transmettait par la parole à travers les âges. Les druides étaient aussi une grande puissance politique. Chaque année, ils tenaient, au centre de la Gaule, dans le pays de Chartres, de véritables assises, où ils jugeaient de tous les procès publics et privés. Contre ceux qui ne répondaient pas à leur appel, ils lançaient des sentences d'excommunication, ce qui était, pour les Gaulois, le plus redoutable des châtiments.
Cette domination du clergé a frappé beaucoup tous les écrivains anciens qui se sont occupés de la Gaule. Il n'y avait à ce moment rien de semblable dans le monde grec ou romain. L'Orient seul offrait, en Egypte ou en Chaldée, une caste sacerdotale aussi puissante que celle des druides. Aussi les Romains disaient-ils volontiers que les Gaulois étaient «la plus superstitieuse des nations», ne se rappelant pas que leurs ancêtres avaient également mérité ce reproche.
6. Les dieux. — La religion présentait le même morcellement, la même absence d'unité que la société politique. Comme dans le culte primitif de la Grèce et de l'Italie, les dieux abondaient en Gaule. C'étaient surtout des divinités locales, dont l'adoration était limitée à un canton ou à une bourgade. Chaque cité avait son dieu, qui était d'ordinaire le dieu de la source qui l'arrosait ou de la montagne sur laquelle elle était bâtie. On adorait à Nimes la fontaine Nemausus, l'Yonne, Icaunis, à Auxerre, la Seine, Sequana, à la source du fleuve, Dumias au Puy de Dôme, la fontaine Divona à Bordeaux, la déesse Arduenna dans les Ardennes, le dieu Vosegus dans les Vosges, le dieu fluvial Vasio à Vaison, et bien d'autres. C'étaient ces divinités des sources et des bois qui étaient l'objet de la plus ardente dévotion : c'est la plus ancienne religion de nos ancêtres, et c'est celle qui a le plus longtemps duré.
Cependant, au-dessus des innombrables divinités locales, quelques grands dieux commençaient à s'élever, représentant les forces éternelles de la nature ou les grands principes de la vie humaine. Les Gaulois les appelaient Teutates, Esus, Taranis : les Romains nous apprennent qu'ils ressemblaient aux plus hautes divinités de leur religion, et la ressemblance paraissait même si grande qu'ils n'appelaient jamais les dieux gaulois que des noms latins de Jupiter, Mercure ou Mars. « Mercure, dit Jules César, est le principal dieu. C'est de lui qu'il y a le plus d'images; c'est lui, à ce que croient les Gaulois (et remarquons que les Romains et les Grecs ne croyaient pas autre chose), c'est lui qui a inventé les arts, qui préside au commerce, protège les routes, fait gagner de l'argent. Puis viennent Apollon, qui écarte les maladies, Minerve, l'éducatrice des artistes et des travailleurs, Jupiter, le roi du ciel, Mars, le chef de guerre. » Dans la pensée de César, le panthéon gaulois ne différait pas du panthéon classique des Grecs et des Romains.
7. — Mais c'étaient les croyances populaires des Gaulois qui étonnaient le plus les Latins. On racontait mille choses étranges sur les pratiques superstitieuses, les sortilèges, les amulettes, les charmes auxquels les druides, disait-on, habituaient la Gaule : les Romains du temps de César oubliaient un peu que les mêmes dévolions populaires s'étaient rencontrées dans l'ancienne Italie.
Deux surtout excitaient rétonnement, celle de « l'œuf de serpent» et celle du «gui de chêne». — «Durant l'été, raconte Pline le Naturaliste, on voit se rassembler dans certaines cavernes de la Gaule des serpents sans nombre qui se mêlent, s'entrelacent et, avec leur salive, jointe à l'écume qui suinte de leur peau, produisent une espèce d'œuf. Lorsqu'il est parfait, ils l'élèvent et le soutiennent en l'air par leurs sifflements; c'est alors qu'il faut s'en emparer, avant qu'il ait louché la terre. Un homme aposté à cet effet s'élance, reçoit l'œuf dans un linge, saute sur un cheval qui l'attend, et s'éloigne à toute bride, car les serpents le poursuivent jusqu'à ce qu'il ait mis une rivière entre eux et lui. » L'œuf de serpent servait, croyait-on, à faire gagner les procès et à se faire bien voir des rois et des puissants. — Le gui de chêne guérissait de toutes les maladies; on l'appelait le « guérit-tout », omnia sanans. Mais, pour qu'il fût efficace, il fallait le cueillir suivant les rites : « Le prêtre, dit encore Pline, est vêtu d'une robe blanche, il tient une faucille d'or : c'est ainsi qu'il monte sur l'arbre, coupe le gui, qui doit être reçu dans une saie blanche. Alors ont lieu les prières et les sacrifices. » L'œuf de serpent était un talisman, le gui de chêne une panacée. — Le chêne était au reste l'arbre religieux par excellence aux yeux des druides et des Gaulois, comme il le fut dans les temps les plus anciens de la Grèce et de l'Italie, et la superstilion qui s'attachait au gui peut aisément se retrouver dans les religions primitives ou les croyances populaires de beaucoup de nalions antiques.
Notre imagination se représente volontiers les druides au fond des bois et dans de vastes clairières, immolant des victimes et accomplissant leurs sacrifices sur de grands monuments en pierre brute, isolés, tristes et nus; il est resté bon nombre de ces monuments par toute la France, en Bretagne surtout : les dolmens, en forme de table, les menhirs qui se dressent, isolés, comme des obélisques; les alignements et les cromlechs, gigantesques rangées de pierres plantées dans le sol. Nous sommes même habitués à appeler
ces monuments des « pierres druidiques ». Mais tout cela n'est que légende et poésie. Ces pierres n'ont en réalité aucun rapport avec la religion des druides :
 Le roi des menhirs de loch Maria Kher (restitution).
Le roi des menhirs de loch Maria Kher (restitution).
la tadition qui s'est formé à leur propros n'a rien d'historique et il est fort douteux qu'un druide ait jamais sacrifié sur un dolmen ou prié dans l'enceinte d'un cromlech. Ce sont, selon toute vraissemblance, des ruines de tombeaux ou des "pierres de

Aligements de Carnac
souvenir », destinées à recueillir les cendres des morts ou à perpétuer la mémoire des hommes disparus. Il s'en trouve de semblables en Afrique, en Orient, dans le monde entier : ce sont là des formes de sépulcres ou de monuments qui ont été également naturelles à tous les peuples primitifs.
8. Caractère des Gaulois. — A ces Gaulois dont ils raillaient la superstition, les anciens reconnurent cependant deux grandes qualités : le courage et l'éloquence. On disait couramment à Rome qu'il y avait deux arts où ils étaient passés maîtres, l'art de se battu et celui de bien parler. « II y a deux choses, disait Caton l'Ancien, qu'ambitionné la Gaule par-dessus tout : le métier de la guerre et l'habileté de la parole », rem militarem et argute loqui. Ils ont conservé, jusqu'à la fin du monde ancien, ce double renom, et leurs descendants, les Français d'aujourd'hui, méritent encore l'éloge que faisait d'eux un géographe grec : « Le caractère commun de toute la race gauloise, dit Strabon d'après le philosophe Posidonius, c'est qu'elle est irritable et folle de guerre, prompte au combat; du reste, simple et sans malignité. Si on les irrite, ils marchent ensemble droit à l'ennemi, et l'attaquent de front, sans s'informer d'autre chose. Aussi, par la ruse, on en vient aisément à bout; on les attire au combat quand on veut, où l'on veut, peu importent les motifs; ils sont toujours prêts, n'eussent-ils d'autre arme que leur force et leur audace. Toutefois, par la persuasion, ils se laissent amener sans peine aux choses utiles ; ils sont susceptibles de culture et d'instruction littéraire. Forts de leur haute taille et de leur nombre, ils s'assemblent aisément en grande foule, simples qu'ils sont et spontanés, et prennent volontiers en main la cause de celui qu'on opprime. »
" Peuples de guerre et de bruit, dit Michelet dans un passage célèbre, ils courent le monde l'épée à la main, moins, ce semble, par avidité que par un vague et vain désir de voir, de savoir, d'agir.

Dolmen près de Carnac
De grands corps mous, blancs et blonds ; de l'élan, peu de forces et d'haleine ; jovialité féroce, espoir immense ; vains, n'ayant jamais rencontré qui tint devant eux...ce sont les enfants du monde naissant."
9. Progrès de la civilisation et de l'unité. — Mais ce sont des enfants qui veulent apprendre. Les anciens ont souvent fait ressortir cette éternelle curiosité de la race gauloise, « la plus sympathique et la plus perfectible des races humaines ». dit encore Michelet. On citait d'eux un trait singulier : quand un étranger venait chez eux, ils le gardaient, le forçaient à parler, à leur raconter les choses des pays lointains. Dès qu'ils furent mis en contact avec les Grecs, ceux de Macédoine ou les Phocéens établis à Marseille, ils se laissèrent gagner peu à peu par la civilisation méditerranéenne.lls apprirent la culture de l'olivier et de la vigne; ils remplacèrent par le vin le lait et la bière, leurs boissons ordinaires. Ils frappèrent des pièces à l'imitation des monnaies de la Grèce et copièrent les statues de ses divinités.
| Tétradrachme de Philippe | Imitation gauloise de cette même monnaie (1) |
 |
 |
Leurs grands dieux se transformèrent sur le type des dieux voisins, plus élégants et plus visibles, et en particulier sur le modèle de cet Hermès on de ce Mercure, dont les négociants de Marseille devaient leur parler sans cesse et leur montrer les curieuses images.
(1) Remarquez, au revers, la façon incohérente dont le monnayeur a groupé les différents traits de la légende grecque.
Aux grands monuments informes de l'âge primitif, aux dolmens, aux menhirs, succédèrent des stèles soigneusement dégrossies et ornées bientôt de naïves sculptures. Les Grecs enseignèrent aux Celtes à écrire, le premier alphabet gaulois fut composé de lettres grecques. Peut-être même la philosophie hellénique s'insinua-t-elle dans les dogmes enseignés par les druides, et il ne serait pas impossible d'y trouver un écho lointain de l'enseignement de Pythagore.
 |
 |
| Tétradrachme de Thasos | Imitation gauloise de cette même monnaie |
Tout concourait donc à développer en Gaule la culture gréco-romaine. Les Gaulois appartenaient d'ailleurs, comme les Hellènes et les Latins, à la grande race indo-européenne ; peut-être même étaient-ils plus proches parents d'eux que les Germains et les autres nations barbares. Leur langue avait quelques affinités avec la langue grecque. Leur religion, leurs dieux et leurs superstitions ne différaient pas sensiblement des vieilles croyances de l'Italie ou de l'Hellade, leur constitution ressemblait aux constitutions primitives de toutes les cités du monde méditerranéen. Entre Gaulois, Grecs et Romains, il y avait des différences d'âge; il n'y avait pas des oppositions de nature.
En même temps, la Gaule, malgré son état d'anarchie, tendait à l'unité. Les Gaulois en occupaient les trois quarts, ils en tenaient le massif central et là étaient leurs nations les plus puissantes, les Bituriges, les Arvernes, les Éduens. Ils avaient, en dépit de leurs divisions, la conscience d'une origine commune et les mêmes souvenirs de leurs exploits d'autrefois. Les ligues que les principales peuplades formaient pour établir leur suprématie, montrent au moins un besoin de groupement et le désir de l'union. Peut-être la Gaule possédait-elle déjà de grandes assemblées politiques où se réunissaient les représentants de toutes les nations. Il y avait en tout cas de ces conseils généraux pour les affaires religieuses, conseils présidés par les druides. Le clergé commençait l'unité religieuse : la Gaule avait de grands dieux communs, précurseurs de l'unité politique.
 |
 |
|---|
Monument d'Entremont (Musée d'Aix, 1er siècle avant notre ère.)
Certes elle ne formait pas plus un État que l'Italie avant la conquête romaine, que la Grèce de l'indépendance. D'unité semblable nous ne trouverions d'exemple dans aucune contrée du monde ancien. Mais, plus que l'Italie et plus que la Grèce, elle était destinée par la nature à devenir rapidement une nation compacte, à former une seule patrie, nulle contrée n'avait une structure si harmonieuse, un organisme si parfait; les anciens admiraient la Gaule comme ils eussent fait d'une œuvre d'art, et l'on ne peut mieux la juger qu'en résumant ce que disait d'elle le géographe Strabon : «II semble qu'une Providence a élevé ces chaînes de montagnes, rapproché ces mers, tracé et dirigé le cours de tous ces fleuves, pour faire un jour de la Gaule le lieu le plus florissant du monde ».
 Buste de Grézan (1). Musée de Nîmes.
Buste de Grézan (1). Musée de Nîmes.
(1) Monument récemment trouvé à Grézau, près de Nîmes, et qui parait appartenir au IIIème ou au IIème siècle avant notre ère. C'est peut-être la plus ancienne sculpture connue d'origine indigène.
CHAPITRE II
LA CONQUÊTE ROMAINE
1. Phéniciens et Grecs. — La civilisation et l'unité allaient être rapidement données à la Gaule par les deux grandes nations du monde antique, les Grecs et les Romains. Nous ne parlons pas des Phéniciens : des légendes les prornenaient un peu partout dans le midi et l'orient de la Gaule, et il n'est pas douteux qu'ils n'aient fondé quelques comptoirs isolés sur les rivages de la Méditerranée, par exemple à Marseille et à Monaco. Mais ils n'ont laissé aucune trace durable de leur séjour en Gaule, et ils ont cédé de bonne heure la place aux négociants grecs.
Les Phocéens, venus de l'Asie Mineure, s'établirent à Marseille vers l'an 600 avant notre ère. Marseille, Massilia, donna naissance à son tour à Nice, Antibes, Tauroentuni (près de la Ciotat), Agde. Elle étendit ses domaines et multiplia ses comptoirs même dans la vallée du Rhône, et elle sut presque toujours vivre en très bonne intelligence avec les Gaulois, sinon avec les Ligures. De la colonie phocéenne partaient sans cesse des caravanes de marchands et de banquiers pour se rendre dans les trois grandes vallées de la Gaule océanienne. Elles descendaient la Garonne jusqu'à Bordeaux, la Loire jusqu'à Nantes, la Seine jusqu'à Rouen :
des Grecs allaient s'embarquer dans ces bourgades, pour commercer avec les îles Britanniques. En même temps, la civilisation grecque, soit par la vallée du Rhône, soit par celle du Danube , rayonnait sur tout le monde gaulois, lorsque les Romains arrivèrent pour compléter et achever son œuvre.
2. La première province romaine. — Ce sont les Grecs qui les ont introduits dans notre pays. Marseille avait été de tout temps l'alliée de Rome. Dès l'année 155, inquiétée par les peuplades ligures qui l'avoisinaient, elle appela les Romains à son secours. Trente ans pins tard, vers 125, elle eut recours à eux une seconde fois; mais dès lors ils ne quitteront plus le sol gaulois.
 Drachme de Marseille (1).
Drachme de Marseille (1).
Il y eut, de 124 à 118. une série de campagnes contre les Ligures, les Allobroges, les Arvernes surtout; une grande victoire fut remportée, près du Rhône, sur le roi de ce dernier peuple, Bituit : on dit que cent vingt mille Gaulois périrent dans la bataille.
Ces combats heureux donnèrent aux Romains la suprématie sur tout le pays compris entre les Cévennes et les Alpes, de Toulouse à Genève et à Nice. Ils en firent une province de l'empire sous le nom de Gaule Transalpine. Leur principale ville fut Narbonne, où ils envoyèrent une colonie. Toulouse, Aix (Aquae Sextiae) étaient les autres places importantes de leur domination. Toutefois les Romains laissèrent aux Marseillais un très grand domaine entre le Rhône, la Durance et les Alpes Maritimes.
(1) Tête de déesse; au revers, lion, avec légende.
En même temps, ils préparèrent la voie à leur influence dans le reste de la Gaule. La plus civilisée des peuplades de la Celtique était celle des Éduens. Ils reçurent le litre glorieux d'alliés et d' « amis du peuple romain » et ils appelèrent les Romains du nom de « frères ».
3. Le rôle des Romains en Gaule. — L'empire de Rome valut bientôt à la Gaule du Midi un premier bienfait. Il la sauva de la terrible invasion des Cimbres et des Teutons. Le consul Marius écrasa les Teutons dans une grande bataille livrée près d'Aix, l'an 102. Ce fut la première des invasions germaniques qui devaient désoler notre pays jusqu'au Vème siècle, et Rome montra, au lendemain même de son arrivée, quel allait être son rôle chez les Gaulois : leur donner un pouvoir assez fort pour les défendre contre les envahisseurs germains.
Un général romain, Cérialis, le dit un jour à des Gaulois mécontents de Rome : « Les mêmes motifs de passer en Gaule subsistent toujours pour les Germains : l'amour du plaisir et celui de l'argent, et le désir de changer de lieu; on les verra toujours, quillant leurs solitudes et leurs marécages, se jeter sur ces Gaules si fertiles pour asservir vos champs et vos personnes ». Et, faisant allusion aux motifs qui appelèrent Jules César en Gaule, Cérialis disait « Lorsque les généraux de Rome entrèrent sur votre territoire, ce ne fut point par esprit de cupidité. Ils y vinrent à la prière de vos ancêtres, que fatiguaient de meurtrières dissensions, et parce que les Germains avaient réduit indistinctement à l'esclavage alliés et ennemis. Je ne parlerai point de tous nos combats contre les Cimbres et les Teutons, des grands exploits de nos armées et du succès de nos guerres avec les Germains; ils sont assez connus. Si nous nous sommes fixés sur le Rhin, ce n'a pas été pour proléger l'Italie, mais c'est pour veiller à ce qu'un nouvel Arioviste ne s'élevât pas sur vos têtes. »
4. L'état de la Gaule romaine sous la République.
Toutefois, si Rome sut bien défendre sa nouvelle province contre les barbares, elle ne chercha pas tout de suite à faire l'éducation des habitants et à développer la richesse du sol. Narbonne devint sans doute le centre d'un trafic très important; le pays fut rempli de négociants et de banquiers italiens, qui se répandirent même de là dans la Gaule indépendante; il y eut un gouverneur, qui avait le titre de « propreteur ».
Mais tout ce monde d'étrangers, plus avides encore qu'ambitieux, traitèrent la Gaule en pays conquis : ils l'exploitèrent, mais pour leur compte, pillant les temples, ruinant les riches, spéculant sur les biens des villes, multipliant les impôts. Un des propréteurs, Fontéius, se rendit par ses déprédations aussi célèbre en Transalpine que Verres le fut en Sicile. Les peuples de la Gaule envoyèrent à Rome une députation pour accuser leur gouverneur : défendu par Cicéron (en 69 av. J.-C.), Fontéius fut sans doute absous. Un de ses successeurs, Calpurnius Pison, se rendit coupable des mêmes excès : il fut l'objet d'une semblable accusation, mais il trouva le même défenseur et fut également renvoyé absous (en 67). Si la république romaine avait vécu, la Gaule n'aurait peut-être jamais atteint le degré de prospérité auquel elle arrivera sous l'empire; en tout cas, Rome n'y serait jamais devenue respectée et populaire.
5. L'intervention de César en Gaule. — C'est du reste la Gaule qui fut le point de départ de l'empire, car c'est dans la conquête de ce pays que le vrai fondateur du régime impérial, Jules César, trouva la puissance, l'armée et la gloire qui lui permirent de renverser les lois de son pays.
C'est en qualité de proconsul des Gaules Transalpine et Cisalpine qu'il commença, en 58, la conquête de la Gaule propre. Sans doute, il y avait songé depuis longtemps dans ses rêves ambitieux; car, de toutes les grandes contrées que touchaient au monde romain, la Gaule était la plus célèbre par la gloire de son passé, la bravoure de ses hommes, la richesse de son sol. De plus, l'occasion semblait y appeler César : le moment était propice pour lui de paraître en Gaule, plutôt comme libérateur que comme conquérant, et d'y affirmer la politique que Rome y avait prise dès le début. Les Suaves, puissante nation germaine, avaient franchi le Rhin et dominaient l'est du pays. Leur roi Arioviste parlait couramment de « sa Gaule ». Les Eduens, alliés de Rome, réclamèrent alors le secours de César, jouant au centre de la Gaule le même rôle que les Marseillais au Sud.
Une première campagne délivra la Gaule des Germains. Il est à croire que c'en était fait d'elle, faute d'unité et d'union, si les Romains n'étaient venus à temps pour la secourir, et qu'elle serait tombée sous l'empire des barbares. «Il arrivera nécessairement, disait un Gaulois en implorant le secours de César, qu'en peu d'années tous les Gaulois seront chassés de la Gaule, et que tous les Germains auront passé le Rhin ; car le sol de la Germanie et celui de la Gaule ne peuvent se comparer non plus que la manière de vivre des habitants. Si le peuple romain ne vient à notre secours, il ne nous restera d'autre parti à prendre que d'émigrer, d'aller chercher loin des Germains d'autres demeures, une autre patrie, et de tenter les chances d'une meilleure fortune. »
La Gaule divisée n'avait plus que le choix entre les deux dominations. En la débarrassant des Germains, même au prix de sa liberté, Rome l'a préservée de la barbarie et a peut-être sauvé sa race et son existence historique.
 Episode de la guerre des Gaules (Bas-relief du mausolée des Jules à Saint Rémy, époque d'Auguste.)
Episode de la guerre des Gaules (Bas-relief du mausolée des Jules à Saint Rémy, époque d'Auguste.)
Mais, une fois les Germains écartés, Jules César resta et commença la conquête pour son propre compte, plus encore peut-être que pour le compte de Rome. Pendant cinq ans, de 58 à 53, il soumit peu à peu tout le pays entre le Rhin et les Pyrénées; il ne se heurta guère qu'à des résistances régionales et fut en partie aidé par les dissensions locales et les rivalités entre peuples. Quelques-unes de ces nations se montrèrent dès le début des alliés sincéres des armes romaines : les Rèmes leur ouvrirent la Belgique comme les Eduens les avaient entrainées en Celtique.
 Episode de la guerre des Gaules (Bas-relief du mausolée des Jules à Saint Rémy, époque d'Auguste.)
Episode de la guerre des Gaules (Bas-relief du mausolée des Jules à Saint Rémy, époque d'Auguste.)
6. La guerre de l'indépendance : Vercingétorix.- Mais en 52, sous la direction de l'Arverne Vercingétorix, la Gaule entière se leva. Une seconde fois l'Arvernie fournit à Rome le plus redoutable de ses adversaires gaulois. C'était un jeune homme, riche et populaire, de haute condition. Il était d'ailleurs désigné pour le rôle de chef dans la lutte suprême : son père, tout-puissant chez les Arvernes, avait exercé sur toute la Gaule une sorte de suprématie politique. A la tête d'une troupe d'amis et de fidèles, Vercingélorix va de ville en ville, invoquant le nom de ses ancêtres, les glorieux souvenirs des conquêtes gauloises, et rappelant à tous le devoir de s'armer pour la a patrie. Ses paroles, son exemple, son action décidèrent enfin le pays à une action commune. Des extrémités de l'Armorique aux bords de la Marne, de la Garonne aux monts d'Auvergne, toutes les cités envoyèrent à Vercingétorix des soldats et des chevaux et lui confièrent le commandement suprême. César dut reconnaître cette fois le merveilleux accord de la Gaule pour ressaisir son indépendance.
 Monnaie de Vercingétorix (1)
Monnaie de Vercingétorix (1)
« II y eut alors chez les Gaulois, dit-il, une telle ardeur unanime pour reconquérir la liberté et pour ressaisir l'ancienne gloire militaire de leur race, que même les anciens amis de Rome oublièrent les bienfaits qu'ils avaient reçus d'elle et que tous, de toutes les forces de leur âme et de toutes leurs ressources matérielles, ne songèrent plus qu'à se battre. »
Toutefois, il fallut céder devant la ténacité du proconsul et la solidité des légions romaines. Des combats acharnés se livrèrent à Avaricum (Bourges), à Gergovie en Auvergne, à Alésia dans la Côte-d'Or.
1. Cabinet des médailles. Elle représente peut-être le portrait idéalisé du chef; légende : Vercingétorix.
Vercingétorix dut s'avouer vaincu.
 Gergovie
Gergovie
" Si le nombre des hommes et leur courage, dit Fustel de Coulanges, avaient suffi pour être vainqueur, Vercingétorix l'aurait été. Vaincu, il tomba en homme de coeur." "Vercingétorix, raconte Plutarque, avait été l'âme de toute cette guerre. Il se couvrit de ses plus belles armes et sortit d'Alésia sur un cheval magnifiquement paré ; il le fit caracoler autour de César, qui était assis sur son tribunal; puis il mit pied à terre, se dépouilla de ses armes et alla s'asseoir aux pieds du proconsul. Il se tint ainsi en silence. César le remit en garde à des soldats et le réserva pour son triomphe."
 Alésia (Alise-Sainte-Reine)
Alésia (Alise-Sainte-Reine)
II y eut, en 51, un dernier soulèvement et une résistance obstinée de la ville d'Uxellodunum, chez les Cadurques. Mais, à partir de l'an 50, sauf des révoltes isolées, toute la Gaule se déclara soumise.
7. Le patriotisme gaulois. — De toutes les contrées qui ont formé l'empire romain, aucune n'a été plus vite réduite que la Gaule. Ce sont les Romains eux-mêmes qui l'ont remarqué et répélé. Est-ce à dire que le patriotisme lui a manqué? Certains partis politiques et certaines villes ont été favorables aux Romains; mais la même désertion s'est produite en Grèce aux temps de l'invasion des Perses et des guerres contre la Macédoine et contre Rome; on la retrouve encore en Italie lors des luttes pour l'indépendance; elle se rencontre sans cesse dans les États du monde ancien, où les passions politiques ont toujours tenu en échec les intérêts nationaux.
La résistance de la Gaule a été plus courte que celle de l'Espagne; mais elle a été plus générale, elle s'est vite centralisée, elle a pris rapidement ce caractère d'unité que nécessitait la structure du pays et que provoquaient les instincts de la race. Devenue compacte, elle a pu être brisée d'un seul coup. Pour être courte, elle n'en fut pas moins intense. Songeons que la Gaule a eu affaire au plus grand capitaine des temps anciens, que ses légions ne l'ont pas quittée pendant huit ans, qu'il l'a parcourue, pillée, piélinée, sans une minute de répit. Songeons surtout à l'état où il l'a laissée : "Qu'on se représente, dit un écrivain romain, un malade, pâle, décharné, défiguré par une longue fièvre brûlante qui a tari son sang et abattu sa force pour ne lui laisser qu'une soif importune et qu'il ne peut satisfaire. Voilà l'image de la Gaule épuisée et domptée par César d'autant plus altérée de la soif ardente de sa liberté perdue que ce bien précieux semble lui échapper pour jamais. De là, la perte de l'espérance même." César nous apprend Plutarque avait pris de force plus de huit cents villes, soumis plus de trois cents nations, combattu en divers temps contre trois millions d'hommes, sur lesquels un million périt en bataille rangée et un million fut réduit en captivité.
 Monnaie de Vercingétorix (1), grossie au quintuple.
Monnaie de Vercingétorix (1), grossie au quintuple.
" A l'étendue des souffrances, on devine l'énergie de la lutte : on peut affirmer que les Gaulois n'ont jamais montré, dans Alésia, moins d'union et de patriotisme que les Espagnols à Numance ou les Grecs à Salamines.
(1) Collection Changarnier à Beaune, légende : VERCINGETORIXIS. De toute les pièces au nom du chef, c'est peut être celle qui représente le plus exactement ses traits.
CHAPITRE III
LA GAULE SOUMISE ET FIDÈLE A ROME
1. Les premiers jours de la soumission. — L'empereur Claude sollicitait un jour du sénat romain, pour les premiers d'entre les Gaulois, le privilège de devenir sénateurs. Le principal mérite qu'il reconnaissait aux Gaulois était celui de la fidélité : « Il faut considérer, Pères Conscrits, que ce pays, qui a fatigué le dieu Jules par dix années de guerre, a compensé ces dix années par un siècle d'immuable fidélité, d'une soumission éprouvée au delà de tout ce qu'on peut dire et cette soumission ne s'est point démentie dans les temps les plus troublés de notre histoire ».
Dès le lendemain de la conquête, les Gaulois avaient, en effet, montré qu'ils l'acceptaient de bonne grâce. Jules César trouva chez eux quelques-uns de ses meilleurs soldats : la Gaule aida son vainqueur à fonder l'empire. Il avait près de lui une légion composée exclusivement de soldats levés en Gaule : il l'appelait « la légion des Alouettes », Alaudae, du nom de l'oiseau cher à la nation celtique. On lui reprocha d'avoir fait entrer des Gaulois dans le sénat. Quand il triompha, les soldats le plaisantaient en l'appelant « l'ami des Gaulois ». Ses ennemis disaient hautement qu'à force de vivre au milieu des Gaulois, César était devenu Gaulois lui-même: « Du haut des Alpes, il a déchaîné la furie celtique. Cette race, c'est lui qui l'a soulevée et qui la conduit; des bords de l'Océan et du Rhin, elle accourt sous ses drapeaux : il lui a promis le pillage de Rome. » " Adieu l'urbanité romaine! s'écriait tristement Cicéron; adieu la fine et élégante plaisanterie! la braie gauloise a envahi nos tribunes."
Par un bizarre revirement, le vainqueur de la Gaule était devenu le chef des Gaulois. Il semble que les malheurs de la guerre n'aient point empêché la sympathie de naître entre les Celtes et leur conquérant : ils ont dû aimer son intelligence ouverte, son esprit aux vastes espérances, son humeur facile, son tempérament éveillé et nerveux, et César de son côté a pu, en les étudiant, retrouver dans leur nature ses propres qualités.
Les Gaulois purent, dès les premiers jours de la domination romaine, en apprécier les bienfaits : dans leur pays désormais tranquille l'ère de la conquête apparut, comme l'ère de la prospérité. « Voyez cette Gaule, disait Marc-Antoine dans son panégyrique de César, cette Gaule qui nous envoya de si redoutables ennemis : elle est aujourd'hui cultivée comme l'Italie. Des communications nombreuses et sûres sont ouvertes d'une frontière à l'autre : la navigation est libre et animée jusque sur l'Océan. »
2. La Gaule sous Auguste et Tibère; la famille de Drusus (30 av.-37 ap. J.-C.). — Le gouvernement, des deux premiers successeurs de César, Auguste et Tibère, fut assurément moins agréable aux Gaulois. Leur politique froide, étroite, strictement attachée aux intérêts romains, n'était pas de nature à leur gagner les cœurs. Il y eut quelques séditions sous le règne d'Auguste, mais toutes locales, soit en Aquitaine, soit dans le Nord-Est.
 Combat entre les Gaulois de Sacrovir et les Romains. (bas-relief de l'Arc d'Orange, époque de Tibère)
Combat entre les Gaulois de Sacrovir et les Romains. (bas-relief de l'Arc d'Orange, époque de Tibère)
Une révolte plus importante éclata sous Tibère, en l'an 21 : elle eut pour chefs le Trévire Florus et l'Eduen Sacrovir mais elle fut aisément réprimée : ce ne fut en aucune manière un soulèvement national. Même en ce temps-là les Romains n'avaient pas besoin, pour contenir les Gaules, d'un grand nombre de soldats. Un millier d'hommes suffisaient pour habituer à l'obéissance leurs douze cents bourgades.
Les villes gauloises s'étaient dès lors mises à travailler sous la loi romaine. Les premières années du règne d'Auguste avaient vu commencer leur transformation. Toutes les villes de la Gaule du Midi, la Narbonnaise, étaient déjà décorées de somptueux édifices. Partout ailleurs, la langue, les arts et les usages de Rome avaient également pénétré. Dès les temps d'Auguste et de Tibère, des inscriptions latines furent gravées dans presque toutes les cités d'entre Rhin et Pyrénées : la langue en est aussi correcte, la gravure aussi pure, l'apparence presque aussi régulière que celles des inscriptions contemporaines de Rome et de l'Italie. C'est sous le règne de Tibère que la corporation des bateliers de la Seine, nautae Parisiaci, élève à Paris un monument au grand dieu romain du Capitole, « Jupiter Très Bon et Très Grand ».
D'ailleurs, en ce moment, la domination romaine rendait à la Gaule un service signalé. Les campagnes de Drusus et de son fils Germanicus au delà du Rhin lui assuraient enfin la sécurité; le péril de l'invasion germanique était pour longtemps écarté. Aussi ces deux vaillants princes, plus aimés des Gaulois que ne le furent Auguste et Tibère, contribuèrent infiniment plus que leurs deux empereurs à consolider au delà des Alpes le régime impérial et l'œuvre romaine. A cet égard, ils furent en Gaule les vrais héritiers de Jules César; c'était sa politique qu'ils continuaient : ils fortifiaient contre la Germanie la frontière du Rhin, ils prenaient la revanche de la Gaule sur Arioviste.
En même temps, Drusus lui donnait une capitale, Lyon : c'est là que, l'an 12 avant notre ère, se réunirent les délégués de toutes les villes de la Gaule conquise par César ; elle arrivait ainsi, sous les lois de Rome, à cette unité politique qu'elle avait jusque-là connue si rarement.
Dans leurs rapports avec les Gaulois, Drusus et Germanicus maintenaient la tradition de César. Actifs, intelligents et affables, ils vivaient au milieu des provinciaux, cherchaient à gagner leur sympathie, ne cachaient point celle qu'ils éprouvaient pour eux. La famille de Drusus trouvait ainsi le plus sûr moyen de concilier la souveraineté de Rome et l'amour-propre gaulois. Aussi est-elle demeurée longtemps populaire dans nos pays, et de différents côtés des monuments s'élevèrent en son honneur.
3. Caligula et Claude (37-54 ap. J.-G.). — Ce fut sous les deux empereurs de la famille de Drusus, Caius Caligula et Claude, que la Gaule fut le plus prospère pendant le Ier siècle. C'est alors que l'essor pris par les grandes villes de la Narbonnaise se propagea dans les cités du Nord et de l'Ouest. De grandes constructions s'élèvent à Trêves, à Saintes, des jeux sont fondés à Lyon. Caius, malgré son extravagance, Claude, malgré sa sottise, firent aux Gaulois beaucoup de bien et peu de mal. Le premier aimait à se montrer aux populations de la Gaule et ne se fâchait point trop de leurs railleries. Claude, né à Lyon, s'occupa de très près des affaires de la Gaule. L'aristocratie romaine, qui chargea volontiers d'outrages ces empereurs amis des provinciaux, l'appela « un vrai Gaulois », ainsi qu'elle avait autrefois nommé César.
Il plaida même un jour la cause de ses chères provinces dans un discours prononcé en plein sénat, discours qui nous a été conservé. "Claude, dit M. Duruy, avait deviné ce secret de la grandeur romaine ; en plein sénat, en face de ces nobles qui oubliaient que leur laticlave cachait tant d'Italiens et d'étrangers, il rappela, avec une rare intelligence de l'histoire, comment Rome s'était formée; il montra que la même loi d'extension continue et d'assimilation progressive qui avait fait la fortune de la république devait être le salut de l'empire." La conquête de la Bretagne, sous ce règne, assura la frontière de la Gaule contre toute incursion de pirates et ouvrit un important débouché au commerce du pays. Protégée par les camps de Bretagne et de Germanie, la Gaule cessait d'être un pays frontière et pouvait s'adonner sans retour à de pacifiques travaux.
4. Les révoltes de 69-70. —Mais, pendant l'anarchie qui accompagna la mort de Néron, la Gaule se remua et quelques indices montrèrent que sa fidélité à l'empire n'était pas inébranlable. Deux nations orientales, les Lingons et lesTrévires, se détachèrent de l'empire; un instant même on prononça le nom d' « empire des Gaules »imperium Galliarum, comme au temps des Bituriges et des Arvernes. Mais ce fut peut-être une formule imaginée par les chefs plus encore qu'une espérance conçue par les peuples. Car il n'y eut pas, à beaucoup près, une insurrection générale ni même essentiellement gauloise. Trévires et Lingons reconnurent l'autorité suprême d'un Germain, Civilis : c'étaient des Germains qui faisaient la principale force des révoltés. Ci et là, quelques druides prédisaient la chute de Rome; mais c'était une prophétesse germaine, Velléda, qui inspirait les chefs.
Au surplus, quand la révolte parut un instant triomphante, des députés de toutes les villes gauloises se réunirent d'eux-mêmes à Reims, et là on délibéra librement sur la question de l'indépendance : les discussions eurent lieu à l'écart de toute menace armée, à l'abri même de toute influence. Or la presque unanimité des délégués se déclarèrent pour la fidélité à l'empire, et ce ne fut pas la crainte seule qui les décida, « Julius Auspex, un des chefs rémois, raconte Tacite, exposa la force de Rome et les bienfaits de la paix ; il retint les plus ardents par la crainte, les plus sages en leur rappelant le respect dû aux serments. D'ailleurs, toutes ces villes se jalousaient. On le savait, on craignait les conséquences de leurs rivalités. Si l'on faisait la guerre, qui commanderait ? Qui donnerait le mot d'ordre, ferait prêter serment, prendrait les auspices ? Si l'on était vainqueur, où serait la capitale? Par dégoût de l'avenir, on préféra le présent. L'assemblée écrivit une lettre aux Trévires, les invitant, au nom de toutes les Gaules, à déposer les armes. »
Civilis et ses adhérents, isolés en Gaule, furent battus et le général romain, Cérialis, en s'adressant aux Gaulois domptés, leur rappela dans un discours solennel que leur intérêt national et leur vérilable patriotisme devaient les unir autour de Rome et des héritiers de César contre les Germains et l'émule d'Arioviste. Rome éloignait de la Gaule les deux grands périls de l'indépendance, la barbarie germaine et l'anarchie politique.
5. Le temps de la paix romaine (70-180). — Depuis lors, pendant un siècle, la Gaule jouit d'une paix continue; c'est le temps où régnent à Rome les Flaviens et les Antonins, l'époque la plus prospère pour l'empire, le moment où notre pays fut le plus heureux, le plus calme, le plus laborieux. C'est alors que le sol se transforma, que les villes achevèrent de se construire, que la langue, les mœurs, le bien-être romains pénétrèrent dans nos campagnes les plus reculées. Cent ans durant, la Gaule travailla avec passion, sous la protection des troupes qui stationnaient sur la frontière du Rhin : la Germanie était alors si peu menaçante qu'on réduisit l'effectif du corps chargé de la contenir. Ce siècle fut le vrai temps, le seul temps peut-être, de ce que les auteurs, les monnaies et les lois appellent la « paix romaine », la sécurité romaine », la « félicité romaine », pax romana, securitas, félicitas, pax populi romani.
Assurément, la glorieuse lignée des Antonins fut moins populaire en Gaule que ne l'avait été celle des Césars du Ier siècle; ils étaient plus fidèles que les hommes de la famille de Drusus aux habitudes et aussi aux préjugés du monde gréco-latin, et c'était dans l'aristocratie romaine qu'ils cherchaient surtout leurs amis. Mais, s'ils se montrèrent assez froids pour la nation gauloise, s'ils ne lui accordèrent aucun nouveau privilège politique, ils ne furent point avares de
leurs bienfaits, et surtout de leurs trésors ; ils eurent tous également le souci de la prospérité financière et de l'éclat matériel des cités gauloises. En ce temps s'élevèrent quelques-uns des plus beaux monuments du Midi. Hadrien visita la contrée, s'informant de ses besoins, aidant les villes endettées, méritant le titre que lui donnent ses monnaies, de « restaurateur », de «conservateur des Gaules »
 Monnaie d'Hadrien, restaurateur de la Gaule.
Monnaie d'Hadrien, restaurateur de la Gaule.
On a trouvé une trace précieuse du voyage que fit Hadrien dans les Gaules : c'est l'épitaphe de son cheval Borysthène, qui fut enterré à Apt, en Vaucluse, et cette épitaphe, dit-on, a été composée par l'empereur lui-même, qui se piquait d'être poète à ses heures de loisir.
La famille d'Antonin était originaire de Nîmes; le pieux empereur et son père adoptif Hadrien ornèrent la ville de beaux édifices : ce fut une ère glorieuse pour la cité nîmoise, qui put se croire un instant la « Rome des Gaules ». Marc-Aurèle se tint assez à l'écart du monde gaulois : son devoir d'empereur le retint sur les bords du Danube, menacés par les barbares; son âme de philosophe l'attachait aux traditions des peuples helléniques.
6. Le temps de l'anarchie et les empereurs gallo-romains (180-273). — A partir de la mort de Marc-Aurèle, la Gaule commença à être troublée par le brigandage d'abord, puis par les incursions des Germains et les luttes politiques.
En 197, deux prétendants à l'empire, Clodius Albinus et Septime Sévère, se livrèrent une grande bataille près de Lyon ; à la suite de violents combats, la riche métropole des Gaules fut pillée et brûlée et dès ce jour commença pour elle
Lyon une irrémédiable décadence.
Toutefois, la Gaule ne profita point du désordre pour ressaisir une indépendance à jamais oubliée.
 Monnaie d'or de Postume, avec la légende : POSTVMVS PIVS AUGustus
Monnaie d'or de Postume, avec la légende : POSTVMVS PIVS AUGustus
Elle ne concevait pas un état de choses autre que le régime romain : comme l'a bien dit M. Lavisse, l'empire romain était pour elle, ainsi que pour le monde entier, beaucoup moins une domination qu'une" façon d'être".
 Monnaie de Postume et de Laetianus
Monnaie de Postume et de Laetianus
Vers le milieu du IIIème siècle, au temps que l'on est convenu d'appeler l'anarchie militaire, elle se trouva abandonnée des empereurs de Rome, livrée à elle-même, menacée par de nouvelles invasions germaniques. Alors, sans se
détacher de l'empire, elle se donna des empereurs : Postume, Lélianus, Victorinus, Marius, Tétricus, qui régnèrent l'un après l'autre, de 258 à 273.
Mais ces princes ne firent rien pour réveiller les vieux souvenirs celtiques, tout au plus peut-on constater qu'ils avaient un certain penchant à représenter sur leurs médailles les noms des grandes divinités gallo-romaines.
 Monnaie de Victorinus et de Tétricus
Monnaie de Victorinus et de Tétricus
Mais, dans leurs actes officiels, c'est du latin qu'ils se servaient; la langue des inscriptions qu'ils firent graver est le latin, comme celle de leurs monnaies; leurs titres sont ceux des empereurs de Rome, ils s'appellent césars, augustes, consuls. Enfin, leur politique est franchement romaine : c'est le nom romain qu'ils défendent aux frontières contre les barbares ; c'est l'œuvre d'Auguste et d'Hadrien qu'ils continuent dans les cités; c'est la civilisation latine qu'ils patronnent à l'intérieur.
Ce fut d'ailleurs un bienfait pour la Gaule que cette domination. Elle put, pendant quelques années, travailler et prospérer comme aux beaux temps d'Hadrien; les routes furent réparées, de beaux monuments s'élevèrent dans les villes, les barbares furent contenus; le titre de « restaurateur des Gaules » reparut comme épithète des empereurs.
Le monde romain lui-même profita tout entier à cette création d'un empire gaulois. Un historien officiel de la fin du IIIème siècle a caractérisé en ces termes l'œuvre des cinq empereurs gaulois : " Ils ont été les vrais défenseurs du nom romain. C'est, je crois, un décret de la Providence qui a voulu que la Gaule ait eu ses propres empereurs. Sans eux, les Germains franchissaient le Rhin et foulaient le sol romain. Or, en ce temps-là, Perses et Goths étaient répandus dans l'empire : que serait-il arrivé si tous ces barbares s'étaient rejoints? Certes, c'en était fait du nom de l'empire romain."
7. Les empereurs du quatrième siècle (274-395). — La Gaule n'opposa aucune sérieuse résistance aux empereurs Aurélien et Probus qui voulurent reconstituer l'unité de l'empire. Mais les premières années de cette restauration ne lui furent pas favorables. Les Germains reparurent et, pendant quelques mois, furent les vrais maîtres de la Gaule, qu'ils mirent à feu et à sang. Les années 275 et 276 ont été, en particulier, les plus funestes que notre pays ait vues sous la domination romaine. Soixante villes furent détruites, l'œuvre des trois premiers siècles fut presque tout entière anéantie dans la Gaule du Nord et de l'Ouest.
Au IVème siècle, la Gaule jouit d'une paix relative, à la faveur de laquelle elle acheva enfin de devenir romaine. Les écoles s'y multiplièrent; elle eut des orateurs et des poètes, ce fut, dans l'histoire littéraire de Rome, le moment où la Gaule prit le premier rang. Il y eut chez elle un élan inusité de vie intellectuelle, en même temps qu'un dernier regain de luxe et de culture.
Elle fut le plus souvent fidèle aux empereurs de Rome, mais à une condition, c'est qu'ils vécussent au milieu d'elle. Elle créa quelques usurpateurs à l'empire, mais elle s'attacha aux princes qui séjournèrent dans ses provinces et qui surent ainsi flatter son amour-propre national. Maximien, Constance Chlore, Valentinien, Gratien furent sans doute populaires en Gaule. Julien le fut très certainement.
 Julien. (Paris, palais des thermes).
Julien. (Paris, palais des thermes).
Son intelligence éveillée, son humeur enjouée, la simplicité de son allure, la séduisante jeunesse de son esprit et de son cœur lui attirèrent toutes les sympathies; la Gaule vit en lui un empereur de son tempérament. « Je me trouvai, écrit Julien, avec des hommes incapables de faire leur cour et de flatter, accoutumés à vivre simplement et librement avec tout le monde. J'avais trop de sympathies pour les Gaulois pour n'en être pas aimé. Leurs biens, leurs personnes, tout était à moi. Combien de fois m'ont-ils forcé d'accepter l'argent qu'ils m'offraient ? Ils me chérissent à l'égal de leurs propres enfants. » Julien nous parle longuement de Paris, qu'il affectionnait comme résidence : car la situation géographique de la ville, au carrefour de grandes vallées fluviales, faisait d'elle le centre naturel de concentration des troupes pour préparer les campagnes contre les Germains, envahisseurs de la Gaule.
Les autres empereurs préférèrent le séjour de Trêves; ils y étaient plus près de la frontière. Trêves fut la vraie capitale militaire de la Gaule à la fin du IVème siècle. Ce fut la clef de la défense de l'empire contre la Germanie. Au moment des grandes invasions, nul pays n'était donc plus romain que la Gaule, nul n'était plus étroilement associé à l'œuvre romaine: c'était le séjour aimé des empereurs, la gloire des lettres latines, le boulevard de Rome et l'ornement de l'empire.
CHAPITRE IV
LES POUVOIRS SOUVERAINS EN GAULE : L'ÉTAT ROMAIN ET L'EMPEREUR
1. Citoyens romains et étrangers. — La Gaule faisait partie d'un vaste État qui s'étendait des bords de l'Océan jusqu'aux rives de l'Euphrate, de celles du Rhin et du Danube jusqu'aux déserts de l'Afrique. Le centre de cet Etat était le bassin de la mer Méditerranée, « notre mer », mare nostrum, disaient les Romains. C'était le long des rivages de cette mer que la conquête romaine s'était peu à peu propagée. C'était elle qui donnait maintenant à l'État romain son unité géographique et sa symétrie extérieure.
Cet Etat s'appelait, du nom du peuple qui l'avait créé et auquel il obéissait, « l'empire romain », imperium populi romani, imperium romanum. Il comprenait deux groupes bien distincts d'habitants : les membres du peuple romain, cives romani, étaient seuls les maîtres, jouissaient seuls, en droit, de la souveraineté politique; les autres peuples compris dans les limites de l'empire, même ceux auxquels on donnait le titre honorifique d' « alliés du peuple romain », n'étaient que de simples sujets, à la discrétion des magistrats de Rome ou de leurs délégués.
En vertu de son droit de conquête, Rome avait en effet, sur ses sujets et sur leurs biens, un pouvoir sans limites : elle était la maîtresse absolue des hommes qui s'étaient soumis à elle et la seule propriétaire du sol qu'elle avait conquis. La formule habituelle par laquelle on se soumettait à son empire le reconnaissait expressément : « Je donne, disait cette formule, ma personne, ma ville, ma terre, l'eau qui y coule, mes dieux termes, mes temples, mes objets mobiliers, toules les choses qui appartiennent aux dieux, je les donne au peuple romain. »
II y avait ainsi dans ce vaste empire deux grandes classes d'hommes, et entre ces classes le droit ancien plaçait, semble-t-il, d'infranchissables barrières : les citoyens romains et « les étrangers », peregrini.
2. Extension du droit de cité. — Seulement, et c'est ce qui fait la grandeur du rôle que Rome a joué dans l'histoire, elle n'appliqua jamais en Gaule les dernières conséquences du droit de conquête. Elle ne voulut point perpétuer entre les citoyens et les étrangers ces distinctions ineffaçables qu'ont maintenues si longtemps tant d'autres États de l'antiquité.
Elle accorda peu à peu à un grand nombre d'alliés et de sujets le droit de cité, et les admit ainsi au partage de l'autorité souveraine. On put, sans être né à Rome, sans même y séjourner, devenir citoyen romain, sénateur, magistral de Rome : un sujet gaulois put être ainsi transformé en un membre du peuple romain.
Même aux Gaulois, Rome ouvrit toutes grandes les portes qui permettaient d'entrer dans la cité. Dès le lendemain de la conquête, on en vit qui pénétrèrent au sénat. Quelques villes de la Gaule méridionale reçurent le litre de « colonies romaines » : leurs habitants, les indigènes aussi bien que les émigrants envoyés d'Italie comme colons, étaient citoyens de plein droit. D'autres villes, également dans le Midi, prirent le litre de « colonies latines »; d'autres encore obtinrent ce qu'on appelait « le droit latin », Latium, jus Latii. Les habitants des villes dites « latines », qui devenaient sénateurs ou magistrats dans leur pays natal, arrivaient, par là même, au droit de cité romaine : l'État l'accordait, par ce détour, aux plus considérés d'entre les étrangers. Il le concéda de même à ceux qui le servaient comme soldats : le conscrit gaulois qui était incorporé dans une légion était fait citoyen romain avant d'y entrer (car il ne pouvait y avoir que des citoyens dans une légion); le conscrit qui servait dans les autres corps de troupes, dits " corps auxiliaires", recevait le droit de cité en sortant du service.
Le droit de cité ne cessa d'être largement octroyé aux Gaulois sous les premiers empereurs, surtout sous César, Caligula et Claude. A partir du règne de Claude, les citoyens romains forment la majorité des habitants de la GauleNarbonnaise; et, dans le reste du pays, tous ceux qui, à des titres divers, comme magistrats municipaux, comme prêtres ou soldats, avaient rendu des services à l'Etat romain, jouissaient du droit de cité et faisaient souche de citoyens. L'aristocratie romaine se plaignait vivement de cette extension; elle reprochait en particulier à l'empereur Claude d'avoir voulu octroyer le droit de cité à tous les habitants de l'empire : « Par Hercule ! dit la Parque dans une satire composée par Sénéque, je voulais ajouter quelques jours à la vie de Claude, pour qu'il fit citoyens ce peu de gens qui restent à l'être; car il s'était mis en tête de les voir tous en toge romaine, Grecs, Gaulois, Espagnols, Bretons même ». D'ailleurs, ajoute Sénèque, « c'était un franc Gaulois; et, comme il convenait à un Gaulois, il a pris Rome ». C'est-à-dire, sans aucun doute, il a donné aux Gaulois les droits des Romains.
Les empereurs qui suivirent Néron furent plus imbus des préjugés de l'aristocratie italienne; aussi les vit-on moins prodigues de ce droit de cité. Mais aucune restriction ne fut apportée aux lois qui le conféraient.
Sous Caracalla, enfin, un édit impérial donna le droit de cité à tous les habitants de l'empire. Désormais, il n'y eut plus qu'un seul peuple dans tout l'État romain; on ne distinguera plus des sujets, des alliés, des maîtres qui étaient seuls citoyens romains. Il n'y eut plus qu'un seul nom, qu'une seule patrie, qu'une seule cité.
3. Le régime impérial. — Le gouvernement de la cité romaine avait été, jusqu'en l'an 49 avant notre ère, le gouvernement républicain. La Gaule obéissait au peuple et au sénat de Rome. Après l'usurpation de Jules César, le pouvoir d'un seul succéda à celui du peuple romain. Le peuple fut censé déléguer son autorité, qu'on appelait imperium, à un chef unique; comme délenteur de cette souveraineté populaire, ce chef prenait le litre d'imperator, « empereur ». Sauf une courte tentative de restauration républicaine, en 44, le régime impérial ne cessa de gouverner pendant cinq siècles l'État romain.
C'est donc à peu près le seul régime que la Gaule ait connu. Que les Gaulois fussent ou non citoyens romains, ils ont constamment obéi à des empereurs : car le prince commandait à la fois au peuple romain et aux sujets du peuple romain.
L'autorité exercée par l'empereur était absolue. Jamais monarchie n'a été aussi complète que la monarchie romaine. Le prince réunissait entre ses mains tous les pouvoirs ; pour mieux indiquer quels étaient ses droits, on lui donnait une série de titres qui leur correspondaient.
Ces titres se lisent tout au long dans les documents ou sur les inscriptions. L'empereur Antonin est appelé, par exemple, dans une inscription de Nîmes, imperator Caesar divi Hadriani filius, Titus Aelius Hadrianus Antoninus, augustus, pius. pontifex maximus, tribunitia potestate VIII, imperator II. consul IIII, pater patriae.
4. L'empereur, chef militaire. — L'empereur est surtout un imperator, c'est-à-dire un chef militaire : il possède l'imperium, qui comprend le droit de lever des troupes, de commander aux soldats, de déclarer et de faire la guerre : c'est le général en chef de toutes les armées romaines.
La direction suprême des affaires militaires est pour lui, à la fois, un droit et un devoir. C'est une obligation de son titre de paraître à la lête des armées. Il n'est guère d'empereur, si poltron et si mou qu'il fût, qui ne vint un instant en Gaule diriger en personne les campagnes contre les Germains et se montrer aux troupes et à l'ennemi. Tibère fit exception.
Comme imperator encore, le prince exerce les droits que la conquête a conférés au peuple romain : il est le maître des provinciaux; il a sur eux le «droit du glaive», jus gladii. Il est le proconsul, le gouverneur légitime de toutes les provinces conquises par Rome.
5. Les pouvoirs civils de l'empereur. — L'empereur a ce qu'on appelait la tribunitia potestas, « la puissance tribunitienne » : il est inviolable et possède tous les droits et les les privilèges que le peuple conférait autrefois à ses tribuns par l'élection. Il est son protecteur, mais il est aussi son chef.
Il dirige les affaires civiles, il juge, il a un tribunal, il détient l'autorité législative, il administre et il décrète. C'est le premier en dignité de tous les citoyens; si, comme imperator, il se montre surtout en maître, dominus, la puissance tribunitienne fait de lui un supérieur et un prince, princeps. Aussi le régime impérial s'appelle-l-il également un « empire », une « domination » et un « principat».
C'est ce titre de princeps qui confère à l'empereur, dans Rome, l'autorité suprême, comme le titre d'imperator la lui confère dans les provinces et à la têle des armées. On peut presque dire que la qualité de princeps est une émanation de l'antique autorité royale.
Sur les inscriptions, on compte les années de règne du prince par le chiffre de ses puissances tribunitiennes. Quand nous lisons sur un monument : tribunitia potesiate VIII, il faut comprendre que ce monument date de la huitième puissance tribunitienne, autrement dit de la huitième année du gouvernement du prince.
Ajoutons à cela que l'empereur prend de temps à autre le titre de consul, le consulat étant la plus ancienne, la plus respectée et la plus élevée des magistratures romaines.
Enfin, en sa qualité de pontifex maximus, « souverain pontife », l'empereur est le chef suprême de la religion romaine.
6. Caractère sacré de l'empereur. — Surtout, il porte le titre d'augustus, «auguste». Ce titre ne lui confère aucun pouvoir, ne lui vaut aucun droit. Mais il fait de lui une personne sainte : c'est plus qu'un homme, plus qu'un chef, plus qu'un maître. C'est un demi-dieu dès son vivant, comme Hercule, comme Castor ou Pollux. A l'empereur on doit surtout l'obéissance, à l'auguste on doit la fidélité religieuse et comme la dévotion. Après sa mort, le prince pourra être complètement divinisé et, sous le titre de divus, il prendra place parmi les vrais dieux. De son vivant, sa famille est la « maison divine », domus divina, dit-on couramment.
7. La centralisation administrative. — Rarement le monde a vu une centralisation aussi complète que ce régime: toutes les supériorités divines et humaines avaient été mises aux mains d'un seul homme; l'obéissance et les prières convergeaient vers lui de tous les points du monde.
Ce fut l'empire qui fit connaître à la Gaule la centralisation administrative. Tous les fonctionnaires qui, en Gaule, représentaient l'état romain, les chefs des armées et des flottes, les gouverneurs, les intendants de finances, tous, relevaient directement du prince. Il avait, pour l'aider dans sa lâche, un certain nombre de bureaux résidant à Rome : il y avait un bureau de finances, a rationibus; un bureau de requêtes, a libellis; un bureau des archives, a memoria; un bureau des affaires judiciaires, a cognitionibus; un bureau de la correspondance, ab epislulis. Le préfet du prétoire assistait le prince dans les affaires militaires et judiciaires. Sur toutes choses, d'ailleurs, l'empereur décidait souverainement : toutes les affaires, grandes ou petites, des moindres cités de la Gaule, pouvaient être évoquées devant lui.
8. La religion impériale. — Mais il faut se garder de conclure que la monarchie romaine ait été une tyrannie inquiète et détestée. Cet absolutisme s'est concilié avec l'affection des sujets. On adora l'empereur comme augustus ou comme divus, autant qu'on put le redouter comme imperator et lui obéir comme princeps.
Il y eut, par toute la Gaule, dès les temps d'Auguste et de Tibère, un prodigieux développement de cette religion, que nous pouvons appeler la religion impériale. A Lyon, à Narbonne, on éleva des autels où les délégués des villes gauloises sacrifièrent à Rome et à l'auguste, à la cité maîtresse de l'empire et à son délégué suprême. Aux jours solennels, des victimes étaient immolées, du vin répandu, et l'encens brûlait en l'honneur du demi-dieu que, suivant l'expression emphatique d'une inscription de Narbonne, « la félicité du siècle a donné comme chef à l'univers tout entier ». On créa, dans les villes, des prêtres officiels, ou flamines, pour desservir le culte des empereurs divinisés, et ces prêtres furent toujours choisis parmi les premiers personnages de la cité. Il se forma, parmi les gens de moindre rang, des corporations pour célébrer le culte des empereurs régnants, seviri augustales. Les particuliers mirent la statue du prince à côté de celles de leurs lares et pénates, du Mercure gaulois ou des Génies locaux. Les inscriptions abondent, dédiées par des hommes qui se sont « dévoués à la divinité impériale », dévotus numini majestalique augusti, ou qui élèvent un autel « en l'honneur de la famille divine », in honorem domus divinae.
L'union des cœurs se fit par celle religion, comme celle des intérêts par l'obéissance au prince. Fustel de Coulanges a admirablement montré la place que cette religion prit dans les âmes des Gaulois et dans la vie de ce temps : « La puissance suprême se présentait aux esprits comme une sorte de Providence divine. Elle s'associait dans la pensée des hommes avec la paix dont on jouissait après de longs siècles de troubles, avec la prospérité et la richesse qui grandissaient, avec les arts et la civilisation qui s'étendaient partout. L'âme humaine, par un mouvement qui lui était alors naturel et instinctif, divinisa cette puissance. De même que dans les vieux âges de l'humanité on avait adoré le nuage qui, se répandant en eau, faisait germer la moisson, et le soleil qui la faisait mûrir, de même on adora l'autorité suprême qui apparaissait aux hommes comme la garantie de toute paix et la source de tout bonheur. Ces générations ne subirent pas la monarchie, elles la voulurent. Le sentiment qu'elles professèrent à son égard ne fut ni la résignation, ni la crainte, ce fut la piété. Elles eurent le fanatisme du pouvoir d'un seul, comme d'autres générations ont eu le fanatisme des institutions républicaines. Il est naturel à l'homme de se faire une religion de toute idée qui remplit son âme. A certaines époques, il voue un culte à la liberté; en d'autres temps, c'est le principe d'autorité qu'il adore.»
CHAPITRE V
LES ASSEMBLÉES NATIONALES
1. les bienfaits du régime impérial en Gaule. — De ce que le pouvoir des empereurs était absolu et l'empire romain un État centralisé, il ne faut point conclure que la Gaule fût traitée en pays conquis et les Gaulois en esclaves. L'omnipotence du prince et l'unité de l'empire n'empêchèrent pas l'existence de libertés pour la Gaule et de garanties pour ses habitants.
En théorie, le sol appartenait à Rome; en fait, les Gaulois le possédaient, le cultivaient, le transmettaient comme s'ils en étaient les vrais propriétaires. Les impôts que les Romains établirent furent souvent lourds; mais le chiffre n'en rappela jamais les droits exorbitants que la coutume antique conférait au vainqueur sur le vaincu.
Une fois citoyens romains, et nous avons vu qu'ils le devinrent rapidement, les Gaulois étaient les égaux de leurs maîtres. C'est ce que disait le général romain Cérialis aux Trévires et aux Lingons révoltés. Après avoir fait l'apologie de la conquête romaine, il fit en ces termes celle de l'administration impériale : « II y eut en Gaule des rois et des guerres, jusqu'au moment où vous reçûtes nos lois. Tant de fois provoqués par vous, nous n'avons imposé sur vous, à titre de vainqueurs, que les charges nécessaires au maintien de la paix. Sans armées, en effet, pas de repos pour les nations, et sans solde pas d'armées, sans tributs pas de solde. Le reste est en communauté : c'est vous qui souvent commandez nos légions; c'est vous qui gouvernez ces provinces ou les autres; entre nous rien de séparé, rien d'exclusif. Je dis plus : la vertu des bons princes vous profite comme à nous, tout éloignés que vous êtes; les bras des mauvais ne frappent qu'autour deux. On supporte la sécheresse, les pluies excessives, les autres fléaux naturels : supportez de même le luxe et l'avarice des puissances. Il y aura des vices tant qu'il y aura des hommes; mais ces vices, le règne n'en est pas continuel ; de meilleurs temps arrivent et consolent. » Tibère, Caligula, Néron, Domitien ont été, par leur folie ou leur cruauté, des hommes détestables. La Gaule fut aussi prospère sous leur règne que sous celui des vertueux Antonins. Avides ou cruels à l'égard de ceux qui les approchaient, ces princes ne permirent jamais que leur exemple fût imité de ceux qu'ils envoyaient pour gouverner les Gaules.
Sous la république, Fontéius avait mis au pillage la Gaule du Sud, exploitant le pays à la manière dont Warren Haslings exploita les Indes. Sous l'empire, les faits de ce genre devinrent extrêmement rares. Les empereurs avaient intérêt à ce que leur pouvoir fût aimé, au moins de loin et des provinces.
D'ailleurs, celles-ci avaient le droit de faire entendre des plaintes. L'institution des assemblées provinciales leur offrait de sûres garanties, sinon de liberté, du moins d'équité.
2. Le culte provincial de Rome et de l'empereur. — Les anciens n'ont jamais pu concevoir une réunion d'hommes, état famille, société, confédération, qui ne fût pas en même temps une association religieuse. Au même titre que les familles ou que les cités, les ligues formées par des peuples devaient avoir des dieux communs, et un autel autour duquel se faisait comme l'union morale : « De même, dit Fuslel de Coulanges dans la Cité Antique, que la cité avait son foyer du prytanée, les cités associées ont eu leur foyer commun. La cité avait ses héros, ses divinités poliades, ses fêtes : la confédération a eu aussi son temple, son dieu, ses cérémonies, ses anniversaires marqués par des repas pieux et par des jeux sacrés. » Toute ligue était aussi une fédération religieuse.
Il est digne de remarque qu'une des premières choses que les Romains ont créées en Gaule, c'est précisément cette fédération religieuse. Quand ils entrèrent dans le pays, le druidisme commençait à fonder cette unité morale, de culte et de prières, d'où pouvait sortir peu à peu l'idée de patrie : ce furent les Romains qui achevèrent cette unité.
Le culte commun qu'ils donnèrent à la Gaule fut celui de Rome et d'Auguste, c'est-à-dire de Rome divinisée et de la sainteté impériale. C'était d'une habile politique que d'instituer précisément pour religion commune l'adoration du maître et de la cité conquérante. Mais il y eut peut-être dans le choix de ces divinités autre chose que l'œuvre d'une sage administration : il y eut une nécessité religieuse. Il était impossible de donner à la Gaule romaine d'autres dieux à prier. Les cités antiques avaient deux cultes essentiels. Elles adoraient leur fondateur : c'était pour elles un être sacré, ce que le premier ancêtre était pour chaque famille. L'autre culte était celui de la cité elle-même, considérée comme déesse. Or représentons-nous ce qu'étaient pour la Gaule ces deux divinités, Rome et l'empereur, qu'elle allait vénérer : l'empereur est comme le héros fondateur de l'État; il se nomme le « père de la patrie » ; Rome, c'est l'État même, c'est la patrie à laquelle la Gaule appartient. Les provinces devaient prier Rome et Auguste en vertu des mêmes principes qui avaient fondé dans les villes le culte du fondateur et le culte de la cité elle-même.
3. Les assemblées religieuses de Lyon : l'autel et le culte. —Il y eut en Gaule deux centres de ce culte de Rome et d'Auguste, l'un à Narbonne pour l'ancienne province, l'autre à Lyon pour la Gaule conquise par César. Nous connaissons surtout le culte qui se célébrait à Lyon.
On éleva, sur la presqu'île formée par la Saône et le Rhône, à l'endroit nommé « au Confluent », ad Confluentes,
un autel colossal portant l'inscription « à Rome et à l'auguste », Romae et augusto. Les monnaies ont conservé l'image de cet autel.
 Autel de Lyon sur un grand bronze de Tibère.
Autel de Lyon sur un grand bronze de Tibère.
Chaque année, au 1er août, commençaient les solennités religieuses : sacrifices, processions, jeux de toute sorte, même des concours d'éloquence et de poésie. En même temps une foire se tenait dans le voisinage. C'étaient les jours des grandes fêtes nationales, fêtes à la fois gauloises et romaines. Lyon offrait alors un merveilleux spectacle, qu'Allmer nous a décrit : « Au-dessus du champ de foire, à mi-pente du coteau qui le domine, s'élève, orienté vers l'Italie, l'autel national de Rome et d'Auguste. Là tout est merveille, splendeur, magnificence. L'autel est de marbre et resplendit d'ornements éclatants; son soubassement, atteignant peut-être à près de 50 mètres de long, est également de marbre. Deux Victoires colossales ailées, dressées à ses côlés, sont en bronze doré et paraissent être en or; elles tiennent de grandes palmes et des couronnes d'or ; leurs piédestaux, colonnes de 30 pieds de haut, sont de granit gris d'Egypte avec des chapiteaux ioniques vraisemblablement de porphyre.
 Autel de Rome et d'Auguste à Lyon, restitué d'après les monnaies.
Autel de Rome et d'Auguste à Lyon, restitué d'après les monnaies.
D'un côté est un
temple, de l'autre est un amphithéâtre; par derrière s'élend au loin un bois ; autour et devant sont des jardins, des pièces d'eau, des statues : les statues colossales de Rome et d'Auguste, les statues colossales des soixante cités, les statues de tous les empereurs, de tous les princes, de nombreux grands personnages, de nombreux hauts fonctionnaires, les statues des prêtres et de leurs proches, groupés sur de longs stylobates, tantôt rectilignes, tantôt en forme d'hémicycle. Il y a des statues en bronze doré, en bronze non doré et en marbre; il y en a d'équestres, il y en a de pédestres : une légion de statues.
" Chaque année, se réunit là, pour faire solennellement hommage à la souveraineté romaine et célébrer en grande pompe les fêtes du culte de l'empereur, l'assemblée des Gaules, composée des délégués de toutes les cités pris dans les rangs les plus hauts et les plus riches de la noblesse gauloise, assemblée destinée à supplanter les anciennes réunions nationales des druides et des nobles. Les fêtes coïncident avec la foire et attirent non moins qu'elle un immense concours de Gaulois et d'étrangers; c'est, pendant un mois, tout le mois d'août, une panégyrie, dont l'éclat, l'ampleur, le mouvement, l'étrangeté n'ont nulle part ailleurs rien de pareil. »
4. Le Conseil des Gaules : organisation. — Une assemblée de notables gaulois avait la surintendance de ce culte à Lyon. On l'appelait le « Conseil des Gaules », concilium Galliarum. Il était composé de soixante-quatre délégués
représentant chacun une des cités de la Gaule propre.
 Les trois Gaules, denier de la Gaule romaine (1).
Les trois Gaules, denier de la Gaule romaine (1).
Ces délégués étaient choisis par le sénat de leur ville parmi les citoyens
les plus considérés, et
d'ordinaire parmi d'anciens magistrats : " ils ont parcouru toute la carrière des honneurs dans leur patrie" omnibus lionoribus apud suos functi, disent souvent de ces personnages les dédicaces des statues qu'on leur élevait.
1. Trois têtes figurant les trois provinces de Gaule ; légende : TRES GALLIAe. — Au revers, l'empereur galopant. — Le denier est du temps de Galba.
Ils portent le titre de « prêtres », saccedotes ad aram ou ad templum Romae et Augusti ad confluentes Araris et Rhodani.
Ce Conseil renfermait donc l'élite de l'aristocralie gauloise. Les membres étaient choisis par leurs concitoyens, et l'État n'intervenait ni dans l'élection des prêtres ni dans l'organisation intérieure du Conseil. Ce n'était assurément pas une assemblée populaire, cette réunion n'avait aucun caractère démocratique : mais c'était en tout cas le Conseil représentatif de toutes les cités de la Gaule.
5. Les pouvoirs politiques du Conseil des Gaules. — Les Gaules étaient à la fois une fédération religieuse et un ressort administratif: de même, les prêtres des Gaules étaient également des personnages politiques, et le Conseil qu'ils formaient n'avait pas seulement des attributions sacrées : il exerçait, au besoin, une autorité civile et politique, tout comme les assemblées qui présidaient aux confédérations helléniques.
Le Conseil des Gaules communiquait avec le prince, presque toujours sans l'intermédiaire des agents de l'État. Il lui transmettait les vœux et surtout les plaintes des populations gauloises. Le prince lui écrivait pour lui annoncer une réforme ou la nomination d'un nouveau chef. Surtout, l'assemblée discutait les actes des gouverneurs, décernait des statues à ceux dont elle approuvait la conduite, infligeait un blâme ou intentait un procès à ceux dont elle avait à se plaindre. Au besoin, elle envoyait à Rome des délégués pour accuser le légat par devant l'empereur, et ces accusations étaient rarement de vaines menaces : car elles pouvaient aboutir pour le gouverneur coupable à la confiscation des biens et à la déportation.
De ces deux pouvoirs rivaux, le représentant de l'État et le Conseil des Gaules, ce n'était pas toujours le premier qui était le plus fort. Au temps de Néron, des sénateurs, fiers de l'antique souveraineté de Rome, se plaignaient des abus que les Conseils provinciaux faisaient de leur droit, et Thraséas comparait ainsi l'ancien état de choses au régime impérial: « Autrefois, quand il s'agissait de visiter les provinces et de se rendre compte de la manière dont elles obéissaient, ce n'était pas seulement un préteur, un consul qu'on leur envoyait : de simples particuliers étaient chargés de cette mission, et les nations attendaient en tremblant le jugement qu'on porterait d'elles. Et maintenant c'est nous qui caressons et qui adulons les provinciaux : au gré d'un seul d'entre eux on accorde des actions de grâces, ou l'on se hâle de décréter une accusation. » Or c'est sous le règne de Néron, un des plus mauvais que vit Rome, qu'on se plaignait ainsi de l'extrême liberté laissée aux Conseils provinciaux.
6. L'affaire de Sollemnis et le marbre de Vieux. — Nous avons un curieux monument de l'activité de ce Conseil des Gaules. C'est la dédicace d'une statue élevée à Sollemnis, représentant de la cité des Viducasses(Vieux) à l'assemblée de Lyon. Elle renferme, entre autres choses, la lettre authentique d'un gouverneur de la Gaule, dont le prédécesseur, attaqué dans le Conseil, avait été vivement défendu par Sollemnis : « Mon prédécesseur, Claudius Paulinus, se vit attaqué dans le Conseil des Gaules, à l'instigation de quelques députés qui paraissaient n'avoir pas reçu, de sa part, le traitement auquel leur donnait droit leur mérite; ils entreprirent de dresser une accusation contre le gouverneur, comme en vertu du consentement de la province. Mais alors Sollemnis, mon ami, s'opposa à cette proposition : il interjeta son avis, attendu que sa cité, en le créant député parmi les autres, n'avait formulé aucun mandat de cette nature; bien au contraire, elle n'avait, eu que des paroles d'éloges pour le gouverneur. Il en résulta que tous abandonnèrent l'accusation. » Cela se passait dans la première moitié du IIIème siècle.
On peut conclure de ce passage d'une lettre officielle que les actes des gouverneurs, avant d'être discutés par le Conseil des Gaules, étaient examinés au préalable dans le sénat de chaque cité, au moment de l'élection des députés, et que ceux-ci recevaient de leurs concitoyens une sorte de mandat impératif.
7. L'assemblée des Gaules sous le bas-empire. — Ces assemblées ont duré jusque dans les derniers temps de l'empire, et il ne semble pas que leur autorité ait diminué. Au milieu du IVème siècle, elles cessèrent d'être des corps religieux; mais elles subsistèrent comme conseils politiques. En pleine invasion, l'empereur Honorius faisait réunir à Arles les représentants de toutes les villes du Midi et donnait à cette réunion les plus grands pouvoirs : « C'est l'intérêt de l'Etat et des particuliers, écrivait-il en 418, que des délégués de toutes les villes se réunissent en Conseil. Par la réunion des habitants les plus notables on pourra obtenir sur chaque sujet en délibération les meilleurs avis possibles. Rien de ce qui aura été traité et arrêté, après une mûre discussion, ne pourra échapper à la connaissance d'aucune des provinces, et ceux qui n'auront point assisté à l'assemblée seront tenus de suivre les mêmes règles de justice et d'équité. Nous avons choisi Arles pour être le siège de l'assemblée, qui aura lieu tous les ans : et en choisissant cette ville si bien située et où les étrangers abondent, nous croyons faire une chose non seulement avantageuse au bien public, mais encore propre à multiplier les relations sociales. Nous voulons que cette ordonnance soit éternellement observée. »
Au milieu des désordres du Vème siècle, ces assemblées en arrivèrent peut-être à jouer un rôle dans la politique générale : c'est un Conseil de notables gaulois qui en 455 donna la pourpre à l'empereur Avitus.
8. Que les Romains ont contribué à l'unité de la Gaule. — La Gaule n'était donc pas simplement une subdivision administrative de l'État romain. Elle avait une vie qui lui était propre. Les Romains avaient conservé les noms de Gaule et de Gaulois; ils avaient laissé au pays ses anciennes limites. De plus, ils lui avaient donné des capitales religieuses, un culte commun, les mêmes besoins politiques, et un conseil national. La soumission à Rome et l'incorporation à l'État romain n'ont donc pas eu pour conséquence la disparition de la nation gauloise.

Loin de là! à la faveur de la paix romaine et de l'obéissance à un seul chef, l'unité de la Gaule a pu se fortifier. Il y avait eu, avant la conquête, plus d'indépendance et moins de cohésion. Autour des autels de Lyon et de Narbonne, les Gaulois ont pris l'habitude de pensées communes, le goût de l'entente, la conscience d'intérêts semblables et le désir de l'unanimité. Ils se sont sentis plus solidaires les uns des autres. L'idée d'une patrie gauloise n'a pu que grandir au sein même de l'Etat romain.
CHAPITRE VI
LE RÉGIME MUNICIPAL
1. La cité gauloise; son origine, ses limites, son nom.— La Gaule romaine comprenait un certain nombre de communes, qu'on appelait des « États », respublicae, ou plus fréquemment des « cités », civitates. La cité était, en Gaule comme presque partout dans l'empire, l'unité administrative; les provinces n'étaient, à vrai dire, que des associations de petits États; l'empire lui-même était une vaste fédération de cités.
Nos communes d'aujourd'hui sont d'étendue fort inégale, mais toutes sont infiniment plus petites que la cité gauloise. Elle occupait un très vaste territoire. La plus petite civitas de la Gaule, celle de Marseille, avait encore trois ou quatre lieues carrées; la plus grande, celle des Piclons, était aussi étendue que trois de nos départements. Plus nombreuses dans le midi de la Gaule, les cités y étaient aussi moins considérables que dans le Nord. Vers l'an 400 de notre ère, il n'y avait en tout que cent quatorze cités entre le Rhin et les Pyrénées.
Une cité comprenait une ville importante qui en était le chef-lieu et un territoire rural divisé en un certain nombre de circonscriptions qu'on appelait des « cantons », pagi.
Ces subdivisions administratives ne sont pas une création de Rome. Quand elle conquit le pays, elle y avait trouvé une centaine de gentes, de nations indépendantes. La gens, la peuplade, devint la commune romaine, la respublica ou la civitas, et conserva son territoire. Les cités de la Gaule romaine étaient donc composées de familles qui, depuis des siècles, avaient eu les mêmes intérêts et le même gouvernement, qui avaient les mêmes traditions historiques, et qui, sous les lois de Rome, continuaient à vivre d'une vie commune. Entre la peuplade gauloise et la cité gallo-romaine il n'y a aucune solution de continuité.
Au sud de la Gaule, cependant, nous constatons quelques changements dans les limites et les noms. La grande nation des Volques entre autres fut morcelée; elle forma plusieurs cités qui toutes prirent le nom de leur chef-lieu, les cités de Nîmes, de Toulouse, de Béziers, de Carcassonne, de Narbonne. Partout ailleurs les limites furent conservées et l'intégrité de la gens maintenue; les anciens noms subsistèrent également.
Officiellement, les cités s'appelèrent du nom traditionnel de la peuplade. La gens des Parisii forma la civitas Parisiorum, qui eut pour chef-lieu la ville de Lutèce, Lutetia.
Vers le milieu du IIIème siècle, on prit l'habitude d'appeler du même nom le chef-lieu de la cité et la cité tout entière. Presque partout, ce nom fut l'ancien nom du peuple. Lutetia devint Parisii et est aujourd'hui Paris. Avaricum, chef-lieu des Bituriges, prit leur nom, s'appela Bituriges et est devenu Bourges. C'est pour cela que la plupart de nos grandes villes conservent aujourd'hui encore le nom des vieilles peuplades gauloises. Il y eut un petit nombre d'exceptions, on en rencontre surtout, comme nous l'avons vu, dans le Midi. En Gaule propre, elles sont infiniment rares : deux seulement sont importantes. Rotomagus, Rouen, ne prit pas le nom des Veliocasses dont il était le chef-lieu; Burdigala, Bordeaux, imposa son nom à la civitas des Bituriges, Vivisci, à qui elle servait de capitale.
2. Les colonies. — II y avait plusieurs catégories de cités, suivant la condition sociale ou les droits politiques que les lois de Rome avaient conférés aux habitants.
Les cités les plus considérées portaient le nom de « colonies romaines » ou « colonies latines ». Cela signifiait que leurs habitants étaient citoyens romains ou pouvaient le devenir sous certaines conditions. De plus, ce titre de colonie établissait un lien moral entre la ville qui en jouissait et la ville de Rome : elle était censée la fille de la Cité Éternelle, sa fondation et comme son image en petit.
I)u reste, la plupart des villes qui obtinrent ce titre glorieux et recherché reçurent en même temps des immigrants et des colons de Rome ou d'Italie, presque tous des vétérans des guerres civiles. Fréjus, Arles, Narbonne, Béziers, Orange furent, sous Jules César ou Auguste, créées colonies romaines, et on y établit les vétérans des huitième, sixième, dixième, septième et seconde légions : ce qui explique la longue série d'épithètes qu'on donnait officiellement à ces villes; Arles, par exemple, s'appelait colonia Julia Paterna Arelate Sextanorum, « colonie des soldats de la sixième légion, fondée par Jules le père ».
Presque toutes les autres villes de l'ancienne province, sauf Marseille et deux ou trois autres, reçurent, sous Auguste, le titre de colonies latines, et, selon toute vraisemblance, on y envoya en même temps, comme colons, des vétérans pris parmi les troupes auxiliaires de l'armée romaine. C'est ainsi qu'à Nîmes on établit des soldats originaires d'Egypte, peut-être de ceux qui se soumirent après la bataille d'Actium; aussi les habitants de Nîmes gardèrent-ils longtemps, sous l'empire, un culte de prédilection pour Isis et les divinités égyptiennes, et Nîmes conserva toujours, sur ses médailles et dans ses armoiries, comme un symbole
parlant de son origine coloniale, le crocodile attaché au rameau de palmier.
 Monnaie de Nîmes.
Monnaie de Nîmes.
Les colonies étaient beaucoup plus rares dans la Gaule propre : on n'en rencontre que près de la fronlière de Germanie; Lyon et Trêves sont les plus célèbres de cette région. Les colonies formaient donc à la Gaule une vaste ceinture le long de la Méditerranée, du Jura et du Rhin.
3. Cités alliées, libres et tributaires. — Toutes les villes de l'intérieur étaient de vraies cités gauloises. Mais les unes, les plus privilégiées, en souvenir de services rendus par elles au peuple romain, portaient le titre d' «alliées », foederatae : telles étaient les cités des Éduens, les anciens frères du peuple romain, et des Rèmes, les principaux auxiliaires de Jules César dans la conquête de la Belgique. D'autres s'intitulèrent cités « libres », libérée, par exemple les Santons, les Arvernes, les Cituriges, les Trévires. Les autres cités, c'est-à-dire la majorité des cités de la Gaule, étaient cités « tributaires », stipendiariae.
Les cités alliées et libres devaient jouir, au début de l'empire, de privilèges politiques et d'immunités financières, mais, dès le IIIème siècle, les titres qu'on leur donnait n'étaient plus que des appellations honorifiques.
A la fin de l'empire, on appelait également toutes les villes de la Gaule des « municipes », municipia. Mais le terme de civitas était encore le plus usité, et c'est celui qui passera au moyen âge.
4. Les magistrats municipaux. — Quelle que fût d'ailleurs la qualification de la respublica ou de la commune gallo-romaine, l'organisation était à peu près partout la même, et calquée, au moins en apparence, sur l'organisation primitive de la ville de Rome. L'empire n'eut d'ailleurs qu'à maintenir ou rétablir le régime aristocratique qui dominait en Gaule avant la conquête et qui s'adaptait fort bien à ses habitudes de gouvernement.
La cité obéissait, comme autrefois la gens, à des magistrats suprêmes; seulement, le nom latin de « préteur», praetor, prévalut d'abord sur l'appellation celtique vergobret. Plus tard, et dès la fin du ier siècle, toutes les villes de la Gaule eurent uniformément quatre magistrats supérieurs, qu'on appela « duumvirs » ou « qualuorvirs », duoviri ou quattuorviri : deux étaient chargés de rendre la justice, duoviri jure dicundo; les deux autres veillaient à la police, duoviri aediles. A ces quatre magistrats s'ajoutait le «questeur», quaestor, chargé, comme le questeur de Rome, de la gestion de la caisse municipale.
De temps à autre l'empereur envoyait un délégué dans les villes pour vérifier les comptes et contrôler l'administration des biens municipaux; on l'appelait un « curateur », curator reipublicae.
A la fin de l'empire, le système d'une magistrature supérieure unique reparut : le chef de la cité prit le titre de « défenseur », defensor.
5. Le sénat municipal. — Le vrai maître de la cité était, comme autrefois, le sénat. Il y avait bien des assemblées du peuple pour nommer les magistrats; mais il est probable que dans ces assemblées les sénateurs municipaux avaient la haute main : d'ailleurs elles tombèrent en désuétude d'assez bonne heure.
L'«ordre» des sénateurs municipaux ou « curiales », ordo curialium, était composé des principaux propriétaires du pays; il formait l'aristocratie de la cité. Les chefs du gouvernement n'administraient qu'avec son aide. Les curiales étaient responsables, vis-à-vis de l'État romain, de la gestion des affaires locales, et notamment de la levée des impôts : ce qui ne laissait pas de rendre la dignité de curiale presque aussi lourde qu'elle était honorable. Aussi, vers le IVème siècle, beaucoup de villes furent-elles abandonnées par leurs sénateurs, désireux d'échapper aux obligations attachées à leur litre. Les empereurs durent faire des lois pour les contraindre à demeurer dans leurs cités, à siéger au sénat, à diriger l'administration, à veiller à la rentrée des impôts, pour empêcher en un mot l'effondrement du régime municipal. Toutefois cette décadence des sénats locaux parait avoir été moins grave en Gaule que dans le reste de l'empire. Car, à la veille même de l'invasion, nous trouvons encore dans les cités gauloises des sénateurs riches, considérés et patriotes, dont leurs concitoyens étaient fiers et qui étaient fiers de gouverner leurs villes.
6. Les droits des villes. — Ce qui manquait à la cité gallo-romaine, c'était l'indépendance politique. Il ne restait à ses magistrats ni le droit de paix, de guerre et d'alliance, ni le droit de vie et de mort. Leurs attributions judiciaires étaient limitées aux affaires correctionnelles ou à des affaires civiles et commerciales concernant de très petites sommes. C'étaient surtout des juges de paix et des commissaires de police.
Mais les villes avaient la libre disposition de leur budget, sauf, de temps à autre, l'obligation de le soumettre au contrôle d'un curateur impérial. Elles possédaient des terres, des bois, des prairies, des immeubles, et ses magistrats les affermaient à leur gré. La ville était souveraine en matière religieuse et pouvait choisir à sa guise entre les dieux et les cultes répandus dans l'empire. Elle avait même, jusqu'à un certain point, une autorité militaire. Sauf la plupart des colonies et quelques villes privilégiées (comme Autun), les cités n'étaient point entourées de murailles; mais il semble qu'il ne leur était pas défendu d'avoir des armes et de s'armer, sous les ordres de ses magistrats, pour repousser une attaque subite ou poursuivre des bandes de brigands.
On voit la profonde différence qui séparait la commune gallo-romaine de la nôtre. Aujourd'hui, les chefs municipaux n'ont que des attributions de police et de finance; autrefois, ils étaient aussi des juges, des chefs militaires, des administrateurs tout-puissants pour le compte de Rome. La cité était alors, comme l'indiquait son nom de respublica, un État politique plus encore qu'un district administratif. M. Guiraud l'a dit fort justement : « II est vrai qu'au-dessus d'elle planait la puissante autorité de Rome. Mais, si cette domination s'était brusquement évanouie, toutes ces cités auraient pu, du jour au lendemain, et presque sans aucun changement, former autant de petits États souverains, pourvus de leurs organes essentiels, et capables de se suffire pleinement à eux-mêmes. »
7. Le patriotisme municipal. — Aussi, malgré la perte de son indépendance, la cité gauloise, qui conservait son nom, son foyer sacré, la solidarité de ses membres et la tradition de son passé, a-t-elle toujours vécu d'une vie intense sous les lois de Rome. Les ressources d'argent et d'intelligence que les anciens sénateurs gaulois gaspillaient dans les guerres civiles ou dans de vaines rivalités, ils les appliquaient maintenant à la prospérité de leurs villes. En trois générations, la cité gauloise se transforma. D'une bourgade en chaume, en terre et en bois sortit une ville de pierre et de marbre. A la fin du Ier siècle, le chef-lieu des civitates était déjà une grande ville, ornée de statues, de fontaines, de mosaïques, avec des aqueducs, des thermes, des basiliques, des portiques décorés de bas-reliefs, des théâtres et souvent même de vastes arènes. Tous ces monuments furent élevés, non pas aux dépens du budget municipal, mais surtout aux frais des magistrats ou des sénateurs. D'autres fondaient des écoles, d'autres instituaient des sacrifices. La ville gagna en richesse ce qu'elle avait perdu en liberté; mais le patriotisme municipal ne s'affaiblit pas. Ceux-là mêmes d'entre les Gaulois qui devinrent consuls n'oublièrent pas leur ville natale : « Si je vénère Rome, j'aime ma petite patrie, écrivait le Bordelais Ausone qui fut consul; si j'ai là-bas ma chaise curule, je n'oublie pas qu'ici j'ai mon berceau » : car, après avoir rempli les plus hautes fonctions de l'empire, Ausone était revenu dans sa chère ville de Bordeaux, pour en faire le « nid de sa vieillesse ».
TABLEAU DES PROVINCES ET CITÉS DE LA GAULE VERS L'AN 400
I. ALPES MARITIME
Nom de la cité. Nom actuel du chef-lieu.
1. Civitas Ebrodunensium. ... Embrun.
2. — Diniensium........ Digne.
3. — Rigomagensium.... Chorges?
4. — Salinensium....... Castellane.
5. — Sanitiensium....... Senez.
6. — Glannativa......... Glandèves.
7. — Cemenelensium..... Cimiez.
8. — Vinliensium........ Vence.
II. NARBONENSIS SECONDA
Nom de la cité. Nom actuel du chef-lieu.
9. Civitas Aquensium . ....... Aix.
10. — Aptensium......... Apt.
11. — Reiensium......... Riez.
12. — Forojuliensium..... Fréjus.
13. — Vapincensium...... Gap.
14. — Segesteriorum...... Sisteron.
15. — Antipolitana ....... Antibes.
III. VIENNENSIS
16. — Viennensium...... Vienne.
17. — Genavensium....... Genève.
18. — Gralianopolllana... Grenoble.
10. — Albensium. ........ Aps.
20. — Deensium. ......... Die.
21. — Vasiensium.. ..... Vaison.
22. — Valentinorum...... Valence.
23. — Tricastinorum...... Saint-Paul-Trois-Châteaux.
24. — Arausicorum....... Orange.
25. — Carpentoratensium. Carpentras.
26. — Cabellicorum....... Cavaillon.
27. — Avennicorum....... Avignon.
28. — Arelatensium....... Arles.
29. — Massiliensium...... Marseille.
IV. NARBONENSIS PRIMA
30. — Narbonensium...... Narbonne.
31. — Tolosatium........ Toulouse.
32. — Beterrensium...... Béziers.
33. — Nemausensium..... Nimes.
34. — Lutevensium....... Lodève.
V. ALPES POENINAE
— Ceutronium........ Moutiers.
— Vallensium......... Martigny-en-Valois.
VI. NOVEMPOPULANA
37. — Elusatium.......... Eauze.
38. — Aquensium......... Dax.
39. — Lactoratium........ Lectoure.
40. — Convenarum........ Saint-Bertrand-de-Comminges.
Vf. NOVEMPOP'ULANA (suite)
Nom de la cité. Nom actuel tlu chef-lieu.
41. Civilas Consoranorum...... Saint-Lizier-de-Conserans,
42. — Roiatium........... La Teste-de-Buch.
43. — Renarnensium...... Lescar dans le Béarn.
44. — Aturensium........ Aire.
45. — Vasatica. .......... Bazas.
46. — Turba.............. Tarbes.
47. — Iloronensium...... Oloron.
48. — Ausciomm......... Auch.
VII. AQUITANICA PRIMA
49. — Bilurigum.......... Bourges.
50. — Arverovrum........ Clermont en Auvergne.
51. — Albigensium....... Alby.
52. — Cadurcorum....... Cahors.
53. — Rutenorum........ Rodez.
5l. — Lemovicum. ....... Limoges.
55. — Cabalum........... Javols.
56. — Vellavorum........ Saint-Paulien-en-Velay.
VIII. AQUITANICA SECUNDA
57. — Burdigalensium.... Bordeaux.
58. — Agennensium...... Agen.
59. — Ecolismensium..... Angoulême.
60. — Santonum......... Saintes.
61. — Pictavorum........ Poitiers.
62. — Petrocoriorum. .... Périgueux.
IX. LUGDUNENSIS PRIMA
63. — Lugdunensium. .... Lyon.
64. — Aeduorum.......... Antun.
65. — Lingonum.......... Langres.
X. LUGDUNENSIS SECUNDA
60. — Rotomagensium. ... Rouen.
67. — Baiocassium. ...... Bayeux.
68. — Abrincatum........ Avranches.
69. — Ebroicorum........ Evreux.
70. — Sagiorum.......... Séez.
71. — Lexoviorum........ Lisieux.
72. — Constantia......... Coutances.
XI. LUGDUNENSIS TERTIA
Nom de la cité. Nom actuel du chef-lieu.
73. Civitas Turonorum........ Tours.
74. — Cenomanorum. .... Le Mans.
75. — Redonum. ......... Rennes.
76. — Andecavorum. ..... Angers.
77. — Namnelum......... Nantes.
78. — Coriosopitum ...... Quimper ?
79. — Venetum. .......... Vannes.
80. — Osismorum. ....... Coz-Castell-Ach?
81. — Diablintum........ Jublains.
XII. LUGDUNENSIS SENONIA
82. — Senonum. ......... Sens.
83. — Autissiodorum. ... Auxerre.
84. — Carnotum.......... Chartres.
85. — Aurelianorum. ..... Orléans.
86. — Tricassium......... Troyes.
87. — Melduorum......... Meaux.
88. — Parisionum......... Paris.
XIII. MAXIMA SEQUANORUM
89. — Vesontiesium...... Besançon.
90. — Equestrium. ....... Nyon.
91. — Helvetiorum. ...... Avenches.
92. — Basiliensium....... Bâle.
XIV. BELGICA SECUNDA
93. — Remorum. ......... Reims.
94. — Catuellaunorum.... Châlons.
95. — Suessionum........ Soissons.
90. — Veromanduorum ... Saint-Quentin (Vermandois) ?
97. — Atrabatum......... Arras.
98. — Camaracensium .... Cambrai.
99. — Turnacensium...... Tournai.
100. — Silvanectum........ Senlis.
101. — Bellovacorum....... Beauvais.
102. — Ambianensium. .... Amiens.
103. — Morinorum........ Thérouanne.
104. — Bononiensium.. .... Boulogne.
XV. BELCICA PRIMA
Nom de la cité. Nom actuel du chef-lieu.
105. Civitas Treverorum........ Trêves.
106. — Mediomatricorum..... Metz.
107. — Leucorum.......... Toul.
108. — Verodunensium..... Verdun.
XVI. GERMANIA PRIMA
109. — Magonliacensium... Mayence.
110. — Argentoratensium.... Strasbourg.
111. — Nemetum.......... Spire.
112. — Vangionum........ Worms.
XVII. GERMANIA SECUNDA
113. — Agrippinensium.... Cologne.
114. — Tungrorum. ....... Tongres.
CHAPITRE VII
L'ADMINISTRATION PROVINCIALE
1. Les circonscriptions provinciales. —Au-dessus des cités, en face des Conseils nationaux, se trouvent les représentants de l'État romain, les gouverneurs des provinces.
Le pays entre le Rhin et les Pyrénées a formé, pendant les trois premiers siècles de l'empire, neuf subdivisions administratives appelées « provinces », provincia, la Gaule Narbonnaise, Gallia Narbonensis, qui n'était autre que la province de Gaule Transalpine d'avant César; — le long des Alpes, les trois petites provinces des Alpes Maritimes, Pennines et Cottiennes, Alpes Maritimae, Alpes Cottiae, Alpes Pœninae; —le long du Rhin, les deux provinces militaires de Germanie, Germania superior et Germania inferior, démembrées du reste de la Gaule dans les premières années de l'empire; — enfin,ce qu'on appelait « la Gaule Chevelue », Gallia Comata, ou « les Trois Gaules », Tres Galliae, c'est-à-dire les provinces qui envoyaient leurs délégués à Lyon : l'Aquitaine, Gallia Aquitanica, des Pyrénées à la Loire, la Lyonnaise ou Celtique, Gallia Lugdunensis ou Celtica, entre la Loire et la Marne, et la Belgique, Gallia Belgica.
Sous le bas-empire, au IVème et au Vème siècle, la Gaule comprenait dix-sept provinces, réparties en deux diocèses. Voici les noms de ces provinces et de leurs métropoles :
I. DIOCÈSE DES GAULES, diœcesis Galliarum.
1. Belgica prima, métropole Trêves.
2. Belgica secunda.— Reims.
3. Germania prima, — Mayence.
4. Germania secunda, — Cologne.
5. Maxima Sequanorum, — Besançon.
6. Lugdunensis prima, — Lyon.
7. Lugdunensis secunda, — Rouen.
8. Lugdunensis tertia, — Tours.
9. Lugdunensis Senonia, — Sens.
10. Alpes Graiœ et Poeninae, — Moutiers.
II. DIOCÈSE DE VIENNE ou DES SEPT PROVINCES, diœcesis Viennensis ou Septem Provinciarum.
11. Viennensis, métropole Vienne.
12. Narbonensis prima, — Narbonne.
13. Narbonensis secunda, — Aix.
14. Novempopulana, — Eauze, plus tard Auch.
15. Aquitanica prima, — Bourges.
16. Aquitanica secunda, — Bordeaux.
17. Alpes Maritimae, — Embrun.
Les Alpes Cottiennes étaient alors rattachées aux ressorts italiens, mais elles avaient perdu celles de leurs cités qui étaient situées de ce côté-ci des Alpes : on les avait données à la province des Alpes Maritimes.
Ces deux diocèses dépendaient du préfet du prétoire des Gaules, qui résidait à Trêves.
2. Les titres des gouverneurs. — A la tête de chacune de ces provinces était un gouverneur, qu'on appelait indifféremment praeses, « président », rector, « gouverneur », judex, « juge ». Mais les titres officiels de ces gouverneurs variaient suivant leur dignité et l'importance des provinces.
Sous le haut empire, les petites provinces alpestres étaient administrées par des « intendants » du prince, procuratores Caesaris, chevaliers romains en règle générale; la Gaule Narbonnaise obéissait à un ancien préteur, désigné par le sénat, et qui prenait le titre de « proconsul »; les cinq autres provinces dépendaient de « délégués » choisis par l'empereur, legati augusti, les légats des Trois Gaules n'étaient que d'anciens préteurs, ceux des deux Germaines étaient de rang « consulaire ».
Sous le bas-empire, les provinces les plus importantes, par exemple celles de la frontière du Rhin et de la Moselle, étaient administrées par des « consulaires », viri clarissimi les autres par des praesides, qui avaient le rang inférieur de viri perfectissimi.
3. Les pouvoirs des gouverneurs. — Mais, quels que fussent le rang et le titre de ces différents gouverneurs, leur autorité à tous était sensiblement la même.
Le gouverneur romain, qu'il soit envoyé par César ou par le sénat, est le délégué souverain du peuple romain ; il exerce sur les provinciaux tous les droits que la conquête a conférés à la cité conquérante. Seuls les citoyens romains échappaient à son pouvoir et ressortissaient directement aux magistrats de Rome. Encore, à partir du IIème siècle, s'occupait-il au même titre des citoyens romains de la province et des pérégrins.
Le gouverneur a l'imperiurn, c'est-à-dire la puissance souveraine, le droit de juger, de condamner, même à mort; il possède ce qu'on appela le " droit du glaive" ,jus gladii; comme dit saint Paul dans ses Épîtres, « il tient l'épée ». Avant tout, le gouverneur est un juge, il doit parcourir incessamment sa province, tenir des assises régulières, conventus, pour punir les criminels et juger les affaires qui se présentent à lui. S'il y a des troupes cantonnées dans les limites de la province, c'est lui qui les commande et qui les mène à l'ennemi.
C'est aussi le chef administratif des cités, il contrôle leur budget, c'est leur « curateur » naturel. Il veille à la légalité des élections municipales. Il surveille la rentrée des impôts, la construction des routes. C'est lui qui est chargé de maintenir la paix publique dans la province. « II doit la purger, dit un jurisconsulte, de tous les malfaiteurs, faire rechercher les sacrilèges, les brigands, les voleurs d'hommes, tous les voleurs en général, et punir chacun suivant son délit. »
Quelques changements se produisirent au début du IVème siècle. Les gouverneurs perdirent l'autorité militaire et le commandement des troupes. On plaça au-dessus d'eux, comme des degrés intermédiaires entre eux et le pouvoir central, le préfet du prétoire des Gaules et les vicaires des diocèses. Vicaires et préfet étaient, du reste, ainsi que les gouverneurs, des chefs administratifs et des juges. Il ne leur manquait que les attributions militaires, qui, depuis Constantin, étaient séparées du pouvoir civil et conférées à des chefs spéciaux.
4. Précautions prises contre les gouverneurs. — Mais cette omnipotence théorique du gouverneur était, en fait, limitée et contenue. De singulières précautions furent prises contre lui, d'abord pour protéger les provinciaux contre ses abus de pouvoir, puis pour l'empêcher d'accroître sa puissance au détriment des droits souverains de l'État.
Ses attributions, surtout vis-à-vis des cités, furent soigneusement réglées par une loi qui définissait jusqu'où allaient ses pouvoirs et où commençaient ceux des magistrats municipaux; c'est ce qu'on appelait la « loi de la province », lex provinciae. Puis les deux grands Conseils des Gaules devaient discuter et contrôler ses actes à la fin de son année de charge, et ce contrôle pouvait amener un acte d'accusation. Le gouverneur n'avait aucun représentant dans les cités, il avait des secrétaires, des archivistes, des trésoriers, un bureau assez compliqué, mais c'étaient des employés qui restaient près de lui; il n'entretenait aucun agent dans les villes : à la différence de nos grandes communes, elles n'étaient point soumises à l'action permanente et toujours présente des délégués du pouvoir central. Enfin, il était permis au condamné d'en appeler de la sentence du gouverneur au tribunal du prince ou du préfet du prétoire. La loi de la province, l'appel au prince, la discussion du Conseil, voilà autant de garanties qui protégeaient la province contre l'envoyé tout-puissant de l'État romain.
L'État, de son coté, prenait ses précautions pour l'empêcher de s'élever trop haut dans sa province ou d'y acquérir une indépendance dangereuse. Le gouverneur recevait un traitement, payé par l'Etat. Il lui fut souvent interdit de se créer trop d'attaches dans le pays par des alliances de famille ou des achats de biens-fonds. Enfin, il n'était nommé que pour un petit nombre d'années, d'ordinaire pour un an. « II ne pouvait espérer, dit Fustel de Conlanges, de se perpétuer dans sa dignité ou de faire de sa province un petit royaume. »
Enfin les lois impériales ne cessaient, dans un langage très élevé, de rappeler aux gouverneurs qu'ils avaient plus encore de devoirs envers les provinciaux que de droits sur eux. « Que le tribunal du juge ne soit point vénal, disait Constantin, qu'on n'achète pas l'accès du prétoire, et que les oreilles du gouverneur soient également accessibles aux plus pauvres comme aux riches. » Valentinien recommande que les sentences soient prononcées en public, « toutes portes ouvertes », et, quand le juge voyage, que ce ne soit pas pour se divertir, mais pour montrer qu' « il est à la disposition de tous ».
5. Les bons gouverneurs de la Gaule. — La meilleure garantie qu'avaient les provinces fut encore le soin apporté par le prince ou son conseil au choix des gouverneurs. On peut croire qu'il y en eût de détestables; mais on sait qu'un grand nombre de ceux que reçut la Gaule furent des hommes intelligents, probes et actifs, et ce ne furent pas les plus mauvais princes qui envoyèrent les gouverneurs les moins bons. Germanicus administra toute la Gaule pendant les trois premières années du règne de Tibère; Galba fut gouverneur au temps de Néron ; Vespasien envoya Agricola en Belgique, le jurisconsulte Julien gouverna l'Aquitaine sous Hadrien; au temps de Commode, Septime Sévère commanda en Celtique, et il y fut, dit son biographe, « aimé comme pas un ».
 Inscription d'Hasparren (IIème siècle) (1)
Inscription d'Hasparren (IIème siècle) (1)
1, Inscription sur marbre conservée dans la sacristie de l'église d'Hasparren (Basses-Pyrénées).— D'après une photographie de M. Toulet, instituteur à Souraïde. — Inscription consacrée par Vérus, délégué des Neuf Peuples d'entre Garonne, Océan et Pyrénées, lorsqu'il eut obtenu de l'empereur que ces Neuf Peuples fussent séparés des provinces gauloises (cf. la liste de ces peuples ). FLAMEN, ITEM DVuMVIR, QVAESTOR, l'AGIQue MAGISTER, VERVS, AD AVGVSTVM LEGATO MVNERE FVNCTVS, PRO NOVEM OPTINVIT POPVLIS SEIVNGERE GALLOS : VRBE REDVX, GENIO PAGI HANC DEDICAT ARAM.
CHAPITRE VIII
LES IMPÔTS
1. Le caractère de l'impôt. — Les Romains soumirent la Gaule à un tribut, tributum, stipendium. Le sol payait l'impôt foncier, les hommes l'impôt personnel. En théorie, le tribut était comme le prix dont les Gaulois rachetaient la jouissance de leurs terres et la liberté de leurs personnes : c'était le souvenir de la conquête et la marque de la soumission. Les quelques villes qui en étaient exemptes étaient censées ne pas faire partie de la province : on les appelait « cités libres », si elles étaient composées de pérégrins, « cités de droit italique », si elles étaient romaines.
2. — L'impôt foncier était pour les provinces le plus onéreux de tous. Il frappait surtout les membres de l'aristocratie municipale, les propriétaires locaux, possesseurs, parmi lesquels se recrutaient les sénateurs des villes.
Pour en fixer le chiffre, l'Etat refaisait constamment le cadastre des provinces, forma censualis, et le recensement des biens, census. C'était une opération longue et délicate, qui causait toujours une grande agitation en Gaule : dans ces moments, le pays troublé était mis comme en état de siège.
« Voici de quelle manière, dit un texte de loi, il faut indiquer les biens sur les registres du cens. D'abord le nom de la terre; — puis le nom de la cité; — puis le nom du pagus où la terre se trouve ; — puis le nom des deux terres les plus proches. — Puis, pour les champs labourés, leur étendue en arpents; — pour les vignobles, le nombre des plants de vigne;— pour les olivettes, le nombre des pieds d'oliviers; — pour les prés, leur étendue en arpents; — de même pour les pâturages, leur étendue en arpents; — de même pour les bois taillis. » On voit avec quel soin l'opération était faite.
Les terres provinciales qui appartenaient à des sénateurs romains étaient estimées à part, et l'impôt qu'elles payaient portait un nom spécial, l'« impôt de la glèbe », collatio glebalis.
Il faut ajouter à l'impôt foncier les redevances en nature, corvées, fournitures aux troupes et aux fonctionnaires (annona). Elles étaient presque aussi onéreuses que l'impôt foncier, car elles laissaient plus de place encore à l'arbitraire du gouvernement.
3. Impôts directs sur les personnes et les biens. — Un impôt personnel, ou « capitation », était payé par les provinciaux; mais il frappait surtout ceux qui ne possédaient ni terres ni biens, c'est-à-dire les plébéiens des municipes : aussi prit-on l'habitude de l'appeler « la capitation des plébéiens», capitatio plebeia.
Entre les plébéiens et les propriétaires se trouvaient les négociants, negotiatores : ils payaient un impôt particulier, aurum negotiatorum ou chrysargyrum. Une estimation rigoureuse était faite des biens et des sources de revenus : le banquier payait d'après son chiffre d'affaires, l'armateur en proportion des navires qu'il équipait, le portefaix en raison du nombre et de la paye de ses jours de travail.
4. — Les impôts indirects paraissent avoir été beaucoup moins lourds. Le plus important de tous, en Gaule, était celui des douanes, portoria. Toute la Gaule formait en effet une vaste circonscription douanière, séparée du reste de l'empire; des bureaux de douane, stationes, étaient échelonnés sur sa frontière maritime et terrestre, notamment à Saint-Bertrand-de-Comminges, Elne, Arles, aux principaux passages des Alpes, à Grenoble, Lyon, Trêves, Metz. Lyon possédait la direction centrale des douanes de la Gaule, et l'on a trouvé dans le lit du Rhône des plombs de la douane romaine, portant encore la marque de la ficelle qui les traversait et l'empreinte de l'étoffe ou du bois sur lesquels on les avait appliqués.
Les marchandises payaient à l'entrée comme à la sortie. En réalité, le portorium est donc moins un droit de douane qu'un droit de circulation, et les Romains ne paraissent avoir eu, en l'établissant, aucun souci de protection commerciale : la question de libre-échange ou de protection ne s'est peut-être point posée pour eux. Le droit était simplement un impôt prélevé sur les marchandises en vue d'assurer le bon entretien des routes et des ponts. Ce droit était fixé, pour la douane des Gaules, au quarantième, 2 1/2 pour 100, de la valeur des marchandises : de là le nom de la « quarantième des Gaules », qu'on donnait à l'administration et à l'impôt de la douane dans ce pays, quadragesima Galliarum.
Ajoutons enfin certains impôts indirects qui ne frappaient que les citoyens romains, l'impôt du vingtième sur les affranchissements, vicesima libertatis, l'impôt du vingtième sur les successions qui n'allaient pas aux plus proches parents, vicesima hereditatium. Tous les deux furent supprimés au commencement du IVème siècle.
5. L'administration financière. — Les impôts indirects étaient affermés à des compagnies de banquiers qu'on appelait des « publicains », publicani, du mot publicum, « impôt public ». Des intendants du prince, procuratores, élaient chargés de surveiller la perception, et d'empêcher les fraudes des contribuables ou les exactions des fermiers. Au IIème siècle, on essaya, pour les deux impôts du vingtième, la perception directe par l'intendant impérial. On peut noter que pour l'administration de la taxe sur les successions, la Gaule fut divisée en deux circonscriptions : l'une comprenait les provinces du Nord et formait le ressort du procurator vicesimœ hereditatium per Gallias Lugdunensem et Belgicam et utramque Germanium, l'autre était faite des provinces du Sud et dépendait du procurator vicesimœ hercditatium provinciarum Galliarum Narbonensis et Aquitanicœ.
Les impôts directs étaient perçus par voie administrative. Le chiffre du tribut foncier était fixé pour chaque cité. Les décurions municipaux en faisaient, à leurs risques et périls, la répartition entre les propriétaires. Ils étaient aussi chargés d'en opérer la levée. De là, évidemment, vint la lourde responsabilité qui pesa sur eux, et le triste sort qui leur fut fait sous le bas-empire. L'opération était surveillée par des envoyés de l'Étal, censitores, legati ad censum.
6. Situation financière de la Gaule. — II est impossible d'indiquer, à n'importe quel moment de son histoire, le chiffre exact des contributions que la Gaule avait à payer. Jules César la taxa à 40 millions de sesterces, 10 millions de francs; mais le chiffre a dû être provisoire et fut singulièrement élevé depuis, et tout nous fait croire que l'impôt, surtout l'impôt foncier, fut pour les Gaulois une charge fort pénible. D'abord son origine a pu le rendre odieux : on le considérait comme la marque de la conquête, plus encore qu'une contribution mise au service de l'État. « Les terres frappées du tribut, dit un écrivain du IIIème siècle, sont censées plus viles; les têtes humaines recensées pour l'impôt sont déchues»; toutes ces taxes sont autant de « marques de servitude ». Puis, le mode de perception était fâcheux; les décurions étaient responsables devant l'État et devenaient aisément durs à leurs concitoyens. Le chiffre des fortunes était donné par le contribuable lui-même, sa parole pouvait suffire : les fraudes étaient singulièrement faciles, elles étaient presque naturelles, tout le monde était tenté de mentir dans ces déclarations, et les chrétiens se vantaient d'être les seuls à ne point tromper l'État. Les plus riches s'en tiraient toujours à bon compte, et, comme le chiffre de l'impôt était fixé par cité et par province, les pauvres payaient souvent pour eux.
Ce qui montre bien quel était le poids du tribut et l'excès des impôts, c'est la facilité avec laquelle les empereurs accordèrent à la Gaule des remises d'arriérés : les historiens ne manquent pas d'ajouter que ces remises ne profilaient qu'aux riches, parce qu'on leur laissait toujours du temps pour payer. Les dégrèvements n'étaient pas moins faciles. Galba réduisit d'un quart les contributions de la Gaule. A la seule citéd'Autun, Constantin fit remise d'un quart de l'impôt foncier. L'empereur Julien diminua des deux tiers la quote-part que la Gaule avait à payer de ce même impôt.
Ce qui montre plus encore le poids de ce fardeau, c'est que tout le monde ne cessa de s'en plaindre et que ce fut la vraie cause des agitations et des troubles. Le recensement du temps d'Auguste remua tout le pays; c'est contre l'impôt que Sacrovir s'éleva sous Tibère; c'est l'impôt qui est à la source des grandes révoltes du Ier siècle. Sans doute aussi les terribles séditions de paysans au IIIème siècle, les soulèvements des Bagaudes ont eu pour cause la misère financière. Il était de mode sous le bas-empire de médire de l'impôt; le chrétien Lactance et le païen Zosime décrivent avec la même colère les exactions du fisc : seulement Lactance attaque Dioclétien, et Zosime s'en prend à Constantin. Dans les harangues officielles les orateurs se plaignaient avec force et franchise de la lourdeur des tributs. Ausone, remerciant l'empereur de l'avoir nommé consul, appelle dans sa harangue le registre des contributions un « tissu de fraudes » et affirme que « ce serait une œuvre pie de le brûler ».
L'impôt semble donc bien la principale charge qui ait pesé sur les sujets de Rome. A vrai dire, c'était la seule. Cérialis le rappelait aux Gaulois : « Nous n'avons imposé sur vous que les charges nécessaires au maintien de la paix. Sans armées, pas de repos; sans solde, pas d'armées; sans tribut, pas de solde. » Mais le peuple ne faisait pas de si longs raisonnements, et l'impôt fut à ses yeux le véritable tort de la domination romaine.
CHAPITRE IX
L'ARMÉE GALLO-ROMAINE
I. Le service militaire accepté par les Gaulois. — L'impôt du sang parut aux Gaulois incomparablement moins lourd que le tribut. A proprement parler, le service militaire ne fut jamais regardé par eux comme une charge sérieuse. En principe, ils le devaient tous à l'Etat romain, soit comme alliés ou sujets, soit comme citoyens. En fait, on n'était soldat que de son plein gré : l'empire était vaste, les guerres relativement rares, on enrôlait beaucoup de mercenaires germains. Les recrues volontaires suffirent toujours aux besoins de l'armée.
D'ailleurs la Gaule avait de tout temps aimé les combats et la vie de camp : c'était ce qui faisait sa gloire avant la conquête, et, pendant les cinq siècles de la domination romaine, les Gaulois ne faillirent jamais à leur vieux renom d'incorrigibles batailleurs. C'était la Gaule qui fournissait aux armées romaines leurs plus hardis fantassins et leurs plus solides cavaliers. Dans les moments de crise publique, les Gaulois ont plus volontiers offert à l'empire leur jeunesse que leur argent. A la fin de l'empire, il n'y avait, en dehors des troupes d'auxiliaires barbares, que les Gaulois qui sussent vraiment se battre. Les derniers beaux combats que Rome a soutenus en Orient contre les Perses ou en Occident contre les Germains ont été livrés par des Gaulois. Ammien Marcelin, qui les a vus de près, fait d'eux ce bel éloge : « Ils sont bons soldats à tout âge : jeunes et vieux portent au service la même vigueur; leurs corps sont endurcis par un constant exercice et ils bravent tous les périls ». Le poète Claudien énumère avec complaisance les troupes gauloises comme les meilleures de Stilicon, et rappelle que « le hasard et non la force doit triompher des Gaulois » :
Sitque palam Gallos casu non robore vinci.
2. Les soldats gaulois à la frontière de la Gaule. —
L'empire aurait pu expédier les recrues gauloises en Afrique et en Orient : c'eût été d'une saine politique, s'il avait voulu effacer à tout prix les distinctions de races et supprimer les habitudes nationales. Il le fit quelquefois, mais toujours dans des cas exceptionnels. En règle générale, il préféra envoyer les conscrits gaulois sur les bords du Rhin : c'était moins onéreux pour l'État, et l'obéissance des troupes était plus sûre. Les levées faites en Gaule servaient à combler les vides des légions ou des troupes auxiliaires qui campaient dans les deux provinces de Germanie. C'est là une des faces curieuses de la politique des empereurs : l'État employait surtout des Gaulois pour défendre la frontière de la Gaule; en servant l'empire, ils protégeaient leur pays contre leurs ennemis traditionnels.
Aussi les armées du Rhin étaient-elles véritablement des armées gauloises. Les séditions gauloises du Ier siècle eurent leur point de départ dans les camps du Rhin. Plus tard, il fut permis à ces soldats d'avoir près d'eux leurs femmes et leurs enfants : le camp devint pour eux une patrie, comme l'image en armes de la patrie gauloise. Leur demandait-on de porter secours aux provinces d'Orient, ils ne craignaient pas de refuser. Plutôt que de partir, on les vit un jour se mettre en insurrection et, pour ne point obéir aux ordres qui les éloignaient de la Gaule, faire de leur général un empereur.
3. Durée, conditions et avantages du service militaire. — Les Gaulois servaient ou bien comme légionnaires ou bien comme auxiliaires. Il ne devait y avoir dans les légions que des citoyens romains. Toutefois bon nombre de pérégrins y entraient, après avoir reçu au préalable le droit de cité romaine : c'étaient d'ordinaire les habitants des villes, les « citadins », qui servaient dans les légions; les « ruraux », rustici, faisaient le plus souvent partie des troupes auxiliaires : ceux-ci ne recevaient la cité romaine qu'en sortant du service.
Le service était, en règle générale, de vingt ans dans les légions, de vingt-cinq ans dans les autres corps. Mais il était permis de rester à l'armée bien au delà de ce temps; une inscription des pays du Rhin nous fait connaître un soldat qui a servi pendant quarante ans.
Le service mililaire étaitd'ailleurs un droit d'homme libre : les esclaves et les affranchis en étaient exclus en principe. Il va sans dire que les hommes riches s'en dispensaient aisément. La très grande majorité des soldats étaient fournis par la plèbe des villes et par la plèbe rustique. C'était pour les plébéiens un moyen de vivre et de bien vivre, et des historiens ont remarqué qu'un licenciement de troupes entraînait un reflux de petites gens dans les villes et les campagnes et un accroissement de vols et de brigandages. Le soldat recevait en moyenne une somme équivalant à 300 francs de notre monnaie; il était nourri, logé; l'État plaçait ses économies dans des caisses d'épargne militaires, il avait sa part dans les butins; il pouvait mériter des récompenses et des gratifications; il recevait des terres à sa sortie du service. C'était, pour le plébéien, un métier singulièrement plus lucratif que celui qu'il pouvait exercer aux champs ou dans la ville.
4. Les légions du Rhin. — L'armée chargée de défendre la Gaule se composait, dans les premiers temps, de huit légions, réparties en nombre égal entre les deux légats de Germanie. A partir du règne de Trajan, le nombre des légions germaniques fut diminué de moitié. Chacune de ces légions était commandée par un légat légionnaire, legatus legionis, qui avait sous ses ordres six tribuns et un grand nombre de centurions. Son effectif normal était de six mille hommes.
Voici les noms des légions qui ont fait un service de quelque durée dans les camps de Germanie (1) :
GERMANIE SUPÉRIEURE :
II Augusta. .............. Depuis Auguste jusque sous Claude.
XIII Gemina Pia Fidelis..... — — — Néron.
XIV Gemina Martia Victrix.. — — — Claude.
XVI Gallica................. — — — Vespasien.
*XXI1 Primigenia. ........... — Claude à la fin de l'empire.
IV Macédonica, ........... — — jusque sous Vespasien.
X Gemina Pia Fidelis. .... — Galba — Trajan.
XI Claudia Pia Fidelis.... — Vespasien — —
*VIII Augusta........... .... — — à la fin de l'empire.
GERMANIE INFÉRIEURE :
I Germanica............. Depuis Auguste jusque sous Vespasien.
V Alaudae.. .............. — — Vitellius.
XX Valeria Victrix......... — — — Claude.
XXI Rapax................. — — — Trajan.
XV Primigenia. ........... — Galba — —
*I Minervia. ............. — Domitien à la fin de l'empire.
XXX Ulpia. ................. — Trajan —
(1). Nous marquons d'un astérisque (*) celles qui y sont restées pendant presque toute la durée de l'empire.

Légionnaire casqué et armé du pilum (huitième légion) (1).
(1). Epitaphe : Caius VALerius, Caii Filius BERTA, MENENIA, CRISPVSMILes LEGionis VIII AVGustae, ANnorum XL, STIPendiorum XXI Filius Faciendum Curavit "Caius Valérius Crispus, fils de Caius, originaire de Berta [en Macédoine], de la tribu Menenia, soldat de la huitième légion auguste, âgé de quarante ans, ayant vingt et un ans de services : son fils a fait élever ce monument." — Le monument est originaire de Wiesbaden.
5. Les troupes auxiliaires. — Les troupes auxiliaires, auxilia, étaient également réparties entre les deux légats provinciaux. Ces troupes formaient des corps appelés « ailes », alae, ou « cohortes », cohortes, dont l'effectif, de beaucoup inférieur à celui des légions, variait entre cinq cents et mille hommes. Elles élaient commandées par un préfet,praefectus ; le préfet de l'aile, praefectus equitum ou praefectus alae, est supérieur, comme dignité, au préfet de la cohorte, praefectus cohortis.
Ces troupes sont surtout des troupes de cavaliers. Elles sont composées d'ordinaire d'hommes du même pays; elles conservent souvent leurs armes et leurs enseignes nationales, et leur chef était maintes fois choisi parmi les hommes les plus considérables de la cité ou de la région où la cohorte avait été levée. C'est ainsi que Classicus, praefectus alae Treverorum, était Trévire lui-même, et un des premiers de sa nation par ses richesses et la noblesse de son origine : on le disait de race royale. On voit que les Romains ont su donner comme préfets aux troupes gauloises ceux-là mêmes qui, les premiers d'entre leurs compatriotes, étaient presque leurs chefs naturels.
Aussi s'explique-t-on qu'un bon nombre de corps auxiliaires portent des noms de peuplades gauloises ou germaines. Voici ceux de ces corps qui apparaissent le plus souvent sous le haut empire. Beaucoup servent sur les bords du Rhin.
AILES :
Alae Balavorum. Alae Treverorum.
— Gallorum ou Gallicae. — Vallensium.
— Tungrorum. — Vocontiorum.
COHORTES :
Cohortes Alpinorum. Cohortes Batavorum.
— Aquilanorum. — Belgarum.
 Auxiliaire germain (1).
Auxiliaire germain (1).
Cohortes Biturigum.
— Gallonim.
— Germanorum.
— Helvetiorum.
— Lingonum.
— Menapiorum.
Cohortes Morinorum.
— Nerviorum.
— Tungrorum.
— Ubiorum.
1. Epitaphe : ANNAVuS, SEDAVONIS Filius, CIVES BETASIVS, eques alae II FLAVIAe : « Annavus, fils de Sédavo, citoyen Bétasien [en Germanie inférieure], cavalier de la seconde aile Flavienne. » — Le monument est de Mayence.
Il est bon de rappeler que, peu à peu, un assez grand nombre de recrues non gauloises se glissèrent dans ces différents corps, et que leur nom cessa plus tard d'indiquer exactement l'origine des soldats qui les formaient. — Sauf quelques exceptions, il y avait toujours plusieurs cohortes ou plusieurs ailes portant le même nom; elles étaient numérotées comme les légions.
6. L'armée du Rhin et la défense de la frontière. — Tout cela faisait une armée d'au moins cent mille hommes, en majorité des Gaulois, chargée de défendre la frontière de la Gaule et échelonnée depuis Leyde, Lugdunum Batavorum, jusqu'à Windisch sur l'Aar, Vindonissa. Au IIème siècle, l'armée du Rhin fut sensiblement réduite, peut-être de la moitié, sans que son organisation ait été modifiée.
Les deux quartiers généraux étaient Mayence, dans la Germanie supérieure, et Cologne, dans la Germanie inférieure. Tout le long du Rhin, on avait multiplié les forteresses et les colonies ; toutes les vingt lieues gauloises, au moins, on retrouvait une place d'armes de premier ordre : Noviomagus, Nimègue, Vetera Castra, Xanten, Novesium, Neuss, Colonia Agrippina, Cologne, Bonna, Bonn, Antunnacum, Andernach, Confluentes, Coblentz, Mogontiacum, Mayence, Borbitomagus, Worms, Nemetes, Spire, Argentoratum, Strasbourg, Augusta Rauricorum, Augst. Tous ces postes étaient reliés par une grande route longeant la rive gauche du Rhin; sur cette route venaient déboucher les voies qui conduisaient de l'intérieur du pays : à Windisch, la route d'Italie; à Bâle, la route de Lyon et du sud de la Gaule; à Strasbourg, la route de Metz et du Centre,à Cologne, la route du Nord, de Bologne et de la Bretagne. Le long du Rhin, une flottille, classis Germanica, achevait de maintenir les communications entre les forteresses. En arrière, une route de Cologne à Strasbourg, par Trêves, couvrait la retraite et permettait aux armées de se rejoindre hors de la portée de l'ennemi. Trêves, à égale distance de Cologne et de Mayence, était le centre de l'approvisionnement des troupes. Au delà du Rhin, on avait construit une solide muraille, un « chemin » Fortifié, limes, qui faisait à la Gaule une frontière d'avant-postes : il partait de Coblentz pour aboutir à Ratisbonne et fermait la dangereuse trouée formée par le coude du Rhin.
 Le pont de Mayence (1).
Le pont de Mayence (1).
Il était difficile de mieux comprendre et de combiner avec plus d'intelligence la défense de la frontière gauloise. Pen
(1) Médaillon de plomb trouvé dans la Somme. On y lit les inscriptions : SAECULI FELICITAS, MOCONTIACVM, FLuvius RENYS, CASTELum. En haut, deux empereurs (Dioclétien et Maximien?), entourés de soldats et de captifs. En bas, un empereur (Maximien?) revient d'une guerre au delà du Rhin, escorté de la Victoire.
dant trois siècles, les barbares ne purent jamais franchir cette muraille de colonies et de soldats.
7. Le système de défense à l'intérieur sous le bas-empire. — Elle fut rompue au milieu du IIIème siècle, et pendant de longues années les barbares dévastèrent la Gaule. Toutes les précautions militaires avaient été accumulées à la frontière, l'intérieur du pays avait été laissé sans défense d'aucune sorte, sauf en Narbonnaise : les villes et les campagnes des Trois Gaules furent aisément la proie de l'envahisseur.
 signifer d'une légion gauloise (1).
signifer d'une légion gauloise (1).
Aussi, vers l'an 300, l'organisation militaire de la Gaule fut-elle modifiée. On laissa sans doute aux frontières le plus de troupes possible, et c'est là qu'on éleva le plus de forteresses. Mais on fortifia également toutes les villes de la Gaule, grandes ou petites : on les entoura de murailles gigantesques, hautes de trente
1, Monument du Strasbourg du IVème siècle.— En haut, LEONTIVS...??
pieds, flanquées d'énormes tours. On peut voir encore des restes de ces remparts dans presque toutes nos cités, à Bourges, à Saintes, à Bayonne, à Dax, à Senlis, à Beauvais. Il y en eut de ce genre à Paris, dans l'île de la Cité. Puis, tous les points stratégiques de la Gaule furent occupés par des châteaux forts ou castella. On mit des garnisons un peu partout. Des troupes d'auxiliaires barbares furent installées même dans l'intérieur du pays. Il y eut des corps de Francs campés à Rennes, des Teutons à Sens, des Suèves en Auvergne, au Mans, à Bayeux, à Coutances; Paris reçut une garnison de Sarmates, commandée par un préfet. Des milices locales furent organisées. La défense, jusque-là concentrée aux frontières, fut généralisée à la Gaule entière.
8. Les flottes et la défense maritime. — La Gaule avait en même temps une armée navale. Au commencement de
l'empire, au moment où l'on faisait de la Gaule Narbonnaise une province de colonies et de défense militaire, une flotte avait été établie à Fréjus, Forum Julii : on y avait construit
 Monnaie de Constant relative à la flotte de Boulogne (1).
Monnaie de Constant relative à la flotte de Boulogne (1).
(1). Légende: CONSTANS Pius Félix AVGustus. BONONIA ; OCEANEM [sic]. — Constant s'embarque à Boulogne pour l'Angleterre. Voyez à la proue du navire deux ligures; en arriére deux enseignes; et tout à gauche, la tour ou le phare de Boulogne.
un port de guerre de premier ordre. Au IIème siècle, ce port fut en partie abandonné et la flotte supprimée. Une autre flotte, classis Britannica, était installée à Boulogne et protégeait les relations entre la Gaule et la Bretagne. Nous avons déjà mentionné la flotte du Rhin.
Au IVème siècle, la défense des côtes fut réorganisée suivant les mêmes principes que la défense de l'intérieur. A tous les points importants du rivage, nous trouvons des corps de marine; il y a une « milice garonnaise » à Blaye; une cohorte « armoricaine » à Granville; d'autres troupes à Bayonne, à Vannes, à Rouen, à Avranches, à Marseille : les embouchures de tous les fleuves sont gardées. En même temps, des flottilles fluviales à l'intérieur du pays viennent renforcer la défense des terres; on en rencontre sur le Rhône, sur la Saône, dans les lacs du Sud-Est : il y a à Paris une flottille dite classis Anderetianorum, placée sous les ordres d'un paefectus, et qui sert d'appui à la garnison des Sarmates.
9. Aspect militaire de la Gaule sous le bas-empire. — Avec ses corps d'armée aux frontières, ses milices locales, ses flottes, ses campements de barbares, la Gaule entière ressemblait, en l'an 400, à un immense camp retranché. A côté de ses chefs civils, les gouverneurs et le préfet du prétoire, elle a maintenant aussi ses chefs militaires : le « duc d'Armorique », aux dux tractus Armoricani, veille à la défense des rivages de l'Océan, les ducs de Séquanie, de seconde Belgique, de Germanie première, le duc de Strasbourg, le duc de Mayence, s'occupent de la frontière du Rhin. La direction suprême est entre les mains du « maître de la milice pour les Gaules », magister militiae, qui réside à Trêves, capitale militaire de toute la Gaule. La Gaule forme en ce temps-là un vérilable Etat militaire : elle a ses soldats à elle qui sont surtout des Gaulois, et c'est pour elle et chez elle qu'ils combattent.
CHAPITRE X
LA SOCIÉTÉ : PETITES GENS ET CORPORATIONS
1. Les distinctions sociales en Gaule. — De ce que tous les habitants de la Gaule obéissaient à un seul maître; l'empereur, de ce que l'État pouvait réclamer de tous l'impôt et le service militaire, il ne faut pas conclure que l'empire romain formait une vaste société démocratique, semblable à la France moderne. L'égalité fut la chose du monde qui lui manqua le plus. Il y avait des distinctions à l'infini entre les hommes, suivant leur naissance, suivant leur profession, surtout suivant leur richesse. La société gauloise fut aussi divisée à l'époque romaine que la société française au temps de la féodalité. Il y eut un aussi grand nombre de classes et une hiérarchie aussi régulière entre ces classes.
Ces distinctions remontaient d'ailleurs aux périodes les plus lointaines de la vie antique : Rome les avait eues, comme Sparte et comme Athènes; mais elle les avait conservées avec plus de soin, maintenues strictement et transportées un peu partout dans le monde conquis par elle. Il y avait maintenant en Gaule autant de groupes de citoyens qu'il y en avait eu autrefois dans la Rome primitive. Chacun de ces groupes vivait à part, avait sa place marquée au tribunal, à l'armée et au théâtre. Nous avons vu qu'ils ne payaient pas tous les mêmes impôts.
 Enfant vêtu de cuculle.
Enfant vêtu de cuculle.
Il y a plus, l'habitude se répandit de les distinguer par des costumes de forma et de couleur différentes. Les règlements impériaux veillaient à ce que la bande de pourpre que les chevaliers portaient sur leur tunique (angustus clavus) fût plus étroite que celle des sénateurs (latus clavus). La toge était destinée au citoyen romain. Le Gaulois portait surtout le manteau à capuchon qu'on appelait le cuculle. Le vêtement de pourpre était réservé à l'empereur seul : c'était un crime de lèse-majesté, punissable de mort, que de se vêtir d'un manteau de pourpre. L'empereur Sévère Alexandre eut même l'intention d'assigner un costume spécial à toutes les fonctions, à toutes les dignités, à toutes les classes : on l'en dissuada, mais ce que cet empereur renonça à établir, l'usage le fit mieux que la loi.
2. La plèbe urbaine et la plèbe rustique. — Indépendamment de la grande distinction entre esclaves, servi, et citoyens ou hommes libres, liberi, la société présentait deux groupes bien distincts : ceux qui étaient propriétaires du sol et ceux qui ne l'étaient pas.
Parmi ces derniers, on peut séparer les plébéiens proprement dits des marchands ou commerçants, negotiatores, et des artisans ou industriels, artifices.
Il y avait en Gaule, comme dans tout l'empire, une « plèbe des villes », plebs urbana, et une « plèbe des campagnes », plebs rustica. Nous connaissons fort peu la situation matérielle et l'état moral de l'une et de l'autre. A Rome, la plèbe demandait « du pain et des jeux de cirque », panem et circenses. II est probable que, dans les grandes villes de la Gaule, les exigences de la plèbe étaient de même nature, mais d'une moins grande intensité. Des jeux, il y en eut dans toutes les villes gauloises, si toutes ne possédaient point de cirque, chacune eut du moins son théâtre et son amphithéâtre. Du pain, la plèbe en trouva dans les camps, où les plébéiens des villes gauloises servirent surtout comme légionnaires : ceux de Rome se dispensaient du service militaire. Aussi la plèbe des provinces ne fut-elle jamais à beaucoup près aussi dangereuse à l'État que la populace romaine, le vrai fléau de l'Italie, Pendant les premiers temps de l'empire, dans quelques villes privilégiées, comme à Narbonne, il fut même permis à la plèbe de voter dans les assemblées.
La plèbe rustique de la Gaule fournissait aussi aux années romaines un très fort contingent. D'elle venaient les soldats auxiliaires.
Il ne semble donc, pas que, pendant les trois premiers siècles, le sort de l'une et de l'autre plèbe ait été bien misérable. Au IIIème siècle, quand les invasions commencèrent, que les légions furent décimées, que les barbares, de gré ou de force, se rendirent maîtres des armées romaines et imposèrent leurs services au détriment des volontaires gaulois, la plèbe, éloignée des camps, reflua clans les villes et les campagnes. Cela explique en partie sa misère dans les deux derniers siècles de l'empire. Il y eut alors de véritables insurrections, connues sous le nom de révoltes des « Bagaudes »; les plébéiens des villes se mêlèrent même parfois aux barbares pour piller et pour tuer. Ceux des campagnes se réfugièrent le plus souvent sous le patronage des grands, et, comme fermiers à demeure ou coloni, vécurent, à peine supérieurs aux esclaves, dans une dépendance qui leur assura au moins le pain quotidien.
3. Artisans et marchands. — Au-dessus des plébéiens proprement dits se trouvaient les industriels, les artisans, les négociants, les armateurs, artifices, negotiatores, plébéiens riches ou aisés qui formaient une véritable bourgeoisie marchande. La grande aristocratie romaine méprisait assez cette classe de gens. Ils étaient suspects par leur origine : c'étaient tous des parvenus, anciens esclaves presque toujours, en tout cas plébéiens, étrangers souvent. Ils étaient plus suspects encore par leur genre de vie, « métier vulgaire, dit quelque part Sénèque, où l'on ne recherche qu'un gain sordide ». Mais dans la province, dans la Gaule surtout, la bourgeoisie laborieuse des grandes villes de Narbonne, d'Arles, de Lyon ou de Trêves jouissait de la considération publique. C'était elle qui faisait la richesse de ces villes; c'est son travail qui explique la rapidité prodigieuse avec laquelle, en moins de cent ans, se construisirent les cités gauloises. La fortune de quelques-uns de ces commerçants était prodigieuse, si l'on en juge par les gigantesques tombeaux que les négociants Trévires se sont fait élever sur les bords de la Moselle.
Beaucoup d'entre eux travaillaient isolément, vivaient sans attache avec leurs confrères. Toutefois il n'est pas rare de les trouver groupés en syndicats ou corporations, qu'on appelait des « collèges », collegia.
Les principaux métiers qui se groupaient ainsi sont les suivants.
4. Les grandes corporations. — Les plus importantes , corporations étaient peut-être celles que formaient les bateliers, patrons ou armateurs de navires, nautae, navicularii. « Aujourd'hui, dit M. Boissier, les commerçants qui tiennent la première place dans nos ports de mer sont les armateurs; de même alors la corporation des « nautes » était rangée parmi celles qu'on considérait le plus. On les trouve en grande estime dans toutes les villes de commerce; à Arles, ils formaient cinq associations différentes. Un des plus anciens souvenirs que nous ayons conservés de l'existence du vieux Paris, c'est un monument élevé par les « nautes de la Seine».
 Autel élevée par les nautes parisiens (1).
Autel élevée par les nautes parisiens (1).
A Lyon, on distinguait les « nautes du Rhône et de la Saône »; ils formaient deux corporations puissantes, qui possédaient des comptoirs dans les villes voisines des deux rivières; les personnages les plus élevés,de la cité étaient fiers de leur appartenir, et les habilants de Nîmes leur réservaient quarante places dans leur bel amphithéâtre. » — A côté d'eux, il
faut placer « les patrons de radeaux », ratiarii, qu'on trouve sur les bords du lac de Genève.
Les corporations dites de centonarii réunissaient tous les fabricants d'étoffes grossières, en particulier de bâches, de couvertures ou de toiles, centones. — Les dendrophori étaient les marchands de bois de construction et probablement aussi les scieurs de long et ceux qui exploitaient les bois taillis et les forêts.— Les fabri tignarii étaient les charpentiers. —
1. L'inscription porte : TIBerio CAESARE AVGusto, IOVI OPTVMO MAXSVMO, NAVTAE PARISIACi puBLICE POSIERuNt « Sons le règne de Tibère, les nautes parisiens ont élevé à frais publics ce monument à Jupiter Très Bon et Très Grand. » Au musée de Cluny.
 Charpentier. (Musée de Bordeaux.)
Charpentier. (Musée de Bordeaux.)
Ces trois corporations existaient sans nul doute dans toutes les villes de la Gaule : le plus souvent, elles se réunissaient pour ne former qu'un collège, qui groupait ensemble tous les gens de métier. La loi, qui surveillait d'assez près ces corporations, recommandait que, « pour leur donner plus de force, on en fit un seul corps ».
Les autres collèges ne se rencontraient que dans les cités les plus importantes ou dans certaines contrées de la Gaule.
Les collèges des marchands de vin, vinarii, ceux des fabricants ou marchands d'outres, utricularii, se montrent surtout dans les villes de la vallée du Rhône. C'étaient deux métiers solidaires l'un de l'autre, car les outres servaient au transport du vin. — Puis venait, par exemple à Lyon, «la très brillante corporation des négociants cisalpins et transalpins », splendidissimum corpus negotiatorum Cisalpinorum et Transalpinorum, elle groupait, sans doute, tous ceux qui faisaient le commerce de commission et de transit dans les Gaules des deux côtés des Alpes. — A Lyon encore, nous trouvons la corporation des sagarii, les fabricants de « sayons» ou de « saies », sagum, le vêtement cher aux Gaulois. — Dans d'autres villes, les bouchers, laniones, paraissent s'être réunis en collèges,qui n'eurent pas d'ailleurs, tant s'en faut, la même importance qu'au moyen âge.
5. Rôle public de ces corporations. — L'Etat romain n'aimait pas les corporations. « Rome voulait, a dit justement M. Renan, par suile de son idée exagérée de l'État, isoler l'individu, détruire tout lien moral entlre les hommes. » Pendant les premiers siècles de l'empire, on prit les précautions les plus minutieuses contre les corporations des plé
béiens. Il fallait l'autorisation du prince pour qu'elles pussent se former et vivre; les peines les plus sévères menaçaient ce qu'on appelait collegia illicita, les « collèges défendus », ce que nous nommerions volontiers les « sociétés non autorisées ».
Seuls les collèges des ouvriers, des industriels, des négociants, trouvèrent grâce devant l'État : ils furent reconnus et acceptés.
 Dendrophores (1).
Dendrophores (1).
Encore furent-ils soumis à une assez rigoureuse surveillance jusque vers le IIème siècle. Mais en ce temps-là, la politique des empereurs devint plus libérale, et,
1. D'après un bas-relief du musée de Bordeaux.
tout en les observant de près, on leur donna comme une existence officielle. Désormais ces grands collèges furent, non seulement reconnus, mais protégés, et on leur fit une place dans l'Etat, « ils ont été établis, dit un jurisconsulte, pour rendre service à l'État », et un magistrat de Rome affirmait qu' « ils servaient la patrie à leur manière ».
Ils furent chargés de certains services publics : en retour, l'État leur accordait des immunités financières, des privilèges devant les tribunaux, et des places d'honneur dans les cérémonies publiques. Les bateliers de la Loire, de la Seine, du Rhône et de la Saône eurent sans doute l'obligation de veiller au transport des fournitures dues à l'État : ils devinrent les entrepreneurs des travaux publics. Les collèges associés des dendrophori, centonarii et fabri furent dans les villes chargés de maintenir l'ordre, et en particulier d'éteindre les incendies ; les ouvriers qui en faisaient partie venaient se placer sous les ordres du chef de la police municipale : nous savons qu'à Nîmes ce « préfet de police » s'appelait praefectus vigilum et armorum. Quand un incendie se déclarait dans une grande ville, le crieur public appelait au secours tous les membres des collèges : « Collegiati omnes! » Ces corporations devinrent ainsi, sous le bas-empire, comme elles étaient au moyen âge, de véritables corps publics, jouant un rôle dans les affaires politiques, puissantes, fières et fort remuantes.
6. Organisation de ces corporations. — Elles étaient en effet fortes par le nombre de leurs associés. Les plus grandes devaient bien compter cent cinquante membres. A leur tête était un chef suprême, le « maître du collège», magister; près de lui un curator s'occupait surtout des affaires administratives, tous deux étaient élus pour un an par les membres. Les séances, le chiffre des cotisations, les droits des chefs, le mode d'élection, étaient fixés par un règlement qu'on appelait la " loi du collège", lex collegii. La discipline était, dans ces corps, rigoureusement maintenue par les maîtres, ce qui explique la durée et la puissance grandissante des collèges. Ils avaient un lieu de réunion nommé la schola.
Ces associations avaient des protecteurs : elles prenaient, parmi les hommes les plus considérés de la cité, un ou plusieurs « patrons », patroni,qui les représentaient en justice. En outre, elles avaient un protecteur céleste : car, de même que les corporations du moyen âge se choisissaient un patron et une chapelle, les collèges des artisans possédaient leur dieu et leur temple. Les dendrophores étaient voués au culte de Cybèle, à laquelle ils servaient de prêtres les jours de procession.
Enfin les sociétés de ce genre jouirent de la personnalité civile : elles possédaient des immeubles, recevaient des legs, avaient des esclaves qu'elles pouvaient affranchir. Véritables petites cités dans la cité municipale, les corporations se réunissaient autour de leurs bannières, vexilla, qu'elles promenaient dans les cérémonies publiques. Un écrivain du IVème siècle nous montre, à l'entrée de l'empereur dans une grande ville de Gaule, toute la population venant au-devant de lui, et, à côté des processions de prêtres portant les statues des dieux, les collèges présentant leurs bannières. Tout cela survivra à l'empire et se retrouvera au moyen âge.
7. Les collèges des petites gens. — A côté de ces corporations riches et nombreuses, presque officielles, il y avait les « collèges des petites gens », collegia tenuiorum : c'étaient ceux que formaient les esclaves, ou les affranchis et les plébéiens pauvres. L'objet de ces sociétés était d'assurer à leurs membres ce que les anciens désiraient par-dessus tout, un lieu de sépulture. « On prenait autant de peine, dit M. Boissier, pour se préparer un tombeau qu'un chrétien met de soin à se munir avant sa mort des derniers sacrements. C'était le souci de tout le monde : on y songeait d'avance, pour n'être pas pris au dépourvu. » Ces collèges de pauvres garantissaient un tombeau aux associés : ils achetaient un terrain qui devait servir de sépulture commune à tous les membres. C'étaient, en somme des « sociétés de secours mutuels », mais comme on pouvait les comprendre en ce temps-là : on épargnait pour la sépulture comme de nos jours on épargne pour la maladie ou la vieillesse.
Pour l'achat et l'entretien de ce lieu de sépulture, les membres du collège payaient une petite cotisation mensuelle, stips menstrua. Ainsi que les grands collèges, ces sociétés de petites gens se plaçaient sous la protection d'une divinité, ils s'appelaient les «dévots de Jupiter», ou les « adorateurs de la fontaine Eure », cultores fontis Urae, comme à Nîmes, parfois même « ceux qui boivent ensemble », copotores, comme à Bordeaux.
Chacun de ces collèges renfermait, à la différence des autres, un nombre de membres fort limité : tout le monde s'y connaissait. Les humbles y trouvaient, en attendant la tombe commune, comme une gaité de famille et la fraternité d'une église. Pour ces humbles, la vie dans l'État romain, si foncièrement aristocratique, était sérieuse et pénible. « Il y faisait un froid glacial, dit M. Renan, comme en une plaine uniforme et sans abri. La vie reprenait son charme et son prix dans ces tièdes atmosphères de synagogue et d'église. »
L'Etat romain maltraitait fort ces petits collèges, qui lui étaient doublement antipathiques, et comme sociétés d'allure mystérieuse, et comme ramassis de gens de rien. Il employa tout son pouvoir à les surveiller. Ils ne pouvaient recevoir qu'un nombre de membres très limité; la loi ne leur permettait de se réunir qu'une fois par mois, ils ne devaient s'occuper dans ces séances que de sépulture et d'affaires religieuses. Toute association qui n'avait pas un « motif de religion » était « illicue ». L'empire s'acharna contre eux, combattant ainsi, remarque encore M. Renan, « un désir légitime des pauvres, celui de se serrer les uns contre les autres dans un petit réduit pour avoir chaud ensemble ».
Dans cette lutte, il se trouva que l'empire romain fut vaincu. C'est au milieu de ces petites gens que le christianisme prit naissance. Les églises chrétiennes ne furent à l'origine que des collèges d'humbles et de pauvres réunis pour prier ensemble et s'assurer dans les catacombes une sépulture commune. « Chacun, dit Terlullien. apporte tous les mois une cotisation modique. Il paye s'il le veut, quand il le veut, ou plutôt quand il le peut. Nous regardons cet argent comme un dépôt qui nous est confié par la piété. Il sert à donner du pain aux pauvres et à les ensevelir. » Voilà la formule des collegia tenuiorum. C'est comme collèges que les chrétiens furent persécutés, et surtout comme collèges de misérables. Leur triomphe sur l'empire fut en partie celui des petites gens sur l'aristocratie gouvernante et du collège sur l'État.
CHAPITRE XI
LA SOCIÉTÉ : NOBLES ET PROPRIÉTAIRES
1. La propriété, origine principale de la noblesse. — Les classes supérieures étaient composées de ceux qui possédaient le sol. La propriété de la terre a été, dans l'antiquité la plus lointaine comme au moyen âge, l'origine de toute considération et presque toujours la condition de tout pouvoir. Le propriétaire foncier pouvait aspirer à tous les honneurs. Les moins riches formaient les aristocraties municipales : l'ordre des décurions était presque uniquement composé de propriétaires, possessores, et encore fallait-il, à ce qu'il semble, posséder au moins 25 arpents pour avoir le droit d'en faire partie. Les plus riches composaient l'aristocratie romaine, appartenaient à la grande classe des « sénateurs de l'empire ».
2. La noblesse équestre. — Toutefois, entre ces deux noblesses, existait ce qu'on appelait l'« ordre équestre » ou l'« ordre des chevaliers », equestris nabilitas, equites Romani : les Gaulois purent prétendre à cette noblesse des l'instant où ils étaient admis au droit de cité.
La noblesse équestre, à la différence des deux autres classes supérieures, fut une aristocratie d'argent en même temps qu'une aristocratie de mérite : la possession de la terre n'était pas attachée au titre de chevalier. Il suffisait de posséder une fortune en espèces ou de recevoir de l'Etat un traitement important. On pouvait d'ailleurs appartenir à la fois à la noblesse municipale des décurions et à l'ordre équestre. Les principaux magistrats et les prêtres des villes gauloises en faisaient partie presque de droit et s'y rencontraient avec les fermiers de l'impôt, les intendants du prince, les préfets et les tribuns de l'armée du Rhin, aussi bien qu'avec les notables négociants et les affranchis parvenus. Jamais corps de noblesse ne fut plus mêlé que la chevalerie romaine.
Elle ne représentait aucune communauté d'origine, d'intérêts ou de tendance. Si riches que furent la plupart de ses membres, il lui manqua surtout ce qui, dans le monde ancien, était à la base de l'autorité et de la dignité : la propriété foncière. Malgré ses efforts, l'empire romain fut impuissant à maintenir le prestige d'une aristocratie qui ne reposait pas sur le sol. Aussi, dès le commencement du IVème siècle, le corps des chevaliers a à peu près disparu de l'empire. Il n'y a plus, au-dessus des possessores locaux, que les grands propriétaires, sénateurs romains.
3. La noblesse sénatoriale en Gaule. — Les principaux personnages de la Gaule ambitionnèrent de bonne heure le titre de sénateurs romains, et la politique impériale, surtout au Ier et au IIIème siècle, ne fit qu'encourager leurs ambitions. La Gaule Narbonnaise avait fourni au sénat, dès le milieu du Ier siècle, quelques-uns de ses membres les plus illustres. L'empereur Claude obtint pour les plus riches ou les plus nobles des villes de la Gaule Chevelue le droit d'entrer au sénat; on le combattit : mais il prononça à ce propos un discours fort énergique qui nous a été conservé: «Voici, par exemple, disait l'empereur, la colonie de Vienne; vous savez depuis combien de temps elle nous donne des sénateurs. Est-ce que Lyon ne nous a pas donné des collègues? Le regrettez-vous?,.. Je n'estime pas juste que les provinciaux eux-mêmes, lorsqu'ils peuvent être l'honneur du sénat, en soient écartés, » Ce discours de Claude et le discours que Cérialis adressa aux Gaulois révoltés sont les deux programmes de la politique impériale en Gaule.
En même temps que les Gaulois arrivaient au sénat romain, l'appellation de sénateur, répandue à profusion, cessait d'être le nom d'une fonction effective pour devenir un titre de noblesse. Etaient sénateurs du peuple romain presque tous les grands propriétaires de la Gaule, qu'ils fussent ou non d'anciens magistrats municipaux. Le titre était transmis héréditairement, il passait même aux femmes; il y avait des sénateurs romains des deux sexes. Le sénateur ajoutait à son titre le qualificatif d' " homme très illustre",vir clarissimus, sa femme s'intitulait femina clarissima. A la fin du IIIème siècle, il y eut ainsi, dans tous les municipes gaulois, une dizaine de sénateurs romains, riches en domaines et en influence, et qui dominaient du prestige de leur titre et de l'étendue de leurs biens la noblesse municipale des décurions.
4. L'extension de la grande propriété, — Un sénateur du peuple romain était avant tout un grand propriétaire. Ses domaines les plus vastes étaient situés dans le territoire de sa ville natale. Il faut songer, pour avoir une idée de sa richesse foncière, qu'un domaine de 1000 arpents était considéré comme des plus modestes. Le Bordelais Ausone, qui appartint dans les premières années de sa vie à la simple noblesse municipale, décrit en ces termes le « petit champ héréditaire » qu'il possédait en ce temps : « Je cultive 200 arpents de terre labourable; la vigne s'étend sur 100 arpents; le pré sur la moitié moins. En fait de bois, j'en ai deux fois plus que de pré, de vigne et de terre tout ensemble. » Cela fait 1050 arpents, soit plus de 250 hectares, et notons qu'Ausone appelle ce beau domaine « une toute petite villa», herediolum, villula. Plus tard, quand Ausone devint magistrat de l'empire et sénateur du peuple romain, il avait des domaines un peu partout dans le Bordelais et le Bazadais; d'autres, fort considérables, en Saintonge et dans le Poitou. Son petit-fils en possédait dans tout le sud-ouest de la Gaule, puis à Marseille et jusqu'en Macédoine. Paulin de Bordeaux, qui fut plus tard évoque de Nole, était propriétaire, sur les bords de la Garonne, de véritables royaumes : on disait dans le pays regna Paulini.
« Ces grandes fortunes, dit Fustel de Coulanges dans son livre sur l'Alleu, ne se sont pas formées par l'extension à l'infini d'un même domaine. C'est par l'acquisition de nombreux domaines fort éloignés les uns des autres qu'elles se sont constituées. Les plus opulentes familles ne possèdent pas un canton entier ou une province; mais elles possèdent vingt, trente, quarante domaines épars dans plusieurs provinces, quelquefois même dans toutes les provinces de l'empire. » L'historien Ammien Marcellin appelle ces domaines de l'aristocratie foncière des « patrimoines épars dans le monde ».
5. Description de la villa. — Chacun de ces domaines, villa, avait sa vie propre : il formait presque un petit Etat. La demeure du maître, le château, praetorium, s'élevait au centre, le plus souvent sur une colline, dominant la terre comme le sénateur dominait ses hommes. Ce « prétoire » était une habitation somptueuse, vaste et compliquée : elle répondait à la fois à cet amour du confort et du luxe et à ces soucis pratiques que surent toujours concilier les Gallo-Romains de l'empire. Elle renferme des greniers où il y a des provisions pour plusieurs mois; elle est entourée de remparts et de tours qui la mettent à l'abri d'un coup de main de brigands ou de barbares. Mais à côté de cela, on y rencontre accumulé tout ce qui faisait la richesse et l'élégance de la vie.
 Mosaïque de Lillebonne (scènes de chasse) (1)
Mosaïque de Lillebonne (scènes de chasse) (1)
Une lettre de Sidoine Apollinaire nous décrit dans ses moindres détails la villa d'un sénateur de Narbonnaise au Vème siècle : «
1. L'inscription nous donne les noms des artistes mosaïstes : Titus SENnius FELix, PVTEOLANVS, FECit, ET AMOR, Civis Kaletus (??), DISCIPVLUS, « fait par Titus Sénius Félix, de Pouzzoles, et par son disciple Amor. »
On y arrive, dit Fustel de Coulanges en résumant cette lettre, on y arrive par une large et longue avenue qui en est le « vestibule ».On rencontre d'abord le balneum, c'est-à-dire un ensemble de constructions qui comprend des thermes, une piscine, un frigidarium, une salle de parfums, c'est tout un grand bâtiment. En sortant de là, on entre dans la maison. L'appartement des femmes se présente d'abord ; il comprend une salle de travail où se tisse la toile. Sidoine nous conduit ensuite à travers de longs portiques soutenus par des colonnes et d'où la vue s'étend sur un beau lac. Puis vient une galerie fermée où beaucoup d'amis peuvent se promener. Elle mène à trois salles à manger. De celles-ci on passe dans une grande salle de repos, diversorium, où l'on peut à son choix dormir, causer, jouer. L'écrivain ne prend pas la peine de décrire les chambres à coucher, ni d'en indiquer même le nombre. »
Au pied de la colline se trouve la ferme, qu'on appelle villa rustica. Elle se compose d'une série de constructions séparées par une cour centrale, curtis : il y a là les étables, les colombiers, les granges, les celliers; puis la cuisine, grande et haute de plafond, qui servait de lieu de réunion à toute la domesticité; on y trouvait aussi un four, un moulin et. suivant les pays, un pressoir pour le vin et pour l'huile. Entre les communs s'étendaient les chambres des esclaves.
Plus loin enfin, s'élevaient, sur le domaine, de petites fermes où habitaient les tenanciers du sénateur, colonicae.
6. Importance historique de la villa. — Tous ces grands domaines ont leur histoire, et cette histoire dure encore. La plupart de nos villages se sont formés autour de ces châteaux; d'ailleurs, avec leur nombreuse population d'esclaves occupés aux métiers les plus divers, la villa était déjà un véritable village. Au IVème siècle, l'ensemble se complète par la construction d'une chapelle, comprise dans l'enceinte du château. Dès lors nous avons, réuni sur un même point, tout ce qui fera le village moderne. C'est de ces villae que viendront presque toutes nos paroisses et nos communes rurales. Elles conservent aujourd'hui encore le nom du premier propriétaire et peut-être les limites du domaine primitif, Pauillac, en latin Pauliacus, Juilly, en latin Juliacus, Fleury, Floirac, tous deux également Floriacus en latin, sont les anciennes villas d'un Florus, d'un Julius, d'un Paulus. Si nos grandes villes ont pour origine les antiques oppida celtiques, la plupart de nos villages ne sont que les domaines des grands seigneurs gallo-romains.
7. Les serviteurs de la villa. — Sur ces domaines vit tout un monde de serviteurs qu'on appelle les « hommes » du maître. Ce sont d'abord les esclaves : les uns attachés à la personne du maître comme domestiques d'intérieur, les autres travaillant à la ferme, à la lingerie, au moulin, d'autres occupés à la culture du sol. Comme ces esclaves sont fort nombreux, on les a répartis en escouades, dirigées chacune par un chef ou magister et surveillées par un régisseur, villicus : maîtres et régisseur sont également des esclaves.
Au-dessus des esclaves les affranchis sont employés, auprès du maître, à des services plus honorables : ils sont intendants, secrétaires, précepteurs.
Enfin, nous trouvons les fermiers attachés au sol, les « colons » : ce sont des cultivateurs libres qui payent, chaque année, une redevance fixe au maître, et qui, cela fait, peuvent cultiver la terre à leur guise. Le propriétaire ne peut augmenter cette redevance; mais en revanche il n'est pas permis au colon d'abandonner la terre dont il est le tenancier.
8. La vie d'un grand seigneur. — Sur son domaine, le sénateur gallo-romain est véritablement roi. Il y vit plus volontiers qu'à la ville, où il ne va guère que pour les fêtes religieuses ou les devoirs de la vie publique. La vie qu'on menait dans ces villas nous est fort bien connue, grâce aux écrivains gaulois de la fin de l'empire, Ausone, Paulin de Pella, Sidoine Apollinaire.
 Braques gaulois. (D'après un bas-relief)
Braques gaulois. (D'après un bas-relief)
Elle y était à la fois fort occupée et fort agréable. Les sénateurs surveillaient de très près la gestion de leurs biens-fonds : c'était la tradition romaine, qui ne s'était jamais perdue depuis Romulus, Nous savons d'un noble aquitain du IVème siècle qu'il trouva « le moyen de rendre aux vignobles épuisés leur ancienne vigueur » : c'est ainsi que de nos jours les grands propriétaires girondins luttent avec succès contre le phylloxéra. Les sénateurs aimaient à vivre au milieu de leurs serviteurs, et tous n'abandonnaient pas à des intendants le soin de veiller à la rentrée des foins, à la cueillette des olives ou à l'écoulage du vin.
Mais cela ne les empêchait nullement de se distraire. Leur vie était, comme leur château, à la fois agréable et pratique. Ils chassaient beaucoup, dans les vastes forêts des Ardennes, du Morvan ou du Limousin. Leurs écuries étaient
remarquablement montées; ils avaient des meutes superbes, et notaient avec soin la généalogie de leurs chevaux et de leurs chiens : les braques gaulois, qu'on dressait à la chasse au sanglier, étaient célèbres dans l'empire. Quelques-uns de ces nobles pratiquaient la chasse au faucon ou à l'arbalète. C'est déjà la vie que mènera le seigneur du moyen âge. Ajoutez il cela le luxe intérieur. « Ma table, dit l'un d'eux, était toujours élégamment servie, le mobilier brillant, l'argenterie précieuse. »
Mais ne croyons pas que la chasse, la bonne chère et l'agriculture absorbassent tous leurs soins. Ils eurent aussi des préoccupations d'un ordre tout différent : le sénateur gallo-romain avait le goût des choses de l'esprit autant que le souci des intérêts matériels. Il se livrait avec ardeur aux plaisirs littéraires ; son éducation avait été fort soignée: il avait travaillé dans les écoles, il avait lu Homère et Virgile et il les relisait. Ce n'étaient pas les chasseurs les plus intrépides qui faisaient les plus mauvais vers. Quand ces nobles s'écrivaient, ils aimaient à soigner leurs lettres; beaucoup avaient l'arrière-espoir qu'elles pourraient bien être publiées un jour comme celles de Pline et de Cicéron. Ils avaient l'ambition dépasser pour des stylistes. Ils gardaient le culte des muses comme les chevaliers chrétiens le culte de l'honneur. Faire des vers était un devoir de leur rang. Voilà ce qui manquera longtemps à la noblesse du moyen âge.
9. L'autorité du propriétaire sur ses serviteurs. — Le sénateur exerce sur la plupart de ses hommes une autorité à peu près souveraine. Il a une prison pour ses esclaves, ergastulum, et il n'est pas absolument certain qu'il n'ait pas conservé le droit de les condamner à mort. Il peut enchaîner et réprimander même les colons : si l'esclave ou le colon s'enfuit, il est ramené au maître, qui doit le punir.
Il y a plus, l'autorité publique laissa de plus en plus le sénateur exercer sur ses domaines tous les droits de l'Etat. Au besoin, il arme ses hommes pour faire la police chez lui ; il poursuit les brigands, il punit les voleurs ou entre en composition avec eux. Le sénateur est juge dans sa villa presque autant que le gouverneur dans la province.
Aussi, peu à peu, tous les hommes libres qui habitaient dans son voisinage se placèrent sous son appui. Il eut des " clients" qui lui jurèrent fidélité et auxquels il promettait sa protection. Il était le patron de la plèbe des campagnes et de nombreux plébéiens des villes ; il acceptait même le patronage de villages entiers, dont les habitants venaient se mettre d'eux-mêmes sous son autorité. La puissance du grand propriétaire rayonnait ainsi, au loin, autour de lui et de ses domaines.
10. Puissance politique des grands propriétaires. — Maître chez lui, le sénateur est également maître dans sa cité et dans l'Etat romain. Il siège dans le sénat municipal et c'est son influence qui dirige les affaires de la cité plus encore que l'autorité du défenseur. Au Vème siècle, il prendra pied dans l'église et deviendra souvent l'évèque de sa ville natale.
Mais il s'intéresse encore plus aux affaires de l'empire : les plus hautes charges sont réservées presque de droit aux grands propriétaires fonciers de l'ordre sénatorial. C'est parmi eux que se recrutent les gouverneurs de provinces et les préfets des prétoires. Ils font partie du conseil du prince et de son tribunal. Les plus heureux deviennent consuls. Le poète Ausone a été d'abord magistrat dans sa ville natale, puis il s'est élevé peu à peu dans les honneurs sénatoriaux : il est devenu questeur, préfet du prétoire, consul enfin, et, après son consulat, revenu en Aquitaine, il a passé sur ses terres les dernières années de sa vie.
Puissants par leurs domaines, par leur nombre et la dépendance de leurs serviteurs, ces grands seigneurs l'étaient plus encore par les pouvoirs que l'État leur conférait. « Quoique le gouvernement, dit Fustel de Coulanges, fût en principe une monarchie absolue et personnelle, il est visible que cette monarchie n'administrait que par l'intermédiaire de l'aristocratie, qui se trouvait ainsi de toutes les manières la classe dirigeante de la société. » Plus lard, quand l'empire tombera, il n'entraînera pas dans sa chute l'aristocratie foncière : tout au contraire, celte chute lui profitera. Elle restera dehout et saura accroître son autorité sous le gouvernement des rois barbares. Plus tard encore, sous le régime féodal, elle réunira à la possession de la terre le commandement des hommes et la souveraineté politique. Mais dès le IVème siècle, elle est ce qu'il y a de plus fort dans l'État et de plus haut dans la société.
CHAPITRE XII
LA TRANSFORMATION MATÉRIELLE DE LA GAULE
1. Le travail. — Toutes ces classes se ressemblèrent par un point durant les cinq siècles de la domination romaine : leur amour du travail. Ce besoin d'action, cette insatiable curiosité qui, au temps de l'indépendance, poussèrent les Gaulois dans de folles entreprises ou d'éternelles querelles, ils les dépensèrent alors à transformer le sol de leur pays. « Auparavant, écrit Strabon au Ier siècle de l'ère chrétienne, les Gaulois songeaient à se battre plus qu'à travailler. Maintenant que les Romains les ont contraints à déposer les armes, ils se sont mis avec la même ardeur à cultiver les champs; ils se sont adonnés avec le même goût à des mœurs plus civiles. » Plébéiens, affranchis, décurions, grands seigneurs, chacun selon ses forces accomplit une lâche et s'applique à faire valoir les dons merveilleux que la nature avait faits à la Gaule. De ce pays hérissé de bois et couvert de marécages, on créa, en moins d'un siècle, la province par excellence de la richesse et du bien-être.
2. Les principales routes de terre. — L'État romain donna l'impulsion à ce grand travail de transformation, en faisant construire, presque toujours à ses frais, un vaste réseau de routes, Commencé en Narbonnaise, dans les derniers temps de la république, il s'étendit sur les Trois Gaules dès les premières années de l'empire. Tous les chefs-lieux des cités furent réunis par des voies directes, dont le tracé fut toujours fort habilement choisi par les ingénieurs romains.
Ce réseau eut quatre têtes de lignes principales :
1° Dans la vallée du Rhône, le centre des routes était la ville d'Arles. C'est là qu'aboutissaient les deux grandes voies qui venaient d'Italie : la « voie Aurélienne », via Aurélia, qui côtoyait le rivage au pied des Alpes et passait à Fréjus et à Aix; — la « voie Domitienne », via Domitia, qui franchissait les Alpes Cottiennes au col du Mont-Genèvre et traversait la Durance près de Cavaillon. — Au delà d'Arles, la voie Domitienne se prolongeait vers l'Espagne par Nîmes, Béziers, Narbonne et le col de Perthus. — D'Arles, enfin, une quatrième route remontait la rive gauche du Rhône jusqu'à Lyon, où elle se soudait au réseau des routes centrales.
2° A quelques lieues de Lyon débouchait la troisième des voies alpestres, celle qui franchissait les Alpes Grées au col du Petit-Saint-Bernard. —De Lyon parlaient toutes les routes du Nord et du Centre : celle de Bordeaux, qui gravissait les massifs des puys, passait à Clermont, Limoges, Périgueux; — celle de la Loire, par Bourges et Tours ; — celle de la Seine, par Autun, Auxerre et Paris; — celle de la Manche et de Bretagne, qui se détachait de la précédente à Auxerre et gagnait le port de Boulogne par Reims et Amiens; — et enfin les trois routes qui conduisaient aux armées de Germanie, l'une, par Langres, Toul, Metz et Trêves, à Cologne et dans la Germanie inférieure; — l'autre, par Besançon, rejoignait à Bâle le coude du Rhin et la Germanie supérieure; — une troisième, par Genève et Avenches, desservait le pays des Helvètes et la frontière de Rhétie.
3° Trêves était, comme nous l'avons vu, le centre des routes de l'Est; elle communiquait directement avec Reims, Lyon, Strasbourg, Mayence et Cologne. —Mais, à côté de Trêves, il faut faire une place importante à Metz dans le réseau des voies militaires : Metz était dès lors un point stratégique de premier ordre, comme lieu de jonction de deux grandes routes fort suivies par les convois de troupes, la route de Lyon à Trêves, qui longeait les Vosges, et la route de Reims à Strasbourg, qui les traversait au col de Saverne.
4" Enfin Bordeaux était la tête de ligne de toutes les grandes voies du Sud et de l'Ouest. Une route menait directement de Bordeaux à la Loire et en Belgique par Saintes, Poitiers, Tours, Chartres et Paris, — une autre roule conduisait à Lyon,— une troisième se dirigeait, par Dax, vers l'Espagne et franchissait les Pyrénées à Roncevaux,— une quatrième, enfin, remontait la Garonne, passait à Toulouse, traversait les Cévennes au col de Naurouze et rejoignait à Narbonne le réseau de la Gaule Narbonnaise.
Il est difficile de rien imaginer de plus simple et de mieux compris que ce réseau de routes, et l'on est tenté de croire que les ingénieurs romains l'ont dressé et entrepris à la même date et sur un plan tracé tout d'une pièce.
3. Importance et aspect de ces routes. — Ces routes furent toujours admirablement entretenues, et jusque dans les derniers temps de l'empire. On réparait encore, à la date de 438, en pleine invasion, la voie Aurélienne.
Les distances étaient indiquées sur ces routes à l'aide de bornes en pierre, très hautes et solidement enfoncées dans le sol. Elles étaient marquées soit en milles romains, -millia de 1478m.50, soit en « lieues » gauloises, leugae, de 2222 mètres. Les lieues n'apparaissent d'ailleurs sur les bornes qu'à partir du règne de Septime Sévère, et ne sont usitées qu'en dehors de la Gaule Narbonnaise.
Les voies romaines étaient fort souvent pavées de larges dalles soigneusement aplanies : on peut encore voir de ces dalles à leur place, surtout sur le parcours de la voie Aurélienne en Provence. En outre, ces routes étaient aussi droites que le permettait la nature du sol, franchissant les collines par des pentes raides, traversant les marécages sur des talus ou sur des pilotis, allant droit au but comme ce peuple romain dont elles portent le nom et dont elles conservent le souvenir. Lorsque Henri IV, Colbert et les intendants dotèrent la France de ces belles et larges routes royales que peuvent lui envier tous les pays du monde, c'est presque toujours le tracé des voies romaines que suivirent les ingénieurs de la royauté.
On devine le changement qu'allait produire en Gaule la création de ces voies droites, solides, sans ornières, incessamment parcourues par la poste impériale, protégées par des détachements militaires, et qui enserraient le pays d'un réseau si intelligemment combiné. Elles amenèrent une transformation matérielle aussi rapide et aussi complète que celle que les chemins de fer opèrent de nos jours dans nos campagnes les plus reculées. Elles furent pour la Gaule un inestimable bienfait, et pour Rome la plus sûre garantie de sa domination et de son influence.
4. Les voies fluviales. — II est curieux de remarquer que l'État romain, qui fit tant de choses pour les routes, songea moins à améliorer le système des voies fluviales.
Strabon admirait beaucoup la disposition de nos fleuves. « Leurs cours, disait-il, sont si ingénieusement disposés en regard l'un de l'autre, qu'il est aisé de transporter les marchandises de l'une à l'autre mer, en remontant ou en descendant les fleuves, sans avoir à recourir longtemps à la voie de terre. » C'est presque exclusivement par ces fleuves que se faisait le commerce avant l'arrivée des Romains, et il n'est pas douteux qu'ils demeurèrent sous l'empire une voie importante de transit : le nombre et la puissance des corporations de nautae le prouvent surabondamment. Comme de nos jours, ces routes fluviales étaient moins coûteuses, quoique moins rapides, que les chaussées de terre.
Mais il ne semble pas que les Romains aient eu, comme nos rois de France, l'idée d'un vaste système de canaux destinés à compléter le système des voies fluviales. On ne peut guère citer que le canal construit par Marius à l'embouchure du Rhône, et le canal creusé sous les gouvernements de Drusus et de Corbulon aux bouches du Rhin et de la Meuse; mais c'étaient là des canaux d'embouchure et non des canaux de jonction. Une tentative plus sérieuse fut faite sous le règne de Néron : un légat de Germanie, L. Antistius Vetus, conçut le projet de réunir par un canal la Saône et la Moselle, la Méditerranée et la mer du Nord, l'empire romain n'eût peut-être rien fait en Gaule de plus hardi et de plus grandiose que ce travail, que d'assez misérables rivalités de personnes firent échouer.
5. L'agriculture. — Le premier bienfait de la conquête romaine, remarque Strabon, fut d'apprendre aux Gaulois à cultiver leurs champs. Déjà sous le règne de Tibère, tout ce qui n'était pas forêts ou marécages était couvert de riches cultures. On commençait même à éclaircir les forêts et à dessécher les marais qui occupaient une si grande partie de la Gaule, la construction des grandes routes contribua singulièrement à cette œuvre de défrichement, qui allait se poursuivre sans relâche pendant trois siècles et que les moines reprendront au moyen âge. La voie Domitienne, entre Arles et Nîmes, avait été tracée en plein marécage. La vaste forêt des Ardennes était enserrée et rétrécie par quatre chaussées. De grandes villes, comme Bordeaux, furent à moitié conquises sur les marécages par les Gallo-Romains. Le déboisement des régions voisines des fleuves explique la formation dans les villes de commerce, à Arles et à Nantes par exemple, d'importants chantiers de construction pour navires.
Le sol cultivé produisait en abondance du blé, du millet, de l'orge et du lin. De nombreux pâturages servaient à l'élève des bestiaux ; la race des chevaux de la Gaule Belgique était célèbre par tout l'empire. Les jambons préparés chez les Séquanes étaient fort recherchés des gourmets de Rome. L'olivier et le figuier étaient cultivés dans le Midi.
La culture de la vigne commençait à être une des richesses de la Gaule. On connaissait, en Italie surtout, les vins du Midi, et notamment le vin blanc des coteaux de Béziers. Toutefois les Gaulois de ce pays avaient la déplorable habitude de gâter leur vin par toutes sortes de préparations : ils y faisaient infuser de la poix pour en corriger l'acidité; ils le concentraient en le fumant; ou encore, pour lui donner de la couleur et du piquant, ils y mêlaient de l'aloès et des herbes amères. Les Italiens raillaient beaucoup les boissons, souvent peu authentiques, qu'on leur servait sous le nom de « vins de Béziers ». A l'Ouest, les vins de Bordeaux ou plutôt « des Bituriges », connus d'assez bonne, heure, ne furent célèbres que dans les dernières années de l'empire. Au Nord, on parlait beaucoup déjà des vins de la Moselle, et l'on cultivait la vigne même aux environs de Paris.
Mais la bière ou cervoise, cervisia, était la boisson presque exclusive des Gaulois de la Celtique et de la Belgique, II y avait naturellement une fort grande variété de bières. Il paraît qu'on devait en faire un constant usage à Paris, car on y a trouvé une bouteille ou plutôt une gourde qui porte l'inscription suivante : Hospita, reple lagonam cervesia : « Cabaretière, remplis la bouteille de bière ».
 Gourde à bière (1).
Gourde à bière (1).
1, L'inscription porte en mauvais latin : OSPITA, REPLE LAGONA CERVESia. — L'objet est au musée Carnavalet.
L'empereur Julien qui habita longtemps Paris, a dû maugréer souvent contre la boisson des hommes du Nord, car il nous a laissé sur elle une assez piquante épigramme : " D'où viens-tu, et qui donc es-tu, nouveau Bacchus? Je ne le reconnais point : j'en jure, par le véritable Bacchus! Je ne connais sous ce nom que le fils de Jupiter: il a l'odeur du nectar et tu n'exhales que celle du bouc. Certes, les Gaulois, à défaut de raisins, t'ont formé d'épis. Il faudrait donc t'appeler fruit de Cérés et non Dionysos, nourrissant, et non pas pétillant"
6. Mines et carrières. — L'exploitation des mines et des carrières fut poussée aussi activement que la culture du sol.
La quantité de grands édifices construits en Gaule pendant les trois premiers siècles de l'ère chrétienne est incroyable : tous furent bâtis avec les matériaux que fournissait le pays. A peu près toutes les carrières de pierres, de moellons et de sables connues aujourd'hui furent utilisées par nos ancêtres, et l'on peut voir encore dans certaines roches du Midi les brèches gigantesques qu'y ont faites les entrepreneurs gallo-romains.
 Foculus ou brasero du musée des antiques de Lyon.
Foculus ou brasero du musée des antiques de Lyon.
Sans doute on importait beaucoup de marbres. d'Italie, d'Afrique, même de Grèce; mais les carrières des Pyrénées et de l'Ariège étaient exploitées dès le temps d'Auguste, La Gaule était autrefois bien plus riche en métaux que de nos jours, quoique peut-être les Italiens exagérassent sa richesse. On trouvait de l'argent dans les Cévennes, et de l'or dans les Pyrénées de l'ouest. Il y avait d'importantes mines de fer chez les Bituriges et dans le pays des Petrucorii, et il parait qu'on peut voir encore dans les forêts du Périgord les scories laissées par les forges gallo-romaines. — Il faut ajouter les eaux minérales et thermales, exploitées de très bonne heure à Vichy, à Néris, à Luchon, à Dax, et partout où nous trouvons aujourd'hui des stations de baigneurs. Les Gaulois ont connu tous les pèlerinages de santé qui ont la vogue de maintenant.
7. Industrie. — Les deux principales industries de la Gaule romaine semblent avoir été l'industrie textile et la
métallurgie.
 Vase de verre trouvé à Nîmes
Vase de verre trouvé à Nîmes
La Gaule était renommée pour ses étoffes de toutes sortes. Chez les Cadurques, on préparait des étoffes de lin, ceintures, rideaux, draps de lit, qui s'exportaient jusqu'à Rome. Pline nous donne à ce propos un détail curieux : « Le lin des Cadurques est le plus réputé pour les matelas; aussi dit-on que les Gaulois ont fait connaître les matelas et les lits bourrés aux Italiens, qui jusque-là couchaient sur la paille ». On fabriquait également à Cahors des toiles à voiles; on en fabriquait aussi dans les pays du Nord. A Tournay, à Arras, à Langres, à Saintes, il y avait d'importantes manufactures de draps de laine, et notamment de ces chauds vêtements qu'on appelait des sayons, sagum gallicum, et qui étaient demandés par le monde enlier. Enfin Lyon était déjà le centre de fabrication en Gaule des étoffes de luxe ; on y filait l'or comme aujourd'hui on y tisse la soie.
La métallurgie était dès lors très perfectionnée dans notre pays.
 Tête de bronze (1).
Tête de bronze (1).
La Gaule était renommée pour la trempe du cuivre. Les Bituriges avaient, croyait-on, inventé l'étamage, et les Éduens, le placage. Les Bituriges, rapporte Pline, appliquaient à chaud l'étain sur le cuivre avec une telle habileté qu'on avait peine à distinguer de l'argent les objets ainsi préparés.
La céramique gauloise n'offrait rien de remarquable que son étonnante fécondité; les tuileries, les briqueteries, les poteries abondaient dans tout le pays. Mais il n'est pas douteux que l'orfèvrerie et la verrerie n'aient été, comme de nos jours, une des industries où excellaient les Gaulois : on peut le deviner à la finesse des moindres objets qu'on a conservés de ce temps.
1. Trouvée près de Vienne et aujourd'hui au musée de Lyon. La tête est en bronze plaqué d'argent; les yeux étaient en or ou en pierre fine. — Sur le diadème on lit le nom du donateur: Lucius LITugius, SEXti filius, LAENA, et plus loin quaestor coloniae.
C'est une question de savoir si les Gaulois n'étaient pas déjà passés maîtres dans la fabrication de ces jolis bibelots qu'on appelle maintenant les « articles de Paris »: il n'est pas difficile de voir, surtout dans les œuvres de Pline, que
les Romains les regardaient, an même titre que les Grecs, comme « les plus industrieux des hommes ».
 Coupe de verre trouvée à Treves.
Coupe de verre trouvée à Treves.
8. Le commerce. — Aussi la Gaule devint-elle de très bonne heure, grâce à ses routes de terre, à sa situation sur deux mers, à la richesse de son sol et à l'activité de ses industriels, le centre d'un important mouvement de transactions. Si l'on créa à ses frontières un cordon de douanes, on supprima les entraves que le morcellement en peuplades apportait au commerce intérieur. Les Romains avaient été les premiers à profiter de la facilité et de la liberté des échanges. A la fin de la république, la Gaule Narbonnaise était pleine de trafiquants latins, negotiatores : aucun Gaulois ne concluait un marché sans recourir aux offices d'un banquier ou d'un courtier romain. Dès que César entre en Gaule, les hommes d'affaires italiens arrivent à la suite de ses légions; et beaucoup d'entre eux s'établissent à Genabum, Orléans, au cœur du pays. Dès lors la Gaule entière fut envahie par tout ce que l'Italie possédait de manieurs d'argent et de marchandises : les négociants italiens avaient des comptoirs dans les grandes villes et, s'ils étaient assez nombreux, ils s'y groupaient en collèges, collegia civium Romanorum.
Mais les Gaulois surent rivaliser avec eux; ils ne se bornèrent pas à produire : ils étaient fort experts dans la vente et le trafic. C'étaient des Gaulois qui faisaient le transit et la commission entre la Bretagne et la Gaule; c'étaient eux encore qui approvisionnaient les armées de Germanie. Ce sont les Gaulois enfin qui ont créé à Bordeaux le plus vaste emporium du Sud-Ouest.
Enfin, la Gaule donna l'hospitalité à des négociants de toutes les provinces de l'empire. Il en vint surtout des régions orientales : la Gaule fut toujours chère au monde grec. Il y eut, dans toutes les grandes villes, des colonies d'étrangers : à Bordeaux et à Lyon, des Espagnols, à Bordeaux, à Lyon, à Arles, des Grecs, des Asiatiques et des Syriens. Ces Orientaux s'établissaient à demeure, débitant dans de vrais bazars les marchandises variées et les séduisants produits des pays lointains. Les Espagnols apportaient leur huile, leurs conserves alimentaires et leurs armes d'un acier si finement trempé. A l'Orient on demandait surtout des tentures et des étoffes de pourpre et d'or.
Remarquons la place que les Syriens occupaient en ce temps dans les grandes villes de commerce : intelligents, remuants, ayant le flair du négoce, ils y jouaient le même rôle que les juifs au moyen âge.
9. La richesse des Gaules. — II est difficile de se figurer à quel degré de richesse les Gaules arrivèrent ainsi sous les beaux temps de la paix romaine. Aucun excès de travail n'y avait encore fatigué les hommes ou épuisé le sol. Le pays était nouveau et fécond ; la race, jeune et laborieuse. Il suffit de l'impulsion donnée par Rome pour que la Gaule devint un intense foyer de richesse et de culture.
Ce qui y attirait les étrangers, ce qui poussait les barbares à l'envahir, c'était, suivant le mot de Cérialis, "l'amour de l'or, la soif des voluptés, le désir de posséder ses ferliles campagnes". A la fin du Ier siècle, un historien oriental, Josèphe, disait de la Gaule : « Les sources de la richesse y sourdent dans les profondeurs mêmes du sol, et de là se répandent comme un torrent par toute la terre », et il souhaitait à ses compatriotes d'être « aussi braves que les Germains, aussi habiles que les Grecs, aussi riches que les Gaulois ». Ce fut un Gaulois, Valérius Asiaticus, qui acheta à Rome les fameux jardins de Lucullus, et qui, véritable héritier du fastueux Romain, devint sous le règne de Claude l'arbitre du luxe dans la capitale. Trois siècles plus lard,Ammien Marcellin prétendait qu'il était difficile de trouver en Aquitaine un pauvre on un misérable, et un de ses contemporains remarquait qu'« il y a en Gaule de tout en abondance et que cependant tout y est hors de prix ».
CHAPITRE XIII
L'ART
1. Faiblesse générale de l'art gallo-romain. — La production artistique ne fut pas moins générale en Gaule que la culture des champs ou le travail industriel. Toutes les villes se couvrirent de temples, s'ornèrent de statues et, à l'image de Rome, brillèrent de la splendeur du marbre et de l'or. Si elles reçurent des colonies de négociants, si elles demandèrent à l'étranger ses produits, elles surent aussi acheter les œuvres des artistes d'Italie et de Grèce, au besoin les inviter eux-mêmes à travailler en Gaule, II y eut dans notre pays, pendant trois siècles, une importation ininterrompue de chefs-d'œuvre ou de copies de l'art grec. En même temps, plus d'un architecte ou d'un sculpteur oriental s'établit volontiers en Gaule, ces villes, éprises de faste et d'élégance, voulurent ajouter à leur luxe l'éclat artistique et payaient généreusement ceux qui les embellissaient. C'est ainsi que les Arvernes commandèrent au Grec Zénodore une statue colossale de leur dieu Mercure, statue qui leur coûta 40 millions de sesterces, et qui lui demanda dix ans de travail.
La Gaule eut aussi ses sculpteurs et ses peintres indigènes. Ils se formèrent à l'école hellénique, dont ils se montrèrent les fidèles disciples et les imitateurs consciencieux. Mais l'originalité leur manqua. C'est là en effet la grande faiblesse de la civilisation gallo-romaine : la Gaule, ni en art ni en littérature, n'eut le mérite de fonder une école, d'établir des traditions. Il n'y a pas eu, à vrai dire, d'art gallo-romain.
Elle ne trouva rien de nouveau. Elle ne sut que copier les modèles gréco-romains. Ses premiers essais, les monnaies gauloises du IIème siècle avant notre ère, ne sont que de maladroites copies des statères macédoniens on des drachmes de Marseille. Les plus belles statues, l'Athlète de Vaison, la Vénus de Vienne, le Faune et la Vénus d'Arles, en supposant (chose fort incertaine) qu'elles soient l'œuvre de sculpteurs indigènes, ne sont que d'excellentes reproductions de types connus.
 Le faune d'Arles.
Le faune d'Arles.
La Gaule n'imagina rien de durable ou de spontané, de vraiment vivant. Autant la production artistique fut intense, autant l'invention fut nulle. Si l'on peut parler de l'art gallo-romain, c'est pour montrer qu'il est le dernier épisode de l'histoire de l'art hellénique.
On doit rappeler à ce propos les excellentes remarques de M. Lacour-Gayet : « Quand les Romains eurent imposé au monde antique une loi unique, ils lui imposèrent aussi une architecture unique, l'architecture grecque romanisée. Les temples d'Héliopolis, de Palrnyre, de Lambessa, de toutes les cités espagnoles ou gauloises sont l'application des mêmes principes d'architecture que les temples de Rome, copiés eux-mêmes sur les temples d'Athènes. Rome a fait l'unité dans les questions d'art comme elle l'a faite en toute chose : tous les styles provinciaux ont cédé la place à un style uniforme et universel. »
Aussi le développement artistique de la Gaule n'a-t-il pas suivi une marche régulière : il ne s'est pas produit graduellement, allant peu à peu de l'ébauche à l'œuvre parfaite. Nous trouvons à la même date, dans les mêmes pays, des statues qui, par leur grossièreté, rappellent les essais naïfs de la Grèce primitive, et des statuettes d'un travail exquis, comparables aux meilleures œuvres de l'art classique. Ici, sur une stèle funéraire trouvée dans un cimetière de village, des dessins qui paraissent dus à quelque sauvage : la tête d'un homme représentée par un cercle, un sein de femme par une circonférence avec un point central, les mains par un zigzag à dix branches. Tout près de là, dans les ruines d'une villa, un Apollon et une Vénus qui ne laissent qu'à admirer.
2. La sculpture religieuse-. — C'est la sculpture religieuse qui a été, en Gaule comme en Grèce, le plus lot travaillée et qui a produit le plus d'oeuvres, et de belles œuvres. Mais ces œuvres ne sont que des copies : si elles n'ont pas été exécutées eu Grèce, la Grèce en a du moins fourni l'original. C'est surtout dans celte partie de l'art que les Gaulois ont marqué leur impuissance à créer. Les plus célèbres morceaux trouvés dans notre pays, les Vénus, les Jupiters, les Dianes et les Faunes, ne diffèrent en rien, ni par le type ni par l'attitude, des modèles consacrés par l'art hellénique. L'expression elle-même n'offre rien de gaulois. Les Vénus de cette Narbonnaise, où les artistes pouvaient cependant trouver de si belles figures de femmes, ont la froide beauté des sculptures classiques. La divinité principale des Gaulois était celle que les Romains avaient appelée Mercure : même en représentant le dieu qui leur était le plus cher, les Gaulois n'ont rien imaginé de nouveau : la figure du Mercure gaulois est devenue gréco-romaine comme son nom ; les innombrables statues que nous possédons du dieu n'offrent rien qu'une copie banale du vieil Hermès des Grecs, avec son caducée, son pétase et ses talonnières.
Toutefois, pour représenter certain divinités étranges de leur panthéon, qu'ils ne pouvaient reproduire d'après des modèles grecs ou romains, il a bien fallu aux Gaulois un certain effort d'imagination. Mais là encore ils n'ont pu faire preuve de génie créateur et n'ont abouti qu'à des types difformes, incohérents, ou tout au moins sans grâce et sans beauté. Rien n'est plus laid que les images de cette divinité infernale qu'ils figuraient avec des cornes. La Gaule possédait, dans ce que nous appelons le « dieu au marteau », une divinité originale et puissante : les statues qui nous en restent manquent également de force, de vie et de grandeur.
 Buste de déessse (Nîmes).
Buste de déessse (Nîmes).
Les types de nymphes ou de « Mères » gauloises ont quelque chose de guindé, de hiératique, mais on y chercherait également en vain la douceur des primitifs ou la naïve solennité des Byzantins : il n'y a rien là que des ébauches de vrais barbares. Que l'on étudie les figures de dieux gaulois représentés sur les autels trouvés à Paris : ce taureau sur lequel sont perchées trois grues, cet Ésus en forme de bûcheron, n'ont ni vigueur ni pittoresque, et n'offrent rien à remarquer ni comme invention ni comme exécution. Si l'on osait, on dirait que ce sont là uniquement les produits d'un fétichisme religieux : le sculpteur n'a eu qu'un seul désir, reproduire tous les symboles du dieu, tous ses attributs, n'en omettre aucun, même le moins artistique et le plus répugnant.
 Le dieu Esus. Le dieu Taureau aux trois grues. (bas-relief trouvé sur un autel à Paris-Musée de Cluny.)
Le dieu Esus. Le dieu Taureau aux trois grues. (bas-relief trouvé sur un autel à Paris-Musée de Cluny.)
Ces statues sont avant tout conformes au rituel de la religion gauloise : ce sont des types de commande, toujours les mêmes, à l'usage des dévots. Si on les compare aux Vénus et aux Jupiters de la vallée du Rhône, on pensera volontiers que ce qu'il y a de moins bon dans la sculpture gauloise est précisément ce qu'y a mis la Gaule.
3. — La sculpture funéraire est plus représentée encore dans les Gaules que la statuaire religieuse. Il n'y a pas de pays, dans tout l'empire romain, où les tombeaux aient été plus ornés de bas-reliefs, plus encombrés de figures que les provinces gauloises, surtout les Trois Gaules. Près des deux tiers peut-être des monuments funéraires nous offrent les portraits des défunts ou des scènes empruntées à leur existence. Les musées de Trêves, de Bordeaux, d'Arlon, de Sens, bien d'autres encore, ont à cet égard un singulier intérêt.
Sur beaucoup de ces monuments on voit le buste ou l'image en pied du défunt : ce sont bien des portraits, et nous n'avons pas affaire un seul instant à des figures idéalisées.
Le mort a une physionomie très nette, ses défauts physiques ne sont point cachés: quelques-uns ont une calvitie bien apparente. Il est toujours représenté avec les objets qui caractérisent sa profession ou ses habitudes, ou ceux qu'il a le plus aimés. Les enfants ont des jouets, ou tiennent un chat, un oiseau, quelque animal familier. Les femmes portent des miroirs, des vases à parfum, des corbeilles de fleurs ou de fruits. Un tailleur de pierre tient un ciseau, le cocher agile son fouet, le forgeron soulève son marteau.
 Entrepreneur. (1)
Entrepreneur. (1)
Sur un tombeau de Bordeaux, un sculpteur est représenté dans une niche,
1. Sculpture d'un tombeau. Épitaplio : Diis Manibus CAIIVS GETVLl filius. — Remarquez tous les instruments dont se servent les entrepreneurs de bâtisses, scie, règle ou ciseaux, truelle, ascla ou marteline.
sculptant un chapiteau de son propre monument. Ailleurs, le titulaire du tombeau est représenté en face de son médecin qu'il consulte et qui lui tâte le pouls. Cet autre a certainement été la victime d'un meurtre : on le voit, assis à une table de travail, et derrière lui un malfaiteur s'approche, le poignard levé. Il n'est pas de riche marchand qui ne fasse sculpter sur son tombeau les épisodes de sa vie ou les occupations de sa journée : l'arrivée de barques chargées de tonneaux, ses fermiers qui lui apportent leurs redevances, ses chariots qui transportent ses marchandises, et, au milieu de toutes ces scènes, son portrait, celui de sa femme et de ses enfants. Quelques-uns de ces tombeaux sont de véritables mausolées atteignant jusqu'à soixante pieds de haut et sont couverts d'innombrables figures depuis la base jusqu'au faîte : tel le monument encore debout d'Igel, près de Trêves.
Mais dans ces œuvres encore, il est difficile de voir les beaux spécimens d'un art vraiment original. L'artiste n'a obéi qu'à une seule préoccupation, où l'art n'avait rien à faire : ne négliger aucun détail précis pouvant faire connaître la vie, les habitudes ou l'opulence de son mort. Il en est de la sculpture funéraire comme de la statuaire religieuse : elle vise à une exactitude minutieuse, à éviter toute omission, à exprimer le plus de détails possible sur une
 Marchand de pomme (1).
Marchand de pomme (1).
(1). Sculpture d'un tombeau (musée de Narbonne). — A côté une inscription reproduit le cri du marchand : MALA, MYLIERES, MYLIERES MEAE : « Des pommes, mesdames, mesdames ».
place donnée. L'exécution est à peu près partout maladroite: peu ou point de perspective, aucune harmonie dans la disposition des figures, absence complète de composition esthétique, beaucoup de fautes de dessin et de proportion ; à peine, ça et là, quelques figures expressives, quelques vigoureuses attitudes, peuvent faire supposer que les sculpteurs gallo-romains avaient déjà un peu ces tendances réalistes qui sont la meilleure part de l'art français.
Le seul mausolée qui soit une véritable œuvre d'art est le mausolée des Jules, prés de Saint-Remy en Provence. Mais tout dans ce monument, le dessin de l'édifice, la disposition des bas-reliefs, le choix des sujets, le type des figures, tout dénote l'influence gréco-romaine. « Le tombeau des Jules, dit justement M. Mommsen, œuvre du temps d'Auguste, est un merveilleux témoignage de la manière vivante et intelligente avec laquelle le sud de la Gaule a recueilli l'art hellénique. Les deux étages quadrangulaires, que couronne une colonnade à coupole conique, forment un ensemble architectural d'une grande hardiesse; ses bas-reliefs, avec leurs scènes de chasses et de combats, rappellent d'assez près le style des sculptures de Pergame. » On pourrait faire de semblables rapprochements en étudiant les bas-reliefs des arcs de triomphe, en particulier de celui d'Orange.
 Le mausolée de Saint-Remy.
Le mausolée de Saint-Remy.
4. Architecture religieuse. — La Gaule nous a laissé des monuments architecturaux d'une idéale perfection : le temple dit la Maison Carrée, à Nîmes, le temple d'Auguste et de Livie, à Vienne, contemporains l'un de l'autre. Ce sont des temples d'ordre corinthien, admirables comme harmonie et comme finesse de détails. Rien n'offre un travail plus exquis que les feuilles d'acanthe de leurs chapiteaux, pleines de naturel et de vie, et les élégantes consoles qui surmontent les corniches. On l'a dit avec raison : ces deux temples sont de vrais bijoux. Mais ils n'ont rien qui ne soit grec, si ce n'est que leur grâce un peu efféminée est assez loin de la majesté des grands temples helléniques. Ils rappellent aussi peu le Parthénon que l'Enéïde rappelle la grandeur des poèmes homériques.
Beaucoup de temples semblables furent bâtis au Ier siècle de l'empire dans la Gaule, surtout dans la Gaule du Midi, et ont dû être aussi parfaits que ceux de Nîmes et de Vienne. A partir du IIème siècle, des construclions analogues s'élevèrent en grand nombre par toute la Gaule, mais elles furent bien inférieures en mérite aux monuments de la Gaule Narbonnaise.
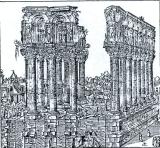 Le temple de Tutelle à Bordeaux, d'après une gravure du XVIème siècle.
Le temple de Tutelle à Bordeaux, d'après une gravure du XVIème siècle.
Les temples qu'on bâtit à Saintes, à Bordeaux, à Trèves et dans les autres cités des Trois Gaules sont des édifices de décadence, comme tous les monuments de l'époque des Antonins et des Sévères. On recherche surtout le luxe, on vise au grandiose, on y aime l'effort et la difficulte vaincue ; ce sont des monuments pleins d'exubérance et parfois aux proportions colossales, C'est toujours le chapiteau corinthien qui domine, mais l'influence du génie romain en a écarté la grâce hellénique; à la feuille d'acanthe svelle et pure succède l'acanthe flamboyante, aux lobes fouillés et subdivisés à l'infini, encombrée d'ornements étrangers. Ces temples sont trop larges de base, beaucoup trop hauts surtout; les proportions ne sont plus gardées ; la façade perd sa simplicité : on y accumule les figures, les ornements, les statues. Le temple de la déesse Tutelle, à Bordeaux, détruit sous Louis XIV, peut être regardé comme le type le plus net que ce style ait laissé en Gaule.
5. Architecture civile. — C'est une influence franchement romaine qui a dominé l'architecture civile en Gaule : les monuments qu'on y éleva, basiliques, thermes, portiques, théâtres, amphithéâtres, arcs de triomphe, ponts, aqueducs, villas, ne diffèrent en rien des monuments similaires que l'art romain multiplia en Italie, en Espagne et en Afrique : c'est le même type architectural, ce sont les mêmes procédés de construction.
Il y eut des thermes dans toutes les villes de la Gaule, on peut ajouter sans exception. Les moins mal conservés sont ceux de Fréjus, qui paraissent du Ier siècle, ceux de Trêves, qui portent les traces de différentes époques, et les fameux thermes de Cluny, à Paris, qui sont vraisemblablement du IIIème siècle. Des vestiges fort remarquables de thermes ou de bains se voient dans les ruines de quelques grandes villas.
Les plus célèbres des amphithéâtres sont les arènes de Nîmes et d'Arles, qui sont, celles-ci du Ier siècle, celles-là du commencement du IIème; elles sont assez intactes, aujourd'hui encore, pour servir à de pittoresques et vivantes représentations. Mais on en éleva peu à peu dans toutes les villes de la Gaule, depuis le règne d'Auguste, qui parait avoir fait construire l'amphithéâtre de Fréjus, jusqu'au milieu du IIIème siècle, d'où date celui de Bordeaux. Et, de fait, il n'est guère de cité, même médiocre, qui ne montre encore les ruines de ses arènes. Paris a les siennes comme Senlis et Saintes, comme Perigeux et bien d'autres. Les théâtres ne paraissent pas avoir été moins nombreux dans les cités gallo-romaines, et il n'est pas rare d'en rencontrer en pleine campagne, et presque en plein bois. On connait ceux d'Arles, de Fréjus, d'Autun et d'Orange, ce dernier est aujourd'hui si merveilleusement conservé qu'on peut y représenter des pièces antiques et y donner un instant la résurrection du passé, et que nos ingénieur peuvent y étudier le soin méticuleux avec lequel leurs prédécesseurs romains appliquaient les règles d'une acoustique savante. Presque toutes les villes de la Gaule eurent des arcs de triomphe. Celui d'Orange, qui date du règne de Tibère, est le plus pur comme style, et quelques uns de ses bas-reliefs sont parfaits comme finesse d'exécution. Les moindres villes du sud de la Gaule, comme Cavaillon, Carpentras, Saint-Remy, ont eu également leur arcade triomphale, Saintes a la sienne, qui est du temps de Tibère. Si l'on voulait étudier avec soin nos arcs de triomphe, peut-être pourrait-on y reconnaître deux groupes bien séparés, ceux du règne de Tibère ou de Claude et ceux des temps d'Hadrien à Marc-Aurèle.
 L'arc de Saint-Remy.
L'arc de Saint-Remy.
Il nous est resté, près de l'étang de Berre, dans un endroit presque désert, aux deux extrémités d'un petit pont jeté par les Romains sur la Touloubre, deux arches curieuses qui datent du règne d'Auguste. D'autres ponts dans le Midi, celui de Trêves, passent, également pour l'œuvre des Romains.
Des basiliques et des portiques, il ne nous est demeuré que des souvenirs et des inscriptions, et surtout quelques-uns des beaux chapiteaux ou des meilleurs bas-reliefs conservés dans nos musées. Les ruines des villas abondent dans presque toutes nos campagnes.
Mais ce sont les restes des aqueducs qui sont peut-être les plus intéressants débris de l'art romain en Gaule. C'est là le propre de la civilisation romaine d'avoir voulu, à tout prix, doter toutes les villes d'une eau abondante, je ne pense pas qu'aucune cité de la Gaule, grande ou petite, ait été privée de son aqueduc. L'étude la plus intéressante à faire en Gaule pour observer l'incomparable habileté des architectes romains est de suivre depuis la prise d'eau jusqu'au bassin d'amenée la ligne d'un aqueduc; c'est ce qu'on peut faire, presque pas à pas, pour les aqueducs de Fréjus,de Lyon et de Nîmes. Ce dernier traverse le Gard sur un pont à trois étages, étonnante construction qui est peut-être la plus belle chose que les Romains aient laissée d'eux dans le monde entier.
Rien ne montre peut-être mieux que l'histoire de l'architecture civile combien fut profonde la transformation de la Gaule à la Romaine : elle ne nous apprend pas seulement comment le sol se décora d'édifices : elle nous révèle aussi comment les mœurs se changèrent et que de nouvelles habitudes furent aisément prises. Les bains étaient, sans contredit, les monuments les plus utiles à la vie quotidienne d'un Romain : il s'en éleva, dès le temps d'Auguste et de Tibère dans toutes les villes et les villas de la Gaule et c'est par les thermes que l'architecture civile débuta chez eux. Les jeux préférés des Romains étaient ceux de l'amphitéâtre : les plus belles ruines de la Gaule sont celles des arènes. L'aqueduc était pour une cité romaine presque une chose sainte : chacune de nos villes eut le sien.
 Type de construction du IIIème siècle : l'amphithéâtre de Bordeaux.
Type de construction du IIIème siècle : l'amphithéâtre de Bordeaux.
6. Du mode de construction. — Il est à remarquer que l'on peut aisément distinguer deux catégories dans ces monuments, si l'on examine leur mode de construction. Ceux du Ier siècle et du IIème sont, dans leur œuvre extérieure, construits entièrement en pierres : ces pierres sont disposées tantôt en petit appareil, comme dans les thermes, tantôt en grand appareil, comme dans la plupart des amphithéâtres. On peut constater peut-être que le petit appareil domine dans les constructions de la première époque, depuis Auguste jusqu'à Claude : cela est visible notamment à Fréjus, à Saintes, à Trêves et dans toutes les villes qui ont eu à cette époque leur plus grand développement. Le grand appareil domine au contraire dans le siècle des Antonins. Dans ces deux systèmes de construction, les pierres sont également disposées de la façon la plus symétrique, superposées de manière à former un dessin d'une parfaite régularité : la brique est employée surtout dans les détails de la construction intérieure.— Au IIIème siècle, au contraire, elle est utilisée même pour le revêtement extérieur de l'édifice : dans les monuments de ce temps, les lignes de briques, posées à plat, viennent presque toujours alterner avec les pierres de petit appareil : le tout ajusté et cimenté par un mortier compact et dur comme la pierre. Le grand appareil n'apparaît alors que dans le soubassement des édifices les plus considérables : il est maintenant disposé en assises inégales et disgracieuses.
7. L'architecture militaire : les murailles des cités gauloises. — De toutes les constructions élevées par la Gaule romaine, les plus importantes pour l'histoire politique de notre pays sont les murailles de nos cités. Les murs des anciens oppida gaulois ressemblaient à tous les remparts des époques primitives : c'étaient d'énormes blocs inégaux et irréguliers, juxtaposés et superposés presque toujours sans mortier. Mais déjà à l'époque de César, on savait construire les remparts d'une façon moins rude et moins « pélasgique » : on connaissait le moyen appareil régulier, aux assises presque symétriques de pierres légèrement équarries, et l'on utilisait déjà, pour renforcer la bâtisse, la terre et le bois. Ces remparts furent détruits ou abandonnés dans les premiers temps de l'empire, et surtout sous le règne de Tibère et sous celui de Galba. Un très petit nombre de villes eurent le privilège de conserver leurs anciennes murailles, qui d'ailleurs tombèrent très vite en ruine.
Dans les colonies seulement et dans les villes favorisées comme Autun, les empereurs firent construire de nouvelles murailles. Le contour en fut habilement tracé par les ingénieurs; ils surent profiter des déclivités du terrain pour appuyer le rempart et assurer à la ville une situation plus forte : c'est ce qu'on peut constater à Arles, à Fréjus et ailleurs. Ces murs étaient revêtus, à l'extérieur, d'assises de pierres en moyen et petit appareil : les blocs, soigneusement équarris, disposés en lignes régulières, formaient un ensemble presque décoratif. Le tout était assujetti au blocage du massif intérieur du mur, à l'aide d'un mortier spécial, fait de sable, de brique pilée et de chaux, d'une étonnante dureté et d'une adhérence telle qu'il fait aujourd'hui corps avec la pierre. Les portes qui s'ouvraient dans ces remparts étaient élégantes dans leurs dimensions, légères et sobrement ornées : voyez à Nîmes la porte d'Auguste.
A la fin du IIIème siècle, lorsqu'on entoura de remparts toutes les autres villes de la Gaule, les procédés de construction furent plus rapides. À la base, d'énormes blocs irréguliers, formant façade; à l'intérieur, comme blocage, des débris de toute sorte, et tous de forte dimension : chapiteaux, tambours et fûts de colonnes, autels, bas-reliefs, statues, tombeaux, tout cela emprunté aux édifices construits durant les deux premiers siècles et détruits par les barbares au temps de Gallien ou de Probus. C'est pour cela que, de nos jours, ces murailles de l'an 300 sont si précieuses pour nous : ce sont de véritables caractères d'inscriptions et d'antiquités ; c'est grâce à elle que nous retrouvons les vestiges du passé de nos villes. Comme revêtement extérieur, de la moitié de la hauteur jusqu'au sommet, ces remparts offrent une construction plus régulière : les assises de pierres en petit apareil s'alignent avec des couches de briques soigneusement disposées à plat. Le ciment employé est aussi solide que celui du Ier siècle. Mais les ingénieurs militaires des temps de Maximien ou de Constance n'ont plus la même habileté : le tracé de ces murailles est jeté un peu au hasard, sans trop de souci de la facture ou de l'aspect du sol ; pour plus de facilité les remparts sont presque toujours quadrangulaires, alignés au cordeau. Des tours, demi-rondes, les flanquent en très grand nombre : il y en a parfois tous les cents pieds. Tout cela est massif et lourd. Les portes seules sont plus soignées, encadrées d'un appareil assez régulier; mais, trop basses ou trop larges,sans proportion, trop compliquées,ou écrasées par une trop grande masse de mur, elles ont un aspect trapu,
lourd et disgracieux. Voyez la Porte Noire à Trêves, la porte de Langres, et bien d'autres.
 Coupe d'un mur romain du bas-empire (Bordeaux).
Coupe d'un mur romain du bas-empire (Bordeaux).
8. La céramique. — Les Gaulois s'adonnèrent de très bonne heure aux arts industriels et ils y ont excellé. Mais, même dans ce qu'ils ont produit de plus parfait, notamment en orfèvrerie, ils n'ont rien fait qu'imiter les types et les formes des ateliers grecs ou romains.
C'est en céramique qu'ils paraissent avoir le moins réussi : la quantité y a fait singulièrement tort à la qualité. Les ruines gallo-romaines abondent en vases de terre cuite, notamment en vases à vernis rouge qu'on appelle ordinairement, du nom des villes qui en ont créé la vogue, « vases samiens », ou «vases arrétins ». Beaucoup sont d'importation étrusque; beaucoup aussi sont visiblement de fabrication gauloise, mais ceux-là n'offrent rien qui les distingue des autres : ce sont de simples imitations.
Les figurines en terre cuite, grise ou rougeâtre, sont extrêmement communes en Gaule. Elles ont fort occupé les érudits. Presque tous ont voulu y voir des images de divinités gauloises. Mais il semble plus probable qu'elles ne sont que des copies de modèles grecs, et on ne les a crues originales que parce qu'elles étaient des copies trop informes.
 Vase de terre cuite trouvée à Paris.
Vase de terre cuite trouvée à Paris.
Les types les plus répandus sont certainement empruntés à ceux de la céramique grecque ou italo-grecque : la Vénus Anadyomène, Éros sur le dauphin, la Gérés au diadème, des bustes d'enfants, des matrones drapées, Eros et Psyché, Vénus à la colombe, des coqs, et surtout (c'est le type le plus répandu) la Déesse Mère avec ses nourrissons sur les genoux. Mais quelle différence d'avec les modèles grecs ! M. Poltier le dit fort bien : « Ce sont les mêmes motifs, mais appauvris de formes et raidis par une exécution barbare dont le caractère anguleux semblerait marquer un retour aux procédés archaïques, si la négligence du modelé et les traits émoussés des visages ne révélaient la fin d'un art vieilli ». On peut appliquer cette remarque à presque toutes les œuvres de la sculpture gallo-romaine. Et M. Pottier ajoute finement: « L'admirable Vénus du maître attique devient entre les mains de ces gâcheurs d'argile une idole figée dans son immobilité hiératique, au corps efflanqué, à la poitrine plate, aux gestes gauches. Les jolies promeneuses de Tanagre se reconnaîtraient difficilement dans la descendance que leur donnent les céramistes gallo-romains en façonnant d'informes poupées, plantées maladroitement comme des mannequins sur une base demi-sphérique. Aux charmants et espiègles bambins de l'art hellénistique se substituent d'horribles magots, qui tiennent plus de l'avorton et du nain difforme que de l'enfant.
 Vénus, figurine gallo-romaine.
Vénus, figurine gallo-romaine.
Le groupe poétique d'Éros et de Psyché, l'image de l'amour vainqueur et de l'âme s'éveillant au plus délicat des sentiments, est travesti en un groupe de bourgeois patauds qui s'embrassent placidement. »
9. La verrerie. — En revanche, les Gaulois sont, de très bonne heure, passés maîtres dans l'art de fabriquer et de travailler le verre. On a trouvé dans les régions de la Seine et de la Moselle des pièces qui sont les plus beaux spécimens peut-être que nous aient laissés les maîtres verriers d'autrefois. Ils n'ont ignoré aucun des procédés pour décorer le verre. Ils savaient le graver ou l'orner de reliefs : et ces reliefs ou cette gravure sont parfois d'une ténuité inimitable. Dans certaines pièces de dimensions importantes, ils appliquaient l'une sur l'autre deux couches de verre de teinte différente, et arrivaient à produire, avec ces verres doublés, les plus étranges effets de couleurs. Quelques vases trouvés en Gaule passent pour des chefs-d'œuvre de fine sculpture. Toutefois les motifs de décoration et le choix des figures paraissent encore empruntés aux traditions des écoles gréco-romaines : ici, ce sont des scènes mythologiques, là, des représentations de cirque; plus rarement, des scènes de genre, tantôt des animaux; tantôt de simples détails d'ornements. Mais tout cela est souvent d'une finesse incroyable. On ne sait qu'admirer davantage : l'exécution de l'artiste ou l'habileté du fabricant, la grâce un peu maniérée des dessins et def figures, ou l'éclat et la variété des scintillements rte couleurs. Les verriers gaulois avaient certainement atteint la perfection des grands maîtres en cet art, les verriers d'Alexandrie d'Kgypte.
10. Le travail des métaux. — Les artistes en métal rivalisèrent aussi heureusement avec ceux de la Grèce et de l'Italie. Si nos bronziers n'ont rien livré de comparable aux vases de Corinthe, les orfèvres qui travaillaient en Gaule étaient déjà fort habiles. On a trouvé près de Lyon l'écrin complet d'une dame romaine : sept colliers, deux anneaux, sept bracelets, six pendants d'oreilles, des broches, des fibules : chaque bijou a son caractère et l'or s'y allie habilement avec la perle et la pierre précieuse ; peut-être l'originalité a manqué à l'artiste, en tout cas l'exécution est parfaite, quoique visant plus au luxe qu'à la grâce. Le chef-d'œuvre de l'orfèvrerie romaine est la patère de Rennes, en or massif, renfermant, sur un espace d'à peine 25 centimètres de diamètre, près de cinquante figures, exécutées au repoussé, puis ciselées : elle date sans doute des environs de l'an 200, mais l'art en est encore d'une grande finesse, le style d'une réelle pureté, sans excès dans le relief, sans grossièreté, dans le trait et l'expression.
 Patère d'or, de Rennes
Patère d'or, de Rennes
Ce sont surtout les argentiers gaulois qui paraissent avoir été d'incomparables artistes. Déjà au temps de l'indépendance on citait leur habileté dans l'argenture des métaux, et l'on montrait à Rome un char argenté, dépouille du roi arverne Bituit. Depuis ils ne cessèrent de se perfectionner, affinant leur goût en même temps que leur ciseau.
 Vase d'argent du trésor de Bernay (1).
Vase d'argent du trésor de Bernay (1).
Il suffit, pour se rendre compte du talent qu'ils avaient acquis, d'étudier les trésors de Hildesheim et de Bernay. Ce dernier, conservé à la Bibliothèque nationale, renferme soixante-six pièces, la
(1) Légende en pointillé : DOMITIVS TITVS EX VOTO.
plupart ornées de figures en repoussé et ciselées, et j'hésite encore à croire que toutes les bonnes pièces soient d'importation étrangère. Ce sont, évidemment, des copies de modèles grecs, mais d'une extrême délicatesse dans l'exécution des figures et des ornements. C'est que les riches Gaulois avaient, plus qu'autre chose, le goût de l'argenterie. C'était à peine le signe de l'aisance que de manger dans de la vaisselle d'argent. On l'employait aux usages les plus humbles : on a trouvé récemment jusqu'à des passoires et des seaux qui sont de bonnes pièces d'argenterie.
11. Mosaïques. — Enfin un art que les Romains ont implanté en Gaule et qui y devint fort populaire est celui de la mosaïque, opus musivum. Les temples et les demeures des particuliers, des plus pauvres comme des plus riches, avaient des pavés en mosaïque. On peut dire que le sous-sol de nos villes est encore presque partout recouvert de mosaïques romaines, et l'on en trouve de fort élégantes dans des recoins perdus de nos campagnes. La mosaïque fit, en Italie, une véritable concurrence à la peinture; on la préférait, comme plus durable, et peut-être comme plus décorative : en cela, comme dans tout le reste, la Gaule accepta les caprices romains. Elle nous a déjà donné de précieux morceaux en ce genre ; il faut s'attendre chaque jour à des découvertes plus bellesencore.
Les plus simples des mosaïques ne présentent que des fantaisies de dessins géométriques, ou des rinceaux, des palmes, des feuillages; mais les couleurs sont combinées de manière à produire toujours un effet surprenant, un peu trop éclatant parfois et de tons un peu crus et heurtés. Les plus belles figurent des scènes mythologiques, ou, ce que les Gaulois affectionnaient, des scènes de chasses ou des combats de cirque ou d'amphithéâtre.
 Cirque, d'après une mosaïque de Lyon.
Cirque, d'après une mosaïque de Lyon.
Dans la célèbre mosaïque de Lillebonne, ce sont des chasses, celles de Nîmes et d'Aix représentent des légendes de la Fable ; à Reims, à Nennig près de Trèves, ce sont des gladiateurs, à Lyon, des jeux de cirque,à Grand dans les Vosges, une scène de théâtre. On peut voir à Trêves les fragments d'une vaste mosaïque qui renfermait les portraits des principaux écrivains latins. Le mosaïste se conformait évidemment au goût du propriétaire ou à la destination de la salle.
12. Le goût des Gaulois pour les choses de l'art. — On voit, d'après tout cela, quelle place les Gallo-Romains faisaient, même dans leur vie quotidienne, aux choses de l'art. Que l'on compare la maison moderne à la maison du IIIème siècle : que de détails négligés de nos jours ou donnant lieu à la plus banale décoration étaient alors le motif d'ornements artistiques! Nos tapisseries fragiles et médiocres ont remplacé les peintures à fresque des murailles; les tapis ou d'insignifiants carrelages ont succédé aux mosaïques chatoyantes; il y a bien peu de riches qui se glorifient de vaisselle en métal ciselé. Il y avait autrefois dans chaque maison une incroyable quantité de statues : le riche avait ses marbres et ses bronzes, le pauvre ses terres cuites. Si misérables que fussent quelques-unes de ces productions, elles répondaient toutes à ce besoin de choses artistiques que nos ancêtres eurent au plus haut point : l'art fut pour les Gaulois une des formes de ce bien-être que la domination romaine leur apprit à désirer.
CHAPITRE XIV
L'ÉPIGRAPHIE ROMAINE EN GAULE
1. Importance de l'épigraphie en Gaule. — Un des
phénomènes les plus intéressants qui marquèrent la transformation de la Gaule fut son goût pour les inscriptions. La production épigraphique, pour parler ainsi, y fut d'autant plus forte que le pays se romanisa plus vite. Rome inculqua ce goût aux Gaulois comme à toutes les nations occidentales de l'empire. Dès le temps de César, il y a des inscriptions dans la Gaule Narbonnaise : l'épigraphie apparaît sous Auguste dans les grandes villes des Trois Gaules. On trouve à Paris, sous Tibère, une inscription en langue latine. Fort active dans les trois premiers siècles, l'activité épigraphique se ralentit un peu chez nous à partir de Dioctétien; mais les Gallo-Romains ne cesseront jamais d'être de grands faiseurs d'inscriptions.
C'est qu'en effet, en ce temps-là, il en était de l'épigraphie comme de l'art : elle avait sa place dans les moindres incidents de la vie publique et privée. Les inscriptions tenaient lieu, dans l'antiquité, de bien des choses que nous avons remplacées par le livre, le journal ou l'affiche. L'imprimerie a porté à l'épigraphie un coup mortel. C'est en les gravant et en les exposant sur des plaques de bronze ou de marbre qu'on faisait connaître les lois et les décrets officiels, on les promulgue aujourd'hui par voie de journal ou d'affiche. On gravait aussi les enseignes des boutiques, les dédicaces des monuments, les marques de fabriques : ce qu'on indique aujourd'hui par un écriteau ou une étiquette imprimés donnait lieu jadis à une inscription. L'épigraphie, reléguée maintenant surtout dans les cimetières ou les vestibules des édifices publics, s'étalait autrefois partout, dans la maison et dans la rue, dans le temple et au forum. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner qu'on ait trouvé en Gaule plus de dix mille inscriptions, dont six mille en Narbonnaise. Nous ne parlons pas des marques de fabriques, dont le nombre est incalculable.
2. Les documents. — Des différentes classes d'inscriptions, la plus importante et la moins nombreuse est celle des documents officiels, des acta de l'Etat. Nous n'en trouvons en Gaule qu'un seul qui ait un intérêt capital. C'est un long fragment du discours que l'empereur Claude prononça au sénat en faveur des Gaulois, pour lesquels il sollicitait le droit de devenir sénateurs. Ce discours fut gravé sur une table de bronze, dont les morceaux ont été retrouvés à Lyon: elle devait sans doute être exposée dans un des édifices appartenant au Conseil des Gaules. L'inscription est la reproduction la plus exacte du discours impérial : ou peut même dire qu'elle en est la sténographie car dans le texte du discours gravé on a intercalé, comme on le fait aujourd'hui dans le compte rendu officiel des séances du Parlement, l'interruption faite par un sénateur. L'empereur Claude, qui était fort bavard, se laissait aller à une digression géographique un peu longue : un sénateur hardi le ramène en ces termes à la question :
 Fragment du discour de Claude (1)
Fragment du discour de Claude (1)
" Mais il est bientôt temps, Tibère César Germanicus, d'expliquer clairement au sénat à quoi tend ton discours car te voilà maintenant aux confins les plus éloignés de la Gaule Narbonnaise". Tout cela est gravé sur le bronze, et rien ne nous avertit qu'il y a là
la transcription d'une interruption : le graveur a transcrit, sans changer un mot, le compte rendu in extenso de la partie de la séance du sénat où fut prononcé le discours de Claude. — On sait que Tacite, dans ses Annales, nous donne, en racontant cette séance, un discours de Claude; mais il a étrangement écourté et travesti la harangue de l'empereur : nous pouvons prendre l'historien en flagrant délit de substitution, remplaçant le document officiel par une éloquente et infidèle analyse.
On a découvert à Narbonne, en 1888, un fragment de la lex ou du règlement de l'assemblée provinciale de la Gaule Narbonnaise : elle était également gravée sur une table de bronze. — On peut lire sur le marbre de Vieux des extraits de lettres de personnages officiels. —Enfin on possède de très curieux fragments du cadastre de la ville d'Orange, gravé sur des plaques de marbre.
(1) Le monument se compose de deux fragments d'une table de bronze. Découverts en 1528, ils sont aujourd'hui conservés au musée de Lyon. Les lettres étaient dorées. Nous donnons le fagment de droite.
Voici la traduction de ce fragment, le seul d'ailleurs qui intéresse directement la Gaule :
« Ce fut assurément une innovation du dieu Auguste, mon grand-oncle, et de Tibère César, mon oncle, d'avoir voulu que de partout la fleur des colonies et des municipes, c'est-à-dire tout ce qui s'y trouve d'hommes recommandables et riches, fût admise dans cette assemblée. — Quoi! un sénateur italien n'est-il donc pas bien préférable à un sénateur provincial? [Cela est sans doute l'interruption d'un sénateur, à laquelle Claude répond sur-le-champ :] — Quand tout à l'heure j'aurai à discuter cette proposition dont l'objet rentre dans les attributions de ma censure, je vous montrerai par des faits ce que je pense sur ce point. Mais je n'estime pas même qu'on doive repousser les hommes de la province qui pourraient faire honneur au sénat. Voici cette splcndide et puissante colonie des Viennois : qu'il y a longtemps déjà qu'elle envoie des sénateurs à cette assemblée! De cette colonie est Lucius Vestinus, rare ornement de l'ordre équestre, pour qui j'ai une affection toute particulière et qu'en ce moment je retiens auprès de moi pour mes affaires privées. Que ses fils soient pourvus, je vous prie, du premier degré des sacerdoces afin que, plus tard, leurs années le permettant, ils puissent poursuivre l'avancement de leur dignité. Je veux taire comme infâme le nom de ce voleur, que je déteste [il s'agit du Viennois Valérius Asiaticus], de ce prodige en palestrique, qui apporta le consulat dans sa maison avant même que sa colonie eût obtenu le droit entier de cité romaine. Autant puis-je en dire de son frère, bien malheureux sans doute, mais devenu absolument indigne, par suite de cette circonstance, de pouvoir être parmi vous un sénateur utile. — [Interruption d'un sénateur :] Allons! Tibère César Germanicus, il est temps de faire connaître aux Pères Conscrits où tend ton discours; car déjà te voilà arrivé aux extrêmes limites de la Gaule Narbonnaise. — [Claude reprend :] Tous tant qu'ils sont, ces jeunes gens distingués sur qui je promène mes regards ne vous font sans doute pas plus regretter de les voir au nombre des sénateurs qu'il n'est regrettable pour Persicus, de l'élite de notre noblesse et mon ami, de lire sur des portraits de ses ancêtres le nom d'Allobrogique. Si donc vous reconnaissez avec moi qu'il en est ainsi, que vous reste-t-il à souhaiter, si ce n'est que je vous fasse toucher du doigt que le sol lui-même, au delà des limites de la Province Narbonnaise, vous envoie déjà des sénateurs, puisque nous n'avons nullement à être fâchés de compter des Lyonnais parmi les membres de notre ordre? C'est, il est vrai, avec hésitation, Pères Conscrits, que je franchis les limites des provinces qui vous sont connues et familières; mais le moment est venu de plaider ouvertement la cause de la Gaule Chevelue. Si dans cette cause quelqu'un objecte que la Gaule a pendant dix ans soutenu la guerre contre le dieu Jules, qu'il oppose donc aussi cent années d'une fidélité invariable et d'un dévouement constant dans un grand nombre de circonstances critiques où nous nous sommes trouvés. De ce dévouement plus qu'éprouvé les Gaulois ont fait preuve lorsque mon père Drusus a soumis la Germanie; ils ont maintenu derrière lui une paix profonde assurée par leur propre tranquillité. Et cependant, au moment où Drusus fut appelé à cette guerre, il était occupé à faire le cens en Gaule, opération nouvelle et en dehors des habitudes des Gaulois. Combien cette opération est encore difficile pour nous, bien qu'il ne s'agisse de rien autre chose que d'établir publiquement l'état de nos fortunes, nous ne le savons que trop par notre propre expérience."
La Gaule est évidemment moins riche que les autres parties de l'empire en documents publics, et il est difficile d'expliquer cette pauvreté autrement que par un hasard. Mais les recnerches n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Ce sont également des actes émanés de la chancellerie impériale que les « diplômes militaires ». Nous avons vu que le soldat qui sortait du service dans les délais légaux recevait d'importants privilèges. On gravait sur un diptyque de bronze le texte du règlement qui les lui conférait : on y ajoutait ses noms, ceux de témoins, l'indication du corps où il avait servi, et on lui remettait ce diplôme en même temps que son congé régulier. Les vétérans avaient le plus grand soin de ces tablettes; ils les gardaient précieusement, comme une garantie ou un titre d'honneur; on les déposait avec leur corps dans le tombeau, et c'est dans des tombes d'anciens soldais qu'on retrouve de nos jours presque tous les diplômes militaires.
Les inscriptions gravées sur les bornes des routes peuvent être aussi regardées comme des documents officiels : elles indiquent, avant le chiffre des distances, les différents noms et les titres de l'empereur qui a fait construire ou réparer ce point de la route.
Il faut rapprocher de ces bornes milliaires cellesqui étaient dressées sur le parcours des aqueducs. Nous en avons conservé une, qui porte comme inscription: « De l'autorité de l'empereur Hadrien, personne n'a le droit de labourer, semer ou planter dans cet espace de terrain qui est réservé à la protection de l'aqueduc ». Les extraits des « actes» municipaux sont fort peu nombreux. Nous possédons le règlement de la confrérie religieuse fondée à Narbonne en l'honneur d'Auguste, il est gravé sur l'autel de marbre consacré à l'empereur. On peut lire encore le texte d'un décret porté par les habitants d'un canton rural, pagus, de la cité d'Arles. A la différence des actes de la chancellerie impériale, il semble que les ordonnances municipales étaient gravées plus souvent sur marbre que sur bronze.
Il faut ajouter à cette catégorie d'inscriptions quelques acta privata, « documents de famille », qui intéressent le droit privé, par exemple les testaments : nous possédons celui d'un Nimois et celui d'un Lingon, gravés à la suite de leur épitaphe.
3. Dédicaces de monuments et de statues. — Les autres catégories d'inscriptions sont infiniment plus riches. Ce sont d'abord les dédicaces des monuments publics et des statues.
Les premières se lisent, sur la façade de l'édifice, en lettres d'une grande hauteur; la dédicace de la Maison Carrée de Nîmes, " à Caius César, fils d'Auguste, consul, à Lucius César, fils d'Auguste, consul désigné, princes de la jeunesse", était gravée en lettres de bronze hautes de 30 centimètres, et l'on voit aujourd'hui encore les trous et les entailles destinés à les recevoir. A côté du nom du personnage ou du dieu en l'honneur duquel l'édifice était élevé, on mettait presque toujours le nom de celui qui l'avait fait construire, et parfois même la somme dont le donaleur avait contribué : « Caius Julius Sécundus, préteur, a donné les eaux à la ville, en lui léguant à cet effet la somme de 2 millions de sesterces », portent les dédicaces des châteaux d'eau et des fontaines construites à Bordeaux. — Les lois réglaient
d'ailleurs le texte de ces dédicaces : « II est défendu, disaient-elles, d'inscrire sur un édifice public un autre nom que celui du prince ou de la personne aux frais de laquelle il a été construit ». Et les lois ajoutaient : « Si un particulier a contribué de ses deniers à l'érection d'un édifice public, on doit indiquer sur l'inscription, titulo inscriptionis, le chiffre de la somme ».
Les dédicaces des statues sont assez fréquentes en Gaule, à Lyon surtout : le Conseil des Gaules accordait avec une extrême facilité les honneurs d'une statue à ses gouverneurs ou à ses prêtres. Gravées sur le socle qui portait l'image, les inscriptions donnaient tous les noms et tous les titres du personnage ainsi honoré, et, souvent aussi, l'indication des noms des donateurs, les dédicaces des statues décernées par le Conseil portaient la simple et glorieuse mention : « Les Trois Provinces gauloises », Tres Provinciae Galliae.
4. Autels ou ex-voto. — Les dédicaces des autels, des ex-voto, et, en général, des édicules ou des objets religieux, forment en Gaule un groupe fort important. Leur rédaction
est à peu près toujours la même et ne diffère guère de celle des monuments semblables que renferment en si grand nombre toutes les provinces de l'empire. Elle offre d'abord le nom de la divinité, puis celui du donateur, puis un mot relatif aux conditions dans lesquelles le monument a été donné.
 Monument élevé à la tutelle de Bordeaux (1)
Monument élevé à la tutelle de Bordeaux (1)
Il s'agit ordinairement d'un ex-voto, c'est-à-dire d'un autel, ou d'une figurine, ou d'un bijou, promis à la divinité en échange d'un vœu réalisé, d'un bienfait accordé, d'une guérison ou d'un miraculeux salut :
(1) C'est la dédicace d'un autel ou d'une statue élevée à la Tutelle de Bordeaux (au musée de cette ville). —TUTELAE AVGustae, Caius OCTAVIVs VITALIS EX VOTO P'OSVIT. Locus datus EX Decreto Decurionum [emplacement donné par un décret des décurions]. DEDlCatum X Kalendas IV Lias, IVLIANO II ET CR1SP1NO COnSulibus [le 22 juin 224].
« Pour la santé du prince », disent beaucoup d'inscriptions gravées sans doute dans des moments où la Gaule craignait pour les jours de son empereur; « si ma fille survit », dit très nettement le donateur d'un monument de Nimes. Le dévot ajoute souvent qu'« il s'est acquitté volontiers et librement de son vœu, parce que la divinité l'a mérité » ; de là la formule votum solvit libens merito, qu'on abrège V. S. L. M., une des abréviations les plus courantes de l'épigraphie latine. Cette formule indique que le dévot et son dieu ont tenu tous deux leurs engagements. Le dieu a fait son miracle, il a bien mérité, merito, le fidèle a fait son cadeau volontiers, libens.
Il peut aussi arriver que le cadeau est spontané de la part du donateur : c'est un don sans retour et désintéressé. On trouve simplement dans ce cas la formule donum ou dono dedit, « il a fait don ».
5. Épitaphes. — II va sans dire que les épitaphes fournissent plus des trois quarts de l'épigraphie gallo-romaine. Les épitaphes sont d'ailleurs des inscriptions religieuses au même titre que les dédicaces d'autel. Elles sont toujours précédées de la formule « aux dieux mânes », Diis Manibus, abrégée D. M. : la formule et l'abréviation les plus fréquentes de l'épigrapliie latine. La pierre dont cette formule est la dédicace doit être regardée moins comme un tombeau que comme un monument consacré aux divinités infernales et, plus particulièrement, à la divinité du défunt. On sait que, d'après les croyances des anciens, la mort était comme une apothéose : « Nos ancêtres ont voulu, disait Cicéron, que tous ceux de nos parents qui étaient morts devinssent des dieux », et le monument dédié « aux dieux mânes » était soit le temple où le mort séjournait, soit l'autel qui était consacré à son culte. L'épigraphie funéraire est un reflet de ces vieilles croyances.
Toutefois, en même temps que l'idée religieuse, d'honorer le mort devenu dieu, une pensée purement humaine se manifeste sur un bon nombre des épilaphes gauloises : celle du souvenir qu'on doit au défunt. On constate souvent, à côté de la dédicace « aux dieux mânes », la présence des mots memoria ou monumentum, « mémoire» ou « souvenir ». Il est à remarquer que ces deux dernières expressions, assez rares dans la Gaule Narbonnaise, presque inconnues dans le reste de l'empire, ne sont fréquentes que dans les Trois-Gaules, c'est-à-dire dans les pays les plus tardivement, pénétrés par la civilisation latine. Ne serait-ce pas parce que nous sommes, dans ce pays, plus près de l'époque des menhirs, c'est-à-dire des temps où la stèle du tombeau était surtout la « pierre du souvenir »?
On indique avec soin sur les épitaphes les noms et l'âge du défunt; on fait suivre ces indications des noms des parents ou des amis qui ont pris soin d'élever le monument, posuerunt, fecerunt, faciendum ou ponendum curaverunt. Si le nom du mort est accompagné d'une louange, elle est d'ordinaire d'une extrême simplicité : c'est une simple épithète, presque toujours la même, pientissimus, carissimus, optimus, merentissimus.
Il est à remarquer que la date de la naissance ou celle de la mort ne sont à peu près jamais indiquées sur les inscriptions païennes, et c'est là peut-être la différence fondamentale qui les sépare des épitaphes chrétiennes ou modernes.
 Epitaphe d'un soldat de la ville de Luc, en Dauphiné (1).
Epitaphe d'un soldat de la ville de Luc, en Dauphiné (1).
6. Marques de fabriques et de propriétaires. — Dans l'antiquité, comme de nos jours, les industriels
marquaient leurs noms sur
les produits sortis de leurs
magasins : ces noms, nous
pouvons les lire sur les
débris trouvés dans les ruines gallo-romaines. Il est fâcheux seulement que ces
marques de fabriques renferment presque exclusivement
le nom des manufacturiers, et ne nous donnent jamais,
comme celles de nos jours, le nom de la ville où ils étaient
installés.
Potiers, bronziers, verriers, orfèvres, argentiers, plombiers et bien d'autres, ont ainsi fait graver leur nom sur les objets fabriqués dans leurs maisons : ces marques s'appelaient signum, ou, plus souvent peut-être, character, c'est-à-dire « empreinte » ou « chiffre ».
(1) Caius MARIVS, Lucii filius, V0Ltinia tribu, LVCO AVGVSTO, EQVES LEGionis primae, ANNORum XXX, STIPENdiorum XV, Hic Silus Est. SEXtus SEMPRONIVS FRATER FACIENdum CVRAVIT.
Grâce à elles, nous pouvons retrouver les principaux industriels de la Gaule et connaître le nom ou refaire l'histoire de la poterie de Pistillus ou de la verrerie de Frontinus.
On doit réunir à cette catégorie les marques qui indiquent les noms des propriétaires des objets, par exemple les cachets qu'on lit sur les anneaux, ou les « chiffres » marqués sur certaines pièces précieuses. Cet usage des « chiffres » était en effet aussi répandu dans l'antiquité que de nos jours, on marquait ainsi même les moutons et les bêtes à cornes. Enfin on peut grouper avec ces marques les inscriptions gravées sur de menus objets pour en indiquer la destination
ou le caractère : telles sont, par exemple, les inscriptions des plombs de douane ou la curieuse inscription de la gourde à bière du musée Carnavalet.
Parmi les plus intéressantes de ces marques, il faut signaler celles qui sont gravées sur les cachets des médecins ou pharmaciens oculistes: elles offrent ceci de particulier qu'elles ne se rencontrent guère que dans la Gaule, ce qui doit tenir à certaines traditions de la médecine gauloise. Ces cachets servaient à l'oculiste pour marquer les produits de sa préparation : il les imprimait sur les pâtes qu'il vendait, et faisait ainsi connaître son nom et la nature du remède : « Remède de Claudius pour les cicatrices », Claudii ad cicatrices. Mais, sur ces cachets encore, il n'y a pas la moindre adresse.
Ces marques font corps avec l'objet qui les porte; il est rare qu'elles aient été tracées après l'achèvement du vase ou du bijou : elles ont été frappées, comme les légendes monétaires, en même temps que l'objet, à l'aide du même moule qui a servi à le fabriquer. Mais quelquefois aussi elles ont été
imprimées, appliquées après coup, à l'aide d'un véritable timbre mobile, qui portait l'inscription toute prête. Et il faut remarquer encore que quelques-uns de ces timbres étaient de véritables composteurs, pourvus de lettres mobiles analogues à nos caractères d'imprimerie : ce qui le prouve, c'est qu'il n'est pas rare de trouver, dans ces inscriptions industrielles, des renversements ou des interversions de lettres semblables aux coquilles et aux fautes que commettent nos imprimeurs, il est curieux de constater jusqu'à quel point les anciens se sont rapprochés de notre imprimerie : ils l'ont pour ainsi dire touchée sans la pressentir.
7. Graffiti. — On appelle graffiti les inscriptions tracées à la pointe du graphium ou poinçon : ce sont d'ordinaire des inscriptions sans caractère officiel ni juridique, sans utilité pratique, de simples fantaisies dues à des particuliers désoeu
vrés. On sait que les murs de Pompéi en sont couverts, et que ces graffiti permis de retracer le tableau de la vie populaire dans cette ville au moment de sa destruction.Mais la Gaule possède par malheur fort peu d'inscriptions de ce genre. A peine quelques-unes, très courtes, souvent difficiles à lire, se lisent sur des briques, des objets en métal ou sur des poteries.
8. Langue et gravure des inscriptions de la Gaule. — Le caractère commun de ces inscriptions est qu'elles sont toutes également en latin. La langue celtique n'a jamais été une langue épigraphique, pas plus que le provençal ou nos patois modernes. C'est tout au plus si nous trouverions quarante inscriptions celtiques gravées, la plupart en lettres grecques, les autres en lettres latines ; ce sont presque toutes des dédicaces à des divinités, et il n'est pas très facile de les comprendre. Il y a aussi plusieurs inscriptions grecques à Marseille et dans quelques villes du Midi; mais cela est moins que rien à côté des milliers d'inscriptions latines.
Sur ces inscriptions latines, il est extrêmement difficile de signaler à coup sur des vestiges qui trahissent une influence celtique, à une exception près : les graveurs gallo-romains emploient une lettre particulière, D-, d barré, pour représenter un son analogue sans doute au th anglais, son que possédait la langue celtique et qui manquait à la langue latine. A part cela, tout le reste est latin, et franchement latin; la langue n'est pas sensiblement plus mauvaise que dans les autres provinces reculées de l'empire. Dans les inscriptions gravées pour de petites gens, les archaïsmes, les locutions populaires, les incorrections abondent; mais ces particularités ne sont pas différentes de celles que présentent les épitaphes de la plèbe rurale de l'Italie ou du bas peuple de Rome.
La gravure de ces inscriptions ne s'écarte pas non plus des habitudes de l'art lapidaire romain. Les belles inscriptions de Lyon ou de Bordeaux sont aussi bien gravées que celles de Rome ; la paléographie de nos inscriptions a passé par les mêmes vicissitudes que celle des inscriptions latines de tous les pays. Les lettres des premiers temps sont carrées, régulières, sans ornement; les traits ont tous la même épaisseur: c'est le type parfait de ce que les anciens appelaient les « lettres carrées », litterae quadratae. Dès le règne de Tibère, les lettres sont plus ornées, les pleins s'y combinent harmonieusement avec les déliés; les caractères, plus sveltes, moins « carrés », sont le modèle des types que nos imprimeurs appellent les « elzévirs ».
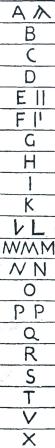 Lettres de l'épigraphie "carrée" Lettres de l'épigraphie "carrée" |
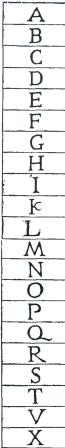 Lettres de l'épigraphie classique Lettres de l'épigraphie classique |
|---|
Au milieu du IIème siècle, la décadence commence pour les lapicides comme pour tous les artistes de l'empire, et en Gaule comme ailleurs : il n'y a plus de symétrie dans la disposition des lettres et des mois; la gravure est tatonnante, on dirait que le coup de ciseau du graveur tremble et glisse; les lettres sont trop allongées ou trop pâteuses : on sent, à chaque génération, grandir l'influence de l'écriture courante ou cursive sur le type lapidaire, de la même manière que le latin vulgaire écarte peu à peu la langue des temps littéraires et classiques.
 Epitaphe en lettres demi-cursives (1)
Epitaphe en lettres demi-cursives (1)
1. Épitaphe de la fille d'un triérarque de la flotte de Bretagne, stationnée à Boulogne. — Lecture : GRAECiae TerTIAE, Publii FILiae, V1XIt ANnos III, Mensem I, Dies XVI. Publius GRAECIVS TERTINVS, PATER, TRierarchus Classis BRitannicae Ponendum Curavit.
Il est presque inutile d'ajouter qu'il y a beaucoup plus d'inscriptions mal gravées en Gaule que dans le reste de l'empire mais il n'y a pas trace d'une école lapidaire gallo-romaine. La Gaule, en épigraphie comme pour le reste, n'est qu'une province romaine. Ces inscriptions sont dues presque toutes à l'initiative privée, les Gaulois les ont gravées à leur guise et ils ont toujours essayé de le faire à la manière latine. L'épigraphie nous montre aussi complètement que l'architecture avec quelle facilité les Gaulois ont accepté les habitudes romaines.
CHAPITRE XV
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
1. Développement de l'instruction publique en Gaule: elle est toute latine. — C'était en partie grâce à l'enseignement public que la langue et les habitudes romaines s'étaient ainsi répandues dans les Gaules. Avant l'arrivée des conquérants, le soin d'instruire la jeunesse était confié aux druides : il est visible qu'ils le perdirent en même temps que leur autorité politique. L'enseignement passa, tout naturellement, entre les mains des fonctionnaires municipaux.
Or il est digne de remarque que, dans l'enseignement qu'on donnait en Gaule, la langue celtique n'eut pas la moindre place : on n'apprit jamais le gaulois dans les écoles municipales, même dans celles des villes les plus attachées à la tradition celtique. Les Romains ne proscrivirent pas l'idiome national, ils ne l'encouragèrent pas non plus et il ne semble pas que les Gaulois aient été plus désireux que leurs maîtres de cultiver leur propre langue. L'école fut pour eux un centre d'éducation latine.
Dès que les Romains eurent soumis le pays, les villes gauloises firent venir d'Italie des rhéteurs et des grammairiens. Sous le règne d'Auguste, il y avait déjà à Autun une école célèbre : on y venait de tous les points de la Gaule pour s'instruire dans les « arts libéraux », ce qui revenait à dire dans les arts grecs et romains. Quand le soldat de Rome avait achevé son œuvre, ses deux collaborateurs se mettaient sur-le-champ au travail : à la suite des armées arrivaient le négociant, pour faire valoir le pays conquis, et le rhéteur, pour lui apprendre la langue des maîtres.
2. Principales écoles gallo-romaines. — Les deux plus florissantes écoles furent d'abord celles d'Autun et de Marseille. Marseille est l'école grecque, où l'on enseigne surtout la philosophie et où l'on a le culte d'Homère : il s'y rend des jeunes gens de la Gaule , il en arrive plus encore de Rome et d'Italie; c'est presque l'Athènes de l'Occident. Autun est l'école latine, où l'on apprend la rhétorique aux fils des grandes familles gauloises : jusque sous Constantin elle sera le centre du haut enseignement dans la Gaule propre. Ces deux écoles étaient de véritables universités, à l'usage des jeunes gens. L'instruction primaire était donnée dans toutes les villes importantes par des maîtres d'école ou des grammairiens, payés assez souvent sur le budget municipal.
A la fin du IVème siècle, les écoles d'Autun et de Marseille tombèrent dans le discrédit. Le premier rang passa à celles de Trêves, de Narbonne, de Toulouse et surtout de Bordeaux. L'Aquitaine devint à la fin de l'empire comme la «terre nourricière de la rhétorique romaine»; c'est à Bordeaux qu'il y a le plus d'élèves et les meilleurs maîtres, des maîtres que les capitales de Rome et de Constantinople cherchent à attirer à grands frais. Deux mille étudiants ont suivi les cours de l'un d'eux. Le poète Ausone, qui a été professeur à l'école de Cordeaux, nous a fait connaître dans ses vers les noms et l'enseignement de chacun de ses collègues.
3. Organisation de l'école. — L'école s'appelait auditorium. Un professeur était chargé de la diriger, avec le titre de moderator, summus doctor, peut-être même de rector: tout à la fois chef et membre du corps enseignant, il ressemblait assez au doyen d'une Faculté. Une école comprenait, comme nos facultés actuelles, un certain nombre de « chaires », cathedrae, chacune était occupée par un professeur en litre, doctor, professor, qu'assistait parfois un sous-maître ou suppléant, proscholus, subdoctore.
Les professeurs recevaient des émoluments de la ville ou de l'État; le chiffre en était d'ailleurs, sauf dans les très grands centres, assez modique. Mais ils étaient également rétribués par leurs élèves; aussi les cours les plus fréquentés rapportaient-ils de fort gros revenus, tandis que les professeurs médiocres restaient dans la gêne. Il pouvait se faire encore que l'État ou la ville accordassent des avantages exceptionnels à certains professeurs célèbres pour se les attacher plus sûrement. Le rhéteur Eumène, qui, il est vrai, était à la fois professeur et recteur de l'école d'Autun, reçut de l'empereur Constance le traitement étonnant de 600.000 sesterces, peut-être plus de 100.000 francs. Il y avait dans les écoles, comme dans toute la société gallo-romaine, de très grandes inégalités.
C'étaient les sénats municipaux qui nommaient les professeurs. Ils leur faisaient subir, au préalable, une sorte d'examen. L'empereur se réservait d'ordinaire le droit de sanctionner leur décision ; parfois même il désignait pour occuper telle chaire un homme de son choix. L'Etat garda toujours la haute main sur les écoles municipales, sur le recrutement des maîtres, la nature de renseignement et même sur la discipline des étudiants.
4. — Les étudiants étaient groupés en corporations, avec leurs chefs et leurs bannières. Eux aussi d'ailleurs étaient fort surveillés par l'État. Chacun d'eux avait son dossier, dont une copie était gardée dans les bureaux de l'administration centrale. L'État en effet recrutait parmi les anciens étudiants des écoles ses employés, ses secrétaires, ses référendaires, ses conseillers; il tenait à connaître le plus tôt possible et à suivre de très près ceux qui pouvaient être appelés à l'honneur de le servir. Les auditoria municipaux jouaient au IVème siècle le même rôle qu'aujourd'hui les grandes écoles du gouvernement.
5. — Les professeurs étaient presque tous fort considérés : ils tenaient une grande place dans la ville et même dans l'Etat. Il était rare qu'ils ne fussent point membres des sénats municipaux. Si les étudiants donnaient aux bureaux du prince leurs employés supérieurs, les maîtres fournissaient à l'empire ses plus hauts fonctionnaires. Ausone, qui fut professeur de rhétorique à l'école de Bordeaux, devint comte, préfet du prétoire, consul. Le mot de Juvénal fut plus vrai que jamais à la fin de l'empire : « La rhétorique mène au consulat ». Si nous voulons connaître la position que la société faisait alors aux professeurs, il faut lire les poésies d'Ausone : « Les rhéteurs, dit d'après elles M. Boissier, nous apparaissent comme de grands personnages que l'empereur vient souvent prendre dans leurs chaires, pour les attacher à sa personne, comme secrétaires d'Etat, ou même pour en faire des gouverneurs et des préfets. Ceux qui n'arrivent pas à cette fortune et qui ne quittent pas l'école n'en ont pas moins, dans la ville où ils enseignent, une situation brillante. Ils font souvent de riches mariages, ils épousent des femmes nobles et bien dotées. Leur maison est fréquentée par la haute société; leur table a de la réputation, et l'on y est attiré moins par les dépenses que fait le maître que par les agréments de son esprit et le charme de sa conversation piquante. »
6. L 'enseignement : la grammaire. — L'enseignement donné dans les écoles gauloises comprenait seulement deux degrés : la « grammaire », pour les enfants de cinq à dix ans; la « rhétorique »,pour ceux de dix à dix-huit ans. Ceux qui, au delà, de cet âge, voulaient se perfectionner dans des études spéciales, comme le droit ou la philosophie, se rendaient dans les grandes universités de l'empire : pour la philosophie, on allait surtout à Athènes, pour le droit, à Rome ou à Beyrouth. Seuls les futurs médecins pouvaient se former directement auprès des praticiens locaux, qui faisaient toujours un peu d'enseignement à côté de la clientèle.
On enseignait dans les classes de grammaire bien des choses, et des choses fort différentes. D'abord, on y apprenait à lire aux tout petits enfants. Ausone, qui fut professeur de grammaire avant de devenir rhéteur, recevait, nous dit-il, les enfants « au sortir de la mamelle », et il avoue que ce métier lui fut bien pénible. Dans les classes plus avancées on leur apprenait à lire et à expliquer les auteurs classiques.
L'exercice à peu près unique dans les classes moyennes était l'interprétation d'un auteur, qui était le plus souvent un poète. On en faisait lire d'abord un passage, et l'on veillait à ce qu'il fût bien lu : les anciens attachaient un grand prix, dans les écoles, à l'enseignement de l'art de la lecture. Puis on commentait minutieusement ce passage : on en cherchait et en arrêtait le sens. Enfin, toujours à propos du même texte, le maître donnait aux enfants des notions sur toutes choses : de religion, de mythologie, de métrique, s'il s'agissait de Virgile ou d'Homère, de philosophie ou de science, en lisant Lucrèce, d'histoire ou de géographie, en commentant Salluste. C'était un enseignement très général et très superficiel fourni à propos d'une lecture. Quintilien recommandait de donner aux enfants, dans les classes de grammaire, « ce que les Grecs appellent une éducation encyclopédique ». C'est exactement ce qui se faisait dans les écoles gauloises au IVème siècle.
On enseignait dans ces écoles aussi bien le grec que le latin : il y avait un assez bon nombre de maîtres grecs dans la division de grammaire de toutes les universités. Il n'était même pas rare que l'on commençât par l'étude du grec et la lecture d'Homère : Virgile et le latin ne venaient qu'après. Virgile et Homère étaient d'ailleurs les auteurs essentiellement classiques, et leurs œuvres étaient la vraie « bible » de cet enseignement.
Il est à noter que l'on recourait assez fréquemment, pour compléter l'instruction de ces enfants, à des tableaux, à des figures et surtout à des cartes géographiques ; la géographie fut assez en vogue dans les écoles gauloises du dernier siècle de l'empire.
V. L'enseignement : la rhétorique. — Les classes supérieures étaient celles de rhétorique. L'exercice principal y était, comme au temps de Cicéron ou de Quintilien, la harangue ou la déclamation. On cherchait d'abord à former de toutes les manières la mémoire du jeune homme : la mémoire était une qualité à laquelle les rhéteurs gaulois tenaient infiniment. Puis, l'étudiant apprenait l'art de la déclamation et du geste. Venait enfin la manière de composer, de diviser et d'écrire un discours, de « finir ses périodes » et de « tenir ses métaphores ». D'ailleurs, ces déclamations roulaient sur n'importe quel sujet, sur les lettres, la philosophie, l'histoire et la morale. L'enseignement n'était pas moins « encyclopédique » en rhétorique qu'en grammaire. Seulement les grammairiens avaient mission de donner des connaissances : les rhéteurs apprenaient l'art de les faire valoir, par le style et par la parole.
8. Importance de la rhétorique dans l'histoire de Rome. — Mais on se méprendrait sur la portée de cet enseignement public, si l'on ne voyait dans la rhétorique que l'art de bien dire : elle était plus que cela pour le Romain et le Gaulois; elle était comme la condition de l'exercice de l'autorité publique, un instrument de pouvoir et presque l'art de commander. C'est du jour où les Gaulois devinrent des rhéteurs, qu'il n'y eut plus entre eux et leurs maîtres, suivant l'expression de Cérialis, « ni exclusion ni privilège ». La rhétorique, c'était la manière de haranguer les soldats, de parler dans la curie, devant les tribunaux, au sénat : elle était un peu, comme la toge, l'insigne du Romain. C'est en partie grâce à elle que s'est faite l'unité du monde romain et que la Gaule est devenue latine. M. Boissier fait à ce propos d'excellentes remarques : « Dans la liste des professeurs de Bordeaux, telle qu'Ausone nous l'a laissée, nous voyons figurer, à côté d'anciens Romains, des fils de druides, qui enseignent comme les autres la grammaire et la rhétorique. Les armes ne les avaient qu'imparfaitement soumis, l'éducation les a domptés. Aucun n'a résisté au charme de ces études, qui étaient nouvelles pour eux. On est lettré, on est romain, quand on sait comprendre et sentir ces recherches d'élégance, ces finesses d'expressions, ces tours ingénieux, ces phrases périodiques qui remplissent les harangues des rhéteurs. Le plaisir très vif qu'on éprouve à les entendre s'augmente de ce sentiment secret qu'on montre en les admirant qu'on appartient au monde civilisé. » « Si nous perdons l'éloquence, disait Libanius, que nous restera-t-il donc qui nous distingue des barbares?»
Quintilien disait ; « La rhétorique est une vertu ». On peut ajouter qu'elle était une vertu romaine. L'école était donc en réalité une préparation à la vie romaine comme à la vie publique; et, à cet égard, nul pays ne devint plus romain que la Gaule , car nul ne fournit plus de rhéteurs à l'empire.
CHAPITRE XVI
LA LITTÉRATURE GALLO-ROMAINE
1. Diffusion de la langue latine. — II n'y a pas en Gaule de littérature gauloise à l'époque romaine. Il n'existe qu'une langue littéraire, le latin, qui est la langue des poètes et des rhéteurs comme celle des inscriptions, de l'école et de l'État. De poésies gauloises, populaires ou savantes, il n'est pas une seule fois question. Assurément, la langue celtique a persisté en Gaule jusque dans les derniers temps de l'empire, on la parlait dans la campagne; on la comprenait dans le bas peuple, même des grandes villes, comme Trêves ou Lyon. Les lois romaines ne lui firent jamais la guerre : elles permettaient de se servir du gaulois, par exemple pour rédiger un testament. Mais il était exclu de la vie publique et littéraire : comme les patois de la France actuelle, il n'avait place que dans la vie intime et il est probable que nul ne songea à une renaissance de la langue et des lettres celtiques, analogue à celle que les Félibres ont tentée de nos jours pour le provençal.
Les progrès du latin furent, continus. Nous ne constatons pas un instant de réaction sérieuse contre son influence. C'était en latin qu'avaient lieu les délibérations des sénats municipaux; les soldats l'apprenaient au camp, les enfants à l'école, les plébéiens au forum, les dévots dans les temples. L'épigraphie le propageait presque autant que l'école. Au IVème et au Vème siècle, il pénétra plus avant encore, jusque dans les populations les plus reculées des campagnes. L'Eglise chrétienne l'adopta, activa ses progrès et acheva son triomphe. C'est du latin que dérive notre langue française tout entière, et, si elle renferme quelques douzaines de mots celtiques, c'est parce que la langue latine les a d'abord adoptés : « alouette » et « lieue » sont des mots d'origine gauloise, mais ils ne sont restés dans notre langue que parce que les Latins les ont mis dans la leur, ils ne viennent pas directement du celte, mais du latin alauda, leuga. Les mots celtiques n'ont été conservés qu'à la condition de prendre une forme romaine.
2. Les rhéteurs gaulois. — Du jour où les Gaulois surent le latin, ils tirèrent admirablement profit de leur science. Dès les premières années de la conquête romaine, il y a des noms de Gaulois dans l'histoire de la littérature latine. Mais, en écrivant en latin, les Gaulois marquèrent toujours leurs travaux à l'empreinte de leur tempérament national. En art, ils ont manqué d'originalité, la littérature gallo-romaine, tout en se rattachant étroitement par l'invention et le style aux traditions romaines, a su prendre parfois une physionomie qui lui est propre.
C'est surtout une littérature de rhéteurs. Experts dans l'art de bien dire, les Gaulois l'étaient déjà au temps de l'indépendance; ils le furent plus que jamais, quand, sous les lois de Rome, il leur devint plus facile de parler que de se battre.
Au Ier siècle, deux des plus célèbres avocats de Rome sont Gaulois : Votiénus Montanus de Narbonne et le Nîmois Domitius Afer. Montanus était un peu trop bavard, il se répétait volontiers ; on l'appelait l'Ovide des avocats. Quant à Domitius, on le regardait comme un homme supérieur : ce fut le plus grand orateur que Quintilien ait jamais connu. Rhéteur et Gaulois sont deux termes qui s'appellent déjà l'un l'autre. Dans le Dialogue des orateurs, attribué à Tacite, c'est un Gaulois, Aper, qui est chargé de faire l'apologie de l'art oratoire, et il s'exécute avec cette abondance et cette verve qui sont dans le génie de sa race. Il faut lire le vigoureux éloge de l'éloquence que Tacite place dans la bouche d'Aper, pour comprendre la fièvre d'enthousiasme qui poussa les Gaulois vers la rhétorique : « Pour parler franchement, dit le rhéteur gaulois, aucun des jours heureux pour moi, ni celui où je fus décoré du laticlave, ni ceux où je fus nommé questeur, puis tribun, puis préteur, aucun n'est plus beau que celui où il m'est donné de sauver un accusé, ou de plaider heureusement devant les centumvirs, ou de défendre avec succès auprès du souverain les affranchis et les intendants. Alors je me crois au-dessus des tribunats, des prétures et des consulats; je crois posséder ce qui nous vient de nous-mêmes et non d'autrui, ce que ne donnent point des titres, ce qui ne résulte pas d'une faveur. Quoi de plus doux pour un esprit libre, généreux et né pour les plaisirs honnêtes, que de voir sa maison toujours fréquentée et remplie d'un concours de personnes du rang le plus élevé, et de savoir que ce n'est ni votre argent, ni votre héritage, ni quelque place mais votre mérite que l'on recherche ! Il sort et déjà quel cortège de personnes en toge ! Quelle joie, dés qu'il se lève et parle au milieu du silence, tous les regards fixés sur lui ! » Le IVème siècle marque à la fois l'apogée du culte de la rhétorique dans l'école et dans l'Etat, et le triomphe des Gaulois dans la littérature. Ils fournissent alors aux tribunaux de l'empire leurs avocats à la mode. Nous avons les discours de quelques-uns d'entre eux, d'Eumène d'Autun et d'Ausone de Bordeaux. Ce sont des panégyriques prononcés lors d'une cérémonie publique, la visite d'un empereur, la prise de possession d'un consulat : les Gaulois étaient des maîtres incomparables dans ces harangues officielles, mais il est difficile, en lisant les discours d'Eumène, de ne pas souscrire au rigoureux jugement porté par M. Mommsen : « Ce sont des modèles dans l'art de dire peu de chose en beaucoup de mots, et de protester d'une loyauté absolue avec un manque non moins absolu de jugement et de réflexion ».
3. La poésie : Ausone et Paulin . — A côté de ses orateurs, la Gaule avait ses poètes : la poésie et la rhétorique, voilà ses grandes passions d'autrefois et d'aujourd'hui.
Dès le temps de César, Térentius Varron, originaire du bourg d'Atax en Narbonnaise, écrivit un poème des Argonautiques qu'admirait Ovide, on y mettant sans doute un peu de complaisance.
Un orateur gaulois était souvent doublé d'un poète. Ausone, qui fut professeur de rhétorique, fut en même temps un des plus incorrigibles versificateurs de la fin de l'empire (il mourut vers 395).
Ses œuvres sont les principales que la poésie profane ait produites en Gaule. Il est vrai qu'elles ne nous donnent pas une très haute idée de la muse gallo-romaine : l'originalité y fait totalement défaut, du moins au vers et au style. Elles sont toutes faites à l'aide de réminiscences classiques, surtout de Virgile. Il y a chez Ausone des vers d'une grande simplicité et d'une rare élégance, des expressions qui touchent et séduisent; étudiez-les de près, vous verrez qu'Ausone a tout emprunté à quelque classique. Il vaut surtout par son incroyable dextérité à ajuster l'un à l'autre les hémistiches virgiliens dont il faisait ses centons. Il avait trop de mémoire pour être bon poète : la mémoire était la qualité chère aux rhéteurs, il nuisit à Ausone d'être un excellent professeur de rhétorique. Ajoutons à cela, pour avoir une idée de son talent, l'amour des tours de force métriques : des poésies faites en mots d'une syllabe, des acrostiches, des bouts-rimés, il a mis en quatrains les travaux d'Hercule, les divisions de l'année, le système des poids et mesures : c'est une poésie de salon, les gageures d'un pédantisme désœuvré.
Toutefois, il y a dans les poésies d'Ausone une certaine originalité qui décèle le Gaulois. C'est son amour de la nature, la fraîcheur de ses descriptions; c'est le naturel de sa phrase et sa douce émotion quand il parle des fleuves et des coteaux de sa patrie. Il y a, dans son poème de la Moselle , des peintures vivantes et des paysages bien compris. Écoutons-le, décrivant les eaux de la rivière : « Elles se glissent, transparentes, éclairées d'une lumière azurée, laissant apparaître, ici le sable qui se ride sous la vague légère, là le caillou qui brille et qui se cache et le gravier qui se détache de la mousse verte». Et voici sur les bords « le voyageur qui suit sa roule, tandis que le batelier chante des refrains moqueurs aux laboureurs attardés, et que les rochers résonnent de l'écho de ces voix ».
Et puis, ce qui fait surtout d'Ausone un vrai Gaulois, c'est que ses poésies sont essentiellement gaies. Il ne songeait guère qu'il vivait à la fin d'un empire : il n'a rien de découragé et de triste; on dirait volontiers que la vie est pour lui une charmante promenade : « Vivons toujours, dit-il à sa femme, la vie que nous avons vécue; gardons les noms que nous nous sommes donnés au premier jour de notre union. Qu'aucune journée ne vienne nous changer l'un pour l'autre; pour toi, que je sois toujours jeune, et pour moi, sois toujours ma chère enfant. Je deviendrai peut-être plus vieux que Nestor; tu dépasseras l'âge de Déiphobé, la sibylle de Cumes : ignorons cependant ce qu'est la maturité d'une longue vie. Sachons le prix des années; ne les comptons pas. » Ausone est bien le poète de la bonne humeur.
Ausone était païen mais cette gaieté et cet amour de la nature, nous les trouvons aussi chez le grand poète chrétien de la Gaule , Paulin de Bordeaux, évêque de Nole en 409. Comme Ausone, son contemporain et son ami, il eut ces deux qualités, si françaises et si gauloises, l'esprit et la gaieté. M. Boissier l'a dit : « Comme poète, Paulin est bien de notre pays; il n'a pas assez d'élévation et de souffle pour réussir dans l'ode ou dans l'épopée. Les genres où il excelle, l'épître, l'élégie, sont ceux où l'on se tire d'affaire avec de la grâce et de l'esprit. Il a le goût des qualités tempérées, il aime l'élégance et le bien dire ; quelque sujet qu'il traite, il le ramène à lui, il s'en sert comme d'un prétexte pour une causerie qui suit les caprices d'une conversation ordinaire. »
Car Paulin, comme Ausone, Eumène et tous les Gaulois, est un bavard. Les gens pieux et graves reprocheraient à ses lettres de divertir plus que d'instruire. C'est un théologien formé par des rhéteurs gaulois et qui a été leur meilleur élève. Comme eux aussi, il a le goût de la nature. Lors même qu'il décrit la fête de son saint favori et qu'il est le plus emporté par la fougue d'un religieux délire, il n'oublie pas les détails gracieux du paysage, il s'attarde aux charmants épisodes de la vie de la nature environnante, il voit la verdure et respire les fleurs qui encadrent son église : « Le printemps rend la voix aux oiseaux; moi, mon printemps, c'est la fête de saint Félix. Quand elle revient, l'hiver fleurit, la joie renaît. En vain l'âpre froidure durcit le sol, blanchit les campagnes : l'allégresse de ce beau jour nous ramène le printemps et ses douceurs. Les cœurs se dilatent; la tristesse, hiver de l'âme, se dissipe. Elle reconnaît l'approche de la chaude saison, la douce hirondelle, ce bel oiseau aux plumes noires, au corset blanc, et aussi la tourterelle, sœur de la colombe, et le chardonneret qui gazouille dans les buissons. Tous ces doux chanteurs qui erraient en silence autour des haies dépouillées, tous, ils retrouvent au printemps leurs chansons aussi variées que leur plumage. De même, j'attends pour chanter que l'année ramène copieux anniversaire. C'est le printemps alors qui renaît pour moi; alors le moment est venu de laisser échapper de mon âme mes vœux et mes prières et de me fleurir de chants nouveaux. » C'est une piété joyeuse et fleurie que celle de Paulin.
4. L 'histoire. — Les Gaulois réussirent moins dans les genres plus sérieux. De tous, c'est l'histoire qu'ils semblent avoir le plus goûtée, et, en cela encore, les tendances de nos ancêtres ne diffèrent pas sensiblement des nôtres.
Le plus célèbre des historiens gallo-romains est Trogue Pompée, originaire du pays de Vaison. Il écrivit, au temps d'Auguste, une histoire universelle, dont nous possédons un résumé fait par Justin. On le regardait comme un auteur « très sévère», et nous savons qu'il prenait très vivement à partie Tite-Live et Salluste, pour avoir prêté à leurs personnages des discours peu authentiques. Il était, parait-il, de l'école de Polybe et de Thucydide. Il avait une haute idée de son devoir d'historien.
Quatre siècles plus tard, Sulpice Sévère, Aquitain et chrétien, écrivit, vers l'an 400, une chronique universelle, en s'attachant de préférence aux événements religieux. Comme Trogue Pompée, Sulpice Sévère a l'amour de son métier; il est possédé du désir de trouver et de ne dire que la vérité : mais il sait l'envelopper d'élégance et de finesse. Il écrit à un ami dans une charmante préface : « Tu demanderas grâce pour moi à mes lecteurs : s'ils lisent ce petit livre, qu'ils pèsent les faits et non les paroles. Qu'ils ne s'irritent pas si un mot vicieux vient à choquer leurs oreilles : le royaume de Dieu ne réside pas dans l'éloquence, mais dans la foi. Ce sont des pêcheurs qui ont apporté le salut au monde : ce ne sont pas des orateurs; toutefois, rien n'empêchait le Seigneur, s'il l'avait jugé utile, de confier cette mission à des rhéteurs. » Sulpice Sévère, évidemment, ne veut pas se mettre mal avec les rhéteurs : il est bien de son temps et de notre pays. « C'est lui aussi, dit M. Boissier, un des nôtres, et sa nationalité se reconnaît à la modération de son esprit, au sens pratique de ses réflexions et à sa façon d'écrire. Son style est clair et coulant, sans obscurité, sans effort. Il compose bien ses récits; il leur donne un tour dramatique et les relève de temps en temps par des réflexions piquantes. Sa bonhomie n'est pas exemple de malice, et, malgré sa foi robuste, il se permet des plaisanteries qui causeraient aujourd'hui quelque scandale. Cette façon libre et vive de dire son opinion, cette clarté, cette élégance, ces qualités de composition donnèrent alors aux ouvrages de Sulpice Sévère un très grand succès. Cette faculté de se répandre partout, d'être compris et goûté de tout le monde, est encore un des caractères des lettres françaises. »
5. Les sciences . — La littérature scientifique est assez mal représentée en Gaule. Il ne faut pas s'attarder à l'arlésien Favorinus, contemporain d'Hadrien : rhéteur, philosophe et polygraphe, il écrivit et parla sur toute chose, sur la mythologie homérique comme sur la fièvre intermittente; mais il ne fut sérieux ni comme archéologue ni comme médecin. Chez lui, c'est encore le rhéteur et le bavard qui dominent.
De toutes les sciences, c'est la médecine qui a été le plus honorée chez les Gaulois. L'école médicale de Marseille était célèbre, comme celle de Montpellier le fut au moyen cage. L'un de ses membres, Charmis, se fit le patron de l'hydrothérapie : il imposait en plein hiver, nous dit Pline, l'eau froide « même à de vieux consulaires ». C'est à cette école grecque que les médecins gaulois paraissent s'être longtemps formés.
Mais voici qui caractérise la médecine gallo-romaine : de tous les domaines de l'activité intellectuelle, c'est le seul où se soit conservée avec une certaine ténacité la tradition celtique. Comme les prêtres asclépiades de l'ancienne Grèce, les druides avaient été à la fois prophètes et médecins. La domination romaine les supprima comme prêtres publics : ils demeurèrent comme sorciers et comme renoueurs, et leur influence, pour être occulte, ne s'en exerça pas moins sur les petites gens de la campagne et de la ville. Peut-être se faisait-elle encore sentir au moment de l'invasion. A côté de la médecine publique, tout entière importée de Grèce, il y eut une médecine populaire, faite d'amulettes, de mystérieux breuvages, d'herbes rares, de paroles magiques, exercée par les derniers héritiers des druides. A la fin même, cette médecine finit par s'imposer : dans un recueil de recettes médicales fort curieux, écrit sous le règne de Théodose par l'Aquitain Marcellus, nous lisons, au milieu de préceptes empruntés à la médecine classique de l'école grecque, des formules étranges, pleines de vertus secrètes, et visiblement composées en langue celtique. C'est le dernier vestige du druidisme, et le seul souvenir qu'il ait laissé dans la littérature gallo-romaine.
CHAPITRE XVII
LES DIEUX
1. L 'union religieuse. — La transformation religieuse de la Gaule s'opérait en même temps que son éducation littéraire et artistique. Seulement la langue latine chassa devant elle l'idiome gaulois et ne voulut accepter que quelques mots : les dieux de la Gaule , au contraire, allaient tous s'unir aux dieux romains.
Les Romains ne persécutèrent pas un seul instant les divinités indigènes : ils se bornèrent à interdire certaines cérémonies barbares, par exemple les sacrifices humains. Ils supprimèrent ou laissèrent se dissoudre la corporation des druides, dont ils redoutaient avec raison la puissance politique et l'influence populaire; toutefois, ils ne purent les empêcher qu'à moitié de continuer leurs pratiques mystérieuses, leurs sortilèges et leurs médecines occultes, et ils ne voulurent point combattre à outrance les derniers d'entre eux. Grâce à la tolérance de l'autorité publique, le druidisme subsista ainsi jusqu'au IVème siècle; mais il ne forma plus que des sorciers et des devins, échangeant son antique suprématie contre une popularité de bas étage. Mais, en dehors des derniers druides, il est curieux de voir avec quelle rapidité se fit la fusion entre la religion gauloise et la religion romaine. Les Gaulois adorèrent les dieux romains avec la même aisance que les Romains sacrifièrent aux dieux gaulois, ou plutôt les deux nations ne firent pas de différence entre les deux cultes. Déjà César donnait aux dieux celtiques des noms romains; il nous disait que les Celtes pensaient de Mars, de Mercure et de Jupiter les mêmes choses que les Romains pensaient de ces dieux. Cela est probable; il est possible aussi que César ait voulu préparer chez les vaincus une fusion religieuse que son esprit philosophique lui permettait aisément de faire.

Vulcain Jupiter Bas-reliefs sur un autel trouvé à Paris.
Et de fait les Gaulois ne tardèrent pas, comme César, à assimiler leurs dieux à ceux de leurs maîtres. Les uns et les autres ne vécurent pas seulement côte à côte : ils finirent par se confondre. Il n'y eut plus un Taranis gaulois en face d'un Jupiter romain : Taranis et Jupiter furent deux noms différents d'une seule divinité. Les Gaulois donnèrent à leurs grands dieux les noms, les attributs, les légendes, la figure même des grands dieux romains. C'est ainsi que, sous la domination latine, l'unité de la Gaule ne tarda pas à se faire sur le nom et au profit des divinités du panthéon gréco-romain.
D'ailleurs, la même concorde religieuse régnait dans toutes les provinces de l'empire : seul le Jéhovah des Juifs était irréductible, et les Romains essayaient vainement de le résoudre en Jupiter. «Il semblait, dit M. Boissier, que d'un bout de l'univers à l'autre, toutes les nations pratiquaient à peu près le même culte. On fermait les yeux sur les diversités de détail qui séparaient les diverses religions, pour ne voir que le fond, qui était presque semblable, et jamais peut-être le monde ne parut plus près de s'unir dans des croyances communes. »
2. Les dieux locaux d'origine indigène. — De toutes les divinités celtiques, les plus tenaces ont été les divinités locales. Chacune des villes avait son dieu qui la protégeait, et ce dieu, le plus ancien du pays, vécut avec l'appui de Rome jusqu'à la fin de l'empire. C'était d'ordinaire le dieu de la source qui arrosait la cité : on l'adorait sous le même nom que la cité elle-même. A Cahors, la divinité municipale était la source Divona, et c'était ce nom de Divona qu'on donnait, à la ville à l'époque romaine. A Nîmes, le dieu était la grande fontaine, deus Nemausus. Vesunna était le nom de la source qui alimentait Périgueux, de la divinité qui protégeait la ville et de la ville elle-même. On adorait toujours le dieu Vasio à Vaison, à Vence le dieu V incius.
De ces déesses locales, les plus nombreuses étaient celles qu'on appelait les « Mères », Matrae ou Matres : c'étaient les déesses qui protégeaient les sources; comme tant de divinités grecques et romaines, elles n'allaient jamais que par groupes de trois, rarement de cinq. Les plus célèbres fontaines, comme celle de Nîmes, avaient leurs Mères, Matres Nemausicœ. Toutefois les Mères de Nîmes firent place de bonne heure au dieu Nemausus, au temps classique, les Mères se rencontraient peu dans les grandes villes : elles protégeaient surtout les sources humbles et paisibles des villages, et c'est dans les campagnes que leur culte était le plus répandu.
Près d'elles, on priait les Nymphes, Nymphœ, les Fatœ, ou « Fées », les Sulevœ, peut-être déesses des bois, les Proximae, d'autres encore : on les groupait trois par trois et elles n'avaient d'autre nom que celui de la source qu'elles habitaient.
Le nombre de ces divinités locales, chères aux petites gens, est incroyable : elles sont surtout fréquentes dans les pays de montagnes, où la nature du sol invitait à l'isolement religieux comme au morcellement politique. C'est ainsi que chaque vallon, chaque sommet, chaque recoin perdu des Pyrénées possédait son dieu, dont le nom bizarre se retrouve parfois aujourd'hui dans le nom d'une localité voisine : le dieu Averranus était adoré près du col de l'Aouëran, Baicorrixus est la divinité du val de la Barousse , Artahe, du pays d'Ardet, Harixo, du pays de Carice.
Toutefois ces dieux eux-mêmes ont subi l'influence romaine. On les a fort souvent habillés et travestis à la manière latine. Ils ont presque tous reçu l'épithète d'augustus,
« vénérable », réservée aux divinités d'allure moins solennelle. Fréquemment encore on les a regardés comme des manifestations locales, on peut presque dire des émanations d'une grande divinité gallo-romaine, Mars, Jupiter, Diane, Apollon ou Mercure : dans ce cas, le nom primitif du dieu a été réduit au rang de simple épithète; au dieu local, né à l'endroit même, a succédé le grand dieu, protecteur du lieu. Dumias, le « dieu du Puy de Dôme », a été changé en Mercurius Dumias. Borvo, le dieu de Bourbon, est devenu l'Apollon de Bourbon, Apollo Borvo ; le deus Vincius de Vence n'est plus qu'une figure de Mars, Mars Vincius.
Mais les déesses des sources ont résisté davantage à l'action romaine; elles ont conservé jusqu'au bout leur altitude de petites divinités rustiques. Elles avaient été les premières qu'aient adorées les Gaulois, et ce sont elles qui ont eu la vie la plus longue. Ces divinités féminines avaient une incroyable vitalité. C'étaient les déesses de l'endroit, chères aux enfants et aux vieilles femmes, qui créent les légendes et font vivre les dieux; on les regardait comme les fées puissantes et les mères secourables; elles habitaient tout près des hommes: on avait pour elles une reconnaissance mêlée de crainte. Aussi leur culte allait-il se conserver bien au delà de l'époque romaine. Charlemagne se plaignait encore en 802 qu'on vénérât les arbres, les rochers et les fontaines, et aussi qu'on interrogeât les devins et les sorciers. Les sorciers, derniers rejetons du druidisme, et les déesses des bois et des fontaines, voilà ce qui a le plus longtemps survécu de la religion de nos ancêtres.
3. Dieux locaux d'origine romaine. — A côté des divinités indigènes prirent place, dans les villes et les campagnes, les « Génies » et les « Tutelles » : c'étaient là des divinités locales franchement romaines, directement venues de la religion italienne. Aussi ne furent-elles jamais très populaires : elles étaient trop froides, trop impersonnelles pour plaire aux Gaulois; elles ne jouèrent un rôle important que dans le culte officiel des municipes gaulois et peut-être aussi dans la pensée et les croyances de quelques lettrés ou d'hommes à la fois dévots et philosophes. Le bas peuple n'allait pas à elles.
Les Romains croyaient que les cités et les nations avaient, ainsi que les hommes, un Génie, naissant avec elles, grandissant comme elles, et mourant de leur mort. On adorait le « Génie du peuple romain», Genius Populi Romani. De la même manière, toutes les cités de la Gaule se donnèrent un Génie auquel elles élevèrent des autels et immolèrent des victimes. On l'adora publiquement dans le chef-lieu de la cité : à Bordeaux, on priait le Génie de la cité des Bituriges Vivisques, dont la ville était la capitale, Genius Civitatis Biturigum Viviscorurn; les Arvernes adoraient le Genius Arvernorum; à Lyon, on priait le « Génie des Lyonnais », Genius Lugdunensium,
 La Tutelle de Lyon
La Tutelle de Lyon
II n'est pas impossible que ce culte des Génies de cités ait eu une influence dans le développement municipal de la Gaule , et que l'État ne l'ait propagé dans le même but qu'il créa le culte de Rome et d'Auguste. En habituant les membres d'une même cité à adorer le Génie commun de leur nation, on établissait entre eux une solidarité morale et religieuse; ils s'habituaient à regarder la civitas comme un être divin dont ils partageaient les destinées, une famille dont le génie était l'âme : l'autel du Génie devenait ainsi le foyer de la patrie municipale, et les habitants se groupaient autour de lui comme les membres de la famille autour de l'autel domestique.
Les théologiens romains disaient aussi que chaque ville avait sa divinité tutélaire : le nom véritable de cette divinité était inconnu, son existence était lointaine et mystérieuse : on devait l'adorer sous le nom vague de Tutela, ou sous celui de la ville que le dieu inconnu protégeait ;
 Génie de la cité des Eduens .
Génie de la cité des Eduens .
C'est ainsi que la « déesse Rome », dea Roma , était en principe moins la ville de Rome déifiée que l'insaisissable divinité qui présidait à sa vie. Les peuples de la Gaule acceptèrent cette théologie, à laquelle ne s'opposait aucune des tendances religieuses de la nation; la cité, c'est-à-dire, la réunion des hommes, avait son Génie; la ville, c'est-à-dire la réunion des demeures, eut sa Tutelle. Dans toutes les grandes villes, surtout en Aquitaine, il y eut des autels élevés à la Tutelle du lieu : Tutelae Vesunnae, disait-on par exemple à Vésonne, aujourd'hui Périgueux ; un des plus beaux édifices élevés en Aquitaine était le temple de la Tutelle de Bordeaux.
4. Les grands dieux gaulois. — Les grandes divinités gauloises devaient se métamorphoser plus vite encore que les dieux locaux. Les vieux noms d'Esus, de Teutatès, de Taranis, de Bélénus disparurent de très bonne heure : à leur place nous trouvons ceux de Sylvain, de Mars, de Mercure, de Jupiter, d'Apollon. La transformation a été si brusque, les transitions ont été si peu ménagées, que nous ne savons même pas sous quel aspect et sous quel nom les anciens dieux ont continué à vivre. Il est probable que Taranis a pris la figure de Jupiter, et Bélénus celle d'Apollon mais il n'est pas certain que Teutatès se soit transformé en Mercure, et l'on se demande si Ésus est devenu Mars ou Sylvain : peut-être a-t-il pris également l'un et l'autre nom.
 |
 |
|---|
Le dieu aux trois têtes (autel de Beaune). Le dieu au maillet
L'incertitude même où nous sommes au sujet de ces changements de noms montre avec quelle facilité les Gaulois ont, non pas abandonné, mais transfiguré leurs dieux.
Il n'est pas inutile de rappeler ici que, lorsqu'ils voulurent leur donner un corps et des attributs extérieurs, ils ne firent aussi que copier les statues de la mythologie classique. Il n'y a, sur les images des dieux gaulois, qu'un nombre très restreint de détails qui ne soient pas directement fournis par les légendes des divinités gréco-romaines, et une étude approfondie de ces monuments permettrait encore de diminuer la quantité de symboles ou de signes qu'on peut attribuer à coup sur à la mythologie celtique. Bien rares sont les dieux auxquels on peut trouver une attitude personnelle et un air national. On a regardé longtemps comme franchement celtique cette étrange divinité à plusieurs têtes, dont on rencontre assez souvent la statue dans les Gaules : on s'est demandé si elle n'était pas simplement une copie difforme du Janus romain à quatre têtes, Janus quadrifrons. « Elle n'a rien de gaulois, a dit avec hardiesse M. Mowat, si ce n'est le caractère grossier et barbare de la main-d'œuvre. »
Peut-être un jour réussira-t-on à prouver la même chose des trois figures les plus répandues de la mythologie gauloise. — C'est d'abord un dieu que quelques inscriptions appellent du nom latin de Sylvain; tantôt nu, une chlamyde jetée sur l'épaule, tantôt vêtu de la tunique gauloise, il lient de la main droite un gobelet, de la main gauche un maillet ou un marteau, parfois une serpe ; un chien est à ses pieds. — C'est ensuite le « dieu à la roue », ainsi nommé d'une rouelle qu'il porte à la main : si ce symbole est bien, comme on le dit, celui du soleil, ce dieu serait Taranis, le Jupiter gaulois mais il serait imprudent de l'affirmer. —C'est enfin Cernunnos, le dieu cornu, qui se tient toujours accroupi, à la figure laide, au corps trapu. On en a fait une sorte de Pluton gaulois.
Pour se rendre compte de cette disparition de la religion gauloise, qu'on songe surtout à ce qu'est devenue leur divinité principale, celle dont parlait le plus longuement César et dont il disait que les figures en étaient nombreuses : nous ne savons pas à coup sûr si elle s'appelait autrefois Teutatès; mais nous savons à n'en pas douter que les Gaulois ont changé son nom en celui de Mercure, et nous constatons qu'ils l'ont toujours représentée sous les traits et avec le costume du Mercure classique. Ils lui ont donné le pétase, les talonnières, le caducée, ils lui ont prêté la vie, les légendes et les attributs du fils de Maïa : il ne lui reste plus rien de son passé celtique, ni son nom, ni sa figure, pas même le souvenir de son histoire.
 Cernunnos, le dieu cornu, sur un autel de Paris.
Cernunnos, le dieu cornu, sur un autel de Paris.
5. Les grandes divinités romaines. — A peine peut-on dire après cela que les dieux romains firent concurrence aux dieux gaulois : les deux cultes se pénétraient plutôt qu'ils ne vivaient côte à côte. Quand un Gaulois adorait Mercure, soyons sûr qu'il ne se demandait jamais s'il entendait par là le Mercure gaulois ou celui de ses maîtres.
Toutefois, quelques divinités classiques apparaissent en Gaule sous une forme qui semble parfois exclure l'identification avec un dieu indigène : Castor et Pollux, Minerve, Hercule, Diane et Apollon, Mars, Junon sont souvent adorés comme des divinités étrangères auxquelles on ferait bon accueil.
Deux surtout parmi les dieux franchement romains ont été l'objet de la vénération constante de tous les Gaulois : c'étaient les deux grands protecteurs de l'empire romain, ou, plutôt, ils s'identifiaient avec la conquête et la domination même de Rome. C'était la divinité de l'empereur, Augustus, et, à côté d'elle, le Jupiter du Capitole romain, Jupiter Optimus Maximus.
Le grand dieu du Capitole représentait aux yeux des Romains et de leurs sujets le dieu de la conquête et de la victoire; c'est lui qui avait conduit les légions et qui avait créé l'empire. C'était le premier de tous les dieux, le « maître des choses divines et humaines », l'« arbitre des destins », le « gardien des empereurs », « le champion de Rome », le « propagateur de l'empire ». On put croire, pendant les trois premiers siècles de l'ère chrétienne, que l'unité divine et la fusion des cultes allaient se faire au profit du Jupiter Capitolin.
6. Divinités orientales. — Toutefois les cultes du Jupiter romain, d'Auguste ou du Mercure gaulois avaient aux yeux des hommes de cette génération un immense inconvénient. C'étaient des divinités trop précises, qui ressemblaient trop à l'humanité, surtout à ce qu'elle offrait de dur, de trivial et de matériel : c'étaient le plus souvent des maîtres exigeants et redoutables, et c'étaient parfois aussi des camarades vulgaires et familiers. Ils étaient à la fois trop haut ou trop près. Les philosophes pouvaient dégager la pureté de leur essence divine : le populaire ne voyait en eux que des êtres tout corporels.
 Diane, trouvée à Chalon.
Diane, trouvée à Chalon.
Or il y avait, dans le monde apaisé et unifié qu'avaient crée les lois de Rome, un ardent besoin de croire à un pouvoir plus lointain et plus mystérieux, plus divin comme origine, plus paternel comme nature. « On voulait, dit Renan dans son Marc-Aurel on voulait une religion qui enseignât la piété, des mythes qui offrissent de bons exemples, susceptibles d'être imités, une sorte de morale en action fournie par les dieux. On voulait une religion honnête; or le paganisme ne l'était pas. On voulait surtout des assurances pour une vie ultérieure où fussent réparées les injustices de celle-ci. Les populations se précipitèrent, par une sorte de mouvement instinctif, dans toute secte qui satisfaisait leurs aspirations les plus intimes et ouvrait des espérances infinies. »
C'est pour satisfaire ce besoin d'aimer, d'espérer, de donner à une puissance bonne et mystérieuse son âme et sa vie, que les Gaulois accueillirent les divinités de l'Orient. Elles arrivèrent dans leur pays dès les premiers temps de l'empire. Toutes se ressemblaient en deux points : leur culte était fait de cérémonies étranges, pleines d'émotions et de ravissements, d'extases ou de délires; puis, il créait une fraternité entre les adeptes, il les obligeait à s'aimer et à vivre unis. Par leurs mystères et les liens qu'elles créaient, ces religions orientales, suivant la parole de M. Renan, tenaient sans cesse « l'âme en éveil ».
Dans le sud de la Gaule , on adora quelque temps la déesse égyptienne Isis; « déesse aux mille noms », mais surtout « tendre mère des mortels », elle leur tendait la main dans les tempêtes de la vie. Un peu partout dans la Gaule , et surtout au IIème et au IIIème siècle, on éleva des autels au dieu persan Mithra, que ses fraternelles agapes et ses pieuses confréries ont longtemps rendu populaire.
 La Cybèle d'Abbeville.
La Cybèle d'Abbeville.
Mais ce fut une déesse asiatique, la Cybèle phrygienne, qu'on appelait couramment la « Mère des dieux », qui eut le plus de dévots dans les Gaules. Du IIème au IVème siècle, elle fut la rivale heureuse de Mercure et de Jupiter, surtout dans les villes; elle eut, dans presque toutes, ses autels et ses prêtres; Lyon et Lectoure paraissent avoir été les deux centres de sa religion et de sa propagande. Le culte qu'on lui rendait avait presque toujours un caractère officiel : on l'adorait au nom des cités et même au nom des provinces, et les confréries de ses prêtres, que dirigeait un archigallus, étaient reconnues par l'État.
 Autel taurobolique trouvé à Lyon.
Autel taurobolique trouvé à Lyon.
C'est surtout en l'honneur de la Grande Mère des dieux qu'avaient lieu les pieuses cérémonies qu'on appelait « tauroboles » et dont un grand nombre d'inscriptions nous ont conservé le souvenir. Le taurobole était à la fois un sacrifice et un baptême : on immolait un taureau et l'on arrosait les fidèles du sang de la victime. Celui qui avait reçu ce baptême du sang en sortait purifié, régénéré pour l'éternité : ce jour était pour lui le « jour d'une nouvelle naissance », une vraie résurrection morale. Ces sacrifices se faisaient souvent aussi pour le salut du prince : le taurobole donnait lieu alors à une grande solennité publique, où se manifestaient à la fois le pieux enthousiasme du populaire et le dévouement de la cité à l'empire. Aucune cérémonie n'était plus émouvante, aucune fête ne remplissait à ce point les âmes d'un trouble religieux.
CHAPITRE XVIII
LES COMMENCEMENTS DU CHRISTIANISME EN GAULE
1. Caractère primitif du christianisme. — Une autre religion orientale, celle du Christ, devait donner à la Gaule l'unité de croyances, et achever l'œuvre commencée par le Mercure gaulois, le Jupiter du Capitole et la Mère asiatique. Mais de profondes différences séparaient le christianisme des cultes rivaux, différences qui firent longtemps sa faiblesse et qui devaient cependant amener, tôt ou tard, son triomphe.
Les autres divinités orientales étaient, comme les grands dieux romains, des divinités aristocratiques : le culte qu'on leur rendait était surtout officiel ; les prêtres étaient opulents, les cérémonies imposantes; il y avait une hiérarchie savante entre les initiés. Les pratiques étaient compliquées, elles offraient trop de symboles abstraits, et demandaient plus de réflexion encore que de dévotion. C'étaient des cultes d'hommes riches, d'intelligences raffinées ou de cœurs subtils. Au contraire, la religion du Dieu unique, « Père des hommes et régnant dans les cieux », avait été fondée par le fils d'un charpentier : il l'avait enseignée d'abord à de pauvres gens, il avait prêché le mépris des richesses et prédit le triomphe des humbles et des ignorants; il était mort, sur la croix, de la mort ignominieuse des esclaves. Plus tard, la religion qu'il avait annoncée s'était développée presque uniquement dans la plèbe des villes : les premières églises chrétiennes avaient ressemblé à ces « collèges de petites gens », collegia tenuiorum, si odieux à l'État romain. Dans ces réunions, il n'y avait ni prêtre ni maître; c'étaient des fraternités toutes démocratiques. « Des groupes peu nombreux d'humbles et pieuses gens, menant entre eux une vie pure et attendant ensemble le grand jour qui sera leur triomphe et inaugurera sur la terre le règne des saints, voilà, dit M. Renan, le christianisme naissant. »
Seule de toutes les religions de l'empire, celle du Dieu le Père, révélée par le Christ, avait été dès son origine même une religion d'opposition. Le Christ avait été exécuté avec l'assentiment de l'intendant du prince; les Juifs, ses compatriotes, étaient en lutte ouverte avec l'autorité impériale; les petites gens dont il provoquait l'enthousiasme étaient terriblement suspects à l'empire. Le chrétien avait beau rendre à César ce qui appartenait à César, il vivait à l'écart de l'État : sa patrie n'était ni la cité romaine, ni la cité humaine, c'était la cité de Dieu, l'Église; le devoir de citoyen était à ses yeux secondaire.
Enfin le christianisme, à la différence des autres cultes, exigeait pour le Père une foi exclusive; il n'admettait pas de partage avec les autres divinités, de conciliation avec les autres croyances. Un Gaulois pouvait prier le même jour, sans scrupule, le Jupiter du Capitule, son Bélénus national, le Numen d'Auguste et la Mère des dieux : aucune de ces divinités n'était jalouse; leurs figures prenaient place, l'une à côté de l'autre, sur les mêmes bas-reliefs; les prêtres de Mercure sacrifiaient de bonne grâce sur les autels d'un dieu voisin. Le Dieu des chrétiens, comme celui des Juifs, était essentiellement jaloux. Le chrétien ne devait tenir pour vrai que son Dieu. Les autres étaient des démons ou les noms de vaines idoles : leur brûler de l'encens était un crime. Même, ce qui était plus grave, le chrétien ne pouvait adorer la divinité impériale. Auguste n'était pour lui qu'un homme; il devait lui obéir; il pouvait le respecter : il ne devait pas le prier. Or le culte de l'empereur était alors un devoir de citoyen, au même titre que le payement de l'impôt et que le service militaire. Le chrétien se trompait encore étrangement, en prétendant donner à César ce qui était à César : il lui refusait la qualité divine à laquelle le prince avait droit aussi bien qu'à l'imperium et qu'à la puissance tribunitienne.
Le christianisme ne fit jamais une guerre directe à l'empire : il croyait vivre en dehors de lui. Il n'en représentait pas moins les tendances les pins hostiles au régime impérial : il glorifiait les petites gens, il pratiquait l'indifférence politique, et il prêchait le Dieu unique et exclusif.
2. Premières conversions en Gaule. — Le christianisme parut assez tard dans les Gaules. Il y eut peut-être, dès le temps de Domitien, une petite église chrétienne dans la ville grecque de Marseille : c'est là qu'on a trouvé la plus ancienne épitaphe chrétienne de la Gaule et peut-être de tout l'empire; c'est sur le territoire d'une cité voisine, d'Arles, que se rencontre le plus ancien tombeau laissé par le christianisme. Il semble bien que c'est dans cette région que la foi prit naissance en Gaule : Marseille n'était-elle pas le port naturel où le christianisme devait débarquer en venant d'Asie ?
Toutefois, la première grande église de notre pays fut celle de Lyon. A Lyon, d'ailleurs, comme à Marseille, le christianisme est d'origine grecque et asiatique. C'est en Orient qu'il était né : ce sont des colonies d'Orientaux qui l'ont apporté et recueilli.
Il y avait, en effet, dans la métropole des Gaules, une fort nombreuse colonie d'Asiatiques et de Syriens, industriels et négociants : c'est parmi eux que le christianisme se développa, propagé par deux prêtres de Smyrne, Pothin et Irénée. De Lyon, il gagna les deux grandes villes voisines, Vienne et Autun. Il y eut surtout, dans ces églises primitives, des plébéiens, des esclaves et des Orientaux : le seul personnage important y était Attale, de Pergame, riche citoyen romain. Pothin en fut le premier évêque. Il est douteux que ces confréries de chrétiens fussent bien nombreuses; mais elles étaient assez remuantes et d'une piété fort grande. D'origine grecque, l'église gauloise était devenue bien lyonnaise par l'exubérance de ses rêves, le mysticisme de ses croyances et le zèle de sa foi. Elle se laissa même séduire par l'hérésie des gnostiques, dont elle aima les bizarres prédications et le piétisme passionné.
C'est aussi l'église de Lyon qui allait fournir au christianisme gaulois ses premiers et plus célèbres martyrs.
3. Premières persécutions. — De toutes les religions de l'empire, le christianisme fut la seule que l'État persécuta; car nulle ne s'appuyait au même degré sur tous les principes contraires à la société romaine. Il fut aisé au gouvernement de trouver des lois pour la combattre : contre les églises ou confréries chrétiennes, il eut la loi sur les collèges de petites gens; contre leur dieu, il eut la loi qui interdisait l'importation de divinités étrangères; contre leur attitude politique, il eut lit « loi de majesté », qui obligeait tout citoyen à vénérer le prince, représentant la « majesté du peuple romain ». Le christianisme tombait sous le coup de toutes ces lois. « Être chrétien » suffisait donc pour constituer un crime contre le droit romain; cela signifiait être le contempteur de la divinité impériale, le membre d'une société illicite, un étranger à la cité romaine, un ennemi de tous les dieux, même un « ennemi du genre humain »; car les Romains identifiaient volontiers leur empire avec le monde et leur société avec le «genre humain», et, d'ailleurs, le Christ n'avait-il pas dit de ses disciples : « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde »? Le titre seul de chrétien suffisait donc pour entraîner la condamnation la plus sévère : il n'y eut pas, il n'était pas nécessaire qu'il y eût contre eux de loi spéciale.
Ce fut à Lyon, en l'an 177, sous le règne de Marc-Aurèle, qu'eut lieu la plus sérieuse des persécutions contre les chrétiens de la Gaule. On arrêta les membres les plus connus de l'église et on les exécuta. L'affaire ne fit pas grand bruit à Lyon : ce n'était aux yeux du peuple, a dit avec raison M. Allmer, que « la punition de quelques coupables de bas étage, un acte de police locale ». Mais les fidèles survivants écrivirent à leurs frères d'Asie une longue et émouvante lettre, où ils racontèrent le détail de leurs misères. C'est dans cette lettre que se trouve le récit de la glorieuse mort de l'esclave Blandine. « Ses compagnons de captivité avaient craint, à cause de la faiblesse de son corps, qu'elle n'eût pas même la force de confesser. Mais elle mit à bout tous ceux qui, l'un après l'autre, lui firent subir toutes sortes de tourments, depuis le matin jusqu'au soir; ils s'avouaient vaincus, ne sachant plus que lui faire et admirant qu'elle respirât encore ayant tout le corps ouvert et disloqué. Pour elle, la confession du nom chrétien renouvelait ses forces : son rafraîchissement et son repos étaient de dire : Je suis chrétienne ! Après le fouet, les bêtes, la chaise ardente, elle est enfermée dans un filet et livrée aux attaques d'un taureau furieux, qui la secoue longtemps; enfin elle est égorgée, les païens eux-mêmes déclarent qu'ils n'ont jamais vu une femme tant souffrir. »
Toutefois, sous la direction d'Irénée, l'église grecque de Lyon se reconstitua très rapidement. Grâce à l'éloquence et au zèle de son chef, à l'auréole de ses martyrs, elle brilla au IIème siècle par la chrétienté tout entière d'un éclat particulier. « Blandine, dit M. Renan, en croix à l'extrémité de l'amphithéâtre, fut comme un Christ nouveau. La douce et pâle esclave, attachée à son poteau sur ce nouveau calvaire, montra que la servante, quand il s'agit de servir une cause sainte, vaut l'homme libre et le surpasse quelquefois. »
4. Seconde période d'évangélisation . — Ce ne fut cependant pas de Lyon que le christianisme se répandit sur les Gaules. L'église de Lyon était d'origine grecque : l'évangélisation des provinces gallo-romaines fut latine. Durant deux siècles, le groupe lyonnais demeura isolé, sans appui dans le reste du pays, encore entièrement païen. Peut-être son origine orientale a-t-elle nui à la propagation de la foi. Au milieu du IIIème siècle, rapporte la tradition chrétienne, une mission partit de Rome pour convertir les Gaules. C'était, semble-t-il, une mission d'un caractère populaire et en tout cas, franchement romain. L'Église a conservé les noms de ces premiers apôtres : Paul alla à Narbonne, Trophime à Arles, Martial à Limoges, Gatien à Tours, Strémonius en Auvergne, Saturnin à Toulouse, Denis à Paris. Nous ne savons rien, d'ailleurs, ni de leurs efforts ni de leurs succès.
 Sarcophage d'Arles. (La résurrection de la fille de Jaïre).
Sarcophage d'Arles. (La résurrection de la fille de Jaïre).
C'est à Arles et à Narbonne que se fondèrent sans doute les principales églises : villes de commerce, cosmopolites et populeuses, elles se prêtèrent mieux que les autres à la diffusion de la foi nouvelle. Mais, là encore, il ne peut être question que d'églises fort peu nombreuses et recrutées assez bas.
5. Nouvelles persécutions. — Les persécutions de la fin du IIIème siècle, sous les empereurs Décius, Valérien et Maximien, vinrent peut-être compromettre l'œuvre de la mission latine. Presque tous ses chefs, dit la tradition, périrent du dernier supplice, Denis fut, a ce qu'on rapporte, décapité à Paris sur la colline de Montmartre. Mais il est malheureusement permis de douter de plus d'un de ces beaux martyres. La piété et l'imagination des fidèles multiplièrent à leur sujet les récits merveilleux. On avait consigné les détails exacts de leur mort dans des actes écrits; mais l'amour de la vérité ne tarda pas à souffrir, dans la rédaction des Actes des Saints, de l'exaltation des dévots : « Des mains infidèles, disait le pape Gélase, les ont surchargés de détails inutiles ou suspects».
C'est ainsi que se créa, à propos des martyrs du IIIème siècle, toute une épopée du christianisme gaulois : c'est cette époque qui a fourni à notre Église ses légendes les plus étranges et les plus populaires. Denis de Paris, Quentin, le « porte-drapeau de la cohorte de Dieu », Crépin et Crépinien, les deux cordonniers de Soissons, Ferréol de Vienne, Julien de Brioude, Rogatien de Tours, Victor de Marseille, bien d'autres encore, furent les héros favoris de la piété gauloise. Chaque église se donna un fondateur et un patron qui fût saint et martyr, comme les villes anciennes cherchaient pour héros et pour père un guerrier revenu du siège de Troie.
6. La conversion des Gaules au quatrième siècle; saint Martin. — Aucune de ces églises ne nous est connue comme celle de Lyon au IIème siècle; aucune n'eut à beaucoup près son importance. Elles ne se développèrent qu'au IVème siècle, lorsque la persécution prit fin sous le règne de Constance Chlore, et qu'un accord intervint sous Constantin entre le christianisme et l'État. Leurs progrès, d'ailleurs, furent extrêmement lents, même à l'abri de la paix de l'Église. Ce ne fut guère, sans doute, que dans la première moitié de ce siècle que le christianisme put s'élever en Gaule jusqu'aux classes moyennes et qu'il gagna les décurions municipaux. Mais l'aristocratie des sénateurs demeura nettement à l'écart de la religion du Christ.
Il faut descendre jusqu'à la fin du IVème siècle, entre les années 375 et 400, pour constater enfin le triomphe du christianisme dans les Gaules : c'est alors que les vrais maîtres du pays, les sénateurs, les grands propriétaires fonciers, se laissent gagner par lui.
L'homme qui « amena véritablement la Gaule au Christ» fut saint Martin, évêque de Tours de 372 à 397. Pendant vingt-cinq ans, sans relâche, il pria, prêcha, lutta, renversant les idoles, haranguant la foule, imposant aux grands sa parole et son Dieu. Il fonda à Ligugé, en Poitou, le premier monastère de la Gaule. On l'appela, même de son temps, l'«apôtre des Gaules ». Un contemporain s'écriait: «Heureuse la Grèce d'avoir entendu saint Paul; mais Dieu n'a pas abandonné la Gaule , car il lui a donné Martin ». Par sa vie, par sa parole, il exerça sur tous ceux qui l'approchèrent un ascendant qu'on a peine à croire.
Il est difficile de mieux le caractériser que ne l'a fait M, Boissier dans la Fin du Paganisme : « Saint Martin est d'abord un saint un peu démocratique, ce qui n'a jamais nui chez nous. Il est de basse extraction, et ne fait rien pour le dissimuler. Avec les petits, il est doux et familier, mais avec les grands il se relève. Il ne souffre pas que les empereurs eux-mêmes manquent au respect qu'on lui doit.... Martin était un homme de petite science, mais de grand sens; il évitait les excès et savait garder en tout une juste mesure. Sa foi était ardente, mais elle cherchait à être éclairée. Il se méfiait beaucoup des saints douteux, et ne se croyait pas obligé d'accepter sans examen les récits qu'on lui faisait.... Au-dessus de toutes les vertus, Martin mettait la charité. Il était doux et compatissant pour tout le monde. À plus forte raison, ne voulait-il pas qu'on punît de mort les hérétiques. Sa conscience honnête et droite lui disait qu'il avait raison de sauver, même au prix d'une faiblesse, la vie de quelques malheureux. Cette haine des persécutions, cette horreur du sang versé, jointe à cette charité ardente, à cette pitié inépuisable et à ce ferme bon sens, n'est-ce pas là l'idéal d'un saint français? »
II fallait insister sur saint Martin : il a fixé les destinées du christianisme gaulois, il en a été vraiment le créateur. Mais, en outre, il a été l'inspirateur, pendant des siècles, de notre littérature religieuse. Sa vie est le principal épisode de l'épopée de la Gaule chrétienne, comme elle en est par bonheur le morceau le plus historique. Déjà au début du Vème siècle l'Aquitain Sulpice Sévère écrivait : « Qu'on nous parle latin ou gaulois, peu importe! Mais qu'on nous parle de saint Martin ». Il est peu de prêtres lettrés au temps des Mérovingiens, qui n'essayassent d'écrire une vie de l'apôtre ou le récit de ses miracles posthumes. Par les conversions opérées sur son tombeau ou à la lecture de sa Vie, il fut donné à saint Martin de continuer et d'achever son œuvre bien longtemps après sa mort et du fond de sa basilique de Tours, devenue le sanctuaire du christianisme gaulois, il demeura pendant des siècles encore l'apôtre des Gaules.
C'est du vivant de saint Martin que se place la conversion de l'aristocratie gallo-romaine. Toutes les grandes familles du pays acceptèrent, sous les règnes de Gratien el de Théodose, la foi du Christ. Il y eut quelques conversions éclatantes, notamment celle de Paulin, le plus riche propriétaire de 1'Aquilaine, ancien magistrat, un des hommes les plus lettrés de la Gaule : il abandonna ses biens et ses espérances de gloire pour se faire prêtre. A la fin du IVème siècle, grands et petits devenaient également, comme on disait alors, « frères en Christ». Il n'y a plus d'attardés au culte des anciens dieux que les plébéiens des campagnes, des pagi, les pagani, dont on fera plus tard les « païens ».
Il est à remorquer que les dieux qui résistèrent le plus furent les dieux d'origine gauloise. Il y a beau temps, vers l'an 400, que la Mère des dieux n'a plus en Gaule qu'un culte de sympathie. Le Jupiter du Capitole est bien démodé : mais Mercure, cher au Gaulois, tient bon encore. Saint Martin avouait qu'il lui donnait quelque peine; pour Jupiter, il s'en moquait, c'était une « franche bête ». Mercure disparu, il restera encore les Mères et les Fées : celles-là auront la vie dure; chassées de leurs domaines terrestres, elles se réfugieront dans les légendes et les traditions humaines et elles y resteront.
7. L 'organisation de l'Église. — Mais au fur et à mesure que l'Eglise chrétienne se développait, elle se transformait aussi, et peu à peu son organisation prenait modèle sur celle de la société politique dans laquelle les chrétiens trouvaient enfin place. Au IVème siècle, nous ne reconnaîtrions plus dans les églises ces fraternités démocratiques des premiers temps. Il y a une aristocratie de prêtres, un clergé, distinct du commun des fidèles, ou des laïques. Au-dessus de ce clergé il y avait un chef ou surveillant,
l'« évêque ». Dès le premier quart du IVème siècle, il y a un évêque dans un grand nombre de cités gauloises. La structure de l'Église moderne commence alors à se dessiner. « Quand l'empire, dit Fustel de Coulanges, en se faisant chrétien, eut pris la charge de protéger et de surveiller l'Église, son esprit la pénétra si fort, que toute son ancienne constitution en fut altérée. Les principes autoritaires s'introduisirent en elle. Les habitudes administratives l'envahirent. Elle fortifia en elle le gouvernement. Le corps des prêtres ne fut plus un conseil indépendant vis-à-vis de l'évêque. Comme le fonctionnaire impérial, l'évêque n'eut que des sujets. Chaque église fut gouvernée monarchiquement par un prélat. Les métropolitains eurent un droit de surveillance sur les simples évêques, absolument comme dans l'ordre administratif les fonctionnaires de rang supérieur avaient un droit de surveillance sur ceux d'ordre inférieur.... Il arriva donc que, lorsque l'autorité impériale disparut, l'Église chrétienne portait en elle une image des institutions de l'empire et une partie de son esprit. »
Ainsi l'Église chrétienne représentera, pendant tout le moyen âge, les traditions et les règles de cet empire romain qui l'avait si longtemps combattue. Un seul fait servira à le montrer. La Gaule était divisée en cités : chacune d'entre elles forma, au IVème siècle, un diocèse épiscopal ; l'étendue de ce diocèse fut exactement celle de la cité. Or, depuis ce temps jusqu'en 1789, les diocèses de la Gaule , à très peu d'exceptions près, ont conservé les mêmes limites. C'est pour cela que les divisions ecclésiastiques de la France en 1789 sont la copie fort ressemblante de la carte politique de la Gaule au moment de la chute de l'empire.
8. L 'art chrétien. —En même temps que l'Église se mêlait à la vie du monde, elle en acceptait les tendances artistiques et littéraires. On a vu qu'elle ne méprisa ni l'histoire, ni la poésie, ni la rhétorique, et que les meilleurs écrivains chrétiens de la Gaule ont été d'excellents élèves de nos rhéteurs païens.
On a indiqué aussi plus haut quelle place les choses de l'art tenaient dans la vie des Gaulois, et quelle importance la statuaire notamment avait dans les traditions de leurs cultes, le goût des images et des statues était inséparable d'une dévotion bien entendue : c'était comme un besoin religieux. Le christianisme voulut aussi le satisfaire. De bonne heure les catacombes se couvrirent de peintures et l'on décora de sculptures les marbres des tombeaux.
Il ne reste en Gaule aucun fragment important de peintures chrétiennes. En revanche, les tombeaux ornés de bas-reliefs religieux sont une des richesses de notre archéologie nationale. Arles en possède une incomparable galerie. Le plus ancien de ces sarcophages, celui de la Cayolle dans le Var, remonte à l'époque des Antonins.
Les scènes représentées sur ces tombes sont à peu près uniquement empruntées aux traditions et aux légendes de la religion chrétienne. M. Le Blant, l'initiateur et le maître en France de l'archéologie chrétienne, énumère ainsi les principales de ces scènes : «le frappement du rocher, le passage de la mer Rouge, les tables de la Loi , la chute des cailles
dans le désert, David et Goliath ; puis la Nativité , le baptême du Christ, saint Pierre recevant les clefs célestes, le Seigneur lui lavant les pieds, lui prédisant la renonciation; la montagne aux quatre fleuves, avec le Christ qui la domine, les cerfs qui s'y abreuvent, le martyre de saint Paul, la résurrection symbolisée par la croix s'élevant triomphante au-dessus des soldats endormis ».
 Castor et Pollux sur un sarcophage chrétien d'Arles.
Castor et Pollux sur un sarcophage chrétien d'Arles.
A côté de scènes bibliques, les ornements abondent sur ces sarcophages. Toutefois il est douteux qu'il ne faille voir en eux que de simples motifs de décoration. La plupart de ces ornements, tous peut-être, avaient dans l'esprit des chrétiens un sens mystérieux : c'étaient les symboles secrets des croyances qui leur étaient chères. Les rinceaux et les feuilles de lierre, l'arbuste toujours vert, rappellent l'éternité de Dieu ou l'immortalité de l'âme. Les palmes et les couronnes sont les récompenses des martyrs. Le poisson est la figure du Christ : le mot grec qui signifie poisson, est formé des initiales des noms de Jésus. La vigne fait allusion à la parole du Seigneur à ses disciples : « Je suis le cep et vous en êtes les sarments ». Les oiseaux voltigeant dans les branches sont une image du paradis. Toutes ces représentations sont comme la mise en scène de ces métaphores et de ces comparaisons chères à la littérature chrétienne des temps primitifs.
Toutefois, il serait abusif de parler, au moins avant le VIème siècle, d'un art chrétien. Les artistes qui ont sculpté ces tombes manquent aussi complètement d'originalité, d'imagination, d'esprit créateur que les artistes qui ont figuré les Mercures et les Sylvains gaulois. Ce sont d'ailleurs les mêmes procédés d'école. Les Gaulois ont copié et adapté à leur religion les types et les symboles de la statuaire religieuse gréco-romaine. Les chrétiens ont fait de même. Ils ont pris parmi les scènes ou les images des ateliers païens celles qu'ils pouvaient le plus aisément appliquer à leurs croyances, et ils les ont servilement copiées. Les motifs qui décorent les tombeaux sont parfois très antiques
« ils appartiennent en propre, dit M. Le Blant, à l'imagerie païenne » : le christianisme n'y a ajouté qu'une chose, le sens mystérieux qu'il leur a donné. Orphée attirant les animaux par les sons de sa lyre est devenu le portrait du Bon Pasteur; Prométhée modelant le corps de l'homme représente le Seigneur dans son œuvre de création; l'image d'Icare ailé figure l'âme du chrétien volant vers le ciel; la roue à six branches du Jupiter gaulois se transforme en monogramme du Christ.
 Les Apôtres. (Sarcophage d'Arles)
Les Apôtres. (Sarcophage d'Arles)
CHAPITRE XIX
LA VIE PRIVÉE
1 . La vie conjugale . — Ce qu'il est le plus malaisé de connaître chez les anciens Gaulois, c'est le détail de leur vie intime, leur existence familiale, leurs mœurs privées. Nous n'avons jour sur leur intérieur que par quelques poésies du bas-empire et les inscriptions funéraires. Or les unes et les autres sont suspectes d'exagération : il n'y a rien de menteur comme une poésie de famille, si ce n'est une épitaphe.
Toutefois, si mensongères que soient les épitaphes, elles nous apprennent au moins quelles sont les qualités que l'on estimait le plus. Dans la vie conjugale, le plus bel éloge que méritaient les époux était la fidélité dans l'affection. Même sur les inscriptions, on a su trouver des expressions simples et touchantes. Celle-ci a été une épouse « très aimante, pudique, un bien précieux entre tous »,amantissima, pudica, omnium rerum pretiosissima. Les inscriptions de Lyon ont à cet égard un charme tout particulier : l'amour conjugal s'y montre sous la forme d'une douce et aimable poésie. « Elle a vécu sans tache, est-il dit d'une jeune femme de vingt-quatre ans, pure de cœur, heureuse encore de mourir la première. » Une femme loue son mari d'avoir été « son nourricier par son travail, son père par son amour pieux, son patron par ses bienfaits ». Pour n'être pas mélancolique, cet éloge a bien son prix : « Toi, lecteur de ces lignes, va aux bains d'Apollon, ainsi que souvent je l'ai fait avec ma femme, et voudrais bien le faire encore ». Voici une agréable épitaphe : « Aux dieux mânes et à la mémoire de Septicia Gemina, femme très vertueuse et qui n'a connu que son mari, sanctissimae, uniusque maritae : Lucius Modius Annianus à son épouse très chère et bien aimante qui a vécu en mariage avec lui pendant trente ans ». Et l'épitaphe est accompagnée de ces paroles, que la morte est censée adresser à son mari du fond de la tombe : « Ami, amuse-toi, réjouis-toi, puis viens » : amice, lude, jocare, veni. On peut rapprocher de ces épitaphes la poésie qu'Ausone adresse à sa femme, poésie qui respire la même gaîté conjugale : « Ma femme lisait dans mes vers les noms des Laïs et des Glycères, noms fort entachés de légèreté, elle m'a dit que je m'amusais et que je me divertissais à des amours imaginaires, tant elle a de confiance dans ma vertu ».
2. La femme. — C'est un lieu commun de plaindre le triste sort que l'antiquité faisait à la femme. Le Droit la traitait, sans doute comme une personne toujours en tutelle,
 Enfant dans un berceau (1)
Enfant dans un berceau (1)
1. Sculpture trouvée aux sources de la Seine. Le chien est endormi au pied du berceau. Le chien était le gardien du foyer, le symbole vivant de la piété et de la fidélité familiale.
mais, en fait, elle apparaît, surtout en Gaule, comme l'égale de son mari et la maîtresse respectée de la maison : matrona honestissima, disent les épitaphes; proba, fidelis, et surtout pudica, voilà les éloges qu'elles accordent aux femmes. Qui donc a dit que la femme antique ignorait la pudeur? Jamais vertu féminine n'a été au contraire en ce temps-là plus gardée et plus estimée.
D'ailleurs il n'est peut-être pas de nation, dans l'antiquité, où la femme ait reçu plus d'égards que chez les Gaulois. Jules César rapporte que la communauté des biens était admise entre époux. « Autant le mari recevait de sa femme, à titre de dot, autant il déposait de son propre avoir : le tout appartenait au survivant. » La femme faisait elle-même l'éducation de ses enfants jusqu'au moment où ils étaient en âge de porter les armes. Dans certains États, les femmes prenaient part aux délibérations publiques, ce qui devait paraître une chose inouïe aux Grecs et aux Romains; on dit même qu'Annibal, traversant le sud de la Gaule , dut soumettre ses contestations avec les indigènes à un tribunal de femmes.
La domination romaine renferma davantage dans sa famille la femme gauloise; mais elle tint toujours la première place dans sa maison par sa fidélité, sa grâce et sa beauté. Les Grecs et les Latins ont également vanté la grâce et la beauté des femmes gauloises, célèbres par l'élégance de leur taille el la blancheur de leur teint. Quant à la fidélité conjugale, n'est-ce pas une femme de la Gaule romaine qui en a donné le modèle au monde antique ? On connaît la touchante histoire d'Éponine, vivant neuf années dans un souterrain avec son mari proscrit. « Seule, dit Plutarque, comme la lionne au fond de sa tanière, elle supporta les douleurs de l'enfantement et nourrit ses deux lionceaux. » Découverte par les agents du prince, conduite devant l'empereur Vespasien, elle lui montra ses enfants : « Je les ai conçus et allaités dans les tombeaux afin que plus de suppliants vinssent embrasser tes genoux ». Elle demanda la grâce de mourir avec son mari, pour que leurs deux destinées, si longtemps communes, ne fussent point séparées au moment suprême.
Tout près de l'héroïne, il faut placer la simple femme de ménage, paisible, active, accomplissant gaiement sa tâche de chaque jour. C'est Ausone qui nous en fait souvent le portrait : « Toutes les vertus de l'épouse digne et pudique, tu les a eues, dit-il à sa mère : la foi conjugale, le soin d'élever tes enfants, les mains actives à travailler la laine, le culte de la chasteté, une gravité mêlée d'enjouement, un sérieux adouci par le sourire ». Celle-là, dit-il d'une de ses parentes, n'eut qu'un défaut : « Elle ne sut point pardonner les fautes : elle faisait plier tout le monde à la règle, elle-même comme les siens ». Mais d'ordinaire on aimait chez les femmes gauloises une vertu plus souriante; « enjouée, pudique et sérieuse », laeta, pudica, gravis, voilà le plus bel éloge qu'on lui décernait et qu'elle a su mériter.
3. La piété familiale. — Les liens qui unissaient entre eux les différents membres de la famille étaient beaucoup plus forts que de nos jours. On avait une expression pour caractériser l'affection des parents entre eux, c'était la « piété » ,pietas :pius,pius in suos,« pieux envers les siens», ces deux expressions reviennent constamment sur les épitaphes gallo-romaines. Pictas, c'est un amour fait plus encore de religion que de tendresse : nous sommes, du moins en Gaule, dans un temps où la religion familiale a encore toute sa vigueur et tout son charme primitifs, qu'elle a déjà perdus chez les peuples plus vieillis de Grèce et d'Italie. Les touchantes paroles de Cicéron en songeant au foyer paternel sont demeurées longtemps vraies chez les Gaulois : « Ici est ma religion, ici est ma race, ici les traces de mes pères; je ne sais quel charme je trouve ici qui pénètre mon cœur et mes sens ».
Cette piété s'étendait aux morts comme aux vivants. On connaît les traditions du culte familial dans le monde d'autrefois. Fustel de Coulanges les a rappelées dans la Cité antique : « Hors de la maison, tout près, dans le champ voisin, il y a un tombeau. C'est la seconde demeure de la famille. Là reposent en commun plusieurs générations d'ancêtres ; la mort ne les a pas séparés. Ils restent groupés dans cette seconde existence, et continuent à former une famille indissoluble. Entre la partie vivante et la partie morte de la famille, il n'y a que cette distance de quelques pas qui sépare la maison du tombeau. » Le culte des morts a été aussi intense et plus durable dans la Gaule romaine que dans les cités du monde classique : les inscriptions funéraires suffisent à le montrer; elles sont comme les perpétuels échos des croyances et les meilleurs exemples des règles si admirablement exposées dans la Cité antique. C'est ce livre à la main qu'il faudrait commenter les recueils des inscriptions gallo-romaines.
Le premier devoir à rendre au parent défunt est de lui élever un tombeau. Le désir de la sépulture est la grande préoccupation morale du Gaulois. Beaucoup se sont fait construire leur tombe de leur vivant, vivus sibi , et cette tombe est destinée souvent à réunir les époux et leur descendance, vivus sibi et conjugi liberisque et posteris eorurn. Un habitant de la Narbonnaise , sans doute un peu misanthrope, déclare qu'« il s'est de son vivant bâti une demeure éternelle, pour n'avoir pas à prier son héritier de le faire », domum œternam vivus sibi curavit, ne heredem rogaret . Il était défendu de vendre le sol sur lequel reposait le corps de l'ancêtre. Aussi bien des épitaphes rappellent-elles cette vieille prescription du droit familial : « Je t'en prie, lit-on sur un tombeau, par les dieux du ciel et par les dieux d'en bas, par la fidélité que tu me dois, veille à ce que ce lieu soit toujours sur et toujours bien protégé ». Le tombeau était un lieu sacré : diis manibus sacrum; il appartenait au défunt, comme le temple appartenait au dieu.
4. L 'humanité. — Le culte de la famille, qui avait été le lien des sociétés antiques, apparaît ainsi nettement à chaque ligne de nos épitaphes gallo-romaines. Ce que l'on y voit moins, c'est l'amour du prochain, c'est cette humanité ou cette charité dont la philosophie et le christianisme devaient faire la grande vertu de l'homme. Nous la trouverons inscrite sur les tombes chrétiennes; amatus ab omnibus, amans pauperum, voilà des épitaphes de fidèles de l'Évangile : l'amour pour les pauvres, la piété envers tout le monde, voilà l'éloge qui va remplacer sur les marbres chrétiens cette « piété envers les siens » qui est le mérite consacré de la vertu païenne.
Il ne serait pas impossible de trouver, sur quelques inscriptions de Lyon, les premiers vestiges de ce culte de la charité, Celle-là « a vécu sans nuire à personne », sine ullius animi lœsione, celui-ci a été un homme « très probe », probissimus. Toutefois, il n'est pas bien sûr que ces éloges ne correspondent pas à certaines conceptions de la vertu familiale ou du devoir politique. Mais au IVème siècle la charité se montre enfin à nous, avec toute sa pureté, même dans la société païenne de la Gaule ; Ausone fait de son père, qui était médecin, cet éloge qu'admettraient les épitaphes chrétiennes : « A ceux qui lui demandaient le secours de son art, il l'accorda sans le vendre; et aux services rendus, il ajouta toujours l'amour pour le prochain », officium cum pietate fuit. Cette fois, la « piété » s'étend au delà du cercle restreint de la famille.
5. L 'amitié. — La seule affection en dehors de la famille dont les inscriptions fassent souvent mention est l'amitié. On sait la grande place que les anciens ont faite à ce sentiment, même à côté de la piété familiale, et les beaux écrits que l'éloge de l'amitié a inspirés à Platon et à Cicéron. C'était un sentiment naturel à la société antique, et qui prenait rang entre le culte des parents et celui de la cité. Il ne ressemblait pas tout à fait à ce que nous appelons aujourd'hui de ce nom; comme le patriotisme, comme l'amour de la famille, l'amitié était un lien religieux autant qu'humain. Elle comportait l'affection, la bienveillance, mais aussi une sorte de «communauté dans les choses divines», omnium divinarum humanarumque rerum consensio, dit Cicéron. Aussi le titre d' « ami » n'a jamais rien de banal dans les inscriptions romaines : c'est un titre qui engage et qui oblige, comme celui de parens ou comme celui de civis.
Les épitaphes de la Gaule nous montrent que l'amitié a été aussi cultivée dans notre pays et qu'elle a eu le même caractère qu'à Rome et que dans l'ancienne Grèce. Beaucoup de tombes ont été élevées à des amis « incomparables » par d' « inconsolables » amis: amicus, amica, c'est ce qui revient le plus souvent après conjux, pater ou filius. Une épithète chère aux amis était celle de dulcis : Hic conviva fuit dulcis, « ce fut un doux convive », dit une épitaphe rédigée par des amis. Dulcis, c'est la principale qualité que Cicéron demande à l'ami; c'est l'éloge essentiel que nos inscriptions lui accordent : être « doux », c'était être à la fois agréable et bon. On était « doux» pour son ami comme on était « pieux » envers les siens.
6. Les esclaves. — On voudrait savoir quel a été le sort des esclaves dans la famille gauloise. La législation était terriblement dure pour eux, puisqu'elle les mettait à la discrétion du maître. Il est possible que la loi ait été parfois appliquée en Gaule dans toute sa rigueur : il y aura fréquemment dans le pays, au temps des invasions, des révoltes d'esclaves, et l'on verra un professeur de Bordeaux mis à mort par ses serviteurs. Mais il est certain aussi que le droit a été corrigé par les mœurs, et que les rapports entre maîtres et esclaves ont été souvent courtois et humains. Les inscriptions nous montrent très fréquemment des tombes élevées par un esclave à son maître, par un maître à son esclave. Le maître était dit « excellent », optimus, par ses serviteurs, et il leur décernait les mêmes épithètes de « doux » et de « pieux » qu'il accordait aux membres de sa famille : l'épigraphie gallo-romaine nous rappelle ainsi la place que l'esclave occupait encore dans la famille. C'était une esclave que Blandine, la célèbre martyre de Lyon; elle souffrit à côté d'hommes libres, et son mérite ne fut pas moins touchant: il est vrai qu'elle était chrétienne. Mais des inscriptions païennes, en Gaule même, montrent assez souvent des esclaves associés à des hommes libres dans des confréries religieuses. Bien des esclaves, affranchis par leurs maîtres, ont été faits leurs héritiers et prennent ce titre sur la dédicace des monuments qu'ils dressent à leurs patrons et bienfaiteurs. Enfin il n'est pas très rare de voir un maître épouser son esclave après l'avoir affranchie, et lui donner le titre d'épouse sur la tombe qu'il lui élève : libertae et conjugi pientissimae.
7 . Valeur morale de la société gallo-romaine. — Nous ne conclurons pas de tout cela à la perfection morale de nos ancêtres. Mais au moins pouvons-nous dire que, autant que nous les connaissons, ils ne furent ni meilleurs ni pires que nous ne le sommes : il y avait dans la société de la Gaule romaine le même degré de vertu et de vice que dans la nôtre. Il faut citer tout au long à ce propos les éloquentes paroles avec lesquelles Fustel de Coulanges caractérise la société gauloise à la fin de l'empire : «Essayons de nous représenter ici l'homme riche tout occupé de ses vers et de ses harangues, là le professeur de philosophie attirant la foule pour lui démontrer la spiritualité de l'âme, ailleurs le prêtre chrétien enseignant les dogmes de la religion et les lois de la morale ; ayons en même temps sous les yeux ces villes couvertes de monuments, ces temples et ces basiliques que chaque génération construit, ces villas somptueuses que décrit Sidoine Apollinaire, ces moissons dont Salvien lui-même vante la richesse ; calculons ensuite ce que tout cela suppose de labeur quotidien, et demandons-nous si tout ce travail de l'esprit, de l'âme ou des bras serait compatible avec une absolue dépravation des mœurs....
 Tombeau de famille (Au musée de Bordeaux- Le père de famille tient l' arca ou coffre fort, la petite fille une grappe de raisin).
Tombeau de famille (Au musée de Bordeaux- Le père de famille tient l' arca ou coffre fort, la petite fille une grappe de raisin).
« On ne saurait exiger de l'histoire un jugement formel sur la valeur morale des différents peuples. Au moins y a-t-il grande apparence qu'à l'époque dont nous parlons, la société de l'empire romain, si imparfaite qu'elle lut, était encore ce qu'il y avait de plus régulier, de plus intelligent, de plus noble dans le genre humain. »
CHAPITRE XX
A TRAVERS LA NARBONNAISE
1. Aspect général de la Gaule Narbonnaise. — C'est vers l'an 150 de notre ère que la Gaule arriva à l'apogée de la richesse et du bien-être. En ce temps-là régnait l'empereur Antonin, qui appartenait à une famille de la Gaule Nar bonnaise. Jamais peut-être notre pays ne fut plus heureux et plus calme que du vivant de ce prince, le seul sous lequel le beau mot de « paix romaine » n'ait pas cessé un jour d'être une stricte vérité.
Les Romains d'alors aimaient à voyager dans leur empire. A l'exemple de l'empereur Hadrien, ils avaient la curiosité des pays si divers dont leurs ancêtres avaient fait un seul État. Parcourons à ce moment, comme tant d'eux le firent, les provinces et les villes de la Gaule , et cherchons ce qui attirait surtout les regards des touristes italiens.
C'est par la Gaule Narbonnaise que le voyage commençait. On pouvait y arriver par terre et par mer. Par terre, on suivait la voie Aurélienne : comme aujourd'hui la route de la Corniche , la voie dominait le rivage de la mer Méditerranée; elle passait au pied du célèbre trophée élevé par Auguste en souvenir de ses victoires sur les peuplades alpestres; elle desservait Monaco, Nice, Antibes. Ces villes étaient déjà les rendez-vous d'une villégiature élégante, mais à coup sur moins fastueuse et moins bruyante que de nos jours. Les voyageurs qui ne craignaient pas le mal de mer pouvaient se faire débarquer dans un des trois grands ports de la Méditer ranée gauloise : Fréjus, Marseille et Narbonne.
Mais de quelque manière qu'un Italien entrât en Narbonnaise, il était surpris et séduit par le pays. L'éclat bleu du ciel et de la mer, ces clairs paysages où le gris de l'olivier se mêle aux tons ardoisés des montagnes et à la verdure des vignes, la limpidité des horizons, lui rappelaient les beautés campaniennes du golfe de Cumes ou les grâces attiques de la baie de Salamine. En même temps, la culture soignée du sol, l'élégance des mœurs, la haute dignité des habitants, l'abondance des richesses, lui faisaient songer aux colonies historiques du vieux Latium : de toutes les régions de l'empire, il n'y en avait aucune qui ressemblât davantage à l'Italie. C'était maintenant comme un prolongement de Rome; on disait volontiers, en parlant de la Narbonnaise , la « Province » par excellence : de là viendra le nom de Provence. Aujourd'hui encore il n'y a dans le monde aucun pays qui par ses ruines et ses mœurs soit un plus vivant souvenir de la domination romaine.
2. Fréjus. — De ces trois grands ports, Fréjus, Marseille et Narbonne, Fréjus était le port militaire. Il en faut toujours un sur ces rivages : nous avons Toulon ; les Romains avaient Fréjus. Le port avait été creusé artificiellement, bien à l'abri, à quelque distance du rivage : il était l'œuvre de César et d'Auguste. C'était une station stratégique de premier ordre, la voie Aurélienne y quittait le rivage pour pénétrer par la vallée de l'Argens dans l'intérieur de la Provence. C'était aussi la clef de la Gaule sur
la Méditerranée. Les premiers empereurs l'avaient entouré d'un système de remparts fort intelligemment : on peut encore maintenant les suivre et les étudier dans les moindres détails de leur construction. Fréjus était abondamment pourvu de greniers et d'arsenaux : c'était une ville forte par excellence. Ajoutez à cela des arènes, un théâtre et surtout un long aqueduc dont les ruines colossales et déchiquetées ressemblent étrangement aux interminables arceaux de la campagne romaine.
Au IIème siècle, dans ce temps de paix profonde, Fréjus n'avait déjà plus l'importance que lui avaient assignée ses fondateurs. La flotte qui y stationnait depuis Auguste est sur le point de quitter le port, les remparts ne sont plus entretenus. La décadence commence pour la cité. Elle ne s'arrêtera plus. L'histoire de Fréjus est presque tout entière dans sa naissance et sa formation. Aujourd'hui, la paisible bourgade, cinq ou six fois plus petite que la colonie romaine semble dormir dans un coin des vieux remparts déserts, au milieu des débris qui l'encombrent. Il n'y a pas en France une ruine de cité aussi complète et qui rappelle de plus près les villes mortes d'Herculanum et de Pompéi.
 |
 |
La porte d'or à Fréjus. Ruines de l'amphithéâtre de Fréjus.
3. Marseille. — Marseille était aussi, vers l'an 150, en pleine décadence. Comme au temps de Pythéas, elle occupait toujours la colline escarpée et la vaste plate-forme qui dominaient son fameux port de Lacydon et qui l'abritaient si bien contre les vents du nord. Mais, depuis qu'elle avait été prise par César, son développement s'était arrêté. Elle n'avait plus de commerce, plus de vaisseaux, plus de domaines. Son territoire finissait à moins de 8 milles du rivage. De ses colonies, on ne lui avait laissé que Nice et les îles Stéchades, les îles d'Hyères aujourd'hui. Il ne lui restait plus que le vain nom de « ville libre ».
Mais les Marseillais, gens pratiques, ne s'étaient point laissé abattre. Ils avaient travaillé d'une autre manière. Ils avaient remplacé l'amour du lucre par celui des arts : l'ancienne métropole commerciale de la Gaule était devenue une ville intellectuelle et laborieuse. Ce fut pour elle une nouvelle façon de s'enrichir. Les étudiants et les professeurs y accouraient : c'était une cité d'études. On y enseignait la médecine, la rhétorique, la philosophie. On y rendait un culte à Homère; des hommes savants en donnaient à Marseille une édition célèbre. Comme les mœurs y passaient pour fort pures, les grandes familles de Rome y envoyaient leurs enfants, plus volontiers même qu'à Athènes. C'était la véritable Université grecque de l'Occident. Je ne parle pas de ses figues et de ses olives, que les Romains estimaient fort.
4. Narbonne . — Tout le commerce de Marseille était passé à la vieille colonie romaine de Narbonne : après avoir été le rempart de la domination romaine en face du monde gaulois, elle était devenue le centre du trafic de la Méditerranée occidentale; ses nombreux ports offraient de vastes abris aux vaisseaux marchands. Narbonne fut, au I er siècle du moins, la plus grande ville de la province à laquelle elle donnait son nom. Elle était, avec Lyon, la ville la plus populeuse de la Gaule entière, et elle mérita de Martial l'épithète de « belle entre toutes », pulcherrima. Elle n'a laissé sans doute aucune grande ruine de son temps de splendeur; mais ses innombrables inscriptions sont encore le témoignage de l'étonnante activité de ses habitants sous le règne des premiers empereurs. Les gens de métiers y abondaient. C'était peut-être, de toutes les cités de la Gaule , celle où la plèbe était la plus forte, où il y avait le plus d'affranchis, d'ouvriers, de petites gens.
Au milieu du IIème siècle, Narbonne était moins prospère. Un incendie venait de la détruire, et le commerce d'Arles lui faisait une terrible concurrence. Il est à remarquer en effet qu'à partir du IIème siècle, la richesse et la faveur vont plus volontiers, dans la Gaule Narbonnaise , aux villes éloignées du littoral. Narbonne, Marseille et Fréjus, les villes maritimes, ont fait leur temps.
Narbonne du moins se relèvera dans les derniers temps de l'empire et retrouvera son ancienne animation. Elle redeviendra « Narbonne la puissante ». Ausone lui fera une place parmi les « villes célèbres » de la Gaule ; c'était toujours alors une ville de négoce : les étrangers et les marchandises affluaient dans ses ports. « Les mers de l'Espagne et de l'Orient l'enrichissent, disait le poète bordelais, les flottes d'Afrique et de Sicile te visitent; tes rues sont pleines d'une multitude à l'aspect bariolé. » C'était sans doute le spectacle qu'elle avait déjà offert sous le haut empire.
5. De Toulouse à Nîmes. — De Narbonne on pouvait gagner Carcassonne, Toulouse et l'Aquitaine par la vallée de l'Aude aux terres fécondes. Carcassonne possédait le titre de colonie. Toulouse avait été de bonne heure connue et fréquentée des Romains; elle avait son Capitole et ses rhéteurs; c'était déjà une ville fort lettrée, la « cité de Pallas », avait dit Martial et elle méritera ce surnom jusqu'aux derniers moments de l'empire : Toulouse est une des villes de la Gaule qui ont le moins changé dans leurs penchants et dans leurs traditions.
Mais l'attention du voyageur était plus facilement attirée vers l'Est. Il trouvait là une admirable plaine, qui allait s'étendant des bords de l'Aude à ceux du Rhône, plaine trop fouettée peut-être par les vents du nord, mais merveilleusement cultivée, riche en vignes et en oliviers, couverte de villages et de villes, et dominée par les colonies populeuses et gaies d'Arles et de Nîmes.
 Statue trouvée à Martre, près de Toulouse.
Statue trouvée à Martre, près de Toulouse.
De Narbonne à Nîmes et à Arles, on suivait la voie Domitienne. On s'arrêtait peu dans la colonie de Béziers. Solidement bâtie par César et Auguste sur un vaste rocher qui dominait la vallée de l'Orb, elle occupait une excellente situation militaire. Comme Fréjus, dont elle était contemporaine, elle avait été une forteresse de premier ordre; mais, comme Fréjus encore, elle se trouvait un peu oubliée et démodée dans cette époque pacifique des Antonins.
Ce temps était en revanche celui de la splendeur de la colonie nîmoise.
6. Nîmes . — Nîmes avait la gloire d'avoir donné le jour à la famille de l'empereur régnant, Antonin. Comme Rome, elle était la « ville aux sept collines ». Aujourd'hui encore il n'y a pas au monde, Rome exceptée, une ville aussi romaine. Nulle cité de la Narbonnaise n'avait des monuments d'une perfection aussi surprenante, d'une grâce aussi captivante. C'était, partout, l'art de la Grèce joint à la solidité latine. La Maison Carrée , temple dédié aux Princes de la Jeunesse , fils adoptifs d'Auguste, était, par sa délicatesse, la merveille de l'architecture gréco-romaine. Hadrien y éleva, en l'honneur de Plotine, une basilique qui passait, à Rome même, pour le chef-d'oeuvre de l'art. Au IIème siècle, on achevait les arènes : plus heureuses que la basilique de Plotine, elles sont maintenant fièrement debout
 Intérieur des arènes de Nîmes.
Intérieur des arènes de Nîmes.
et comme autrefois, toujours vivantes et bruyantes aux jours de fêtes : ces jours là quelque chose de la vie romaine renaît dans le vieil amphithéâtre. Nîmes a gardé ses anciens thermes, son château d'eau, sa fontaine aussi populaire et aussi bienfaisante qu'au temps où elle était protégée par le dieu Nemausus : près de la source s'élève le temple de Diane, qui est peut-être le sanctuaire même du dieu de la fontaine, sur la colline d'où elle s'échappe, se dresse la mystérieuse Tourmagne, sans doute le gigantesque mausolée de quelque riche Nîmois. Et que de ruines de moins grande allure, nous rencontrons à chaque pas !
 Le temple de Diane, à Nîmes.
Le temple de Diane, à Nîmes.
Il n'est point de fouille qui ne ramène au sol d'admirables débris, tombeaux, sculptures et mosaïques.
Comme toutes les villes du monde ancien, Nîmes était admirablement pourvue d'eau. Elle qui se mourait de soif il y a quelques années à peine, devait être, à l'époque romaine, la ville la mieux arrosée, la plus fraîche, de la Gaule du Midi. Elle avait d'abord sa Fontaine, plus abondante et plus pure qu'elle n'est de nos jours. Puis, un large aqueduc lui amenait les eaux des sources de l'Eure et de l'Airan près d'Uzès. Cet aqueduc, nous pouvons le suivre aujourd'hui sur presque tout son parcours; il nous intéressera plus que celui de Fréjus. Ce dernier est un peu monotone avec ses arcades toujours les mêmes. L'aqueduc nîmois nous offre des surprises incessantes, et surtout une œuvre d'art incomparable, le Pont du Gard. On nomme ainsi la partie de l'aqueduc qui traverse la vallée du Gardon; ce sont trois étages d'arcades lancés au-dessus de la rivière, et venant s'appuyer des deux côtés à de hautes collines, le troisième étage porte la cuvette de l'aqueduc, assez haute, assez intacte pour permettre aux promeneurs d'y circuler librement. Il n'y a pas dans le monde romain un monument dont la vue surprenne et trouble au même degré : on l'aperçoit brusquement, au détour de la route, élégant et majestueux, encadré par le ciel, encadrant de ses arceaux le gracieux paysage du torrent et des collines.
Nîmes était déjà au II ème siècle peuplée de travailleurs, industriels, artisans, négociants. Mais ce qui paraît lui avoir donné sa physionomie propre, c'est qu'elle était une ville d'une rare dévotion. Elle avait un culte passionné pour sa Fontaine, le deus Nemausus, culte qu'elle n'a pas tout à fait perdu. De toutes les colonies de la Narbonnaise , c'est Nîmes qui conservait le plus les traditions superstitieuses des anciens Gaulois. Elle y joignait les souvenirs de l'Egypte, patrie de quelques-uns de ses ancêtres. Elle adorait avec ferveur Isis. C'était une ville religieuse et artistique, et elle l'est restée jusqu'à nos jours.
7. Arles. — A quelques milles de là, de l'autre côté du Rhône, s'élevait la glorieuse colonie d'Arles. Elle était la rivale en influence de la ville d'Antonin; et, de nos jours, il n'y a chez nous que les ruines d'Arles qui peuvent se comparer à celles de Nîmes. Ses arènes ont la même majesté que les arènes nîmoises, mais elles sont leurs aînées d'un siècle; elle a son théâtre, si curieux a étudier, et qui a fourni à son musée de si jolies choses; les remparts de César n'ont pas encore tout entiers disparus et le sol de la vieille colonie est fécond en débris précieux.
 L'amphithéâtre d'Arles.
L'amphithéâtre d'Arles.
Mais elle n'offre pas de ces élégantes constructions qui font le charme de la cité nîmoise. C'est qu'Arles était peut-être avant tout une ville de commerce. Depuis le commencement du II ème siècle, elle éclipsait de sa concurrence l'antique Narbonne. C'était, au temps des Antonins, le véritable entrepôt de tout le Midi. Elle possédait d'importants chantiers de constructions. Ses bateliers formaient cinq grandes corporations et sillonnaient de leurs barques la Durance et le Rhône. Il y avait à Arles une aristocratie de négociants, fortement syndiqués, qui concentraient entre leurs mains, par un habile monopole, les transports et les transits dans la florissante région de la Gaule rhodanienne. C'était une ville d'armateurs. Comme toutes les villes de grand commerce, ses habitants étaient fort adonnés au luxe et au plaisir. Ce qui reste d'Arles, les arènes et le théâtre, caractérise bien sa vie d'autrefois. Elle avait des gladiateurs, des comédiens, des factions même, tout comme la capitale de l'empire romain.
Le II ème siècle n'est d'ailleurs pour Arles que le commencement d'une prospérité qui ne fera que grandir. Arles a eu, seule en Gaule, ce rare bonheur de croître et de s'enrichir sans cesse : il n'y a eu dans sa vie ni de ces temps d'arrêt ou de recul, que nous constatons à Trêves, Bordeaux et Narbonne, ni de ces subits effondrements comme à Fréjus, Nîmes ou Lyon. Elle a été, on peut le dire, dans la Gaule romaine, la « ville heureuse » par excellence. Au IV ème siècle, elle deviendra la cité la plus riche et la plus commerçante de l'Occident : « Les richesses du monde y affluent » disait un écrivain contemporain et les empereurs eux-mêmes en parlaient avec admiration. Ils l'affectionnaient et y séjournaient aussi volontiers qu'à Trèves. Ausone l'appellera la « Rome des Gaules ». Constantin en fera son séjour préféré, lui donnera son nom, y construira un palais. Depuis l'an 200, Arles est la capitale du Midi ; c'est là que réuniront les délégués de toutes les provinces d'entre Loire et Pyrénées. Viennent les derniers jours de l'empire en Gaule : sa gloire grandit encore. L'empereur Honorius lui décernera le litre de « mère de toutes les Gaules », mater omnium Galliarum. Elle est le centre de la résistance aux barbares, la forteresse avancée de l'Italie, et les derniers empereurs romains mériteront le titre que la tradition provençale leur a donné de « rois d'Arles ».
8. Le pays arlésien . — Arles avait encore ceci de particulier parmi les villes du Midi : de toutes, elle avait le territoire le plus étendu et le plus riche. Elle possédait les deux tiers de la Provence actuelle; ses domaines n'étaient limités que par le Rhône, la Durance , la mer, et allaient rejoindre, dans les monts des Maures, ceux de Fréjus; ils enserraient de tous côtés les petites enclaves formées par les territoires d'Aix et de Marseille. Tout ce vaste pays, d'ailleurs, n'était autre que l'ancien domaine de Marseille : Jules César l'avait donné n Arles, sa colonie préférée. Aix, ville paisible et sage, résidence de grandes familles bourgeoises, n'était en réalité que la cliente de sa puissante voisine.
Dans tout ce pays s'étendaient les villas de l'aristocratie arlésienne : ça et là on remarquait des groupes assez importants de petites propriétés, car la propriété était dès lors plus morcelée dans le Midi que dans le reste de la Gaule. De loin en loin s'élevaient de grosses bourgades, dont de riches patrons arlésiens faisaient la gloire et la splendeur, où ils aimaient à vivre et à bâtir. N'y avait-il pas une villa romaine aux Saintes-Maries ? Ce qui donne un singulier démenti à ceux qui prétendent que cette rive de la Camargue a été tout récemment formée par les alluvions du Rhône.
En dehors du pays d'Arles, on ne trouverait certainement pas en Gaule une région qui fournisse en plus grand nombre et dans des endroits plus déserts d'aussi beaux vestiges du passé. Près de Saint-Chamas, le ruisseau de la Touloubre passe encore sous un pont du temps d'Auguste, orné à ses deux extrémités d'arches monumentales. A Vernègues, dans un pays perdu, on admire encore un temple, la « Maison Basse », qui devait être aussi parfait de formes que les temples de Nîmes et de Vienne. Enfin à Saint-Remy s'élèvent côte à côte, sur le même plateau, un arc triomphal et le colossal mausolée des Jules. Ce dernier est le monument le mieux conservé qui reste de l'empire romain : ses bas-reliefs, ses statues, son inscription, tout est encore intact, et le mausolée se dresse sur les dernières pentes des Alpines, à l'entrée de la route qui les traverse, aussi solide que les rochers qui le dominent.
Chose à noter : tous ces monuments du territoire d'Arles remontent aux premières années de l'empire; ce qui montre avec quelle énergie et quel succès les riches colons arlésiens se sont mis dès la première heure à travailler et à s'enrichir.
9. Les colonies de Vaucluse. — Remontons la vallée du Rhône, dont Arles est la vraie reine. Les villes y sont moins grandes et moins célèbres, mais plus nombreuses que sur les rivages de la Méditerranée ; et le pays, avec ses oliviers, ses vignes, ses prairies, ses vergers et ses admirables jardins maraîchers, est la région la mieux cultivée de tout le Midi.
Voici, au delà de la Durance , les cinq cités agricoles d'Avignon, Apt, Carpentras, Cavaillon, Orange, les unes adossées aux pentes du Ventoux et du Luberon, les autres mollement étendues dans la plaine des bords du Rhône. Toutes ont conservé quelque chose de leur passé romain, qui fut si brillant au début du I er siècle. Il est intéressant de remarquer que ces ruines ont toutes le même caractère : ce sont surtout des ruines d'arcs de triomphe. Le moins bien conservé est celui d'Avignon, dont il ne reste que des morceaux démembrés, mais fort beaux. Celui d'Orange, qui perpétue le souvenir de la défaite de Sacrovir sous Tibère, est le plus intact et d'ailleurs le plus remarquable et nous laisse deviner qu'au Ier siècle, la ville exerçait une sorte de suprématie sur cette région d'entre Durance et Rhône. Après Arles, Orange était en effet la plus vieille et la plus célèbre des colonies rhodaniennes.
 Arc de triomphe d'Orange.
Arc de triomphe d'Orange.
Contemporaine de Béziers et de Fréjus, elle datait de Jules César, et peut-être, dans la pensée du dictateur, devait-elle être la clé de la défense et la métropole du moyen Rhône. Comme Béziers et comme Fréjus encore, elle était en pleine décadence à l'époque des Antonins. Mais, elle est demeurée fière de son théâtre, le monument le plus parfait et le plus grandiose en ce genre qu'ait nulle part laissé la domination romaine, on peut encore y donner des représentations et s'y procurer, comme dans les arènes d'Arles et de Nîmes, l'illusion d'une vraie fête latine.
10. Chez les Voconces. — Au nord d'Orange, la vallée du Rhône était plus déserte. Les grandes villes s'éloignaient du fleuve : elles s'étaient retirées dans les vallées plus calmes et plus abritées de l'Ouvèze et de la Drôme. Dans cette région montagneuse, fraîche et pittoresque, la nation celtique des Voconces présentait ses trois villes de Luc, de Die et de Vaison. C'étaient des villes moins romaines que les autres cités de la Gaule Narbonnaise. Les Gaulois, hommes et dieux, y régnaient à peu près en maîtres : ils occupaient les montagnes, laissant la plaine et les bords du grand fleuve aux Romains. Seule avec la cité de Marseille, la nation des Voconces était libre : c'était un îlot de traditions celtiques, comme Marseille était une enclave grecque, au milieu de colonies romaines et latines.
Mais la civilisation romaine n'en avait pas moins pénétré dans les moindres replis des Alpes du Dauphiné : les bords de l'Ouvèze, de l'Aygues et de la Drôme étaient couverts de villages et de villas où se montraient les élégances d'un luxe tout arlésien. Les Voconces aimaient, autant que les Romains des colonies voisines, les choses et les arts de l'Italie. Le sol de Vaison est d'une étonnante richesse en ruines précieuses : on y marche presque à chaque pas sur des débris romains, et c'est sur le territoire de cette ville qu'on a trouvé quelques-unes des statues les plus parfaites de la Gaule romaine. Et qui sait les surprises que des fouilles habiles pourraient nous réserver dans le pays des Voconces ?
11. Vienne et les abords de Lyon. — Revenons sur les bords du Rhône; car, au delà de l'embouchure de la Drôme , les grosses bourgades vont réapparaître : Valence, qui a le titre de colonie, Tain, Tournon, Vienne enfin.
Nous sommes dans le pays des Allobroges. La colonie de Vienne en est le chef-lieu. Elle commande à un immense territoire qui va des Cévennes au lac Léman, d'elle dépendent un grand nombre de villes importantes, groupées le long du Rhône et de l'Isère. Deux d'entre elles, Grenoble et Genève, sont si importantes qu'elles mériteront, au III ème siècle, d'être détachées de Vienne et de former des municipes indépendants.
Par l'étendue de son territoire, Vienne ressemble un peu à Arles. Mais, à presque tous les points de vue, c'est à Nîmes qu'on peut la comparer surtout. Elle a sa Maison Carrée, le temple de Livie et d'Auguste, moins bien conservé, mais aussi gracieux peut-être que le temple des Princes de la Jeunesse. Elle a des restes de son forum ; d'autres ruines, de date plus récente, nous montrent qu'à la différence de Nîmes, Vienne aura au IV ème siècle un regain de faveur et de vie. Il est possible que, comme Nîmes, elle ait été une ville de dévotion : les dieux celtiques, les vieilles sources gauloises surtout, paraissent avoir été chers aux Allobroges. Mais, en tout cas, Vienne fut une cité fort intelligente, fort éveillée : les Allobroges étaient vraiment des Celtes. La vie y était facile, riche, fort élégante, plus peut-être que dans n'importe quelle cité de la Gaule. C'était , je suppose, une ville à la mode, une cité d'aristocrates et d'oisifs, adonnée au luxe et au plaisir. Pantomimes, comédiens, gladiateurs, musiciens, artistes de cirque, tout ce monde-là s'y rencontrait.
Au nord de Vienne, une promenade sur le Rhône devait offrir, au II ème siècle, un plaisant spectacle. Il roulait ses claires eaux verdâtres entre deux rangées de collines finement découpées : sur les coteaux étincelaient les marbres de riches villas, comme des éclairs au milieu de vertes cultures ou des teintes sombres des bois. Des barques sillonnaient constamment le fleuve : ici des bateaux de plaisance, dont la tente de pourpre abritait un puissant fonctionnaire des Gaules ou un riche armateur de Lyon, plus loin, de lourdes barques chargées de blé, de vin ou de bois de construction : c'était un mouvement incessant. On approchait de Lyon, la capitale des Gaules.
CHAPITRE XXI
A TRAVERS LA CELTIQUE
1. Lyon : les habitants et la vie. — Lyon était au II ème siècle le but principal de tout voyage au delà des Alpes. C'était la capitale de la Gaule , non pas seulement le chef-lieu administratif des trois provinces, mais l'image réduite de la Gaule tout entière. Elle en était la ville la plus grande, la plus peuplée, la plus riche, la plus bruyante, la plus variée. Comme Paris à notre époque, Lyon était le cœur de la Gaule. D'ailleurs , à quinze siècles de distance, ces deux villes se ressemblent par bien des côtés. Villes de fonctionnaires, d'étrangers, lieux de plaisir et de labeur, de luxe effréné et de bruits populaires : voilà le Lyon d'autrefois et le Paris d'aujourd'hui. C'étaient, comme dit le poète, des « cités mères», « sans cesse en travail ».
Toutefois le Paris français a un avantage sur le Lyon gaulois. Lyon avait pour lui la richesse : il lui manquait ce prestige intellectuel, cet éclat littéraire, cette auréole artistique, qui sont aujourd'hui la meilleure gloire de Paris. Ses écoles n'étaient point célèbres; les Romains de passage pouvaient s'étonner d'y trouver des libraires; les Lyonnais passaient pour opulents et actifs; mais on devait, hors de Gaule, les juger un peu barbares.
Avant tout, Lyon était le grand marché des Gaules. Toutes les routes de la Gaule y aboutissaient : c'était la tête de ligne des chaussées romaines, comme Paris est celle de nos voies ferrées. Tout ce qui se produisait, se fabriquait, s'importait dans les Gaules, tout ce que l'étranger offrait ou demandait, venait se concentrer à Lyon : c'était un immense entrepôt.
Puis, Lyon est la seule des villes gauloises où il y a une garnison : l'empereur y entretient une cohorte, détachée des troupes de la garde de Rome. Elle possède aussi un hôtel des monnaies. C'est la résidence d'un nombre considérable de hauts et puissants fonctionnaires : gouverneurs, intendants du fisc ou des domaines, directeurs des douanes, tous amènent avec eux d'innombrables cohortes d'employés, d'affranchis et d'esclaves. A ces personnages officiels, à ces soldats ou à ces agents qui viennent de Rome et d'Italie, à ces négociants qui accourent de tout l'empire, ajoutons les délégués des soixante cités gauloises, avec leurs cortèges de clients et d'esclaves et nous aurons une idée du Lyon d'autrefois.
Ville cosmopolite, il n'y en a aucune en Gaule qui soit aussi bizarre d'aspect et d'allures. C'est le rendez-vous des étrangers, des parvenus, des aventuriers, des fondateurs de religions. Espagnols, Italiens, Grecs, Syriens, Germains, toutes les populations de l'empire viennent s'y coudoyer, toutes les divinités y fraternisent. C'est un vaste chaos de langues et de cultes. Il faut songera Rome, à Alexandrie ou à l'antique Carthage pour retrouver dans le monde ancien un tel va-et-vient de marchandises, d'hommes et de dieux.
 La Victoire de bronze de Lyon.
La Victoire de bronze de Lyon.
Tout cela nous explique pourquoi, dès le temps d'Antonin, il y eut à Lyon une église chrétienne d'une certaine importance. C'est au milieu du tumulte de ces grandes villes cosmopolites que le christianisme se développait de préférence. Dans cette colonie asiatique et syrienne qui était nombreuse à Lyon, il croissait peu à peu, obscurément.
« Chaque année, écrit à ce propos M. Renan dans une page touchante, amenait des colonies de ces Syriens poussés par le goût naturel qu'ils avaient pour les petites affaires. On les reconnaissait sur les navires à leur famille nombreuse, à ces troupes de jolis enfants, presque du même âge, qui les suivaient; la mère, avec l'air enfantin d'une petite fille de quatorze ans, se tenant à côté de son mari, soumise, doucement rieuse, à peine supérieure à ses fils aînés. Ce marchand syrien sera un homme bon et miséricordieux, charitable pour ses compatriotes, aimant les pauvres. Il causera avec les esclaves, leur révélera un asile où ces malheureux, réduits par la dureté romaine à la plus triste solitude, trouveront un peu de consolation. L'aristocratie romaine s'irritera. Mais la victoire est écrite d'avance. Le Syrien, le pauvre homme qui aime ses semblables, qui partage avec eux, qui s'associe avec eux, l'emportera. »
2. Lyon : la colonie romaine et la cité des Gaules. — Le coup d'œil que présentait la ville était aussi pittoresque, aussi bigarré que l'aspect de la population. En réalité ce qu'on appelait Lyon se composait de deux villes distinctes, et très différentes l'une de l'autre.
 Plancus et le Génie des Lyonnais (1).
Plancus et le Génie des Lyonnais (1).
Sur le coteau de Fourvières s'élevait le vrai Lyon, la colonie fondée en l'an 43 par Plancus, peut-être d'après les projets laissés par Jules César.
(1) Poterie avec figures en relief. A droite, le Génie des Lyonnais; à ses pieds, un corbeau. Devant lui, Plancus offre des épis de blé et tend un rouleau. Le corbeau rappelle, dit-on, l'origine de Lyon (Lugu-dunum signifierait la « ville du corbeau »). Le rouleau est la « charte » de la colonie, lex coloniae, — En haut, FELICITER
Elle s'étageait sur les pentes de la colline : au centre, sur la plate-forme, était le « vieux forum » de Lyon, forum vetus, qui adonné son nom à Fourvières. Tout autour, surtout vers le sud, les grands édifices abondaient : le palais impérial, l'hôtel des monnaies, sans doute aussi la caserne et les palais des gouverneurs et des intendants. Sur le flanc s'adossaient le théâtre et l'amphithéâtre. Sur le sommet et sur les versants de la colline, jusqu'au bord de la Saône , les constructions publiques et privées s'amoncelaient. C'était là le Lyon officiel, impérial et romain, et en même temps le Lyon ouvrier et populeux, encombré de maisons et d'habitants.
Au pied de la montagne, de l'autre côté de la Saône , dans la longue bande de terre comprise entre les deux rivières, s'étalait à demi dans la plaine une autre ville, celle qu'on appelait la ville « du confluent ». Celle-là était la cité gauloise. Le terrain en appartenait sans doute au Conseil des Gaules. Là peu de maisons : surtout de vastes et somptueux édifices qui se développaient dans une majestueuse aisance. Au confluent était la vraie capitale des Gaules, capitale indigène en face du chef-lieu administratif de la province romaine qui se dressait sur le coteau de Fourvières. Au centre de la presqu'île, à peu de distance de l'endroit où est aujourd'hui la place des Terreaux, s'élevait l'autel colossal de Rome et d'Auguste. On peut dire de cet autel qu'il était pour toute la Gaule ce qu'était l'autel de Vesta pour l'ancienne Rome, le foyer national et le cœur de la patrie. Autour du monument sacré étaient disposés les édifices destinés aux jeux ou aux fêtes des Gaules : le temple d'Auguste, le cirque, l'amphithéâtre, au pied se développaient les jardins et les promenades, ornés de statues de marbre et de bronze, et sans cesse rafraîchis par les eaux abondantes qu'amenait l'aqueduc de Miribel. Ce coin de terre offrait alors toutes les séductions. C'était dans la Gaule ce que sont dans notre France les Champs-Elysées et la place de la Concorde. Mais le « confluent » de Lyon avait un caractère de vie morale qui manque au centre de Paris : aux séductions du luxe et à l'éclat de la foule s'ajoutait l'émotion religieuse qu'inspirait l'autel de la nation.
3. La fin de Lyon. — Toute cette splendeur disparaîtra presque en un jour. En 197, Lyon fut brûlé à la suite de la bataille livrée près de ses murs entre Clodius Albinus et Septime Sévère. Ce fut la catastrophe la plus complète de toute l'histoire des Gaules. On a peine à croire cependant que le désastre ait été assez grand pour que Lyon n'ait jamais pu songer à s'en relever : d'autres villes, Narbonne, Rome, Smyrne, sont sorties d'épreuves aussi grandes : Lyon traîna au III ème siècle une vie misérable. A peine pouvons-nous affirmer que le Conseil des Gaules y a tenu ses séances pendant une centaine d'années encore. Mais ni les empereurs gaulois, ni les princes réorganisateurs du temps de la tétrarchie, ni Constance ni Julien ni Gratien n'ont songé à rendre à Lyon son ancienne place dans la Gaule. La suprématie de la nation, depuis l'an 300, est partagée entre Trêves et Arles. Lyon compte alors beaucoup moins dans le monde que les cités voisines d'Autun et de Vienne. Cette chute irrémédiable, après un passé si éclatant, peut-elle n'avoir pour cause que l'incendie de 197 ? Qui sait si quelque fatalité religieuse n'a pas pesé un jour sur les destinées de Lyon, semblable à la malédiction que la Convention porta contre elle seize siècles plus tard?
4. Aspect général de la Lyonnaise. — Mais, en l'an 150, la métropole était dans tout l'éclat d'une splendeur inaltérée, et c'est avec regret que le voyageur se séparait de Lyon, pour continuer sa route vers le nord.
Au coteau de Fourvières commençait la province à laquelle Lyon donnait son nom, la Lyonnaise , qu'on appelait aussi la Celtique. C'était une province à forme singulière : longue, étroite, elle s'étendait entre la Loire et la Seine , depuis les bords de la Saône jusqu'à l'océan d'Armorique. C'était, des quatre grandes provinces de la Gaule , la moins célèbre et la moins visitée. Ses deux voisines, l'Aquitaine au Sud, et la Belgique au Nord, lui faisaient tort : celle-ci avec ses vignobles, son commerce, son luxe et son élégance, celle-là avec ses grandes villes, ses prairies, son activité industrielle et le glorieux voisinage de l'armée du Rhin. En Lyonnaise, les belles cultures étaient plus rares, les villes moins grandes et moins nombreuses, moins opulentes surtout. De vastes forêts y entravaient la marche de la civilisation et les progrès de la vie municipale. Sans contredit, c'était la plus arriérée des quatre provinces gauloises.
Le climat y passait pour très rude. C'était le pays de l'hiver gaulois, de cet hiver qui, comme dit Pétrone, « vous gèle la parole sur les lèvres ». C'était aussi le pays de la bière insipide, celui des grandes chasses et des grands propriétaires ruraux. Ce que les riches Gaulois de ce pays possédaient comme attirail de chasse est incroyable : lacets, filets, rets, épouvantails, lances, épées, couteaux; l'un d'eux nous a laissé dans son testament l'énumération complaisante de tous les engins de son arsenal, et il ordonnait qu'on les brûlât avec son corps sur le bûcher. En dépit de la civilisation romaine, on sent bien que les hommes de la Gaule celtique ont conservé des habitudes et une vie toutes gauloises. Ceux-là ont fourni à l'empire peu de rhéteurs, mais des soldats surtout et leur aristocratie préférait à la vie des palais et des tribunaux les courses dans les bois, les émouvantes chevauchées, le bruit des meutes, la grande existence campagnarde qui rappelait un peu les folles aventures du temps de l'indépendance.
5. Autun. —Le pays ne changeait pas subitement d'aspect au nord de Lyon. Pendant les cinq premières étapes, on parcourait encore un pays fertile, riche en vignobles, on suivait la rive droite de la Saône , on rencontrait de grandes bourgades destinées à devenir bientôt des villes, Mâcon, Chalon. Puis, la route était plus triste : on traversait la ligne des monts boisés du pays des Eduens. Après la septième étape, on arrivait à Autun.
 Porte romaine, à Autun.
Porte romaine, à Autun.
Autun était une grande et belle ville, comparable à tous les égards et par ses monuments et par la culture de ses habitants, aux cités de la Narbonnaise. Elle était comme un dernier prolongement vers le nord de la civilisation de cette province. Les Eduens maintenaient en effet dans la Gaule cette suprématie intellectuelle que les Romains de la république avait déjà reconnue. Leurs écoles étaient célèbres, la jeunesse gauloise s'y pressait, et les rhéteurs latins et attiques ne dédaignaient pas d'y venir enseigner l'éloquence aux fils de ces chefs de bandes gauloises si longtemps redoutées. Auguste, qui, comme tous les Romains intelligents de sa génération, affectionnait le peuple éduen, avait donné son nom à sa nouvelle capitale, l'héritière de Bibracte ; elle fut la « ville d'Auguste », Augustodunum. On lui permit des remparts, les Eduens demeurèrent cité libre. Gracieusement assise sur le penchant d'un coteau, Autun avait toute l'élégance de certaines villes du Midi : les portes monumentales qui y sont restées debout, des restes d'un théâtre, bien d'autres raines encore, témoignent de sa splendeur dans les premiers siècles : c'est une ville qui a conservé jusqu'à nos jours l'allure romaine.
Sa gloire durera longtemps. Au III ème siècle, elle possédera de célèbres avocats. La faveur de quelques grands princes, Maximien, Constance, Constantin, vaudra un dernier jour de prospérité matérielle et d'éclat littéraire à l'antique capitale du peuple « frère des Romains» : il avait appelé en Gaule les légions de César et accueilli le premier les légendes et les arts de la Grèce , peu de nations ont été dans notre pays aussi constantes dans leurs goûts, aussi fidèles à leur physionomie primitive.
6. La vallée de l'Yonne; Sens. — Mais, passé Autun, on entrait immédiatement en plein pays sauvage. On pénétrait dans la vallée de l'Yonne : à gauche, on longeait les pentes mystérieuses des monts du Morvan ; on traversait alors la vaste ceinture des forêts gauloises, qui formaient un colossal demi-cercle autour des bassins de la Loire et de la Seine , parlant d'Arras pour finir à Périgueux. Ce n'étaient, entre la source de l'Yonne et son confluent avec la Seine , que des bois à perte de vue, sombres, impénétrables, dangereux, où se cacheront, dans les mauvais temps de l'empire, les brigands, les Bagaudes ou les barbares germains. Au II ème siècle, ces forêts servent surtout d'asile aux vieilles divinités gauloises, que le christianisme ira pendant longtemps combattre au fond de leurs bois séculaires. C'est, de toute la Gaule , le coin qui est demeuré le plus longtemps celtique.
Quelques villes s'élevaient ça et là au milieu de vastes clairières : Auxerre, Sens surtout, centre assez important de travail industriel et agricole. Sens était sans doute alors la ville la plus considérable de la vallée de la Seine , comme on peut s'en rendre compte en étudiant les beaux débris conservés dans son musée; il ne serait pas impossible que Paris n'ait été tout d'abord que l'héritier de son importance.
 Bas-relief du musée de Sens
Bas-relief du musée de Sens
Mais Sens était encore, au II ème siècle, une ville à demi gauloise, où le cuculle se montrait plus souvent que la loge, où les habitants, actifs et rudes au travail, étaient peu faits aux finesses de la vie romaine.
Le pays s'éclaircissait tout à fait au confluent de l'Yonne et de la Seine : on entrait dans la vallée du grand fleuve, plus ouverte, plus riante, mieux cultivée et l'on arrivait à Lutèce ou Paris.
7. Paris. — Paris était peu de chose alors, et nul n'aurait pu en ce moment prédire ses glorieuses destinées. Si l'on avait pu croire à la naissance d'une grande capitale dans ce pays maussade et déshérité, Romains et Gaulois n'auraient songé qu'à la ville de Sens. Toutefois, Paris devait offrir un agréable lieu de repos et de réconfort au touriste fatigué par un monotone voyage à travers les forêts. On se sentait enfin dans un paysage plus élégant, où l'air était plus libre, le coup d'oeil plus varié. Paris n'était en ce temps-là qu'un petit port de commerce, le centre du cabotage dans la vallée de la Seine , et l'intermédiaire obligé du transit entre Sens et l'Océan : c'est ce qui donnait une importance particulière à cette corporation des « nautes parisiens »,qui apparaît dès le temps de Tibère. La ville occupait surtout l'île de la Cité , son berceau primitif. Mais, sur la rive gauche de la Seine , elle s'était peu à peu étendue et gravissait les pentes du mont Sainte-Geneviève : là se construiront bientôt ses édifices de plaisir. La rive droite était laissée aux marécages.
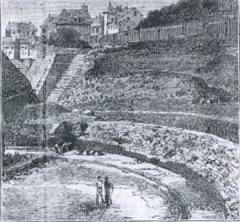 Portion des arènes de Lutèce.
Portion des arènes de Lutèce.
Les débuts de Paris ont été lents et pénibles mais sa marche sera continue. Lyon a surgi tout d'un coup dans toute sa splendeur : il est tombé aussi brusquement qu'il s'est élevé. Paris à marcher doucement, à pas régulier, assurés. Trois ou quatre générations après le règne d'Antonin, on lui donnera, sur la rive gauche, un amphithéâtre dont les ruines sont à peine visibles et des thermes, en partie bien conservés. Au IV ème siècle, au moment où tant de villes célèbres des Gaules déclinent et s'effondrent, Paris continue agrandir: non pas en étendue, car, à partir de l'an 300, il se renferme de nouveau dans son île; mais il croit au moins en renom. Il sera la résidence aimée du césar Julien, l'empereur le plus semblable aux Gaulois qui ait jamais gouverné la Gaule. Désormais , son avenir est fixé.
Julien nous a raconté avec enjouement son séjour à Lutèce et nous a donné, à son sujet, de piquants détails : « J'étais en quartier d'hiver dans ma chère Lutèce : c'est ainsi que les Celtes appellent la petite ville des Parisiens.
 L'intérieur des thermes de Cluny restitué.
L'intérieur des thermes de Cluny restitué.
Elle est située sur le fleuve, et un mur l'environne de toutes parts, en sorte qu'on n'y peut aborder que de deux côtés, par deux ponts de bois. Il est rare que la rivière se ressente beaucoup des pluies de l'hiver et de la sécheresse de l'été. Les eaux pures sont agréables à la vue et excellentes à boire. Les habitants auraient de la peine à en avoir d'autres, comme ils sont dans une île, l'hiver n'y est pas rude, ce qu'ils attribuent au voisinage de l'Océan, qui peut envoyer jusque-là des souffles propres à tempérer le climat. Ils ont de bonnes vignes et des figuiers même, depuis qu'on prend soin de les revêtir de paille et de ce qui peut garantir des injures de l'air. » Julien ajoute qu'une année « un hiver extraordinaire couvrit la rivière de glaçons : c'étaient des pièces énormes de glaces, qui flottaient au gré des eaux, et qui, se suivant sans relâche, étaient près de se raccrocher et de faire un pont. On se chauffe, en ce pays-là, par le moyen de poêles, qu'on met dans la plupart des appartements ». On voit que bien des choses sont restées du Paris d'autrefois : ce qui a le plus changé, c'est l'eau de la Seine , « excellente à boire », disait Julien.
8. La région de la basse Seine. — En aval de Paris, la navigation était assez active sur la Seine , des navires descendaient jusqu'à l'embouchure, pour gagner de là l'île de Bretagne. Rouen était le vrai port maritime de la région; mais son importance était bien inférieure à celle de Nantes et de Bordeaux. Des embouchures des trois fleuves océaniens, celle de la Seine est aujourd'hui la plus vivante : c'était alors, au contraire, la moins fréquentée.
Plus loin, Lillebonne, Juliobona, paraît avoir été la vraie capitale de cette région : elle a laissé des ruines importantes; elle a surtout livré de superbes mosaïques et des pièces d'orfèvrerie. Quelques gros bourgs de la Basse-Normandie , Vieux surtout, ont aussi donné de précieux monuments. Le trésor d'argenterie de Bernay est célèbre parmi les archéologues. On connaissait dans ce pays, aussi bien que dans la Narbonnaise , tous les raffinements du luxe et de la grande vie. Sans pouvoir l'affirmer, on devine que cette fertile région était bien exploitée, intelligemment cultivée, et qu'elle possédait déjà cette richesse agricole qui est aujourd'hui l'apanage de la Normandie.
9. En Armorique. — La région voisine, qu'on appelait encore l'Armorique et qui est notre presqu'île de Bretagne, vieille terre celtique, faisait peu parler d'elle dans le monde et même en Gaule. Elle était bien traversée par une grande chaussée qui allait de Rennes à Brest, et qui fut l'objet de soins attentifs de la part de certains empereurs. Mais il n'y avait pas de villes importantes sur ce long parcours : Rennes était la moins insignifiante et s'annonçait déjà comme la capitale du pays. En Armorique, les cités étaient rares, les habitants rudes et l'Océan inhumain. En revanche, les villas y étaient assez nombreuses. La contrée appartenait presque en entier à la grande aristocratie terrienne, qui, du reste, était peut-être moins arriérée que celle du Morvan : elle se faisait bâtir de vastes châteaux, avec des statues, des mosaïques, des bains à la romaine, et s'y reposait, au milieu d'un confort tout moderne, de ses grandes chasses à la manière antique dans les landes de son pays.
On peut croire, d'ailleurs, que les Armoricains oubliaient volontiers ces souvenirs gaulois dont ils sont si fiers aujourd'hui. Ils ne devaient guère montrer leurs dolmens et leurs cromlechs aux rares touristes perdus dans cette fin de terre du monde romain. S'ils avaient songé à le faire, les Italiens les eussent plaisamment raillés. Au II ème siècle, la mode était aux fantaisies orientales, aux vieilleries égyptiennes, travaillées, mystérieuses et compliquées. Qui donc aurait été assez puéril pour faire attention à ces pierres, brutes, incolores et muettes? Elles n'étaient bonnes qu'à entretenir les superstitions de villageois aussi grossiers qu'elles.
10. La vallée de la Loire. – de Rennes, une route importante conduisait par Angers sur les bords de la Loire. La vallée n'avait pas encore son renom de mollesse et de luxe ; elle n'était pas, comme au XVI ème siècle, le pays des opulents châteaux et des vertes promenades. C'était à la Moselle et à la Garonne que cette gloire était alors dévolue. La région de la Loire n'avait même plus, comme au temps de l'indépendance, ces grandes assemblées que les druides tenaient dans le pays de Chartres. Les souvenirs de l'époque où les destinées gauloises se décidaient entre Chartres et Orléans étaient bien morts. Il n'y avait plus là que des villes laborieuses, heureuses et paisibles. En arrière du fleuve s'élevaient Le Mans et Chartres : celle-ci, quoique située sur l'Eure, avait dans la vallée de la Loire tous ses intérêts et la plus grande partie de ses domaines : Orléans dépendait d'elle. Près du fleuve lui-même se succédaient d'assez grandes villes. Orléans était le centre du cabotage sur la Loire , comme Paris sur la Seine : son importance grandira assez au III ème siècle pour qu'on le constitue en cité indépendante de Chartres; plus loin, Tours, Angers, chefs-lieux, comme Le Mans et Chartres, de peuplades qui avaient été longtemps turbulentes et vagabondes, donnaient alors l'exemple de cités assagies, actives, et qui unissaient le culte du gouvernement à l'amour du travail.
Nantes était un port de mer des plus prospères. On s'y embarquait, comme à Rouen, pour la Bretagne. Les bateliers de la Loire y formaient une puissante corporation. On y construisait beaucoup, et l'on y adorait à bon droit le grand dieu des forgerons et des charpentiers, Vulcain. Nantes eut aussi de beaux édifices, surtout des temples. Il y avait là toute une population de riches armateurs et de marins dévots.
A Nantes, le voyageur pouvait s'embarquer, s'il ne craignait pas les fureurs de l'Océan, pour faire le tour de la Gaule du Nord et rejoindre par mer Boulogne, le port qui donnait accès à la province de Belgique.
CHAPITRE XXII
A TRAVERS LA Belgique
1. Boulogne. — Boulogne, que l'on appelait en ce temps-là Gesoriacum, était le port de la Gaule Belgique , et en particulier le port d'embarquement pour l'île de Bretagne. Mais c'était plutôt un port militaire qu'un port de commerce. Les trafiquants préféraient descendre le cours des fleuves et s'embarquer à Rouen ou à Nantes : la route était plus longue mais plus sûre et moins coûteuse.
Boulogne était la station navale de l'Océan comme Fréjus était celle de la Méditerranée. Son port était le centre de ralliement de la grande flotte de Bretagne, classis Britanica, chargée d'assurer les transports de l'État entre l'île et la Gaule. Tandis que Fréjus n'a plus aucune importance dès le II ème siècle, Boulogne demeurera, jusqu'à la chute de l'empire, une ville très forte, très protégée par l'État, et le centre de la défense militaire de l'Océan gaulois. L'empereur Caligula y avait fait construire un des beaux phares de l'Occident : c'était une tour très haute, à dix étages, dont les feux éclairaient au loin les navires dans ces parages dangereux. L'aristocratie romaine, qui fut si injuste dans ses déclamations à l'endroit de Caligula, se plaisait à railler cette construction utile entre toutes et à la taxer de « monument d'un ridicule orgueil ». En cela, et en bien d'autres choses, Caligula a été assurément moins fou que les plus sages des sénateurs qui le combattaient.
 Le phare de Caligula à Boulogne (d'après une ancienne gravure).
Le phare de Caligula à Boulogne (d'après une ancienne gravure).
De Boulogne partait la grande voie militaire qui, à travers la Belgique , conduisait jusqu'à Lyon.
2. Aspect général de la Belgique . — La Belgique était un pays de contrastes. Au centre s'étendait l'immense forêt des Ardennes, auxquelles les chaussées romaines formaient une sorte de ceinture, mais qu'elles essayaient à peine d'entamer : la ligne de hauteurs boisées se continuait au sud sur les bords de la Meuse , et allait rejoindre les plateaux agrestes du pays de Langres. A l'Est, les Vosges n'étaient ni moins boisées, ni moins sauvages : une seule grande route les traversait au col de Saverne.
Ces deux pays de bois et de montagnes se défrichaient avec une extrême lenteur. Nulle part en Gaule, sauf dans le Morvan, les mœurs et la religion n'avaient gardé au même degré leur caractère primitif. Les plus vieux dieux d'autrefois vivaient toujours dans les Ardennes et dans les Vosges. On trouvait encore dans les villages de ces tombes bizarres, dont la forme allongée et la pierre à peine dégrossie rappelaient les stèles des premiers âges. Mais les robustes habitants en étaient parmi les soldats les plus vaillants et les plus solides de l'armée romaine.
A l'Ouest, à la lisière des grandes forêts de la Meuse , une immense plaine continue allait de l'Océan aux sources de la Marne : c'était une région en partie couverte de gras pâturages, célèbre dans tout l'Occident par l'élève des bestiaux, des moutons et des chevaux. Les chevaux de la Belgique étaient la grande ressource de la cavalerie romaine; avec la laine de leurs moutons, les Belges fabriquaient de grosses étoffes, d'un drap solide et chaud, qu'on exportait par tout l'empire. Déjà à l'époque romaine il s'était fondé dans le pays quelques-uns de ces grands centres industriels qui feront au moyen âge et de nos jours l'incomparable fortune de la Flandre et de la Champagne , sauf le vin, alors inconnu ou méconnu, les industries étaient déjà les mêmes qu'aujourd'hui, et elles vivaient presque à la même place.
Entre les régions sauvages des Ardennes et des Vosges, la vallée de la Moselle étendait le long et gracieux ruban de ses eaux limpides, de ses coteaux verdoyants, de ses blanches villas et de ses riches vignobles. C'est une région d'opulents châtelains : sur les bords du fleuve, ils bâtissent leurs châteaux, préparent leurs mausolées el se tiennent à la portée des grandes chasses dans les bois. C'est aussi la région d'un incessant va-et-vient de soldats et de trafiquants: la vallée de la Moselle est la voie principale par laquelle se déversent vers le Rhin les troupes, l'or et les marchandises nécessaires pour soutenir la plus forte armée permanente de l'empire romain. Aussi s'est-il formé là, dans les deux grandes villes de Metz el de Trêves, toute une bourgeoisie de négociants enrichis, actifs, glorieux et dépensiers, dont nous allons voir les tombeaux fastueux et de mauvais goût.
Avec les aspects si divers de son sol, les aptitudes si variées de ses habitants, la Belgique était pour l'empire romain une province de très grande ressource : les cavaliers de ses plaines, les fantassins de ses montagnes, opposaient, suivant le mot d'un historien, un « mur compact » dans les combats contre les Germains : de la Belgique venait la force de l'armée du Rhin. La Belgique avait de plus cette richesse sans cesse renouvelée que donnaient une agriculture bien entendue, l'industrie de ses grandes villes, l'activité toujours éveillée de ses trafiquants. Il en a été d'elle comme de notre Flandre et surtout de l'Alsace-Lorraine : on se sentait dans un pays frontière, où le repos était difficile, où toutes les ressources vitales du sol et des hommes étaient mises en œuvre pour le travail et pour la lutte.
3. La vallée de l'Escaut; Reims. — En partant de Boulogne, on se rendait à Reims par la route directe d'Amiens et de Soissons, mais on pouvait y arriver aussi, sans trop de retard, en faisant le détour de la route de l'Escaut, par Bavay. La région de l'Escaut avait peut-être plus d'attrait; les villes y étaient nombreuses, actives et vivantes : c'était dès lors la partie industrielle de la Gaule du Nord-Est. A Arras, à Tournai on fabriquait les manteaux de laine destinés aux soldats : l'armée romaine s'approvisionnait dans les vastes manufactures de ces deux villes.
Reims, la métropole de la Belgique , passait pour la plus belle ville du Nord : elle avait dès ce moment ce renom de cité somptueuse et grandiose qu'elle conservera durant tout le moyen âge et qu'elle mérite encore aujourd'hui. Malheureusement Reims a vécu trop près de la frontière et des barbares : ce fut une proie trop convoitée et trop souvent mal défendue. De son éclatant passé il n'est resté que de chétifs débris, une belle mosaïque et quelques tombeaux. Sa porte de Mars n'est qu'un assez triste monument d'un temps de décadence. De ses thermes de marbre, de ses aqueducs aux eaux abondantes, de ses temples aux formes parfaites, de ses basiliques, rien n'est resté debout. Les fragments mêmes en ont disparu. L'histoire de Reims n'est, pour le curieux en quête du passé romain, qu'un long sujet de plaintes et de déboires.
4. La route de la Moselle. — En revanche, Trêves est aujourd'hui encore, par ses ruines, une ville toute romaine : c'est la seule cité du Nord qui ressemble à Nîmes et à Arles; elle mérite le surnom qu'on a pu lui donner quelquefois d' « Arles du Nord ».
On y arrivait de Reims par la pittoresque route de Mouzon, coupée en plein bois, et qui allait déboucher dans la vallée de la Moselle , prés de Wasserbillig, au confluent de la Sauer. Les quelques milles que l'on faisait alors en suivant la rivière étaient une des plus exquises promenades de la Gaule. C'était , dans ces pays du Nord tristes et sauvages, un coin de fraîche culture et de tiède climat.
 Porte de Mars à Reims.
Porte de Mars à Reims.
« Ce ne sont plus, écrira plus tard Ausone, ces branches enlacées par des liens enchevêtrés, au milieu desquelles on cherche le ciel que dérobe l'obscurité des bois; rien, sur les bords du fleuve, ne cache aux regards le clair rayonnement du soleil et l'éclatante pureté du ciel ; l'air est libre et le jour transparent. Tout dans ce spectacle me charmait : ces villas dont le faite s'élève sur les rives qui dominent le fleuve, ces collines vertes de vignes, ces belles eaux de la Moselle qui coulent à leurs pieds avec un murmure presque insensible.... Salut, ô fleuve dont les coteaux produisent un vin parfumé, fleuve verdoyant dont les rives sont semées de gazons! »
Au pied et au sommet des coteaux les villas et les villages se succédaient sans relâche : « L'une se dresse sur un massif de rochers; celle-là s'élève sur une saillie du rivage; celle-ci se cache dans un repli du fleuve. Une autre occupe une colline qui surplombe la Moselle , et étend au loin sa vue sur les cultures et sur les bois. Cette autre enfin, perchée au plus haut sommet des monts, ne voit qu'à travers un brouillard confus le fleuve perdu à ses pieds, »
Ça et là, espaçant chaque domaine, se dressent les gigantesques mausolées élevés auprès de leurs demeures par les riches châtelains. Les villas ont disparu; mais il est resté quelques vestiges de leur magnificence : ces bijoux, ces verreries, ces trésors d'or et d'argent, ces mosaïques, tout ce qui fait l'incomparable richesse du musée de Trêves. Une mosaïque grandiose est demeurée en place, à Nennig. Les mausolées ont mieux résisté au temps : on pourrait en reconstruire aisément quelques-uns, à  Mausolée d'Igel (facade).
Mausolée d'Igel (facade).
l'aide des énormes fragments conservés à Trêves. L'un d'eux, celui d'Igel, est encore debout, à sa place, étonnamment conservé.
5. Trêves. —On arrivait ainsi aux portes de la colonie de Trêves. Au II ème siècle, Trêves était sans contredit fort éclipsée par Reims sa métropole. Elle avait eu sous les premiers empereurs, au temps de Drusus, de Germanicus et des deux souverains de leur famille, Caligula et Claude, un assez long moment d'éclat et de célébrité. La grande guerre de Germanie lui avait donné une importance considérable. On avait fait d'elle une colonie; on y avait bâti une large enceinte, un amphithéâtre, des thermes. Elle s'essaya, en face de la barbarie du Nord, à ce rôle de capitale romaine qu'elle tiendra si bien au IV ème siècle. Mais, dès le règne de Vespasien, Trêves décline : son adhésion à la révolte de l'an 69 lui a certainement nui; plus encore, la fin des guerres de Germanie a restreint son importance. Le silence se fait pour longtemps autour d'elle.
Toutefois, elle continue, sinon à grandir, du moins à vivre, très richement, très laborieusement. C'était une grande ville; il semble même qu'on l'ait faite trop grande au temps où on l'avait bâtie et où on la destinait à être le point de départ d'une vaste domination sur le Rhin et sur l'Elbe. Elle était trop à l'aise dans ses remparts. C'était surtout une ville de gens fort opulents, qui amassaient de gros revenus à cultiver le pays et plus encore à exploiter l'armée du Rhin. Elle était une métropole commerciale de premier ordre, l'intermédiaire entre la Gaule , la Bretagne et l'Italie, d'une part, la Germanie de l'autre. De Trêves partaient sans doute les grandes expéditions commerciales qui allaient porter aux barbares du Nord les produits du monde romain.
Ces riches Trévires étaient des Gaulois, de condition parfois peut-être un peu basse, fort intelligents, fort actifs, et qui arrivaient rapidement à la fortune, pour étaler ensuite un luxe d'assez mauvais aloi. Ils ressemblent, on le dirait presque, à la classe des fournisseurs des armées sous le premier empire. Aux bas-reliefs qui ornent leurs tombeaux, on devine aisément ce qu'ils étaient.
6 . Le mausolée d'Igel. — Que l'on compare par exemple le mausolée d'Igel à celui de Saint-Remy, si pur de détails, si harmonieux de forme.
Au sommet du monument, un aigle agite ses ailes éployées. Que vient faire sur la tombe d'un négociant propriétaire cet emblème de la force militaire et de la victoire armée ? Le corps de l'édifice est couvert, depuis la première pierre du socle jusqu'au sommet du fronton, d'une effrayante quantité de bas-reliefs. Nous chercherions en vain dans ces figures de l'art et du caractère; dans leurs dimensions, qui varient à l'infini, la proportion fait totalement défaut; dans les scènes, les personnages sont mal groupés, les attitudes raides et compassées. Voici d'abord, en façade, le portrait du mort, Sécundinus, et celui de sa femme, tous deux en pied : au-dessus, dans des médaillons, les bustes des enfants. Puis, tout autour d'eux, s'étagent des tableaux fort variés et les scènes les plus inattendues : une voiture sur une route, un chariot lourdement chargé, des mulets qui gravissent un coteau, des scènes de famille, de bureau, d'atelier, et, pêle-mêle avec tout cela, des jeux de cirque, les signes du zodiaque, des fantaisies mythologiques, des dieux marins, L'artiste n'a point perdu un pouce carré : il s'est rappelé que le mort connaissait le prix du terrain. C'est bien le tombeau le plus encombré qu'on puisse voir : ceux qui l'avaient commandé avaient tant de choses à y mettre, les dieux du ciel, de la terre et de la mer, et surtout la vie du défunt, Trimalcion a dû voir dans ses rêves un tombeau de ce genre, « évocateur de la sagesse pratique des morts » (Maurice Barrés).
Les autres mausolées du pays trévire ressemblent à celui-ci. Ici, c'est le blé que l'on apporte dans des sacs; là, ce sont d'énormes barriques transportées sur des barques; ailleurs, des tenanciers viennent payer leurs fermes; des colons apportent les fruits de leurs redevances. C'est toute l'histoire du travail gallo-romain et de la fortune trévire que nous lisons sur ces bas-reliefs. On finit par s'intéresser à ces monuments autant qu'à ceux de la Gaule Narbonnaise : dans nos villes du Midi, nous voyons la Gaule se former aux leçons de l'art et de l'élégance; chez les Trévires, nous la voyons transformer le sol et s'enrichir de son travail.
7. L 'avenir de Trêves. — Plus tard, au III ème siècle, les guerres reprendront contre les Germains, Trêves redeviendra, comme au début, la cité des armes et du bruit, le camp retranché de l'empire contre les barbares. « Elle fut la proue latine que battaient les flots du Nord », comme dit M. Maurice Barrés. Les empereurs en feront leur résidence ordinaire. Ils reconstruiront ses murailles. On élèvera cette Porte Noire, si laide, si massive, mais si puissante, qui à elle seule vaut une forteresse. On rebâtira ses thermes. Trêves aura, à l'angle des remparts, un palais impérial, solide comme une tour, somptueux comme une villa. A voir aujourd'hui toutes ces ruines superbes, on sent le suprême effort du monde romain à la porte de la barbarie.
 La porte noire, à Trèves.
La porte noire, à Trèves.
Pendant tout le IV ème siècle, la vie militaire de l'Occident et les espérances de la Gaule et de l'Italie ont tenu dans ces murs. Dans son poème sur « les Villes célèbres », Ausone donnera la première place à Trêves parmi les villes gauloises : « C'est elle qui nourrit, qui habille et qui arme les forces de l'empire. » Ce sera la Rome du Nord, comme Arles est la Rome de la Gaule ; mais une Rome à demi sauvage, aussi agitée par la soldatesque qu'Arles est pacifique et lettrée.
8. De Trêves à Langres. — Laissons de côté les provinces de Germanie, où l'armée défend le nom et implante les usages de Rome. Allons vers la Belgique méridionale, en suivant, au pied des Vosges, la route stratégique qui conduit de Trêves à Langres par Metz et Toul. On arrive à Metz en admirant toujours ces bords de la Moselle qu'Ausone a si bien décrits. A Metz, où l'on croise la route de Reims à Strasbourg, on se retrouve déjà dans un pays plus gaulois, moins romain que Trêves : les souvenirs et les dieux celtiques sont plus vivants. Cependant, par la nature de son commerce, l'aspect de ses monuments, la variété de ses environs, Metz offre un peu l'image réduite de la colonie trévire. A Toul, on quitte la Moselle pour s'en foncer dans la région montagneuse et boisée où le monde des divinités et des superstitions gauloises a gardé toutes ses habitudes. Beaucoup de voyageurs pourtant s'attardaient à remonter la Moselle et à pénétrer en suivant ses bords jusqu'au pied des Vosges : l'aristocratie et la bourgeoisie gallo-romaines faisaient sans déplaisir ce voyage accidenté, pour aller demander la santé ou le repos aux bains des stations vosgiennes.
Langres, solidement bâti sur son plateau était, comme Arras, un centre industriels de la Belgique. On y fabriquait des étoffes de laine et notamment des manteaux à capuchon, dits cuculles, destinés aux travailleurs.
 Porte romaine de Langres (III ème ou IV ème siècle ?).
Porte romaine de Langres (III ème ou IV ème siècle ?).
9. Besançon. – Pour arriver dans la vallée du Doubs, qui appartenait encore à la Belgique , on traversait, tant bien que mal, les forêts du plateau de Langres. Une route directe qui n'était peut-être pas très fréquentée, conduisait de Langres chez les Séquanes, à Besançon et de là par la vallée de l'Orbe chez les Helvètes.
Besançon avait de beaux monuments, un arc de triomphe, des temples riches et nombreux, des thermes : c'était une des villes élégante et instruites de la Gaule Belgique. Mais ce qu'on venait aussi y admirer, c'était sa position qui enthousiasmait les Romains eux-mêmes, pourtant fort peu sensibles au pittoresque des choses. Elle avait frappé César et quatre siècles plus tard, l'empereur Julie s'arrêtait à la décrire dans une lettre aimable : « Le Doubs qui l'environne lui donne l'aspect d'une citadelle : elle est placée comme un rocher sur la mer : on la dirait inaccessible aux oiseaux mêmes si ce n'est par les rivages qui semblent projetés en avant du fleuve ».
Besançon avait pu garder ses antiques murailles, on lui donna même, comme à Langres, le titre de colonies : les Romains avaient compris la nécessité de relier Trèves à Lyon par une ligne ininterrompue de colonies et de places fortes qui couvraient la frontière du Rhin.
10. Chez les Helvètes. — C'est ce voisinage de la frontière qui explique également pourquoi, chez les Helvètes, les grandes villes portaient le titre et sans doute avaient l'aspect de colonies. Les Helvètes formaient un coin avancé de la Gaule entre la Germanie et l'Italie. Autrefois si turbulents, si instables, Rome les avait forcés à s'attacher à leur pays et leur avait appris à l'aimer et à y travailler. Ils vivaient paisiblement dans leurs colonies d'Avenches et de Nyon, construites sur le modèle des colonies de la Narbonnaise. Sur la rive nord, au bord du lac de Genève, les bourgades étaient fréquentes, le pays bien cultivé, les citoyens romains fort nombreux, les lieux de villégiature déjà recherchés. On pouvait deviner que de l'autre côté du Léman étaient le pays des Allobroges et la « Province » par excellence.
Descendons le Rhône : nous nous retrouverons devant Lyon. En continuant la route vers l'Ouest, nous franchirons la frontière de l'Aquitaine, et, après avoir traversé encore une fois la ligne des forêts, nous arriverons à Clermont. Telle est en effet l'excellente situation de Lyon qu'à quelques milles de la cité commencent également les quatre grandes provinces de la Gaule. La Celtique finit à Fourvières, la Narbonnaise au coude du Rhône, les Dombes touchent à la Belgique et l'Aquitaine commence au mont Pilat.
CHAPITRE XXIII
A TRAVERS L'AQUITAINE
1. Aspect général de l'Aquitaine. — A la différence de la Belgique , l'Aquitaine offrait une parfaite unité. A l'Orient et au Midi, un demi-cercle de montagnes la séparait des provinces voisines; au Nord, elle s'arrêtait à la Loire ; au Nord et à l'Ouest, s'adossant aux pentes du Plateau central, s'étageaient ses coteaux couverts de vignes, ses plaines riches en blé, ses gras pâturages, Nulle province gauloise n'avait des limites si nettes et si naturelles, une telle ampleur d'aspect, une structure si harmonieuse. Au centre du pays coulait la Garonne , qui était la voie naturelle de son commerce et l'artère de sa richesse. C'était presque un monde à part, qui pouvait se suffire à lui-même.
Aussi, par son agriculture, par son trafic, par son industrie, l'Aquitaine était déjà, au II ème siècle, la rivale de la Narbonnaise. Plus tard, sous le bas-empire, sa prospérité ne fera que grandir. Sa situation la tenait à l'écart des guerres civiles et des incursions ennemies. Dans les derniers temps du monde romain, elle a été le refuge du bien-être antique, du beau langage, de la rhétorique latine et de la paix romaine. C'était alors le pays aux grandes villes, aux brillantes cultures, la « joyeuse Aquitaine », comme disait son poète Ausone. C'était, à ce que montre Ammien Marcellin, un pays comme reluisant de santé et de fraîcheur. Un prêtre chrétien, Salvien, décrivait ainsi l'Aquitaine dans un langage imagé : « Elle possède la mamelle de toute fécondité, du plaisir, de la beauté. Elle est si merveilleusement entrelacée de vignes, fleurie de prés, émaillée de cultures, garnie de fruits, charmée par ses bois, rafraîchie par ses fontaines, sillonnée de fleuves, hérissée de moissons, que les maîtres du pays semblent détenir moins une portion de la terre qu'une image du paradis. »
Sans être aussi célébrée au II ème siècle, l'Aquitaine était alors un pays de fécond travail. Ses grandes villes étaient toutes des centres industriels ou des métropoles commerciales de premier ordre. Sur les bords de l'Océan, les marais de la Saintonge et du Poitou, sur les pentes des montagnes, les bois du Rouergue et du Limousin reculaient peu à peu devant le labeur continu des sénateurs gallo-romains et de leurs armées de colons.
2. Augustonémétum et les Arvernes. — La ville que nous appelons aujourd'hui Clermont se nommait alors Augustonemetum, c'est-à-dire, en langue celtique, le « temple » ou le « bois sacré ». Le chef-lieu des Arvernes était en effet pour la Gaule une sorte de cité sainte, mais où le culte des dieux tenait infiniment plus de place que le souvenir des héros.
L'Auvergne avait été le centre de la résistance aux Romains : au II ème et au Ier siècle, c'étaient deux chefs arvernes, Bituit et Vercingétorix, qui avaient dirigé la guerre de l'indépendance, et il n'est pas douteux qu'en ce temps-là les Arvernes n'aient possédé le principal de toute la Gaule , échappé des mains de leurs voisins les Bituriges. Non loin de Clermont s'élevait Gergovie, où avait failli se briser la force de Jules César.
Sur les hauteurs de la montagne sainte, le Puy de Dôme, les Arvernes avaient élevés à Mercure, le grand dieu gaulois, le temple le plus riche de la Gaule. « C'était, dit un écrivain gallo-romain, un édifice admirable et solide, dont les murs étaient doubles, ils étaient bâtis en dedans avec de petites pierres, en dehors avec de grandes pierres carrés, et avaient trente pieds d'épaisseur. Dans l'intérieur, le marbre se mêlaient aux mosaïques, le pavé était de marbre et la couverture de plomb. » Si grandes étaient les richesses amoncelées dans le trésor du dieu, statues, bijoux et pierreries, que le temple fut au III ème siècle, le pont de mire des convoitises barbares, comme au IX ème siècle, la basilique de Saint-Martin de Tours était le grand désir des pirates normands.
Les mêmes Arvernes avaient fait venir le plus illustre des sculpteurs et fondeurs en bronze, le Grec Zénodore, et ils lui avaient commandé une statue monumentale du dieu Mercure. Pline nous rapporte qu'elle coûta 40 millions de sesterces, dix ans de travail, et qu'elle était le plus gigantesque colosse qu'on ait vu de son temps. Il est certain que la cité des Arvernes a été extraordinairement riche dans les premiers temps de l'empire, et riche précisément en espèces monnayées, ce qui faisait le plus souvent défaut aux villes romaines qui sait si cette richesse ne venait pas des immenses butins faits par les Arvernes dans leurs courses vagabondes et accumulés dans leurs trésors pendant des générations ?
Après avoir dominé la Gaule par la force de leurs armes et les liens de leur clientèle, ils la dominaient encore par leurs richesses et leur prestige religieux. Dans leur temple de Mercure, les ex-voto et les respects arrivaient de tous les points de la Gaule , même peut-être du monde romain. Car les Romains venaient chez les Arvernes rendre hommage au Mercure gaulois, comme ils avaient adoré Apollon à Délos, consulté la Pythie à Delphes et écouté Sérapis en Egypte. Ils montraient par là qu'ils ne craignaient pas les souvenirs de l'indépendance que ce culte pouvait entretenir. Et de fait, une fois soumis, les Arvernes, auxquels on donnait le titre de « cité libre », paraissent ne plus s'inquiéter que de leur rôle religieux. Par ses souvenirs, par son nom, par son temple, Augustonémétum était ainsi le sanctuaire moral et divin de la Gaule celtique, comme Tours fut celui de la Gaule chrétienne, avec ses reliques et sa basilique de Saint-Martin.
3. Le territoire arverne : la Limagne. — Ce qui avait fait encore la grandeur des Arvernes, c'est qu'ils dominaient directement sur le plus vaste territoire qu'ait eu une nation gauloise; d'eux dépendaient les pays du Velay, du Gévaudan, du Quercy, peut-être aussi du Rouergue. Ils commandaient des bords de la Loire à ceux de la Garonne et aux Cévennes. Les Romains avaient réduit leurs domaines à ce qui formera l'Auvergne propre mais le pays qui leur restait avait, par sa fertilité, une inestimable valeur.
Quand on quittait Augustonemetum pour descendre la vallée de l'Allier, on traversait cette admirable Limagne, aussi célèbre autrefois qu'elle l'est de nos jours. Peut-être même son renom fut-il jadis plus étendu et sa fertilité plus grande. On sait avec quel acharnement les Germains se la sont disputée. « C'est un territoire, dira Sidoine Apollinaire, d'un agrément tout particulier: c'est une vraie mer de moissons, dont les vagues s'inclinent et se redressent sans danger ; pour les voyageurs, tout est charmant pour les laboureurs, tout est fertile, pour les chasseurs, tout est divertissant. Des pâturages entourent la croupe des monts, les vignobles en abritent les flancs, les villas s'élèvent dans les terres, les châteaux dominent les rochers : des repaires dans les bois sombres, des cultures à ciel ouvert, des sources dans les replis du sol, des fleuves dans les escarpements. Les étrangers voient tout cela, admirent, et se persuadent souvent d'oublier leur patrie. » On comprend l'exclamation de Childebert : « Quand verrai-je cette belle Limagne? » Et l'on s'explique le discours de Thierry à ses soldats en les menant en Auvergne : « Suivez-moi, et je vous conduirai dans un pays où vous trouverez de l'argent autant que vous pouvez en désirer, où vous prendrez en abondance des troupeaux, des esclaves et des vêtements ».
Il est un fait qu'on ne peut s'empêcher de rappeler à ce propos. De toutes les régions de la Gaule romaine, l'Auvergne est celle qui opposa aux Goths et aux Francs la plus sérieuse et la plus belle résistance, Elle a seule défendu l'empire qui l'avait abandonné, son histoire, au V ème et au VI ème siècle, est, comme l'a si bien dit Michelet, « celle de la dernière province romaine ». Ainsi, la dernière lutte pour l'indépendance romaine s'est livré dans le même pays que la dernière lutte pour l'indépendance gauloise : les Arvernes ont eu, dans l'histoire de l'ancienne Gaule, le génie de la résistance à l'étranger.
4. De Bourges à Poitiers. – En descendant le cours de l'Allier, on rencontrait Vichy dont les eaux chaudes étaient alors les plus fréquentées de toute la Gaule puis on quittait l'Auvergne pour entrer dans le pays des Bituriges. Toute cette région est évidement le vrai centre historique de l'ancienne Gaule. Avant les Arvernes, les Bituriges avaient commandés à toute la Gaule , leur capitale, Avaricum , aujourd'hui Bourges, avait été, au temps de l'indépendance, la ville la plus riche presque du monde gaulois et peut-être la seule grande ville dont il ait jamais pu être fier. Bien des dépouilles de l'étranger avaient été amassés dans la cité d'Avaricum. Mais elle était fort déchue de son antique éclat.
Bourges n'était plus qu'une assez grande ville industrielle : on y travaillait le fer, l'étain et le cuivre, la contrée du Berry était le centre métallurgique le plus important de la Gaule , un peu ce qu'est aujourd'hui, tout près de là, le pays du Creusot. Il est probable aussi que Bourges était une ville de commerce : elle était à égale distance des vallées de la Seine et de la Garonne , et en particulier des métropoles commerciales de Trêves et de Bordeaux, la route la plus directe d'Espagne en Germanie s'y croisait avec celle de Lyon à la Loire. Comme Vierzon aujourd'hui, Bourges était le principal lieu de croisement des grandes voies du centre.
Une route monotone menait de Bourges chez les Pictons. Poitiers était un séjour assez agréable ; la ville était ornée de beaux monuments, on y avait le sens des arts, les environs étaient riches, cultivés, couverts de villas grandioses. Peut-être Poitiers était-elle une résidence ou une retraite goûtée des fonctionnaires romains.
La nation des Pictons offrait une particularité intéressante : c'est qu'ils formaient en ce moment la cité la plus vaste de la Gaule. Leurs vastes domaines s'étendaient des bords de la Vienne jusqu'à ceux de l'Océan.
L'Aquitaine était d'ailleurs la région par excellence des grandes peuplades. Les moins importantes avaient été démembrées de l'Arvernie primitive. Les Arvernes, les Bituriges, les Pictons dominaient à eux trois tout le bassin méridional du fleuve, depuis sa source jusqu'à son embouchure. Les Lémovices tenaient la Marche et le Limousin; les Santons avaient pour eux seuls toute la vallée de la Charente. Ces cinq cités réunies possédaient plus d'un sixième de la Gaule. On comprend quelle puissance les Santons, les Bituriges et les Arvernes ont pu exercer en Gaule au temps de l'indépendance et au premier siècle de l'Empire.
 Ruines gallo-romaines à Samxay (Poitou)/
Ruines gallo-romaines à Samxay (Poitou)/
Si les Pictons et les Lémovices ont joué un rôle moins glorieux, c'est que leurs domaines étaient en partie fort déserts; il y avait tant de terres à conquérir chez eux sur la nature : chez les Limousins sur les forêts, chez les Pictons sur les marécages. Dans les trois autres grandes cités, au contraire, la population était nombreuse et les cultures tassées.
5. Saintes. — De ces grandes peuplades, la plus prospère et la plus en faveur auprès de l'Etat romain était sans contredit celle des Santons. Peut-être lui avait-elle rendu, dans les temps de lutte, quelques-uns de ces bons offices que les vainqueurs n'oublient pas. Ils ont dû jouer dans le Sud-Ouest la même partie que les Eduens au centre.
On arrivait à Saintes en suivant une belle route, tracée à travers des cultures toutes jeunes, un pays pour ainsi dire neuf encore. Les nobles Santons, l'aristocratie peut-être la plus forte et la plus riche de l'ancienne Gaule, avaient oublié leurs traditions de turbulence. Ils s'étaient assouplis sous les lois de Rome. Ils acceptaient d'elle de grands commandements aux frontières puis ils se retiraient sur leurs terres, devenaient volontiers agriculteurs, faisaient la conquête de leur sol; pour eux s'élevèrent ces vastes villas de la Saintonge , qui s'étageaient sur les pentes des collines de l'Angoumois. Epris des manières romaines, ils y voulurent des thermes, des châteaux d'eau, parfois même des théâtres. Quelques-unes de ces villas, semblables au Tivoli de l'empereur Hadrien, étaient grandes comme des villes, et leurs ruines donnent aujourd'hui l'illusion de cités disparues. Si l'on voulait faire l'histoire de l'aristocratie gauloise, c'est en Saintonge qu'on pourrait le mieux saisir la manière dont elle s'est transformée, échangeant son indépendance politique contre le service aux armées romaines et les devoirs de la vie municipale.
Saintes, au Ier siècle, avait été la plus grande et la plus vivante des cités de l'Aquitaine. Il paraît certain que la famille de Drusus et de Germanicus eut pour elle une affection toute particulière et qu'elle y fut aussi fort populaire : il est probable que les nobles santons ont rendus à ces princes de très grands services dans leur guerre de Germanie. Une bourgade du pays porte le nom de Germanicus. A l'entrée de Saintes se dresse encore l'arc de triomphe qui lui fut élevé (il est vrai qu'on l'a changé de place à l'époque moderne en le transportant pierre par pierre).
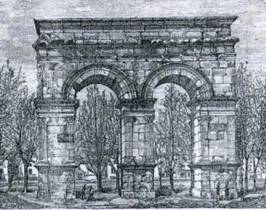 L'arc de Germanicus, à Saintes.
L'arc de Germanicus, à Saintes.
Saintes est de toutes les villes de l'Ouest, celle où il y a le plus de ruines romaines. Elle avait de fort beaux thermes et des arènes de dimensions colossales. Son amphithéâtre date du règne de Tibère ou de celui de Claude tandis que les villes voisines n'auront le leur qu'au II ème ou III ème siècle. Il y a dans toutes ces constructions de Saintes des analogies visibles avec celles que les princes de la même famille ont élevées à Trèves. Il semble évident qu'ils ont voulus faire de Saintes le centre de l'Aquitaine et comme le Lyon de la Gaule occidentale, un foyer de rayonnement des idées romaines. N'eut-elle pas son Capitole ?
C'était, en outre, une ville fort commerçante et plus encore industrielle : les draps de laine de ses manufactures étaient presque aussi célèbres que ceux d'Arras. Encore ne peut-on tout dire sur le rôle et l'importance de Saintes au Ier siècle : son sol, si riche en débris, nous réserve de grandes surprises et plus d'un nouvel enseignement.
Mais au II ème siècle, Saintes, comme tant de villes créées par les premiers empereurs, voyait la décadence commencer pour elle. C'était alors le jour de Bordeaux.
6. Bordeaux. — La route de Saintes à Bordeaux atteignait la Gironde à Blaye. C'était la voie la plus fréquentée de tout l'Occident gaulois. Il y avait entre ces deux grandes villes un passage continu d'hommes et de marchandises. C'est par cette route qu'arrivaient, du Nord et du Centre, les denrées et les produits qu'attiraient les avantages des entrepôts bordelais. Presque tous les monuments de Bordeaux, édifices publics et privés, ont été construits en pierres de taille des environs de Saintes. Tout cela, transporté en chariot jusqu'à Blaye, y était souvent embarqué pour Bordeaux. Aussi la Gironde présentait-elle, entre Blaye et Bordeaux, un aspect mouvant et pittoresque. Il fallait voir surtout le coup d'œil qu'elle offrait à marée basse, lorsque tous ces vaisseaux, les voiles déployées, immobiles, groupés comme une flotte, attendaient le retour du flot qui devait les porter vers la grande ville.
Enfin on arrivait à Bordeaux, qui surgissait tout à coup, avec ses temples et ses thermes, comme un îlot perdu au beau milieu des marécages et à la lisière des grands bois de pins.
Bordeaux, au II ème siècle, était en pleine activité. Il ne brillait encore ni par la grandeur de ses édifices ni par l'éclat littéraire; il n'avait ni amphithéâtre ni beau temple, ni poètes ni école. Mais c'était une ville de grand trafic, un entrepôt de premier ordre, une foire permanente. On y venait de tous les points de la Gaule , des bords du Rhin, du Doubs et de la Loire ; les aciers et les huiles de l'Espagne s'y échangeaient avec les laines de la Belgique ou le lin du Quercy. Les marchands de Trêves avaient à Bordeaux des représentants nombreux. Comme Lyon, Bordeaux possédait toute une colonie d'Orientaux, et le grec y était une langue assez répandue. Ville de bruit, de travail et aussi de prétentions et de dépenses, on y affichait un luxe de parvenus, et de parvenus hâbleurs et sans goût : Martial applique quelque part aux Bordelais l'épithète de « lourdaud », crassus.
Tout cela se modifiera avec le temps. Le goût des Bordelais s'affinera, et les descendants des marchands grossiers deviendront des gens de tact et d'esprit, amoureux d'art et de beau langage. Il y aura changement complet dans la physionomie bordelaise. Où Martial dit : « lourdaud », crassus, on dira plus tard : « brillant », nitens. À la fin du II ème siècle, on commence à faire de cette ville de négoce une vraie capitale, dans le genre de Lyon ou d'Arles. On y élève des monuments aux proportions gigantesques, et qui rappelleront en Occident les temples contemporains des provinces orientales de Baalbek, de Bostra, de Palmyre : c'est, avec moins de proportion et de fini, le même style grandiose et imposant. Le temple de Tutelle, à Bordeaux, fut le type achevé de l'art des Sévères, avec ses dimensions démesurées, son air superbe et lourd.
Au III ème siècle, Bordeaux grandira encore, grâce peut-être à la faveur des empereurs gallo-romains : on le dotera d'un amphithéâtre. Au IV ème siècle, ruiné dans son commerce il échangera, comme avait fait Marseille après sa chute, le culte de Mercure pour celui des Muses : il aura son école, ses poètes, ses rhéteurs, il remplacera la richesse que donne le négoce par le prestige de l'enseignement et des lettres. Il fournira à la Gaule son plus grand poète, Ausone, à l'empire romain ses derniers rhéteurs. Comme la ville d'Arles sur les bords du Rhône, Bordeaux sera en Occident le dernier champion des traditions romaines.
7. La vallée de la Garonne. – C'était en effet, pour les lettrés et les professeurs de Rome, un aimable asile que la vallée de la Garonne , si riche, si bien soignée, si variée d'aspects, si élégante de tons où la vie était ample et facile. De Bordeaux jusqu'à Toulouse, ce n'était que beaux et coquets domaines. Sur les coteaux qui bordaient la rivière, les prairies, le blé et les vignes ; à l'arrière plan, les bois épais de cyprès, de chênes, de lauriers et d'ormeaux, formant comme un mur d'ombre et de verdure ; sur les hauteurs, la villa avec ses statues, ses fontaines, les fresques de ses murailles.
 Porte de Diane, à Cahors.
Porte de Diane, à Cahors.
Que l'on observe de nos jours chacun de ces villages que l'on rencontre en remontant le fleuve, groupé autour de leur clocher dans un repli de terrain ou sur une colline encadrée de bois, nous devinons à les voir ce qu'une villa gallo- romaine, et comment on y pouvait goûter la paix et célébrer le bonheur.
Cette région de l'Aquitaine avait un autre attrait pour les Gallo-Romains, plus épris encore de bonne chère que de beaux paysages. Sur les rivages du Médoc, on nourrissait les huîtres les plus estimées de la Gaule , « grasses, douces, avec une légère saveur marine », et sur les bords du fleuve on récoltait le vin de Bordeaux, qui allait commencer une brillante carrière.
De villes, on ne rencontrait guère qu'Agen avant Toulouse. Encore Agen était-il une des plus petites et plus insignifiantes cités de l'Aquitaine. Assurément, les villas absorbaient, sur les bords du fleuve, la richesse et la vie : telle d'entre elles, comme celle du Mas-d'Agenais, présentait, par l'élégance et l'étendue de ses constructions, par la beauté de ses œuvres d'art, plus d'importance et d'agrément qu'Agen ou Bazas.
Il est, en effet, à remarquer comme les grandes villes se sont bâties en arrière de la Garonne : elle n'a pas, comme la Moselle , la Loire et le Rhône, son cortège de grandes cités. Au Sud, Bazas, Eauze, Auch, Lectoure s'alignent, loin du fleuve, sur les routes qui mènent de Bordeaux à Toulouse. Au Nord, c'est sur les plateaux qui fermaient le fond de la vallée que s'élevaient d'assez grandes villes industrielles : Périgueux, avec ses métallurgies, Cahors, avec ses fabriques de toiles, Rodez, avec les mines d'argent de ses montagnes, toutes trois étaient réunies par une route qui s'en allait rejoindre, à travers les Cévennes, Béziers et la voie Domitienne. De ces trois villes, Périgueux est la seule qui nous ait laissé de belles ruines, comme cette étrange tour de Vésone, qui rappelle le nom gaulois de la cité (Vesunna), et qui est sans doute le reste du temple de la Tutelle municipale.
8. Des Landes aux Pyrénées. — En quittant Bordeaux pour s'enfoncer vers le Sud, le paysage changeait dès le troisième mille après la cité. On était tout de suite au beau milieu des bois de pins, tristes, sombres, redoutés; de loin en loin, de vastes éclaircies, où l'on marchait dans le sable et la poussière qui aveuglaient le voyageur et lui faisaient craindre « de faire naufrage en pleine terre ».
Les peuples changeaient de caractère comme le sol. On ne trouvait plus, au sud de Bordeaux, de ces grandes nations aux territoires immenses et aux villes opulentes. Entre la Garonne et les Pyrénées, il y avait au moins neuf peuplades ou cités, et, sauf celle des Tarbelli, toutes n'avaient qu'un domaine fort restreint, le coude d'une rivière, une vallée des Pyrénées. Les habitants, énergiques, durs à la peine, un peu sombres et renfermés, différaient sensiblement des Gaulois : on comprenait qu'ils appartenaient à une autre race, voisine de celle qui peuplait l'Espagne. Ils aimaient à vivre chez eux, et ils avaient demandé, un jour, à l'État romain le droit de former un district séparé du reste de l'Aquitaine. Les empereurs y consentirent, et, sous le nom de Novempopulanie, le pays au sud de la Garonne forma une région distincte de la Gaule , ayant sa loi et ses chefs.
Dans la vallée de la Garonne et de l'Adour, on rencontrait encore d'assez belles villes. Lectoure surtout, la ville dévote, centre du culte de la Mère des dieux, Eauze, Auch, et, plus au sud, Dax, avec ses eaux thermales qu'essaya peut-être l'empereur Auguste. Puis, quand on se rapprochait des Pyrénées, les villes devenaient plus rares, plus petites; mais alors le paysage prenait un aspect pittoresque et émouvant, le voyage se transformait en vraie partie de plaisir. Il y avait plus de vie dans la région pyrénéenne que dans les Landes infertiles et monotones, on retrouvait à chaque pas de gracieuses villas et d'agréables villages. La civilisation romaine avait pénétré dans les plus profonds recoins du pays. Les stations balnéaires, Bagnères, Luchon, Cauterets, étaient connues et fréquentées des Gaulois, des Romains mêmes. Au II ème siècle, Luchon surtout était à la mode.
Mais le contact des étrangers n'avait point fait perdre à ces populations de montagne l'amour de leur isolement et du chez-soi, le culte de leurs traditions et de leurs souvenirs. Chacune de ces vallées appartenait à une nation différente. Elle y vivait à l'écart, parlant sans doute son patois, adorant en tout cas ses dieux. Chaque ruisseau, chaque vallon, chaque sommet, chaque groupe d'arbres séculaires continuait à avoir sa divinité ou son Génie, au nom bizarre et au caractère plus bizarre encore; n'oublions pas les dieux des vents et des tempêtes, qu'on priait un peu partout dans ces montagnes. Nulle part en Gaule les divinités indigènes n'ont été plus vivaces, le patriotisme local plus tenace que dans les Pyrénées. A voir ces peuplades et ces dieux, si nombreux et si isolés, on devinait le voisinage de l'Espagne, le pays du morcellement de la religion et de la patrie.
CHAPITRE XXIV
LA PATRIE GALLO-ROMAINE
1. L 'unité de la Gaule romaine. — La Gaule fut, au contraire, le pays par excellence de l'unité. Que l'on compare la Gaule aux différentes provinces de l'empire romain : elle a, plus que toutes les autres, un caractère original; elle est demeurée le plus longtemps semblable à elle-même; c'est la Gaule qui est, dans le monde romain, la personnalité la plus marquante.
Et d'abord, il n'y a pas de région qui soit aussi bien faite : qu'on se rappelle les paroles de Strabon. L'Espagne et l'Italie ont assurément des frontières mieux arrêtées; mais elles n'ont pas de centre naturel, leurs provinces n'ont pas de solidarité physique : chacune est isolée et vit de sa vie à part. Il n'y a nul rapport entre la Galice et la Bétique , la Calabre et l'Istrie. En Gaule, toutes les provinces convergeaient vers un point commun. Le pays était fait pour l'unité ; il n'y a pas d'existence individuelle, de province qui se tienne a l'écart; la même vie circule partout, de Dax à Boulogne et d'Antibes à Rennes.
Aussi est-ce la seule des grandes régions de l'empire à laquelle les Romains aient donné une vraie capitale, Lyon, et il n'y a nulle part une assemblée provinciale aussi puissante, aussi compacte, ayant un caractère aussi national que le Conseil des Gaules à Lyon.
Il est bien vrai qu'à cette assemblée ne ressortissent que trois des grandes provinces gauloises : la Gaule Narbonnaise échappait à la suprématie politique de Lyon, En fait, cependant, Lyon pouvait être regardé comme sa métropole, la Gaule du Sud subissait son influence au moins autant que les autres provinces. La colonie de Plancus ne commandait-elle pas le fleuve autour duquel la province narbonnaise s'était formée et qui était la principale voie de son commerce ? Lyon est la tête de ligne du Rhône et comme le correspondant commercial d'Arles et de Narbonne, il avait certes plus de relations avec ces deux villes qu'avec Reims, Trêves ou Bordeaux. Lyon, c'est le trait d'union entre l'antique Narbonnaise et la nouvelle Gaule. Ne peut-on pas dire jusqu'à un certain point que les idées et les mœurs de Rome, après s'être épanouies dans les colonies du Sud, allaient se concentrer à Lyon, pour rayonner de là clans les trois provinces de la Gaule propre?
On a vu comment Lyon perdit au III ème siècle ce rôle de capitale. L'unité de la Gaule semble rompue vers l'an 300, la grande division historique entre la Gaule du Nord et la Gaule du Sud s'annonce peu à peu. Il y a deux diocèses, séparés par le cours de la Loire , renfermant chacun deux des anciennes provinces; il y a deux capitales, Trêves et Arles. L'interrègne commence entre la suprématie de Lyon et la domination de Paris.
Mais il serait impossible de constater entre ces deux régions, en ce temps-là, le moindre vestige d'hostilité ou d'opposition. Il n'y a encore qu'un esprit gaulois; quand la Gaule se donne un empereur, tous les Gaulois se rangent autour de lui. Jamais même l'individualité de la Gaule n'a mieux été en évidence dans le monde romain. Qu'on lise les écrivains du bas-empire, Julien, Ammien Marcellin, Ausone, Claudien, Zosime, et l'on verra comme aux yeux des contemporains la Gaule formait un État homogène et compact. C'est elle, dans ces derniers jours de Rome, qui allait lui rendre le plus de services et tenir dans son histoire la plus belle place. Elle est visiblement demeurée, grâce à son unité, la nation la plus solide, la plus personnelle, de l'empire affaibli. Elle le sait et elle en est fière. Ses soldats ne combattent point volontiers loin de leur Gaule : il y a chez eux un attachement tenace au sol qu'ils défendent. Quand au IV ème siècle on disait « les Gaulois », le mot ne désignait pas seulement les citoyens des provinces gauloises; il n'était pas, comme le terme d'Espagnols, d'Africains ou d'Illyriens, une expression de géographie administrative : on entendait par là une nation originale, forte et sympathique.
2. De la persistance de la nation celtique. — C'est qu'en effet il était bien peu de nations occidentales dont le sang fût demeuré aussi pur de mélange romain. De colonies, romaines ou italiennes, il n'y en a que dans les vallées de l'Aude, du Rhône et de la Moselle ; encore, si elles y ont été assez nombreuses, ne furent-elles pas très fortes, et le contingent de colons amenés à l'origine ne fut peut-être jamais renouvelé. C'est à trente mille au plus que l'on peut évaluer le nombre de colons établis par César et Auguste, en dehors, bien entendu, des provinces de Germanie. Qu'on double et qu'on triple ce chiffre, si l'on veut, qu'on y ajoute les négociants, les industriels, les fonctionnaires, les esclaves : cela ne fera jamais une immigration notable, comparable à celle que les Amériques reçoivent de nos jours et qui ait pu modifier le sang et le caractère d'une nation. Les émigrants italiens se portaient plus volontiers ailleurs, soit vers le Danube, soit surtout dans cette Afrique carthaginoise qui leur dut en partie sa renaissance. Qu'on se rappelle encore qu'il n'y eut entre les Cévennes, les Pyrénées et la Marne aucune colonie romaine, que les négociants étrangers n'habitaient que les plus grandes villes, et l'on ne pourra s'empêcher de croire à la persistance de la nation celtique. On a, en lisant les inscriptions de la Gaule propre, l'impression d'un peuple qui a voulu devenir romain, mais qui n'a été ni contraint par la force ni entraîné par des alliances à une fusion complète avec la nation maîtresse. La civilisation romaine ne lui a point fait perdre son caractère primitif,
3. L 'esprit d'indépendance politique chez les Gaulois. — D'abord, si fidèle qu'elle fût à l'État romain, la nation gauloise était par nature une nation d'opposants, de faiseurs de révolutions. Amédée Thierry l'a bien remarqué : « Le rôle que joua la Gaule comme province de l'empire romain est plein de grandeur et d'intérêt. Son besoin de mouvement et de liberté s'exerça dans les limites de la constitution et des coutumes romaines : il prit le caractère d'opposition, non de révolte. »
C'est de la Gaule qu'est partie sous le règne de Néron la première insurrection romaine contre un empereur; dans les années néfastes qui suivirent, les deux plus dangereux soulèvements que la domination romaine ait eu à comprimer sont ceux de cités gauloises et de l'irréductible Judée.
Cent cinquante ans plus tard, quand le monde se disloque, l'empire provincial le plus solide et le plus durable a été l'empire gallo-romain de Postume et de Tétricus ; il est digne de remarque que dans ces années d'anarchie, c'est cet empire qui a le plus servi la cause romaine, et qui en même temps a su le mieux vivre détaché de l'unité latine, s'est le plus complètement suffi à lui-même.
Au IV ème siècle, il faudra toujours à la Gaule un empereur pour elle seule. « Comme elle est fort grande, disait un écrivain naïf, il lui faut toujours un prince », cum maxima sit imperatore semper eget « maintenant elle en a pris un chez elle », ajoutait-il en parlant de quelque César gallo-romain du IV ème siècle. Elle se crée en effet un César à chaque génération, Magnence, Sylvain, Julien, Eugène, Constantin et bien d'autres. Si elle n'en fait pas, c'est que l'Etat lui en donne un pour elle, Constance Chlore, Julien ; ou c'est que les empereurs, cédant aux besoins de la Gaule , résident au milieu d'elle, à Arles ou à Trêves. Il était permis à la Gaule , au IV ème siècle, de se croire le centre de l'empire d'Occident.
Cette fierté politique et cette turbulence avaient frappé les anciens. Un écrivain de la fin du III ème siècle avait caractérisé en ces termes les Gaulois : « II est dans leur nature de ne pouvoir supporter les princes frivoles et indignes de la Vertu romaine ou livrés à la débauche ». Ils gardaient, plus que les Romains, l'orgueil de la Vertu romaine, et passaient pour rebelles à toute misérable tyrannie. Mais ils avaient les défauts de leurs qualités, et on leur reprochait leur goût pour les révolutions : ils étaient « amoureux de nouveautés politiques », cupidi rerum novarum, ce qui était assurément un très grave reproche dans la bouche des Romains, si fidèles aux traditions.
4. Le goût des Gaulois pour la guerre et la rhétorique. — Le génie de leur nation se manifestait d'une autre manière sous la domination romaine. Ils aimaient à parler et ils aimaient à se battre: c'était leur réputation d'autrefois; ils la gardèrent intacte jusqu'au jour de l'invasion. Mais ces deux qualités, ils les mirent au service de l'empire.
Le Gaulois a toujours eu l'orgueil de bien parler : l'empire offrit une ample matière à ses talents oratoires. Les Gaulois devinrent les vrais rhéteurs de Rome. Nous les avons vus pénétrer au barreau latin dès le Ier siècle, et, au IV ème, revendiquer l'art de la rhétorique comme l'apanage de leurs écoles.
Ils remplissent les armées comme les tribunaux. Ce sont les provinces de Gaule qui enverront le plus longtemps des soldats à l'empire; ce sont elles qui lui en fourniront le plus avec l'Illyrie. Les Italiens ne savent plus se battre ; l'Espagne s'alanguit dans la mollesse, l'Afrique, laborieuse aux champs et démagogue dans les cités, n'aime pas la discipline des camps : les Illyriens pendant deux siècles, les Gaulois pendant tout l'empire, sont les véritables soldats de Rome. C'est sur le Rhin qu'on se bat le plus et le mieux; et quand, dans les derniers jours de l'empire, les princes veulent des soldats qui ne reculent point et qui ne soient pas des barbares, c'est à la Gaule qu'ils les demandent. « C'est le pays des hommes forts et fameux à la guerre », dit un géographe du IV ème siècle.
Les Gaulois sont donc devenus les meilleurs soldats et les meilleurs rhéteurs de Rome. Or voilà ce qui tout de suite les met au premier rang parmi les vrais Romains; aucun peuple n'a mieux collaboré à l'œuvre de Rome que le peuple gaulois : car c'est par la rhétorique et par les armes que Rome a créé et qu'elle a maintenu son empire.
5. Ce que les Gaulois ont reçu de Rome. — Révolutionnaires, éloquents, batailleurs, et dans tout cela, agités et passionnés d'abord, voilà ce qu'étaient les Gaulois au temps de Vercingétorix ; voilà ce qu'ils étaient encore au temps de Julien, Mais cela ne les empêcha point de plier leur esprit aux mœurs de Rome. On remarquait déjà, un siècle avant l'ère chrétienne, leur intelligence souple, éveillée, curieuse de toutes choses : ils l'ont appliquée à suivre les leçons de la civilisation romaine. En même temps qu'ils obéissaient aux lois, ils acceptaient l'éducation latine, au forum et dans la maison.
Pendant longtemps il y aura encore des noms gaulois dans les familles; mais, dès le premier jour de la conquête, nous trouvons à côté de ces noms, dans la même maison, des noms romains : un père donne volontiers à l'un de ses fils un nom gaulois, à l'autre, un nom romain, opérant ainsi chez lui, dans sa famille, l'union fraternelle des deux patries.
Le latin, on l'enseigne dans les écoles, on le parle dans les villes. La littérature est romaine : plus de poésies gauloises; la langue celtique est réduite au rang de patois. L'art vient de Rome ou de la Grèce que Rome enseigne à connaître. L'administration des villes se transforme sur le modèle de celle de Rome. Qu'on pénètre dans une cité gauloise : le magistrat s'appelle duumvir, juge ou édile; il y a un sénat qui délibère en latin ; les temples sont imités de ceux de Rome : les statues de dieux, copiées sur des modèles italiens; les harangues publiques et les conférences se font en latin, les unes à la manière de Cicéron, les autres à la façon de Quintilien; c'est en latin qu'on prie dans les temples, même les dieux qu'on dit être d'origine celtique ; en latin encore sont les affiches des rues, les inscriptions des cimetières. Tous ces hommes sont bien des Gaulois; mais, dans la rue, au forum, au temple, à leur foyer, ils vivent à la romaine, et, quand ils seront morts, leurs mânes seront encore des dieux à la façon romaine.
6. Les Gaulois continuent l'œuvre de Rome . — Cette civilisation, les Gaulois l'aimaient et en tiraient vanité. Nous avons vu qu'ils étaient les gardiens jaloux de la « Vertu romaine ». Quand l'empire tombera, ils conserveront tout ce qu'ils ont reçu de lui. L'impulsion donnée fut telle que, l'empire disparu, la Gaule achèvera de devenir romaine : l'invasion n'arrête ni ne ralentit même les progrès de sa transformation.
Il y a plus. Les meilleurs Romains, au IV ème siècle, sont les Gaulois. On a vu pourquoi : ils étaient rhéteurs et ils étaient soldats. Le boulevard de l'empire, en ce temps-là, est la Gaule. C'est elle qui protège l'Italie : Arles et Trêves sont les avant-postes de Milan et de Rome. C'est en Gaule que se décide le sort de l'empire d'Occident. Au V ème siècle, quand il sera tombé, c'est en Gaule que la vie romaine est le plus intense. Il y a encore des écoles et des rhéteurs en Aquitaine. Le Gaulois Sidoine Apollinaire est un vrai Romain d'esprit et de cœur. Dans le haut moyen âge, c'est la Gaule qui conservera au monde les usages de Rome, son droit, ses arts, ses lettres. « La noble et intelligente race qui l'habite, a dit Amédée Thierry, est la dernière à soutenir le nom romain en Occident. C'est à elle que, dans le déluge de de la Barbarie, la Providence confie le dépôt de la civilisation qui s'éteint, avec le devoir de la rendre plus tard au monde. » A son tour, la Gaule répandra autour d'elle les leçons qu'elle a reçues, et continuera en Germanie l'œuvre que Rome a accomplie chez elle. C'est en Gaule enfin que se réveillera au VIII ème siècle le nom romain, par la renaissance des lettres latines et par la restauration de l'empire.
Nous avons vu qu'une partie de l'héritage de Rome est venue à l'Église chrétienne : la Gaule a gardé le reste.
7. Le patriotisme romain en Gaule. — Aussi nulle part la patrie romaine n'a été plus longtemps aimée et plus dignement célébrée que dans les Gaules. Qu'on lise les œuvres des poètes et des rhéteurs gaulois, d'Eumène, d'Ausone, de Rutilius, de Sidoine : tous ces hommes ont un patriotisme d'une incroyable énergie. Ils croient à l'unité de l'empire alors qu'il est morcelé, à son éternité quand il n'est déjà plus que l'ombre d'un nom.
C'est un Gaulois, Rutilius Namatianus, qui, vers l'an 418 de notre ère, a écrit les plus beaux vers que l'œuvre de Rome ait jamais inspirés: « Écoute, toi la plus belle reine du monde qui est à toi, Rome, mise au rang des dieux, mère des hommes et mère des divinités. Quand nous sommes dans tes temples, nous sommes près du ciel. Nous te chantons et te chanterons, tant que les destins le permettront. Nul vivant ne peut t'oublier. Le soleil disparaîtrait plutôt de notre souvenir que ton culte de notre cœur. Tes bienfaits ne sont-ils pas égaux aux rayons du soleil, et ne s'étendent-ils point partout où l'Océan agile ses ondes près du rivage? C'est pour toi que Phébus, qui embrasse tout, accomplit sa course : il sort de chez toi et c'est chez toi qu'il ramène son char. Ni l'Afrique aux sables brûlants ne t'a retardée, ni l'Ourse glacée ne t'a fait reculer. Partout où la nature étend son domaine, partout s'est avancée la Vertu romaine. De races opposées tu as fait une seule patrie. Ceux-là mêmes qui se refusaient à obéir ont profité à le faire. Aux vaincus tu as offert le partage de tes droits. Autrefois il y avait un monde : tu en as fait une ville » :
Fecisti patriam diversis gentibus unam… Urbem fecisti quod prius orbis erat.
Et ce même Rutilius, au moment de quitter Rome, est ému de joie à l'idée de revoir bientôt sa Gaule, en ce moment triste et dévastée, et qui lui est, dit-il, d'autant plus chère qu'elle souffre davantage. Il rencontre un ami, Gaulois comme lui, et en l'embrassant, il lui semble déjà jouir d'une portion de sa patrie,
Dum videor patriae jam mihi parte frui.
Rutilius a donc deux patries, Rome et la Gaule , et il a pour elles le même amour. On peut en dire autant de tous les Gaulois : ils ont aimé Rome sans oublier la Gaule ; ils sont devenus Romains et ils sont demeurés fidèles à leur caractère national. Le Génie des Gaulois a su vivre dans la patrie romaine.
Fin