L’esclavage était un état pénible, surtout pour celui qui avait connu la liberté, mais non irrémédiable car l’esclave pouvait légalement secouer ses chaines. Il devenait (home ou femme) alors ce que les historiens ont appelé un affranchi, un être à mi-chemin de la servitude et de la citoyenneté, car avant il n’était qu’une chose,.
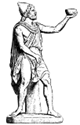
Celui-ci s’appuyait sur 5 formes :
1) Manumissio per vindicatum : le maitre devant un magistrat et son licteur devait donner un léger soufflet à l’esclave agenouillé en disant : « je veux que cet homme soit libre » en même temps, le licteur le touchait avec une baguette « vindicta ». La partie officielle et légale était due à la présence du magistrat.
2) Manumissio censu : le maître inscrivait l’esclave comme personne libre sur la liste des censeurs mais, alors, il fallait attendre cinq ans pour qu’ils officient durant leurs 18 mois de magistrature. Cette forme d’affranchissement n’exista plus avec sa disparition, en 65 après J.C.
3) Manumissio testamento : l’esclave trouvait sa liberté par la mort de son maitre qui avait écrit dans son testament sa volonté de le rendre libre.
4) Puis plus tard, il y eut la manumissio inter amicos par laquelle on déclarait qu’un esclave était libre par des paroles prononcées devant des amis.
5) Manumissio per mensam : le maître recevait l’esclave à sa table
Mais, seules les trois premières ont été largement utilisées.
Une fois affranchi, l’ancien esclave devait se coiffer du pileus (bonnet conique de type phrygien) qu’il était allé chercher dans le temple de la déesse Feronia. Ce chapeau était le symbole de la liberté, il était porté dans les premiers temps de Rome puis il disparut.

L’affranchi prenait le nom et le prénom de son ancien maître, son nom devenait son surnom (cognomen). Ainsi le secrétaire de Cicéron, une fois libéré de l’esclavage, devint Marcus Tullius Tiro. La société romaine ne va pas l’accepter facilement, il est souvent qualifier de servus (esclave) au début de la République et même par la suite (voir Cicéron dans ses « lettes à ses amis ») mais petit à petit le mot libertus va s’imposer. Il demeure un non citoyen, un être à mi chemin entre l’esclavage et la liberté totale. Seuls ses enfants deviendront des citoyens romains à part entière. Mais, souvent, leur ascendance n’était pas oublié, Horace, malgré la protection de Mécène, fut insulté par des jaloux qui l’attaquèrent sur sa naissance de fils d’affranchi. Tout devait changer quelques années plus tard, on vit des affranchis devenir des sénateurs et même un de leur fils accéder à l’empire : Pertinax était fils d’affranchi.
Le nouvel homme libre a de nombreux devoirs et obligations. Il doit le respect (obsequium) et l’obéissance totale à son ancien maître qui est devenu son patron, il lui doit aussi aide et assistance sous forme de travail obligatoire (operae), il ne peut être magistrat (jus honorum) quoique Tibère nomma un affranchi : préfet d’Egypte (c’est l’exception qui confirme la règle), il ne peut épouser une femme de naissance libre, la lex Julia de Adulteris, en 18 avant J.C., permit au patron de tuer son affranchi surpris en commerce illicite avec la femme de l’ancien maître. Il se retrouve dans la dernière classe de sa tribu, celle-ci est pratiquement toujours urbaine pour qu’il soit noyé dans la masse et ainsi selon les règles des élections romaines, il pouvait voter.
Après de longs débats, on finit par convenir qu'on tirerait publiquement au sort dans le temple de la Liberté une des quatre tribus de la ville dans laquelle devaient entrer tous ceux qui étaient sortis d'esclavage Tite Live, XLV, 15.
Il ne peut être prêtre sauf pour rendre un culte à l’empereur, les affranchis vont donc former une partie de la plèbe urbaine, il ne peut intenter une action en justice contre son ancien maître, en 24 après J.C., par la lex Visellia, les affranchis sont exclus des magistratures municipales auxquelles ils avaient accès jusqu’à maintenant et des conseils de décurions, J. César, en effet, les avait autorisé à remplir ces fonctions. L’affranchi ne peut être totalement libre que si son patron décède et qu’il n’a pas d’héritier. Pour continuer cette litanie, on va dire qu’il ne peut tester librement car à la fin de sa vie, son ancien maître va recevoir une partie de ses biens, cela va être fonction de nombre d’enfants que son ancien esclave a.
L’esclave peut se constituer peu à peu un pécule (peculium) en économisant, c’est-à-dire en accroissant son travail confié par le maître, il va être avec son accord, à la tête d’une certaine somme d’argent qui va lui servir à acheter sa liberté et au maître à acheter un autre esclave, souvent plus jeune et plus vigoureux que l’ancien qui est souvent devenu vieux bien que Cicéron ait dit qu’en 6 ans un esclave travailleur pouvait se racheter.
Il y eut quelques affranchis dans les campagnes mais la grosse majorité se retrouva dans les villes comme le montrent les inscriptions funéraires où, comme il a été dit, ils grossirent les rangs de la plèbe.

L’Empire voulut limiter les affranchissements. Ainsi la lex Aelia Sentia interdit tout acte libérateur d’un esclave de moins de 30 ans, quant au maître, il devait avoir au moins 20 ans. La lex Fufia limita le nombre de libération par testament, par exemple, il était interdit d’en libérer plus de 100. La lex Junia créa, sous l’empire, une sous-catégorie d’affranchis ; les « Latins Juniens » leur libération n’avait pas été faite suivant les règles de la loi mais avait un caractère privé. Ils étaient libres mais mouraient esclave, leurs biens revenaient en intégralité à leur maître, ils ne pouvaient désigner un héritier.
Pour augmenter le nombre des citoyens, Auguste les autorisa à épouser des femmes nées libres mais leur interdit de se marier avec des filles de sénateurs.
Un affranchissement, aux yeux de la loi, ne pouvait être annulé, et malgré ce que dit le texte, Claude ne put revenir sur l’acte.
Il confisqua les biens des affranchis qui se faisaient passer pour chevaliers romains. Il remit en servitude ceux qui étaient ingrats et dont les patrons avaient à se plaindre, déclarant à leurs avocats que, puisqu'ils prenaient leur défense, il ne leur rendrait pas justice contre leurs propres affranchis. Suétone, Claude, 25, 3.
L’Empire fut favorable à un tout petit nombre, certains d’entre eux rentrèrent dans l’ordre équestre, bien que théoriquement, ils ne le pussent. Il s’agit des affranchis impériaux qui exercèrent des tâches très importantes au service des premiers empereurs. Mais sous les Flavien, leur autorité et leur puissance va décroitre au profit des chevaliers qui vont peu à peu s’immiscer dans les allées du pouvoir. C’est ainsi que l’on va assister, selon les empereurs, à une occupation, pour un même poste, d’un chevalier ou d’un affranchi.
Comme on a pu le voir, l’affranchi avait un statut juridique propre, il forma une caste de la société romaine. D’une chose, d’un bien, l’esclave est devenu une personne.